Rechercher : les mots du spectacle en politique
Une enquête labyrinthique
 Lire, relire... Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, Philippe Rey / Jimsaan, 2021, Le Livre de Poche, 2023.
Lire, relire... Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, Philippe Rey / Jimsaan, 2021, Le Livre de Poche, 2023.
Prix Goncourt 2021
Au départ, il y a la parution, en 1938, d’un livre étonnant, foudroyant, un de ces livres « qui donnaient l’impression que plus rien n’était à ajouter », un livre dont l’auteur fut qualifié de « Rimbaud nègre » par un critique, avant d’être accusé d’imposture ou de plagiat, puisqu’on y avait décelé des reprises d’ouvrages antérieurs. Le labyrinthe de l’inhumain – tel est le titre du roman en question – est donc entouré de mystère, d’autant que l’auteur sénégalais, un certain T. C. Elimane, a disparu, et que les éditeurs du livre ont dû mettre la clé sous la porte.
Quatre-vingts ans plus tard, un jeune écrivain, Diégane Latyr Faye, sénégalais lui aussi, après avoir découvert et lu Le labyrinthe de l’inhumain et l’enquête qu’avait faite une journaliste sur cette publication, va se lancer sur les traces d’Elimane, traces littéraires, familiales, géographiques. C’est l’occasion pour lui de participer à des discussions passionnées avec de jeunes auteurs africains installés à Paris, de participer à « des joutes littéraires pieuses et saignantes » autour d’un livre qui « tenait de la cathédrale et de l’arène ». L’occasion aussi de rencontrer, directement ou indirectement, beaucoup de personnes qui ont connu T. C. Elimane, de près ou de loin, notamment la belle et expérimentée Siga, dont l’histoire familiale, entre Afrique et Europe, nous est contée en détail, ce qui permet de saisir un certain nombre d’éléments révélateurs à propos de l’énigmatique écrivain. Le récit nous emmène dans le temps à travers tout le XXème siècle et plusieurs événements qui l’ont jalonné (colonialisme et décolonisation, racisme et émigration, nazisme et Shoah…), et dans l’espace entre le Sénégal, la France et même l’Argentine – où Elimane poursuivait on ne sait quoi, on ne sait qui (les dernières pages donnent la réponse).
 Ainsi, La plus secrète mémoire des hommes est une enquête avec tout le suspense suscité par la narration, des morts mystérieuses, des brouilles familiales, des réconciliations, des pérégrinations et des tribulations, des aventures amoureuses et des surprises – et la vie peu à peu découverte d’Elimane en cache un certain nombre. Mais les recherches labyrinthiques de Diégane laissent apparaître aussi, et surtout, le caractère indispensable de la littérature, sa puissance fascinante, aussi fascinante, sinon plus, que le sort des humains, au point que des questions se posent sur les priorités : « Que pesait la question de l’écriture devant celle de la souffrance sociale ? La quête du livre essentiel devant l’aspiration à la dignité essentielle ? La littérature devant la politique ? » On ne peut évidemment tout reprendre des hypothèses, des questions que pose ce roman au style d’une grande originalité, d’une grande densité et d’une grande vivacité (Un exemple au hasard : « Il devait être six heures. Dans la salle d’attente du jour, les premiers bruits s’impatientaient. J’ignorais si on pouvait dire que la Médina se réveillait, vu qu’elle n’avait pas dormi, ou alors d’un œil. »). Impossible de rendre la teneur d’un récit aussi foisonnant. Retenons ce que, dès les premières pages, Stanislas, traducteur de son état et apparemment disciple de Flaubert, dit à son colocataire Diégane : « Un grand livre n’a pas de sujet et ne parle de rien, il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. » Il n’y a rien à ajouter.
Ainsi, La plus secrète mémoire des hommes est une enquête avec tout le suspense suscité par la narration, des morts mystérieuses, des brouilles familiales, des réconciliations, des pérégrinations et des tribulations, des aventures amoureuses et des surprises – et la vie peu à peu découverte d’Elimane en cache un certain nombre. Mais les recherches labyrinthiques de Diégane laissent apparaître aussi, et surtout, le caractère indispensable de la littérature, sa puissance fascinante, aussi fascinante, sinon plus, que le sort des humains, au point que des questions se posent sur les priorités : « Que pesait la question de l’écriture devant celle de la souffrance sociale ? La quête du livre essentiel devant l’aspiration à la dignité essentielle ? La littérature devant la politique ? » On ne peut évidemment tout reprendre des hypothèses, des questions que pose ce roman au style d’une grande originalité, d’une grande densité et d’une grande vivacité (Un exemple au hasard : « Il devait être six heures. Dans la salle d’attente du jour, les premiers bruits s’impatientaient. J’ignorais si on pouvait dire que la Médina se réveillait, vu qu’elle n’avait pas dormi, ou alors d’un œil. »). Impossible de rendre la teneur d’un récit aussi foisonnant. Retenons ce que, dès les premières pages, Stanislas, traducteur de son état et apparemment disciple de Flaubert, dit à son colocataire Diégane : « Un grand livre n’a pas de sujet et ne parle de rien, il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. » Il n’y a rien à ajouter.
Jean-Pierre Longre
www.facebook.com/Editions-Jimsaan-257846464392099
11/04/2023 | Lien permanent
Images de l’amertume
![Cioran-rebus[1].jpg](http://jplongre.hautetfort.com/media/00/01/36276569.jpg) Emil Cioran, Aphorismes traduits en rébus par Claude et Chris Ballaré, préface de Frédéric Schiffter, Finitude, 2009
Emil Cioran, Aphorismes traduits en rébus par Claude et Chris Ballaré, préface de Frédéric Schiffter, Finitude, 2009
Le rébus met en images non seulement les mots, mais aussi les sons. Créant des images, il crée d’autres mots, et le hasard, complété par l’imagination des auteurs, fait parfois admirablement les choses : inaugurer l’amertume (et le livre) avec une lame de rasoir, c’est une trouvaille… Bien sûr, une vache en train de meugler pour traduire la syllabe « me » ou un nœud pour traduire le « ne » illustrent la prédominance de l’image sur le son, de l’imagination sur la lettre ; et c’est tout le charme du rébus, surtout lorsque les objets qu’il donne à voir, comme ici, sont délicieusement kitsch.
 Pourquoi Cioran ? Sans doute parce que l’auteur du Précis de décomposition a le sens de la formule percutante ; mais il n’est pas le seul. Le goût des illustrateurs ? Sans doute. Alors on sent une accointance entre les suites de dessins souvent énigmatiques (bien que les objets pris séparément soient clairement identifiables) et les suites de mots, dont la construction vigoureuse et provocatrice ne peut laisser indifférent. Chaque objet, chaque mot, chaque son est d’une simplicité enfantine ; mis ensemble, ils se « décomposent » les uns les autres, et leurs combinaisons deviennent désespérément mystérieuses. L’œuvre est accomplie.
Pourquoi Cioran ? Sans doute parce que l’auteur du Précis de décomposition a le sens de la formule percutante ; mais il n’est pas le seul. Le goût des illustrateurs ? Sans doute. Alors on sent une accointance entre les suites de dessins souvent énigmatiques (bien que les objets pris séparément soient clairement identifiables) et les suites de mots, dont la construction vigoureuse et provocatrice ne peut laisser indifférent. Chaque objet, chaque mot, chaque son est d’une simplicité enfantine ; mis ensemble, ils se « décomposent » les uns les autres, et leurs combinaisons deviennent désespérément mystérieuses. L’œuvre est accomplie.
Jean-Pierre Longre
03/07/2010 | Lien permanent
Survivre ensemble
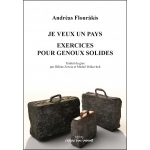 Andrèas Flouràkis, Je veux un pays, traduit du grec par Hélène Zervas, Exercices pour genoux solides, traduit de grec par Michel Volkovitch, préface d’Ekaterini Diamantakou, éditions L’espace d’un instant, 2020
Andrèas Flouràkis, Je veux un pays, traduit du grec par Hélène Zervas, Exercices pour genoux solides, traduit de grec par Michel Volkovitch, préface d’Ekaterini Diamantakou, éditions L’espace d’un instant, 2020
Andrèas Flouràkis, écrivain et homme de théâtre, est l’auteur de nombreuses pièces au rayonnement international. Les deux œuvres publiées dans ce volume sont de factures différentes, mais relèvent de préoccupations collectives et individuelles analogues : survivre à « la crise économique et migratoire » que la Grèce, l’Europe et le monde connaissent à notre époque. Ekaterini Diamantakou analyse parfaitement ces enjeux dans sa préface, « Une double recherche du pays ».
Pour Je veux un pays, les indications de l’auteur sont on ne peut plus simples, laissant toute latitude au metteur en scène : « Personnages : TOUS. Lieu : PAYS. » S’ensuit, sur plus de quarante pages, une série de courtes répliques qui se suivent et se répondent plus ou moins clairement, prononcées par un nombre indéterminé de personnages dont les gestes et les mouvements sont libres. Émigration, voyage sont au cœur des préoccupations, symbolisés par les valises apportées sur scène. « - Nous sommes arrivés au bord du gouffre. / - Il faut agir. / - Il n’y a pas de place pour nous ici. / - Il faut d’urgence trouver un autre pays. / - Émigrer ? » Résolution, rêves, désirs quasiment poétiques, prières contrecarrées, retours sur le passé, désillusions (« Ce pays qui est venu à la place du nôtre est à pleurer »), espoirs… Tout est théâtralement répertorié, tout peut (re)commencer : « Le commencement est la moitié de tout. »
Dans Exercices pour genoux solides, l’atmosphère est aussi différente que la structure. Quatre personnages (« La femme, L’homme, La jeune femme, Le jeune homme »), quatre lieux (« Bureau de la femme, Bureau de réception, Chambre du jeune homme, Chambre d’hôpital »). On passe très rapidement, sans crier gare, d’un lieu à l’autre, d’un dialogue à l’autre, dans une succession de trente-cinq scènes (ou plutôt séquences) parfois fort brèves. La femme, directrice de société, cherche à licencier l’un ou l’une de ses employés, et recourt pour cela à des procédés inavouables et sadiques, dont l’humiliation morale et physique, tout en cherchant à rééduquer son fils porté sur le fascisme et les jeux vidéo. Son absence se scrupules est total : « Mon chéri, l’argent n’a pas de frontières. Il n’a que des propriétaires. Nous virons des gens parce que nous pouvons le faire. Nous rognons les salaires puisque c’est possible. » Il faut donc avoir « les genoux solides » pour garder son emploi et sa place dans une société rongée par les inégalités, les rivalités, la course à la survie, mais aussi par les menaces politiques et les mystères que chacun recèle en soi.
Deux pièces « engagées », dira-t-on, mais dont l’engagement se nourrit d’une réflexion sans schématisation sur la complexité des âmes, des réactions et des destinées humaines, et s’exprime dans une poésie dramatique aux nombreuses ramifications.
Jean-Pierre Longre
Autres parutions récentes aux éditions L’espace d’un instant :
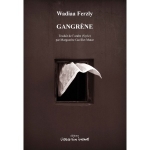 Wadiaa Ferzly, Gangrène, traduit de l'arabe (Syrie) par Marguerite Gavillet Matar, préface Marie Elias.
Wadiaa Ferzly, Gangrène, traduit de l'arabe (Syrie) par Marguerite Gavillet Matar, préface Marie Elias.
« Damas, 2015. Une famille « déplacée » loin des zones de combat. Loin de la maison qu’on a dû abandonner, mais que la mère continue à payer en cachette. Le mari qui perd son travail. Le fils qui sèche les cours, enchaîne les petits boulots et les humiliations. L’arbitraire, la corruption, les privations. La tension de la guerre imprègne le quotidien. La chaleur torride, les rires, les disputes. Et puis le drame. Telle la gangrène, la guerre a ravagé les corps et les âmes. Faut-il rester, s’accrocher à l’espoir de retourner un jour dans sa maison, ou s’endetter encore et prendre le dangereux chemin de l’exil ? Wadiaa Ferzly met en scène avec beaucoup de finesse et d’empathie la vie de ces Syriens victimes de la guerre. »
 Jeton Neziraj, Vol au-dessus du théâtre du Kosovo et Une pièce de théâtre avec quatre acteurs, avec quelques cochons, vaches, chevaux, un Premier ministre, une vache Milka, des inspecteurs locaux et internationaux, traduit de l'albanais (Kosovo) par Sébastien Gricourt et Evelyne Noygues, préface Patrick Penot.
Jeton Neziraj, Vol au-dessus du théâtre du Kosovo et Une pièce de théâtre avec quatre acteurs, avec quelques cochons, vaches, chevaux, un Premier ministre, une vache Milka, des inspecteurs locaux et internationaux, traduit de l'albanais (Kosovo) par Sébastien Gricourt et Evelyne Noygues, préface Patrick Penot.
« Près de dix ans après la fin de la guerre, le Kosovo s’apprête enfin à déclarer son indépendance. Le gouvernement demande alors au Théâtre national de préparer un spectacle pour le jour J. Mais le metteur en scène est soumis à tant de contraintes incompatibles que l’événement connaîtra de multiples rebondissements…
Le Royaume-Uni vient de sortir de l’Union européenne : il y a une place à prendre et le Kosovo vise à l’occuper avant la Serbie. Il s’agit de remplir au plus vite les critères d’accession, ce à quoi tâche de s’employer la boucherie Tony-Blair à Prishtina. C’est sans compter la corruption des fameux inspecteurs et la mobilisation des animaux… »
 Serhiy Jadan, Hymne de la jeunesse démocratique, traduit de l'ukrainien par Iryna Dmytrychyn.
Serhiy Jadan, Hymne de la jeunesse démocratique, traduit de l'ukrainien par Iryna Dmytrychyn.
« Kharkiv, les années 90. Tout en continuant à écrire, San Sanytch décide de quitter son travail chez les Boxeurs pour la justice, pour se lancer dans le business. L’idée est d’ouvrir le premier club gay de la ville, sous couvert de « loisirs exotiques ». Un spécialiste du show-biz sur le retour est embauché, tandis qu’un partenariat est conclu avec l’administration municipale, qui en profite pour leur glisser un missionnaire australien dans les pattes, alors qu’il faut repousser les velléités de la mafia locale. Mais l’entreprise tourne au désastre. Derrière cette comédie quasi balkanique, qui conjugue absurde et burlesque, sont évidemment dénoncées l’intolérance et la corruption au sein d’une société post-révolutionnaire qui découvre la liberté et la démocratie à l’occidentale. »
 Béla Pintér, Saleté, traduit du hongrois par Françoise Bougeard, préface Béla Czuppon.
Béla Pintér, Saleté, traduit du hongrois par Françoise Bougeard, préface Béla Czuppon.
« Celle qui n’est pas aimée ne comprend pas vraiment pourquoi elle est « si peu » aimée. Elle blâme le monde pour cette injustice ou encore les gens pour leur apathie, alors qu’en fait tout le monde l’évite à cause de son intelligence émotionnelle aiguë, de son égoïsme et de son étroitesse d’esprit. Et l’éviter est bien ce qu’ils font tous. Ils n’ont pas vraiment envie de lui adresser la parole. Ne pas être aimé est une agonie. Sourcils froncés, on serre les dents, et les mains deviennent des poings. C’est dans des instants comme ceux-là qu’elle devient dangereuse. Elle, qui n’est pas aimée. »
12/04/2021 | Lien permanent
Singularités d’un foisonnant patronyme
 Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin n’est pas Monsieur Ducon, loin s’en faut. Rappelez-vous ce texte de Jacques Prévert, chanté par Yves Montand, les Frères Jacques et sans doute quelques autres, où est contée l’histoire d’un homme triste, si triste parce qu’il s’appelle Ducon, et qui, ayant découvert dans un vieux Bottin qu’il est « le seul Ducon », change complètement d’humeur et « poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. » À l’opposé, il y a les Martin, qui « pullulent », « essaiment », « se multiplient ». Pour leur malheur ? En tout cas pour le bonheur du lecteur plongé dans l’ouvrage du prénommé Jean-Pierre qui, ne se contentant pas de son patronyme, l’étend à ses équivalents étrangers (Martins, Martinez, Martinson etc.). Mais rassurons-nous; sur le nombre incommensurable, et même s’il leur accorde plus de sept cents pages, il fait un choix : quarante et un chapitres consacrés à autant (disons un peu plus) de Martin, c’est déjà une épopée, un monument d’érudition, un multiple voyage dans le temps et dans l’espace.
Il avoue que « Nous, les Martin, nous formons un monde. Un monde inconnu de lui-même. » Son « Grand Récit » s’adresse donc aussi, et peut-être avant tout, à sa grande famille patronymique, où se sont illustrés voyageurs et baroudeurs, créateurs et découvreurs, mais aussi « Saints et Soldats plus souvent qu’à leur tour », à l’image du fameux Martinus (IVe siècle), celui que le geste de partager son manteau a rendu célèbre… Ce qui n’empêche pas l'hommage rendu à Sainte Martine, vierge et martyre du IIIe siècle – qui a donc précédé son pendant masculin… Si le « saint fondateur » est bien présent, il y a aussi le souci de rendre justice à des Martin méconnus et pourtant eux aussi fondateurs, en tout cas inventeurs : deux chapitres intitulés « L’invention de l’Amérique » consacrent Joseph Plumb Martin (« Martin yankee ») et Joseph Martin (« Martin cherokee »), un autre, intitulé « Naissance de l’Australie », évoque James Martin (ne pas confondre avec un autre James Martin, évadé de Botany Bay)…
C’est dire leur importance, voire leur puissance de création. Impossible évidemment (et inutile) de reprendre ici toutes les trouvailles, tous les détails historiques qui rythment ces pages. Je m’arrêterai un instant sur le chapitre consacré à Claude Martin, « dit le Major Martin », que les Lyonnais connaissent surtout comme le « fondateur de La Martinière », ces lycées dont il avait demandé la création dans son testament. On sait moins qu’il fut un grand voyageur, un aventurier, « négociant, financier et promoteur » : « Le sens des affaires, l’esprit d’entreprise qu’il se découvre doivent l’étonner lui-même. » Autre domaine : le Martin (Jean-Pierre) musicien ne pouvait faire l’impasse sur le Martinů (Bohuslav) compositeur, le « quatrième mousquetaire tchèque » (avec Dvořak, Janáček et Smetana), dont la biographie mouvementée (entre sa Bohême natale, Paris, New-York…) est à l’image de l’œuvre, abondante et multiple, en dehors des écoles et des modes – une originalité qui ne doit pas être pour déplaire à la tribu des Martin.
« Sept mille soixante-quatorze Martin, sans compter les disparus » : ils mériteraient d’être tous nommés, ces Martin morts dans les batailles et les tranchées de la guerre de 1914-1918 ; mais la liste en est si longue ! Hommage collectif, donc, et particulier pour Nelly Martin, une « diva » (pseudonyme Nelly Martyl), qui s’est engagée comme infirmière « sous la mitraille ». Et en matière d’engagement, nous avons deux Henri Martin représentant deux bords radicalement opposés, deux conceptions entre lesquelles l’auteur a manifestement choisi la deuxième (à bon escient), celle qui a produit le « saint laïc » en lutte contre le colonialisme et participant au roman national. Écoutez ce double hommage : « Dans mon lignage, tu es à la fois le contraire et le double de Thérèse Martin, dite de Lisieux : toi, Henri, le petit soldat réfractaire, et elle, Thérèse, la petite sainte de province, vous êtes deux icônes de notre tradition nationale. Vous appartenez à deux mémoires cloisonnées, vous plantez vos drapeaux dans deux régions antipodiques : les lendemains qui chantent ici-bas et le paradis du Très-Haut. » Cela dit, comme les Jean-Pierre (j’en connais plusieurs) ou les Jacques (même remarque), les Henri foisonnent ; outre les précédents, un peintre, un historien et homme politique (cher aux amateurs de Monopoly), et bien d’autres qu’il aurait été fastidieux de recenser, et qui ne le sont pas.
Jean-Pierre Martin (notre auteur) n’a vraiment pas rechigné. Son livre est le fruit, n’en doutons pas, d’un travail colossal, de recherches rigoureuses (livres, journaux, archives), de pêche en eaux profondes (martin-pêcheur… facile). Mais il ne s’agit pas que de cela. Jean-Pierre Martin est un écrivain, et même si l’on peut lire son livre « à sauts et à gambades », nous avons affaire à un roman riche en péripéties et en ramifications, ou à une série de romans qui, comme les Martin, peuvent se reproduire et se multiplier à l’infini.
Jean-Pierre Longre
10/02/2022 | Lien permanent
Amateurs et musiciens
Alain Gerber, Bu, Bud, Bird, Mingus, Martial et autres fauteurs de trouble, Alter Ego Éditions, 2014
Il ne sera pas fait ici l’éloge d’Alain Gerber ni de son inimitable style. Ce serait superflu. On se contentera de signaler aussi bien aux amateurs qu’aux musiciens (attention, distinguons bien les deux catégories : « le musicien est un homme qui écoute la musique […]. L’amateur n’écoute rien. Il imagine. », et ailleurs : « Il y a des gens que des musiques déjà réelles font rêver : on les appelle des amateurs. Il en est d’autres pour rêver des musiques qui n’existent pas encore : ce sont des musiciens ; parfois leurs rêves deviennent réalités. »), on signalera donc que Bu, Bud, Bird, Mingus, Martial et autres fauteurs de trouble est un abécédaire non balbutiant du jazz dans tous ses états, et qui joue toutes sortes d’airs en partant de Henry « Red » Allen pour arriver à Kenny Werner.
Reprenant des textes publiés çà et là en revues, volumes et magazines divers, y ajoutant quelques inédits, Alain Gerber décline les genres, les compositions, les interprètes, ne se refusant pas au passage à quelques confidences ou pensées personnelles, de même qu’à quelques digressions nécessaires (il peut être question du Facteur Cheval, de Picasso, des buffets de gare, de la mondialisation, de souvenirs personnels – mais c’est toujours, en définitive, pour parler de la musique, de ses mystères et des désirs qu’elle suscite).
Et il y en a pour tous les goûts ; goûts musicaux, oui, mais aussi goûts littéraires : de l’essai au récit, de la critique au poème, du monologue au témoignage, les phrases déroulent les mots comme les mélodies déroulent les notes, et l’on peut se promener dans les pages du livre comme dans les plages d’un disque. On y dénichera toujours quelques-uns des « troubles » dont il est question dans le titre. « Chaque musique, comme chaque individu, est le produit et l’agent d’une mentalité. Dans ces conditions, la rencontre, disons, d’un Français avec le blues et le jazz évoque l’union pittoresque de la carpe et du lapin. Elle repose, en particulier, sur une puissante conjuration de malentendus. Malentendus que les mots dissimulent et dénoncent. Que les mots traduisent et trahissent. Qu’ils sapent et qu’ils renforcent, parfois d’un même mouvement. ». À chacun de rêver sa musique et ses mots.
Jean-Pierre Longre
10/08/2015 | Lien permanent
La parade des paronymes

Rémi Bertrand
Un mot pour un autre
Points, collection « Le goût des mots », 2009
Les manuels de langue française contiennent pour la plupart une rubrique « ne pas confondre » destinée à mettre en garde le potache contre les confusions entre mots qui « partagent un véritable air de famille ». Que l'on se rassure, Rémi Bertrand, qui s'est signalé naguère par un ouvrage sur « les nuances des synonymes » (Un bouquin n'est pas un livre, Points, 2006), ne nous assène pas des listes à apprendre par cœur ; il nous propose plutôt un défilé à la fois didactique et plaisant, une promenade savante et drôle, le tout parsemé d'illustrations aussi parlantes que comiques.
Il y a beaucoup de science dans ces pages : l'auteur n'élude pas les explications étymologiques, historiques, phonétiques destinées à renseigner le lecteur sur les raisons des convergences et divergences entre vrais ou faux amis, montrant ainsi comment les mots se sont transformés au fil des siècles.
Beaucoup d'humour aussi : après une préface en forme d'avalanche paronymique, chaque chapitre se déroule comme une broderie, une variation, voire un dialogue, une pièce de théâtre, une ordonnance de tribunal - et se termine toujours par une pirouette, une chute, un trait d'esprit, un jeu verbal. Avec cela, des références à la littérature, à l'histoire, à la bande dessinée (les belles injures du Capitaine Haddock, maître dans l'art d'agonir - et non d'agoniser !)...
On l'aura compris, Un mot pour un autre n'est pas un pensum. Sans affectation, mais avec une visible affection pour la langue, Rémi Bertrand amuse et instruit, pratiquant le classique placere et docere à l'intention de tous les lecteurs, à l'attention desquels nous n'hésitons pas à signaler ce précieux livre.
Jean-Pierre Longre
http://www.sitartmag.com/rbertrand.htm
18/05/2010 | Lien permanent
L’épopée du vulgaire
 Ian Monk, Plouk Town, Introduit par Jacques Roubaud, Éditions Cambourakis, 2007, rééd. 2011
Ian Monk, Plouk Town, Introduit par Jacques Roubaud, Éditions Cambourakis, 2007, rééd. 2011
Au commencement était la contrainte et la contrainte s’est faite verbe et le verbe s’est fait avalanche. Ainsi : Plouk Town est un long texte poétique en onze parties : la première contient un poème (x) d’un vers (x2) d’un mot (x), la seconde deux parties (x) de quatre vers (x2) de deux mots (x), la troisième trois poèmes (x) de neuf vers (x2) de trois mots (x) et ainsi de suite, jusqu’à la dernière partie contenant 11 poèmes de 121 vers de 11 mots… L’avalanche, extension du principe oulipien de « boule de neige », sert donc à l’auteur de contrainte rythmique, et au texte de cadre poétique, à l’intérieur duquel d’autres contraintes (anaphores, rimes et antérimes, recherche de toutes les combinaisons possibles d’un ensemble de 9 mots aboutissant à la composition de 81 vers (99)…) guident le texte.
Soit. Mais l’exercice n’est jamais gratuit. Plouk Town est un ouvrage abouti, qui ne relève pas que de l’expérimental formel, mais aussi et surtout de l’expérience fondamentale du quotidien. Dans la ville en question, les Plouks en question, c’est nous, c’est Monk, c’est tous ceux qui traînent leur cafard quotidien dans un paysage sans horizon. Sans précautions oratoires, en toute lucidité mentale et en toute verdeur lexicale, l’auteur chante en mineur la connerie des gens, les mômes pénibles, les parkings de supermarché, le Quick, l’alcoolisme, la Star Academy, la promiscuité, les appartements crasseux, la clochardisation… Ces scènes de la vie vulgaire sont certes localisées pour la circonstance, mais elles sont de partout : comme partout (à Bombay, Tombouctou, Londres ou New York), « la pauvreté te cogne la gueule à Plouk Town » ; comme partout, on embauche (des vigiles, des surveillants, des tortionnaires, des connards), on a peur, on aime, on se souvient, on pense, on déteste, on tâche de vivre, on est sûr de mourir.
Il y a tout à Plouk Town, et on y ressent tout ce que peuvent ressentir les humains. Il y a tout dans le livre de Ian Monk (après une fort plaisante et fort charpentée préface de Jacques Roubaud), en vers, en morceaux de dialogues, en bribes de monologues, en fragments réalistes, poétiques, comiques, tragiques, épiques. Il y a même des tentatives de réponse à l’angoisse collective et individuelle :
« moi qui vous le dis je m’entraîne
à l’écriture justement mais justement pour sortir
de cette idée de pourriture de ma vie ».
Jean-Pierre Longre
21/06/2011 | Lien permanent | Commentaires (1)
Hurlement de la vie, épuisement du langage
 Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 2007
Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 2007
Prix Robert Walser 2008
Marius Daniel Popescu est né en Roumanie et vit actuellement à Lausanne. Il s’est fait connaître il y a quelques années par ses Arrêts déplacés, recueil de poèmes où la vie quotidienne se décline en miniatures ciselées avec une amoureuse précision. Il rédige et publie en outre avec régularité Le Persil, journal atypique, inimitable, où fleurissent les mots du quotidien. Marius Daniel Popescu est un poète, et l’important roman qu’il vient de faire paraître en est une preuve supplémentaire.
Car les 146 sections des 399 pages (soyons précis !) de La Symphonie du loup sont autant de poèmes en prose. Juxtaposition de tableaux, d’instantanés, de scènes représentant les petits et grands faits d’une existence, le texte est un puzzle à la Perec, une tentative d’épuisement du langage par la vie elle-même, qui devrait triompher des mots, les effacer purement et simplement, ces mots ressassés, réitérés, s’étalant sans vergogne sur la page, et qui « ne devraient pas exister » (leitmotiv tout aussi ressassant). Car ils sont de vrais pièges, des pièges à loup : « Tu as appris tôt la duplicité du monde, la duplicité des gens, la duplicité des mots. Tu as appris depuis petit que le même mot peut provoquer ou arrêter une bagarre. Même le mot cerisier, tu savais qu’il est à la fois donneur de vie et meurtrier ». Et encore : « Quand je lis des mots inscrits quelque part, dans des livres de toutes sortes, sur des murs, dans les journaux ou sur les affiches publicitaires, je ne m’approche pas de leur sens avec une envie de recevoir du plaisir. Je ne cherche pas le plaisir dans les mots ». Et plus on approche de la fin, plus les séquences deviennent brèves, réduites au minimum verbal, au squelette narratif, et le puzzle devient multiple, livré au hasard comme une partie de cartes.
En même temps, La Symphonie du loup est un roman au souffle inépuisable, un souffle qui vous transporte entre passé et présent. L’enfant, le jeune homme qui, comme sa famille et ses compagnons, évoluait sous et malgré l’omniprésence de la dictature, est simultanément ce père de famille qui voit agir et fait grandir ses enfants, la « petite » et la « grande », dans son pays d’adoption. « L’école de la vie », qui signifie « tout ce qu’un être humain peut vivre et comprendre et apprendre sur la terre », est ici et là, en un constant va-et-vient entre là et ici. C’est une école qui enseigne tout, y compris la mort : celle du père, qui est au départ de la narration, celle de l’enfant à naître, relatée en des pages hallucinantes d’émotion contenue : « ce monde est fou, nous sommes des fous parmi les fous, je ne veux pas d’un enfant de fou dans un monde de fous ! », dit en pleurant la fiancée qui « souffrait beaucoup à cause de la vie que le parti unique avait instaurée au pays »… Ce « parti unique » est partout, transformant les hommes en « figurants » obligés de répondre « présent ! » alors que pour survivre ils ne peuvent qu’être mentalement ailleurs.
Le souffle du roman, c’est aussi le style, un style qui prend à la gorge. Le style c’est l’homme, a dit quelqu’un il y a quelques siècles ; mais l’homme est un loup pour l’homme, avait dit un autre un peu auparavant ; résultat de l’équation (qu’aurait donné le héros, féru de mathématiques) : le style, c’est le loup, dont le chant, murmuré ou hurlé, ne peut pas laisser indifférent. Roman à la deuxième personne, parole adressée par le grand-père à son petit-fils, La Symphonie du loup utilise le « tu » général, universel, mais le « je » et le « il » sont là, tout près, en embuscade dans le train du récit : « Tu es resté dans ce compartiment un peu plus d’une heure, presque endormi tu avais pensé à toi à la première personne, tu t’es vu à la deuxième personne, tu t’es regardé et tu t’es écouté à la troisième personne comme quelqu’un qui se regarde dans une glace et s’appelle soi-même, alternativement, par « je », par « tu » et par « il » ».
Transparente simplicité des faits, absurde complexité de la vie. Le loup dévore les mots, et cependant il les métamorphose en un chant aux insondables harmoniques et aux interminables échos.
Jean-Pierre Longre
Rencontre avec Marius Daniel Popescu à l’Université Jean Moulin Lyon 3 : http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_lyon_3_division_de_l_audio_visuel_et_du_multimedia/dossier_programmes/lettres/rencontre_avec_marius_daniel_popescu
09/09/2010 | Lien permanent
En quête des autres, en quête de soi
 Lionel-Édouard Martin, Anaïs ou les Gravières, Les éditions du Sonneur, 2012
Lionel-Édouard Martin, Anaïs ou les Gravières, Les éditions du Sonneur, 2012
Est-il pensable de trouver dans un roman d’aujourd’hui des mots comme « voussure », « fluer », « s’aboucher », « croquemitaine », « floches », des expressions comme « botteler les possibles », « j’hypallageais pas mal sur la bouteille » ou des phrases comme « Il fait sur la rivière un temps de libellule » ? Sachez que oui, au moins sous la plume de Lionel-Édouard Martin, maître en poésie suburbaine et semi-rurale.
Ce n’est pas le tout. Anaïs ou les Gravières est un roman aux multiples facettes. Si d’emblée il prend une tournure policière (le meurtre d’une jeune fille, l’enquête d’un journaliste), on s’aperçoit vite que ce n’est pas vraiment ce qui compte. La rencontre de témoins tourne à la galerie de portraits pittoresques, sensibles, emplis de cette humanité que l’on trouve au fond de tous les yeux, pour peu qu’on le veuille. Il y a Anaïs, la lycéenne morte que l’on finira par connaître grâce aux autres, sa mère, qui confie au narrateur son histoire à la fois commune et unique, Mao, Petit louis, Toto Beauze, le légionnaire… Le lecteur les découvre peu à peu – jamais complètement, car le silence et le non-dit forment une part importante de leurs personnalités –, et devine qui est Nathalie, celle dont le destin reste comme une plaie ouverte dans la trame de l’histoire, comme un reflet pathétique de celui d’Anaïs.
Car les récits enchâssés dans l’intrigue, les souvenirs personnels et collectifs, les évocations de paysages campagnards, minéraux, industriels ou urbains, les portraits, tout cela tient dans l’œil de l’observateur, qui lui-même, dans sa solitude, guette le regard des autres, se voit dans l’autre comme dans un miroir : « Mao. Je dis Mao. Je pourrais aussi bien dire « moi ». Moi, c’est presque dans Mao. Mao, c’est presque moi ». Anaïs elle-même, dès avant sa naissance, a cette puissance du regard silencieux qui perce et reflète son entourage. Sa mère le sent : « À Mao, j’ai dit que j’étais enceinte d’une boule de regards, que j’allais accoucher dans quelques mois d’un gros œil dont il n’était pas responsable ».
Et l’écriture elle-même réfléchit le récit (et vice-versa), puisque le narrateur (l’auteur, aussi bien) ne rechigne pas aux considérations sur son travail, son « droit d’invention » : « Juste inventer ; prendre mon deuil au corps, le travailler de mots ». On y revient toujours : dans ce roman en forme d’enquête, l’important c’est la vie, la mort, les « gens » que l’on interroge par les mots, les silences et le regard, toujours en quête de soi.
Jean-Pierre Longre
A noter ! Rencontre avec Lionel-Édouard Martin le 22 mai à 18h à la Librairie du Tramway, 92 rue Moncey, 69003 LYON
21/05/2012 | Lien permanent
Mater dolorosa
 Marie Darrieussecq, Tom est mort, P.O.L., 2007
Marie Darrieussecq, Tom est mort, P.O.L., 2007
La mort brutale d’un enfant vécue, revécue, ressassée par sa mère peut-elle faire le sujet d’un roman ? Oui, lorsque ce roman relate la douleur universelle, la douleur folle de toute mère.
La narratrice, jeune épouse française d’un anglais qui, à cause de son travail, mène sa femme et ses trois enfants d’une extrémité à l’autre de la terre, de Vancouver à Sidney et Cambera, pourrait être toute mère endeuillée de n’importe quelle époque, de n’importe quel pays. Simplement, l’écriture est là, non pour purger l’être souffrant de son malheur, non pour lui procurer l’oubli et l’apaisement, mais pour lui permettre de rendre compte, de rendre des comptes à soi-même et, peut-être, aux autres.
La sphère infernale de la remémoration et du remords, d’un bout à l’autre de l’écriture, englobe tout, et les dernières phrases du livre, qui pourraient être une explication, ne dénouent rien ; au contraire, elles renvoient aux premiers mots déclencheurs : « Tom est mort. J’écris cette phrase ». Un peu comme dans certains récits de Marguerite Duras (mais avec la singularité de l’événement), les mots sont des cris, un seul cri trouant la surface des sentiments, les vidant de leur substance en une spirale sans fin. Les choses de la vie ne sont pas un recours : objets, déménagements, livres (y compris les grands auteurs, sauf peut-être Charlotte Delbo et Georges Perec), même les deux autres enfants, l’aîné et la benjamine (Tom était le cadet), même les proches – le mari traumatisé et aimant, les parents compréhensifs – , tout ce qui remplit l’existence quotidienne n’y peut rien. La mort de l’enfant fait qu’il sera toujours là, éternellement âgé de quatre ans et demi.
Tom est mort est un livre risqué pour l’auteur : risque humain de s’aliéner celles qui ont connu la pire des souffrances pour une femme : vivre la mort de celui à qui on a donné la vie ; risque littéraire de fabriquer de la mauvaise littérature avec un sujet grave. On peut dire que Marie Darrieussecq a composé là une œuvre littéraire vraie, en donnant à ses mots la mission de nous plonger au plus profond du cœur humain.
Jean-Pierre Longre
04/08/2010 | Lien permanent


