22/01/2026
Les mots de la terre
 Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
"Défenseur de la mémoire rurale, de ses traditions, de sa langue et de ses métiers, Jean-Loup Trassard est décédé le 13 janvier à l’âge de 92 ans. Auteur d’une œuvre pour le moins originale dans le paysage littéraire contemporain – elle marie formes verbales et formes visuelles : récits, romans, relevés de témoignage, photographies, livres illustrés –, il a fait du bocage mayennais le centre matriciel de son écriture." ("La Lettre des anges", Le Matricule des anges, 21/12/2026)
Qui se soucie encore des taupes ? Quelques jardiniers, quelques vacanciers retraités soucieux de leur pelouse, quelques rares paysans ? En tout cas, foi de taupier, il y en a de moins en moins, de ces petites bêtes qu’on ne voit pas, qui marchent sous terre, creusant les galeries où elles trouvent leur pitance, laissant derrière elles ces petits monticules qui empêchent de faucher.
Autrefois, il n’y a tout compte fait pas si longtemps que ça, pour s’en débarrasser, les fermiers pouvaient engager un « taupier », sorte de « journalier » assez miséreux mais libre, vagabond mais quotidiennement attaché au même travail, aux mêmes champs, aux mêmes maisons, aux mêmes familles chez qui il se rendait régulièrement. C’est l’un d’entre eux, Joseph Heulot, que Jean-Loup Trassard a su faire parler et dont il a su restituer la vie, avec ses propres mots d’écrivain, avec ceux de son interlocuteur, avec ceux de la campagne – mots du terroir traduits en marge pour éclairer le citadin.
Par la grâce de cette « conversation » entre deux hommes qui s’entendent pour de bon, on apprend beaucoup. D’abord, comment chasser les taupes le plus efficacement possible, alors que certains ont tout essayé : le poison (dangereux pour le bétail et les poules), les boules de gaz (qui ne font que les repousser ailleurs), le fusil (qui en laisse trop)… Non. Il faut être méthodique, prendre son temps, ne pas regarder aux heures de marche et à la fatigue, ne pas hésiter à se salir, repérer les passages, et avoir de l’expérience. Poser les pinces et les « pièges américains » qui claquent juste quand il le faut, ce n’est pas donné à tout le monde ; chasser « à la houette », c’est plus rapide, mais il faut être là au bon moment. On apprend aussi beaucoup sur les taupes – c’est bien normal : sur leur vie, leur survie, leur mort – et leurs peaux que Joseph Heulot peut revendre pour se faire trois sous de plus, et qui servent à faire des manteaux aux dames. On apprend encore sur la vie dans les fermes – l’essentiel, mais juste ce qu’il faut ; car le taupier n’est pas bavard là-dessus, par nature sans doute, par nécessité surtout : ne pas s’immiscer dans la vie des gens, ne pas parler aux autres de ce qui se passe chez les uns, et vice-versa, c’est le seul moyen de rester en bons termes avec tous et de continuer à travailler chez tout le monde. On apprend enfin sur le taupier lui-même, homme pauvre, dont le logis « ressemble à un terrier », qui se nourrit de peu, mais qui garde en lui « chaque champ de son territoire », et qui nous permet, grâce à ses mots, de mieux comprendre les hommes et leur attachement à la terre.
Jean-Pierre Longre
10:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, jean-loup trassard, le temps qu’il fait | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/01/2026
Au-delà de la mort, l’amour
 Nikos Kokàntzis, Gioconda, traduit du grec par Michel Volkovitch, illustré par Anne Defréville, éditions de l’Aube, 2025
Nikos Kokàntzis, Gioconda, traduit du grec par Michel Volkovitch, illustré par Anne Defréville, éditions de l’Aube, 2025
« Ceci est une histoire vraie. » Telle est la première phrase du livre, et l’on peut croire son auteur, tant son récit respire la sincérité, et s’ancre dans l’Histoire de son pays. Nous sommes en Grèce, à Thessalonique, pendant l’occupation allemande. Deux familles voisines vivent en bonne entente, les enfants et les adolescents se retrouvent et s’amusent sur le terrain en friche qui sépare leurs deux maisons. C’est là que Nikos s’éprend de Gioconda, et que se manifeste un amour réciproque et irrépressible. Plaisir des jeux partagés, première crise de jalousie, premier baiser. « Je me souviens encore de ses lèvres contre les miennes, de ce frisson de bonheur. L’amour débordait par mes yeux, mes oreilles, ma bouche, le bout de mes doigts. Ma peau était amoureuse, mon cœur, ma gorge, tout mon corps. Et son amour à elle venait vers moi, j’étais traversé par cette vague chaude, lisse, affolante. Nous ne dîmes pas un mot. Nous étions si proches l’un de l’autre qu’il n’y avait pas de place pour des mots. »
« Amour des âmes, amour des corps », écrit le traducteur Michel Volkovitch dans sa postface. C’est exactement cela, et cet amour aurait pu durer, s’il n’y avait eu le contexte terribe : la présence de l’occupant (contre lequel Nikos s’engage en participant, à la mesure de son âge (15 ans), à la Résistance) ; et l’antisémitisme galopant. Car Gioconda est juive. Une fin d’après-midi, toute la famille est emmenée dans un camion militaire ; Nikos et Gioconda se disent un adieu déchirant : « Elle se mit à trembler tout entière, elle n’en pouvait plus, des sanglots silencieux montèrent à sa gorge, ses larmes débordèrent et s’unirent aux miennes sur nos visages collés l’un à l’autre – ultime contact, promesse, adieu ».
Pour Nikos Kokàntzis, qui rédige ce récit plus de trente ans après la disparition de Gioconda à Auschwitz, celle-ci « n’est plus qu’un rêve. » Mais un rêve qui reprend réalité dans son écriture, en des scènes à la fois réalistes et poétiques, à la saveur érotique et sentimentale, des scènes parfois même fantastiques, telle l’évocation des splendides incendies provoqués par les bombardements alliés sur les entrepôts investis par les Allemands. Les belles illustrations d’Anne Defréville, colorées ou sombres, évocatrices et suggestives, soulignent esthétiquement les épisodes importants d’une narration émouvante, pleine de sensibilité et d’intensité.
Jean-Pierre Longre
19:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, grèce, nikos kokàntzis, michel volkovitch, anne defréville, éditions de l’aube, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/12/2025
Une émouvante enquête
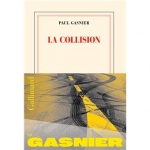 Paul Gasnier, La collision, Gallimard, 2025
Paul Gasnier, La collision, Gallimard, 2025
À une époque où le fait divers prend le pas, dans les informations servies par les médias, sur les autres événements, le livre de Paul Gasnier donne à réfléchir d’une manière sereine, sérieuse et touchante. Il écrit à ce propos : « Ces événements, quand on les prend un à un et qu’on les décortique, peuvent raconter leur époque et l’absurdité tragique qui pend au nez de chacun, mais leur prolifération, accompagnée à chaque fois de conclusions et de solutions clé en main, est devenue si abondante qu’elle a presque l’effet inverse, celui d’annihiler leur possible signification. […] La passion du fait divers permet à l’opinion de trouver dans l’indignation sporadique une forme de divertissement infini, et une inépuisable source d’ostentatoire vertu. »
Car la « collision » dont il est ici question est bien un « fait divers », qui toutefois touche l’auteur de si près qu’il aurait pu se réfugier dans la colère ou le désespoir. « Le 6 juin 2012, à 17h13 précisément […], Saïd, dix-huit ans, qui est alors délinquant récidiviste, remontait une rue étroite des pentes du quartier de la Croix-Rousse, en roue arrière sur une moto cross lancée à 80 km/h. Après quelques mètres, il en perdait le contrôle. La roue avant percuta en pleine tête une femme de cinquante-quatre ans, qui pédalait devant lui à vélo. Cette femme, c’était ma mère. L’hôpital Lyon Sud de Pierre-Bénite la déclara décédée une semaine plus tard. » Pierre Gasnier a alors vingt et un ans. Dix ans plus tard, il décide de faire le récit de ce drame, en se préservant des simplifications manichéennes.
Faisant alterner les faits à l’état brut (reproductions textuelles de documents, dialogues, courriers, narrations objectives d’événements), l’enquête auprès de la famille de Saïd, l’histoire de ses propres parents et les réflexions sur la confrontation des différents microcosmes qui composent et divisent notre société, l’auteur tente d’analyser les tenants et les aboutissants du drame, se demandant si et comment il aurait pu être évité. Ce faisant, il n’occulte ni l’émotion qui le ronge toujours, ni la responsabilité d’un jeune homme qui, façonné par l’argent facile de la drogue et la fréquentation d’individus peu recommandables (alors que les autres membres de sa famille sont tout à fait respectables), reproduit durablement le schéma de la délinquance, ni les méfaits d’une organisation sociale dont les « filets […] n’accrochent plus, ne rattrapent plus, et où l’obsession de soi permet tout. » Le récit de Paul Gasnier se lit à la fois comme une enquête objective et comme un témoignage émouvant, d'une grande humanité ; c’est cette complémentarité qui, outre ses qualités narratives, en fait l’un des intérêts majeurs.
Jean-Pierre Longre
19:52 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, essai, francophone paul gasnier, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/12/2024
Conte de mort, de vie et d’amour
 Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
Film franco-belge d'animation réalisé par Michel Hazanavicius, novembre 2024
« Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! », précisent les premières lignes. Pourtant, nous sommes dans une forêt, où un couple de bûcherons s’échine pour survivre : elle à la recherche du moindre morceau de bois, lui s’affairant à des « travaux d’intérêt public ». Sans enfants, donc sans bouche supplémentaire à nourrir, ni malheureusement à chérir… Très vite on comprend que la voix ferrée récemment construite à travers la forêt transporte des « marchandises » spéciales – hommes, femmes, enfants – vers une destination inconnue. Car tout autour de la forêt, c’est la guerre mondiale. « Pauvre bûcheronne », tous les matins, en ramassant les quelques branchages qu’elle trouve, va voir passer le train, attendant un signe, un cadeau, un miracle.
 Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.
Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.
Le conte nous dit que pendant ce temps la mère et le frère de la petite fille vont mourir, victimes des bourreaux, que seul le père en réchappera, espérant que son geste aura sauvé le bébé. Le récit avance à son rythme, faisant alterner les scènes de cruauté et de tendresse, de violence et d’amour, jusqu’à ce que le père, au hasard de ses recherches erratiques, devine que la fillette qui se trouvait devant lui, vendant des fromages avec sa « mère », était celle qu’il avait arrachée à la mort : « Un cri, un cri terrible, un cri de joie, de peine, de victoire, un cri se forma dans sa poitrine, mais rien, rien ne sortit de sa bouche. […] Il avait vaincu la mort, sauvé sa fille par ce geste insensé, il avait eu raison de la monstrueuse industrie de la mort. »
 Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».
Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».
Jean-Pierre Longre
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=274858.html
18:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, récit, histoire, francophone, jean-claude grumberg, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/10/2024
La certitude de l’amour
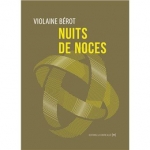 Violaine Bérot, Nuits de Noces, (Editions) La Contre Allée, 2023
Violaine Bérot, Nuits de Noces, (Editions) La Contre Allée, 2023
C’est un livre hors normes, hors des normes sociales et hors des normes habituelles de la littérature. Un long poème (ou, si l’on veut, une suite de 32 brefs poèmes encadrés par la mort), combinant dans son harmonie profonde le lyrisme et la biographie (en l’occurrence celle de de la mère de l’autrice, narrée à la première personne), les vers et le récit, l’elliptique et l’explicite, l’émotion et le réalisme… Un petit livre par ses dimensions matérielles, mais qui mène le lecteur vers l’infini de l’amour, un amour qui a attendu longtemps avant d’enfin trouver réalité : « Au bout de tout ce temps / au bout de ces six ans plus un / arriva donc / ce jour. / Ce jour / au bout de tant de temps / de tant d’attente / au bout de si peu s’être vus / si peu connus / ce jour où / se marier. »
Car il est prêtre, un prêtre hors-normes lui aussi, cet homme dont la jeune fille est amoureuse, d’un amour exclusif, d’autant plus obstiné qu’elle n’aspire qu’à fuir les coups de son père, « Du père / des mâles de ma famille / de leur folie furieuse / de comment tout tremblait autour d’eux / des femmes terrorisées, soumises, atterrées, muettes ». C’est au bout de six ans que celui qu’elle attendait aura répondu à cette attente, six ans pendant lesquels il aura douté, flanché, écrit, six ans pendant lesquels il était retenu par « la Très Sainte Église / et tous ses bien-pensants, ses culs-bénis, ses grenouilles en tous genres ». Sa réponse finalement se fait au grand jour, non dans le secret réclamé par la hiérarchie qui aurait voulu, comme d’habitude, qu’elle devienne « femme cachée du curé / sa secrète maîtresse en l’Église / pouah. » Au grand jour, mariage à la mairie, malgré ceux qui « promettaient l’enfer. » Et ce fut non « pas une simple nuit », mais « une kyrielle / de nuits de noces / et se moquer / que ce soit la nuit ou le jour / et bien loin de la date des noces. », à rattraper tout ce temps perdu.
Et la vie. Il y eut l’arrivée des enfants, des « années vacillantes », des « coups du sort », la vieillesse, la maladie, mais toujours l’amour. « Pouvais-je l’imaginer / ce temps de la fin des temps / quand les corps se sont calmés / desséchés / et quand pourtant / il suffit de sa main / de ses doigts sur ma joue / pour que je frémisse / comme à la toute première / de toutes les nuits de noces. » Et pour finir la mort, le vide, les « lettres à relire », l’espoir insensé de revivre « la même histoire » – et c’est bien cela que réalise ce livre : la fille qui fait revivre, tout en poésie et en tendresse, l’amour de ses parents, l’amour exceptionnel de deux êtres qui ne pouvaient faire autrement que s’aimer.
Jean-Pierre Longre
10:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, biographie, récit, francophone, violaine bérot, (editions) la contre allée, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/10/2023
Une jeune Lyonnaise dans le Yunnan
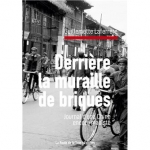 Guillemette Laferrère, Derrière la muraille de briques, « Journal d’une Chine encore maoïste », La Route de la Soie-Éditions, 2023
Guillemette Laferrère, Derrière la muraille de briques, « Journal d’une Chine encore maoïste », La Route de la Soie-Éditions, 2023
Août 1981 : Guillemettre Laferrère, 25 ans, diplômée de l’INALCO, débarque à Kunming, dans la pointe sud-ouest de la Chine, en tant qu’ « experte » : elle va enseigner le français à des adultes (enseignants, étudiants en ingénierie, futurs interprètes…). Par la même occasion, elle ira passer le CAPES de Chinois à Hong-Kong, et elle pourra « assouvir sa soif d’aventures ». Ayant tout récemment retrouvé le pays, et mesurant les « changements radicaux » qu’il a subis en quarante ans, elle a décidé d'attiser ses souvenirs grâce au journal qu’elle a tenu à l’époque et aux courriers envoyés à ses proches.
Cela donne un fort volume empli d’anecdotes émouvantes ou drôles, de descriptions pittoresques, de remarques personnelles ou générales, de réflexions sur la société, la politique, la culture, de tableaux pris sur le vif, de portraits attachants ou incisifs, de récits variés… Le lecteur suit avec un intérêt toujours renouvelé le cheminement quotidien de cette jeune femme en découvrant avec elle les us et coutumes du pays, les types de relations entre et avec les autochtones, les paysages urbains et ruraux, montagnards ou désertiques (au cours de ses escapades et de ses voyages).
Comment choisir ? Il y a les usages auxquels il faut se plier (par exemple, pour les femmes, ne pas être en nu-pieds, ne pas s’étonner devant la manière d’aspirer la nourriture, ne pas se scandaliser devant la mauvaise volonté des employés de commerce ou d’administration, se sortir indemne des bousculades et des coups reçus dans les côtes, n’entraînant pas la moindre excuse…), et ceux auxquels elle décide de s’opposer (demander aux étudiants de ne pas cracher par terre pendant les cours). Il y a le sentiment (fondé) d’être sans cesse espionné, dans le travail, la vie quotidienne, les trajets, et d’être dans un pays fermé : « D’après un étudiant, le seul service efficace en Chine est le service de sécurité. » Un pays fermé par la « muraille de briques », symbolisée par « le mur de briques qui s’élève autour de la maison » où résident les « experts » étrangers. Il y a les aléas du climat (montagnard et tropical), les difficultés de la vie quotidienne, avec son manque d’hygiène, la pollution, l’exiguïté des logements, la pauvreté, le nationalisme politique, mais il y a aussi l’amitié inoubliable de certaines personnes, les découvertes telles que la chirurgie sous acupuncture, les marchés grouillant de nourriture et d’odeurs, les séances de cinéma, les discussions, les visites familiales, les vastes paysages admirés au cours de randonnées, d’ascensions ou de longs voyages en train relatés dans la deuxième partie de l’ouvrage…
Voilà un document foisonnant de détails sur la vie en Chine dans les années 1980, à partir d’une expérience et d’une plongée personnelles au plus profond de cette vie. Mais ce n’est pas tout : la narration, fort bien menée, débouche sur une vision d’ensemble, une mise en perspective qui, malgré la modestie revendiquée du propos, pousse à la réflexion, à l’appui du texte et des photos très parlantes qui occupent les dernières pages : l’évolution technologique du pays, l’élévation du niveau de vie, mais aussi la dictature, la répression (celle des Ouïghours notamment), et plus généralement la question de savoir si les Chinois endurent toutes les vicissitudes de leur vie par passivité ou par endurance. Une interrogation qui dépasse d’ailleurs le cas particulier, et qui est laissée à la méditation de tous.
Jean-Pierre Longre
10:23 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, journal, correspondance, histoire, guillemette laferrère, la route de la soie-Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2023
Juifs contre bétail
 Lire, relire... Sonia Devillers, Les exportés, Flammarion, 2022, J'ai lu, 2023
Lire, relire... Sonia Devillers, Les exportés, Flammarion, 2022, J'ai lu, 2023
Ils s’appelaient Harry et Gabriela, et Sonia, leur petite-fille, les a bien connus. Juifs sans le vouloir, mais obligés de l’être. « Je savais qu’ils étaient juifs, mes grands-parents. Je savais aussi qu’ils n’y accordaient aucune importance, qu’ils ne portaient même plus de nom juif. » Ils ne parlaient pas de ce qu’ils avaient vécu avant et pendant la guerre, accréditant ainsi l’idée que l’antisémitisme n’avait pas sévi en Roumanie, le pays où ils habitaient. Et pourtant… Pogroms, emprisonnements, déportations, tout cela avait bien eu lieu. Mais pour Harry et Gabriela Greenberg, qui prirent le nom de Deleanu parce qu’ils se sentaient plus roumains que juifs, « la franche horreur se situait ailleurs, dans cet exil forcé de 1961, ce voyage si terrorisant de Bucarest à Paris, vécu par ma mère lorsqu’elle avait quatorze ans. »
 Le livre relate toutes les étapes, ô combien éprouvantes, accidentées, périlleuses que sa famille maternelle (son arrière-grand-mère, ses grands-parents, sa mère, sa tante) dut franchir, eux qui avaient eu foi dans le communisme et qui devinrent des parias, pour parvenir à fuir la dictature et les sévices et arriver à Paris, échangés contre… des machines agricoles et du bétail (en particulier des porcs). Car la Roumanie de 1960-1961 avait grandement besoin de renforcer son matériel agricole et son cheptel. Un homme, trafiquant habile, aventurier ambigu et sans grands scrupules (qui pourtant rendit de grands services à nombre de Juifs roumains, dont la famille Deleanu), Hongrois devenu Ukrainien puis Britannique, Henry Jacober, fut la cheville ouvrière de ce troc. Un chapitre entier est consacré à la reproduction (traduite) de documents que Sonia Devillers a trouvés dans les dossiers de la Securitate, et qui dressent la liste des « personnes autorisées à quitter le pays » en échange de vaches, cochons, moutons, taureaux (tous de bonne race), ainsi que de machines agricoles performantes – listes à l’appui là aussi. Cette période plutôt artisanale fut suivie, après l’arrivée au pouvoir de Ceauşescu, d’un commerce identique et même accéléré, mais avec comme monnaie d’échange des centaines de milliers de dollars…
Le livre relate toutes les étapes, ô combien éprouvantes, accidentées, périlleuses que sa famille maternelle (son arrière-grand-mère, ses grands-parents, sa mère, sa tante) dut franchir, eux qui avaient eu foi dans le communisme et qui devinrent des parias, pour parvenir à fuir la dictature et les sévices et arriver à Paris, échangés contre… des machines agricoles et du bétail (en particulier des porcs). Car la Roumanie de 1960-1961 avait grandement besoin de renforcer son matériel agricole et son cheptel. Un homme, trafiquant habile, aventurier ambigu et sans grands scrupules (qui pourtant rendit de grands services à nombre de Juifs roumains, dont la famille Deleanu), Hongrois devenu Ukrainien puis Britannique, Henry Jacober, fut la cheville ouvrière de ce troc. Un chapitre entier est consacré à la reproduction (traduite) de documents que Sonia Devillers a trouvés dans les dossiers de la Securitate, et qui dressent la liste des « personnes autorisées à quitter le pays » en échange de vaches, cochons, moutons, taureaux (tous de bonne race), ainsi que de machines agricoles performantes – listes à l’appui là aussi. Cette période plutôt artisanale fut suivie, après l’arrivée au pouvoir de Ceauşescu, d’un commerce identique et même accéléré, mais avec comme monnaie d’échange des centaines de milliers de dollars…
Le témoignage familial de Sonia Devillers, plein d’anecdotes émouvantes, est au cœur du récit. Mais il est l’occasion d’une véritable enquête historique sur les Juifs roumains du XXe siècle, où l’autrice s’appuie non seulement, en journaliste chevronnée, sur les témoignages directs et sur les archives, mais aussi sur des ouvrages comme ceux de Mihai Sebastian, Matatias Carp, Radu Ioanid, Ion Pacepa, qui montrent que la succession des régimes (notamment fascisme puis communisme), n’a jamais épargné les Juifs, quels qu’ils soient. Les statistiques sont formelles : « À la fin des années1930, la Roumanie comptait 750 000 juifs roumains. Au cours de la seconde guerre mondiale, la moitié d’entre eux furent assassinés. » Ajoutons à cela les 130 000 qui, vivant en Transylvanie, furent déportés à Auschwitz. « Au sortir de la guerre, la Roumanie ne comptait plus que 350 000 citoyens d’origine juive. […] Quatre décennies plus tard, lorsque Nicolae Ceauşescu fut renversé en 1989, les juifs étaient moins de 10 000 dans le pays. Ils avaient physiquement disparu. La Roumanie était bel et bien devenue un pays sans juif. » Ce récit est aussi l’occasion d’une réflexion sur l’exil, les racines, la langue : la mère de Sonia, Marina, arrivée adolescente de Roumanie, épousa ensuite un Français, et ne parla à sa fille qu’en français ; celle-ci parle donc sa « langue paternelle » - sauf si l’on considère la langue maternelle comme celle de la mère patrie… Finalement, évoquant la figure, le sort et les écrits de Georges Perec, elle interroge une judéité qu’elle ne ressent pas, et le sentiment de l’exil : « Je suis étrangère à quelque chose de moi-même. » Familial, pathétique, historique, dramatique, Les exportés résonne aussi comme un questionnement personnel dans lequel le lecteur ne peut se sentir que profondément impliqué.
Jean-Pierre Longre
11:05 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, histoire, francophone, roumanie, sonia devillers, flammarion, jean-pierre longre, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/05/2023
L’exil et l’émotion
 Victoria Yakubova, Chez moi, préface de Volker Schlöndorff, éditions L’espace d’un instant, 2023
Victoria Yakubova, Chez moi, préface de Volker Schlöndorff, éditions L’espace d’un instant, 2023
« Chez moi, ce n’est pas uniquement territorial, chez moi, c’est aussi temporel, c’est aussi il y a vingt-cinq ans.
Alors chez nous, c’est il y a vingt-cinq ans à Tachkent, en Ouzbékistan, quand le monde n’était pas encore fou. Voilà où c’est, chez moi.
Chez moi, c’est à la fois nulle part et partout ! Ni le temps ni l’espace n’existent, disent-ils ! Et ils ont raison. »
Le récit relate les trajets d’un exil à l’autre suivis par la narratrice, à partir de l’émigration familiale depuis Tachkent jusqu’en Israël : « Nous sommes les « décabristes russes ». Incroyable. Il suffisait d’arriver dans le pays des Juifs pour devenir russes et surtout pour arrêter d’être juifs. » Et c’est la découverte d’une autre vie, d’autres mœurs, d’autres lectures, d’une autre guerre, d’autres contraintes, de l’amour…
Victoria ou « Vika », la narratrice, va plus tard accomplir son rêve : étudier le cinéma à l’université de Paris. « Mais le cœur est-il heureux ? » S’il y a de belles découvertes, de belles rencontres, il y a aussi les difficultés pour trouver un travail, obtenir des papiers, il y a la bureaucratie, les soupçons, les tribulations de l’exil… Et que de tracasseries pour envoyer un colis en Israël, ou pour exhiber les documents nécessaires au mariage : « L’Ouzbékistan ? Connais pas. » Puis un jour, la famille Yakubov (les parents, la sœur de New York, Victoria de Paris) se retrouve à Tachkent, dans son quartier, vingt-cinq ans après le départ : la maison, le parc Kirov, les souvenirs, le deuil… et le retour chacun « chez soi ».
Remarquons-le, les éditions L’espace d’un instant on fait une exception : publier un texte ne relevant pas du genre théâtral. Mais remarquons-le encore : ce texte tient à la fois du récit, de la poésie, du cinéma et du théâtre. Récit : on aura compris qu’il s’agit d’une narration à caractère autobiographique ; poésie : les courts paragraphes sont comme des versets ou des strophes au lyrisme tantôt contenu, tantôt éclatant (à faire même pleurer les employés de mairie à qui Victoria a fait connaître sa vie pour débloquer le processus administratif !) ; cinéma : autant de paragraphes poétiques, autant de brèves séquences relevant du montage susceptible de faire du lecteur un véritable spectateur ; théâtre : l’écriture de l’autrice tient de la mise en scène des mots, les caractères de certains d’entre eux mettant en relief le pathétique et l’émotion, cette émotion qui émane de chaque page, de chaque scène, de chaque phrase. Un art total.
Jean-Pierre Longre
Autres parutions récentes aux éditions L’espace d’un instant :
 Dino Pešut, Les Érinyes, filles du désespoir. Traduit du croate par Nicolas Raljević. Préface de Lada Kaštelan
Dino Pešut, Les Érinyes, filles du désespoir. Traduit du croate par Nicolas Raljević. Préface de Lada Kaštelan
Présentation
Un groupe de lycéens confronté à la violence et à la haine se débat pour exister et grandir. Marija a été droguée et violée en soirée par trois garçons. Roza lutte contre ses pulsions violentes et suicidaires. Dane se drogue et se bat. Ivan est passé à tabac parce qu’il est homosexuel. Martin, qu’il aime, a du mal à assumer cette relation. Sanjin est accro à la pornographie. Le viol a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, Sanjin filmait. Les Érinyes, persécutrices représentées par trois jeunes filles du lycée, se chargent de dénoncer et de punir ce que la bonne société dénonce comme des travers condamnables selon « les lois de l’État et les lois du ciel ». Finalement, ce viol devient l’occasion d’une prise de conscience et d’une sortie de l’adolescence : l’amour l’emporte sur la bêtise.
Dino Pešut est né en 1990 à Sisak, en Croatie. Diplômé de l’Académie des arts dramatiques de Zagreb, il travaille comme dramaturge et metteur en scène dans différents pays européens. Ses textes ont notamment été présentés au Théâtre national de Split, au Theatertreffen à Berlin et à la Mousson d’été. Il a obtenu le prix Marin-Držić du meilleur texte dramatique à six reprises, ainsi que le Deutscher Jugendtheaterpreis et le prix de la fondation Heartefakt. En 2019, il est accueilli en résidence au Royal Court Theatre de Londres.
 Wael Kadour, Chroniques d’une ville qu’on croit connaître. Traduit de l’arabe (Syrie) par Nabil Boutros et Simon Dubois. Préface de Monica Ruocco
Wael Kadour, Chroniques d’une ville qu’on croit connaître. Traduit de l’arabe (Syrie) par Nabil Boutros et Simon Dubois. Préface de Monica Ruocco
Présentation
Chroniques d’une ville qu’on croit connaître se déroule à Damas pendant les premières semaines de la révolution de 2011. Dans un moment de profonde transformation du pays, Rola tente de formuler sa propre interrogation sur son identité sexuelle et se retrouve dans une confrontation ouverte avec le pouvoir politique et social.
Braveheart a pour cadre une petite ville française inconnue, en 2021, et traite du problème de l’acte d’écriture depuis l’exil après l’effondrement de la question de la justice et l’impossibilité du retour à la patrie. Aline essaie d’écrire du matériel créatif et se retrouve prise entre un passé traumatisé et un futur illisible. Elle entre dans une relation amoureuse avec un jeune homme qui, selon elle, travaillait dans le renseignement et qui se déguise maintenant en une nouvelle personne.
Wael Kadour, né à Damas en 1981, est auteur, dramaturge et metteur en scène. Il a été accueilli en résidence notamment au Royal Court Theatre de Londres en 2007, ainsi qu’au Sundance Institute de New York en 2017. Il quitte la Syrie fin 2011 pour la Jordanie, avant d’arriver en France début 2016. Ses textes ont été présentés notamment à la Filature, scène nationale de Mulhouse, au Napoli Teatro Festival en Italie et au Weimar Festival en Allemagne.
 Ramzi Choukair, Y-Saidnaya / Palmyre, les bourreaux. Traduits de l’arabe (Syrie) par Ramzi Choukair, Simon Dubois et Céline Gradit. Préface de Pascal Rambert
Ramzi Choukair, Y-Saidnaya / Palmyre, les bourreaux. Traduits de l’arabe (Syrie) par Ramzi Choukair, Simon Dubois et Céline Gradit. Préface de Pascal Rambert
Présentation
Saidnaya et Palmyre, antiques villes syriennes, sont devenues sous le régime dictatorial de hauts lieux de détention. Dans une narration qui transcende le témoignage brut, les personnages, survivants de ces prisons d’effroi, dévoilent un système qui surveille et punit, instille la méfiance jusque dans les relations les plus intimes. Récits de vie autant que de détention, les histoires singulières des personnages évoquent, en creux, les rouages d’un régime de la terreur, perpétrée depuis plus de quatre décennies au moyen d’une étroite imbrication entre pouvoir politique, religion et corruption.
Ramzi Choukair est franco-syrien. Il a longtemps vécu entre la France et Damas, avant que cela ne devienne impossible. Depuis, au gré de ses rencontres, collectant des témoignages, en voyageant où il peut, il écrit. Il tente, avec les artistes-témoins qui l’accompagnent, avec humour parfois, de raconter l’enfer de la guerre et l’oppression au quotidien, l’histoire de ceux qui ont pu fuir, celle de ceux qui sont encore là-bas. Histoire parlée, dansée, chantée, de frontières qu’on passe et de pays, de clandestinité, de résistance. Pour rendre à ces villes leur héritage, ne pas laisser le régime effacer les mémoires individuelles du peuple syrien.
10:34 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, théâtre, francophone, ouzbékistan, victoria yakubova, volker schlöndorff croatie, syrie, dino pešut, nicolas raljević, lada kaštelan, wael kadour, nabil boutros, simon dubois, monica ruocco, ramzi choukair, céline gradit, pascal rambert, l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/10/2022
Anecdotes et souvenirs littéraires
 Roger Grenier, Les deux rives, préface de Jean-Marie Laclavetine, Gallimard, 2022
Roger Grenier, Les deux rives, préface de Jean-Marie Laclavetine, Gallimard, 2022
Roger Grenier (1919-2017), écrivain, journaliste, éditeur, lecteur chez Gallimard, a bien connu le monde littéraire. Dans cet ouvrage posthume, sous la forme d’anecdotes souvent souriantes, ironiques sans méchanceté, il rend compte à sa manière d’épisodes significatifs, parfois saugrenus, parfois émouvants, mettant en scène des personnalités connues ou méconnues.
Situés entre 1937 et 2005, maints événements confidentiels ou notoires sont tombés sous la plume alerte de l’auteur. C’est par exemple, en 1950, Marguerite Duras exclue du P. C. F. pour des raisons relevant de la morale la plus intransigeante ; la visite des fines fleurs de la Beat Generation (Jack Kerouac, Alan Ginsberg, Gregory Corso) dans les bistrots de Saint-Tropez ; les funérailles de Céline, en 1961, à l’occasion desquelles, dans son reportage pour France-Soir, Roger Grenier écrivit : « Il est toujours triste d’être obligé d’avoir honte d’un grand écrivain. » ; André Maurois faisant appel à des « nègres » ; des confidences de Serge Gainsbourg ; l’évocation de la mort, à Venise, de Wagner « se faisant faire une gâterie, comme on dit, par la femme de chambre »… On croise de grandes figures, amis ou connaissances de l’auteur, Camus bien sûr, Raymond Queneau, Jules Roy, Pierre Lazareff, Daniel Boulanger, et bien d’autres membres de la République des Lettres.
Ces échos des « deux rives » sont précédés de trois nouvelles, dans lesquelles Roger Grenier évoque aussi – souvenirs mêlés de fiction – des figures attachantes, discrètes voire secrètes, avec un art consommé du récit bref et du suspense narratif. Et ils sont suivis d’un texte s’attardant sur ce qui fut pour le petit Roger « un inépuisable livre d’images », deux volumes du magazine L’Illustration, aux photos « prodigieuses », atteignant « les sommets du chauvinisme ».
Comme l’écrit Jean-Marie Laclavetine dans sa préface, Roger Grenier fut « un esprit discrètement libertaire et d’un antimilitarisme foncier » (ce qui ne l’empêcha pas, entre autres engagements, de participer à la libération de Paris). Et dans cet ultime ouvrage, il use « toujours du ton d’ironie modeste et du sourire en coin de ceux qui ont perdu toute illusion quant aux capacités d’amélioration de l’espèce. » Un exemple pour finir ? En 1968 : « Mes fils, Frédéric et Nicolas, ont 15 et 13 ans. Comme je leur dis : « Il faudrait quand même que vous lisiez La Condition humaine ou Les Conquérants », l’un d’eux réplique : « Tu ne te figures pas que je vais lire les livres d’un ministre ! » Je me dis alors que Malraux vient de trouver sa punition. »
Jean-Pierre Longre
19:45 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelles, chroniques, autobiographie, récit, francophone, roger grenier, jean-marie laclavetine, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/06/2022
« Elle avait toujours raison »
 Alain Joubert, Toyen. Petits faits et gestes d’une très grande dame, Ab irato, 2022
Alain Joubert, Toyen. Petits faits et gestes d’une très grande dame, Ab irato, 2022
Comptée au nombre des surréalistes, née à Prague et figure majeure de l’avant-garde tchèque, Toyen (Maria Čerminová, 1902-1980) dépasse largement les limites des classifications. Créatrice avec Jindřich Štyrský de l’artificialisme et fondatrice du mouvement surréaliste tchèque, elle rejoint après la guerre le groupe français, liée d’une forte amitié avec certains de ses membres. L’exposition de ses œuvres (peintures, collages, dessins etc.) au Musée d’Art Moderne de Paris (jusqu’au 24 juillet 2022) témoigne de l’originalité de son œuvre.
Cette originalité, Alain Joubert (1936-2021) en témoigne à sa manière, celle de quelqu’un qui, lui-même partie prenante dans les activités surréalistes des années 1950-1960, a connu Toyen dans sa vie quotidienne, dont il évoque ici « quelques moments », montrant combien sa « vie réelle » a pu influer sur sa « vraie vie », celle de l’art. Alors nous voici embarqués avec elle au café où elle retrouvait André Breton et son groupe, ainsi que ses « complices » Benjamin Péret, Charles Estienne et quelques autres. Nous voici confrontés à un langage que l’auteur appelle « le toyen », fort en accent et en images nouvelles, du genre : « Ti sais, moi, j’y bouffe du cinéma ! » ; ou partageant avec elle des tâches ménagères qu’elle considérait comme secondaires, et un goût inattendu pour le Rock de Vince Taylor ; ou séjournant avec elle à Saint-Cirq-Lapopie, s’adonnant à la natation ou à des mimes endiablés devant ses compagnons ; ou encore à l’hôpital, où elle manifestait ouvertement sa détestation de la religion et son éloignement de toutes « racines », se caractérisant par deux mots : surréaliste et APATRIDE.
Relatés sur le mode personnel, émaillés d’anecdotes savoureuses et d’illustrations photographiques, ponctués par le tableau « L’échiquier » (1963), ces « petits faits et gestes d’une très grande dame » révèlent une personnalité hors du commun, dynamique, robuste physiquement, intellectuellement, esthétiquement. Et comme l’écrit Alain Joubert : « Soyons clairs : elle avait toujours raison… ».
Jean-Pierre Longre
09:39 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, illustrations, francophone, alain joubert, jean-pierre longre, toyen, ab irato | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/04/2022
Mère et fils
 Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022
Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022
Il a beau faire, beau dire, beau écrire, Édouard Louis n’en a pas tout à fait fini avec Eddy Bellegueule. Après son fameux livre de 2014, il a malgré tout pris en 2018 la défense de son père, violent mais maltraité par l’injustice sociale (Qui a tué mon père, Le Seuil), et trois ans plus tard il retrace ce qu’il appelle les « combats et métamorphoses » de sa mère.
Cette mère sur qui le malheur s’est acharné – deux maris au mieux indifférents, au pire violents, des grossesses répétées, la misère nourrie par l’alcool, la honte « de notre maison, de notre pauvreté »… Et malgré cela, la volonté de s’en sortir, la recherche d’un bonheur qui paraît illusoire, trompeur : « J’avais tellement l’habitude de la voir malheureuse à la maison, le bonheur sur son visage m’apparaissait comme un scandale, une duperie, un mensonge qu’il fallait démasquer le plus vite possible. » Pourtant elle le trouvera en rompant avec la résignation, en se rapprochant de son fils, en trouvant un emploi, en s’installant à Paris avec un nouveau compagnon, en s’adaptant à la vie citadine jusqu’à transformer son langage, en rencontrant d’autres gens (même Catherine Deneuve, le temps de fumer une cigarette avec elle !).
 Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.
Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.
Jean-Pierre Longre
23:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2022
Singularités d’un foisonnant patronyme
 Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin n’est pas Monsieur Ducon, loin s’en faut. Rappelez-vous ce texte de Jacques Prévert, chanté par Yves Montand, les Frères Jacques et sans doute quelques autres, où est contée l’histoire d’un homme triste, si triste parce qu’il s’appelle Ducon, et qui, ayant découvert dans un vieux Bottin qu’il est « le seul Ducon », change complètement d’humeur et « poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. » À l’opposé, il y a les Martin, qui « pullulent », « essaiment », « se multiplient ». Pour leur malheur ? En tout cas pour le bonheur du lecteur plongé dans l’ouvrage du prénommé Jean-Pierre qui, ne se contentant pas de son patronyme, l’étend à ses équivalents étrangers (Martins, Martinez, Martinson etc.). Mais rassurons-nous; sur le nombre incommensurable, et même s’il leur accorde plus de sept cents pages, il fait un choix : quarante et un chapitres consacrés à autant (disons un peu plus) de Martin, c’est déjà une épopée, un monument d’érudition, un multiple voyage dans le temps et dans l’espace.
Il avoue que « Nous, les Martin, nous formons un monde. Un monde inconnu de lui-même. » Son « Grand Récit » s’adresse donc aussi, et peut-être avant tout, à sa grande famille patronymique, où se sont illustrés voyageurs et baroudeurs, créateurs et découvreurs, mais aussi « Saints et Soldats plus souvent qu’à leur tour », à l’image du fameux Martinus (IVe siècle), celui que le geste de partager son manteau a rendu célèbre… Ce qui n’empêche pas l'hommage rendu à Sainte Martine, vierge et martyre du IIIe siècle – qui a donc précédé son pendant masculin… Si le « saint fondateur » est bien présent, il y a aussi le souci de rendre justice à des Martin méconnus et pourtant eux aussi fondateurs, en tout cas inventeurs : deux chapitres intitulés « L’invention de l’Amérique » consacrent Joseph Plumb Martin (« Martin yankee ») et Joseph Martin (« Martin cherokee »), un autre, intitulé « Naissance de l’Australie », évoque James Martin (ne pas confondre avec un autre James Martin, évadé de Botany Bay)…
C’est dire leur importance, voire leur puissance de création. Impossible évidemment (et inutile) de reprendre ici toutes les trouvailles, tous les détails historiques qui rythment ces pages. Je m’arrêterai un instant sur le chapitre consacré à Claude Martin, « dit le Major Martin », que les Lyonnais connaissent surtout comme le « fondateur de La Martinière », ces lycées dont il avait demandé la création dans son testament. On sait moins qu’il fut un grand voyageur, un aventurier, « négociant, financier et promoteur » : « Le sens des affaires, l’esprit d’entreprise qu’il se découvre doivent l’étonner lui-même. » Autre domaine : le Martin (Jean-Pierre) musicien ne pouvait faire l’impasse sur le Martinů (Bohuslav) compositeur, le « quatrième mousquetaire tchèque » (avec Dvořak, Janáček et Smetana), dont la biographie mouvementée (entre sa Bohême natale, Paris, New-York…) est à l’image de l’œuvre, abondante et multiple, en dehors des écoles et des modes – une originalité qui ne doit pas être pour déplaire à la tribu des Martin.
« Sept mille soixante-quatorze Martin, sans compter les disparus » : ils mériteraient d’être tous nommés, ces Martin morts dans les batailles et les tranchées de la guerre de 1914-1918 ; mais la liste en est si longue ! Hommage collectif, donc, et particulier pour Nelly Martin, une « diva » (pseudonyme Nelly Martyl), qui s’est engagée comme infirmière « sous la mitraille ». Et en matière d’engagement, nous avons deux Henri Martin représentant deux bords radicalement opposés, deux conceptions entre lesquelles l’auteur a manifestement choisi la deuxième (à bon escient), celle qui a produit le « saint laïc » en lutte contre le colonialisme et participant au roman national. Écoutez ce double hommage : « Dans mon lignage, tu es à la fois le contraire et le double de Thérèse Martin, dite de Lisieux : toi, Henri, le petit soldat réfractaire, et elle, Thérèse, la petite sainte de province, vous êtes deux icônes de notre tradition nationale. Vous appartenez à deux mémoires cloisonnées, vous plantez vos drapeaux dans deux régions antipodiques : les lendemains qui chantent ici-bas et le paradis du Très-Haut. » Cela dit, comme les Jean-Pierre (j’en connais plusieurs) ou les Jacques (même remarque), les Henri foisonnent ; outre les précédents, un peintre, un historien et homme politique (cher aux amateurs de Monopoly), et bien d’autres qu’il aurait été fastidieux de recenser, et qui ne le sont pas.
Jean-Pierre Martin (notre auteur) n’a vraiment pas rechigné. Son livre est le fruit, n’en doutons pas, d’un travail colossal, de recherches rigoureuses (livres, journaux, archives), de pêche en eaux profondes (martin-pêcheur… facile). Mais il ne s’agit pas que de cela. Jean-Pierre Martin est un écrivain, et même si l’on peut lire son livre « à sauts et à gambades », nous avons affaire à un roman riche en péripéties et en ramifications, ou à une série de romans qui, comme les Martin, peuvent se reproduire et se multiplier à l’infini.
Jean-Pierre Longre
19:04 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, histoire, francophone, jean-pierre martin, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/08/2021
Effrayants mécanismes
 Lire, relire... Éric Vuillard, L’ordre du jour, Actes Sud, 2017, Babel, 2021
Lire, relire... Éric Vuillard, L’ordre du jour, Actes Sud, 2017, Babel, 2021
Prix Goncourt 2017
Il n’est pas fréquent de rencontrer dans ces pages des livres qui figurent en tête des ventes en librairies. Je ferai pourtant une exception pour le Prix Goncourt 2017, qui est lui-même une exception dans sa catégorie, puisqu’il ne s’agit pas d’un roman, mais d’un « récit », qui plus est d’un récit bref (150 pages). Mais si l’on admet que la littérature aide, entre autres, à débusquer la vérité cachée derrière les leurres, les masques, le voile des apparences, alors oui, L’ordre du jour, dans son exploration des bas-fonds de l’Histoire, est une véritable œuvre littéraire. « La vraie pensée est toujours secrète, depuis l’origine du monde. On pense par apocope, en apnée. Dessous, la vie s’écoule comme une sève, lente, souterraine. », écrit l’auteur à propos des jeunes filles qui, à Vienne en 1938, accueillirent Hitler dans l’enthousiasme : « Comment séparer la jeunesse que l’on a vécue, l’odeur de fruit, cette montée de sève à couper le souffle, d’avec l’horreur ? Je ne sais pas. ».
 On l’aura compris, il s’agit ici de l’Anschluss, de ses prémices, de ses secrets, de ses effrayants mécanismes, de ce qui ne se raconte pas habituellement. Le récit commence par la rencontre, en 1933, des grands industriels allemands, Krupp en tête, avec Goering et Hitler venus leur demander de verser leur contribution pour aider le parti nazi à conquérir définitivement le pouvoir – ce qu’ils s’empressent de faire, chacun à sa mesure. Il se termine avec les mêmes industriels qui, à la fin de la guerre, ont largement augmenté leur fortune en utilisant une main-d’œuvre des plus rentables : les déportés de Buchenwald, Auschwitz, Dachau, Dora, Mauthausen (etc.), qui littéralement mouraient à la tâche (l'auteur de ce compte rendu se sent particulièrement concerné, puisque son oncle maternel Pierre Penel, résistant, arrêté sur dénonciation à Lyon, torturé, déporté, est mort d'épuisement et de maladie au camp de Dora).
On l’aura compris, il s’agit ici de l’Anschluss, de ses prémices, de ses secrets, de ses effrayants mécanismes, de ce qui ne se raconte pas habituellement. Le récit commence par la rencontre, en 1933, des grands industriels allemands, Krupp en tête, avec Goering et Hitler venus leur demander de verser leur contribution pour aider le parti nazi à conquérir définitivement le pouvoir – ce qu’ils s’empressent de faire, chacun à sa mesure. Il se termine avec les mêmes industriels qui, à la fin de la guerre, ont largement augmenté leur fortune en utilisant une main-d’œuvre des plus rentables : les déportés de Buchenwald, Auschwitz, Dachau, Dora, Mauthausen (etc.), qui littéralement mouraient à la tâche (l'auteur de ce compte rendu se sent particulièrement concerné, puisque son oncle maternel Pierre Penel, résistant, arrêté sur dénonciation à Lyon, torturé, déporté, est mort d'épuisement et de maladie au camp de Dora).
Entre ces deux évocations, tout le processus de l’Anschluss est démonté. On n’en reprendra pas ici les différents épisodes (les concessions, les manœuvres, les menaces…), épisodes connus mais qui sont minutieusement détaillés, avec des gros plans permettant d’en distinguer les rouages malsains et malfaisants. On apprend aussi que l’armée allemande envahissant l’Autriche était loin d’être opérationnelle (« une armée en panne, c’est le ridicule assuré »), et que si les nations européennes (France et Grande-Bretagne en particulier) n’avaient pas alors pratiqué une « politique d’apaisement » avec l’Allemagne, celle-ci n’aurait peut-être pas fait le poids.
Le livre d’Éric Vuillard, comme les précédents, est un retour sur l’Histoire, avec des épisodes méconnus, des digressions significatives, des ralentis et des arrêts sur image qui révèlent, dans un style saisissant, les réalités que beaucoup ont eu intérêt à dissimuler. « La vérité est cachée dans toute sorte de poussières », les poussières de la violence, de l’impuissance, de l’effroi et de l’horreur. Et c’est toujours à « l’ordre du jour ». À méditer, ici et maintenant.
Jean-Pierre Longre
18:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, histoire, francophone, Éric vuillard, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/06/2021
Un astronome original
 Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021
Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021
Nicolas Cavaillès a l’art de dénicher des sujets et des personnages à la fois méconnus et porteurs de questionnements sans précédents, ouvrant de nouveaux horizons. Il y a eu la vie aventureuse de Monsieur Leguat, les destins particuliers des enfants Schumann, le tour de l’île Maurice par un âne portant un cadavre sur le dos, les sauts mystérieux des baleines (On trouvera sur http://jplongre.hautetfort.com/tag/nicolas+cavaill%C3%A8s des chroniques sur les ouvrages et les traductions de Nicolas Cavaillès)… Cette fois, c’est Tycho Brahe, astronome danois du XVIe siècle, qui occupe la centaine de pages d’un ouvrage tenant de la biographie et de la réflexion sur le rythme du temps.
 Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».
Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».
L’auteur ne s’en tient pas à l’histoire. Du récit de la vie et des trouvailles de son héros, il tire des anecdotes où il est question de Giordano Bruno, de Copernic, de Johannes Kepler (qui fut « l’un de ses proches collaborateurs »), et même de Shakespeare, puisque se pose la question de savoir si la Tragédie du prince Hamlet n’aurait pas quelque rapport avec le destin de Tycho… Bref, voilà un ouvrage à la fois savant et savoureux qui, dépassant le sujet d’une biographie déjà intéressante en soi et même d’une méditation sur le découpage temporel, nous mène vers des sphères insoupçonnées.
Jean-Pierre Longre
à paraître le 26 août 2021
17:11 Publié dans Essai, Littérature, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, francophone, tycho brahe, nicolas cavaillès, Éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/04/2021
Comique existentiel
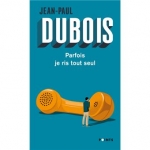 Jean-Paul Dubois, Parfois je ris tout seul, Points, 2021
Jean-Paul Dubois, Parfois je ris tout seul, Points, 2021
Le titre l’atteste : Jean-Paul Dubois a dû bien s’amuser en écrivant ces mini-textes (une page chacun au maximum) parus initialement en 1992 chez Robert Laffont, puis en 2007 aux éditions de l’Olivier. C’est un fait : on rit franchement à la réponse que font les parents (la mère surtout) à la question sur les raisons qui font que les chiens se montent dessus et restent collés l’un à l’autre, au dialogue de deux mécanos évoquant Picasso en se disputant sur la couleur d’un manche de tournevis, à des souvenirs culinaires et bien écœurants de cantine d’école religieuse, ou à des propos de comptoir du genre : « T’es vraiment le cousin du pape ? » Et on apprécie à juste titre certaines surprises finales, par exemple dans la confrontation d’un rêve ou d’un fantasme à la réalité, ou dans la réponse acerbe à une question : « Tu me demandes ce que je voudrais ? Ce que j’attends de toi ? Qu’au moins une fois dans notre vie, tu te comportes comme un être humain. »
Mais comme souvent chez l’auteur, la plaisanterie cache des réflexions et des états d’âme plus profonds qu’il n’y paraît. Le tragique n’est pas toujours loin, lorsqu’il s’agit de dire que « la vérité c’est une chose avec laquelle il ne faut pas rigoler. » Et surtout, les questions existentielles forment une trame régulière, en rapport avec les sensations physiques et la maladie : « Je suis toujours tendu, anxieux. […] J’ai l’impression que quelque chose grésille en moi, la sensation d’avoir la poitrine remplie de hannetons. » Et lorsqu’on s’interroge sur la santé des mouches, on se doute qu’il s’agit de celle des humains. En rapport aussi avec le sentiment amoureux, souvent déçu. Peut-on être heureux ? Oui, si l’on en croit le destin de cet homme (« mon père ») qui se transforme en gitan (sur une remarque de sa femme) en achetant une « Chevrolet Bel Air Power Glide 1957, noire, pavillon blanc », ou si l’on apprécie avec le narrateur de rouler tranquillement au volant de sa voiture et de s’allumer une cigarette…
Il y a donc le choix. Chacun peut se promener à sa guise et à sa façon dans cette forêt livresque, glaner çà et là telle ou telle bribe, y voir de l’humour, de l’inquiétude, de l’insolite, des problèmes irrésolus, des réponses improbables, du plaisir, du bonheur, du malheur… Avec toujours dans un coin de la tête cette question qui clôt une page commençant par « T’as aucune morale » : « Le problème avec toi, c’est qu’on sait jamais quand tu déconnes. »
Jean-Pierre Longre
19:56 Publié dans Essai, Humour, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chroniques, récit, humour, francophone, jean-paul dubois, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/12/2020
L’amour à l’écossaise (économie de moyens)
 Hervé Le Tellier, Je m'attache très facilement, Mille et une nuits, 2007
Hervé Le Tellier, Je m'attache très facilement, Mille et une nuits, 2007
« Notre héros » (puisque c’est sous ce nom que notre auteur dissimule son personnage) est amoureux de « notre héroïne », cela semble clair. Ce qui est aussi clair, c’est que celle-ci a pris ses distances avec celui-là, distances géographiques, physiques, sentimentales.
L’histoire est simple : un homme, menacé par la cinquantaine et la calvitie, débarque en Ecosse pour y retrouver pendant quelques jours une jeune femme qui fut sa maîtresse à Paris. Elle habite chez sa mère, attendant l’arrivée de son « régulier » (« presque un mari ») – alors que notre héros est pour ainsi dire son « irrégulier », celui qui vient la visiter en catimini. Evidemment, comme il devait le prévoir, comme il le prévoyait sans vraiment vouloir se l’avouer, c’est la solitude qui l’attend, une solitude à peine ponctuée de quelques rendez-vous avec la jeune femme, de quelques verres de bière, de quelques errances dans une Ecosse peu conforme aux clichés, de quelques bouffées de désir insatisfait. Déçu, notre héros ? Oui, mais à peine ; il faut bien qu’il reparte, après que notre héroïne l’a gratifié de gestes tendres avidement réclamés, chichement concédés (elle est écossaise, rappelons-le) et teintés de remords, ou de regrets.
La situation est pathétique, certes, mais narrée avec le recul humoristique d’un auteur qui sait ce qu’écrire veut dire – et aimer aussi, certainement. Les silhouettes des personnages passent sur le fond lumineux d’une Ecosse d’aujourd’hui, entre deux avions, entre deux autoroutes, entre les moutons paisibles, quand même toujours là. L’ironique dissection des sentiments et des situations paraît vouloir éviter le pathos, et tout compte fait le met en relief aux moments cruciaux. Avec une sensible économie de moyens, l’écriture d’Hervé Le Tellier nous rappelle comment les hommes se laissent transporter par l’amour : lucidement et follement.
Jean-Pierre Longre
21:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, oulipo, hervé le tellier, mille et une nuits, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/03/2020
« Accumuler le merveilleux »
 David B., Nick Carter et André Breton. Une enquête surréaliste, Éditions Soleil, Noctambule, 2019
David B., Nick Carter et André Breton. Une enquête surréaliste, Éditions Soleil, Noctambule, 2019
Nick Carter, le fameux détective aux multiples aventures, mis à contribution dans la littérature feuilletonesque depuis la fin du XIXème siècle, mais aussi plus récemment au cinéma et dans la bande dessinée, a été l’un des personnages populaires préférés des surréalistes, qui ont toujours eu un faible pour les êtres éveillant l’imaginaire et suscitant le rêve. Enquête et rêve, David B. s’empare de ce double sujet, écrivant à la fin de sa préface : « Ainsi m’est-il venu l’idée d’associer le personnage de fiction qu’est Nick Carter au véridique André Breton au cœur d’une enquête surréalistico-feuilletonesque où s’entremêlent leurs deux univers à la recherche de ce que le chef du mouvement surréaliste appelait “l’or du temps”. ».
 Nous voilà donc embarqués dans cette enquête qui, de 1931 aux années 1960 (disons 1966, année de la mort de Breton), nous permet de revivre, en mots et en images, les péripéties qui ont jalonné l’histoire du mouvement surréaliste, ainsi que les motifs qui l’ont guidé, et que la deuxième planche du livre rappelle, au moins en grande partie : « Beauté, amour, jeu, révolution, suicide, poésie, hasard, amis, manifestes, possible, signes »… Au fil des pages, on croise la plupart des grandes figures du groupe, qui a connu non seulement les amitiés et les complicités, mais aussi les querelles, les exclusions, et bien sûr les excès. Ils sont (presque) tous là : Desnos, Nadja, « les grands transparents », Dali et Gala, Crevel, Aragon, Bataille, Ernst, Ray, Tanguy, et aussi Frida Kahlo, les Belges Nougé, Mesens, Magritte (qui d’ailleurs raconta sur le mode parodique cher aux surréalistes de son pays les aventures d’un autre fameux détective, Nat Pinkerton), ou encore le PCF et Trotski… Et bien sûr, le docteur Quartz, ennemi juré de Nick Carter, courant après l’argent, alors que, notre héros va le comprendre, la vraie mission que cet « étrange client » qu’est André Breton confie au détective, c’est d’ « accumuler du merveilleux ».
Nous voilà donc embarqués dans cette enquête qui, de 1931 aux années 1960 (disons 1966, année de la mort de Breton), nous permet de revivre, en mots et en images, les péripéties qui ont jalonné l’histoire du mouvement surréaliste, ainsi que les motifs qui l’ont guidé, et que la deuxième planche du livre rappelle, au moins en grande partie : « Beauté, amour, jeu, révolution, suicide, poésie, hasard, amis, manifestes, possible, signes »… Au fil des pages, on croise la plupart des grandes figures du groupe, qui a connu non seulement les amitiés et les complicités, mais aussi les querelles, les exclusions, et bien sûr les excès. Ils sont (presque) tous là : Desnos, Nadja, « les grands transparents », Dali et Gala, Crevel, Aragon, Bataille, Ernst, Ray, Tanguy, et aussi Frida Kahlo, les Belges Nougé, Mesens, Magritte (qui d’ailleurs raconta sur le mode parodique cher aux surréalistes de son pays les aventures d’un autre fameux détective, Nat Pinkerton), ou encore le PCF et Trotski… Et bien sûr, le docteur Quartz, ennemi juré de Nick Carter, courant après l’argent, alors que, notre héros va le comprendre, la vraie mission que cet « étrange client » qu’est André Breton confie au détective, c’est d’ « accumuler du merveilleux ».
 En réalité, cette mission est pleinement remplie par David B. lui-même : cinquante pages de dessins à la fois surréalistes, baroques et fantastiques, bourrés de références, dans lesquels le hasard objectif, les cadavres exquis, le jeu des surprises, l’étrange et ses déformations se combinent, se rencontrent, s’entrechoquent en noir et blanc et en action, chaque image étant complétée par un texte résumant d’une manière condensée l’essentiel de l’aventure surréaliste. Un cheminement historique et onirique au cours duquel la « beauté convulsive » chère à Breton explose et se fixe sur chaque image.
En réalité, cette mission est pleinement remplie par David B. lui-même : cinquante pages de dessins à la fois surréalistes, baroques et fantastiques, bourrés de références, dans lesquels le hasard objectif, les cadavres exquis, le jeu des surprises, l’étrange et ses déformations se combinent, se rencontrent, s’entrechoquent en noir et blanc et en action, chaque image étant complétée par un texte résumant d’une manière condensée l’essentiel de l’aventure surréaliste. Un cheminement historique et onirique au cours duquel la « beauté convulsive » chère à Breton explose et se fixe sur chaque image.
Jean-Pierre Longre
17:09 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dessin, récit, francophone, andré breton, david b., Éditions soleil, noctambule, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/01/2020
Journal d’une reconstruction
 Lire, relire, 5 ans après... Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, Folio 2019.
Lire, relire, 5 ans après... Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, Folio 2019.
Prix Femina 2018. Prix spécial du jury Renaudot 2018
À l’hôpital de la Salpêtrière, quelques jours après l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie-Hebdo qui lui a emporté la mâchoire, Philippe Lançon, pensant à l’infirmière de nuit qui « avait le prénom d’un personnage de Raymond Queneau », se prend à évoquer deux vers de l’écrivain : « Je crains pas ça tellment la mort de mes entrailles / et la mort de mon nez et celle de mes os ». Quelques strophes plus loin, Queneau écrit ceci, qui pourrait s’appliquer à ce que Lançon tente de dépasser : « Je crains bien le malheur le deuil et la souffrance / et l’angoisse et la guigne et l’excès de l’absence / Je crains l’abîme obèse où gît la maladie / et le temps et l’espace et les torts de l’esprit ».
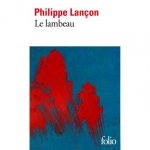 Rescapé de la tuerie dont il fait un récit à la fois terrifiant et subjectif, le récit d’une « abjection » vue du point de vue particulier d’une victime qui attend « simultanément l’invisibilité et le coup de grâce – deux formes de la disparition », l’auteur, journaliste à Charlie-Hebdo et à Libération, consacre le reste des 500 pages de son livre à la reconstruction : celle de sa mâchoire, qui va nécessiter de nombreuses opérations, et celle de sa personne tout entière, corps et esprit. Aucun détail ne nous est caché de ces mois de soins, de greffes, de suintements, de silences, d’interrogations, d’espoirs, de souffrances, d’attente au long desquels Chloé, sa chirurgienne, prend une importance médicale et humaine de plus en plus grande. L’entourage aussi tient une place prépondérante dans l’accompagnement du « patient » : son frère, ses parents, son ex-femme Marilyn, sa compagne Gabriela, ses nombreux et chaleureux amis ; et la lente progression du récit de la réparation, avec ses hauts et ses bas, est si prégnante, les précisions sanitaires et psychologiques si circonstanciées que nous, lecteurs, sommes complètement pris dans la nasse, au point de nous confondre avec l’auteur adressant ses plaintes au corps médical : « Docteur, vous m’écoutez ? La jambe et le pied droit me font mal, la cuisse droite aussi, plus encore la nuit que le jour. Le simple contact du drap m’irrite le pied entier et m’empêche de dormir. Les nerfs semblent à vif. La malléole me fait particulièrement souffrir. […] Le menton, de plus en plus envahi par les fourmis, est vivant. J’en suis venu à croire que je pense par le menton. Heureusement, je pense peu. ». Nous sommes avec lui, pleinement.
Rescapé de la tuerie dont il fait un récit à la fois terrifiant et subjectif, le récit d’une « abjection » vue du point de vue particulier d’une victime qui attend « simultanément l’invisibilité et le coup de grâce – deux formes de la disparition », l’auteur, journaliste à Charlie-Hebdo et à Libération, consacre le reste des 500 pages de son livre à la reconstruction : celle de sa mâchoire, qui va nécessiter de nombreuses opérations, et celle de sa personne tout entière, corps et esprit. Aucun détail ne nous est caché de ces mois de soins, de greffes, de suintements, de silences, d’interrogations, d’espoirs, de souffrances, d’attente au long desquels Chloé, sa chirurgienne, prend une importance médicale et humaine de plus en plus grande. L’entourage aussi tient une place prépondérante dans l’accompagnement du « patient » : son frère, ses parents, son ex-femme Marilyn, sa compagne Gabriela, ses nombreux et chaleureux amis ; et la lente progression du récit de la réparation, avec ses hauts et ses bas, est si prégnante, les précisions sanitaires et psychologiques si circonstanciées que nous, lecteurs, sommes complètement pris dans la nasse, au point de nous confondre avec l’auteur adressant ses plaintes au corps médical : « Docteur, vous m’écoutez ? La jambe et le pied droit me font mal, la cuisse droite aussi, plus encore la nuit que le jour. Le simple contact du drap m’irrite le pied entier et m’empêche de dormir. Les nerfs semblent à vif. La malléole me fait particulièrement souffrir. […] Le menton, de plus en plus envahi par les fourmis, est vivant. J’en suis venu à croire que je pense par le menton. Heureusement, je pense peu. ». Nous sommes avec lui, pleinement.
Le récit n’est pas pour autant égocentré. Outre la leçon de courage et l’éloge du personnel hospitalier, nous avons affaire à une émouvante et pittoresque galerie de portraits : ceux des familiers, mais aussi ceux de pas mal d’inconnus, soignants et soignés, hommes et femmes croisés en chemin, policiers chargés de la protection de celui qui reste une cible potentielle, policiers pour qui il se prend d’une amitié reconnaissante, quand ce n’est pas d’une complicité souriante, silhouettes entrevues, toute une humanité bien campée dans son environnement ou perdue dans l’incertain. Et l’écriture acérée, poétique, chargée de sens ou pétrie de questions de Philippe Lançon est à bonne école. On ne le trouve jamais sans son Proust, son Kafka ou son Thomas Mann, qu’il emporte jusqu’au bloc pour lire et relire ses passages favoris ; sans oublier la musique : Bach le plus souvent possible (Les Variations Goldberg, Le Clavier bien tempéré, L’Art de la Fugue), le jazz aussi… Le lambeau n’est pas une simple « hostobiographie » (pour reprendre le mot-valise d’Alphonse Boudard), mais le roman d’une tranche de vie personnelle qui vaut toutes les destinées (comme l’a écrit Sartre cité par Lançon : « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. »), toutes les destinées donc, avec leurs inévitables paradoxes : alors que l’auteur, jouissant de ses premiers instants de vraie liberté, peut enfin rejoindre sa compagne à New-York, éclate l’attentat du 13 novembre 2015 à Paris. Même de loin, c’est un nouveau « décollement de conscience ».
Jean-Pierre Longre
09:09 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, philippe lançon, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/11/2019
Contes du monde comme il va
 Manuel Anceau, Lormain, Ab irato, 2019
Manuel Anceau, Lormain, Ab irato, 2019
Comme c’était le cas avec son recueil précédent, Livaine (dont Lormain, nous dit-on à juste titre, est le pendant masculin), Manuel Anceau donne à ses nouvelles des allures de contes – et pas seulement des allures. En effet, si les récits sont au départ enracinés dans le réel (un village avec ses rumeurs et ses secrets, le monde de l’entreprise et ses pratiques implacables, la famille et ses non-dits, la campagne investie par les promoteurs, la vie scolaire et ses brutalités, les transports en commun, l’angoissante disparition d’une fillette – on en passe), ce réel se transforme, par le jeu des mots et des phrases (et aussi par celui des noms propres), en imaginaire, à la limite du merveilleux ou du fantastique, sans vraiment franchir la frontière.
Il y a ici des portraits et des situations de toutes sortes, qui se succèdent et se superposent hardiment, étrangement, inexorablement. Les personnages attachants sont souvent les proies d’êtres rebutants, qui leur ressemblent pourtant un peu, ou qui les gangrènent petit à petit. Et l’inverse peut se produire. Les situations confortables ou rassurantes ne le restent pas longtemps, en général ; et ce n’est pas toujours de la faute des gens ; ce peut être à cause du monde comme il va (à la réflexion, c’est presque toujours le cas). Car la plupart des gens, même ceux qui n’inspirent pas confiance, sont des victimes : de la souffrance, du deuil, du malheur, de l’incompréhension, de la solitude, des mystères de la vie et de la mort, du destin…
Au-delà des intrigues, de leurs ombres portées et de leurs prolongements, ce qui est remarquable dans ces nouvelles (ces contes), c’est leur style. Un style qui n’a pas son pareil pour faire d’une histoire qui ailleurs revêtirait les oripeaux de la banalité quotidienne une plongée dans les profondeurs de l’âme et dans les tourbillons de la société. Les hommes ont tous leurs mystères (les animaux aussi, ainsi que les arbres et les plantes, le ciel, le jour et la nuit), et les phrases de Manuel Anceau les explorent, ces mystères, en suivant les chemins détournés et méconnus d’une syntaxe pleine de sauts, de pauses et de rebonds, de détours et de contours. Un seul exemple : « Et c’est ainsi que, ce lundi matin, marchant très tôt déjà dans les rues : je le vis venir vers moi ; vers moi, par accident pensai-je aussitôt : étant ce matin-là le seul bonhomme à marcher sur ce trottoir, il fallait bien que son impatience à dire ce qu’il avait vu, ou cru voir, trouvât un déversoir – et ce déversoir ce furent mes oreilles ; vers moi, seul à marcher sur ce trottoir ; étais-je pour autant le premier être humain à qui ce matin-là il aura parlé ? ». À nous, lecteurs, de recevoir les mots comme si nous étions les premiers à les lire.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, conte, récit, francophone, manuel anceau, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/07/2019
De qui Chestov est-il le nom ?
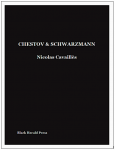 Nicolas Cavaillès, Chestov & Schwarzmann, Black Herald Press, 2019
Nicolas Cavaillès, Chestov & Schwarzmann, Black Herald Press, 2019
À la question ci-dessus, Nicolas Cavaillès, dont les livres ramassent et condensent en quelques dizaines de pages ce que d’autres développent en de gros traités ou de gras romans, répond d’une manière personnelle, originale et séduisante. D’aucuns diront que le « philosophe tragique » (selon Fondane), cet « obsédé de l’impossible » (selon Cavaillès) est vu par le petit bout de la lorgnette, ce que ne semble pas démentir l’introduction en forme de dédicace à Norman Manea, puisque l’auteur y annonce modestement des « scènes et anecdotes », des « singularités, incidents, faits divers puisés entre les lignes de sa légende » ; mais la lorgnette, tout de même, cherche à « illustrer l’incompréhensible ou l’insoluble », et y parvient parfaitement.
Il y a, oui, de petits morceaux d’existence de celui qui vécut « écartelé entre deux chutes connexes : celle d’une brique sur lui et sa propre glissade dans le néant » et avait peur, après avoir prononcé un discours, de « tomber à terre » parce qu’on lui aurait ôté sa chaise (supposition bouffonne mais angoissante), ce Chestov qui s’appelait en réalité Lev Isaakovitch Schwarzmann (et Nicolas Cavaillès ne se prive pas de décortiquer ce nom et les raisons supposées du changement), comme s’il y avait deux personnes en une, ou une personne « fissurée », divisée en deux : un Chestov « né Schwarzmann » ou un « Schwarzmann né en Chestov »… De quoi « se cogner le front contre le mur », mais surtout de quoi suivre les tribulations d’un philosophe qui aura tenté de franchir les murs qui enferment la liberté, de trouver la faille qui lui aura permis de partir « là-bas ».
Bref, à partir de là, le récit, qui adopte le tutoiement à la fois intime et respectueux, devient plus biographique. Le « là-bas » en question est la Palestine, où Chestov s’est rendu en 1936 avec « certaines attentes, informulées, inconscientes, invisibles », mais où « tu retrouves ta croix, ton épreuve intérieure, ton martyre personnel, aux yeux de tous car ils en font partie, mais surtout dans les sables mouvants de ta solitude. ». Chemin faisant, l’auteur nous gratifie de pages poétiques sur ce pays où la beauté des paysages n’occulte pas les incessants conflits dont ils sont le terrain depuis la nuit des temps, où on ne sait plus « qui est l’infidèle de qui ». C’est en tout cas une « Palestine intérieure », indescriptible, indicible, que Chestov (ou Schwarzmann ?) gardera de son périple, et nous de notre lecture.
Jean-Pierre Longre
21:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, francophone, nicolas cavaillès, chestov, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/05/2019
« Paradis perdu »
 Jean-Jacques Nuel, Une saison avec Dieu, Le Pont du Change, 2019
Jean-Jacques Nuel, Une saison avec Dieu, Le Pont du Change, 2019
Arthur Rimbaud nous a chanté sa « Saison en Enfer ». Jean-Jacques Nuel nous livre sa « Saison avec Dieu », qui, dans un genre, un style et des perspectives différents, tient aussi de la quête mystique. Car l’auteur (disons le narrateur, qui le représente clairement et nommément) a bien connu ce Dieu, qui fut son colocataire pendant trois mois lorsqu’il était étudiant à la Faculté des Lettres d’une grande ville de province (Lyon, devine-t-on aisément). Étonnant, non ? Pourtant, cela commence de manière presque banale : « Dieu n’avait rien de remarquable. Dieu n’avait rien d’impressionnant. J’ai le souvenir d’un individu de taille moyenne, très mince, aux élégantes proportions. Physiquement, Dieu était légèrement plus grand que moi, mais il n’a jamais tiré parti de cette supériorité naturelle pour me regarder de haut. Bien au contraire, notre relation était simple, franche, cordiale, d’égal à égal, et nous partagions tout, les frais de l’appartement comme les tâches ménagères. ». Bref, un étudiant comme un autre, qui fume des Gitanes et boit des bières, sans prétention, avec sérénité.
À ceci près qu’il est la perfection même : son savoir encyclopédique n’a d’égal que son habileté pour le bricolage, et son dévouement à toute épreuve se manifeste dans la plus grande discrétion. Cela donne des formules qui hors contexte pourraient paraître de la plus grande dévotion (« Sans l’aide de Dieu je n’aurais jamais réussi aussi facilement ma licence de lettres modernes »). Et jamais un mot plus haut que l’autre, jamais de leçon de morale, jamais de reproches sur la conduite de son ami, conduite pourtant « fort éloignée des préceptes du catéchisme » (certains, qui se revendiquent représentants de Dieu sur terre, pourraient en prendre de la graine).
Alors, que dire des intentions de l’auteur lorsqu’il dévoile (sur le tard) cette rencontre ? Serait-il un nouveau Claudel derrière son pilier de Notre-Dame (en l’occurrence les cloisons vétustes d’un deux pièces insalubre) ? Un nouvel André Frossard qui affirmait « Dieu existe, je l’ai rencontré » ? Non. Jean-Jacques Nuel, d’ailleurs, anticipe les reproches de lecteurs qui n’apprécieraient pas le mélange pourtant subtil et bienvenu des tons (« la légèreté et la gravité, l’humour et le sérieux. »), et les critiques qui enfouissent leurs doutes sous une carapace de certitudes : « Les croyants de toutes confessions seront choqués par cette représentation trop familière de Dieu, fort éloignée de leur enseignement du catéchisme et de leur pratique religieuse […] – tandis que les incroyants me reprocheront au contraire de présenter Dieu sous des dehors trop favorables, ils m’accuseront de complaisance […] ». Lui, agnostique avoué, ne tire pas de leçon rationnelle de son récit ; il en garde simplement l’idée que tout ne s’explique pas, et surtout une émotion débordante au souvenir de ces « jours heureux » d’étudiant, de ce « paradis perdu » qu’il connut en compagnie de Dieu.
Jean-Pierre Longre
20:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, jean-jacques nuel, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/03/2019
L’épopée de Nogent-le-Rotrou
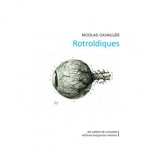 Nicolas Cavaillès, Rotroldiques, éditions Marguerite Waknine, « Les cahiers de curiosité », 2019
Nicolas Cavaillès, Rotroldiques, éditions Marguerite Waknine, « Les cahiers de curiosité », 2019
À la lecture de ce petit livre, on se dit que la collection dans laquelle il est publié, « les cabinets de curiosité », porte bien son nom. Au début, pourtant, la déprimante quotidienneté d’une scène de bistrot, inaugurée par une phrase aussi désespérément longue que poétiquement imagée, nous plonge dans un décor sans grâce et introduit des conversations, entre glauque et comique, dignes des Conversations dans le département de la Seine de Raymond Queneau. Des monologues et dialogues qui, tout compte fait, ne tournent pas à la pire des banalités, car il y est rapidement question des « huit péchés capitaux » que Nanard, le patron, et un buveur remarquable se plaisent à énumérer, suivant en cela et sans le préciser la liste instaurée par Bernard le Clunisien, moine au prieuré de Nogent-le-Rotrou, dans son De Octo vitiis (vers 1150) : luxure, indifférence, colère, orgueil, ambition, tristesse, gourmandise, avarice.
Tout cela dès les premières pages d’un ouvrage qui compte autant de chapitres que de péchés, donc huit, chaque chapitre étant précédé d’une citation dudit Bernard. Ainsi, Nicolas Cavaillès construit un récit rigoureusement structuré, un récit qui, pour le reste, suit un cheminement labyrinthique dans les rues et les ruelles de Nogent, mais s’échappe aussi vers des espaces intérieurs et extérieurs (jusqu’au Moyen-Orient) ou remonte le temps (jusqu’à Rotrou III, au onzième siècle), tout en délivrant des détails savants sur, par exemple, l’opération d’un œil (l’œil, motif récurrent qui induit celui du regard, et dont l’illustration de couverture et les épigraphes annoncent l’importance).
Les péripéties de ce cheminement labyrinthique ne seront pas dévoilées ici. Disons simplement que tout est déclenché par la rencontre improbable et suivie de rebondissements inattendus entre le narrateur et un certain Legrand, chômeur albinos, solitaire et révolté, malade et aboulique. Il y aura donc des propos de bistrot, de bonnes cuites, des bagarres épiques, des entrevues au pôle emploi, des échappées belles et de piètres retours à la réalité, des histoires d’amitié, d’amour, de souffrance, de mort, de famille, et il y a de l’ironie, de l’humour (volontiers noir), de l’aveuglement, de la lucidité… La petite ville de Nogent-le-Rotrou a-t-elle suscité beaucoup de littérature jusqu’à présent ? Quelle que soit la réponse, n’hésitons pas : avec Rotroldiques, elle a maintenant son épopée (en huit chants).
Jean-Pierre Longre
19:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, nicolas cavaillès, éditions marguerite waknine, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/03/2019
Du Kremlin aux Invalides, 1812-2012
 Sylvain Tesson, Berezina, Éditions Guérin, 2015, Folio, 2016, rééd. Folio 2019
Sylvain Tesson, Berezina, Éditions Guérin, 2015, Folio, 2016, rééd. Folio 2019
L’idée lui vint, on ne sait par quel itinéraire de l’esprit, lors d’un périple en Terre de Baffin : « Une dérive, un délire quoi, traversé d’Histoire, de géographie, irrigué de vodka, une glissade à la Kerouac, un truc qui nous laissera pantelants, le soir, en larmes sur le bord d’un fossé », dit-il à son ami Gras. Et la décision fut prise de faire Moscou-Paris en side-car, « une belle Oural de fabrication russe », à l’occasion des deux cents ans de la Retraite de Russie. Décision rapidement suivie d’effet – on n’est pas bourlingueur pour rien) : trois side-cars russes, cinq amis voyageurs (français et russes), départ de Moscou le 3 décembre 2012.
 Chaque chapitre correspond à une étape, chaque étape est l’occasion de souffrances physiques (le froid, bien sûr), de dangers mortels (glissades des véhicules sur des chaussées gelées, camions frôlant à toute allure les tricycles bringuebalants), de miracles mécaniques (les braves « Oural » toujours au bord de la panne et toujours repartant vaillamment pour des pointes à 80 km/h), de beuveries chaleureuses entre amis et de rappels historiques (la déroute de la Grande Armée harcelée par les Russes, les dizaines de milliers de morts, le retour fulgurant de Napoléon à Paris).
Chaque chapitre correspond à une étape, chaque étape est l’occasion de souffrances physiques (le froid, bien sûr), de dangers mortels (glissades des véhicules sur des chaussées gelées, camions frôlant à toute allure les tricycles bringuebalants), de miracles mécaniques (les braves « Oural » toujours au bord de la panne et toujours repartant vaillamment pour des pointes à 80 km/h), de beuveries chaleureuses entre amis et de rappels historiques (la déroute de la Grande Armée harcelée par les Russes, les dizaines de milliers de morts, le retour fulgurant de Napoléon à Paris).
 Le livre de Sylvain Tesson n’est pas seulement un récit de voyage, pas seulement une évocation historique. Il est les deux à la fois, avec mise en regard, à deux siècles de distance exactement, de la capacité des humains à se surpasser physiquement et moralement, et aussi à accepter la souffrance et la mort. Certes, les cinq voyageurs de 2012 n’ont pas subi le sort de la plupart des hommes qui ont suivi aveuglément leur empereur, mais le trajet leur permet de ressentir un tant soit peu ce qu’ont ressenti les soldats de 1812, et permet à l’auteur de faire part de ses réflexions sur l’Histoire, sur les Russes (qu’il aime), sur Napoléon (qu’il admire en tant que stratège, homme politique et personnage historique tout en admettant qu’il jouait sans vergogne avec les vies humaines sans jamais se placer « du côté de la tragédie »). « Les souffrances endurées en 1812 par près d’un million d’hommes de toutes les nationalités m’avaient obsédé. J’avais clapoté dans le souvenir napoléonien pendant des semaines. La nuit, je les voyais, ces civils éperdus et ces soldats blessés, ces bêtes suppliciées, danser leur sabbat devant mes yeux. J’offrais mes insomnies à leur souvenir. Le jour, mon imagination à leur sacrifice. ». À lire, aussi, les mises au point sur ce qu’on appelle les « hauts lieux » (de l’Histoire, de la géographie, du souvenir etc.), et les méditations sur la Révolution et ses suites, sur l’héroïsme, sur le courage et la lâcheté, sur les tenants et les aboutissants des voyages… Berezina, double narration de pérégrinations parallèles et parfois confondues, est un livre doublement épique.
Le livre de Sylvain Tesson n’est pas seulement un récit de voyage, pas seulement une évocation historique. Il est les deux à la fois, avec mise en regard, à deux siècles de distance exactement, de la capacité des humains à se surpasser physiquement et moralement, et aussi à accepter la souffrance et la mort. Certes, les cinq voyageurs de 2012 n’ont pas subi le sort de la plupart des hommes qui ont suivi aveuglément leur empereur, mais le trajet leur permet de ressentir un tant soit peu ce qu’ont ressenti les soldats de 1812, et permet à l’auteur de faire part de ses réflexions sur l’Histoire, sur les Russes (qu’il aime), sur Napoléon (qu’il admire en tant que stratège, homme politique et personnage historique tout en admettant qu’il jouait sans vergogne avec les vies humaines sans jamais se placer « du côté de la tragédie »). « Les souffrances endurées en 1812 par près d’un million d’hommes de toutes les nationalités m’avaient obsédé. J’avais clapoté dans le souvenir napoléonien pendant des semaines. La nuit, je les voyais, ces civils éperdus et ces soldats blessés, ces bêtes suppliciées, danser leur sabbat devant mes yeux. J’offrais mes insomnies à leur souvenir. Le jour, mon imagination à leur sacrifice. ». À lire, aussi, les mises au point sur ce qu’on appelle les « hauts lieux » (de l’Histoire, de la géographie, du souvenir etc.), et les méditations sur la Révolution et ses suites, sur l’héroïsme, sur le courage et la lâcheté, sur les tenants et les aboutissants des voyages… Berezina, double narration de pérégrinations parallèles et parfois confondues, est un livre doublement épique.
Jean-Pierre Longre
09:00 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, histoire, francophone, sylvain tesson, Éditions guérin, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/12/2018
Depuis l’enfance
 Hervé Bougel, Au mois de mai 1968, Éditions Les Carnets du Dessert de Lune, 2018
Hervé Bougel, Au mois de mai 1968, Éditions Les Carnets du Dessert de Lune, 2018
C’est un tout petit livre qui dit beaucoup de choses ; dix pages dont chaque paragraphe commence par « Au mois de mai 1968 », sorte d’antérime d’un long poème qui décline, en tableaux successifs, les souvenirs de celui qui était alors un garçon de dix ans vivant dans une petite ville de province.
« Au mois de mai 1968 », donc, la vie ne changeait pas beaucoup de l’habitude, avec ce qui ne relève ni de la misère ni de l’exaltation. Il ne s'agit pas d'une histoire d'ancien combattant... Les images de la révolte ne passaient que par les lucarnes de la télévision à la maison et par la grève des maîtres à l’école. Et pourtant, pour des raisons annexes et complexes, « nos vies furent dévastées. ».
Avançant par touches apparemment simples (ce qui rappelle qu’en matière littéraire, la simplicité se travaille), entre réalisme et impressionnisme, ce récit place l’autobiographie du côté du poème en prose, et le passé du côté de l’immédiateté. À lire rapidement, et à relire lentement.
Jean-Pierre Longre
19:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : récit, autobiographie, francophone, hervé bougel, les carnets du dessert de lune, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/09/2018
Une odyssée aux frontières de l’Europe
 Laurent Geslin, Jean-Arnault Dérens, Là où se mêlent les eaux, « Des Balkans au Caucase, dans l’Europe des confins », La Découverte, 2018
Laurent Geslin, Jean-Arnault Dérens, Là où se mêlent les eaux, « Des Balkans au Caucase, dans l’Europe des confins », La Découverte, 2018
Ce n’est qu’une petite partie de la planète, et pourtant que d’histoires à raconter, et quelle Histoire à explorer ! De l’Italie à la Géorgie, en voilier et par différents moyens de locomotion maritimes ou terrestres, Laurent Geslin et Jean-Arnault Dérens ont déniché les coins les plus reculés, les localités les plus méconnues des rives de l’Adriatique, de la Mer Égée et de la Mer Noire. Leur livre raconte leur périple, et surtout le passé et le présent de ces régions marginales, dont les fluctuations humaines ont suivi les variations géopolitiques : Italie, Croatie, Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, Russie, Ukraine, Moldavie, Roumanie…
Ces pays, certes connus, recèlent des lieux plus ou moins secrets que les touristes ne fréquentent pas, faute de les connaître. Non seulement des lieux, mais des populations minoritaires – Albanais d’Italie, Slovènes de Trieste, Tatares de Crimée, Russes de Moldavie, Tcherkesses du Kosovo, Lipovènes du Delta du Danube, bien d’autres encore, sans oublier les « migrants » et réfugiés qui contribuent à constituer ce mélange humain à la fois curieux, attachant et circonspect que nous peignent avec affection les deux voyageurs – à l’image des occupants d’un autobus géorgien : « Il faut un peu de temps et quelques gestes, un sourire au bon moment, sans trop en faire, pour être accepté dans la petite communauté du bus, dans cette humanité en mouvement unie par l’objectif d’avancer, par la fatigue partagée, par ces moments aussi intensément vécus qu’ils seront vite oubliés dès que le trajet prendra fin. ».
On remarquera au passage que le style n’est pas celui du reportage, mais plutôt du roman (non fictif) de voyage et d’histoire, dans lequel se dressent des portraits hauts en couleur et touchants, et se peignent des paysages poétiques. Par exemple : « Mustafa s’est attablé dans une bicoque des bords de la Bojana. Il a commandé une soupe de poisson, un citron et quelques miches de pain. Il a le crâne lisse comme un œuf, il n’est pas encore âgé, une petite quarantaine, mais des rides lui coulent des yeux vers la commissure des lèvres. Plus loin, derrière les vitres de la paillotte, les roseaux ondulent sous le vent du large qui a nettoyé le ciel pour dégager un froid soleil d’hiver. Mustafa l’Albanais est citoyen du Monténégro, il connaît bien les méandres de ce bout de terre, à l’extrême sud du pays. ».
Récit de voyage, mais aussi récit historique, voire mythologique : chaque chapitre, chaque étape fait l’objet d’une remontée dans le temps, explorant le passé des localités et des pays (avec des anecdotes qui valent le détour, telle l’histoire du yacht de Tito, ou des détails toponymiques comme l’origine de l’appellation « Mer Noire »…), n’occultant pas les relations parfois conflictuelles, voire chaotiques que ces pays entretiennent (l’histoire turque, notamment, fait l’objet d’explications éclairantes). De cette histoire, de celle des guerres, des traités de paix plus ou moins efficaces, des animosités larvées sont tirées des leçons non définitives, certes, mais d’un grand intérêt. Sans parler des évocations de figures mythologiques (Ulysse, bien sûr, mais aussi Médée, Jason et la Toison d’Or etc.). De rencontre en rencontre, de pays en pays, (et les tracas significatifs de certaines administrations douanières ne nous sont pas épargnés, sur le mode plutôt humoristique), Laurent Geslin et Jean-Arnault Dérens nous conduisent « là où se mêlent les eaux », où se déverse une bonne partie de l’Europe, où le Danube rejoint le Mer Noire en un vaste delta, non sans évoquer la silhouette d’Adrien Zografi, personnage de Panaït Istrati, un autre écrivain bourlingueur, coureur de contrées « où se mêlent » les peuples.
Jean-Pierre Longre
10:09 Publié dans Essai, Littérature, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, voyage, laurent geslin, jean-arnault dérens, la découverte, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/07/2018
Le ballet des phrases et des gens
 Manuel Anceau, Livaine, Ab irato, 2018
Manuel Anceau, Livaine, Ab irato, 2018
La vraie littérature ne fuit ni ne nie le réel. Par le choix des angles de vue, par le travail du style et du verbe, par le hasard (peut-être) de la destinée des choses et des êtres, elle le transforme, ce réel, le transcende et révèle son pouvoir, un pouvoir que seul l’art peut lui donner. Ainsi se forge la poésie du quotidien. Les « contes » que propose Manuel Anceau dans Livaine, et qui illustrent parfaitement ce phénomène, poussent le lecteur vers ce que ce réel contient, solidement et profondément ancré, de surprenant, de déroutant, d’étrange – comme dans « Livaine », le premier texte justement, se découvre la véritable nature de certains personnages, notamment le gentil Loupiot et la mère disparue de la narratrice.
Au long du recueil, suivant le ballet des phrases et des sons (déclinaisons en larges coulures de consonnes, par exemple, avec « Livaine », « Lieuve », « Louvet » etc.), se découvrent des secrets que recèlent la nature, les lieux, les animaux, les humains, les gestes et les attitudes de l’existence. Manuel Anceau n’a pas son pareil pour camper un paysage ou une bâtisse, suggérer une atmosphère, et pour en tirer l’insoupçonnable, voire un surnaturel qui ne doit rien au divin. Voyez comment peut se dresser le profil d’un petit village ordinaire : « Lieuve, en ces époques pittoresques où les gaillards, aux bals interminables, sous le ciel qui poussait bleu puis noir ne se souciaient que de tourner la tête aux filles, qu’est-ce que c’était, sinon la même contrée perdue, abandonnée à son sort ? Ne m’en veuillez pas si je suis de mauvaise compagnie, voilà ce que Lieuve soir après soir répète aux étoiles commençant à s’assembler autour de son clocher. Nous perdons du sang disent de concert girouette et drapeau. Personne ne bat plus des mains pour faire s’envoler les corneilles. Quand elles s’abattaient sur les grains de millet, on voyait les gosses, et pas qu’eux, les vieux aussi, battre des mains. […] Il y a longtemps qu’il n’y a plus de grains de millet : circulez. Il n’y a même plus assez de corneilles, pour qu’on ait le cœur à leur rabattre le caquet. Les temps modernes sont passés par là. ». Attention, il ne s’agit ni de « c’était mieux avant » ni de régionalisme gentillet. On attend forcément une suite, et on l’aura, sortant forcément de l’apparent ordinaire.
Et il y a les gens, « nous autres », ceux qui ne paient pas de mine, ceux qui parfois ressemblent bizarrement (ou pas tant que ça) à des animaux (l’inverse aussi peut avoir lieu), ceux qui parfois ne ressemblent à rien parce que c’est leur absence qui peuple le récit (celle de Louvet, en particulier), les gens dans toute la diversité de leur ballet. Voyez encore comment se forge un portrait parmi d’autres : « Moineau se lève, fait les quelques pas qui la séparent de la porte des toilettes. Il y a ses jambes qui sont fines, qu’on peut trouver belles, de charmantes échasses de jolie bergère – ou simplement bien faites, pas désagréables à regarder ; mais tout le monde sera d’accord pour dire qu’elles restent toujours un peu en arrière, comme si le reste du corps était déjà passé à autre chose. Le bout des doigts brille un peu, ainsi que le nez, qui luit bizarre, comme si on venait de l’astiquer. Moineau plaît. Il est vrai, sans qu’on puisse dire pourquoi. Peut-être même qu’elle ne plaît pas vraiment, et que ce qui attire les regards n’a rien à voir avec la commune acception du verbe « plaire ». Moineau n’est pas ce qu’on appelle une jolie princesse. Lèvres et paupières sont pourtant d’assez remarquables attributs ; mais on les dirait volontairement caricaturales. Il y a une chose curieuse qui est que, quand vous fermez les yeux et que vous essayez de vous rappeler – ce qu’il faut se rappeler quand il s’agit de retrouver un visage précis : un tout autre visage vient à l’esprit. ».
Bref, comme toujours lorsqu’il s’agit d’art véritable, on voudrait tout montrer, tout recommander. Ainsi, on ne peut ni décrire ni raconter ni vraiment commenter Livaine. Il faut lire le livre.
Jean-Pierre Longre
23:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, récit, francophone, manuel anceau, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/03/2018
Sur les pas du « bourik »
 Nicolas Cavaillès, Le mort sur l’âne, Les éditions du Sonneur, 2018
Nicolas Cavaillès, Le mort sur l’âne, Les éditions du Sonneur, 2018
Image insolite : un âne chargé d’un cadavre humain si bien arrimé qu’il ne pourra pas s’en débarrasser parcourt l’île Maurice, ce « volcan surgi des eaux qui composa ses paysages par coulées de lave successives jusqu’au spectacle actuel (gangrené de béton) », une île qui, après avoir été un « désert généreux », est devenu le lieu de rassemblement d’un « peuple hétérogène – d’origine indienne, africaine, européenne et extrême-orientale – mais unanimement obsédé par sa petite géographie insulaire ».
Nous suivons donc, sur les pas de Nicolas Cavaillès, fin connaisseur des lieux, les traces de notre « bourik », qui commence par tourner en rond, puis qui se met à déambuler de coin en recoin, de ville en village. Et l’auteur profite de cette légende du « mort sur l’âne » pour plonger et nous faire plonger dans « l’obsédante géographie de l’île », et aussi dans son histoire, avec parfois une bonne digression qui a tout de même quelque chose à voir, telle celle qui rappelle la visite (forcée) du jeune Baudelaire à Port-Louis et dans les environs. Tant de villages aux noms pittoresques, parfois significatifs, parfois énigmatiques ; tant de lieux-dits, de quartiers, de figures et de groupes humains… Maurice apparaît comme un univers grouillant, dans l’espace et dans le temps, qui pose question : « Comment rendre l’île à sa nudité première, anonyme ? ». Et comment la faire sortir de la misère et de l’injustice, même après les émeutes évoquées vers la fin du récit ? « La vie reprit sa marche benoîte, à Beaux-Songes comme ailleurs – précisément comme l’âne affligé que nous avons laissé tantôt à l’entrée du village, après les vergers de Cressonville, au bord de la rivière… Pauvre bourik traînant jusqu’au bout de sa nuit son incompréhension et sa lourde fatigue, jusqu’au point du jour. ».
Dans une prose à fois impeccable, souple et poétique, dont chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre sont parfaitement pesés et rayonnent de multiples harmoniques, Nicolas Cavaillès ne se contente pas de décrire et de raconter. Il s’amuse parfois (lisez par exemple le chapitre 22 bis, où sont rapportées d’une manière impayable les dernières « aventures sensuelles » du baudet, une journée complète de débauche avec pouliches, ânesses, mules…), et souvent, prenant le lecteur à témoin, le sollicitant même, sollicitant aussi les images qui peuplent son esprit, s’adonne à la méditation et à l’interrogation : « Rien n’est à moi, nulle part le monde n’est ma maison, et tous les drapeaux que j’y plante ne flottent que dans le vent de mon égotisme, pour mieux retomber et s’enrouler autour de leur piquet lorsque mes illusions s’effritent. ». Le cadavre que notre âne trimballe au long des chemins est aussi celui de nos illusions. Reste à laisser chanter les oiseaux, en un « dialogue kreol-kreol, en plein cœur de l’île, alors qu’un ouragan s’approche. ».
Jean-Pierre Longre
10:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, île maurice, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/09/2017
« Comment les sauver tous ? »
 Emma-Jane Kirby, L’opticien de Lampedusa, traduit de l’anglais par Mathias Mézard, Équateurs, 2016, J'ai lu, 2017
Emma-Jane Kirby, L’opticien de Lampedusa, traduit de l’anglais par Mathias Mézard, Équateurs, 2016, J'ai lu, 2017
« Je ne souhaitais pas raconter cette histoire. Je m’étais promis de ne jamais la raconter. Ce n’est pas un conte de fées. Ils étaient trop nombreux. Je voulais y retourner pour les sauver, tous. Je voulais y retourner. ». Ainsi s’exprime le protagoniste de ce récit, homme ordinaire qui vit sa vie familiale, affective et professionnelle d’opticien sans se soucier outre mesure des réfugiés qui abordent la petite île italienne de Lampedusa, si proche des côtes africaines.
C’est un jour prometteur de joie amicale et de grand air maritime que sa vie bascule. Partis pour une promenade en mer, ses amis, sa femme et lui ne comprennent pas tout de suite d’où proviennent les drôles de cris qu'ils prennent d’abord pour d’étranges "miaulements" de mouettes, et dont ils perçoivent finalement l’horrible vérité : des hurlements d’hommes, de femmes, d’enfants naufragés en train de se noyer. Pas d’hésitations, pas de discussion entre eux : tous se mettent avec acharnement aux tentatives de sauvetage, jusqu’à l’épuisement, jusqu’à la limite du danger pour eux et pour leur bateau, et avec le sentiment de ne pouvoir accomplir complètement leur devoir : « Il apparaît clairement que, pour l’opticien, le sauvetage n’est pas terminé. Il sonde du regard les eaux alentours : il cherche encore, sans relâche. ».
Ce récit sans fioritures romanesques, forcément vrai, qui puise sa force dans une terrible réalité, n’a rien de moralisateur, rien de politique non plus. Il n’est pas question de se demander pourquoi ces gens fuient leur pays : la guerre, les persécutions, la misère, le rêve, l’illusion ? Ils sont là, dénués de tout, au bord de la mort, et il faut les sauver, les accueillir, les héberger. Une histoire humaine, tout simplement, avec tout ce qu’elle implique de courage et d’abnégation. Un héroïsme discret qui ne cherche ni la gloriole ni même la reconnaissance, mais qui est guidé par la puissance de l’émotion, de la révolte et de la colère, et par des sentiments qui ont beaucoup à voir avec la solidarité, l’amitié, l’amour du genre humain. Rien de moralisateur donc, mais L’opticien de Lampedusa est un livre qui devrait donner à penser à tous les tenants de la fermeture des frontières et à tous ceux qui dressent des murs et des barbelés prétendument protecteurs.
Jean-Pierre Longre
11:14 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, anglophone, emma-jane kirby mathias mézard, Équateurs, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2017
Lire, relire... L’amour et la barbarie
 Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon, Et tu n’es pas revenu, Grasset, 2015, Le livre de poche, 2016. Suivi d'un dossier d'Annette Wievorka. Grand prix des lectrices de Elle - Document.
Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon, Et tu n’es pas revenu, Grasset, 2015, Le livre de poche, 2016. Suivi d'un dossier d'Annette Wievorka. Grand prix des lectrices de Elle - Document.
Arrêtés en mars 1944 à Bollène, passés par Drancy, Froim Rozenberg et sa fille Marceline ont été déportés à Auschwitz. Séparés dès l’arrivés (lui à Auschwitz, elle à Birkenau), ils ne se sont revus que furtivement, de manière risquée – et lui n’est jamais revenu. Le récit que Marceline fait de cette tragédie bien des années plus tard est une extraordinaire lettre ouverte à son père tant aimé ; comme une amorce épistolaire, cette lettre débute par l’évocation d’un mot que son père avait réussi à lui faire passer là-bas et qui commençait par « ma chère petite fille », et le livre se termine par une terrible question posée par sa belle-sœur : « Maintenant que la vie se termine, tu penses qu’on a bien fait de revenir des camps ? »…
La réponse est contenue par anticipation dans ces cent pages denses, qui racontent l’horreur vécue par une jeune fille de 16 ans, dans le côtoiement quotidien des chambres à gaz et des cadavres, dans la famine et le gel, sous les coups de la cruauté nazie. Elles racontent aussi le retour, l’absence si lourde de celui qui lui avait prédit : « Tu reviendras, Marceline, parce que tu es jeune », un retour auprès d’une mère qui « ne voulait pas comprendre » et d’une famille qui a sa vie, malgré tout, et la tentation du suicide, de l’effacement désespéré.
 Il y aura les mariages – le deuxième avec Joris Ivens, pionnier du cinéma, fameux documentariste, avec qui elle vivra l’engagement, les réussites, les erreurs, les voyages, la création. « Imagine le monde après Auschwitz. Quand la pulsion de vie succède à la pulsion de mort. Quand la liberté retrouvée contamine la planète entière et décrète de nouvelles batailles. ». Chant d’amour filial écrit à l’âge de 86 ans, où on lit entre autres cette phrase bouleversante : « Je t’aimais tellement que je suis contente d’avoir été déportée avec toi. », Et tu n’es pas revenu est aussi une belle leçon d’humanité, de courage et d’intransigeance dans le combat contre la barbarie.
Il y aura les mariages – le deuxième avec Joris Ivens, pionnier du cinéma, fameux documentariste, avec qui elle vivra l’engagement, les réussites, les erreurs, les voyages, la création. « Imagine le monde après Auschwitz. Quand la pulsion de vie succède à la pulsion de mort. Quand la liberté retrouvée contamine la planète entière et décrète de nouvelles batailles. ». Chant d’amour filial écrit à l’âge de 86 ans, où on lit entre autres cette phrase bouleversante : « Je t’aimais tellement que je suis contente d’avoir été déportée avec toi. », Et tu n’es pas revenu est aussi une belle leçon d’humanité, de courage et d’intransigeance dans le combat contre la barbarie.
Jean-Pierre Longre
15:58 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, récit, francophone, marceline loridan-ivens, judith perrignon, grasset, jean-pierre longre, annette wieviorka, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/10/2016
La naissance de l’existence
 Yves Déchavanne, Et nous croquerons la pomme ou Du bon usage de la liberté, Edilivre, 2014
Yves Déchavanne, Et nous croquerons la pomme ou Du bon usage de la liberté, Edilivre, 2014
« La vie ne peut exister sans imperfection ». Le plan divin, lui, était parfait. La souffrance, les malheurs, les soucis, le doute, et aussi – autres conditions nécessaires à toute véritable existence humaine – la liberté et l’amour. Les hommes iront « s’élevant de chute en chute, progressant dans la connaissance, et créant la vie. […] Et si, conscients de leur existence, certains en viennent à douter de nous, à nous maudire, voire à nous nier, n’y vois pas malice et réjouis-toi : c’est qu’ils grandissent. ». Voilà ce que le créateur dit au « Bénin » (vous savez, celui qui deviendra le « Malin » sous la forme du Serpent), mettant au-dessus de tout l’autonomie de sa Création vouée à devenir créatrice, à commencer par Adam et Ève.
Attention : Et nous croquerons la pomme n’est ni un traité de théologie ni un essai philosophique. Quoique. Les allusions, les références, voire les citations peuplent la prose d’Yves Déchavanne. Liberté et responsabilité, essence et existence, connaissance du bien et du mal, conscience du temps et rôle de l’inconscient – les concepts vont bon train dans la parole divine et humaine, de même que dans la méditation d’Adam, qui va jusqu’à anticiper sur un « L’enfer, c’est les autres » plus intemporel qu’anachronique. Et il y a la découverte du plaisir, de la sensualité, de la musique, de l’amour et de la mort. Ève, rendue experte en ces domaines par l’action du Serpent, va tenter de persuader Adam que tout cela vaut la peine. Une quête quasiment bachelardienne occupe ses pensées : « C’étaient des orgies d’imaginations, des symphonies de rêveries où chaque sens, tout à tour sollicité, devenait tantôt soliste, tantôt concertiste. ». Louise Labé elle-même est un recours pour exprimer les signes de l’amour (chaud et froid, rire et larmes…).
On l’aura vite compris, si l’érudition n’est pas écartée (en témoignent les expressions latines qui accompagnent les apparitions de Dieu), l’humour est la dominante. Un humour sans cesse renouvelé, toujours porteur de sens, qui sous-tend le développement des réflexions et les pages de belle poésie accompagnant le récit d’une Genèse revisitée (thème et variations). Sans oublier le chœur des anges qui chante à la fin de chaque chapitre, élevant la prose vers les sphères de la musique céleste. C’est ainsi, d’une manière plaisante et décalée, qu’est décrit le passage du jardin d’Eden (paradisiaque mais monotone et ennuyeux, tout compte fait) à l’existence pleine de douleur et d’amour, d’inquiétude et de satisfactions, de dépressions et de passions, au demeurant source de promesses et d’optimisme. « L’homme est en marche », et cela, espérons-le, ne s’arrêtera pas. Impatients, nous attendons la suite du cheminement.
Jean-Pierre Longre
18:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, essai, francophone, yves déchavanne, edilivre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

