04/02/2026
Force de vie et de mort
 Jacques Brochard, Nuits de feux, Le Vampire Actif, 2025
Jacques Brochard, Nuits de feux, Le Vampire Actif, 2025
« Avez-vous déjà vécu un incendie ? je veux dire un violent incendie, celui qui détruit non seulement un bâtiment, une maison, mais par la dimension spirituelle de ce qu’il détruit, s’attaque aussi à votre âme, à vos souvenirs, à votre amour, à tout votre être ? » Telles sont les questions que Jacques Soulié, un inconnu rencontré sur un promontoire dominant la mer, pose au narrateur. Et le récit qui s’ensuit se déroule, en quelque sorte, à la lumière étrange, terrible et fascinante des feux qui le ponctuent.
Jacques Soulié, le protagoniste, fait ses confidences à son interlocuteur, qui nous les rapporte indirectement ou directement. Instituteur nommé sur une côte peu accueillante, il fait la connaissance de Marine, qui, arrivée de la mer, vient périodiquement se sécher et se chauffer devant sa cheminée, moments de bonheur au cours desquels il profite des « senteurs boisées de son corps. » Mais à la suite d’un feu dangereux qu’il a allumé pour guider la jeune femme sur son bateau, l’Autorité anonyme et implacable qui gouverne le pays le déplace sur une petite île qui fait face à la côte. « Monsieur le Professeur » va travailler et loger dans une école de sept élèves disciplinés et apathiques, et vivre au milieu d’habitants peu loquaces. Alexandre le cantonnier, personnage bizarre, lui explique : « C’est une île […] dans laquelle on arrive, mais dont on ne repart plus, on vit ici parce que des parents vous y ont fait naître, ou l’on vient parce que l’A vous y a reclus en exil pour un temps indéfini. » Et ceux qui sont éventuellement autorisés à partir ne le font pas « car presque tous ceux qui ont vécu ici de nombreuses années ne souhaitent plus retourner à ce qui leur apparaît comme un nouvel exil. »
Ce qui fascine Jacques Soulié, dans cette île apparemment sans grand intérêt, ce sont les feux : grand feu de la Saint-Jean rassemblant la population, feux épars, mais aussi incendies de maisons, allumés par qui ? Et il y a le feu de la cheminée d’Alaine, jeune femme sauvage et séduisante qui, étrangement, lui rappelle Marine, presque jusqu’à la confusion. Alaine et Jacques s’éprennent l’un de l’autre, passant des soirées tendres, puis empreintes de passion, devant la cheminée éclatante. Cela jusqu’à un épisode exaltant et tragique : « Je vous dirai ce que fut cette journée pour moi, ce qu’elle représente encore comme le moment le plus précieux de ma vie, celui de mes souvenirs dans lequel j’aime à m’immerger. Je vis de ce souvenir, il enchante, mais désole encore mon existence. »
Le récit de Jacques Soulié, donc le roman de Jacques Brochard, relève d’une sorte de réalisme fantastique, rythmé par ce que le feu peut avoir de chaleureux et d’effrayant, force de vie et de mort. De ce récit, narrateur/confident et lecteurs garderont en mémoire l’intensité dramatique et la plénitude poétique.
Jean-Pierre Longre
16:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jacques brochard, le vampire actif, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/01/2026
Les voix du corps, de l’âme et de l’esprit
 Alta Ifland, Voix de Glace / Voice of Ice, recueil bilingue français-anglais, préface de John Taylor, Les Figues / Puctumbooks, 2025
Alta Ifland, Voix de Glace / Voice of Ice, recueil bilingue français-anglais, préface de John Taylor, Les Figues / Puctumbooks, 2025
Le parcours biographique et linguistique d’Alta Ifland est singulier : de la Roumanie aux États-Unis, des États-Unis à la France, du roumain à l’anglais, de l’anglais au français. Les textes de cette « Voix de Glace » qu’elle fait entendre ici sont, en l’occurrence, présentés en français et en anglais, les deux langues de l’exil. Et, comme s’ils voulaient recouvrir une vie entière, ils commencent avec « Naissance » et finissent avec « Mort », en une sorte de lutte commune : « Nous luttons contre la mort et nous luttons contre la vie. »
Cette double lutte existentielle est d’ailleurs au cœur de certains textes invoquant un dédoublement de la personnalité, à la fois présence et reflet (comme dans la « glace », polysémie suggérée par le titre), corps et ombre, mère et enfant, « femme vêtue de blanc » et « homme en noir ». « Je sais que moi n’est que l’ombre douteuse et invraisemblable de mon double. » La référence à Rimbaud proposée par John Taylor dans sa préface est judicieuse – et l’on pourrait aussi penser à d’autres poètes comme Hector de Saint-Denys Garneau. Cela peut induire, clairement ou non, des tableaux fantastiques telle la mise à nu des corps devenus squelettes (« la chair épluchée »), les visions de la mort et de la destruction des êtres (« Les yeux crevés », « Les lépreux ») ou des choses (« Ses murs s’écroulent avec un bruit de neige blessée à vif »), et la quête désespérée de soi : « Quelque part derrière une porte dans une ville il y a un corps qui est le mien. Mais je ne saurai jamais lequel. » Ce qui n’exclut pas les images à caractère surréaliste, mettant en regard, par exemple, la « noblesse » et un « spectacle digestif », ou présentant des scènes où se côtoient « une bûche de Noël mangée par un chien inexistant », une « dentelle », le « bureau de Tourgueniev » et « un tournesol dont je n’ai rien à dire ». Le jeu sur les mots, parfois, forme une image étrangement cubiste : « Le nez de mon dos se reflète bizarrement dans l’œil de ma cheville. »
Voilà, dira-t-on, que l’humour n’est pas loin, et on aura raison. Il est là, parfois avec « la douceur des choses », parfois dans des scènes tournant au burlesque, parfois encore dans des portraits sarcastiques, comme ceux des « professeurs au nez pédant et hoquets ataviques » ou d’une voisine « le visage tendu par les nombreuses chirurgies esthétiques, la peau translucide à cause du sérum, la bouche ouverte dans la grimace permanente d’un sourire avorté… » Au-delà du sourire sans concessions, il y a le temps qui passe et les souvenirs qui nous rappellent qui est l’autrice, semblable à « cette émigrée dont je connais l’histoire, une jeune fille qui débarqua – pardon, atterrit – à New York un jour de septembre au début des années quatre-vingt-dix », elle qui se rappelle « la cuisine d’été » dans son pays natal : « Et le feu ne se lassait pas de se réfléchir dans ses yeux, y laissant les souvenirs à venir, et dans ses yeux le temps s’arrêtait et le présent coulait dans le passé et le passé dans l’avenir, riche de silence et de mots. »
Ensemble aux tonalités et aux genres divers, tenant tantôt (ou en même temps) du poème en prose et du récit, de l’évocation onirique et du réalisme morbide, du conte et du mythe, de la réflexion et de la parodie, cette Voix de Glace en appelle à l’esprit, à l’âme, au corps, et offre un concert très dense, quasiment inépuisable, auquel, une fois que l’on a commencé à l’écouter, on a du mal à se soustraire.
Jean-Pierre Longre
19:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, francophone, alta ifland, john taylor, les figues puctumbooks, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/01/2026
Les mots de la terre
 Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
"Défenseur de la mémoire rurale, de ses traditions, de sa langue et de ses métiers, Jean-Loup Trassard est décédé le 13 janvier à l’âge de 92 ans. Auteur d’une œuvre pour le moins originale dans le paysage littéraire contemporain – elle marie formes verbales et formes visuelles : récits, romans, relevés de témoignage, photographies, livres illustrés –, il a fait du bocage mayennais le centre matriciel de son écriture." ("La Lettre des anges", Le Matricule des anges, 21/12/2026)
Qui se soucie encore des taupes ? Quelques jardiniers, quelques vacanciers retraités soucieux de leur pelouse, quelques rares paysans ? En tout cas, foi de taupier, il y en a de moins en moins, de ces petites bêtes qu’on ne voit pas, qui marchent sous terre, creusant les galeries où elles trouvent leur pitance, laissant derrière elles ces petits monticules qui empêchent de faucher.
Autrefois, il n’y a tout compte fait pas si longtemps que ça, pour s’en débarrasser, les fermiers pouvaient engager un « taupier », sorte de « journalier » assez miséreux mais libre, vagabond mais quotidiennement attaché au même travail, aux mêmes champs, aux mêmes maisons, aux mêmes familles chez qui il se rendait régulièrement. C’est l’un d’entre eux, Joseph Heulot, que Jean-Loup Trassard a su faire parler et dont il a su restituer la vie, avec ses propres mots d’écrivain, avec ceux de son interlocuteur, avec ceux de la campagne – mots du terroir traduits en marge pour éclairer le citadin.
Par la grâce de cette « conversation » entre deux hommes qui s’entendent pour de bon, on apprend beaucoup. D’abord, comment chasser les taupes le plus efficacement possible, alors que certains ont tout essayé : le poison (dangereux pour le bétail et les poules), les boules de gaz (qui ne font que les repousser ailleurs), le fusil (qui en laisse trop)… Non. Il faut être méthodique, prendre son temps, ne pas regarder aux heures de marche et à la fatigue, ne pas hésiter à se salir, repérer les passages, et avoir de l’expérience. Poser les pinces et les « pièges américains » qui claquent juste quand il le faut, ce n’est pas donné à tout le monde ; chasser « à la houette », c’est plus rapide, mais il faut être là au bon moment. On apprend aussi beaucoup sur les taupes – c’est bien normal : sur leur vie, leur survie, leur mort – et leurs peaux que Joseph Heulot peut revendre pour se faire trois sous de plus, et qui servent à faire des manteaux aux dames. On apprend encore sur la vie dans les fermes – l’essentiel, mais juste ce qu’il faut ; car le taupier n’est pas bavard là-dessus, par nature sans doute, par nécessité surtout : ne pas s’immiscer dans la vie des gens, ne pas parler aux autres de ce qui se passe chez les uns, et vice-versa, c’est le seul moyen de rester en bons termes avec tous et de continuer à travailler chez tout le monde. On apprend enfin sur le taupier lui-même, homme pauvre, dont le logis « ressemble à un terrier », qui se nourrit de peu, mais qui garde en lui « chaque champ de son territoire », et qui nous permet, grâce à ses mots, de mieux comprendre les hommes et leur attachement à la terre.
Jean-Pierre Longre
10:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, jean-loup trassard, le temps qu’il fait | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/01/2026
Un retour à Salé
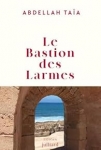 Lire, relire... Abdellah Taïa, Le Bastion des Larmes, Julliard, 2024, Folio, 2026
Lire, relire... Abdellah Taïa, Le Bastion des Larmes, Julliard, 2024, Folio, 2026
Dans Vivre à ta lumière, Abdellah Taïa relatait la vie de Malika, mère lumineuse et obstinée, qui avait économisé « encore et encore » pour construire une maison où faire vivre les onze personnes qui composaient la famille. Dans Le Bastion des Larmes, Youssef, devenu professeur en France, revient momentanément à Salé après le décès de cette mère volontaire (les changements de personnes, de noms et d’activités laissent transparaître, quoi qu’il en soit, le caractère autobiographique du roman) pour vendre le dernier appartement de la maison, dont ses sœurs ont déjà liquidé leurs parts, ces sœurs qui ne se privent d’ailleurs pas de faire des reproches aux fils exilés : « C’est nous qui faisons des efforts pour garder vivante cette mémoire. Pas vous, les garçons. Ni le grand frère Slimane qui nous a oubliées depuis longtemps. Ni toi, Youssef, là-bas, à Paris, en train de vivre je ne sais quoi de soi-disant libre et dont tu ne dis jamais rien. Ni Karim, parti du Maroc comme un voleur. Ce n’est pas vous, les garçons, mais nous, les sœurs, qui faisons tout pour que ce qui a été construit ne s’effondre pas d’un coup. »
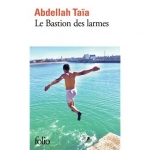 Mais le peu de temps que Youssef reste au Maroc fait ressurgir cette mémoire. Celle de Najib, son amant des années 1980 qui l’a trahi, qui est passé du côté de ceux qui les opprimaient parce qu’ils ne vivaient pas selon les normes, « ceux qui nous tuent tous, chaque jour et chaque nuit. » Najib qui a lui-même été trahi et qui, pour se venger de tous les supplices subis, de toutes les humiliations imposées, est devenu à Salé un trafiquant tout puissant, le roi de la drogue, mais un « Chérif », un saint, « le saint pédé de Salé », « la générosité même avec les habitants », emmenant tout le monde dans sa corruption, et dont les funérailles vont être suivies par une foule considérable. C’est par lui, par son fantôme, que Youssef va découvrir le « Bastion des Larmes », « le cœur même de la ville », là où il peut pleurer Najib, un « endroit magique » au pied de la muraille qui longe l’océan, et dont l’histoire remonte au XIIe siècle, lorsque les Castillans massacrèrent la population de Salé.
Mais le peu de temps que Youssef reste au Maroc fait ressurgir cette mémoire. Celle de Najib, son amant des années 1980 qui l’a trahi, qui est passé du côté de ceux qui les opprimaient parce qu’ils ne vivaient pas selon les normes, « ceux qui nous tuent tous, chaque jour et chaque nuit. » Najib qui a lui-même été trahi et qui, pour se venger de tous les supplices subis, de toutes les humiliations imposées, est devenu à Salé un trafiquant tout puissant, le roi de la drogue, mais un « Chérif », un saint, « le saint pédé de Salé », « la générosité même avec les habitants », emmenant tout le monde dans sa corruption, et dont les funérailles vont être suivies par une foule considérable. C’est par lui, par son fantôme, que Youssef va découvrir le « Bastion des Larmes », « le cœur même de la ville », là où il peut pleurer Najib, un « endroit magique » au pied de la muraille qui longe l’océan, et dont l’histoire remonte au XIIe siècle, lorsque les Castillans massacrèrent la population de Salé.
Livre d’une grande nostalgie et parfois d’une grande cruauté, où des scènes de tendresse voisinent avec quelques scènes difficilement soutenables, comme celles qui décrivent les viols collectifs de jeunes garçons connus comme homosexuels, Le Bastion des Larmes se termine par une lettre de Youssef à sa sœur Kamla, demeurant à Agadir, une lettre sans concessions pour le passé, ses beautés et ses turpitudes, les amours et les haines, mais une lettre magnifique qui veut le rêver, ce passé. « Depuis mon retour à Paris, je passe mes jours et mes nuits à me souvenir de nous autrefois, à revenir à notre lien. Notre pauvreté. Notre beauté. Notre paradis. Notre grande fiction. Je sais que je réécris et que je réinvente sans cesse ce passé. Malgré le noir et le désespoir en moi, malgré les traumatismes et les crises de panique, j’éprouve cette nostalgie étrange d’un espace qui n’a sans doute jamais existé comme aujourd’hui. Une force obscure me pousse à retrouver ce passé, à l’embellir. À ne voir que le printemps, les fleurs, les lilas, les mimosas, les marguerites. » La magie de la fiction, et de la plume d’Abdellah Taïa.
Jean-Pierre Longre
16:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maroc, abdellah taïa, julliard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/12/2025
Les oubliés du Bărăgan
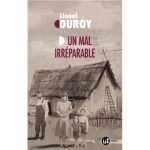 Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault, 2025
Lionel Duroy, Un mal irréparable, Mialet-Barrault, 2025
Depuis quelques années, Lionel Duroy, de son propre aveu, n’en finit pas avec la Roumanie. Dans Eugenia (2018), à travers une relation sentimentale entre l’écrivain Mihai Sebastian et une jeune héroïne de fiction, il retrace l’histoire de la montée du fascisme, du nazisme et de l’antisémitisme dans le pays, insistant notamment sur le pogrom de Iaşi ; dans Mes pas dans leurs ombres (2023), Adèle, jeune Française d’origine roumaine, part enquêter sur les lieux des massacres des Juifs dans les années 1940, entre Roumanie, Moldavie et Ukraine.
Un mal irréparable est aussi, toujours dans le registre romanesque, un retour sur le passé meurtrier de la Roumanie. Frédéric (Friedrich) Riegerl, écrivain français dont le père était né à Czernowitz (ville austro-hongroise, puis russe, roumaine, et maintenant ukrainienne), et dont la mère était originaire de Chişinau, en Moldavie, part sur les traces de son enfance, dont il a oublié des pans entiers. C’est en faisant le voyage à Czernowitz, puis à Brăila (ville natale de Panaït Istrati, ce qui fera souvent revenir au fil des pages l’évocation des œuvres de l’écrivain), que Frédéric va éplucher les archives de ses parents qu’il n’a jusque-là pas consultées alors qu’elles étaient à portée de main dans leur domicile français, va lire des courriers et des témoignages et va rencontrer des personnes susceptibles de le renseigner sur les tribulations de sa famille. C’est alors qu’il découvre le témoignage d’une certaine Elena, qui s’avère être sa mère ; un récit pathétique, qui occupe une partie entière du roman, et qui donne des détails sur le sort effrayant que les communistes roumains alors au pouvoir ont fait subir à sa famille (ses parents, sa petite sœur Angelica, et lui-même, Friedrich), entre 1951 et 1957.
Un sort effrayant, oui : la déportation de la famille, comme d’autres, depuis Orşova, dans le Banat, où elle s’était installée après avoir fui les Russes, vers le Bărăgan, où chacun doit s’efforcer de survivre dans un dénuement complet, soumis aux intempéries, à la faim, à la rudesse insensible des soldats. La petite Angelica, née sur place dans les conditions que l’on devine, y mourra et y sera enterrée, et Friedrich, confié un temps à une famille d’accueil, gardera un traumatisme indélébile de cette période, qu’il aura presque complètement occultée jusqu’à ses découvertes faites à un âge fort avancé, croyant jusque là que pour sa famille la masure du Bărăgan était une maison de campagne. Il comprend alors pourquoi sa mère, férue de Panaït Istrati, ne lui avait jamais lu Les chardons du Bărăgan, et pourquoi les lieux de son enfance se superposaient dans sa mémoire : « Jamais aucune mention du Bărăgan dans mon histoire […], pour la bonne raison que jusqu’à aujourd’hui ces lieux se confondaient dans mon esprit. Nous les avions fuis, et dans notre hâte d’être bientôt français nous avions sûrement voulu les effacer. Mais comment est-ce possible puisque nous avions laissé là-bas Angelica ? Enfin, mes parents, car moi, je l’avais pour ainsi dire… oubliée. » L’oubli, au cœur de ce récit pluriel et terrible, de cette quête poignante de la vérité.
Jean-Pierre Longre
18:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, lionel duroy, mialet-barrault, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/12/2025
L’épopée des « petites gens »
 Lionel-Édouard Martin, Ferpent, soleil par terre, Le Vampire Actif, 2025
Lionel-Édouard Martin, Ferpent, soleil par terre, Le Vampire Actif, 2025
Du haut de sa terrasse, le vieil Albert regarde et écoute le monde. Celui de maintenant, avec les voitures qui passent sur la route et les bruits suggestifs qui montent de l’intérieur de la maison ; celui d’autrefois, de l’amour et de la mort, des existences simples et compliquées.
« Alors, faut bien qu’ils existent, Blaise et Orlande, Jean-Claude et la Dédée, même s’ils parlent dans ma tête, faut bien qu’ils existent.
Et tous les morts avec, les fondeurs, Mone, Pierre, Giselle.
Câlin.
Tout ça d’existence, présente comme passée.
On ne peut pas douter de toute cette existence. Faut bien que ça existe…
Je les entends, sont emplis, tous, d’une grosse existence… »
On le voit, on l’entend, Lionel-Édouard Martin coule son style (comme coule le ferpent fondu des forgerons, comme coule la semence de l’homme sur la terre ainsi fertilisée) dans le langage de ses personnages : celui d’Albert, donc, mais aussi, en monologues distincts, ceux de son fils Jean-Claude, de Rolande (ou Orlande) sa bru, D’Andrée (ou Dédée) qu’il a aimée, de Blaise le petit-fils de celle-ci, et en « narrations » qui éclairent la vie locale et familiale, les plaisirs et les douleurs, les gestes et les habitudes. « On est sans doute de petites gens, mais on aime les choses bien faites, belles, inscrites dans une lignée de gestes qui imprègnent, façonnent. On vit comme ça, dans une continuité : rituels immuables, matières riches, guère nombreuses mais que l’on respecte. »
Et il y a la manière de rapporter tout cela, de faire connaître peu à peu ce qui se passe de grand dans ce petit monde ; et c’est vrai, on comprend peu à peu, au fil des mots, des phrases, ce qui sort du plus profond, du plus brûlant de ces « petites gens », de leur esprit, de leur cœur et de leur corps. Au plus fort de ces « histoires minuscules », la mort du petit-fils Colin (« Câlin ») et l’énorme vengeance sur ce qui a causé cette mort : un vrai morceau d’épopée familiale ! Le reste à l’avenant. Voilà un beau roman, une belle partition à plusieurs voix et à plusieurs mouvements, violence et apaisement, lenteur et rapidité, qu’il faut déchiffrer patiemment pour en goûter la saveur musicale et poétique.
Jean-Pierre Longre
19:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, le vampire actif, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2025
La valse des personnages
 Mireille Hilsum, La fille au manteau jaune, Pont 9, 2025
Mireille Hilsum, La fille au manteau jaune, Pont 9, 2025
Longtemps Mireille Hilsum a travaillé dans les marges de la création littéraire, dévoilant autant que possible à ses étudiants les mystères des œuvres d’Aragon, de Modiano, de Perec et alii, et publiant des études, des essais, des articles sur ses auteurs de prédilection. Elle aurait pu se contenter de ce brillant bilan. Mais non ! Elle a voulu sortir des marges, franchir la frontière qui la séparait de la création même – comme ses semblables le font parfois –, et s’est aventurée en terrain à la fois connu et accidenté, traçant ses propres chemins aux subtiles et complexes sinuosités.
Imaginons. Passant la frontière avec armes et bagages, l’autrice (l’ôtrice, comme elle s’orthographie elle-même, on comprendra pourquoi) pourrait avoir ouvert malencontreusement la valise où elle avait enfermé ses personnages favoris, et voilà que ceux-ci en auraient profité pour s’échapper, s’envoler comme Icare et d’autres le firent dans le dernier roman de Raymond Queneau… Mézalor (comme aurait écrit celui-ci), que faire ? Pleine de ressources, M. H. prend ses personnages au bond, et imagine une agence spécialisée créée par sa narratrice : « Cela faisait bientôt douze ans que je travaillais à l’enlèvement des personnages romanesques. […] C’est ainsi que j’étais devenue une ôtrice indépendante. Habituellement je travaillais au repeuplement du roman contemporain. » Tout naturellement, on aura commencé avec une séduisante allusion métropolitaine, annoncée par le titre, à La petite Bijou de Patrick Modiano. Mais ce n’est qu’un début. Et alors… Nous nous surprenons à fréquenter Balzac, Stendhal, Flaubert, Louise Colet (au passage salutairement réhabilitée), Maupassant, Zola – avec le « prélèvement » de leurs protagonistes destinés à être « recyclés » dans la littérature contemporaine.
C’est ainsi que nous fréquentons aussi Aragon, Emmanuel Bove, Georges Perec, Patrick Modiano (bien sûr), Léo Malet (surprenant peut-être, mais Nestor Burma est un si bon détective) et beaucoup d’autres. Et alors… C’est un joyeux défilé, une folle valse de personnages qui se croisent, s’entrecroisent, se décroisent, s’interpellent pourquoi pas, d’un siècle à l’autre, d’un roman à l’autre, d’un quartier parisien à l’autre, sous la houlette d’une « ôtrice » qui ne fait pas qu’« ôter », mais qui prend des initiatives bienfaisantes (comme le projet de fondation d’un « ouvroir de littérature potentiellement féminine ») et nous fait suivre avec une émotion inédite les méandres secrets de ses ouvrages favoris.
Inédite aussi, la présentation de l’ensemble. La prose romanesque s’assortit d’une mise en page pleine de surprises. Des illustrations, des tableaux récapitulatifs, des pavés didactiques (exemples : définitions d’ « éponyme » ou de « mise en abyme », ou question du genre : « Flaubert a-t-il vraiment prononcé cette célèbre formule : « Madame Bovary, c’est moi ! » ? »), des passages en prose quasiment versifiée, des notes malicieuses etc. La patte de la pédagogue, l’imagination et le style de l’écrivaine : voilà un roman qui nous laisse toute liberté : celle de s’y promener nonchalamment, de s’y perdre sans vergogne, de s’y plonger audacieusement, avec l’espoir de refaire surface un jour… Quoi qu’il en soit, prenez le risque ! Cela vaut largement la peine de le courir.
Jean-Pierre Longre
18:45 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, mireille hilsum, pont 9, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/11/2025
Une double fuite
 Cécile Tlili, Celle qui fugue, Calmann-Lévy, 2025
Cécile Tlili, Celle qui fugue, Calmann-Lévy, 2025
Son mari veut la quitter, lui faisant comprendre « la béance qui s’était formée » entre eux, l’ennui ayant pris la place de l’amour. À cette annonce, Alice est partie, abandonnant sa maison, son époux et sa fille adolescente. Une brève errance en Corse, puis un retour dans la ville méridionale où elle vivait, partageant son temps entre un petit appartement, son travail dans un laboratoire d’analyses, sa solitude, ses regrets d’avoir laissé Romane, sa fille tant aimée, et des insomnies qui la mènent au bord du danger.
Un soir où ce danger est imminent, elle est accueillie par une toute jeune voisine, Siham, qui va être pour elle un vrai réconfort, jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive que sa bienfaitrice est elle-même confrontée à des difficultés familiales qui vont la pousser à une fuite inquiétante. « Je compte les heures qui me séparent du matin, sept heures, une éternité, je ne vais pas arriver à tenir, sans Siham me voici de nouveau livrée en pâture à mes angoisses, j’ai peur pour elle que j’imagine accidentée, blessée, enlevée, violée, j’ai absurdement peur pour Romane, j’entends hurler la terreur que j’ai tenté de bâillonner depuis que ma fille est née, parce que si on la laisse s’exprimer on ne vit plus, et puis, même si je n’ose pas me l’avouer, j’ai peur pour moi, pour moi qui ne sais pas ce que je vais devenir sans Siham. »
Celle qui fugue est le roman, poétique et sensible, d’une double destinée, d’une double fuite : celle d’Alice, celle de Siham. Nous pénétrons dans l’intimité de la première, par les yeux et la parole de laquelle nous percevons le désarroi de ces deux femmes, mais aussi leur soif de vivre autre chose que ce qu’elles ont à subir. Leur « incorrigible tentation de fuir » débouchera peut-être sur une vie plus sereine, faite d’espoir et d’une douceur que laisse entrevoir le dernier chapitre.
Jean-Pierre Longre
19:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, cécile tlili, calmann-lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/11/2025
À la recherche d’une figure perdue
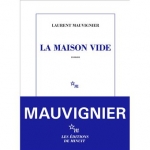 Laurent Mauvignier, La Maison vide, Les éditions de Minuit, 2025
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Les éditions de Minuit, 2025
Prix Goncourt 2025
Marie-Ernestine, l’arrière-grand-mère de l’auteur, était née Proust en 1885. Aucun lien de parenté avec Marcel, mais le vaste roman familial de Laurent Mauvignier est construit sur une recherche, celle de la figure perdue de Marguerite, sa grand-mère, une figure qui a été soigneusement ôtée de toutes les photos familiales, une figure sans doute maudite – on va savoir peu à peu pourquoi, grâce à des investigations qui tiennent à la fois de l’enquête minutieuse et de l’imagination. « Je ne fais que du roman –, mais je crois que si ce que j’écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l’invente pas tout à fait : je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d’un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu’il suffit de le remonter pour qu’il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l’aveugle, en prenant trop de libertés, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens. »
On fait ainsi la connaissance de l’arrière-arrière-grand-père Firmin, propriétaire terrien autoritaire déçu par ses deux fils et mettant tous ses espoirs en sa « petite Boule d’Or », sa fille Marie-Ernestine qui, malgré des dons exceptionnels pour la musique et ses sentiments plus ou moins voilés pour son professeur de piano, devra se résigner à épouser en 1905 Jules, un employé zélé de son père ; le couple héritera ainsi des exploitations agricoles, de la scierie et d’une domination incontestée sur l’ensemble des possessions et du personnel. Après une longue attente, ce sera en 1913 la naissance de Marguerite, qui n’aura pas le temps de connaître son père tué en Argonne en 1916. Marguerite qui, de victime de la concupiscence masculine deviendra celle sur qui tombe le déshonneur familial, Marguerite qui, auparavant, aura découvert des secrets soigneusement celés par sa mère, cette mère qui refusera toujours de jouer du piano pour sa fille – qui l’écoutera en cachette, l’oreille collée contre le plancher…
Car la musique est au cœur de la relation secrète, presque inconsciente, entre la mère et la fille : « La musique lui parle même lorsque sa mère croit s’enfermer et éloigner sa fille, et c’est peut-être même en l’éloignant que sa mère s’approche au plus près de l’intimité de sa fille ; oui, dans l’esprit de l’enfant, la musique vient pour lui dire une parole que sa mère ne peut pas porter par les mots ni par les gestes ; la musique vient jusqu’à elle pour la bercer, la cajoler, la consoler, l’aimer, lui parler, lui murmurer un langage en-deçà des mots ; la douceur et la tendresse maternelle dont sa mère la prive viennent à elle à travers les poutres du grand salon, ils lui traversent le corps lorsqu’elle écoute, allongée sur le parquet, les doigts qui courent sur le clavier et la musique qui monte et imbibe l’air de la maison, et la maison elle-même, dans le corps même de ses murs et de ses fondations. »
Allons plus loin : l’histoire ici évoquée, « dont, écrit l’auteur, je capte seulement l’écho, la vibration dans l’image tremblante d’une fiction et d’un roman possible », est comparable à une symphonie. L’ampleur de la prose, les suspensions et reprises de son rythme, les mystérieuses résonances et harmonies que portent les phrases, tout cela suscite à la lecture l’émotion que provoque une musique profonde. La maison familiale, que la nouvelle génération a redécouverte après une longue période inoccupée, donne certes une impression de vide. Pourtant, au cœur de ce vide, outre les meubles, un « grand corps sombre trône dans la pièce du bas » : le piano, qui est comme un fil conducteur depuis la passion de Marie-Ernestine jusqu’à l’enfance de l’auteur. Pour celui-ci, la quête de la figure perdue de Marguerite… Oui, et pour les lecteurs la découverte d’un grand roman symphonique.
Jean-Pierre Longre
Pour lire des chroniques sur quelques autres livres de Laurent Mauvignier: http://jplongre.hautetfort.com/tag/laurent+mauvignier
11:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/11/2025
Sortir de l’impasse
 Lire, relire... Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 2016, Le livre de poche, 2017, réédition 2020, édition collector, 2025
Lire, relire... Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 2016, Le livre de poche, 2017, réédition 2020, édition collector, 2025
Gabriel, dit Gaby, père français et mère rwandaise, vit à Bujumbura, dans la région de l’Afrique des Grands Lacs, à une époque tourmentée (les années 1990) qui aurait pu faire son malheur, d’autant plus qu’à la guerre et aux massacres s’ajoute la séparation des parents. Pourtant, même si certaines scènes de violence et certains récits (celui de sa mère, par exemple, revenant du Rwanda où elle a découvert l’horreur) le marquent profondément, il n’est pas malheureux. La petite bande de copains qui occupent « l’impasse » où il vit – les jumeaux, Armand, Gino et lui – s’amuse aux chapardages, aux petites expéditions aventureuses, aux bagarres et autres exploits virils de jeunes garçons.
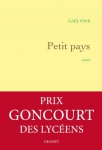 « Chez moi ? C’était ici. Certes, j’étais le fils d’une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l’école française, Kinarina, l’impasse. Le reste n’existait pas. ». Peu à peu, Gabriel va sortir de la bulle enfantine pour prendre conscience de sa place sociale et familiale, de ses propres hontes, des réalités de son pays et du monde, des soubresauts politiques (l’euphorie des premières élections libres, le coup d’État qui a suivi, les rivalités sanglantes entre Hutu et Tutsi), de la guerre qui, malgré ses réticences et son naturel pacifique, vient toucher son petit monde relativement privilégié : « Gaby, c’est la guerre. On protège notre impasse. Si on ne le fait pas, ils nous tueront. Quand est-ce que tu vas comprendre ? Dans quel monde vis-tu ? […] Nos ennemis sont déjà là. Ce sont les Hutu et eux n’hésitent pas à tuer des enfants, cette bande de sauvages. Regarde ce qu’ils ont fait à tes cousins, au Rwanda. Nous ne sommes pas en sécurité. Il faut apprendre à nous défendre et à riposter. Que feras-tu quand ils rentreront dans l’impasse ? Tu leur offriras des mangues ? », lui lance son ami Gino. Mais il y a aussi les lettres qu’il échange avec Laure, sa correspondante d’Orléans, ouverture épistolaire heureuse qui lui offre les prémices d’une vocation littéraire ; il y a l’école, qu’il est bien content de reprendre après des grandes vacances inoccupées (« c’est pire que le chômage ») ; et il y a les livres que Madame Economopoulos, une voisine, lui fait découvrir : « Grâce à mes lectures, j’avais aboli les limites de l’impasse, je respirais à nouveau, le monde s’étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. ».
« Chez moi ? C’était ici. Certes, j’étais le fils d’une Rwandaise, mais ma réalité était le Burundi, l’école française, Kinarina, l’impasse. Le reste n’existait pas. ». Peu à peu, Gabriel va sortir de la bulle enfantine pour prendre conscience de sa place sociale et familiale, de ses propres hontes, des réalités de son pays et du monde, des soubresauts politiques (l’euphorie des premières élections libres, le coup d’État qui a suivi, les rivalités sanglantes entre Hutu et Tutsi), de la guerre qui, malgré ses réticences et son naturel pacifique, vient toucher son petit monde relativement privilégié : « Gaby, c’est la guerre. On protège notre impasse. Si on ne le fait pas, ils nous tueront. Quand est-ce que tu vas comprendre ? Dans quel monde vis-tu ? […] Nos ennemis sont déjà là. Ce sont les Hutu et eux n’hésitent pas à tuer des enfants, cette bande de sauvages. Regarde ce qu’ils ont fait à tes cousins, au Rwanda. Nous ne sommes pas en sécurité. Il faut apprendre à nous défendre et à riposter. Que feras-tu quand ils rentreront dans l’impasse ? Tu leur offriras des mangues ? », lui lance son ami Gino. Mais il y a aussi les lettres qu’il échange avec Laure, sa correspondante d’Orléans, ouverture épistolaire heureuse qui lui offre les prémices d’une vocation littéraire ; il y a l’école, qu’il est bien content de reprendre après des grandes vacances inoccupées (« c’est pire que le chômage ») ; et il y a les livres que Madame Economopoulos, une voisine, lui fait découvrir : « Grâce à mes lectures, j’avais aboli les limites de l’impasse, je respirais à nouveau, le monde s’étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. ».
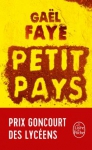 Gabriel, sans aucun doute, ressemble à Gaël, et ce qui est raconté dans le roman est visiblement le fruit de l’expérience. Avec l’exil, il a trouvé la paix, mais il reste « entre deux rives » géographiques et temporelles : exilé « de [son] enfance » plus que « de [son] pays », l’adulte, revenant vers le pays d’origine, n’y retrouvera que les livres, et des traces funestes. Petit pays est écrit au rythme de la vie, des petits et grands événements qui ont marqué le passé. Chaque chapitre déroule un épisode particulier, bonheur ou malheur, et aboutit à une évocation du paysage intérieur ou extérieur, cadence musicale ponctuant la narration. Un roman dont la force réside dans ce qu’il raconte, et dont la densité réside dans ses prolongements poétiques.
Gabriel, sans aucun doute, ressemble à Gaël, et ce qui est raconté dans le roman est visiblement le fruit de l’expérience. Avec l’exil, il a trouvé la paix, mais il reste « entre deux rives » géographiques et temporelles : exilé « de [son] enfance » plus que « de [son] pays », l’adulte, revenant vers le pays d’origine, n’y retrouvera que les livres, et des traces funestes. Petit pays est écrit au rythme de la vie, des petits et grands événements qui ont marqué le passé. Chaque chapitre déroule un épisode particulier, bonheur ou malheur, et aboutit à une évocation du paysage intérieur ou extérieur, cadence musicale ponctuant la narration. Un roman dont la force réside dans ce qu’il raconte, et dont la densité réside dans ses prolongements poétiques.
Jean-Pierre Longre
11:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, burundi, gaël faye, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/10/2025
Du sang et des livres
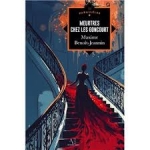 Maxime Benoît-Jeannin, Meurtres chez les Goncourt, Asmodée Edern, 2025
Maxime Benoît-Jeannin, Meurtres chez les Goncourt, Asmodée Edern, 2025
Il se passe des choses bizarres et dramatiques dans l’immeuble où habitent Edmond et Jules de Goncourt. Certes, la soirée promet d’être passionnante, réjouissante et fournie : dans l’appartement des fameux duettistes littéraires, vont se réunir quelques personnalités de l’époque : l’imposant Gustave Flaubert, Théophile Gautier avec femme et enfants, une comédienne à succès (pas seulement théâtral), quelques autres invités appartenant au monde du théâtre et du spectacle, et Léonce Jacquelain, un jeune auteur venu de Gand présenter son premier roman, La Passagère de la Méduse, dont Flaubert va faire une lecture « gueulée ». Cette lecture occupe tout ce monde, et aussi une part non négligeable du livre : une mise en abyme, un roman dans le roman, doublant l’intrigue.
Car de l’intrigue, il y en a… Le meurtre sanglant de la voisine de palier des Goncourt, une « très belle jeune femme exerçant le très antique métier qui console les hommes solitaires ou mariés, et parfois les hommes de lettres » – ce qui multiplie les suspects aux yeux du commissaire de quartier, un certain Fenouil, venu enquêter et soupçonner un peu tout le monde. On n’en restera pas là : le comte Dusseuil (on reste dans les éléments immobiliers…), qui habite au-dessus des Goncourt et dont l’épouse, comme par hasard, est la maîtresse de Jules, trouve la mort dans des circonstances compromettantes, qui pourront être cachées grâce à l’arrivée inopinée d’un peintre bohème et de son singe…
Autant dire que se multiplient des péripéties dans lesquelles mort violente et littérature, sans parler de quelques scènes dans lesquelles la sensualité se déploie sans vergogne, s’emboîtent avec beaucoup de vivacité, et souvent d'humour. Meurtres chez les Goncourt est un roman multiple, à lire comme un vrai « thriller littéraire ».
Jean-Pierre Longre
23:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maxime benoît-jeannin, asmodée edern, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/10/2025
Enquête sur un échec à répétition
 Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Chacun s’est un jour posé des questions sur certaines anomalies de l’orthographe française : pourquoi écrire au pluriel des bijoux et des filous, des chevaux et des landaus, pourquoi dangereux fait-il dangereuse au féminin, ou pourquoi chanceler donne-t-il « il chancelle », mais modeler « il modèle » ? On pourrait multiplier les exemples dans lesquels interviennent non le souci étymologique, mais le hasard des graphies médiévales, voire plus tardives. Et qu’en est-il de la transcription de l’oral ? Eh bien, on constate que par exemple « la consonne /s/ s’écrit s, ss, t, c, ç » ; que « la voyelle nasale /in/ se rend par in, im, ain, aim, ein, yn, ym, etc. » Ne faudrait-il pas réformer tout cela ?
Oui, depuis le XVIe siècle jusqu’à notre époque, on ne compte pas les grammairiens, linguistes, enseignants, écrivains qui se sont lancés « à l’assaut de la forteresse orthographique », et qui ont subi un échec tantôt discret, tantôt retentissant. Bernard Cerquiglini, qui fut officiellement de la partie, mais qui, en bon oulipien, sait combiner le sérieux (universitaire) et le détachement (humoristique), sans négliger la discrète provocation, s’adonne dans ce bref mais dense volume à une enquête minutieuse sur cet échec maintes fois répété.
« À qui la faute ? » Le substantif du titre rappelle en filigrane que l’erreur orthographique connote « une idée de péché », tant les conventions d’écriture semblent revêtues d’un caractère sacré. Qui sont donc les responsables de l’impossibilité de réformer l’orthographe ? L’auteur les répartit en cinq catégories, sous la forme interrogative. Les « cuistres » ? Ce sont les pédants, « latinisants besogneux et souvent responsables d’un étymologisme inopportun », mais qui ne sont pas complètement étrangers aux progrès linguistiques. L’Académie française ? Chargée de « dire le droit en matière graphique », elle aménage la norme au long des siècles et des livraisons du dictionnaire. Jules Ferry ? « Lire, écrire, compter », telle est la mission de l’école, et les deux premières injonctions mettent en avant une graphie figée, donnant le pouvoir à ceux qui maîtrisent l’orthographe, mais aussi faisant surgir, aux alentours de 1900, un « camp de la réforme » qui se manifestera jusqu’aux « Rectifications orthographiques » de 1990, que pratiquement personne n’applique… Les réformateurs ? Depuis Louis Meigret et son « Traité » publié en 1550, les tentatives de simplification tendant à harmoniser l’écriture et la prononciation et à supprimer les anomalies évoquées au début de cette chronique ont été nombreuses, et parfois si excessives qu’elles ont suscité au pire de violentes réactions, au mieux l’indifférence. Charlemagne ? Nous remontons alors aux sources d’une langue française marquée par la « créolité », un mélange complexe d’idiomes qui font sa richesse et sa singularité, une complexité qui, selon l’auteur, demanderait malgré tout une rénovation bien comprise. Sera-t-elle possible ? En tout cas, Bernard Cerquiglini nous incite, sans pédantisme mais avec la science du spécialiste et le savoir-faire du pédagogue, à réfléchir sur le passé et le présent d’une langue qui doit assurer son avenir.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, bernard cerquiglini, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/10/2025
Pâtes italiennes
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Roman épistolaire, roman culinaire, roman oulipien, roman à tiroirs, roman d’investigation… Maintes caractéristiques génériques pourraient qualifier le dernier livre d’Hervé Le Tellier, qui se situe ici dans la droite (mais complexe) lignée des initiateurs de l’OuLiPo. Il y aurait à ajouter, aux limites du romanesque : la fiction autobiographique, l’érudition historique et artistique, la poésie italienne (et anglaise ou irlandaise), les jeux de l’amour (où le hasard, finalement, n’aura pas voix au chapitre), les malices intertextuelles, de Dante à Calvino et Roubaud.
 On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
Voilà le début, et on ne poursuivra pas le résumé ; car à partir de là, l’entrecroisement épistolaire, ponctué d’extraits du « Carnet de l’auteur » et de narrations culinaires, mène le lecteur, comme le narrateur, dans un labyrinthe de faux-semblants (vraisemblables au demeurant), de chemins de traverse, de jeux de piste, d’embûches intellectuelles et sentimentales. Qui dit vrai, qui ment ? Qui est le voleur, qui le volé ? Les « Caro Giovanni », « Cher Monsieur d’Arezzo », « Cher Giovanni », « Giovanni mio », « Carissimo Giovanni », les congratulations et remerciements mutuels sont des formules qui occultent à peine une guerre à pointes de moins en moins mouchetées où l’on n’hésite pas à se dérober des histoires personnelles, des souvenirs, des amours anciennes, des confidences, la « nostalgie » qu’évoque le titre.
Tout cela est un jeu ? En quelque sorte : jeu de l’arroseur arrosé, du piégeur piégé, du bourreau victime… Mais jeu qui, comme dans tout bon roman forgé à l’aune d’une construction rigoureusement préméditée (on ne peut manquer de penser, du côté épistolaire, aux Liaisons dangereuses, et du côté oulipien, à La vie mode d’emploi), engage une ou des existences à part entière ; celles des personnages, et celle du lecteur qui se laisse lui-même prendre au piège et ne peut s’empêcher de deviner que, sous ce qu’il a cursivement saisi, bien d’autres choses se tapissent dans les profondeurs dantesques de l’humaine comédie.
Jean-Pierre Longre
11:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/10/2025
La poésie des insomnies
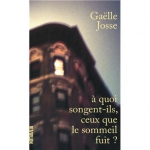 Lire, relire... Gaëlle Josse, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?, Les éditions Noir sur blanc / Notabilia, 2024, J'ai lu, 2025
Lire, relire... Gaëlle Josse, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?, Les éditions Noir sur blanc / Notabilia, 2024, J'ai lu, 2025
Chacun a son histoire, ses histoires, et la nuit est propice à faire surgir ces « quelques éclats [qui] demeurent au milieu des heures profondes, en veille. » Oui, « c’est l’heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l’attente. Ce sont les heures où le cœur tremble, où les corps se souviennent, peau à peau avec la nuit. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. » Alors Gaëlle Josse, qui sait si bien s’y prendre avec les mots intimes, évoque ces heures de veille qui sont des heures de manques, de chagrins, de pleurs parfois, mais aussi de joies discrètes et d’espoir serein.
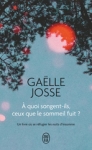 Ils sont là, ces hommes et ces femmes qui attendent une arrivée, un retour, qui pleurent un être cher, qui guettent des silhouettes entrevues, qui savent que la mort va arriver, ou qui ne savent pas ce qu’il va se passer, qui ont décidé d’aller chercher le bonheur ailleurs, ou de rompre, ou de renouer, ou tout simplement de vivre en se disant « que, parfois, tout est bien. »
Ils sont là, ces hommes et ces femmes qui attendent une arrivée, un retour, qui pleurent un être cher, qui guettent des silhouettes entrevues, qui savent que la mort va arriver, ou qui ne savent pas ce qu’il va se passer, qui ont décidé d’aller chercher le bonheur ailleurs, ou de rompre, ou de renouer, ou tout simplement de vivre en se disant « que, parfois, tout est bien. »
Ces brèves séquences, ces instantanés nocturnes se succèdent au rythme lent des émotions, comme des élégies, comme de délicates mélodies. On connaît la prédilection de Gaëlle Josse pour l’art, en particulier pour la musique, évoquée ici à plusieurs reprises : le « monde infini et clos » de l’aria des Variations Goldberg, le « dernier concert » d’un pianiste qui sent la virtuosité lui échapper… Mais la musique s’épanouit surtout dans la prose poétique d’une autrice qui cultive la nuance et l’harmonie, une harmonie dont la continuité est assurée par les brèves transitions entre les différentes séquences ; une ligne, deux lignes à peine comme des portées musicales, « la nuit amère, la nuit comme un gouffre, la nuit consolation », « la nuit colère, la nuit repos, la nuit ouverte, la nuit refuge », « la nuit où tombent les masques »… La tonique et son complément ici multiple, la dominante…
Et puis, parmi toutes ces « microfictions », il y en a une qui penche vers l’aveu autobiographique, qui se nourrit de l’expérience de l’écriture nocturne, qui en dit tout en quelques lignes, et par lequel on terminera cette chronique : « Parfois l’écriture l’emmène au bord du vide et la retient là, sur cette frontière, puis au dernier moment elle la sauve de l’effroi, de la tiédeur, du demi-jour et des colères tristes. Elle poursuit son travail obscur de sourcière. »
Jean-Pierre Longre
www.leseditionsnoirsurblanc.fr/catalogue-collection/notab...
08:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, poésie, francophone, gaëlle josse, les éditions noir sur blanc notabilia, jean-pierre longre, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/09/2025
L’épopée du vulgaire
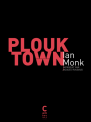
Ian Monk, né en 1960, décédé le 19 septembre 2025...
Ian Monk, Plouk Town, introduction de Jacques Roubaud, Éditions Cambourakis, 2007, rééd. 2011
Au commencement était la contrainte et la contrainte s’est faite verbe et le verbe s’est fait avalanche. Ainsi : Plouk Town est un long texte poétique en onze parties : la première contient un poème (x) d’un vers (x2) d’un mot (x), la seconde deux parties (x) de quatre vers (x2) de deux mots (x), la troisième trois poèmes (x) de neuf vers (x2) de trois mots (x) et ainsi de suite, jusqu’à la dernière partie contenant 11 poèmes de 121 vers de 11 mots… L’avalanche, extension du principe oulipien de « boule de neige », sert donc à l’auteur de contrainte rythmique, et au texte de cadre poétique, à l’intérieur duquel d’autres contraintes (anaphores, rimes et antérimes, recherche de toutes les combinaisons possibles d’un ensemble de 9 mots aboutissant à la composition de 81 vers (99)…) guident le texte.
Soit. Mais l’exercice n’est jamais gratuit. Plouk Town est un ouvrage abouti, qui ne relève pas que de l’expérimental formel, mais aussi et surtout de l’expérience fondamentale du quotidien. Dans la ville en question, les Plouks en question, c’est nous, c’est Monk, c’est tous ceux qui traînent leur cafard quotidien dans un paysage sans horizon. Sans précautions oratoires, en toute lucidité mentale et en toute verdeur lexicale, l’auteur chante en mineur la connerie des gens, les mômes pénibles, les parkings de supermarché, le Quick, l’alcoolisme, la Star Academy, la promiscuité, les appartements crasseux, la clochardisation… Ces scènes de la vie vulgaire sont certes localisées pour la circonstance, mais elles sont de partout : comme partout (à Bombay, Tombouctou, Londres ou New York), « la pauvreté te cogne la gueule à Plouk Town » ; comme partout, on embauche (des vigiles, des surveillants, des tortionnaires, des connards), on a peur, on aime, on se souvient, on pense, on déteste, on tâche de vivre, on est sûr de mourir.
Il y a tout à Plouk Town, et on y ressent tout ce que peuvent ressentir les humains. Il y a tout dans le livre de Ian Monk (après une fort plaisante et fort charpentée préface de Jacques Roubaud), en vers, en morceaux de dialogues, en bribes de monologues, en fragments réalistes, poétiques, comiques, tragiques, épiques. Il y a même des tentatives de réponse à l’angoisse collective et individuelle :
« moi qui vous le dis je m’entraîne
à l’écriture justement mais justement pour sortir
de cette idée de pourriture de ma vie ».
Jean-Pierre Longre
20:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, francophone, ian monk, jacques roubaud, oulipo, Éditions cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/09/2025
Une élégante venue de Rio
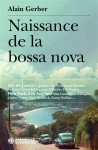 Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Une fois n’est pas coutume, l’auteur de cette chronique avoue n’avoir pratiquement rien connu de la bossa nova avant d’avoir lu le livre d’Alain Gerber. Ou alors ce n’est qu’une impression, tant ce livre lui a ouvert les yeux et les oreilles sur des rythmes et des harmonies qu’il avait en tête sans les identifier formellement. Tout cela pour dire que Naissance de la bossa nova est un titre bien modeste pour un ouvrage d’une érudition qui, certes, ne surprend pas de la part de l’auteur, mais se déploie d’un air si naturel qu’on ne se doute pas de la somme de travail qu’a sûrement nécessité la quantité de références précises qu’il propose.
Il y a la « genèse à Rio de Janeiro », avec les « pères fondateurs » (Vinicius de Moraes, Antônio Carlos « Tom » Jobim, Joấo Gilbert), un certain nombre de chanteurs et chanteuses comme Chico Buarque ou Nara Leấo, et il y a la « jeunesse à New York et ailleurs dans le monde », dont Dizzy Gillespie et Stan Getz sont des figures dominantes, mais non uniques. La première phrase de l’histoire résume un état des lieux implacable : « Grâce à Dizzy Gillespie surtout, le jazz s’est afrocubanisé dans les années 40. Grâce à Stan Getz entre autres, le jazz s’est brésilianisé au début des années 60. » On s’attend donc à apprendre beaucoup de choses au fil des pages, et cette attente n’est pas déçue ! On apprend, par exemple, que l’expression bossa-nova a été utilisée pour la première fois dans une chanson de Mendonça, et d’ailleurs qu’à l’origine les bossas-novas sont essentiellement des chansons avec des paroles qui « leur collent à la peau » ; que la « nonchalance » apparente du genre est loin d’être un « relâchement rythmique », que « des sanitaires ont servi de maternité à la bossa-nova », que la chanson Tu verras chantée par Nicole Croisille et Claude Nougaro est de Chico Buarque (O Que Sera), que Stan Getz a inventé le « Brésil universel », « un pays de nulle part, plein d’ombres et de reflets, de mirages et de réminiscences. »
On le voit, ce n’est pas parce qu’Alain Gerber nous fait partager ses connaissances qu’il abandonne son costume d’écrivain. Même dans un livre historique abondamment documenté, il s’adonne à des considérations bien pensées sur les mystères de « l’invention mélodique », sur la musique codifiée, sur « la science harmonique » qui n’explique pourtant pas « ce qui fait qu’un certain agencement de notes trouvera un écho sur la sensibilité universelle. » Et il ne se prive pas, pour notre plus grand plaisir, de laisser se développer son style ô combien séduisant. Au hasard, un exemple à propos du « L.A. Four » : « Prolifique, professionnel en diable, prodigue en performances instrumentales, délicieux sans conteste, mais aussi, comment dire ?... facultatif, essentiellement distractif. Sans faiblesses et sans reproche. Sans folie et sans nécessité non plus. […] La démagogie n’a pas cours chez les Quatre de Los Angeles. Et la mièvrerie ne pouvait compter sur eux pour s’épanouir : montrer leurs muscles ne fut pas leur préoccupation majeure ; en revanche leur musique en quête de raffinement restait en toute circonstance remarquablement articulée. » Ce ne sont là que quelques lignes parmi de nombreuses non moins prenantes, à la manière de la bossa nova elle-même que, pour changer un peu de plume, Patrick Frémeaux définit en quelques mots dans sa note liminaire : « La bossa nova incarne cette élégance nonchalante qui nous charme immédiatement et qui a vite su conquérir bien au-delà des frontières brésiliennes. » Laissons-nous prendre par cette musique comme par la prose élégante d’Alain Gerber.
Jean-Pierre Longre
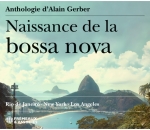 « La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
« La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
Patrick Frémeaux
- CD 1 - RIO DE JANEIRO : HEITOR VILLA-LOBOS : BACHIANA BRASILEIRA N° 5 • DICK FARNEY & LUCIO ALVES : TEREZA DA PRAIA • JOHNNY ALF : RAPAZ DE BEM • ANTÔNIO CARLOS JOBIM & VINÍCIUS DE MORAES : SE TÔDOS FÔSSEM IGUAIS A VOCÊ • LUIZ BONFA : LUZES DO RIO • JOÃO GILBERTO : UM ABRAÇO NO BONFÁ • ELIZETE CARDOSO : OUTRA VEZ • JOÃO GILBERTO : CHEGA DE SAUDADE • DORIVAL CAYMMI : SAMBA DA MINHA TERRA • JOÃO GILBERTO : SAMBA DA MINHA TERRA • TRIO CAMARA : MUITO A VONTADE • JOÃO GILBERTO : HO-BÁ-LÁ-LÁ • ELIZETE CARDOSO : SERENATA DE ADEUS • BADEN POWELL : SAMBA NOVO, PT. 2 • BADEN POWELL : PARA NÂO SOFRER • MAYSA (MATTARAZZO) : O BARQUINHO • SYLVIA TELLES : SE É TARDE ME PERDOA • JOÃO GILBERTO : LOBO BOBO • SYLVIA TELLES : DISCUSSÃO • JOÃO GILBERTO : SAMBA DE UMA NOTA SO • JOÃO GILBERTO : DESAFINADO • SYLVIA TELLES : CORCOVADO • CARLOS LYRA : COISA MAIS LINDA • CARLOS LYRA : MARIA NINGUÉM • OS CARIOCAS : TUDO É BOSSA • SÉRGIO RICARDO : MAXIMA CULPA • ANIBAL SARDINHA “GAROTO” : ALMA BRASILEIRA • OSCAR CASTRO-NEVES : AULA DE MATEMATICA.
CD 2 - (QUELQUE CHOSE SUR L’AMÉRIQUE DU NORD) : CURTIS FULLER : ONE NOTE SAMBA • DAVE BRUBECK : VENTO FRESCO • STAN GETZ & CHARLIE BYRD : É LUXO SÓ • CAL TJADER : SE É TARDE ME PERDOA • SONNY ROLLINS : THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES • DIZZY GILLESPIE : DESAFINADO • BOB BROOKMEYER : CHORA TUA TRISTEZA • STAN GETZ : BIM BOM • ZOOT SIMS : MARIA NINGUEM • QUINCY JONES : BLACK ORPHEUS • DAVE PIKE : PHILUMBA • COLEMAN HAWKINS : UM ABRAÇO NO BONFÁ • IKE QUEBEC : FAVELA • LALO SCHIFRIN : RAPAZ DE BEM • CHARLIE ROUSE : VELHOS TEMPOS • GEORGE SHEARING : MANHA DE CARNAVAL • BUD SHANK : PENSATIVA.
DIRECTION ARTISTIQUE : ALAIN GERBER
09:53 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, alain gerber, patrick frémeaux, alain lesage, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2025
Une entrée en littérature
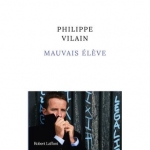 Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
« Mauvais élève », Philippe Vilain le fut toute son enfance, jusqu’à ce que, décidant d’échapper aux horizons limités offerts par le BEP, il découvre la littérature et la philosophie, passe le baccalauréat, puis entame des études de Lettres qui le mèneront jusqu’au doctorat.
Voilà qui est vite résumé, et qui ne ferait pas la matière d’un livre s’il n’y avait pas tout le reste, notamment la rencontre avec Annie Ernaux qui, après un échange de correspondance, s’éprit de lui et le fit entrer dans sa vie. C’est ainsi que, lui-même séduit, il fit avec elle de beaux voyages, côtoya l’aristocratie des Lettres, ne se privant pas d’observer d’un œil acéré ce monde tout nouveau pour lui : « Je savais, grâce à un discernement exercé, saisir la personnalité de chacun, identifier leur appartenance sociale, à leur diction, façon de s’exprimer, posture, manière de se coiffer, de se vêtir, de s’approprier certaines marques ; je pouvais rapidement distinguer les aristocrates, les nobles, les bourgeois, les petits-bourgeois, démasquer les imposteurs, remarquer ceux qui n’appartenaient pas à ces cercles, les opportunistes qui n’y avaient pas grandi mais qui y étaient tolérés, les parvenus qui l’avaient conquis par des relations, mais qu’une assurance surjouée trahissait, tous ceux-là jusqu’aux belles provinciales séductrices mais désargentées qui me souriaient. »
Si sa compagne, bien plus expérimentée que lui, lui fait découvrir ce nouveau monde, elle devient aussi sa maîtresse en écriture ; sous sa houlette, il découvre la « dimension stakhanoviste » d’une tâche « semblable à un travail musical de gammes ou de répétitions », et apprend que « l’écriture demande un investissement sans faille, un apprentissage de l’humilité, une obéissance à une méthode, offrant finalement peu de jubilation, peu de plaisir. » En filigrane, on devine une relation de dominante à dominé, d’aristocrate des Lettres à jeune « plouc » (le mot a été dit) qui, en y réfléchissant, s’aperçoit que celle qui se désigne comme une « transfuge de classe » l’est beaucoup moins que lui : « C’était une erreur de croire que nous avions vécu la même enfance, puisque, en réalité, et heureusement pour elle, elle n’avait pas subi directement la violence et la pauvreté des classes inférieures, des déshérités, elle n’avait pas affronté le licenciement économique de ses parents, les dettes et la saisie immobilière, l’alcoolisme d’un père, l’échec scolaire. »
L’objet principal de Mauvais élève n’est pas tant le récit d’une relation amoureuse initiatrice et hors normes que celui d’une accession à la littérature et à ses dimensions, en même temps qu’une réflexion sur l’écriture elle-même, en particulier sur l’écriture autobiographique, ses « stratégies », ses « distorsions », « la façon dont un écrivain peut transformer son histoire, l’infléchir dans un sens plutôt que dans un autre, instrumentaliser ses expériences par les ruses du genre. » Au-delà des aspects anecdotiques, l’important est là : l’exploration d’une entrée en littérature et la découverte de ses mystères.
Jean-Pierre Longre
21:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, philippe vilain, robert lafont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/09/2025
Hurlement de la vie, épuisement du langage

La publication du Cri du barbeau est l'occasion, pour les éditions Corti, de rééditer La Symphonie du loup, dont la chronique ci-dessous avait été publiée en septembre 2010.
Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 2007
Prix Robert Walser 2008, réédition éditions Corti, 2025
Marius Daniel Popescu est né en Roumanie et vit actuellement à Lausanne. Il s’est fait connaître il y a quelques années par ses Arrêts déplacés, recueil de poèmes où la vie quotidienne se décline en miniatures ciselées avec une amoureuse précision. Il rédige et publie en outre avec régularité Le Persil, journal atypique, inimitable, où fleurissent les mots du quotidien. Marius Daniel Popescu est un poète, et l’important roman qu’il vient de faire paraître en est une preuve supplémentaire.
 Car les 146 sections des 399 pages (soyons précis !) de La Symphonie du loup sont autant de poèmes en prose. Juxtaposition de tableaux, d’instantanés, de scènes représentant les petits et grands faits d’une existence, le texte est un puzzle à la Perec, une tentative d’épuisement du langage par la vie elle-même, qui devrait triompher des mots, les effacer purement et simplement, ces mots ressassés, réitérés, s’étalant sans vergogne sur la page, et qui « ne devraient pas exister » (leitmotiv tout aussi ressassant). Car ils sont de vrais pièges, des pièges à loup : « Tu as appris tôt la duplicité du monde, la duplicité des gens, la duplicité des mots. Tu as appris depuis petit que le même mot peut provoquer ou arrêter une bagarre. Même le mot cerisier, tu savais qu’il est à la fois donneur de vie et meurtrier ». Et encore : « Quand je lis des mots inscrits quelque part, dans des livres de toutes sortes, sur des murs, dans les journaux ou sur les affiches publicitaires, je ne m’approche pas de leur sens avec une envie de recevoir du plaisir. Je ne cherche pas le plaisir dans les mots ». Et plus on approche de la fin, plus les séquences deviennent brèves, réduites au minimum verbal, au squelette narratif, et le puzzle devient multiple, livré au hasard comme une partie de cartes.
Car les 146 sections des 399 pages (soyons précis !) de La Symphonie du loup sont autant de poèmes en prose. Juxtaposition de tableaux, d’instantanés, de scènes représentant les petits et grands faits d’une existence, le texte est un puzzle à la Perec, une tentative d’épuisement du langage par la vie elle-même, qui devrait triompher des mots, les effacer purement et simplement, ces mots ressassés, réitérés, s’étalant sans vergogne sur la page, et qui « ne devraient pas exister » (leitmotiv tout aussi ressassant). Car ils sont de vrais pièges, des pièges à loup : « Tu as appris tôt la duplicité du monde, la duplicité des gens, la duplicité des mots. Tu as appris depuis petit que le même mot peut provoquer ou arrêter une bagarre. Même le mot cerisier, tu savais qu’il est à la fois donneur de vie et meurtrier ». Et encore : « Quand je lis des mots inscrits quelque part, dans des livres de toutes sortes, sur des murs, dans les journaux ou sur les affiches publicitaires, je ne m’approche pas de leur sens avec une envie de recevoir du plaisir. Je ne cherche pas le plaisir dans les mots ». Et plus on approche de la fin, plus les séquences deviennent brèves, réduites au minimum verbal, au squelette narratif, et le puzzle devient multiple, livré au hasard comme une partie de cartes.
En même temps, La Symphonie du loup est un roman au souffle inépuisable, un souffle qui vous transporte entre passé et présent. L’enfant, le jeune homme qui, comme sa famille et ses compagnons, évoluait sous et malgré l’omniprésence de la dictature, est simultanément ce père de famille qui voit agir et fait grandir ses enfants, la « petite » et la « grande », dans son pays d’adoption. « L’école de la vie », qui signifie « tout ce qu’un être humain peut vivre et comprendre et apprendre sur la terre », est ici et là, en un constant va-et-vient entre là et ici. C’est une école qui enseigne tout, y compris la mort : celle du père, qui est au départ de la narration, celle de l’enfant à naître, relatée en des pages hallucinantes d’émotion contenue : « ce monde est fou, nous sommes des fous parmi les fous, je ne veux pas d’un enfant de fou dans un monde de fous ! », dit en pleurant la fiancée qui « souffrait beaucoup à cause de la vie que le parti unique avait instaurée au pays »… Ce « parti unique » est partout, transformant les hommes en « figurants » obligés de répondre « présent ! » alors que pour survivre ils ne peuvent qu’être mentalement ailleurs.
Le souffle du roman, c’est aussi le style, un style qui prend à la gorge. Le style c’est l’homme, a dit quelqu’un il y a quelques siècles ; mais l’homme est un loup pour l’homme, avait dit un autre un peu auparavant ; résultat de l’équation (qu’aurait donné le héros, féru de mathématiques) : le style, c’est le loup, dont le chant, murmuré ou hurlé, ne peut pas laisser indifférent. Roman à la deuxième personne, parole adressée par le grand-père à son petit-fils, La Symphonie du loup utilise le « tu » général, universel, mais le « je » et le « il » sont là, tout près, en embuscade dans le train du récit : « Tu es resté dans ce compartiment un peu plus d’une heure, presque endormi tu avais pensé à toi à la première personne, tu t’es vu à la deuxième personne, tu t’es regardé et tu t’es écouté à la troisième personne comme quelqu’un qui se regarde dans une glace et s’appelle soi-même, alternativement, par « je », par « tu » et par « il » ».
Transparente simplicité des faits, absurde complexité de la vie. Le loup dévore les mots, et cependant il les métamorphose en un chant aux insondables harmoniques et aux interminables échos.
Jean-Pierre Longre
17:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu, josé corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/08/2025
La danse des mots, la vie des humains
 Marius Daniel Popescu, Le cri du barbeau, éditions Corti, 2025.
Marius Daniel Popescu, Le cri du barbeau, éditions Corti, 2025.
Sortie le 4 septembre 2025
Il y a chez Marius Daniel Popescu une générosité à la fois naturelle et illimitée. Pas seulement lorsque le « tu » qui le représente offre, dans son « pays d’ici », un repas au restaurant à un clochard puis l’invite à dormir chez lui, ou lorsque, dans son « pays de là-bas », il nourrit de friandises une dizaine d’enfants des rues puis les emmène en taxi au restaurant de la gare ; la générosité, c’est aussi celle de sa prose, qui se nourrit des moindres détails de la vie et en fait, par la magie des mots, tout un roman ; en plus, il nous dit comment il fait : « Tu frappes les touches de cette machine à écrire, tu ne regardes pas les lettres qui s’impriment sur le papier, tu te racontes à toi-même des histoires de ta vie, tu tapes vite des mots qui n’appartiennent pas à la pensée. Il est trois heures du matin, la nuit te regarde et elle te sourit, ses yeux réveillent en toi la vie sous le règne du parti unique, tu continues à raconter la mort de ton père, tu as choisi qu’un vieil homme sera le narrateur. Tu ne laisses pas de marges sur la feuille, les mots remplissent le blanc du papier jusqu’à la barrière du rouleau noir, tu passes à la ligne suivante, la nuit te suit. »
Si l’on apprend sur le tard que le « vieil homme » omniscient qui raconte est le grand-père de « tu », celui-ci reconnaît aussi la grande autonomie des mots imprimés sur la page : « Les mots s’organisent, ils se donnent rendez-vous pour discuter de leur passé et de leur avenir, les mots se mettent ensemble, ils forment de petits groupes et des hordes de mots traversent les villages et les villes du monde, les mots parcourent nos foyers, les écoles et les entreprises, les mots marchent et ils s’envolent et ils naviguent, les mots sursautent et ils virevoltent, les mots sont en branle. » C’est ainsi que les faits se révèlent, par le pouvoir magique du verbe. Des faits qui peuvent être amusants, comme le refus d’un étalon à honorer la belle jument qu’on lui présente, et qui ne se décide que lorsqu’on a couvert celle-ci de boue ; conclusion d’un spécialiste : « La jument, elle lui paraissait trop belle pour lui ; c’est tout. »
C’est parfois franchement drôle, mais c’est plus souvent souriant, avec une grande tendresse pour les individus croisés au fil des pages, avec lesquels les verres partagés sont autant de signes d’attachement, famille, amis ou inconnus, qui le rendent bien au narrateur – exception faite pour ceux qui se sont accaparé le pouvoir : les dirigeants et les sbires du « parti unique » dans « le pays de là-bas », auxquels ont succédé des personnages qui, sous une apparence démocratique, sont restés identiques à ceux de l’ancien régime, profitant de la corruption ambiante : « Dans ton pays de là-bas la vie est très dure à la campagne, la région de ton enfance est administrée par le parti le plus corrompu, beaucoup de gens sont partis travailler à l’étranger, ceux qui restent se débrouillent dans la vie de chaque jour, ils se disent qu’ils n’ont qu’à suivre leur sort. » Et la satire n’épargne pas non plus d’autres catégories : « Les prêtres bénissent à tour de bras des maisons, des appartements, des voitures, des écoles, des ponts, des hôpitaux, des bureaux, ils bénissent tout et n’importe quoi et ils se font payer pour cela, les prêtres gagnent beaucoup d’argent en bénissant. »
Le cri du barbeau (le barbeau, ce poisson que tout jeune notre héros s’efforçait de pêcher avec ses copains, et qui criait véritablement lorsqu’il se faisait prendre) fait suite à La Symphonie du loup (2007) et aux Couleurs de l’hirondelle (2012), publiés aussi aux éditions Corti. Outre le style, le surgissement des souvenirs, les méandres de la vie, avec ses plaisirs et ses vicissitudes, le point commun entre les trois romans est ce que cette vie n’épargne jamais, la mort : au début du premier, la mort du père ; au début du second, celle de la mère ; au début du troisième, celle d’un grand ami resté dans le « pays de là-bas », une mort qui déclenche le va-et-vient entre là-bas (la Roumanie) et ici (la Suisse), le passé et le présent, et qui révèle les multiples facettes d’une existence pleine d’attention pour tous les humains croisés. Un beau roman qui transforme le quotidien en épopée, et dont nous avions déjà eu quelques aperçus dans le fameux journal Le Persil (voir par exemple les numéros 187 et 222-223), un beau roman qu’il convient de lire dans un même et long souffle.
Jean-Pierre Longre
19:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, roumanie, marius daniel popescu, éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/08/2025
La détresse et la beauté
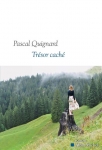 Pascal Quignard, Trésor caché, Albin Michel, 2025
Pascal Quignard, Trésor caché, Albin Michel, 2025
Le titre et le début laissent envisager un roman d’aventures, et c’est le cas. Mais lire un roman de Pascal Quignard, c’est suivre les méandres infiniment poétiques de la mémoire et de la vie intérieure, et c’est aussi le cas. Le premier épisode, qui relate la découverte par Louise d’un réel trésor enfoui – pièces d’or et bijoux –, alors qu’elle enterre son chat au fond du jardin, est à la fois nécessaire et vite oublié : si cette découverte lui permet de voyager à sa guise, ce sont d’autres trésors qu’elle va trouver.
À commencer par la rencontre à Capri de Luigi, ou Ludwick, ou Ludovico, comme elle-même est peut-être Ludovica… Rapprochements intimes et variations musicales sur des prénoms qui passent les frontières, comme il y a des variations sur les états de l’eau, mer au large de Naples ou bras mort de l’Yonne, eau agitée ou stagnante, toujours porteuse de poésie ; comme aussi sur les noms des chats dont elle fait la connaissance sur les îles italiennes : Köthene et Bach, « l’oreille et le petit ruisseau », dont la mère s’appelait Arria ; des malices musicales, et surtout un autre trésor, une autre source de poésie : la présence des félins qui rythment la vie de Louise, qui l’attendent patiemment lorsqu’elle est absente, ou qui partagent avec elle des moments intimes et intenses : « Tous les trois dehors dans l’aube laiteuse ils bondirent sur la table et tous les trois nous petit-déjeunâmes de bon cœur. Puis nous parlâmes. Puis nous recommençâmes de manger. Puis nous bûmes. Puis nous fîmes pipi. Puis nous ronronnâmes. Puis le silence su fit. Le soleil nous toucha. De nouveau nous étions présents à ce monde. C’est peut-être la définition du bonheur : immédiat dans la présence. »
Nous sommes au centre des doutes, des malheurs et des bonheurs de Louise, que l’on saisit de l’intérieur (première personne) ou de l’extérieur (troisième personne), Louise hantée par la mort : celle de Peer, ce vieux chat qui lui a permis de découvrir le trésor ; et celle des hommes aimés : « C’est impossible à confesser. C’est encore plus curieux à penser, alors que les trois hommes avec lesquels j’ai vécu sont morts : mon père du temps de l’Aigle, Jean [le père de sa fille] du temps de Metz, Luigi du temps d’Ischia. Quand je considère les quelques garçons avec lesquels j’ai vécu, il me faut dire : « Peer, c’est toi qui as été l’amour de ma vie. » » Et donc aussi, Louise l’amoureuse, qui goûte les trésors de la vie. Il faut la plume précieuse de Pascal Quignard pour dire la complexité du cœur, de l’esprit et du corps, détresse et beauté mêlées : « Le chagrin illumine étrangement le monde. Le deuil y porte son ombre mais cette ombre, souvent, en souligne, en accuse, en augmente la beauté en même temps que la détresse. L’une et l’autre appartiennent au plus insaisissable de l’âme. C’est ainsi que la mélancolie embellit le présent. »
Jean-Pierre Longre
En lire plus sur Pascal Quignard :
http://jplongre.hautetfort.com/apps/search/?s=Quignard
Quignard et la peinture : Le regard et le silence. Terrasse à Rome de Pascal Quignard. .pdf
Quignard et la musique : Les oreilles n'ont pas de paupières... La haine de la musique de P.Q..pdf
20:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pascal quignard, albin michel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/08/2025
« Ne pas tomber »
 Neige Sinno, Triste tigre, P.O.L., 2023, Folio, 2025
Neige Sinno, Triste tigre, P.O.L., 2023, Folio, 2025
Prix Femina 2023, Prix Goncourt des Lycéens 2023
Entre 7 et 14 ans, Neige a été violée par son beau-père d’une manière systématique, presque quotidiennement, sans que personne le sache. Jeune adulte, elle finit par porter plainte avec l’aide de sa mère à qui elle a tout raconté, et l’homme, qui reconnaît les faits, « comme s’il cherchait à se confesser », est condamné à neuf ans de prison – après quoi il se forgera une nouvelle vie, fondant une nouvelle famille. Neige, quant à elle, va faire des études, une thèse en littérature, et vivre au Mexique avec son compagnon et sa petite fille. Passé la quarantaine, elle publie Triste tigre.
 Voilà pour l’affaire, succinctement résumée. Un énième livre autobiographique sur l’inceste et le viol, et sur leurs conséquences ? En quelque sorte, mais avec beaucoup plus que cela. Car il y a tout le reste, tout ce que l’autrice cherche au-delà des faits. Dans cette tâche, elle sollicite l’aide de références littéraires – Lolita de Nabokov, L’Œil le plus bleu de Toni Morrison, Le Voyage dans l’Est de Christine Angot, Souvenirs de la Kolyma de Varlam Chalamov, bien d’autres encore, comme des supports sur lesquels s’appuyer, grâce auxquels se rassurer. Car comment vivre après cela ? « On ne peut pas se relever et se défaire de quelque chose qui nous constitue à ce point. Le monde entier est perçu à travers ce filtre. Pour celui qui n’a connu que cela, c’est depuis l’oppression que tout s’organise. Il n’existe pas un soi non-dominé, un équilibre auquel on pourrait retourner une fois la violence terminée. » Alors on cherche la « vérité » par la dénonciation, mais « Il faut être prêt à perdre beaucoup de choses quand on décide de parler. On perd sa famille, c’est évident, on perd son village aussi, on perd son enfance, ses souvenirs d’enfance, ses illusions d’enfance. »
Voilà pour l’affaire, succinctement résumée. Un énième livre autobiographique sur l’inceste et le viol, et sur leurs conséquences ? En quelque sorte, mais avec beaucoup plus que cela. Car il y a tout le reste, tout ce que l’autrice cherche au-delà des faits. Dans cette tâche, elle sollicite l’aide de références littéraires – Lolita de Nabokov, L’Œil le plus bleu de Toni Morrison, Le Voyage dans l’Est de Christine Angot, Souvenirs de la Kolyma de Varlam Chalamov, bien d’autres encore, comme des supports sur lesquels s’appuyer, grâce auxquels se rassurer. Car comment vivre après cela ? « On ne peut pas se relever et se défaire de quelque chose qui nous constitue à ce point. Le monde entier est perçu à travers ce filtre. Pour celui qui n’a connu que cela, c’est depuis l’oppression que tout s’organise. Il n’existe pas un soi non-dominé, un équilibre auquel on pourrait retourner une fois la violence terminée. » Alors on cherche la « vérité » par la dénonciation, mais « Il faut être prêt à perdre beaucoup de choses quand on décide de parler. On perd sa famille, c’est évident, on perd son village aussi, on perd son enfance, ses souvenirs d’enfance, ses illusions d’enfance. »
La deuxième partie du livre, « Fantômes » (la première s’intitule « Portraits ») entame une série de réflexions « trente ans plus tard » sur les conséquences du crime, la honte, les amalgames, le normal et l’anormal, et aussi sur le « comment écrire » à ce sujet. Faire de la littérature, afin de « transcender » « la simple et vulgaire expérience » ? « Mais, d’un autre côté, faire de l’art avec mon histoire me dégoûte. » L’essentiel ? Témoigner pour tenter de dire l’indicible, et, selon les derniers mots du livre, pour « ne pas tomber. » En l’occurrence, le témoignage est à la fois prenant, sombre et éblouissant.
Jean-Pierre Longre
10:17 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : témoignage, autobiographie, francophone, neige sinno, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/08/2025
Les déchirements et les découvertes de l’exil
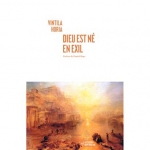 Vintilă Horia, Dieu est né en exil, Les Éditions Noir sur Blanc, 2025
Vintilă Horia, Dieu est né en exil, Les Éditions Noir sur Blanc, 2025
La vie de Vintilă Horia (1915-1992) incarne d’une manière significative l’exil imposé par les forces politiques. Après l’oppression subie par le fascisme de la garde de fer et le nazisme allemand, il refusa de se compromettre avec le régime communiste et vécut dans plusieurs pays dont il adopta tour à tour la langue et la culture : l’Italie, l’Argentine, l’Espagne, la France. C’est en français qu'il publia chez Fayard son roman le plus marquant, Dieu est né en exil. Il devait recevoir le Prix Goncourt, mais cette perspective se heurta à l’opposition de plusieurs intellectuels, accusant l’auteur d’être « réactionnaire » et « ennemi du peuple » dans son pays.
Le déchirement de l’exil y est incarné par le personnage d’Ovide, lui-même relégué aux confins du monde, à Tomis, future Constanţa. Nul doute que la thématique de l’ouvrage ne soit en lien direct avec l’expérience intime de l’auteur, qui combine, ici et ailleurs (par exemple dans Le chevalier de la résignation) la maîtrise de la langue française avec la roumanité et la réflexion sur les rapports avec l'étranger. Écrire en français sur un poète antique chassé de son environnement familier est un moyen, pour Vintilă Horia, d’exorciser la douleur inhérente à l’exil linguistique et géographique, et d’opérer une fusion entre deux cultures d’appartenance par la prise en compte personnelle du bilinguisme.
Peu à peu, perce à travers les vers d’Ovide une évolution de ses sentiments à l’égard du pays et de ses habitants. Il fait des excursions dans l’arrière-pays et le Delta du Danube, apprend à parler le Gète et le Sarmate, écrit des vers gétiques, et reconnaît chez les gens qui l’entourent des marques des sentiments amicaux. C’est peut-être ce qui a conduit l’écrivain roumain à montrer dans son roman un Ovide souvent malheureux, mais plein d’humanité. Dans ce journal imaginaire d’Ovide à Tomes, Horia, s’inspirant des œuvres du poète latin, imagine que celui-ci, dépassant sa solitude, s’initie peu à peu, à travers ses rencontres de sages et de prêtres gètes et grecs, à une spiritualité qui lui fera découvrir une religion à la dimension du christianisme à venir. Il s’agit bien sûr d’une œuvre de fiction, mais dont les personnages et le cadre sont particulièrement attachants.
Redécouvrir Ovide en son exil, c’est donc se replonger dans l’antiquité roumaine, qui se rattache, sous la plume de l’auteur, aux fondements historiques (par exemple les origines grecques de Tomes-Constanţa), géographiques (voir dans Les Pontiques la liste des fleuves qui se jettent dans la Mer Noire), mais aussi mythiques de l’Europe (le poète fait surgir dans ses vers, pour les mettre en relation avec sa terre d’exil, les légendes de la Toison d’Or, de Médée la magicienne, d’Iphigénie...). La terre roumaine représenta pour Ovide les confins du monde « civilisé », mais ses vers nous rappellent qu’elle est à tout point de vue l’un des berceaux de notre vieille Europe. Et Vintilă Horia contribue avec art et détermination à ce rappel.
Jean-Pierre Longre
18:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, vintilă horia, ovide, éditions noir sur blanc, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2025
L’honneur et la littérature
 Virgil Tanase, Saint-Exupéry, Gallimard, Folio-biographies, 2013
Virgil Tanase, Saint-Exupéry, Gallimard, Folio-biographies, 2013
Certes, le livre de Virgil Tanase, conforme à l’intitulé de la collection dans laquelle il est publié, est une biographie d’Antoine de Saint-Exupéry, au sens strict du terme. C’est-à-dire que, depuis sa naissance en 1900 (et même depuis l’ascendance lointaine de sa noble famille) jusqu’à sa disparition en mission le 31 juillet 1944, il raconte la vie mouvementée de l’aviateur, amateur de fêtes et de tours de cartes, ami fidèle, amoureux dispersé, inguérissable distrait, dépensier insoucieux, hypocondriaque soucieux, fumeur invétéré, retardataire régulier, écrivain scrupuleux, orgueilleux, modeste et lucide… Aucun épisode important et significatif de la vie de l’auteur de Terre des hommes et du Petit Prince n’est passé sous silence, et l’ensemble est le fruit d’une documentation sans faille et d’une recherche approfondie de la vérité, dégagée du mythe.
Une vraie biographie, donc, de la part de quelqu’un qui s’y connaît, mais qui ne s’en tient pas seulement aux faits. Cette recherche de la vérité, c’est celle de l’homme Saint-Exupéry, et par la même occasion de l’Homme universel, tel que l’écrivain aurait voulu qu’il fût, en quête de ce fameux essentiel qui reste invisible. Virgil Tanase, tout en évoquant l’indispensable contexte historique et l’atmosphère d’une époque tourmentée, analyse finement l’idéal de l’écrivain qui cherche à se libérer de l’emprise matérialiste, qu’elle soit de gauche ou de droite, communiste ou capitaliste, mettant en avant « la civilisation qui permet aux individus de s’épanouir par l’esprit plutôt que de satisfaire des appétits vulgaires », notamment l’enrichissement à tout prix ou ce qu’il appelle « la civilisation du téléphone » (ô combien actuelle !). Ce qui est rapporté ici, c’est la vie extérieure et intérieure d’un homme de paix qui doit s’engager dans la guerre contre le nazisme, d’un artiste tous azimuts qui doit maîtriser son art, d’un homme absolument désintéressé qui doit subvenir à ses besoins et à ceux d’une épouse aussi volage que lui, d’un technicien qui doit jouer les intellectuels, bref d’un homme de « devoir », pour qui l’honneur n’est pas un vain mot. Et comment ne pas deviner, comme en une accointance secrète, ce que ressent Virgil Tanase lorsqu’il écrit, par exemple :
« Il se bat quand même.
Par solidarité, par devoir, persuadé que la vie ne vaut que par le sacrifice qu’on en fait au nom d’un devoir absolu, d’une évidence indiscutable, envers les autres, quels qu’ils soient. » ?
Jean-Pierre Longre
21:15 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biographie, essai, francophone, antoine de saint-exupéry, virgil tanase, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Le poids de l’Histoire et la séduction du Roman
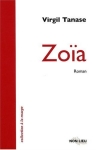 Virgil Tanase, Zoïa, éditions Non Lieu, 2009
Virgil Tanase, Zoïa, éditions Non Lieu, 2009
On pourrait aborder Zoïa comme un roman historique. Tout y serait, sur le plan événementiel, des années 1930 à nos jours, de l’Est à l’Ouest de l’Europe (et même, épisodiquement, jusqu’à Montevideo). Virgil Tanase rappelle, par le truchement de ses personnages, des épisodes de la guerre sur le front de l’Est, de la lutte des résistants en France, de l’avènement du communisme en Roumanie, dans un mélange et une succession d’idéalisme, d’opportunisme, de peur et d’ambition, mai 1968 au Quartier Latin, l’accession de la gauche au pouvoir en France, les bouleversements de 1989-1990 dans les pays d’Europe Centrale et Orientale, particulièrement en Roumanie, le capitalisme sans vergogne et le culte de l’argent prenant le pas sur le collectivisme imposé et l’uniformisation sociale…
Bref, une sorte de bilan historique suscitant – autre plan de lecture possible – réflexions et discussions sur les contradictions des systèmes politiques et économiques, sur les liens plus ou moins patents entre le fascisme et le communisme, sur la place de l’individu dans la collectivité, sur le complexe d’infériorité d’une petite nation et de ses ressortissants exilés, sur la faculté d’adaptation des Roumains aux cultures, aux langages, aux régimes qui les traversent, sur les désillusions des militants : « Je ne suis pas un déçu du communisme. J’y crois toujours ! Non, ce que je ne puis supporter, c’est de vivre sur une terre qui n’est profitable qu’aux vers et aux fauves. Les hommes sont indignes du monde que nous avons rêvé ». Les grands débats, les brassages d’idées dans des dialogues sans fin ne font pas peur à un auteur qui connaît bien tout cela, et dont on sait la prédilection pour le théâtre.
Surtout, Zoïa est une œuvre littéraire, un roman, qui fait de l’Histoire un matériau malléable. « Notre vocation, à nous, romanciers, n’est pas de délivrer un message, ni d’indiquer un sens, mais de proposer au lecteur une épreuve, lui donner l’occasion d’assumer des situations et des conflits qu’il n’a jamais vécus », dit l’un des personnages, écrivain de son état. La chronologie est bouleversée, le rêve se mêle à la réalité, l’illusion et l’action se complètent… Au centre du tourbillon, apparaissant et disparaissant sans crier gare, Zoïa, à qui ses parents, Mircea et Ana, ont donné ce prénom russe par admiration pour l’URSS, Zoïa, belle et flétrie, tendre et cruelle, riant et pleurant, présente et absente, « jetant tour à tour le chaud et le froid », adorant « les situations glauques lui permettant d’exercer une sorte de terrorisme psychologique », Zoïa qui, dans toute son ambiguïté, dans tout son mystère, revêt la séduction des véritables personnages romanesques.
Jean-Pierre Longre
21:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, virgil tanase, non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/07/2025
L’aventure et l’amitié
 Panaït Istrati, Isaac le tresseur de fil de fer suivi de En Égypte, illustrations de Golo, postface de Christian Delrue, coll. Voix d’en bas, éditions Plein Chant, 2025
Panaït Istrati, Isaac le tresseur de fil de fer suivi de En Égypte, illustrations de Golo, postface de Christian Delrue, coll. Voix d’en bas, éditions Plein Chant, 2025
« Les enthousiastes, qu’ils soient ou non juifs, sont toujours des hommes encombrants sur cette terre. » « La destinée du vagabond est totalement contraire à celle que la création octroie au commun des mortels. » Au cas où on ne l’ait déjà fait, on mesure ici combien Panaït Istrati avait le sens de la formule, qu’il s’agisse de relater des aventures vécues par lui-même ou par ses héros. Lui-même ou ses héros : oui, car ce que vivent ceux-ci est souvent tiré de l’expérience de celui-là. La preuve en est donnée ici, grâce à la réunion bienvenue de deux récits relatifs à l’Égypte : Isaac le tresseur de fil de fer (qui sera repris dans La Famille Perlmutter) et En Égypte (précédemment intitulé Entre l’amitié et un bureau de tabac), c’est-à-dire une fiction et une narration autobiographique.
Qu’on ne s’y trompe pas : si les contextes sont similaires, les récits sont différents, dans leur contenu et dans leur style. Christian Delrue le constate dans sa postface : « D’une tonalité plus profonde et d’une progression dans l’intensité favorisée par la dimension restreinte d’une nouvelle, Isaac dégage une force interne et une qualité littéraire peu commune comparables à celles qui se déploient dans le roman Les Chardons du Baragan. » En revanche, même si l’auteur y déploie joyeusement son sens du pittoresque, En Égypte s’en tient à des souvenirs avérés. Revenons à la fiction: Isaac, jeune Juif roumain, a déserté, quitté sa famille et s’est réfugié en Égypte par amour. Situation d’emblée dramatique : un amour perdu, un geste désespéré, un refuge illusoire ; car si en Égypte il trouve de l’amitié – celle du cabaretier Binder, originaire de Galatz, et celle de Youssouf, vieux Juif arabe marchand de loteries –, ces deux amitiés provoquent chez le jeune garçon un incessant tiraillement entre la joie de vivre et la piété intransigeante ; alors, le drame se mue en tragédie, en une progression que seul un véritable écrivain sait ménager. Dans En Égypte, Istrati relate des faits vécus, en mettant en avant son amitié avec Mikhaïl et les aléas du vagabondage avec les peurs qu’il provoque, cela dès le début : « Mon cœur se réduisit aux dimensions d’une puce, au moment où je me sentis livré à ce premier grand hasard de mon existence : oser affronter le monde, sans argent, sans papier, sans même avoir payé sa place. » ; mais aussi, de ce même vagabondage, les bonheurs : « Une vie pleinement vécue, si par vie on veut bien entendre le culte de nos désirs. »
Si, comme l’écrit encore Christian Delrue, ces deux textes « appartiennent au versant oriental de l’œuvre de Panaït Istrati qui a contribué à son succès au moins autant que ses récits roumains », ils sont aussi une bonne initiation à la lecture de ses livres pour un public qui ne les connaîtrait pas. Car, dans leurs différences, ces deux récits sont singulièrement représentatifs de l’art complet de l’auteur, narrateur hors pair, aussi bien dans la fiction que dans l’autobiographie. Et les illustrations de Golo, grouillantes de vie et d’une expressivité inoubliable, donnent un piment artistique supplémentaire à l’écriture littéraire.
Jean-Pierre Longre
09:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, autobiographie, francophone, roumanie, panaït istrati, golo, christian delrue, éditions plein chant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/06/2025
Chute et jubilation
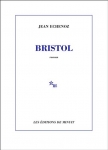 Jean Échenoz, Bristol, Les éditions de minuit, 2025
Jean Échenoz, Bristol, Les éditions de minuit, 2025
Souvenez-vous : dans Vie de Gérard Fulmard, on assistait à la chute de Mike Brant depuis le sixième étage de son immeuble. Voyez maintenant la première phrase du nouveau roman de Jean Échenoz : « Bristol vient de sortir de son immeuble quand le corps d’un homme nu, tombé de haut, s’écrase à huit mètres de lui. » En fait, on ne saura que très tard qui est cet homme, et en vérité ce n’est pas le plus important. Mais une chute initiale dans un roman n’est pas anodine, et on peut se dire qu’elle en préfigure d’autres, surtout lorsqu’on connaît un peu les ruses romanesques de l’auteur. Bristol ? Un réalisateur dont les films n’ont jamais connu un grand succès ; un simple « Clap de bronze » pour l’un d’entre eux, et pour son dernier film, celui dont il est question dans le livre et au tournage africain duquel on assiste, un ratage à peu près complet. La chute de Bristol, en quelque sorte.
Cela dit, le récit ne suit pas un fil continu, loin de là. Méandres, digressions, sauts inattendus d’un épisode à un autre ou d’un personnage à un autre, scènes imprévues comme sait en improviser Bristol au cours du tournage de son film, disparitions et enlèvements… Échenoz promène sans vergogne le lecteur dans la jungle des péripéties, et le lecteur, même si cela lui donne du travail et parfois le tournis, le lecteur, donc, est tout réjoui des surprises que lui réservent la prose de l’auteur et les personnages qu’il a créés. Il y a là, outre le protagoniste, différentes figures qui vont, viennent, disparaissent, réapparaissent : des actrices et acteurs comme Nadia Saint-Clair et Jacky Pasternac, un chauffeur aux divers métiers nommé Brubec, une assistante assez délurée, Marjorie Des Marais, écrivaine à succès qui impose sa protégée Céleste comme actrice dans le film de Bristol, un certain Julien Claveau, drôle de lieutenant de police, un éléphant bien dans son rôle, un commandant Milton Parker à la tête d’une milice armée jusqu’aux dents… Liste non exhaustive, mais visant à donner une idée de l’art de la dénomination (qui va de pair avec l’invention des titres de films), et surtout du bouillonnement narratif (qui va de pair avec la subtilité parodique).
Le bouillonnement narratif en question n’est pas sans s’organiser en mouvements cinématographiques (zooms, gros plans, travellings, panoramiques, plongées ou contreplongées, points de vue variés), avec passages sans transition d’une séquence à l’autre ou, parfois, comme une silhouette fugace en fondu enchaîné, une légère intervention du narrateur (fin d’un chapitre : « Ce qui ne nous arrange pas » ; début du chapitre suivant : « Cela ne fait pas du tout notre affaire… »). Mais le bouillonnement est aussi celui du langage, avec lequel l’auteur joue malicieusement, l’air de rien (« En dépit de toutes les recherches, l’affaire de l’inconnu tombé d’un dernier étage demeure pendante »). Sans parler des aspects ironiques, voire satiriques, de la tonalité. Bref, comme Jean Échenoz nous y a habitués, jamais on ne s’ennuie à la lecture de Bristol. Au contraire, on jubile. À chaque chapitre, à chaque page.
Jean-Pierre Longre
17:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean Échenoz, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/06/2025
Du songe et du théâtre
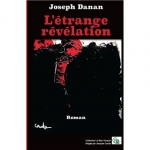 Joseph Danan, L’étrange révélation, éditions Douro, coll. Bleu Turquin, 2025
Joseph Danan, L’étrange révélation, éditions Douro, coll. Bleu Turquin, 2025
« À la fin de L’Illusion comique, […] Alcandre, sortant de sa coulisse comme un lapin de la manche d’un magicien, révèle que tout était théâtre. On aimerait bien. Ou que la vie soit un songe. Variante, d’ailleurs, plus plausible. Se réveiller et que, dans le ciel d’azur de nos enfances, une voix autorisée nous révèle, soulagés, que cette traversée insensée, au bout d’une nuit zébrée d’éclairs, n’était qu’un mauvais rêve. » Nous sommes là presque à la fin du livre, quasiment proches de cette « étrange révélation » que nous promet le titre. Disons que tout ce qui précède semble y converger.
Car avant que tout finisse (d’une manière provisoirement définitive), tout commence par le cauchemar que chacun fait parfois : se retrouver en dehors de chez soi, porte close, sans clefs, en peignoir de bain, obligé de circuler ainsi dans les rues pour, en l’occurrence, se rendre à un mariage. Pourquoi ? Parce qu’on a sorti inopportunément et prémonitoirement les poubelles : « Les ordures déboulèrent dans le conduit métallique… » Tiens ! Les premiers mots de Loin de Rueil de Raymond Queneau. Quelque chose à voir ? Oui : l’imbrication du rêve et du spectacle ; chez Queneau, le cinéma, ici, le théâtre, bien sûr – Joseph Danan étant avant tout un homme de théâtre.
Nous voilà embarqués avec le narrateur (qui aurait pu avoir une vie tranquille avec sa femme et ses enfants), de visions cauchemardesques en rencontres improbables, souvent accompagnés (le narrateur et nous) d’un homme-lapin débrouillard nommé Alfredo, péripéties dédaléennes dans lesquelles l’Université (bien connue de l’auteur) joue le rôle de lieu récurrent, avec son Président, ses étudiants et étudiantes (surtout) et ses drôles de programmes, telle « la nouvelle licence professionnelle des métiers du sexe et du soin relaxant (LPMSSR) »… Réapparaissent parfois Nora, l’épouse, et ses enfants, soit virtuellement (textos, messages téléphoniques), soit physiquement, mais c’est aussitôt pour une nouvelle séparation, bateau manqué ou porte encore fermée… Et parfois notre narrateur tente de faire le point : « La Route de l’Échec s’ouvre dans son évidence. Tandis qu’elle dévide son ruban dans la nuit trouée de la lumière des phares, c’est ma vie qui défile entre les platanes, sur les lambeaux déchirés du ciel. Tout ce qui aura été inaccompli remonte de l’abîme. Les rencontres avortées. Les promesses non tenues. Les livres non écrits. La vie non vécue. Tous ces cauchemars, comme celui de la veille au soir, en dépit du havre d’un souper et d’un sourire, qui ne le rendait que plus cruel, ces nuits perdues, ces voyages immémoriaux, ces pérégrinations sans fin. »
Terrible « sortie du labyrinthe » à prévoir. Heureusement, il y a tout le reste. Le suspense, certes, mais aussi les allusions, les références artistiques (littéraires, musicales…), les souvenirs de l’enfance, et l’humour, comique de situation et manipulations du langage, satire bienvenue et franches plaisanteries… Nous ne sommes pas loin du « pleurire » de Queneau (encore lui), et nous voilà saisis pour un bon moment par le plaisir de la lecture.
Jean-Pierre Longre
22:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, joseph danan, éditions douro, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2025
« Une histoire en cours »
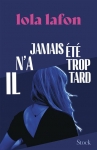 Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
C’est une série de chroniques mensuelles publiées entre fin 2023 et fin 2024 dans Libération, augmentées de plusieurs « P.-S. » prolongeant la réflexion. « Ces notes sont une matière, des couleurs et des textures, des humeurs disparates, un puzzle qui ne révèle aucun paysage connu. À quoi servent-elles, ces notes ? À rien de précis, les mots ne « servent » pas, ils ne sont pas à notre service. Ils se prêtent à nos tentatives. » Modestie de bon aloi, modestie véritable, excessive peut-être. Car ce « rien de précis » permet tout de même à l’esprit du lecteur d’élargir l’horizon de sa réflexion sur des sujets divers.
Il peut s’agir de l’amateurisme, qui « est ce que nous pratiquons le mieux, en toutes choses », car être amateur, c’est aimer ; cela à propos par exemple de la « pratique amateure de la maternité », occupation à plein temps. Ou encore de la « course à la haine » venant de l’extrême-gauche et de l’extrême-droite, alors qu’il faudrait pratiquer la « bienveillance pour ses semblables » et cultiver la perplexité plutôt que la certitude. Ou de l’évocation de la famille paternelle de l’autrice, « exterminée pendant la Shoah », résurgence et perte de la mémoire liées. Et aussi, dans l’actualité proche, du « procès de Mazan » et de ce que cette affaire révèle de terrifiant : « Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs peuvent apparemment être n’importe quel homme. »
Et de beaucoup de choses encore, révoltes ou doutes, incompréhensions ou lucides constatations, aberrations de notre civilisation ou confiance en l’humain… Et comme un rappel de la qualité d’écrivaine de Lola Lafon, le rôle joué par les mots, leur puissance qui est mise à mal lorsqu’ils sont transformés en instruments de pouvoir (« Les mots se dressent face à nous. Ils ne parlent plus, ils communiquent, ordonnent, réduits à menacer, à sanctionner un doigt d’honneur, une poêle à frire ou du sérum physiologique dans un sac à main. ») ou d’invectives (« Les mots seront sommés de décliner leur identité : de quel côté penchent-ils ? On sera renvoyée à son origine, à sa condition. Hashtag juive. Hashtag femme. Hashtag trop de gauche. Hashtag pas assez. »). Malgré tout, c’est eux, les mots, qui permettent de décliner toutes les nuances de la pensée, qui permettent de vagabonder dans l’imaginaire, de raconter « l’histoire en cours », celle qui fait avancer le monde. C’est tout cela que ce beau livre nous révèle.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, chroniques, francophone, lola lafon, stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/06/2025
Finalement on s’y retrouve, délicieusement
 François Salmon, Merci pour la tendresse, Asmodée Edern, 2024
François Salmon, Merci pour la tendresse, Asmodée Edern, 2024
Au bout de quelques pages, les questions commencent à fuser dans l’esprit du lecteur : que peuvent avoir à faire ensemble Érik Satie (qui a vraiment existé, comme on le sait) et une certaine Minique Brouillard (personnage de fiction, comme on s’en doute), une chanson d’Anne Sylvestre (belle et connue) et les histoires (belles et méconnues) qu’un certain Martin Laroche raconte à sa petite-fille Jeanne, la foudroyante apparition de Suzanne Valadon dans la vie de Satie et la disparition de l’étrange Sylwia, épouse de Lambert Laroche et mère de Jeanne, une épaisse et mystérieuse enveloppe que Minique reçoit dans sa boîte aux lettres et la piscine de Tournai…? Arrêtons ici l’énumération, car le futur lecteur risque de se dire que voilà un livre bien embrouillé, d’autant que l’auteur en personne n’hésite pas à relever la sauce en glissant son grain de sel parmi les ingrédients romanesques.
Arrêtons donc l’énumération, pour simplement dire que cet apparent désordre (comparable à celui que le grand-père de Jeanne entretient dans son appartement) procure une délicieuse lecture exploratoire, dans une alternance de faits avérés et d’événements inventés, de personnes réelles et de personnages fictifs, de lieux identifiés et de pays imaginaires. On apprend à connaître presque intimement Érik Satie dans sa relation brève mais passionnée avec Suzanne Valadon, musique et peinture en fusion ; par ailleurs on suit les tribulations de la famille Lambert et de Minique Brouillard, infirmière dévouée mais bien seule dans la vie, qui ne laisse pas de nous intéresser et de faire notre admiration ; et on se laisse entraîner dans les belles histoires racontées à Jeanne par son grand-père, puis par celle-là à celui-ci…
Finalement, ce que prévoit l’auteur va se réaliser : « Je l’admets : tout cela doit sembler bordélique. Qu’est-ce que c’est que ces notes sur Satie qui déboulent de nulle part alors que rien n’a encore vraiment commencé ! Et cette enveloppe de papier kraft qui n’en finit pas de ne pas tomber ! […] Je fais de mon mieux. Je prends les choses comme elles viennent, un peu dans le désordre c’est vrai, mais tout devrait s’organiser plus tard. Enfin, c’est l’idée… » Effectivement tout s’organise dans un roman malicieux, didactique, plein de péripéties, de personnages attachants, de musique, de drames, de sourires, d’humour et, comme l’annoncent le titre ainsi que, rythmant le récit, la chanson Les gens qui doutent, de tendresse.
Jean-Pierre Longre
22:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, belgique, françois salmon, asmodée edern, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2025
Un voyage insolite et nécessaire
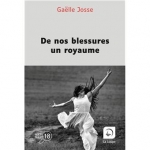 Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet-Chastel, 2025
Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet-Chastel, 2025
Après la dernière représentation, Agnès a décidé de « s’effacer », de quitter ses danseurs qu’elle a menés jusqu’au succès public, ses danseurs qu’elle appelle « mes estropiés, mes esquintés magnifiques, mes abîmés ». Elle qui a perdu Guillaume, son grand amour emporté par la maladie, elle part sur les traces des itinéraires qu’ils ont suivis ou voulu suivre ensemble, des villes visitées ou espérées. De Nice à Milan, de Milan à Trieste, de Trieste à Zagreb, un périple au gré des transports en bus et des hébergements hasardeux, avec « l’essentiel » dans son sac, le Livre : « En dépit de ses quelques centaines de grammes, à peine, il est lourd à porter. Trop lourd. Je le connais par cœur, page après page, il fait partie de moi, que je le veuille ou non. »
Car ce livre, le dernier que Guillaume a lu et s’est fait lire par Agnès, elle voudrait en faire une ultime preuve d’amour en le déposant dans un lieu dédié qui se trouve à Zagreb. Intitulé Quelques Éden, lettres à ma fille, ce vrai-faux roman est composé des lettres que Julien Lancelle adresse à sa fille Emma, née « différente », et qui ne connaît le bonheur que dehors, devant les fleurs et les arbres. Alors le récit qu’Agnès fait de son voyage et de ses souvenirs alterne avec les pages pleines d’amour et de délicatesse du père d’Emma.
Ne nous méprenons pas : ce double roman est entièrement de Gaëlle Josse, qui sait comme personne saisir en mots mûrement choisis et en phrases soigneusement composées les méandres de la sensibilité, la légèreté des instants heureux et le poids des moments désespérés. Sa narration s’adresse autant à Agnès et à son amour disparu qu’à la jeune Emma. Les mouvements de sa prose suivent de près ceux des corps et des cœurs fragiles, leur redonnent le goût de vivre, et il n’est pas indifférent que sa protagoniste-narratrice soit elle-même danseuse. En témoigne l’ultime scène, aussi fascinante pour les lecteurs que pour les passants qui y assistent, une scène tout en mouvements, en rythmes et en sonorités : « Elle danse les larmes et les caresses, les nuits d’insomnie et les jours heureux, elle a dansé les printemps qui reviennent, les nuages qui filent, les neiges dans le cœur des femmes et des hommes, elle danse la terre martyrisée et les cœurs épuisés, elle danse l’espérance et la chute, les voix qui se sont tues et celles qui vont chanter, elle danse ce qu’elle attend et qu’elle ignore. » Un roman ? Certes. Mais aussi un hymne à l’amour, à l’art, aux livres, à la danse… Comme un long poème à l’insolite beauté.
Jean-Pierre Longre
23:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, buchet-chastel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

