14/12/2025
Une émouvante enquête
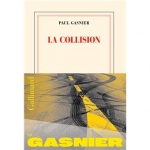 Paul Gasnier, La collision, Gallimard, 2025
Paul Gasnier, La collision, Gallimard, 2025
À une époque où le fait divers prend le pas, dans les informations servies par les médias, sur les autres événements, le livre de Paul Gasnier donne à réfléchir d’une manière sereine, sérieuse et touchante. Il écrit à ce propos : « Ces événements, quand on les prend un à un et qu’on les décortique, peuvent raconter leur époque et l’absurdité tragique qui pend au nez de chacun, mais leur prolifération, accompagnée à chaque fois de conclusions et de solutions clé en main, est devenue si abondante qu’elle a presque l’effet inverse, celui d’annihiler leur possible signification. […] La passion du fait divers permet à l’opinion de trouver dans l’indignation sporadique une forme de divertissement infini, et une inépuisable source d’ostentatoire vertu. »
Car la « collision » dont il est ici question est bien un « fait divers », qui toutefois touche l’auteur de si près qu’il aurait pu se réfugier dans la colère ou le désespoir. « Le 6 juin 2012, à 17h13 précisément […], Saïd, dix-huit ans, qui est alors délinquant récidiviste, remontait une rue étroite des pentes du quartier de la Croix-Rousse, en roue arrière sur une moto cross lancée à 80 km/h. Après quelques mètres, il en perdait le contrôle. La roue avant percuta en pleine tête une femme de cinquante-quatre ans, qui pédalait devant lui à vélo. Cette femme, c’était ma mère. L’hôpital Lyon Sud de Pierre-Bénite la déclara décédée une semaine plus tard. » Pierre Gasnier a alors vingt et un ans. Dix ans plus tard, il décide de faire le récit de ce drame, en se préservant des simplifications manichéennes.
Faisant alterner les faits à l’état brut (reproductions textuelles de documents, dialogues, courriers, narrations objectives d’événements), l’enquête auprès de la famille de Saïd, l’histoire de ses propres parents et les réflexions sur la confrontation des différents microcosmes qui composent et divisent notre société, l’auteur tente d’analyser les tenants et les aboutissants du drame, se demandant si et comment il aurait pu être évité. Ce faisant, il n’occulte ni l’émotion qui le ronge toujours, ni la responsabilité d’un jeune homme qui, façonné par l’argent facile de la drogue et la fréquentation d’individus peu recommandables (alors que les autres membres de sa famille sont tout à fait respectables), reproduit durablement le schéma de la délinquance, ni les méfaits d’une organisation sociale dont les « filets […] n’accrochent plus, ne rattrapent plus, et où l’obsession de soi permet tout. » Le récit de Paul Gasnier se lit à la fois comme une enquête objective et comme un témoignage émouvant, d'une grande humanité ; c’est cette complémentarité qui, outre ses qualités narratives, en fait l’un des intérêts majeurs.
Jean-Pierre Longre
19:52 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, essai, francophone paul gasnier, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/10/2025
Enquête sur un échec à répétition
 Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Chacun s’est un jour posé des questions sur certaines anomalies de l’orthographe française : pourquoi écrire au pluriel des bijoux et des filous, des chevaux et des landaus, pourquoi dangereux fait-il dangereuse au féminin, ou pourquoi chanceler donne-t-il « il chancelle », mais modeler « il modèle » ? On pourrait multiplier les exemples dans lesquels interviennent non le souci étymologique, mais le hasard des graphies médiévales, voire plus tardives. Et qu’en est-il de la transcription de l’oral ? Eh bien, on constate que par exemple « la consonne /s/ s’écrit s, ss, t, c, ç » ; que « la voyelle nasale /in/ se rend par in, im, ain, aim, ein, yn, ym, etc. » Ne faudrait-il pas réformer tout cela ?
Oui, depuis le XVIe siècle jusqu’à notre époque, on ne compte pas les grammairiens, linguistes, enseignants, écrivains qui se sont lancés « à l’assaut de la forteresse orthographique », et qui ont subi un échec tantôt discret, tantôt retentissant. Bernard Cerquiglini, qui fut officiellement de la partie, mais qui, en bon oulipien, sait combiner le sérieux (universitaire) et le détachement (humoristique), sans négliger la discrète provocation, s’adonne dans ce bref mais dense volume à une enquête minutieuse sur cet échec maintes fois répété.
« À qui la faute ? » Le substantif du titre rappelle en filigrane que l’erreur orthographique connote « une idée de péché », tant les conventions d’écriture semblent revêtues d’un caractère sacré. Qui sont donc les responsables de l’impossibilité de réformer l’orthographe ? L’auteur les répartit en cinq catégories, sous la forme interrogative. Les « cuistres » ? Ce sont les pédants, « latinisants besogneux et souvent responsables d’un étymologisme inopportun », mais qui ne sont pas complètement étrangers aux progrès linguistiques. L’Académie française ? Chargée de « dire le droit en matière graphique », elle aménage la norme au long des siècles et des livraisons du dictionnaire. Jules Ferry ? « Lire, écrire, compter », telle est la mission de l’école, et les deux premières injonctions mettent en avant une graphie figée, donnant le pouvoir à ceux qui maîtrisent l’orthographe, mais aussi faisant surgir, aux alentours de 1900, un « camp de la réforme » qui se manifestera jusqu’aux « Rectifications orthographiques » de 1990, que pratiquement personne n’applique… Les réformateurs ? Depuis Louis Meigret et son « Traité » publié en 1550, les tentatives de simplification tendant à harmoniser l’écriture et la prononciation et à supprimer les anomalies évoquées au début de cette chronique ont été nombreuses, et parfois si excessives qu’elles ont suscité au pire de violentes réactions, au mieux l’indifférence. Charlemagne ? Nous remontons alors aux sources d’une langue française marquée par la « créolité », un mélange complexe d’idiomes qui font sa richesse et sa singularité, une complexité qui, selon l’auteur, demanderait malgré tout une rénovation bien comprise. Sera-t-elle possible ? En tout cas, Bernard Cerquiglini nous incite, sans pédantisme mais avec la science du spécialiste et le savoir-faire du pédagogue, à réfléchir sur le passé et le présent d’une langue qui doit assurer son avenir.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, bernard cerquiglini, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/10/2025
« Mourir à vingt ans pour la liberté »
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, Gallimard, 2024, Folio, 2025
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, Gallimard, 2024, Folio, 2025
Comme souvent, c’est le hasard qui fut le déclencheur. La suite est le fait de l’auteur et de son héros. Celui-ci, dont le nom fut découvert sur le mur de la maison qu’Hervé Le Tellier venait d’acheter dans la Drôme, est au nombre des jeunes gens qui décidèrent de combattre l’envahisseur nazi, et qui en moururent. André Chaix, né en 1924, a été tué en août 1944 à Grignan avec plusieurs de ses camarades par des mitrailleurs allemands, et enterré à Montmeyran, où il est né, après avoir vécu à La Paillette, près de Dieulefit.
Les quelques éléments recueillis – photos, témoignages, documents – permettent à Hervé Le Tellier de reconstituer par bribes (des « poussières », écrit-il) l’histoire du jeune homme, son enfance, sa jeunesse d’apprenti aux « Céramiques de Dieulefit », son amour pour Simone, son engagement dans les FTP. Même si, parfois, l’imagination se permet quelques libertés, ce livre n’est pas un roman, et les éléments biographiques sont assortis de retours sur le passé collectif : « L’Histoire est forcément là, puisqu’André en fut à la fois acteur, héros et victime. » Nous pouvons alors apprendre ou réapprendre, par exemple, la signification des abréviations désignant les mouvements de résistance (FTP, FFI et maints autres), avoir des précisions sur le rôle majeur joué par Dieulefit, comme par le Chambon-sur-Lignon, pendant l’occupation, sur le Maquis Morvan, sur certains épisodes de la guerre et sur les blindés de la IIe Panzerdivision (ceux qui ont tué André), ou sur ces anciens nazis français qui participèrent à la fondation du FN (devenu Rassemblement National)… Les rappels factuels fondent aussi des réflexions sur le nazisme, sur le phénomène de la « soumission à l’autorité, la pression des pairs » qui « fabriquent à la chaîne des tueurs sans états d’âme. »
 Face à cela, l’humain : l’amour d’André pour Simone, avec les photos et les mots, émouvants et parfois quasiment prémonitoires, qui le confirment (« Première photo avec toi ma chérie qui seras toujours pour moi la douce et pure Simone de mes amours. Avec toi nous parcourrons la vie dure parfois mais rien ne nous séparera à part la mort. Mes doux baisers. Ton Dédé de toujours. »), un amour qui entraîne quelques confidences de l’auteur lui-même ; l’évocation du fameux livre Le Tour de France de deux enfants, dont André gardait précieusement une page qui « raconte comment le savoir peut dompter la peur » ; une autre évocation, celle d’amis anciens de l’OULIPO (dont Hervé Le Tellier est le président), Italo Calvino, qui fut lui aussi maquisard de son côté, François Le Lionnais, qui fut déporté au camp de Dora, auquel je (l’auteur de cette chronique) ne peux penser sans une forte émotion, puisque mon oncle maternel Pierre Penel, résistant sous le nom de Marceau, y fut déporté après avoir été arrêté et torturé à Lyon, et y mourut à 22 ans, en janvier 1945 ; une rue de Saint-Genis Laval porte son nom, qui est aussi gravé sur une stèle du cimetière de Peyrus, village de la Drôme d’où la famille de Pierre (la mienne, donc) est originaire et où il allait souvent voir ses grands-parents, non loin du Montmeyran d’André… Deux destinées dont la proximité est trop flagrante pour ne pas être signalée…
Face à cela, l’humain : l’amour d’André pour Simone, avec les photos et les mots, émouvants et parfois quasiment prémonitoires, qui le confirment (« Première photo avec toi ma chérie qui seras toujours pour moi la douce et pure Simone de mes amours. Avec toi nous parcourrons la vie dure parfois mais rien ne nous séparera à part la mort. Mes doux baisers. Ton Dédé de toujours. »), un amour qui entraîne quelques confidences de l’auteur lui-même ; l’évocation du fameux livre Le Tour de France de deux enfants, dont André gardait précieusement une page qui « raconte comment le savoir peut dompter la peur » ; une autre évocation, celle d’amis anciens de l’OULIPO (dont Hervé Le Tellier est le président), Italo Calvino, qui fut lui aussi maquisard de son côté, François Le Lionnais, qui fut déporté au camp de Dora, auquel je (l’auteur de cette chronique) ne peux penser sans une forte émotion, puisque mon oncle maternel Pierre Penel, résistant sous le nom de Marceau, y fut déporté après avoir été arrêté et torturé à Lyon, et y mourut à 22 ans, en janvier 1945 ; une rue de Saint-Genis Laval porte son nom, qui est aussi gravé sur une stèle du cimetière de Peyrus, village de la Drôme d’où la famille de Pierre (la mienne, donc) est originaire et où il allait souvent voir ses grands-parents, non loin du Montmeyran d’André… Deux destinées dont la proximité est trop flagrante pour ne pas être signalée…
Trêve de confidences familiales… Je finirai, sans autre commentaire, par un paragraphe essentiel du livre : « L’année 2024 est celle du centenaire de la naissance d’André Chaix, et quatre-vingts années ont passé depuis sa mort. Mais à regarder le monde tel qu’il va, je ne doute pas qu’il faille toujours parler de l’Occupation, de la collaboration et du fascisme, du racisme et du rejet de l’autre jusqu’à sa destruction. Alors, je n’ai pas voulu que ce livre évite le monstre contre lequel André Chaix s’est battu, ne donne pas la parole aux idéaux pour lesquels il est mort et ne questionne pas notre nature profonde, notre désir d’appartenir à plus grand que nous, qui conduit au meilleur et au pire. »
Jean-Pierre Longre
11:38 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, biographie, hervé le tellier, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/09/2025
Une élégante venue de Rio
 Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Une fois n’est pas coutume, l’auteur de cette chronique avoue n’avoir pratiquement rien connu de la bossa nova avant d’avoir lu le livre d’Alain Gerber. Ou alors ce n’est qu’une impression, tant ce livre lui a ouvert les yeux et les oreilles sur des rythmes et des harmonies qu’il avait en tête sans les identifier formellement. Tout cela pour dire que Naissance de la bossa nova est un titre bien modeste pour un ouvrage d’une érudition qui, certes, ne surprend pas de la part de l’auteur, mais se déploie d’un air si naturel qu’on ne se doute pas de la somme de travail qu’a sûrement nécessité la quantité de références précises qu’il propose.
Il y a la « genèse à Rio de Janeiro », avec les « pères fondateurs » (Vinicius de Moraes, Antônio Carlos « Tom » Jobim, Joấo Gilbert), un certain nombre de chanteurs et chanteuses comme Chico Buarque ou Nara Leấo, et il y a la « jeunesse à New York et ailleurs dans le monde », dont Dizzy Gillespie et Stan Getz sont des figures dominantes, mais non uniques. La première phrase de l’histoire résume un état des lieux implacable : « Grâce à Dizzy Gillespie surtout, le jazz s’est afrocubanisé dans les années 40. Grâce à Stan Getz entre autres, le jazz s’est brésilianisé au début des années 60. » On s’attend donc à apprendre beaucoup de choses au fil des pages, et cette attente n’est pas déçue ! On apprend, par exemple, que l’expression bossa-nova a été utilisée pour la première fois dans une chanson de Mendonça, et d’ailleurs qu’à l’origine les bossas-novas sont essentiellement des chansons avec des paroles qui « leur collent à la peau » ; que la « nonchalance » apparente du genre est loin d’être un « relâchement rythmique », que « des sanitaires ont servi de maternité à la bossa-nova », que la chanson Tu verras chantée par Nicole Croisille et Claude Nougaro est de Chico Buarque (O Que Sera), que Stan Getz a inventé le « Brésil universel », « un pays de nulle part, plein d’ombres et de reflets, de mirages et de réminiscences. »
On le voit, ce n’est pas parce qu’Alain Gerber nous fait partager ses connaissances qu’il abandonne son costume d’écrivain. Même dans un livre historique abondamment documenté, il s’adonne à des considérations bien pensées sur les mystères de « l’invention mélodique », sur la musique codifiée, sur « la science harmonique » qui n’explique pourtant pas « ce qui fait qu’un certain agencement de notes trouvera un écho sur la sensibilité universelle. » Et il ne se prive pas, pour notre plus grand plaisir, de laisser se développer son style ô combien séduisant. Au hasard, un exemple à propos du « L.A. Four » : « Prolifique, professionnel en diable, prodigue en performances instrumentales, délicieux sans conteste, mais aussi, comment dire ?... facultatif, essentiellement distractif. Sans faiblesses et sans reproche. Sans folie et sans nécessité non plus. […] La démagogie n’a pas cours chez les Quatre de Los Angeles. Et la mièvrerie ne pouvait compter sur eux pour s’épanouir : montrer leurs muscles ne fut pas leur préoccupation majeure ; en revanche leur musique en quête de raffinement restait en toute circonstance remarquablement articulée. » Ce ne sont là que quelques lignes parmi de nombreuses non moins prenantes, à la manière de la bossa nova elle-même que, pour changer un peu de plume, Patrick Frémeaux définit en quelques mots dans sa note liminaire : « La bossa nova incarne cette élégance nonchalante qui nous charme immédiatement et qui a vite su conquérir bien au-delà des frontières brésiliennes. » Laissons-nous prendre par cette musique comme par la prose élégante d’Alain Gerber.
Jean-Pierre Longre
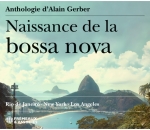 « La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
« La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
Patrick Frémeaux
- CD 1 - RIO DE JANEIRO : HEITOR VILLA-LOBOS : BACHIANA BRASILEIRA N° 5 • DICK FARNEY & LUCIO ALVES : TEREZA DA PRAIA • JOHNNY ALF : RAPAZ DE BEM • ANTÔNIO CARLOS JOBIM & VINÍCIUS DE MORAES : SE TÔDOS FÔSSEM IGUAIS A VOCÊ • LUIZ BONFA : LUZES DO RIO • JOÃO GILBERTO : UM ABRAÇO NO BONFÁ • ELIZETE CARDOSO : OUTRA VEZ • JOÃO GILBERTO : CHEGA DE SAUDADE • DORIVAL CAYMMI : SAMBA DA MINHA TERRA • JOÃO GILBERTO : SAMBA DA MINHA TERRA • TRIO CAMARA : MUITO A VONTADE • JOÃO GILBERTO : HO-BÁ-LÁ-LÁ • ELIZETE CARDOSO : SERENATA DE ADEUS • BADEN POWELL : SAMBA NOVO, PT. 2 • BADEN POWELL : PARA NÂO SOFRER • MAYSA (MATTARAZZO) : O BARQUINHO • SYLVIA TELLES : SE É TARDE ME PERDOA • JOÃO GILBERTO : LOBO BOBO • SYLVIA TELLES : DISCUSSÃO • JOÃO GILBERTO : SAMBA DE UMA NOTA SO • JOÃO GILBERTO : DESAFINADO • SYLVIA TELLES : CORCOVADO • CARLOS LYRA : COISA MAIS LINDA • CARLOS LYRA : MARIA NINGUÉM • OS CARIOCAS : TUDO É BOSSA • SÉRGIO RICARDO : MAXIMA CULPA • ANIBAL SARDINHA “GAROTO” : ALMA BRASILEIRA • OSCAR CASTRO-NEVES : AULA DE MATEMATICA.
CD 2 - (QUELQUE CHOSE SUR L’AMÉRIQUE DU NORD) : CURTIS FULLER : ONE NOTE SAMBA • DAVE BRUBECK : VENTO FRESCO • STAN GETZ & CHARLIE BYRD : É LUXO SÓ • CAL TJADER : SE É TARDE ME PERDOA • SONNY ROLLINS : THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES • DIZZY GILLESPIE : DESAFINADO • BOB BROOKMEYER : CHORA TUA TRISTEZA • STAN GETZ : BIM BOM • ZOOT SIMS : MARIA NINGUEM • QUINCY JONES : BLACK ORPHEUS • DAVE PIKE : PHILUMBA • COLEMAN HAWKINS : UM ABRAÇO NO BONFÁ • IKE QUEBEC : FAVELA • LALO SCHIFRIN : RAPAZ DE BEM • CHARLIE ROUSE : VELHOS TEMPOS • GEORGE SHEARING : MANHA DE CARNAVAL • BUD SHANK : PENSATIVA.
DIRECTION ARTISTIQUE : ALAIN GERBER
09:53 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, alain gerber, patrick frémeaux, alain lesage, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2025
L’honneur et la littérature
 Virgil Tanase, Saint-Exupéry, Gallimard, Folio-biographies, 2013
Virgil Tanase, Saint-Exupéry, Gallimard, Folio-biographies, 2013
Certes, le livre de Virgil Tanase, conforme à l’intitulé de la collection dans laquelle il est publié, est une biographie d’Antoine de Saint-Exupéry, au sens strict du terme. C’est-à-dire que, depuis sa naissance en 1900 (et même depuis l’ascendance lointaine de sa noble famille) jusqu’à sa disparition en mission le 31 juillet 1944, il raconte la vie mouvementée de l’aviateur, amateur de fêtes et de tours de cartes, ami fidèle, amoureux dispersé, inguérissable distrait, dépensier insoucieux, hypocondriaque soucieux, fumeur invétéré, retardataire régulier, écrivain scrupuleux, orgueilleux, modeste et lucide… Aucun épisode important et significatif de la vie de l’auteur de Terre des hommes et du Petit Prince n’est passé sous silence, et l’ensemble est le fruit d’une documentation sans faille et d’une recherche approfondie de la vérité, dégagée du mythe.
Une vraie biographie, donc, de la part de quelqu’un qui s’y connaît, mais qui ne s’en tient pas seulement aux faits. Cette recherche de la vérité, c’est celle de l’homme Saint-Exupéry, et par la même occasion de l’Homme universel, tel que l’écrivain aurait voulu qu’il fût, en quête de ce fameux essentiel qui reste invisible. Virgil Tanase, tout en évoquant l’indispensable contexte historique et l’atmosphère d’une époque tourmentée, analyse finement l’idéal de l’écrivain qui cherche à se libérer de l’emprise matérialiste, qu’elle soit de gauche ou de droite, communiste ou capitaliste, mettant en avant « la civilisation qui permet aux individus de s’épanouir par l’esprit plutôt que de satisfaire des appétits vulgaires », notamment l’enrichissement à tout prix ou ce qu’il appelle « la civilisation du téléphone » (ô combien actuelle !). Ce qui est rapporté ici, c’est la vie extérieure et intérieure d’un homme de paix qui doit s’engager dans la guerre contre le nazisme, d’un artiste tous azimuts qui doit maîtriser son art, d’un homme absolument désintéressé qui doit subvenir à ses besoins et à ceux d’une épouse aussi volage que lui, d’un technicien qui doit jouer les intellectuels, bref d’un homme de « devoir », pour qui l’honneur n’est pas un vain mot. Et comment ne pas deviner, comme en une accointance secrète, ce que ressent Virgil Tanase lorsqu’il écrit, par exemple :
« Il se bat quand même.
Par solidarité, par devoir, persuadé que la vie ne vaut que par le sacrifice qu’on en fait au nom d’un devoir absolu, d’une évidence indiscutable, envers les autres, quels qu’ils soient. » ?
Jean-Pierre Longre
21:15 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biographie, essai, francophone, antoine de saint-exupéry, virgil tanase, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2025
« Une histoire en cours »
 Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
C’est une série de chroniques mensuelles publiées entre fin 2023 et fin 2024 dans Libération, augmentées de plusieurs « P.-S. » prolongeant la réflexion. « Ces notes sont une matière, des couleurs et des textures, des humeurs disparates, un puzzle qui ne révèle aucun paysage connu. À quoi servent-elles, ces notes ? À rien de précis, les mots ne « servent » pas, ils ne sont pas à notre service. Ils se prêtent à nos tentatives. » Modestie de bon aloi, modestie véritable, excessive peut-être. Car ce « rien de précis » permet tout de même à l’esprit du lecteur d’élargir l’horizon de sa réflexion sur des sujets divers.
Il peut s’agir de l’amateurisme, qui « est ce que nous pratiquons le mieux, en toutes choses », car être amateur, c’est aimer ; cela à propos par exemple de la « pratique amateure de la maternité », occupation à plein temps. Ou encore de la « course à la haine » venant de l’extrême-gauche et de l’extrême-droite, alors qu’il faudrait pratiquer la « bienveillance pour ses semblables » et cultiver la perplexité plutôt que la certitude. Ou de l’évocation de la famille paternelle de l’autrice, « exterminée pendant la Shoah », résurgence et perte de la mémoire liées. Et aussi, dans l’actualité proche, du « procès de Mazan » et de ce que cette affaire révèle de terrifiant : « Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs peuvent apparemment être n’importe quel homme. »
Et de beaucoup de choses encore, révoltes ou doutes, incompréhensions ou lucides constatations, aberrations de notre civilisation ou confiance en l’humain… Et comme un rappel de la qualité d’écrivaine de Lola Lafon, le rôle joué par les mots, leur puissance qui est mise à mal lorsqu’ils sont transformés en instruments de pouvoir (« Les mots se dressent face à nous. Ils ne parlent plus, ils communiquent, ordonnent, réduits à menacer, à sanctionner un doigt d’honneur, une poêle à frire ou du sérum physiologique dans un sac à main. ») ou d’invectives (« Les mots seront sommés de décliner leur identité : de quel côté penchent-ils ? On sera renvoyée à son origine, à sa condition. Hashtag juive. Hashtag femme. Hashtag trop de gauche. Hashtag pas assez. »). Malgré tout, c’est eux, les mots, qui permettent de décliner toutes les nuances de la pensée, qui permettent de vagabonder dans l’imaginaire, de raconter « l’histoire en cours », celle qui fait avancer le monde. C’est tout cela que ce beau livre nous révèle.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, chroniques, francophone, lola lafon, stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/03/2025
Les risques de la franglophonie
 Académie française, N’ayons pas peur de parler français, « Le rapport qui alerte », Plon, 2024
Académie française, N’ayons pas peur de parler français, « Le rapport qui alerte », Plon, 2024
Ce livre bref mais dense veut donner l’alerte face « à la violence d’un phénomène », celui de l’extension « vertigineuse » de « l’utilisation non seulement abusive, mais invasive de termes anglo-américains. » C’est ce qu’écrit Dominique Bona dans la préface, tout en admettant que la langue française « n’a jamais cessé d’évoluer » grâce aux apports d’autres langues. Il s’agit donc, dans ce « rapport », de montrer en quoi la langue française subit « une évolution préoccupante » : « Jusqu’au XXe siècle, l’implantation de vocables étrangers se faisait à travers un processus d’assimilation, de francisation progressive. Actuellement, au contraire, l’entrée quasi immédiate dans la vie publique de mots anglais ou supposés tels, via les moyens de diffusion de masse, sans adaptation aux caractéristiques morphologiques et syntaxiques du français, conduit à une saturation. »
Les exemples ne manquent pas, dans les domaines publics et privés. Ce qui est préoccupant, ce n’est pas que certains mots ou certaines tournures venus du monde anglo-américain s’intègrent dans le français, mais que ces mots ou tournures soient incompréhensibles pour le commun des mortels (« la climatisation bi-split », « OpenClassrooms MOOC », le « crowdsourcing affluence voyageurs » etc.) ; et aussi que l’arrivée de nombreux termes soient injustifiée parce qu’ils existent déjà. « Exemples : concorder, correspondre/matcher ; déployer, répartir/dispatcher ; emballage/packaging ; faux, forgé, mensonge/fake ; foyer/cluster ; mélange/mix ; message/post ; mettre en place, processus/process ; réaliser/implémenter ; réseau/network ; sûr, sécurisé/secure. »
On ne reprendra pas ici les nombreux exemples donnés au fil des pages, une liste qui pourrait s’allonger de jour en jour, par un phénomène expansif de mode, de snobisme (pour utiliser un mot d’origine anglaise mais bien ancré dans le français), ainsi que dans une perspective d'élitisme technocratique, excluant de fait celles et ceux qui n'ont pas accès à ce type de lexique; le langage comme facteur d'exclusion, ce n'est pas nouveau, mais en l'occurrence cela s'avère de façon cruciale. L’ouvrage se clôt sur quelques préconisations destinées à aller « vers une communication claire et efficace ». Sans « s’opposer à l’évolution du français, à son enrichissement au contact d’autres idiomes », les académiciens proposent un triple but à atteindre : « Tenir compte du public dans son ensemble, contribuer au maintien du français et lui permettre de participer à une mondialisation réussie. » Espérons…
Jean-Pierre Longre
Pour donner suite…
Si l’on veut profiter d’une vraie relation harmonieuse entre les langues anglaise et française, rien ne vaut la lecture de belles traductions et de publications bilingues. Voir : https://www.blackheraldpress.com
Et voici quelques rappels
 Il y a plus de 60 ans : Étiemble, Parlez-vous franglais ? Première parution en 1964. Nouvelle édition sous-titrée Fol en France Mad in France - La Belle France Label France et augmentée d'un avant-propos de l'auteur en 1991, Folio, 1991
Il y a plus de 60 ans : Étiemble, Parlez-vous franglais ? Première parution en 1964. Nouvelle édition sous-titrée Fol en France Mad in France - La Belle France Label France et augmentée d'un avant-propos de l'auteur en 1991, Folio, 1991
Présentation :
Les Français passent pour cocardiers ; je ne les crois pas indignes de leur légende. Comment alors se fait-il qu'en moins de vingt ans (1945-1963) ils aient saboté avec entêtement et soient aujourd'hui sur le point de ruiner ce qui reste leur meilleur titre à la prétention qu'ils affichent : le français. Hier encore langue universelle de l'homme blanc cultivé, le français de nos concitoyens n'est plus qu'un sabir, honteux de son illustre passé. Pourquoi parlons-nous franglais ? Tout le monde est coupable : la presse et les Marie-Chantal, la radio et l'armée, le gouvernement et la publicité, la grande politique et les intérêts les plus vils. Pouvons-nous guérir de cette épidémie ? Si le ridicule tuait encore, je dirais oui. Mais il faudra d'autres recours, d'autres secours. Faute de quoi, nos cocardiers auront belle mine : mine de coquardiers, l'œil au beurre noir, tuméfiés, groggy, comme disent nos franglaisants, K.O. Alors, moi, je refuse de dire O.K.
Étiemble
 En contrepoint (et contrepied) : Bernard Cerquiglini, La langue anglaise n'existe pas. C'est du français mal prononcé, Folio, 2024
En contrepoint (et contrepied) : Bernard Cerquiglini, La langue anglaise n'existe pas. C'est du français mal prononcé, Folio, 2024
Présentation :
Langue officielle et commune de l’Angleterre médiévale durant plusieurs siècles, le français a pourvu l’anglais d’un vocabulaire immense et surtout crucial. Traversant la Manche avec Guillaume le Conquérant, il lui a offert le lexique de sa modernité. C’est grâce aux mots français du commerce et du droit, de la culture et de la pensée que l’anglais, cette langue insulaire, est devenu un idiome international. Les « anglicismes » que notre langue emprunte en témoignent. De challenge à vintage, de rave à glamour, après patch, tennis ou standard, de vieux mots français, qui ont équipé l’anglais, reviennent dans un emploi nouveau ; il serait de mise de se les réapproprier, pour le moins en les prononçant à la française. Avec érudition et humour, Bernard Cerquiglini inscrit la langue anglaise au patrimoine universel de la francophonie.
Un article ancien : Jean-Pierre Longre, « Franglophones, encore un effort ! », Revue Lettre(s) (Asselaf) n° 43, décembre 2006 - janvier 2007 p. 14-16.
La défense de la langue française passe par son illustration ; le programme ne date pas d’aujourd’hui, et ce que Du Bellay accomplit en son temps, nous pouvons et devons le perpétuer. La richesse, la diversité et l’expressivité du français, admettons-le, sont dues au moins en partie à sa perméabilité aux langues étrangères, et singulièrement à l’anglais – cela non plus ne date pas d’aujourd’hui.
Rappelons-nous que si le français vient globalement du latin (du latin populaire, lui-même bien mêlé), une forte minorité de mots sont d’origine germanique, italienne, arabe, anglaise… De la langue anglaise viennent des termes aussi courants que (au hasard et dans le désordre) chèque, vitamine, autocar, bébé, firme, bifteck, sinécure, station service, bol, paquebot, visualiser, redingote, snob… Et n’oublions pas les va-et-vient entre les deux langues, dont certains sont bien connus : tunnel (qui, venant des tonneau / tonnelle français, est passé par l’anglais pour revenir au français) ; tennis (mot anglais issu de l’impératif français tenez) ; ajourner (de l’anglais d’origine française to adjourn) ; rosbif (de bœuf rôti – rosté en ancien français) ; flirter (flirt venant de fleurette, celle que l’on conte) ; management (issu de l’ancien français), et, évidemment, e-mail (mail venant de la malle-poste)…
Laissons de côté ces aspects historiques, que les connaisseurs complèteront aisément et abondamment, pour reconnaître que les écrivains contribuent à un enrichissement, à une diversification que la notion moderne de francophonie ne peut que confirmer et renforcer. Peut-on encore défendre la langue française ? N’en doutons pas. Mais cela ne se fera pas en piquant des colères aussi néfastes (pour la santé) que vaines (pour ladite défense) contre les méchants Anglo-Américains qui veulent nous imposer leur loi, ou contre les vilains Franco-Francophones qui dépassent les normes strictes de l’idiome académique. Chacun sachant que de nos jours la vie des pays anciens ne peut se passer de la vigueur de l’immigration, intéressons-nous au concept de « naturalisation » ou de « francisation » des mots anglais, que Baudelaire ne s’est même pas donné la peine de mettre en pratique, tant le « spleen » doit correspondre tel quel à un état d’esprit international. N’y cédons pas, et considérons l’inventivité, par exemple, d’un Marcel Aymé qui n’a pas hésité à intituler un de ses romans Travelingue, ou d’un Raymond Queneau qui, en éminent angliciste, s’en est donné à cœur joie avec ses coqutèle, ouisqui, bouledoseur, cloune, niqueurzes, bicause, nokaoute, quidnappeurs (ou guidenappeurs), bloudjinnzes, apibeursdè touillou, gueurle, claqueson, coboille, glasse, cornède bif, bâille-naïte… Et ce petit dialogue des Fleurs bleues, n’est-ce pas du français ?
Il y avait un campeur mâle et un campeur femelle.
- Esquiouze euss, dit le campeur mâle, mà wie sind lost.
- Bon début, réplique Cidrolin.
- Capito ? Egarrirtes… lostes.
- Triste sort.
- Campigne ? Lontano ? Euss… smarriti…
- Il cause bien, murmura Cidrolin, mais parle-t-il l’européen vernaculaire ou le néo-babélien ?
Du français international, sans doute, mais compréhensible tout de même, et si pittoresque… Et peut-on résister à la tentation de reproduire ici celui des Exercices de style qui s’intitule « Anglicismes » ?
Un dai vers middai, je tèque le beusse et je sie un jeugne manne avec un grète nèque et un hatte avec une quainnde de lèsse tressés. Soudainement ce jeugne manne bi-queumze crézé et acquiouse un respectable seur de lui trider sur les tosses. Puis il reunna vers un site eunoccupé.
A une lète aoure je le sie égaine ; il vouoquait eupe et daoune devant la Ceinte Lazare stécheunne. Un beau lui guivait un advice à propos de beutone.
Évidemment, ces triturations sont celles d’un écrivain, qui conçoit la langue comme un instrument de créations aussi poétiques que ludiques ; c’est ce que font, moins systématiquement mais tout aussi sérieusement, dans une pure tradition célino-quenienne, des écrivains (parmi un grand nombre) aussi différents que Daniel Pennac et Pierre Autin-Grenier (qui n’hésite pas à envoyer des « émiles » aussi facilement qu’on pourrait envoyer des « himêles » ou des « y-mêle(s) »). Alors, pourquoi ne pas s’inspirer de ces triturations pour « naturaliser », « assimiler », « intégrer » des mots qui, dans ces conditions, ne seraient pas considérés comme des intrus ou des envahisseurs, mais comme des amis venus nous prêter main-forte ? Une immigration maîtrisée, en quelque sorte. Si les Anglo-américains veulent nous envoyer leurs enfants, accueillons-les, adoptons-les, faisons-en de bons petits francophones.
Dans le même ordre d’idées, on peut se référer à Gaston Miron, que l’on ne risque pas de soupçonner de vouloir saboter la langue française. Pour lui, la langue « n’évolue pas par son propre dynamisme interne » ; se plaçant dans la situation du bilinguisme propre au Québec (mais cette situation, tout bien réfléchi, est celle de la plupart des francophones, y compris, par les temps qui courent, des hexagonaux), voici ce qu’il écrivait dans Décoloniser la langue (1972) :
Il serait étonnant que la langue ne subisse pas d’influences déformantes. Mais, dans l’ouvert et le fermé d’une langue, les facteurs de résistance, de rejet, d’assimilation ne sont pas négligeables. Celui qui dit : « Mon dome light est locké » ou « Y a eu un storm hier » ou « Le dispatcher m’a donné ma slip pour aller gaser » parle québécois, la phrase demeure fidèle au système de la langue, on ne constate qu’une insuffisance de vocabulaire qui s’explique sociologiquement. Ce genre de frottement, de contact avec l’autre langue, est assez superficiel. Ça ne va pas plus loin que l’emprunt lexical, souvent l’emprunt est transitoire ou assimilé. Ce qui est plus grave c’est une influence qui crée un type de symbiose subtile et pénétrante, et qui attaque le système syntaxique. Exemples : Ne dépassez pas quand arrêté, Saveur sans aucun doute, Pharmacie à prix coupés. Ce n’est pas, comme certains le prétendent, une langue nouvelle, ça. C’est la communication de l’autre dans nos signes ; la langue de l’autre informe notre langue de ses calques. Les chasseurs d’anglicismes lexicaux ne trouveront pas un traître mot d’anglais là-dedans ; pourtant c’est de l’anglais en français. La communication de notre langue dé-fonctionne là-dedans sous l’effet du code de l’autre. Ça produit du non-sens, ou un sens autre que le sens que ça devrait produire.
Puisque nous parlons tous le franglais (et aussi le frallemand, le fritalien, le frarabe, le frespagnol etc…), évitons de tirer hostilement la langue aux autres (une langue bien chargée, dont la pureté est illusoire) ; nourrissons-la, en revanche, d’apports lexicaux nouveaux, laissons-la respirer au vent des horizons lointains, en faisant en sorte de préserver ses fonctions vitales. C’est à ce prix qu’elle vivra.
https://www.asselaf.fr/numeros/Lettres43.pdf
23:00 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, rapport, article, francophone, académie française, étiemble, bernard cerquiglini, plon, gallimard, folio, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/02/2025
De l’art du balayage en musique
 Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Il y a un an (janvier 2024), Alain Gerber nous gratifiait d’une belle et indispensable « autobiographie de la batterie de jazz » (voir ici) en nous racontant l’histoire de Deux petits bouts de bois, de l’art desquels il est à la fois expert et pratiquant éclairé. Maintenant, il célèbre les « balayeurs célestes du jazz avec Shelly Manne en point de comparaison », ce grand « Sheldon Manne [qui] fut un des batteurs les plus « littéraires » de l’histoire de l’instrument : un homme recherchant en permanence l’équilibre instable, mais jamais perdu, entre les différentes valeurs des éléments mis en jeu, entre les nuances dynamiques, entre les couleurs sonores, entre les couleurs du temps , entre la distension et la contraction du temps qui passe, l’instinct de vie et son contraire. »
Affirmons-le sans réserve, nul mieux qu’Alain Gerber ne sait lier l’expérience personnelle et le savoir encyclopédique. Ici comme ailleurs, il commence par évoquer un souvenir, celui de l’acquisition de sa première batterie : caisse claire, baguettes, mailloches et… balais. « Depuis cette époque, je porte un amour fou à l’art des balais, ainsi qu’à ceux qui l’ont inventé de toutes pièces et fait évoluer de manière spectaculaire depuis la fin des années vingt ; si dévorante est cette passion qu’elle s’étend aux instruments eux-mêmes. » Et depuis la même époque, il a tout appris des « brosses », de leur pratique et de leurs virtuoses, et il nous en fait tout connaître.
N'oublions pas qu’Alain Gerber est un écrivain, l’un de ceux qui, sans jamais se hausser du col, font partie de l’élite des stylistes, et son érudition musicale ne l’empêche pas de nous faire profiter de sa pratique littéraire, en nous livrant par exemple « une réflexion au passage : en littérature, j’ai toujours penché en faveur des écrivains soucieux d’entretenir une pulsation dans leurs périodes, leurs paragraphes, leurs chapitres. Et d’abord dans chacune de leurs phrases. » Pour lui « c’est affaire de métrique », de « ponctuation » et, « métaphoriquement cette fois, d’accentuation et de nuances dynamiques. » Ou encore de considérations à la fois larges et acérées : « L’un des signes très sûrs de décivilisation est le renoncement massif à l’ironie au profit de la croyance. Il s’agit ici de l’ironie à usage interne et de la croyance sans condition, telle la capitulation du même nom. Je n’ai jamais eu l’âme d’un inconditionnel, et cela ne s’est pas arrangé avec le temps. Le statut de groupie n’aura exercé sur moi qu’une timide attirance. » Un dernier extrait, en guise d’encouragements : « Quels que soient votre âge, votre sexe, votre expérience et votre culture, votre morphologie, vos capacités physiques, votre bagage technique, votre projet esthétique, soyez assuré qu’il existe, ou qu’il existera, la paire de balais la mieux adaptée à votre personnalité. Celle qui va répondre à vos besoins comme si elle avait parié sur vous pour justifier son existence. » Voilà qui donne vie à une paire d’objets apparemment bien anodins mais ô combien précieux. Martine Palmé, agent des plus grands, l’a écrit : ce livre est un « véritable trésor. »
Jean-Pierre Longre
Une autre parution récente chez Frémeaux & associés: Stéphane Carini, Les alchimies discrètes d'Henri Crolla. Accompagné de deux CD.
 Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Patrick FRÉMEAUX
« APRÈS LUI, IL N’Y A PLUS DE GUITARISTES »
NAGUINE REINHARDT (ÉPOUSE DE DJANGO REINHARDT)
20:15 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, jazz, alain gerber, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/02/2025
« Je parle d’homme à homme »
 Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Verdier Poche, 2006, rééd. 2025
Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Verdier Poche, 2006, rééd. 2025
Né à Iaşi (Roumanie) en 1898, mort à Auschwitz en 1944, Benjamin Wechsler, devenu ensuite B. Fundoianu puis Benjamin Fondane, manifesta très tôt son intérêt pour la littérature française en publiant en roumain, en 1921, Images et livres de France, contenant des textes sur Baudelaire, Mallarmé, Gide et quelques autres, préfigurant des essais à venir publiés à Paris, où il s’installe dès 1923. « Importateur de culture européenne », selon la formule de Petre Raileanu, il joue un rôle décisif d’une part dans les mouvements de va-et-vient entre l’Est et l’Ouest, d’autre part dans la vie culturelle française et européenne. « De Dada à l’existentialisme, Benjamin Fondane a […] parcouru un long chemin avec la pensée de son temps. Témoin lucide et exigeant, il l’a accompagnée et bien souvent précédée, au risque de ne pas être entendu par ses contemporains », a écrit Michel Carassou.
Penseur, critique, homme de théâtre, Fondane fut aussi – et surtout, devrions-nous dire – un grand poète de langue française. La réunion et la réédition chez Verdier de ces cinq livres de poèmes est salutaire, et d’ailleurs conforme au désir exprimé par le poète dans une lettre envoyée à sa femme depuis le camp de Drancy, avant de partir vers la mort.
Cinq livres, donc : Ulysse (publié en 1933, remanié jusqu’en 1944), Le mal des fantômes (écrit en 1942-1943, resté inachevé), Titanic (1937), Exode (écrit vers 1934, complété en 1942 ou 1943), Au temps du poème (écrit entre 1940 et 1944).
En septembre 1943, Fondane écrivait :
Je pense au poète vieilli.
Voyez : il écrit un poème.
En a-t-il écrit, des poèmes !
Mais celui-là c’est le dernier.
Cette strophe, tirée d’un poème inédit publié par Monique Jutrin dans Poèmes retrouvés, est pour ainsi dire prémonitoire et n’est pas sans annoncer ce que dit Henri Meschonnic dans son « retour du fantôme » liminaire : « Benjamin Fondane s’écrit d’avance mort ». Mais aussi – toujours Henri Meschonnic – « pas un n’a écrit la révolte et le goût de vivre mêlé au sens de la mort comme Benjamin Fondane. Sa situation de fantôme lui-même y est sans doute pour quelque chose : un émigrant de la vie traqué sur les fleuves de Babylone ».
Ulysse / Fondane est le « Juif errant », celui qui se demande : « Est-ce arriver vraiment que d’arriver au port ? », celui qui, dans un perpétuel exode, chante l’Amérique et l’Argentine, et la mélancolie de l’exil :
Sur les fleuves de Babylone nous nous sommes assis et pleurâmes
que de fleuves déjà coulaient dans notre chair
que de fleuves futurs où nous allions pleurer
le visage couché sous l’eau,
celui qui interroge la légitimité du poème :
Quelle chanson chanterais-je sur une terre étrangère […]
car l’homme n’est pas chez lui sur cette terre.
L’émigrant chante, navigue et se souvient de ses origines :
Pourquoi l’océan me fait-il penser à ces plaines de Bessarabie
on y marchait longtemps et c’était long la vie.
Et s’il aspire au port, c’est sans illusions :
Nous ne parlons aucune langue
nous ne sommes d’aucun pays
notre terre c’est ce qui tangue
notre havre c’est le roulis.
De la fuite incessante à la révolte et à la résistance, le mouvement est naturel, comme l’avoue le « Non lieu » écrit par Fondane en guise de présentation du « Mal des fantômes » : « J’ai voulu écrire ces poèmes dans le goût dévorant de mon siècle. Si j’ai résisté, d’où m’est venue cette résistance ? »
La poésie de Benjamin Fondane est de toutes dimensions. Poésie du mythe et du sacré (L’Odyssée, La Bible…), poésie de l’amour pour « la frêle bergère » et « la fiancée promise et noire du Cantique des Cantiques », elle est avant tout poésie humaine :
Je parle d’homme à homme,
avec le peu en moi qui demeure de l’homme,
avec le peu de voix qui me reste au gosier.
Fondane, c’est un homme qui tente de se dire avec son universalité, ses contradictions, ses imperfections, dont le chant peut n’être « qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un poème parfait », mais qui tente de se donner « un visage d’homme, tout simplement ».
Jean-Pierre Longre
Sur Benjamin Fondane, voir aussi CECI et CELA
 Cahiers Benjamin Fondane n° 27, 2024. « L'art en questionS, années 20 ». Édition établie par Agnès Lhermitte et Serge Nicolas avec la collaboration de Monique Jutrin. Faux Traité d’esthétique, inédit de 1925.
Cahiers Benjamin Fondane n° 27, 2024. « L'art en questionS, années 20 ». Édition établie par Agnès Lhermitte et Serge Nicolas avec la collaboration de Monique Jutrin. Faux Traité d’esthétique, inédit de 1925.
Extrait de l’introduction par Agnès Lhermitte :
« En 1938, Fondane réutilise le titre de Faux Traité d’esthétique pour publier un essai qui a cette fois pour sous-titre « Essai sur la crise de réalité ». Il ne s’agit pas pour autant d’une reprise du manuscrit de 1925. Treize années ont passé, le contexte culturel a changé. Le jeune émigré récent encore incertain de ses orientations s’est nourri de nouvelles lectures. Il est devenu un poète maître de son art et un philosophe résolument existentiel qui aura approfondi et affermi sa pensée grâce à la rencontre de deux maîtres à penser. Chez Léon Chestov, qui guide ses lectures, il trouve la vision existentielle de la duplicité tragique de soi ; chez Lucien Lévy-Bruhl, la pensée de participation des primitifs, qui lui offre une voie d’accès au réel. Le sous-titre confirme la teneur nettement philosophique du nouvel essai.
Fondane y poursuit une réflexion qui récuse les problématiques esthétiques stricto sensu pour s’attaquer de front à la question primordiale : Pourquoi l’art ? Pourquoi justement l’art chez le seul animal raisonnable ? Il se concentre alors sur la poésie, son propre champ d’action et d’interrogation, dans un mouvement inverse de celui qui, en 1925, lui faisait élargir à l’art la crise de la littérature étudiée par Rivière. Bien des questions abordées alors, restées sans réponse ou devenues obsolètes à ses yeux, comme l’enracinement socio-historique de l’art ou la forme, encore liée à l’ordre, à la raison, auront été évacuées. Mais l’idée essentielle, déjà présente dans le manuscrit, d’un art vivant, sera devenue le principe du nouveau traité, présenté comme la mise au point vitale d’un enjeu existentiel, et où la poésie, expérience mystique du réel, se confond avec la vie de l’homme. »
Sommaire
Introduction, Agnès Lhermitte
Faux Traité d’esthétique (1925)
- La Crise du Concept de l’Art
- Erreur de l’art moderne « en tant que progrès »
- L’Idée de l’originalité
- « Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison » : (Blaise Pascal)
- Règne de l’homme théorique
- L’Art autonome
- De Dada au surréalisme – ou de « l’idiotie pure » au suicide
Textes annexes
- Préface du Faux Traité d’esthétique
- Foi et dogme
- Le Concept du beau
- Faux concepts de l’art classique
Textes complémentaires
- « Faut-il brûler le Louvre ? »
- Réflexions sur le spectacle
Études
- L’Art en question : un premier cheminement philosophique, Serge Nicolas
- Une pensée en images, Agnès Lhermitte
19:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, francophone, roumanie, benjamin fondane, patrice beray, michel carassou, monique jutrin, henri meschonnic, agnès lhermitte, serge nicolas, non lieu, verdier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/01/2025
« Essayer d’être heureux »
 François Morel, Oh ! La belle vie, « 32 conseils pour aller imperceptiblement mieux », illustré par Alain Pilon, Philosophie magazine éditeur, 2024
François Morel, Oh ! La belle vie, « 32 conseils pour aller imperceptiblement mieux », illustré par Alain Pilon, Philosophie magazine éditeur, 2024
Humoriste ? Moraliste ? Philosophe ? François Morel est tout cela, et plus encore. Que vous soyez ou non auditeur de ses chroniques sur France-Inter, la lecture de Oh ! La belle vie, suite de textes parus entre septembre 2020 et octobre 2023 dans – excusez du peu – Philosophie magazine, vous confortera dans vos opinions interrogatives, dans vos appréciations surprises, dans vos doutes réconfortants. Alors voyons…
L’humour ? Oui, généralement sous-tendu par des préoccupations à la limite de l’angoisse, un peu comme chez Raymond Queneau. L’angoisse du contact au temps du covid, par exemple : « Les gestes barrières ne facilitaient pas l’approche amoureuse. Puisqu’on ne pouvait plus s’approcher, il devenait difficile de faire des enfants. » Ou, à la même époque, la solitude de celui qui ne peut « vivre une histoire d’amour » qu’avec lui-même : « J’ai eu le sentiment, un peu triste, un peu désemparé, comme tout un chacun sans doute, d’être seul au monde. »
La morale ? Oui, mais pas celle d’un moralisateur ; celle qui s’exprime avec l’ironie d’un observateur qui, sans se poser en donneur de leçons, s’adresse aux délateurs (« Écrire une lettre anonyme est un excellent apprentissage pour développer la dextérité, la concentration, mais également l’apprentissage de sa langue, de la grammaire et de l’orthographe »), fustige ceux qui pensent « s’élever au-dessus de la réalité » avec l’histoire de Jésus mais hésitent à « tomber des nues » en lisant le rapport Sauvé sur les viols d’enfants dans l’Église catholique, ou encore analyse les mouvements de la connerie bien répandue qui, d’abord limitée aux automobilistes, devient une caractéristique des cyclistes.
La philosophie ? Oui, optons avec lui pour celle d’Oncle Georges, natif de Sète, qui aurait eu 100 ans en 2021, mais qui a l’âge « de l’humanité tout entière, celui de l’Auvergnat, de la fille de joie et du petit cheval de Paul Fort » : « Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacro-saint / Se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. »
Plus encore ? Oui, bien plus ! Fin analyste de la société contemporaine et contempteur se ses excès, il raconte comment elle pourrait en arriver à interdire Le Petit Chaperon rouge, accusé de « discriminations de toutes sortes, sexisme, inceste… », se fait aussi linguiste lorsqu’il déplore la disparition, chaque année, de « milliers de mots », « remplacés par des expressions invasives, intrusives et proliférantes » (comme le fameux « du coup » supplantant tant d’adverbes pittoresques). Et surtout, François Morel est poète. Pas seulement lorsqu’il écrit une chronique entière en alexandrins – ce qui relève déjà d’un art manifeste –, mais aussi tout au long de ces pages, à la manière de Jacques Prévert (« Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple ») et en suivant les préceptes de Baudelaire (s’enivrer « de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise »). Une poésie qui, si parfois elle frise la nostalgie ou côtoie la satire, nous aide mine de rien à « aller imperceptiblement mieux ».
Jean-Pierre Longre
11:10 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, chroniques, humour, poésie, françois morel, alain pilon, philosophie magazine éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/12/2024
Disparition d’un foisonnant continent
 Jacques Roubaud, 1932-2024
Jacques Roubaud, 1932-2024
Né le 5 décembre 1932 à Caluire-et-Cuire, tout près de Lyon, Jacques Roubaud est mort le 5 décembre 2024 à Paris. Poète et mathématicien, membre actif de l’OULIPO, c’est un auteur tous azimuts, un foisonnant continent qui disparaît.
Pour lire des chroniques qui le concernent, en tout ou en partie, on peut suivre ce lien: http://jplongre.hautetfort.com/apps/search/?s=Roubaud
Voir aussi: https://www.lmda.net/2008-02-mat09016-jacques_roubaud?deb...
Et encore... :
 Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010
Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010
À personne, parmi ses lecteurs, n’échappe le caractère étendu, complexe, hybride de l’œuvre de Jacques Roubaud, et il fallait bien une escouade de connaisseurs pour, sinon en faire le tour complet, du moins en sonder les strates superposées, en suivre les « courbes sinueuses, volutes, lignes serpentines, méandres, boucles nœuds et spirales » (Christine Jérusalem). Passionnés, spécialistes – dont l’écrivain lui-même fait partie, sous pseudonyme – explorent le « continent roubaldien », ses grands espaces, ses recoins et ses pièges, un continent où résonnent les échos conjoints « du verbe et du nombre », comme l’annonce le titre.
Les maîtresses d’œuvre, Agnès Disson et Véronique Montémont, ont réparti les études en cinq sections : Mathématique(s) et littérature, Question de genre(s), Retour aux sources, Poésie, Intermédialité. De quoi, donc, mettre en avant cinq facettes représentatives d’une œuvre dans laquelle les nombres et les structures, la polyvalence générique (poésie, prose, théâtre, autobiographie etc.), la richesse intertextuelle, l’attachement à des formes traditionnelles comme le sonnet, la variété des repères esthétiques, ne sont pas incompatibles, loin s’en faut, avec l’humour et la rigueur.
Parmi les références plus ou moins ouvertes, l’Oulipo et Queneau tiennent, bien sûr, une place prépondérante (y a-t-il eu TROu ou TOuR – c’est-à-dire Tournant Roubaldien de l’Oulipo ou Tournant Oulipien de Roubaud – ? Réponse dans la contribution de Marcel Bénabou). Mais pas seulement. La culture de Jacques Roubaud est immense : « J’ai la passion de la lecture. Je suis un liseur ; un liseur de livres surtout ». Et « la poésie est la mémoire de la langue ». C’est sur la mémoire des textes que se compose l’œuvre de Roubaud, même oralement, comme l’explique Florence Delay pour Graal Théâtre ; sur la variété des arts – peinture, photographie, musique, performance… – que se construit « l’hybridité » comme « principe structurant » de l’œuvre (Pierre Hyppolite). Mais c’est évidemment Jacques Roubaud lui-même qui, fort de la distance parodique et de l’investissement personnel qui le singularisent, est le premier et le dernier compositeur de son œuvre.
Dans la « réflexion collective » que propose cet ouvrage, complétée par quelques documents (manuscrits, tableaux) et une vaste bibliographie, chaque lecteur trouvera un chemin d’accès vers l’élucidation, au moins partielle, de quelques secrets roubaldiens.
Jean-Pierre Longre
10:57 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, jacques roubaud, oulipo, agnès disson, véronique montémont, éditions absalon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/11/2024
Un parcours louvoyant et pluriel
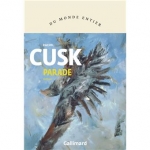 Rachel Cusk, Parade, traduit de l’anglais par Blandine Longre, « Du monde entier », Gallimard, 2024
Rachel Cusk, Parade, traduit de l’anglais par Blandine Longre, « Du monde entier », Gallimard, 2024
Tous sont désignés par l’initiale G, et tous un rapport étroit avec l’art. En quatre chapitres (« La cascadeuse », « La sage-femme », « Le plongeur », « L’espion »), à la première ou à la troisième personne, sont abordés à leur propos ou par leur propre voix de grands sujets, toujours en rapport avec l’art et toujours problématiques, tels que l’amour, les relations dans le couple et dans la famille, les enfants, la violence, la mort (voulue ou subie)… Si les lieux ne sont jamais nommés, sinon par leur statut (musée, voie publique, logement, atelier, restaurant…), ils sont déterminés par la présence des personnages, par leurs mouvements, par les rapports qu’ils entretiennent entre eux et par les incidents ou accidents qu’ils subissent ou provoquent.
Dans le troisième chapitre, sans doute le plus dense et le plus représentatif de l’ensemble, les discussions vont bon train autour de la directrice du musée qui a assisté, du haut du dernier étage où se tenait une rétrospective de la célèbre G, au mystérieux suicide d’un inconnu (d’où le titre du chapitre, « Le plongeur »). À cette occasion, sont disséqués tous les thèmes énumérés plus haut, en particulier celui du statut des femmes artistes, de la possibilité ou non pour les artistes d’avoir des enfants, des rapports entre l’art, la souffrance et la mort, et de son assimilation au sacré ou à la profanation, comme l’exprime la directrice : « À certaines heures de la journée, […] quand le musée n’est pas bondé, son atmosphère est semblable à celle d’une église. On voit bien que les gens attribuent un caractère sacré à ces œuvres d’art et des pouvoirs divins aux artistes qui les ont créées. À d’autres moments, le musée est comble et l’atmosphère change complètement. Les visiteurs se poussent et se bousculent pour essayer de voir, comme des badauds qui tentent d’apercevoir la scène d’un accident de voiture ou un spectacle tout aussi macabre. Ils prennent des photos avec leurs téléphones, à la manière de voyeurs et, à dire vrai, je crois parfois qu’ils ne savent même pas ce qu’ils photographient. »
On le constate, plus qu’un roman, le livre de Rachel Cusk est un ensemble d’essais ou d’ébauches d’essais semés de pensées développées ou d’aphorismes (par exemple : « L’art est le pacte que concluent des individus refusant que la société ait le dernier mot. »), cet ensemble tenant, au choix, du puzzle, du patchwork, de la « parade » louvoyante et plurielle, du parcours esthétique et philosophique, psychologique et sociétal. Il laisse ainsi une empreinte indélébile sur l’esprit du lecteur, qui n’a pas fini de prolonger la réflexion. D’autant que, si la première phrase évoque l’artiste G qui « entreprit de peindre à l’envers », comme pour trouver « l’avènement d’une réalité nouvelle », dans les dernières lignes les membres de la famille réunis autour de la dépouille de leur mère entrevoient la « vérité », la « réalité grise » et avouent : « tel était notre commencement. » À Chacun de continuer…
Jean-Pierre Longre
19:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, essai, anglophone, rachel cusk, blandine longre, gallimard | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/10/2024
Consolation et libération
 Lire, relire... Laure Murat, Proust, roman familial, Robert Laffont, 2023, Prix Médicis Essai 2023, Le Livre de Poche, 2024
Lire, relire... Laure Murat, Proust, roman familial, Robert Laffont, 2023, Prix Médicis Essai 2023, Le Livre de Poche, 2024
À la fin de Du côté de Guermantes, on assiste à une scène significative de ce que Proust définit comme la « vulgarité » du grand monde, qui s’assimile, ici comme ailleurs, à une profonde cruauté. La duchesse de Guermantes s’apprête à partir avec son mari à un dîner lorsque Swann lui apprend que, condamné par la médecine, il va bientôt mourir. « Placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville, et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir », elle choisit la première option en feignant de ne pas croire à la gravité de la maladie de son ami, et en prétextant un retard. Malgré cela, le duc de Guermantes exige que sa femme, qui a mal assorti sa toilette avec ses chaussures, aille changer celles-ci, perdant un temps qu’elle avait prétendu précieux… Pendant son absence, « le duc n’était nullement gêné de parler des malaises de sa femme et des siens à un mourant, car les premiers, l’intéressant davantage, lui apparaissaient plus importants. »
Laure Murat tire une belle leçon de cet épisode : « Difficile d’achever un volume sur une accusation plus cinglante d’un milieu dont le narrateur a par ailleurs tant vanté l’élégance et l’esprit. Car la critique vise bien plus une classe dans son mécanisme que des personnages dans leur caractère. Bien que de tempéraments et de comportements différents, le duc et la duchesse obéissent aux mêmes règles et sont solidaires dans une même grossièreté, dont la particularité est de découler en droite ligne de leur “bonne éducation”. » Nous sommes là au cœur du propos de l’autrice, elle-même issue d’une famille d’aristocrates (les Murat du côté paternel, les de Luynes du côté maternel) qui tient à conserver les traditions ancestrales, alors que la France a instauré la République depuis longtemps. Les traditions, et aussi les non-dits, cette « loi de l’injonction au silence », qui permet de conserver une sorte de normalité toute-puissante et d’éviter la honte sociale. Lorsque Laure parle à sa mère de son homosexualité, elle lui ordonne de faire silence là-dessus : la « faute suprême » n’est pas l’homosexualité (celle d’un oncle de la famille qui, lui, reste discret, ou celle que l’on trouve, intériorisée et socialement tue, dans l’œuvre de Proust), mais, justement, le fait de la rendre publique – ce que Laure ne manque pas de faire, rompant ainsi avec sa famille.
« Roman familial », dit le titre. La famille revêt une importance capitale par l’éclat revendiqué de son passé qui pèse encore de tout son poids sur le présent ; le romanesque repose à la fois sur l’histoire personnelle de l’autrice, partie vivre, aimer et travailler aux États-Unis, et sur À la recherche du temps perdu. Voici ce que Laure Murat écrit à propos de Proust : « Sa précision, sa lucidité, sa tendresse, sa grandeur comique m’ont épargné des années de mécompréhensions et d’atermoiements stériles. C’est pourquoi il m’a, chaque fois, consolée. Or la consolation recèle une puissance libératrice. C’est une force d’émancipation. » Tout est dit.
Jean-Pierre Longre
23:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, laure murat, marcel proust, robert laffont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/10/2024
Maria Anna, Clara, Fanny, Alma et les autres
 Lire, relire... Aliette de Laleu, Mozart était une femme, « Histoire de la musique classique au féminin », Stock, 2022, Champs Flammarion, 2024
Lire, relire... Aliette de Laleu, Mozart était une femme, « Histoire de la musique classique au féminin », Stock, 2022, Champs Flammarion, 2024
Maria Anna Mozart a été injustement oubliée ; ou si l’on en parle, c’est uniquement en tant que sœur du grand Wolfgang Amadeus. D’où le titre emblématique du livre d’Aliette de Laleu, qui introduit son « Histoire de la musique classique au féminin » en évoquant les sœurs de… (Maria Anna Mozart, donc, ou Fanny Mendelssohn) et les épouses de… (Clara Schumann, Alma Mahler…). « Combien de Maria Anna Mozart n’ont pas pu développer leur talent ou leur art parce que femmes ? »
L’autrice ne prétend pas faire une étude exhaustive sur les compositrices, interprètes ou cheffes d’orchestre sans lesquelles le patrimoine musical ne serait pas ce qu’il est, mais qui « ont été exclues du monde de la musique ». Toutefois, en dénonçant les préjugés tenaces, les oublis plus ou moins délibérés, les exclusions abusives, elle comble les importantes lacunes qui jonchent l’histoire de la musique. Car il y a parmi ces « effacées » des génies qui, si elles avaient été hommes, auraient connu la gloire.
 Construit avec la clarté de la chronologie, l’ouvrage nous mène de l’antiquité (Sappho bien sûr) à l’époque contemporaine (qui paradoxalement a vu décliner la création féminine) en passant par le Moyen Âge (Hildegarde de Bingen, « star historique », ou, beaucoup moins connues, les « trobairitz », qui chantaient « pour le plaisir »), puis par la période baroque (avec, par exemple, un questionnement sur le rôle d’Anna Magdalena Bach), la période classique (notamment les révolutionnaires comme Hélène de Montgeroult), le Romantisme (les sœurs ou épouses de…), l’époque moderne (les sœurs Boulanger, les premières grandes cheffes etc.), et le XXe siècle, qui laisse des questions en suspens…
Construit avec la clarté de la chronologie, l’ouvrage nous mène de l’antiquité (Sappho bien sûr) à l’époque contemporaine (qui paradoxalement a vu décliner la création féminine) en passant par le Moyen Âge (Hildegarde de Bingen, « star historique », ou, beaucoup moins connues, les « trobairitz », qui chantaient « pour le plaisir »), puis par la période baroque (avec, par exemple, un questionnement sur le rôle d’Anna Magdalena Bach), la période classique (notamment les révolutionnaires comme Hélène de Montgeroult), le Romantisme (les sœurs ou épouses de…), l’époque moderne (les sœurs Boulanger, les premières grandes cheffes etc.), et le XXe siècle, qui laisse des questions en suspens…
L’étonnant, c’est que sur le nombre considérable de femmes musiciennes, si peu aient laissé un nom dans l’Histoire. Aliette de Laleu nous fait comprendre combien l’injustice des hommes a pesé sur cette absence. Injustice liée aux préjugés, par exemple, sur la prétendue incapacité des femmes à jouer de tel ou tel instrument, ou tout simplement à jouer dans un orchestre symphonique ; liée aussi à la condescendance manifestée à l’encontre de celles qui réussissent à diriger un orchestre (en réaction, de bienvenus orchestres féminins ont été créés au fil des années, et les conservatoires, sous la pression, ont ouvert leurs classes aux jeunes filles). Bref, si l’on veut avoir une vision réelle de l’histoire de la musique, il faut lire ce livre, qui donne aussi de belles idées d’auditions d’œuvres trop méconnues et de lectures complémentaires. Et espérons, comme Aliette de Laleu, que son travail, à la fois très documenté et tout à fait accessible, portera ses fruits.
Jean-Pierre Longre
https://editions.flammarion.com
19:51 Publié dans Essai, Histoire, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, histoire, francophone, aliette de laleu, éditions stock, jean-pierre longre, flammarion | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/10/2024
Un « écrivain total »
 Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024
Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024
De Mihai Eminescu, le grand public amateur connaît surtout la poésie fulgurante et désespérée, nourrie du fameux « dor » roumain, « sentiment douloureux et profond », rêve et regret à la fois ; il sait moins, ce grand public, que le chantre de « Luceăfarul », Lucifer le « porteur de lumière », est surtout un « écrivain total ». Nicolas Cavaillès, dans sa présentation au titre prometteur (« Un joyau de la littérature universelle »), explique parfaitement comment « cette étoile devint un phénomène culturel essentiel et incontournable en Roumanie et en Moldavie » ; à la fois « poète maudit » mort trop tôt, « écrivain prolifique et polygraphe », il est une figure encore trop méconnue des lecteurs francophones.
 Les morceaux ici choisis, précisément traduits et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »
Les morceaux ici choisis, précisément traduits et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »
Oui, l’ « écrivain total », qui, nous dit Nicolas Cavaillès, « n’aura pas connu l’union avec son contraire, principe originel de la vie humaine », est pourtant une « étoile paradoxale ». Pour le poète, « les antithèses sont la vie », et « on ne peut élever une butte sans engendrer à côté une fosse ». Eminescu, poète pessimiste par-dessus tout et malgré tout, hanté par le malheur et par la mort qui l’emportera très tôt, « grand esprit » pour qui « tout est problème » (selon ses propres mots), est aussi celui qui nous révèle « l’infinité du temps ».
Jean-Pierre Longre
17:46 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, roumanie, mihai eminescu, nicolas cavaillès, arfuyen, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/09/2024
Ne pas oublier… Des étrangers morts pour la France
 Jean-David Morvan, Thomas Tcherkézian, Missak, Mélinée et le groupe Manouchian, « Les Fusillés de l’affiche rouge », préface de Georges Duffau-Epstein, cahier historique de Thomas Fontaine, Dupuis, 2024
Jean-David Morvan, Thomas Tcherkézian, Missak, Mélinée et le groupe Manouchian, « Les Fusillés de l’affiche rouge », préface de Georges Duffau-Epstein, cahier historique de Thomas Fontaine, Dupuis, 2024
Ils étaient dix sur la célèbre « affiche rouge » diffusée par l’occupant ; ils furent vingt-trois à être fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944, sans compter Golda Bancic, qui fut guillotinée le 10 mai suivant. « Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant / Vingt-et trois amoureux de vivre à en mourir / Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant. », chante la fin du poème d’Aragon. Étrangers morts pour la France, à la tête desquels Missak Manouchian ; né en 1906, poète et féru de littérature, arrivé en France en 1924 après avoir vécu le drame du génocide arménien, il adhère au PCF en 1934 et s’engage dans la MOI (Main-d’Œuvre Immigrée, puis les FTP-MOI, le fameux groupe de Résistance).
C’est son histoire que raconte l’album de Jean-David Morvan et Thomas Tcherkézian – son histoire personnelle, l’enfance, le massacre de son peuple, la fuite vers la France, la rencontre et l’amour de Mélinée (née en 1913 à Constantinople), l’engagement malgré son aversion pour la violence. Mais c’est aussi une histoire collective, celle de tous ces résistants étrangers qui ont lutté au péril de leur vie contre l’occupant allemand et ses sbires français : attentats contre des responsables ou des groupes de soldats, opérations de sabotage – histoires de patriotisme, d’amitié et d’amour, accompagnées de portraits, visages parlants et biographies essentielles de ces hommes et femmes au courage indéfectible, venus de partout, Arménie, Turquie, Pologne, Roumanie, Hongrie, Italie, Espagne, Ukraine, et aussi France.
Cet ouvrage réunit l’esthétique du graphisme, la réalité de l’Histoire, et surtout l’émotion véritable que provoquent les destinées de personnes vues dans leur volonté et leur sensibilité. Ouvert par le fameux poème d’Aragon, il se referme sur des « extraits des dernières lettre connues des 23 », précédés de la si touchante lettre de Missak à Mélinée, « Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée… ». Pour conclure ce bel album, quelques phrases parmi les dernières : « Tout ce que j’ai à vous dire, c’est que vous ne devez pas vous attrister mais être gais au contraire, car pour vous viennent les lendemains qui chantent » (Thomas Elek) ; « Je meurs avec la conscience tranquille et avec la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère » (Golda Bancic à sa fille) ; « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain » (Missak Manouchian) ; « Je meurs pour la Liberté » (Stanislas Kubacki). Ne pas oublier…
Jean-Pierre Longre
11:36 Publié dans Histoire, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, histoire, essai, jean-david morvan, thomas tcherkézian, missak manouchian, georges duffau-epstein, thomas fontaine, dupuis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/09/2024
Pour le jazz
 Alain Gerber, L’histoire du Be-bop, Miles Davis ; Un Noël de Jelly Roll Morton, Frémeaux & Associés, 2024
Alain Gerber, L’histoire du Be-bop, Miles Davis ; Un Noël de Jelly Roll Morton, Frémeaux & Associés, 2024
Martial Solal, Mon siècle de jazz, Frémeaux & Associés, 2024
Guillaume Nouaux, La naissance de la batterie, Frémeaux & Associés, 2024
L’éditeur producteur Frémeaux & Associés est un vecteur incontournable de la connaissance du jazz. En témoignent tous les ouvrages qu’il fait paraître sur le sujet. Parmi les plus récents, deux sont signés Alain Gerber : L’histoire du Be-bop, Miles Davis, qui reprend les livrets et notices discographiques que l’écrivain a rédigés, avec Daniel Nevers et Alain Tercinet, pour l’histoire du jazz appelée « The Quintessence ». « En un style cadencé, l’auteur examine à la loupe les parcours biographiques et musicaux de Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, 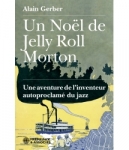 Thelonious Monk, Jay Jay Johnson, Bud Powell, Kenny Clarke, Max Roach, Roy Haynes et Sarah Vaughan, dont les destins, les accents virtuoses et les inventions formelles feront la postérité du mouvement Be-bop. » (Patrick Frémeaux). Second ouvrage : Un Noël de Jelly Roll Morton, « Une aventure de l’inventeur autoproclamé du jazz », à propos duquel Patrick Frémeaux, toujours lui, écrit : « Délectable à souhait, Un Noël de Jelly Roll Morton donne la parole à celui qui n’hésitait pas à écrire « inventeur du jazz » sur ses cartes de visite, un certain Ferdinand Joseph Lamothe dont les multiples compositions ont durablement imprimé l’histoire de la musique américaine. » Inlassable historien du jazz, Alain Gerber l’est assurément, et plein d’érudition, mais pas seulement : en toutes circonstances, dans tous les contextes, il reste un virtuose des mots.
Thelonious Monk, Jay Jay Johnson, Bud Powell, Kenny Clarke, Max Roach, Roy Haynes et Sarah Vaughan, dont les destins, les accents virtuoses et les inventions formelles feront la postérité du mouvement Be-bop. » (Patrick Frémeaux). Second ouvrage : Un Noël de Jelly Roll Morton, « Une aventure de l’inventeur autoproclamé du jazz », à propos duquel Patrick Frémeaux, toujours lui, écrit : « Délectable à souhait, Un Noël de Jelly Roll Morton donne la parole à celui qui n’hésitait pas à écrire « inventeur du jazz » sur ses cartes de visite, un certain Ferdinand Joseph Lamothe dont les multiples compositions ont durablement imprimé l’histoire de la musique américaine. » Inlassable historien du jazz, Alain Gerber l’est assurément, et plein d’érudition, mais pas seulement : en toutes circonstances, dans tous les contextes, il reste un virtuose des mots.
 Autres parutions récentes chez Frémeaux & Associés : Mon siècle de jazz, autobiographie du fameux Martial Solal, préfacée par… Alain Gerber, qui annonce avec brio ce qu’on s’apprête à lire : « Dans son écriture comme dans sa musique, Martial ne donne pas son temps au temps. Le tempo est sa seule affaire. » et un peu plus loin : « Cet écrivain-là ne veut pas se contenter d’exposer ses souvenirs : il veut les vivre, ici et maintenant. » Puis, de Guillaume Nouaux, La naissance de la batterie. « Les origines de la batterie et les premiers batteurs à La Nouvelle-Orléans », fort volume écrit par « l’un des plus grands batteurs de jazz de sa génération », qui, nous disent Augustin Bondoux et Patrick Frémeaux, « établit ici une typologie claire et précise des éléments historiques, culturels, techniques et contextuels qui ont permis l’émergence de cet instrument » et « revient
Autres parutions récentes chez Frémeaux & Associés : Mon siècle de jazz, autobiographie du fameux Martial Solal, préfacée par… Alain Gerber, qui annonce avec brio ce qu’on s’apprête à lire : « Dans son écriture comme dans sa musique, Martial ne donne pas son temps au temps. Le tempo est sa seule affaire. » et un peu plus loin : « Cet écrivain-là ne veut pas se contenter d’exposer ses souvenirs : il veut les vivre, ici et maintenant. » Puis, de Guillaume Nouaux, La naissance de la batterie. « Les origines de la batterie et les premiers batteurs à La Nouvelle-Orléans », fort volume écrit par « l’un des plus grands batteurs de jazz de sa génération », qui, nous disent Augustin Bondoux et Patrick Frémeaux, « établit ici une typologie claire et précise des éléments historiques, culturels, techniques et contextuels qui ont permis l’émergence de cet instrument » et « revient  également sur les pionniers, les premiers grands maîtres et les figures incontournables qui ont façonné et stylisé la batterie. »
également sur les pionniers, les premiers grands maîtres et les figures incontournables qui ont façonné et stylisé la batterie. »
Avis aux amateurs comme aux spécialistes, aux pratiquants comme aux auditeurs, « Frémeaux & Associés est depuis 30 ans l’éditeur-producteur de référence – en CD audio, téléchargement, et désormais livre et livre numérique – pour les collections de musiques du XXe siècle », sans oublier « le patrimoine parlé phonographique et radiophonique, et les cours de sciences humaines, d’histoire et de philosophie. »
Jean-Pierre Longre
15:36 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, alain gerber, martial solal, guillaume nouaux, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/07/2024
Le surineur et l’écrivain
 Salman Rushdie, Le Couteau, traduit de l’anglais par Gérard Meudal, Gallimard, 2024
Salman Rushdie, Le Couteau, traduit de l’anglais par Gérard Meudal, Gallimard, 2024
« Je n’ai jamais vu le couteau ou du moins je n’en ai aucun souvenir. […] Elle a été bien assez efficace, cette arme invisible, et elle a accompli sa tâche. » L’attaque de Salman Rushdie en août 2022 par un homme armé d’un couteau a défrayé la chronique, et on pourrait se demander pourquoi l’écrivain revient sur cette affaire. Comprendre. Comprendre ce qui s’est passé avant, dans la tête du « A » (le nom qu’il donne à son agresseur), puis pendant les vingt-sept secondes de l’attaque, « dans le seul moment d’intimité que nous partagerons jamais. » Et raconter en détail les interminables soins qu’il a fallu endurer pour revenir à la vie, non par miracle (Rushdie n’y croit pas), mais grâce à la médecine et, peut-être, à la chance – le tout relaté avec quelques pointes d’humour bienvenues, à l’instar des surnoms donnés aux médecins spécialistes (le Docteur U pour l’urologue, le Docteur Œil, le Docteur Main etc.)
Solidairement, il y a l’amour et l’art, qui forment des cercles concentriques au cœur et autour du récit médical et psychologique. La rencontre d’Eliza et le bonheur qu’elle apporte, la « petite famille aimante [qui] s’était solidairement constituée autour de moi : mes deux fils, ma sœur, ses deux filles et une nouvelle génération qui commençait à apparaître », les amis dont plusieurs ne sont pas épargnés par la maladie…
La souffrance, la multiplicité des soins n’empêchent pas (les favorisent peut-être) les références littéraires, les allusions à une culture sans exclusives, ni surtout la réflexion, notamment les questions que se pose la victime sur celui qui a tenté de l’assassiner. Comment aller au plus profond ? En utilisant ce qui est à la portée du véritable écrivain : passer par l’imaginaire pour approcher le réel ; et voici un épisode crucial du livre : « Dans ce chapitre, j’ai rapporté une conversation qui n’a jamais eu lieu entre moi et l’homme que j’ai rencontré une seule fois dans ma vie pendant seulement vingt-sept secondes. » C’est ainsi que les choses importantes sont dites. Au surineur, endoctriné par un certain « Imam Yutubi » (humour thérapeutique), et après s’être souvenu des suites des Versets sataniques : « Vous pouviez envisager un meurtre parce que vous étiez incapable de rire. » Au même, et surtout au lecteur : « L’art défie l’orthodoxie. Le rejeter ou le vilipender pour ce qu’il est c’est ne pas comprendre sa nature. L’art place la vision personnelle de l’artiste en opposition aux idées reçues de son temps. […] L’art n’est pas un luxe. C’est l’essence même de notre humanité et il n’exige aucune protection particulière si ce n’est le droit d’exister. » À deux doigts de la mort, et de si belles vérités…
Jean-Pierre Longre
16:47 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, salman rushdie, gérard meudal, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/06/2024
Survivre, pardonner, changer les choses
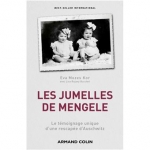 Eva Mozes Kor, avec Lisa Rojany Buccieri, Les jumelles de Mengele. Le témoignage unique d’une rescapée d’Auschwitz. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Armand Colin, 2023
Eva Mozes Kor, avec Lisa Rojany Buccieri, Les jumelles de Mengele. Le témoignage unique d’une rescapée d’Auschwitz. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Armand Colin, 2023
On ne s’habituera jamais à l’horreur, et chaque témoignage sur les camps d’extermination apporte son lot de questions sur « l’espèce humaine », à la suite de celles que se pose Robert Antelme. En lisant Survivre un jour de plus, on se demande comment des hommes, des médecins devenus bourreaux, ont pu faire subir les atrocités infligées à leurs victimes sous prétexte d’expérimentations médicales, et comment les victimes – du moins certaines d’entre elles – ont pu résister aux souffrances. Cette résistance, Eva Mozes Kor l’explique par l’amour que sa jumelle Miriam et elle se portaient mutuellement, ce qui constituait un soutien inébranlable : « Nous nous raccrochions l’une à l’autre parce que nous étions des jumelles. Nous comptions l’une sur l’autre parce que nous étions des sœurs. Et parce que nous appartenions à la même famille, nous ne renoncions pas. ». Ajoutons à cela une force de caractère exceptionnelle : « Je ne suis pas morte, me répétais-je. Je refuse de mourir. Je vais me montrer plus futée que ces docteurs, prouver à Mengele qu’il a tort, et sortir d’ici vivante. ».
Âgées de dix ans, Eva et Miriam, Juives nées en Roumanie, ont été déportées à Auschwitz avec leur famille – leurs parents et leurs deux sœurs, qu’elles ne reverront pas. C’est leur long calvaire qu’avec l’étroite collaboration de Lisa Rojany Buccieri l’auteure relate ici : le départ forcé de leur village sous le regard muet d’une population rongée par l’antisémitisme, l’arrivée brutale au camp, les expériences inhumaines faites sur les jumeaux, et donc sur Eva et Miriam, par Mengele et ses sbires, les maladies, la faim, la peur incessante de la séparation et de la mort, mais le courage inaltérable. Enfin la déroute nazie, la libération par les Russes (qui ne manquent pas de mettre en scène le film de la sortie du camp), et la question de l’avenir qui se pose aux deux fillettes maintenant seules : « Nous avions survécu à Auschwitz. Nous avions onze ans. Nous n’avions désormais qu’une question en tête : comment allions-nous rentrer chez nous ? ». Après maints détours, c’est le retour au village de Porţ, le malaise qui les prend en réalisant que ce ne sera plus jamais comme avant, et la volonté de se construire « une nouvelle vie ». Pendant cinq ans elles vivront à Cluj chez leur tante, puis, avec les difficultés que l’on devine sous le régime roumain de l’époque, ce sera le départ pour Israël.
Devenue par la suite américaine, Eva Mozes Kor a fondé « une association de soutien aux jumeaux ayant survécu aux expérimentations de Josef Mengele, et a aidé à faire pression sur plusieurs gouvernements afin que soit retrouvé ce dernier. ». Après le décès de Miriam, elle a ouvert à sa mémoire le « Musée et centre éducatif de la Shoah », et est devenue une ambassadrice de la paix et du pardon – conformément à ce qu’elle espèrait transmettre aux jeunes générations et qui conclut l’ouvrage : ne jamais renoncer, et pardonner à ses ennemis. Ce livre poignant, illustré par d’émouvantes photos, est à la fois témoignage nécessaire, leçon de courage et « message de pardon ».
L'ouvrage a été publié pour la première fois en 2009 sous le titre Surviving the Angel of Death: The Story of a Mengele Twin in Auschwitz, puis en 2018 dans une traduction française de Blandine Longre sous le titre Survivre un jour de plus - Le récit d'une jumelle de Mengele à Auschwitz aux éditions Notes de Nuit. Après le décès d’Eva Mozes Kor en 2019, une nouvelle édition est parue en 2020 en anglais et en 2023 en français, augmentée d’une postface de l’éditrice Peggy Tierney, qui insiste sur certains traits de caractère d’Eva comme la ténacité et la détermination, le sens de l’humour et du pardon, et qui écrit : « Si une rescapée d’Auschwitz d’un mètre quarante-cinq, orpheline, réfugiée, immigrée, agente immobilière avec un accent roumain vivant à Terre Haute, dans l’Indiana, a été en mesure de trouver un public international pour propager son histoire et son message, alors chacun de nous est capable de changer les choses, qui que nous soyons et où que nous vivions. »
Jean-Pierre Longre
22:49 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, anglophone (États-unis), eva mozes kor, lisa rojany buccieri, peggy tierney, blandine longre, armand colin, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/04/2024
« Trompettes de la Renommée » au temps des réseaux sociaux.
 Lydie Salvayre, Irréfutable essai de successologie, Seuil, 2023, Points, 2024
Lydie Salvayre, Irréfutable essai de successologie, Seuil, 2023, Points, 2024
On s’en souvient, Georges Brassens chanta naguère son refus de prêter le flanc à la « déesse aux cent bouches », de dévoiler les secrets (même fictifs) de sa vie privée ; on peut être sûr que s’il vivait actuellement, il refuserait tout autant de se répandre sur les réseaux sociaux. La veine satirique de Lydie Salvayre, si elle prend des itinéraires différents, poursuit le même but, celui dont Shakespeare, placé en exergue de cet « Irréfutable essai », montrait le chemin, sur lequel « les places d’honneur sont pour les plus indignes. »
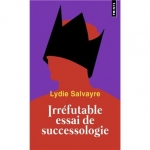 Comme son titre l’indique, l’ouvrage est un essai, c’est-à-dire qu’il analyse d’une manière méthodique les tenants et les aboutissants de son sujet : d’abord définir le succès, facteur en particulier de séduction et de richesse ; puis étudier les différentes familles de succès, portraits pittoresques à l’appui, ironiques à souhait, tels celui de « l’influenceuse bookstagrammeuse », passée forcément par Dubaï, et dont le principal mérite réside dans les formes rebondies de son physique refait, ou celui de « l’homme influent », héritier fortuné qui se pique d’être mécène, que l’on craint (« ça l’enchante »), que l’on « aime d’un amour apeuré »… Plusieurs chapitres sont, bien sûr, consacrés à la littérature : « Les diverses variétés d’écrivains », dont ceux et celles qui répètent à l'envi qu'ils ont trahi leur classe sociale, « Les critiques littéraires », qui peuvent être, par exemple, « tueurs en série » ou « consciencieux ». Et puis, ceci peut servir, « Comment obtenir un succès littéraire » (ou d’ailleurs « en tous domaines »), comment cultiver « l’art de paraître » (rien à voir avec le talent), comment utiliser les amis, les réseaux sociaux etc.
Comme son titre l’indique, l’ouvrage est un essai, c’est-à-dire qu’il analyse d’une manière méthodique les tenants et les aboutissants de son sujet : d’abord définir le succès, facteur en particulier de séduction et de richesse ; puis étudier les différentes familles de succès, portraits pittoresques à l’appui, ironiques à souhait, tels celui de « l’influenceuse bookstagrammeuse », passée forcément par Dubaï, et dont le principal mérite réside dans les formes rebondies de son physique refait, ou celui de « l’homme influent », héritier fortuné qui se pique d’être mécène, que l’on craint (« ça l’enchante »), que l’on « aime d’un amour apeuré »… Plusieurs chapitres sont, bien sûr, consacrés à la littérature : « Les diverses variétés d’écrivains », dont ceux et celles qui répètent à l'envi qu'ils ont trahi leur classe sociale, « Les critiques littéraires », qui peuvent être, par exemple, « tueurs en série » ou « consciencieux ». Et puis, ceci peut servir, « Comment obtenir un succès littéraire » (ou d’ailleurs « en tous domaines »), comment cultiver « l’art de paraître » (rien à voir avec le talent), comment utiliser les amis, les réseaux sociaux etc.
Ce livre est un chef-d’œuvre d’ironie, de second degré (pas sûr que la « bookstagrammeuse », qui comme quelques autres en prend pour son grade, sache ce qu’est le second degré, elle qui prend Sainte-Beuve pour une sainte ou le grand Chamfort du XVIIe siècle pour un chanteur.) À ce propos, Lydie Salvayre n’hésite pas à parsemer son argumentation de maximes bien senties ; quelques échantillons : « Tous les imbéciles aiment à être approuvés » ; « Un véritable ami est un bon placement » ; « Les humains d’aujourd’hui placent tous leur salut dans l’opinion publique » ; « Les gens de grand talent ne rencontrent de leur vivant qu’incompréhension et jalousies ». « Mais » (titre du dernier chapitre), elle n’hésite pas non plus, en apothéose finale, à oublier le second degré et à proclamer ce qui pour elle est la meilleure attitude à avoir : dire Non, notamment, « aux lois qui mènent censément au succès en vous mordant le cœur et en vous broyant l’âme », « Non à ces livres sans nerfs, sans os, sans chair, sans poids, ces livres sans bonté, sans joie, sans rage et sans exultation, ces livres sans épines, ces livres sans arêtes, ces livres bien prudents, bien polis, bien proprets, ces livres bien nippés, bien peignés, pommadés, ces livres écrits à l’eau tiède à l’usage des tièdes et qui châtrent, affadissent et dévoient toutes les choses qu’ils nomment. » Qu’on se le dise, surtout en période de « rentrée littéraire » !
Jean-Pierre Longre
18:44 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, satire, francophone, lydie salvayre, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/04/2024
Le regard aigu de Queneau
 Raymond Queneau, Allez-y voir, Écrits sur la peinture, édition établie, présentée et annotée par Stéphane Massonet, Gallimard / Les cahiers de la NRF, 2024.
Raymond Queneau, Allez-y voir, Écrits sur la peinture, édition établie, présentée et annotée par Stéphane Massonet, Gallimard / Les cahiers de la NRF, 2024.
Raymond Queneau avait de nombreuses cordes à son arc, et parmi elles la fibre artistique vibrait généreusement. Ses propres œuvres ont été présentées par Dominique Charnay dans un bel ouvrage, Queneau, dessins, gouaches et aquarelles (Buchet-Chastel, 2003) – et n’oublions pas que son fils Jean-Marie fut lui-même peintre, graveur, illustrateur. On peut donc penser que lorsqu’il commente les œuvres des artistes de son temps, il le fait en connaissance de cause. Dans l’avant-propos d’Allez-y-voir, ce livre qui rassemble tous les textes de l’écrivain consacrés aux peintres, graphistes et sculpteurs, Stéphane Massonet analyse le cheminement critique de l’écrivain : « Lorsque Raymond Queneau écrit sur la peinture, il suit l’œil du peintre comme une dialectique du voir et du non-vu. L’œil du peintre est un révélateur. Il montre à l’amateur ce qu’il ne peut voir. » Queneau lui-même l’affirme, à propos de Mario Prassinos : « Si la fonction du peintre est de révéler dans l’univers ce que l’œil commun ne peut y voir et si, mieux même, elle oblige ce monde à se montrer objectivement tel que la sensibilité de l’artiste le transcrit d’avance au moyen de couleurs étalées sur une surface plane, alors Prassinos peut se dire peintre. »
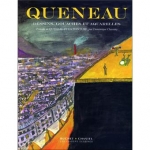 Dans cette perspective (et dans quelques autres), Queneau a ses préférences, ses amitiés aussi : outre Prassinos, Enrico Baj, Jean Hélion, Élie Lascaux, Picasso, Jean Dubuffet et bien sûr Joan Miró. Ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser à Maurice de Vlaminck, à Félix Labisse, à Gala Barbisan, à François Arnal et à quelques autres ; ni même de composer un poème sur « L’atelier de Brancusi », qui « a trouvé refuge dans un musée / mais le sculpteur arpente toujours le pavé »…
Dans cette perspective (et dans quelques autres), Queneau a ses préférences, ses amitiés aussi : outre Prassinos, Enrico Baj, Jean Hélion, Élie Lascaux, Picasso, Jean Dubuffet et bien sûr Joan Miró. Ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser à Maurice de Vlaminck, à Félix Labisse, à Gala Barbisan, à François Arnal et à quelques autres ; ni même de composer un poème sur « L’atelier de Brancusi », qui « a trouvé refuge dans un musée / mais le sculpteur arpente toujours le pavé »…
À quoi reconnaissons-nous l’écriture de Queneau ? À la précision du style, à l’emploi des mots adéquats, à l’originalité des sujets, à la combinaison du rire et du sérieux. C’est par exemple le parallélisme entre « Picabaj et Bacasso », l’un de « Barcelan », l’autre de « Milone », ou la mise en avant, à propos de Massin, de la S.P.A. ou « Société Protectrice de l’Alphabet », ou encore la confusion (jouée) entre Eric von Stroheim et Jean Dubuffet… Ne nous étonnons donc pas de lire, à propos de Baj : « Il équilibre parfaitement le sérieux et l’amusement, j’entends ce qui l’amuse (lui) et ce qu’il estime sérieux, et c’est ce jeu de forces qu’on ne peut expliquer, mais indicible, car c’est dans ce jeu que réside le secret. »
C’est aussi le secret de l’écriture de Queneau lui-même, qui n’hésite pas, parfois, à parler de lui, sans narcissisme et toujours pour aboutir à l’art – par exemple pour évoquer Élie Lascaux, leur amitié et l’œuvre du peintre. L’art, toujours, sous le regard aigu d’un écrivain qui sait reconnaître ce qui se tapit sous les apparences : « Un tableau de Lascaux a cette rare qualité que, se présentant comme la simple pellicule des choses, il conserve précisément toute la profondeur de la réalité : tout est devant nous. » C’est pourquoi, pour Queneau, peinture et poésie fusionnent, comme il l’écrit à propos de Miró (dont il est abondamment question dans le livre) : « La poésie de Miró n’est pas seulement dans cette technique et, si j’ai insisté sur tout cet aspect, explicable et construit, de ses toiles, ce n’est que pour en permettre la lecture. Un poème doit être lu dans sa langue originale : il faut apprendre le miró, et lorsqu’on sait (ou que l’on croit savoir) le miró, alors on peut se mettre à la lecture de ses poèmes. » Le titre est un bel encouragement, et la promesse implicite est tenue : ce livre donne une furieuse envie d’aller voir ou revoir avec des yeux neufs les œuvres dont il y est question.
Jean-Pierre Longre
17:49 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, peinture, raymond queneau, stéphane massonet, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2024
« La passion des baguettes »
 Alain Gerber, Deux petits bouts de bois, une autobiographie de la batterie de jazz, Frémeaux & Associés, 2024
Alain Gerber, Deux petits bouts de bois, une autobiographie de la batterie de jazz, Frémeaux & Associés, 2024
On connaît l’érudition jazzistique d’Alain Gerber. On savait moins, jusqu’à maintenant, qu’il pratique depuis longtemps un instrument complexe et majeur de la musique de jazz : la batterie ; en amateur, avoue-t-il modestement, mais tout de même… Une pratique à laquelle il s’adonne encore au moins une heure par jour dans un sien cabanon isolé, ce qui lui évite les récriminations du voisinage telles qu’il les a connues lorsqu’il habitait en appartement (on pouvait s'y attendre, l’humour et la malice de sont pas absents de certaines anecdotes jalonnant cette « autobiographie de la batterie de jazz ». Voir aussi, par exemple, un furtif portrait d’André Malraux, qui dans un prestigieux restaurant lui servant de cantine « semblait tenir son propre rôle », un autre d’une Catherine Deneuve « piétinant devant un mur » chaussée de « pataugas à talons » durant le tournage d’un film…).
Difficile de mesurer toutes les dimensions de ce livre foisonnant, conduit effectivement par l’histoire des paires de baguettes pour lesquelles l’auteur avoue une véritable passion, ce qui ne l’empêche pas d’utiliser sans vergogne un vocabulaire quasiment amoureux pour décrire ses relations avec les cymbales. La science exhaustive du jazz n’est pas venue toute seule, et la dimension autobiographique laisse le champ libre non seulement à l’apprentissage de la batterie, mais aussi à l’acquisition de la connaissance des jazzmen, de leurs prestations dans les caves et surtout de leurs disques, avec des références précises aux grands batteurs concédées à qui veut y prêter l’oreille ; ils sont tous là, de Kenny Clarke à Ringo Starr (oui), en passant par Jo Jones, André Ceccarelli, Max Roach, Georges Paczynski, Buddy Rich, Elvin Jones, Art Blakey, Baby Dodds, Gene Krupa, Connie Kay ou Daniel Humair.
Mais la science musicale n’occulte pas le reste, car Alain Gerber le reconnaît, il « cultive l’art (l’art ou la marotte ?) de la digression. » L’autobiographie n’est pas seulement celle de la batterie, mais aussi celle de l’auteur en personne : la rencontre décisive de l’amour, les « petits boulots » de jeunesse pour survivre, les voyages et, bien sûr, parallèlement à la musique, la littérature. Écoutons-le, dans son inimitable style nourri de paradoxes : « Quel état des lieux suis-je en mesure de dresser ce matin, si je compare mon itinéraire d’instrumentiste à celui d’homme de plume ? D’un côté, je sais de mieux en mieux ce que je devrais faire avec mes tambours et mes cymbales, mais j’en reste largement incapable ; de l’autre, je vois très bien ce qu’il ne faut pas faire et, sauf exception, ne parviens toujours pas à m’en empêcher. » Un parallèle dont il s’étonne lui-même, mais qui est d’un riche enseignement sur la puissance de ces petits instruments que sont les baguettes et le stylo, utilisés au départ sans ambition démesurée par quelqu’un qui doute de ses capacités, ne se sent pas à sa place, comme lors de ses débuts à France Culture (on le lui a fait sentir plus tard lorsqu’il en fut brusquement exclu), et qui dit avoir « fait des pieds et des mains pour entrer dans le rang. Le rang des non-alignés ».
Sans doute. Mais ce « non-aligné » nous en apprend toujours plus, sur le jazz, sur le style littéraire (cultiver la « simplicité » – pas si simple), sur la vie culturelle, sur la vie tout court. Sans parler du plaisir toujours recommencé, jamais le même, de la lecture. Et si l’auteur de ces lignes perdait un jour la mémoire, il ne se pardonnerait pas de ne pas retenir malgré tout cette formule : « C’est toute l’énigme de la musique : avec elle, ou l’on touche au sacré, ou l’on ne touche à rien du tout. »
Jean-Pierre Longre
17:44 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, autobiographie, musique, jazz, alain gerber, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/01/2024
Un impitoyable réquisitoire
 Arthur Schopenhauer, La ruine de la littérature, traduit de l’allemand par Auguste Dietrich, éditions Mille et une nuits, 2023
Arthur Schopenhauer, La ruine de la littérature, traduit de l’allemand par Auguste Dietrich, éditions Mille et une nuits, 2023
En 1851, Schopenhauer publiait Parerga et Paralipomena, dont les éditions Mille et une nuits ont opportunément extrait le chapitre intitulé « Écrivains et style ». Opportunément, parce que si l’on fait abstraction un tant soit peu du contexte géographique (l’Allemagne) et historique (le XIXe siècle), ce petit livre, un pamphlet plutôt qu’un traité, est resté d’une étrange actualité.
Fidèle à son humeur pessimiste, le philosophe s’en prend d’abord à ceux qui écrivent pour leur profit, distinguant les « écrivains de profession » des « écrivains de vocation », les vrais, plus rares que les premiers. Les journaux littéraires, qui devraient faire cette distinction, se fient plus aux « recommandations de compères » qu’à l’importance et à la qualité des livres. Schopenhauer, à ce propos, fustige violemment l’anonymat des critiques, ceux qui déchargent « anonymement et impunément [leur] bile. » Comment ne pas penser aux méfaits actuels des réseaux sociaux en lisant ces lignes : « Gredin, nomme-toi ! Car attaquer, déguisé et masqué, des gens qui vont à visage découvert, c’est ce que ne fait aucun honnête homme. Seuls les drôles et les coquins agissent ainsi. Donc, gredin, nomme-toi ! » ?
L’auteur a ses préférences, et les exprime avec une clarté sans concessions. C’est Goethe contre Schelling, Hegel et Schiller. C’est la logique française contre la « lourdeur » allemande ; c’est la précision de la grammaire grecque contre ces « grossiers apprentis allemands de la corporation des barbouilleurs ». La brutalité des jugements, auxquels le lecteur peut apporter ses propres nuances en faisant la part des choses, s’assortit de sentences intemporelles et vigoureusement assénées sur le style, du genre : « Le style est la physionomie de l’esprit. » ; « Imiter le style d’autrui, c’est porter un masque. » ; « Tout style écrit doit plutôt garder une certaine trace de parenté avec le style lapidaire, qui est l’ancêtre de tous. » ; « Le style doit être non subjectif, mais objectif. » J’appliquerai cette dernière qualité au commentaire, et garderai à l’esprit que La ruine de la littérature est, comme le dit la quatrième de couverture, une « plaidoirie implacable », exactement dans l’esprit de son auteur.
Jean-Pierre Longre
20:35 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, pamphlet, arthur schopenhauer, auguste dietrich, éditions mille et une nuits, fayard, jean-pierre longre, allemagne | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/12/2023
L’écriture contre l’effacement
 Maxime Decout, Faire trace, les écritures de la Shoah, éditions Corti, 2023
Maxime Decout, Faire trace, les écritures de la Shoah, éditions Corti, 2023
Le projet du « Reichsführer-SS » Heinrich Himmler, exécuteur des basses œuvres de Hitler, était non seulement d’exterminer les Juifs, de « faire disparaître ce peuple de la terre », mais aussi d’éliminer toute trace de cette extermination, d’emporter le secret « dans la tombe ». « L’entreprise nazie […] relève d’une triple destruction : destruction d’un peuple, destruction de sa mémoire, destruction des traces de son anéantissement. » Maxime Decout, dans son livre, propose de montrer comment la littérature lutte contre l’effacement, et il le fait avec une précision particulièrement documentée, issue de recherches concernant des textes de toutes sortes.
Il s’agit d’abord de « cerner la part occultée de l’extermination » à partir d’« œuvres survivantes » telles que les écrits d’André Schwartz-Bart et de Tadeuz Borowski, ou les images de Claude Lanzmann dans Shoah ; ce sont aussi les œuvres parvenues « par-delà la mort de leur auteur » (la plus célèbre étant le journal d’Anne Frank), et qui « ouvrent un espace de résistance essentiel dans lequel l’écriture s’est dressée contre une extermination si généralisée qu’elle la mettrait elle-même en péril. » Dans un deuxième temps, l’auteur étudie ce qu’il appelle « un puissant mal d’archive », posant entre autres la question du rapport entre fiction et « authenticité du témoignage », ainsi que celle des sources. Car le document se transformant en œuvre littéraire devient plus visible, plus intense, tentant ainsi de dire l’indicible. L’exemple de Charlotte Delbo qui, plus tard que Rousset et Antelme, livre son témoignage sous forme de constat morcelé, en « paragraphes disloqués » confinant à la poésie, est particulièrement significatif. Une importante section consacrée à Perec et à son autobiographie W ou le souvenir d’enfance pose la question du rôle de la construction littéraire dans la « réhabilitation » des faits. De même Modiano, qui aborde le problème tour à tour par le biais de la fiction (Voyage de noces) et par celui du récit de quête (Dora Bruder). La quête, en outre, peut suive « la trame générale d’une histoire collective et les destins singuliers des individus sur lesquels elle porte. »
Au fil de l’ouvrage, particulièrement riche en références d’œuvres et d’auteurs, Maxime Decout insiste ouvertement ou en filigrane sur le rôle du lecteur, qui doit endosser une double mission : « relayer à son tour l’éradication des faits par le génocide et faire survivre le texte. » Mieux que le « tourisme mémoriel » consécutif à « l’industrie de la mémoire », c’est dans l’art et la littérature que nous trouverons la capacité d’affronter « le monstre de la mémoire et l’effacement des traces. »
Jean-Pierre Longre
17:07 Publié dans Essai, Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, maxime decout, éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/10/2023
Observateurs observés
 Gilles Bonnet, La photophonie au musée, Éditions Universitaires de Dijon, 2023
Gilles Bonnet, La photophonie au musée, Éditions Universitaires de Dijon, 2023
Pendant longtemps, il fut interdit de photographier les œuvres exposées dans les musées. Grand contraste avec ce qui se passe actuellement, le téléphone mobile, dans sa version photo (d’où le mot « photophonie » remplaçant celui de « photographie ») étant devenu, chez beaucoup de visiteurs, une sorte de prolongement, voire de suppléant du regard. Gilles Bonnet, qui pour l’occasion a dépassé les frontières de ses recherches littéraires, s’est fait savant et lucide observateur de « visiteurs-photographes, aux pratiques photophoniques aussi diverses que massives » – se faisant lui-même photographe de ces pratiques et de ces pratiquants. En cinquante textes, tous accompagnés d’un cliché, il analyse chaque type d’approche.
Ce qui ressort de ces commentaires illustrés, détaillés, érudits, richement documentés (voir l’abondante bibliographie finale), c’est principalement la double idée d’appropriation à caractère autobiographique et de partage social : « La photophonie, au musée comme ailleurs, on le sait bien, instaure une séquence de gestes successifs, dont le principal est probablement le partage. Le cliché est souvent pris et pensé, dès le départ, comme devant être envoyé aux « amis » des applis et à leur communauté. » Ce cliché, qui plus est, peut être retouché, recadré, transformé : « Transgression tactile : pouvoir manipuler ce qui, parce qu’œuvre, est devenu irrémédiablement intouchable. »
Les analyses ne reculent pas devant la complexité des processus enclenchés par l’usage muséal du smartphone, instrument de communication et de fixation, instrument à la fois personnel et collectif, « qui nous donne à voir, littéralement et dans tous les sens, selon que le pronom « nous » se fait COI ou COD : accès à l’infini des connaissances comme à la diversité des communautés en même temps qu’aspirateur à données personnelles capable de tracer la moindre de nos activités. » L’auteur se fait volontiers sociologue, au plus près des individus et des groupes qu’il donne à voir, eux-mêmes en train de voir. Il y a un « consensus social » dans cette activité qui réunit bourgeoisie et classes populaires via l’instrument utilisé. Et ce constat d’apparente « symétrie des classes » n’entraîne aucune critique, au contraire, de l’attirance « touristique » pour les « tableaux-stars » que, malgré la « reconnaissance du déjà vu », chacun veut et peut s’approprier. Un peu d’humour, dans ce contexte, se glisse entre clichés et textes, par exemple lorsque des mains que l’on croirait sculptées par Rodin se referment sur un smartphone, ou lorsqu’on voir un corps se plier à de drôles de mouvements voulus par la prise d’une vidéo…
Étude esthétique, psycho-sociologique, d’où les considérations techniques ne sont pas exclues, La photophonie au musée est un essai indispensable pour qui s’intéresse aux mœurs d’aujourd’hui.
Jean-Pierre Longre
 Pour rappel : Gilles Bonnet, qui n’hésite pas à fréquenter les marges littéraires et artistiques, a publié en 2021 un ouvrage sur les œuvres littéraires écrites par des chanteurs du début du XXe siècle : Auteur-Compositeur-Interprète-Écrivain, L’âge de l’ACIÉ (2000-2020), aux Presses Universitaires de Provence. Ne pas oublier ce livre-carrefour qui n’exclut aucune zone culturelle.
Pour rappel : Gilles Bonnet, qui n’hésite pas à fréquenter les marges littéraires et artistiques, a publié en 2021 un ouvrage sur les œuvres littéraires écrites par des chanteurs du début du XXe siècle : Auteur-Compositeur-Interprète-Écrivain, L’âge de l’ACIÉ (2000-2020), aux Presses Universitaires de Provence. Ne pas oublier ce livre-carrefour qui n’exclut aucune zone culturelle.
19:55 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, art, photographie, sciences sociales, chanson, gilles bonnet, Éditions universitaires de dijon, presses universitaires de provence, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/07/2022
Mystérieux champion
 Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Le jeune Paul a eu beau, tout au long de son enfance et des routes parcourues sur deux roues, se prendre pour son champion préféré (souvenons-nous, il y avait deux clans bien marqués, celui, plus populaire, des Poulidor et celui, plus élitiste, des Anquetil), jamais il n’a réussi jusqu’à présent à percer les mystères de celui pour qui « l’essentiel se joue dans la solitude ».

« Petit cycliste, j’avais des idées claires sur ce que devait être un champion. Elles étaient si claires que je les consignais dans un cahier d’écolier parmi les photos que je découpais dans les journaux et collais dans un ordre qui n’appartenait qu’à moi. Ce cahier était à la fois mon Panthéon et mes Commandements ». Devenu grand, Paul doit pourtant se poser les questions essentielles, résumées par le titre du chapitre central, « À quoi marche Anquetil ? » : à l’exploit, à l’amour du vélo, à l’argent, à la douleur, à la drogue, à la générosité ? À tout cela sans doute, ce qui le rend d’autant plus « énervant » qu’il reste très secret.
Paul Fournel, qui s’y connaît en vélo, sportivement, pratiquement, théoriquement et littérairement (voir Besoin de vélo, Méli-vélo etc.), livre dans Anquetil tout seul des réflexions qui ne doivent rien à l’hagiographie (même si Anquetil est devenu, comme d’autres et plus que d’autres, une légende, celle-ci n’occulte en rien les défauts humains qui ne lui ont pas été épargnés), rien à la complaisance, rien au moralisme, beaucoup tout de même à l’admiration inséparable de l’autobiographie. Des réflexions, et des variations : ce livre est la partition d’une cantate qui suit les rythmes variés d’une combinaison instrumentale élégante et indicible : l’homme et la bicyclette.
Jean-Pierre Longre
23:12 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, cyclisme, francophone, paul fournel, le seuil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/07/2022
“Mépriser son être essentiel”
 Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Médecin de marine, écrivain, grand voyageur, Victor Segalen (1878-1919) a peu publié de son vivant, mais son œuvre est abondante (deux volumes dans la Pléiade). Le double Rimbaud, publié pour la première fois dans Le Mercure de France le 15 avril 1906, n’en est qu’un échantillon fort bref, mais très représentatif des préoccupations de l’auteur : peut-on être à la fois un immense poète et un négociant aventureux ? À la fois, non. Successivement, oui, apparemment, et Segalen s’interroge sur les deux Rimbaud : « Quel fut, des deux, le vrai ? Quoi de commun entre eux ? »
On le sait, Rimbaud s’arrêta brusquement d’écrire, et après avoir erré pendant au moins quatre ans, passa les dix dernières années de sa vie entre l’Abyssinie et Aden. Segalen utilise divers documents (lettres, souvenirs écrits ou oraux) pour retracer cette aventure, non sans citer et analyser auparavant un certain nombre d’extraits poétiques parvenant à « d’insoupçonnables horizons » et proclamant des désirs d’ailleurs : « Et cela fut, en vérité, prophétique des désirs constants de l’autre Rimbaud, qui même avant ses souffrances, avant ses échecs, en pleine fièvre de vie et d’action, entrevoyait, comme but seul désirable, le repos. »
Comment expliquer ce « cas singulier, d’un poète récusant son œuvre entière de poète […] par son mutisme définitif » ? Segalen avance alors « le Bovarysme », fameuse théorie conçue d’après l’héroïne de Flaubert par Jules de Gautier comme « le pouvoir départi à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est. » Et de donner les exemples d’Ingres et son violon, de Chateaubriand et ses velléités politiques, de Goethe et ses ambitions scientifiques etc. Voilà qui expliquerait aussi « les deux essors divergents » et l’étouffement de l’inspiration poétique chez Rimbaud, « persistant à mépriser son être essentiel. » Rien n’est définitivement éclairci, et Arthur Rimbaud restera toujours un cas mystérieux et fascinant dans l’histoire de la poésie. Mais Victor Segalen, dans ce petit ouvrage que les éditions Black Herald Press ont eu l’excellente idée de rééditer – en version bilingue qui plus est – fait avancer la réflexion non seulement sur le poète de Charleville, mais plus généralement sur la destinée des artistes.
22:13 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, anglophone, victor segalen, arthur rimbaud, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/02/2022
Un passé retrouvé : des nouvelles de Marcel
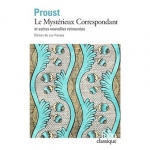 Marcel Proust, Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles retrouvées. Textes transcrits, présentés et annotés par Luc Fraisse, Gallimard, Folio classique, 2021.
Marcel Proust, Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles retrouvées. Textes transcrits, présentés et annotés par Luc Fraisse, Gallimard, Folio classique, 2021.
Il avait vingt-cinq ans, et il avait déjà écrit un certain nombre de textes. En 1896, Marcel Proust publiait son premier livre, Les Plaisirs et les Jours, recueil de textes poétiques, narratifs, descriptifs… Il n’y avait pas inclus quelques nouvelles restées à l’état de brouillon, publiées seulement en 2019 par les Éditions de Fallois, et reprises dans ce volume, accompagnées d’annotations et d’annexes substantielles minutieusement élaborées par Luc Fraisse, un connaisseur…
Si ces nouvelles, on s’en aperçoit vite, ne sont pas complètement abouties, si elles contiennent quelques maladresses et approximations formelles, elles sont le creuset de ce que deviendra l’écriture de Proust dans À la Recherche du Temps perdu. Comme l’indique Luc Fraisse dans sa préface, « Nous y apercevons l’écrivain au moment où son entreprise littéraire, qui prendra progressivement forme en continuité jusqu’à la Recherche, commence. » Sur des tons divers, ces textes esquissent des motifs que l’œuvre ultérieure développera : l’amour – plus particulièrement l’homosexualité, féminine ou masculine –, le rôle de la mémoire, l’éloge de l’affection des femmes, le génie musical (« C’est l’âme vêtue de son, ou plutôt la migration de l’âme à travers les sons, c’est la musique »), la suprême nécessité de l’art… On reconnaît par anticipation l’hypersensibilité du romancier à venir : « C’est ainsi qu’il avait aimé et souffert par toute la terre et Dieu changeait si souvent son cœur qu’il avait peine à se rappeler par qui il avait souffert et où il avait aimé. » Et le style de la Recherche est déjà là, en germe, en une syntaxe sans doute moins construite, mais déjà soucieuse de suivre les méandres de l’esprit et du cœur.
Complétant ces proses, on peut lire des textes eux aussi « restés inédits jusqu’en 2019 » et que l’on peut considérer comme les « sources de La Recherche du Temps perdu », illustrés par des fac-similés de documents tels que les pittoresques « cris de Paris » notés par le concierge à qui Proust avait demandé de les écouter et de les noter. Le dossier comprend ensuite une biographie très détaillée, une solide bibliographie et les notices, notes et variantes relatives aux nouvelles. Il y en a donc pour tout le monde, dans cette édition d’un intérêt indéniable, à la fois abordable (à tous points de vue) et savante, qui s’adresse à tous les lecteurs, fervents de Proust ou simples amateurs.
Jean-Pierre Longre
19:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, essai, notes, marcel proust, luc fraisse, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/01/2022
Musicothérapie au XVIIIe siècle
 Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021
Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021
Au XVIIIe siècle, on débattait volontiers à propos de la nature de la musique et de ses répercussions sur le corps et le cœur humains. Pour Rameau, par exemple, les sons et leurs vibrations agissent sur l’intellect et le corps, tandis que pour Rousseau c’est le cœur et la sensibilité qui sont touchés par l’harmonie. Entre les deux fameux compositeurs-philosophes, les points de vue paraissent donc antinomiques, mais ils semblent se rejoindre sous la plume d’auteurs méconnus qui se sont intéressés en particulier aux « effets thérapeutiques de la musique », selon la formule que Philippe Sarrasin Robichaud emploie dans sa présentation. Encore une fois, les éditions Manucius ont mis au jour des textes précieux qui, bien qu’ils datent de près de trois siècles, restent d’une fraîche actualité.
Dans Effets de la musique, Jean-Joseph Ménuret de Chambaud reprend d’une manière synthétique, en se fondant sur des exemples puisés dans la mythologie (le chant merveilleux d’Orphée, entre autres) et dans la réalité (de l’antiquité aux temps modernes), les diverses influences que la musique exerce sur le comportement des animaux, mais surtout sur les corps, les esprits et les cœurs des humains, plus particulièrement sur leur santé. « C’est principalement sur les hommes plus susceptibles des différentes impressions, et plus capables de sentir le plaisir qu’excite la musique, qu’elle opère de plus grands prodiges, soit en faisant naître et animant les passions, soit en produisant sur le corps des changements analogues à ceux qu’elle opère sur les corps bruts. » Il rapporte comment certains médecins ont utilisé la musique avec succès comme « remède universel », en l’adaptant aux différentes sortes de maladies. Selon plusieurs observations, on peut prescrire la musique en tenant compte de « la nature de la maladie », du « goût du malade », de « l’effet de quelques sons sur la maladie » - en prenant soin d’ « éviter la musique dans les maux de tête et d’oreilles surtout. » Tout est donc précisément prévu, sachant que les sons musicaux ne sont pas « jetés » au hasard, mais « combinés suivant des règles constantes, unies et variées suivant les principes démontrés de l’harmonie. »
Le second texte porte sur le Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger (synthétisé, donc, pour L’Encyclopédie par Ménuret de Chambaud). Dans cette préface, Étienne Sainte-Marie résume les théories de l’auteur, qui tiennent, on l’aura compris, de ce qu’on appelle de nos jours la musicothérapie. D’après l’auteur, « l’homme renferme en lui trois centres principaux d’activité, qui composent toute son existence, et qui réunis donnent la somme entière des ses forces et de ses moyens : la vie animale, la vie morale et la vie intellectuelle », entre lesquelles il faut trouver un équilibre ; une sensibilité exacerbée, notamment, produit la méchanceté, ce qui explique que des hommes cruels « ont aimé la musique avec passion » (l’auteur évoque Néron, mais nous pourrions maintenant trouver maints autres exemples, chez les bourreaux nazis notamment). Malgré tout, la musique est apte à préserver « l’ordre et l’harmonie », elle est « indispensable à l’homme qui vit dans le tourbillon du monde. »
Si ce n’étaient les références historiques ou morales et, parfois, le style ou le lexique, on oublierait que ces textes, qui ont une même source et se complètent très bien l’un l’autre, ont été écrits au XVIIIe siècle. Toutes les époques, et la nôtre en particulier, peuvent prendre en considération cette assertion : « L’influence de la musique devient chaque jour plus nécessaire dans ce siècle corrompu.»
Jean-Pierre Longre
10:10 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, ménuret de chambaud, Étienne sainte-marie, joseph-louis roger, philippe sarrasin robichaud, éditions manucius, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2021
Huit siècles de commerce du livre
 Patricia Sorel, Petite histoire de la librairie française, La fabrique éditions, 2021
Patricia Sorel, Petite histoire de la librairie française, La fabrique éditions, 2021
Du Moyen Âge à nos jours, c’est une histoire complète du commerce du livre que nous raconte Patricia Sorel. Dès le treizième siècle, des « stationnaires » et des « libraires » (on découvrira la différence dans les premières pages) sont chargés de fournir les manuscrits nécessaires aux étudiants, tant à Paris qu’en province. Et bien sûr, l’invention de l’imprimerie et sa diffusion en France à partir de 1470 vont « profondément bouleverser » la vente des livres et le métier de libraire, qui va subir des variations au gré des conditions culturelles, sociales et politiques, des réglementations, du succès de tel ou tel type d’ouvrage, des goûts des lecteurs, des choix des éditeurs…
Cinq grandes étapes rythment cette histoire : « La librairie sous l’Ancien Régime », « Le développement de la librairie au XIXe siècle », « Une profession ancrée dans la tradition (fin XIXe siècle – 1945) », « La modernisation à marche forcée » (1945-1981) », « La librairie sous le régime du prix unique », le tout complété par des considérations sur la concurrence actuelle du commerce en ligne, par un index fort utile et par une bibliographie dite « sommaire », mais déjà bien fournie.
On peut bien sûr s’intéresser aux statistiques, aux chiffres détaillés, aux références précises qui jalonnent ces pages semées d’illustrations, devantures ou intérieurs de librairies connues (celles d’Adrienne Monier ou de Sylvia Beach par exemple) ou moins connues. S’intéresser aussi aux fluctuations économiques, aux modes de gestion des stocks, aux relations entre éditeurs, lecteurs, législateur et libraires. Mais les passages les plus prenants sont ceux qui relatent les grandes batailles : contre les différentes formes de censure (ouverte ou insidieuse), entre les grandes surfaces et les véritables librairies, et bien sûr celle du « prix unique » du livre, demandé de longue date par certains, finalement instauré sous la présidence de François Mitterrand et le ministère de Jack Lang le 1er janvier 1982, malgré les vives résistances de forces commerciales comme la Fnac et Édouard Leclerc, qui a cherché par tous les moyens mais finalement sans succès à conserver le statu quo. Des épisodes quasiment épiques qui, comme tout cet ouvrage, nous montrent que la salutaire croissance actuelle du nombre de librairies indépendantes n’est pas due au hasard, mais à une longue lutte pleine de péripéties, de négociations, d’espoirs, de désespoirs, d’abnégation. Cette « petite ( ?) histoire » met les pendules culturelles à l’heure.
Jean-Pierre Longre
19:03 Publié dans Essai, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, patricia sorel, la fabrique éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

