Rechercher : les mots du spectacle en politique
La Grande Gidouille en minilivre
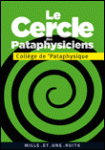 Collège de ’Pataphysique, Le Cercle des Pataphysiciens, Mille et une nuits, 2008
Collège de ’Pataphysique, Le Cercle des Pataphysiciens, Mille et une nuits, 2008
Pataphysiciens, nous le sommes tous, consciemment ou inconsciemment. « Science des solutions imaginaires » selon Alfred Jarry, « la ’Pataphysique est une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir », fait-il dire au Père Ubu. L’avantage, c’est que les définitions peuvent se multiplier et s’élargir sans préjudice pour ladite science (dont le nom, rappelons-le, doit s’orner d’une apostrophe initiale, alors que l’adjectif en est dispensé), au point que « le monde est dans toute sa dimension le véritable Collège de ’Pataphysique », ou que « la ’Pataphysique est une machine à explorer le monde ».
Mais les recherches ne doivent pas partir à vau l’eau, et le Collège est là pour régenter ce qui pourrait devenir, selon le vœu d’Umberto Eco, « la science des solutions inimaginables ». Le Collège de ’Pataphysique, fondé en 1948 (exactement le 1er décervelage 76 de l’ère pataphysique), est donc là, avec son immuable hiérarchie (dans l’ordre décroissant : le « Curateur Inamovible » - Jarry en personne -, le « Vice-Curateur » - chef suprême temporel - , puis les « Provéditeurs », « Satrapes », « Régents », « Dataires », et enfin les « Auditeurs » et « Correspondants »), ses « commissions », « sous-commissions », « intermissions », son Ordre de la Grande Gidouille, son Calendrier (qui commence à la Nativité d’Alfred Jarry), ses publications, ses membres…
L’objet du présent ouvrage est, en 120 pages, de donner au lecteur une idée de ce que sont les éminents membres du Collège de ’Pataphysique, dont la liste est fort longue, mais dont le choix, pour être judicieux, n’en est pas moins ici limité. Entre Alfred Jarry, qui ne connut jamais le Collège, mais en fut la cause inaugurale et illustre « patacesseur », et Sa Magnificence Lutembi, auguste crocodile du lac Victoria et « Quatrième Vice-Curateur », est répertorié un échantillon représentatif des sociétaires, avec leurs diverses occupations ((écrivains, peintres, actifs, oisifs), leurs diverses origines, leurs rangs divers. On apprend à mieux connaître, ou à pataphysiquement connaître, par exemple, Marcel Duchamp, Raymond Queneau (par ailleurs cofondateur de l’OuLiPo, qui n’est pas sans liens avec le Collège), Jacques Prévert, Boris Vian, Eugène Ionesco (dont l’élection à l’Académie Française ne contrecarra pas son appartenance au Collège de ’Pataphysique qui, déclara-t-il, « couronne toutes les académies passées, présentes et futures »), Jean Dubuffet, Fernando Arrabal… sans oublier le fameux Baron Mollet… Ajoutons que chaque notice a été rédigée par un membre du Collège (sous-commission du Grand Extérieur »), ce qui ne peut que mettre en confiance aussi bien le Patapysicien chevronné que le lecteur innocent qui, en quelques pages, a la possibilité de pénétrer dans le labyrinthe de la Gidouille. Il aura du mal à en sortir.
Jean-Pierre Longre
04/08/2010 | Lien permanent
Le train de la mémoire
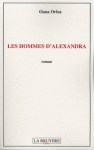 Oana Orlea, Les hommes d’Alexandra, Éditions La Bruyère, 2010
Oana Orlea, Les hommes d’Alexandra, Éditions La Bruyère, 2010
Oana Orlea (Maria-Ioana Cantacuzino), née en Roumanie en 1936, a connu dès 1952 les geôles et les camps de travail de la dictature communiste, puis les petits métiers auxquels étaient voués les intellectuels rétifs et les rejetons de familles naguère trop en vue (elle était de la famille de Georges Enesco, et son père avait été un grand aviateur). Après avoir publié plusieurs ouvrages dans les années de relative ouverture (60-70), elle s’installe en France à partir de 1980 et se signale par des parutions en français : Un sosie en cavale (Le Seuil, 1986), Les années volées (Le Seuil, 1991), Rencontres sur le fil du rasoir (L’Arpenteur, 2007).
Dans Les hommes d’Alexandra, les souvenirs se succèdent au rythme d’un trajet en train auquel des événements déconcertants et des rencontres inattendues donnent une dimension quasiment fantastique. Périodiquement, un grand cheval aubère galope le long de la voie ferrée, comme s’il faisait signe à l’héroïne d’avancer avec lui ; une étrange femme aux cheveux rouges vient la harceler, comme pour la faire renoncer à poursuivre le voyage ; un jeune homme obèse, une jambe dans le plâtre, semble vouloir la protéger… Un par un se déclenchent les souvenirs des hommes qu’elle a connus, aimés brièvement ou longuement, superficiellement ou profondément, et qui viennent hanter sa mémoire vagabonde.
Les deux couches principales du récit (Alexandra à la troisième personne dans son wagon, Alexandra à la première personne dans les scènes d’autrefois) permettent l’évocation des sentiments intimes, de la diversité des amours ; elles permettent aussi celle du passé sociopolitique dans un pays en proie au totalitarisme, à la misère, au travail forcé, aux brimades, et malgré tout celle des petits plaisirs et des grandes émotions, des espoirs et des révoltes. L’atmosphère d’antan, les ambiances contrastées peuplent une mémoire saturée : « D’autres images s’avancent, coquillages flottant à la dérive dans la galaxie de la mémoire, s’entrechoquent, explosent, volent en éclats, se dispersent en mille morceaux qui jamais ne retrouveront une cohérence ». Les hommes d’Alexandra est un roman riche de l’expérience d’une vie plurielle, un roman qui, dans son foisonnement, en contient plusieurs.
Jean-Pierre Longre
02/01/2011 | Lien permanent
Champions de la forme fixe
 OuLiPo, C’est un métier d’homme, Mille et une nuits, 2010
OuLiPo, C’est un métier d’homme, Mille et une nuits, 2010
La contrainte et l’invention font bon ménage. C’est ce que, depuis cinquante ans, l’Oulipo vérifie et met en pratique, selon l’une de ses options, « la tendance analytique [qui] travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonné » (François Le Lionnais, « La Lipo (Le premier Manifeste) »).
Dans C’est un métier d’homme, l’œuvre du passé (tout est relatif…) est « Autoportrait du descendeur », texte liminaire du recueil Les athlètes dans leur tête de Paul Fournel. Cet autoportrait est celui d’un skieur qui se voit en champion médaillé d’or, bourreau de travail, toujours à l’entraînement, soignant le moindre détail, mais prévoyant aussi la faute infime qui lui apportera « le seul moment de vrai repos ». Cette nouvelle en contient une autre (sinon plusieurs) en filigrane : le descendeur est aussi le nouvelliste, aussi soigneux dans son labeur, aussi soucieux de sa tâche que le descendeur.
Sur ce modèle, Hervé Le Tellier a composé un « autoportrait du séducteur », qui s’adonne à son activité avec autant de scrupules et de méticulosité que le descendeur ; puis d’autres ont emprunté le moule pour y couler leur prose et sculpter leurs « autoportraits d’hommes et de femmes au repos » : outre les deux premiers, Jacques Jouet, Frédéric Forte, Michelle Grangaud, Marcel Bénabou, Ian Monk, Michèle Audin, Daniel Levin Becker, Olivier Salon, tous Oulipiens, créent ainsi une nouvelle forme fixe et une possibilité de variations à l’infini, dont ces prototypes ont tout pour plaire, pour faire réfléchir, voire pour faire peur de la chute finale. Les métiers (puisqu’il faut les appeler ainsi) les plus divers sont ici présentés en situation, aussi bien le ressusciteur que le tyran, la fourmilière que la toupie, le philosophe télévisuel que le Président, le buveur que la femme en quiétude… j’en passe. Preuve est faite que la contrainte est source d’ouverture, la forme fixe de trouvailles, la matrice immuable des tonalités les plus variées, parmi lesquelles l’humour et la satire ne sont pas les plus rares, mais sont à prendre au sérieux.
L’un des avantages de ce genre de publication, c’est que chaque lecteur sent poindre en lui des potentialités littéraires que sans cela il aurait gardées enfouies au plus profond de son cerveau. Certes, pour devenir réalité, une potentialité doit faire l’objet, comme ici, de la plus extrême attention, de la préparation la plus pointilleuse, de la volonté la plus acharnée, de la « concentration » la plus « totale ». Un vrai travail de chroniqueur littéraire.
Jean-Pierre Longre
et pour lire çà et là quelques notes éparses, quelques chroniques en pointillés qui ont quelque chose à voir avec l’Ouvroir de Littérature Potentielle, voir :
03/01/2011 | Lien permanent
The Black Herald
 Literary magazine – Revue de littérature
Literary magazine – Revue de littérature
Issue #1 January 2011 – Janvier 2011
160×220 – 148 pages - 13.90 €
ISBN 978-2-919582-02-0
Poetry, short fiction, essays, translations.
Poésie, fiction courte, essais, traductions.
The first issue can now be ordered
Le premier numéro est désormais disponible
Texts by / Textes de : Laurence Werner David • John Taylor • Valeria Melchioretto • Tabish Khair • Émile Verhaeren • Will Stone • Philippe Rahmy • Rosemary Lloyd • Osip Mandelstam • Alistair Noon • Onno Kosters • Willem Groenewegen • Sandeep Parmar • Georges Rodenbach • Andrew O’Donnell • Khun San • Sylvie Gracia • Georg Trakl • Anne-Sylvie Salzman • James Byrne • Claro • Brian Evenson • Siddhartha Bose • Romain Verger • Yahia Lababidi • Sébastien Doubinsky • José Mena Abrantes • Cécile Lombard • Darran Anderson • Anne-Françoise Kavauvea • Emil Cioran • Nicolas Cavaillès • Mark Wilson • Zachary Bos • Paul Stubbs • Blandine Longre. Images: Emily Richardson • Romain Verger • Will Stone. Design: Sandrine Duvillier.
More about the contributors / les contributeurs
Co-edited by Blandine Longre and Paul Stubbs, the magazine’s only aim is to publish original world writers, not necessarily linked in any way by ‘theme’ or ‘style’. Writing that we deem can withstand the test of time and might resist popularization – the dangers of instant literature for instant consumption. Writing that seems capable of escaping the vacuum of the epoch. Where the rupture of alternative mindscapes and nationalities exists, so too will The Black Herald.
L’objectif premier de la revue, coéditée par Blandine Longre et Paul Stubbs, est de publier des textes originaux d’auteurs du monde entier, sans qu’un « thème » ou un « style » les unissent nécessairement. Des textes et des écritures capables, selon nous, de résister à l’épreuve du temps, à la vulgarisation et aux dangers d’une littérature écrite et lue comme un produit de consommation immédiate. Des textes et des écritures refusant de composer avec la vacuité de l’époque, quelle qu’elle soit. Éclatement des codes, des frontières nationales et textuelles, exploration de paysages mentaux en rupture avec le temps : c’est sur ces failles que l’on trouvera le Black Herald.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de Rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
28/01/2011 | Lien permanent
L’écume du malheur
 Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Dans l’avant-propos de L’écume des jours, Boris Vian proclame la primauté, dans la vie comme dans son livre, de l’amour (sans oublier une certaine musique de jazz), et dévoile son principe romanesque : « Les quelques pages de démonstration qui suivent tirent toute leur force du fait que l’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ». À la fin de sa présentation de D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère écrit ceci : « Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d’extrême pauvreté, de justice et surtout d’amour. Tout y est vrai ». Faut-il arrêter ici la comparaison ? Sans doute, mais si elle m’est venue à l’esprit malgré le paradoxe, c’est parce que dans les deux cas les récits sont profondément humains et profondément « vrais », l’humanité et la vérité empruntant des chemins littéraires différents – l’imaginaire fantaisiste et l’humour (noir) dans le premier, la relation précise et sans concessions des faits réels dans le second. L’amour, la tendresse, l’amitié, la maladie, la mort, le malheur sont en tout cas, dans l’un et l’autre roman, le substrat humain qui fonde le besoin d’écriture et le désir de lecture.
 On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
Événements pathétiques s’il en est, racontés sans pathos, avec des détails que l’on sent précisément choisis, dans leur apparente objectivité et à travers quelques exemples individuels, pour montrer la confiance que l’on peut avoir dans l’amour humain (ce sont bien, d’ailleurs, les malheurs dont ils sont témoins qui renforcent les sentiments que se portent l’auteur et sa compagne, et finalement sauvent leur couple). Les personnes réelles deviennent des personnages symboliques de l’humanité, dans tous les sens du terme. Ils sont modestes (petites familles, petits juges), les morts ne sont ni héroïques ni vraiment exceptionnelles (catastrophe naturelle, cancer), mais ce qui est représenté, c’est le pouvoir qu’a chaque être humain, confronté à la fatalité, de changer la vie, de combattre la souffrance, de ressouder les liens, et aussi de peser sur les contraintes sociales, de protéger les pauvres, de braver la puissance des groupes financiers quand on est un « petit juge de province » obstinément épris de justice… Dans l’écume du malheur, il y a toujours de la place pour l’expression poignante de l’amour, et d’une œuvre de « commande », il y a toujours de quoi faire un beau roman.
Jean-Pierre Longre
24/03/2017 | Lien permanent
Un théâtre bien vivant
 Alternatives théâtrales n° 106-107, « La scène roumaine. Les défis de la liberté », 4e trimestre 2010
Alternatives théâtrales n° 106-107, « La scène roumaine. Les défis de la liberté », 4e trimestre 2010
Depuis vingt ans, la vie intellectuelle et artistique roumaine s’est évidemment libérée, animée, étendue, diversifiée. Rien de tel que les arts du spectacle, notamment le théâtre, pour illustrer ce phénomène. Forte de ce constat, la revue belge Alternatives théâtrales consacre son dernier numéro à « la scène roumaine », sous l’égide de Georges Banu et Mirella Patureau, très bien placés pour cela, puisque leur point de vue est à la fois extérieur et intérieur (respectivement professeur à la Sorbonne Nouvelle et chercheur au CNRS, ils vivent en France tout en étant fortement impliqués dans l’univers théâtral roumain).
Il était sans doute nécessaire de rappeler au public d’Europe occidentale, aux « lecteurs d’ailleurs », qu’en Roumanie le théâtre est bien vivant, et qu’en ce qui concerne le répertoire « la scène roumaine se montre nettement plus ouverte que la scène française » ! Si la censure, jusqu’en 1989, a imposé un cadre rigide à la création scénique (comme à toute création), elle n’a pas interdit le théâtre, et l’éclatement libérateur des années 1990 n’est pas une rupture complète, mais une métamorphose dans la continuité. C’est en tout cas ce qu’explique Georges Banu dans son introduction, en analysant les différentes formes du spectacle théâtral qui s’élabore depuis, dans un « archipel des solitudes » s’épanouissant sans conflit mais dans une infinité d’identités, en dépit des contraintes économiques entraînant des restrictions budgétaires.
Les deux grandes parties de ce numéro (« Repères pour un paysage théâtral », « Paroles et portraits d’artistes ») permettent un tour d’horizon, sinon exhaustif, du moins très détaillé, de ce qui se fait en matière de réalisation et d’écriture scéniques à Bucarest et dans les grandes métropoles culturelles du pays. Le répertoire dans toute sa variété – de la tragédie antique à la jeune avant-garde, des pièces roumaines aux œuvres internationales, de la tradition à la provocation – est passé en revue par les critiques ou par les acteurs (au sens général), et les grands événements évoqués montrent l’étendue géographique du renouveau : Festival national de théâtre de Bucarest, Festival de Sibiu, Festival Shakespeare de Craiova, Théâtre Ariel de Târgu-Mureş… Le tour d’horizon est largement complété, à bon escient, par des réflexions en profondeur sur des phénomènes marquants : l’enseignement du théâtre, qui tend à multiplier le nombre de comédiens diplômés ; la fameuse « ostalgie », dont les jeunes dramaturges se dégagent pour faire porter leurs critiques non seulement sur le passé communiste, mais aussi sur le présent capitaliste ; l’expérimentation originale souffrant du « synchronisme », c’est-à-dire du désir d’adaptation aux modes européennes ; l’importance du rôle joué par le groupe du « dramAcum », sous la houlette de Nicolae Mandea… Il était primordial, en outre, de donner la parole aux grands créateurs, metteurs en scène et dramaturges, directement ou sous la forme d’entretiens. Cette parole tient une place révélatrice d’un état des lieux et d’une dynamique. Le tout se termine par un bref panorama du cinéma roumain, plusieurs fois récompensé, et qui pose des questions, en tout cas qui « entame avec nous un dialogue ».
Les textes fouillés, les synthèses, les témoignages, tous signés de critiques avertis, d’universitaires, de metteurs en scène, de comédiens, d’écrivains, sont ponctués de belles et larges photos de mises en scène, pour la plupart proposées par Mihaela Marin, spécialisée dans les arts du spectacle. Cette combinaison du textuel et du visuel compose un très bel ensemble, complété, signalons-le, par un dossier sur le norvégien Jon Fosse, et par un article de Bernard Debroux, codirecteur de la revue avec Georges Banu, sur « les langues d’Europe » examinées dans la perspective théâtrale.
Ce numéro dévoile les richesses et les potentialités de la « scène roumaine » actuelle dans toutes ses dimensions, avec ses paradoxes, ses enjeux, ses héritages, son esprit créateur, ses expériences, ses mutations… Un ensemble indispensable à l’exploration du paysage théâtral et artistique européen.
Jean-Pierre Longre
24/01/2011 | Lien permanent
Présente et absente
 Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
PRIX FEMINA 2010
Rééd. Folio, 2012
« Il y a des circonstances où quoi qu’on fasse on va toujours nulle part ». En l’occurrence, dans le dernier roman de Patrick Lapeyre, on va et on vient entre passé et présent, entre ici et ailleurs, entre le réel quotidien et nulle part. Plus précisément, Nora Neville, jeune anglaise farouchement attachée à sa liberté, sans qu’elle éprouve le besoin de s’en justifier, va et vient entre Paris et Londres, entre Louis Blériot (qui n’est pas aviateur) et Murphy (qui est trader).
Et tout tourne autour d’elle, qu’elle soit physiquement présente ou absente, jusqu’à l’obsession, une obsession aux pouvoirs aussi absolus que mystérieux : « C’est à cette heure qu’autrefois Murphy aimait entrer en communication avec Nora. Il la retrouvait sagement assise, un livre à la main, à l’intérieur d’un café de Soho ou bien se promenant dans les allées de Green Park » ; une obsession qui peut suspendre le cours du monde, pour Blériot et pour les autres : « Le temps qu’elle pivote sur elle-même en le cherchant des yeux, il n’y a plus aucun bruit, on ne sent plus le souffle d’air, la rotation de la terre s’interrompt quelques nanosecondes ».
C ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
A l’instar du titre, évocateur et harmonieux, emprunté au poète japonais Issa, le style de Patrick Lapeyre est aéré et allusif, limpide et plein d’échos ; sous un apparent dépouillement, il ne dédaigne pas l’expressivité, la tournure imagée voire surprenante – comme est surprenante l’héroïne fraîche et tragique, présente et absente, attendue et imprévisible, réelle et irréelle – un peu comme si se retrouvaient dans le monde d’aujourd’hui la Manon Lescaut de l’abbé Prévost (dont l’auteur revendique d’ailleurs la paternité), mais aussi la Nadja d’André Breton.
Jean-Pierre Longre
06/03/2012 | Lien permanent
Pour la nouvelle, toujours
 Revue Brèves n° 93, « Vue imprenable sur Pascal Garnier », 2010
Revue Brèves n° 93, « Vue imprenable sur Pascal Garnier », 2010
Voici ce qu’il y a quelques années j’écrivais dans Sitartmag à propos de la revue Brèves :
Combien de revues littéraires les vingt dernières années ont-elles vu naître pour rapidement disparaître ? Combien de publications sur la nouvelle, genre qui, paradoxalement, se « vend(ait) mal » mais envahi(ssai)t les pages ouvertes aux jeunes auteurs et fai(sai)t l’objet de multiples concours, dans des circuits parallèles à ceux des grandes maisons d’édition ?
Brèves, en toutes circonstances, maintient son cap obstiné. À l’Atelier du Gué, dans l’Aude, crue ou sécheresse, tempête ou calme plat, on a l’esprit de suite, on traverse coûte que coûte, et c’est tant mieux. Daniel et Martine Delort savent où ils vont. Ils ont su composer avec le temps, avec les modes, avec les obstacles techniques, administratifs et financiers (sûrement), humains (peut-être), sans faire de concessions aux lois du commerce. Et tout en ayant vocation à éditer des livres, ils continuent depuis 60 numéros à publier leur revue, qui mêle en toute harmonie dossiers et entretiens littéraires, auteurs consacrés ou inconnus, textes inédits, notes critiques, recensions et informations.
Voilà sans doute la publication la plus complète, la plus sérieuse et la moins prétentieuse de la famille. Courant le risque de la nouveauté (donc de l’erreur) mais demeurant dans les strictes limites du texte narratif court, elle a fait beaucoup pour la réhabilitation d’un genre qui, naguère boudé par le monde littéraire, retrouve depuis peu ses lettres de noblesse. Beaucoup plus en tout cas que les éditoriaux désolés des grands organes. Sans effets médiatiques, sans éclats démagogiques, Brèves nous donne à lire des écrivains souvent mal connus et qui gagnent à l’être mieux, des textes venus d’ailleurs ou de tout près, en langue française ou traduits, nous renseigne sur l’essentiel de la production actuelle ; et nous montre ainsi que la nouvelle, genre à part entière qui porte en germe ou en concentré les qualités essentielles de l’art littéraire, ne peut se faire connaître que par elle-même.
Que demander de plus ? Peut-être que, arrivée au bel âge d’une séduisante jeunesse, la revue Brèves se fasse encore mieux apprécier du grand public. Nous tentons d’y contribuer.
Rien n’a changé, à un chiffre près. Les obstacles sont toujours là, le cap est maintenu, et Brèves en est à son numéro 93… Un numéro consacré tout entier à une « vue imprenable » sur Pascal Garnier, qui a quitté ce monde en mars 2010, laissant une œuvre noire et grise, sombre et lumineuse, inquiétante et roborative. Hubert Haddad, qui a imaginé et coordonné ce numéro, parle avec justesse d’un écrivain « qui marque la littérature française par sa langue retenue autant que retorse, rétive aux enfumages lyriques et cependant portée par une surprenante pyrotechnie d’images en noir et blanc ».
Ce volume donne un portrait dense et varié de l’écrivain : après quelques-unes de ses nouvelles, de nombreux souvenirs littéraires, qui ne sont pas des hommages conventionnels, mais de vrais témoignages d’amitié. Pascal Garnier n’est plus, son œuvre demeure, et l’équipe de Brèves compose obstinément, pour le bonheur de la nouvelle et des lecteurs, son « anthologie permanente de la nouvelle ».
Jean-Pierre Longre
Un ouvrage de Pascal Garnier
Chambre 12, Flammarion, 2000.
Il a sa petite vie bien réglée, Charles, petite vie sans bonheur et sans enthousiasme, entre son travail de veilleur de nuit, les infimes occupations quotidiennes et les apéritifs pris au Balto du coin avec quelques copains dont il écoute sans les entendre les conversations de café du commerce. Une petite vie sans fioritures et sans fantaisie, étrangère aux sensations fortes et aux grands sentiments. Il est devenu une sorte de Meursault en fin de parcours depuis qu’un jour il a frappé à la porte du malheur et qu’il a payé par la prison un sursaut de révolte contre la tromperie de l’amour.
Il n’est ni heureux ni malheureux, et pourtant les autres autour de lui sont bien gentils et voudraient lui faire plaisir : Arlette, la soubrette rondelette qui lui fait œil et bouche de velours, les copains du Balto qui le font gagner au Loto, Madame Tellier sa patronne, qui veut lui faire prendre des vacances. Mais il ne se sent pas concerné… Ce n’est pas ce qu’il cherche.
Son destin, il le trouvera en la personne mystérieuse et fascinante d’Uta, belle grande dame élégante et borgne, qui hantera son esprit et sa vie, dont il ne pourra plus se séparer et qui l’emmènera pour un seul et ultime voyage qu’il voudrait interminable. Personnage décisif qui traverse sa vie d’Est en Ouest, du levant au couchant, et dont il devient dépendant comme nous tous. Uta est celle que chacun attend sans vraiment la chercher.
Pascal Garnier a écrit plusieurs romans noirs. Chambre 12 est un roman gris. Cette description apparemment limpide d’un quotidien plutôt désespérant n’est dénuée ni d’humour ni d’opacité, et l’écriture, à travers l’évocation de petites vies, parvient à faire entrevoir les mystères et les abîmes de l’existence.
29/11/2010 | Lien permanent
Cachée derrière…
 Pierre Autin-Grenier, Elodie Cordou, la disparition, « vu par Ronan Barrot », les éditions du Chemin de fer, 2010
Pierre Autin-Grenier, Elodie Cordou, la disparition, « vu par Ronan Barrot », les éditions du Chemin de fer, 2010
« Elodie Cordou, outre qu’elle était parmi nous d’une éblouissante beauté, la légèreté faite plume, je l’ai déjà dit, faisait toujours preuve d’une agilité d’esprit très rare qui témoignait d’une intelligence lumineuse que ne risquait jamais d’effleurer le superficiel ». Elle a toujours détesté se faire prendre en photo, et d’une manière générale redoutait les « photographistes », leur préférant les peintres dérangeants, « briseurs d’ordre établi », tel celui qui vivait dans le village du Limousin où elle donna son dernier rendez-vous au narrateur.
Car, comme le titre et la première page du récit l’annoncent d’emblée, personne ne peut dire où se cache Elodie Cordou, ni même « attester sa présence au monde ». Ce monde de la finance et du pouvoir, incarné par son frère Jean-Maximilien, héritier de l’affaire familiale, ce monde du négoce et de la rentabilité aux yeux duquel tous ceux (dont Elodie Cordou) qui n’entrent pas dans le moule sont atteints de « déséquilibre mental », ce monde, donc, elle l’a fui pour on ne sait où, on ne sait quoi.
Elodie Cordou, alliance complexe de la douceur musicale (son prénom) et de la dureté du cuir (son nom), est éprise d’indépendance, mais sa révolte lucide exclut la violence. D’où sa disparition, ultime manifestation du refus. On aurait pourtant bien voulu la connaître en chair et en os, voir si elle est bien telle que l’évoquent les pages poétiques et litaniques, graves ou légères de Pierre Autin-Grenier, telle que nous la montrent les peintures vives et sombres, statiques ou mouvementées de Ronan Barrot – un peu ce qu’on peut voir, à l’occasion, sur les toiles du peintre d’Eymoutiers dont il est question au détour du chemin. Mais à y bien réfléchir, on ne peut la connaître que par la représentation littéraire et graphique, en retrait du réel, cachée derrière.
La combinaison du texte et de l’image illustre parfaitement, aux antipodes du figé mécanique de la photographie et des clichés de l’écriture à la mode, la profondeur de la liberté humaine et les mystères de l’art salvateur.
Jean-Pierre Longre
Un petit rappel…
Pierre Autin-Grenier, Là-haut, « vu par Ronan Barrot », les éditions du Chemin de fer, 2005.
Au sommet de la colline, la « baraque bleue », où vient de mourir une vieille femme qui y demeurait recluse depuis on ne sait quand, recèle des mystères insoupçonnés. Les hommes robustes chargés de la vider, à mesure de leur exploration, découvrent des secrets à frémir : des boîtes aux étranges contenus, un portrait qui nous fait remonter à des origines familiales porteuses de malédiction et de mort, et encore… laissons au texte le soin de ses effets. Les illustrations de Ronan Barrot, à grands traits sombres suggestifs et énigmatiques, s’adaptent précisément aux pages de cette nouvelle qui nous plonge dans les profondeurs lugubres du temps.
J.-P. L., novembre 2005
…et sur l’auteur : http://remue.net/cont/autingrenier1.html
14/04/2011 | Lien permanent
« Allumer des flambeaux pour les esprits »
 Victor Hugo, Du péril de l’ignorance, préface de Marie-Noël Rio, Les Éditions du Sonneur, 2010
Victor Hugo, Du péril de l’ignorance, préface de Marie-Noël Rio, Les Éditions du Sonneur, 2010
En 1848, Victor Hugo n’est pas encore un homme de gauche : élu le 4 juin à l’Assemblée constituante, il siège parmi les monarchistes du parti de l’Ordre. Et pourtant… Comme le rappelle Marie-Noël Rio dans sa préface, depuis toujours préoccupé par le sort du peuple et des petits, « il se bat contre la médiocrité, la lâcheté et la bêtise ». À partir de ce moment, il se rapprochera de plus en plus de la gauche.
Parmi les discours qu’il prononce cette année-là, la « Question des encouragements aux lettres et aux arts » (10 novembre 1848), que Les Éditions du Sonneur publient avec à-propos sans leur « petite collection », sous le titre plus ouvert de Du péril de l’ignorance. Le budget de ce qu’on appelle aujourd’hui le ministère de la Culture était alors le « budget spécial des lettres, des sciences et des arts », géré par deux ministères, l’Instruction publique et l’Intérieur. Il fallait (déjà) faire des économies ; sur quoi ? Sur (déjà) la culture… Comment ? En supprimant (déjà) des emplois… L’argumentation et la rhétorique du poète, défendant l’intelligence au nom de la morale, fustigeant l’ignorance au nom de la conscience, sont implacables, sans concessions : « Quoi ! D’un côté la barbarie dans la rue, et de l’autre le vandalisme dans le gouvernement ! ». C’est du grand Hugo, pour qui la gloire de la France ne peut aller sans l’intelligence, pour qui le développement matériel ne peut aller sans celui de l’esprit, du grand Hugo reconnaissable à son inimitable sens de la formule : « À côté du pain de vie je veux le pain de la pensée, qui est le pain de la vie ».
Toutes les époques ne sont pas égales. Depuis 1848, beaucoup de choses ont évidemment changé, et il faut éviter de confondre les contextes. Mais ce discours – auquel s’ajoute, prononcé en avril 1849, le « Secours aux artistes » qui nous fait découvrir le sculpteur romantique Antonin Moine, mort de ne pas avoir été secouru par l’État – concerne en bien des points aussi notre actualité. Qu’on se le dise !
Jean-Pierre Longre
01/01/2011 | Lien permanent

