Rechercher : les mots du spectacle en politique
Les masques de la vie
 Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
« M. Ali, j’ai parfois l’impression que ce que nous sommes, ce que nous paraissons être, ce que nous prétendons être et ce que nous sommes aux yeux des autres sont quatre choses bien distinctes. Telle est la nature de l’existence, l’une de ses nombreuses imperfections, pourriez-vous ajouter » : le capitaine William Meadows, revenu d’Inde en 1837 avec Amir Ali, semble avoir compris ce qui fait la diversité de l’existence et de ses énigmes, des récits que l’on en fait, aux autres et à soi ; ils sont au cœur du roman de Tabish Khair.
Le protagoniste, donc, s’est installé dans le Londres victorien, sous la protection du capitaine Meadows, qui lui demande de raconter sa vie d’adepte du « thugisme », secte réunissant jadis des musulmans et des hindous pratiquant rituellement le vol et le meurtre. En parallèle, Amir confie à Jenny, la jeune servante qu’il aime, dans des lettres dont il sait qu’elle ne pourra les lire, les vraies vicissitudes de sa vie en Inde et ses doutes actuels, dans la grisaille anglaise.
Une autre intrigue met en scène le fameux phrénologue lord Batterstone, dont la volonté est de montrer à tout prix le bien-fondé de ses théories raciales, et son employé John May qui, à force de chercher pour son patron des crânes difformes dans les tombes, sombrera dans l’acharnement du meurtre, entraînant ses complices avec lui. Le récit tourne au roman noir, avec double enquête, officielle et journalistique d’une part, nourrissant le fantasme du « cannibale décapiteur », officieuse et populaire d’autre part, assurée par quelques représentants efficaces et solidaires de la populace des bas-quartiers.
Tabish Khair, dont l’art des récits alternés se manifestait déjà dans Apaiser la poussière, sait que la vie humaine n’est pas une, et que l’existence n’est pas vouée à la certitude ; surtout, il sait l’écrire, par le truchement d’histoires qui se situent aux confins du réel, aux limites de la possibilité, aux frontières du doute. Et il sait le confier à la plume fictive de ses personnages : « Qu’il est étrange de devenir ce qu’on n’est pas. Quelques histoires, quelques mots suffisent-ils ? Notre emprise sur la réalité est-elle si faible, si précaire ? Les histoires – racontées par nous ou par d’autres – peuvent-elles nous transformer ainsi ? Et pour quelle raison avons-nous besoin de nous en revêtir – quelle que soit notre manière d’avoir prise sur la réalité, et quelle que soit cette réalité ? Est-ce donc ce à quoi nous nous résumons ? Des histoires, des mots, un souffle ? ».
Jean-Pierre Longre
http://blongre.hautetfort.com/archive/2012/04/29/a-propos-d-un-thug.html
12/12/2012 | Lien permanent | Commentaires (1)
Des trouvailles au Pont du Change
Roland Tixier, Chaque fois l’éternité, préface de Geneviève Metge, Le Pont du Change, 2011
Alphonse Allais, L’agonie du papier et autres textes d’une parfaite actualité, introduction de Jean-Jacques Nuel, Le Pont du Change, 2011
Le Pont du Change, maison d’édition lyonnaise, enrichit sa production de deux livres à déguster lentement, avec délectation.
 L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
 L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
Le Pont du Change passe par-dessus les années en deux démarches différentes. Empruntez-le sans hésiter, le trajet ne vous décevra pas.
Jean-Pierre Longre
07/09/2011 | Lien permanent
À la recherche du temps disloqué
 Marien Defalvard, Du temps qu’on existait, Grasset, 2011, Le Livre de Poche, 2013
Marien Defalvard, Du temps qu’on existait, Grasset, 2011, Le Livre de Poche, 2013
360 pages d’errances dans le temps (presque 50 ans), dans l’espace (des milliers de kilomètres), dans l’imaginaire, dans le monde et à l’écart du monde ; une vie entière enfermée à l’intérieur d’un enterrement. 360 pages emplies d’« aspérités profondes et distordues », de couleurs et de formes, de va-et-vient entre deux villes, entre deux paysages, entre deux maisons, entre deux dates, entre deux rêves…
Ces pages évoquent, plus qu’elles ne racontent, une vie de dandy postromantique avec ses rencontres, sa solitude, ses livres, ses routes entrecroisées, ses dates et ses lieux, repères auxquels se raccroche une vie entière de rêverie, d’écriture et de peinture (« Je devenais un peintre, et une envie soudaine commençait alors à grimper en moi, puissante ; il me fallait, tout de suite, un chevalet, une blouse, un pinceau, car devant cette scène forestière, j’échangeais mon âme contre celle d’un artiste, et j’avais l’impression qu’en moi bouillait un talent fou »), de recherche à la fois détachée et présomptueuse de soi et du temps (« J’aimerais atteindre, quand trop d’églises en perspectives trompeuses, trop de raccourcis aux noms oubliés, trop d’immeubles noirs, lépreux, sous ciels bleus, maintenant anéantis m’auront abandonné, atteindre, comme une clairière, le jour du temps démoli. Le grand jour du temps démoli »).
 Tout s’enchaîne sous nos yeux parfois ébahis par l’audace d’une écriture foisonnante et baroque qui, à la limite du bancal, se joue des normes, n’hésite pas à faire plier les mots sous le jeu des sonorités (« Paul était d’une hétérosexualité sans vergogne, sans verte guigne, ni repos ; droite, roide, stoïque, aimable. Rossé pensant ») et des formes (« Lyon. Un nom plein, qui adhère à la bouche, consistant, presque gras. Le L coulant du paysage, le L liquide des eaux, le L lit du fleuve et de la rivière. Le Y, aristocratique, petit doigt en l’air, le Y assez crâneur et le Y affecté, rare. Le Y confluent. Le ON plein, ample en bouche, le ON ascensionnel, le ON fort. Le tout pour un nom très court mais très expressif, sonore, comme la ville, concentrée et étirée à la fois ; ville diérèse, synérèse, chaude et froide, dorée, déshéritée »).
Tout s’enchaîne sous nos yeux parfois ébahis par l’audace d’une écriture foisonnante et baroque qui, à la limite du bancal, se joue des normes, n’hésite pas à faire plier les mots sous le jeu des sonorités (« Paul était d’une hétérosexualité sans vergogne, sans verte guigne, ni repos ; droite, roide, stoïque, aimable. Rossé pensant ») et des formes (« Lyon. Un nom plein, qui adhère à la bouche, consistant, presque gras. Le L coulant du paysage, le L liquide des eaux, le L lit du fleuve et de la rivière. Le Y, aristocratique, petit doigt en l’air, le Y assez crâneur et le Y affecté, rare. Le Y confluent. Le ON plein, ample en bouche, le ON ascensionnel, le ON fort. Le tout pour un nom très court mais très expressif, sonore, comme la ville, concentrée et étirée à la fois ; ville diérèse, synérèse, chaude et froide, dorée, déshéritée »).
L’auteur, nous dit-on, a 19 ans. Peu importe. Du temps qu’on existait est un livre définitif, une quête où tout commence et où tout finit. Tout commence avec « Il y a la vie », tout finit avec « Moi ou la fin de tout ». Entre les deux, le monde défile en désordre, le temps s’en va, s’emmêle, s’enchaîne, se déchaîne, et les mots cherchent (y arrivent-ils ?) à donner une cohérence à tout cela : « Je ne savais plus ce que j’étais ; j’étais le temps ; tout était rentré dans l’ordre, le blanc ».
Jean-Pierre Longre
24/06/2013 | Lien permanent
« L’oiseau bicéphale »
 Ici é là, revue de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 13, 2010
Ici é là, revue de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 13, 2010
Ici é là, revue publiée sous la responsabilité, entre autres, de Jacques Fournier, se signale d’abord par son format original, sa mise en page soignée, ses coloris variés, et le choix des textes qu’elle propose, dans une présentation séduisante. Un bel objet poétique.
Le n° 13, dédié à Arlette Albert-Birot, disparue l’été dernier, tient les promesses de son intitulé. Dans ses quatre sections, de la création, des articles de fond, des notes et recensions diverses, et, tout particulièrement, un dossier (« si près é si loin ») consacré aux « poètes roumains d’expression française ». Dans une introduction qui fait la part belle à un historique des relations entre la Roumanie et la langue française, Linda Maria Baros décrit « l’oiseau bicéphale », image forte qui figure pour elle la poésie roumaine francophone, dans une série d’aller-retour entre « ici » et « là », au cours desquels se croisent et se mêlent les cultures.
Successivement, les poèmes de Horia Badescu, Sebastian Reichmann, Valeriu Stancu, Marlena Braester, Matéi Visniec, Rodica Draghincescu et Linda Maria Baros elle-même offrent des exemples de la diversité verbale et prosodique d'auteurs dont les préoccupations passent par une singulière maîtrise de la langue française, cette langue qu’ils ont délibérément choisie sans renier leurs origines. Comme leurs prédécesseurs, ils n’hésitent pas à se confronter à la difficulté ; ainsi que l’écrit Matéi Visniec, « il y a des jours où les mots ne veulent plus sortir / il y a des jours où les mots se replient au fond de nous-mêmes / dégoûtés de nous et surtout de nous-mêmes » ; mais lorsqu’ils veulent bien venir, ils nourrissent des textes dont la forme et la teneur ne sont ni roumaines ni françaises, mais les deux à la fois et, tout compte fait, universelles. « On ne naît pas une langue collée au front », écrit encore Linda Maria Baros.
Tout en fournissant de belles lectures dans un cadre esthétique harmonieux, ici é là incite à aller plus loin, chercher d’autres auteurs, d’autres textes, suivre des chemins nouveaux, trouver « l’écriture en images » (Rodica Draghincescu), franchir des « portes obscures » (Horia Badescu) vers des « traînées de lumière » (Marlena Braester).
Jean-Pierre Longre
18/01/2011 | Lien permanent
Épreuves et variations
 Christian Gailly, K.622, Minuit, 1989, réédition coll. « double », 2011
Christian Gailly, K.622, Minuit, 1989, réédition coll. « double », 2011
Les phrases de Christian Gailly sont tâtonnantes, voire tatillonnantes – comme l’est la quête de son personnage, assidue, obstinée, aléatoire. Un personnage tantôt narrateur et observateur de lui-même, tantôt protagoniste et observé à la loupe, toujours à la recherche de l’émotion suscitée par l’audition radiophonique du Concerto pour clarinette en la majeur de Mozart (K.622). Mais voilà, « les conditions de l’émotion ne sont pas l’émotion, les conditions de l’émotion ne sont que le décor de l’émotion, et s’il est possible, toujours possible de reproduire le décor extérieur, le décor intérieur, lui, n’est pas reproductible, il change à vue, écrit-il ». L’achat de diverses interprétations enregistrées s’avère infructueux, même s’il procure quelques instants de quasi bonheur, jusqu’au jour de l’annonce d’un concert qui va remplir chaque instant de la vie du personnage et créer l’événement.
La lecture burlesque est possible (de ce burlesque irrésistible, agile et subtilement agaçant que peut procurer, parfois, le son de la clarinette dans les traits mozartiens). Mais K.622 est aussi une série de variations sur des thèmes liés à la quête éprouvante, inassouvie, réitérante (d’un choc musical, d’un costume parfait, de la beauté littéraire, sonore, visuelle) : « Reste l’écriture, la musique, la peinture, la beauté en un mot, la BEAUTÉ, mais que vaut-il mieux ? La chercher ? L’ignorer ? La connaître ou ne pas la connaître ? Meurt-on plus heureux auprès d’elle ? Moins désespéré ? ». Et le chapitre 3, qui tente de traduire en mots les trois mouvements du concerto de « WAM », ou en tout cas les impressions subjectives procurées par son audition, témoigne, en une sorte de condensé du roman, d’un art consommé de l’écriture musicale autant que des limites objectives de la superposition des deux esthétiques, sonore et verbale.
La parole et son commentaire, la musique et ses effets : il y a tout cela. En outre, K.622 est paradoxalement et fondamentalement un roman de l’émotion amoureuse : « Ses yeux ne me laissent pas la regarder en paix, il y a un point blanc dans chaque œil, un reflet qui m’indique qu’une source de lumière est entre nous ». C'est à quoi peut mener la musique de Mozart…
Jean-Pierre Longre
28/03/2011 | Lien permanent
Une interminable chute
 Lyonel Trouillot, Parabole du failli, Actes sud, 2013, Babel, 2016
Lyonel Trouillot, Parabole du failli, Actes sud, 2013, Babel, 2016
Jacques Pedro Lavelanette, dit simplement Pedro, comédien exigeant et marginal, « doué et tourmenté », s’est jeté du douzième étage d’un immeuble alors qu’il se trouvait en tournée en Europe. Issu d’une famille relativement aisée de la société haïtienne, mais ayant choisi la vie miséreuse du petit peuple du quartier Saint-Antoine, spécialiste des « mots des autres », il disait des poèmes aussi bien aux coins des rues que dans les salons mondains, ne manquant pas à l’occasion d’y laisser éclater sa colère de révolté.
C’est donc là, dans ce quartier plein de pauvreté et de chaleur humaine, qu’il partageait la chambre (le « bateau ivre ») de « l’Estropié », professeur de maths exploité, spécialiste des calculs les plus inattendus, et du narrateur, journaliste attaché à la rubrique nécrologique. Leur amitié sans concessions, aux non-dits éloquents, faisait leur force, mais il faut croire que Pedro cachait profondément ses faiblesses sous ses incartades, sous les textes qu’il extirpait des œuvres d’Éluard, de Rimbaud, de Baudelaire, d’Hugo, de Musset, de Verlaine, de Villon et sous les pages poétiques qu’il écrivait en secret et qu’il avait intitulées, comme pour annoncer sa chute, « Parabole du failli ».
Le roman de Lyonel Trouillot n’est pas une simple biographie plus ou moins imaginaire, plus ou moins réaliste. C’est un monde grouillant de personnages – le trio d’amis, certes, mais aussi les enfants de la rue, les camarades artistes ou pseudo artistes, une certaine Madame Armand, prêteuse sur gages et donneuse sans gages, dont la présence s’imposera peu à peu. Tous ont leur histoire, ici racontée ou esquissée, tous composent ce genre humain auquel l’auteur ne manque pas de dire son affection, mais dont il ne se prive pas non plus de faire la satire dès qu’elle est méritée.
Non, ce n’est pas un simple roman. C’est, le temps d’une interminable chute depuis un douzième étage européen, « une virulente adresse au disparu » (comme l’annonce la quatrième de couverture), un long poème en prose et en forme épistolaire, une foisonnante recréation de la réalité individuelle et collective, une tentative désespérée pour forcer le silence du langage, dans le style rebondissant et inimitable que Lyonel Trouillot, mine de rien, définit sous la plume de son journaliste de narrateur : « J’ai parfois envie de laisser courir les mots, d’écrire comme tu parlais, comme les voix de la colère, de suivre le flux des cris qui ne s’arrêtent qu’à épuisement de la voix. À d’autres moments, me vient le rythme calme des paysages dans lesquels chaque chose occupe la place qui convient, attend son tour sans impatience. Le désespoir se moque des normes académiques. Il dérange l’ordre de la phrase et s’oppose aux grammaires progressives. ». L’essentiel est là, même si l’on ressent le besoin d’en dire toujours davantage.
Jean-Pierre Longre
18/08/2016 | Lien permanent
Enfances rêvées, enfances vécues
 Pierre Autin-Grenier, Jours anciens, L’Arbre, 2003.
Pierre Autin-Grenier, Jours anciens, L’Arbre, 2003.
Jours anciens (troisième édition augmentée d’un poème) a fait l’objet d’une parution en 1980, d’une autre en 1986, a reçu le Prix Claude Brossette à Quincié (Beaujolais), et, pour tout dire, est un très beau petit objet livresque, à manier avec un mélange de respect et de familiarité, à consommer avec précautions et sans modération. Tout y est soigné, le contenant et le contenu, le flacon et le nectar.
Le flacon, ou le « gobelet d’argent » (titre de l’un des textes) : vingt-cinq poèmes en prose dans une édition précieuse assurée par Jean Le Mauve, typographe et poète, à qui succède, depuis sa mort, sa compagne Christine Brisset Le Mauve. Vrai papier, vraie reliure, belle couverture, belle mise en page… Recommandons aux auteurs et aux lecteurs pour qui un livre n’est pas qu’un alignement de mots les éditions de l’Arbre, 7, route d’Hameret, 02370 Aizy-Jouy.
Le nectar, ces « jours anciens » vieillis en fût de mémoire et de rêve : vingt-cinq poèmes en prose, disions-nous, où l’enfance et la jeunesse, en générations diverses, d’illusion en réalité, se déclinent sur fond de nostalgie et de vains espoirs de retour. Tableaux colorés, gravures douces, miniatures précises (aussi précises et ondoyantes que les enluminures qui ornent l’initiale de chaque texte). Les lieux et les temps familiers côtoient des scènes plus lointaines, surgies du rêve et de l’histoire, en instantanés d’éternité (d’une éternité pas aussi inutile que l’auteur ne le dira plus tard, puisqu’elle permet de conserver les clichés témoins de l’éphémère). Tableaux colorés, mais aussi sonates et sonatines, musique des mots et des phrases, dans une prose jouée en tonalités mineures et en rythmes impairs.
Il y a un peu des chansons de Verlaine, des révoltes et des jeunes filles de Rimbaud, des alcools d’Apollinaire, il y a surtout Pierre Autin-Grenier avec ses bonheurs et ses tristesses, ses souvenirs personnels ou collectifs, pris à son compte ou à celui des autres, souvenirs d’avant et d’après naissance, d’en-deçà et d’au-delà, de paix et d’avant-guerre, de naguère et de jadis, avec paysages mentaux et tangibles, urbains et naturels, avec tout ce qui donne à un poète le pouvoir de faire vivre et revivre la mémoire de chacun.
Jean-Pierre Longre
02/07/2010 | Lien permanent
Les paradoxes du désenchantement
 Jean-Baptiste Happe, Milieu de gamme, Le Pédalo ivre, 2018
Jean-Baptiste Happe, Milieu de gamme, Le Pédalo ivre, 2018
Il y a dans la poésie de Jean-Baptiste Happe un désenchantement qui, heureusement pour elle (et pour lui, et pour nous), n’atteint pas « les cimes du désespoir » et ne se traduit pas en « syllogismes de l’amertume ». Si jamais comme beaucoup d’autres il pense au suicide, c’est « en amateur » (un peu comme Cioran, il faut le reconnaître), car « le suicide est trop voyant / l’absence devient tout un problème ». Il faut donc en finir avec le suicide, « Vivre un peu con / un peu intelligent / disons content quand même ».
Nous sommes là au cœur du propos : la vie en « milieu de gamme » qu’évoquent le titre et les vers du recueil est celle de tout un chacun, de ceux en tout cas qui, à la différence des « grands écrivains », « ne font pas la queue / avec leur squelette / à l’entrée du Panthéon ». Ce qui n’empêche pas de se voir, par exemple, « les jambes arquées sur un cheval imaginaire », ni de « s’indigner de l’injustice », ni d’aspirer au « silence / du sommet ». Mais l’existence est déroutante, coincée entre le quotidien et le rêve, faite de paradoxes (personnels, collectifs, universels…) qui laissent peut-être entrevoir un « passage / à l’horizon, au-dessus de l’autoroute / […] une sortie une aire une solution ». Mais pas sûr.
Quoi qu’il en soit, il reste la poésie et l’humour, d’autant plus drôle que sa noirceur décoiffe :
« - qu’est-ce qu’on fait de vous ?
demande la coiffeuse
- coupez la tête, je dis
pour plus l’entendre ».
Un peu comme chez Henri Michaux tendance Plume, il reste donc l’autodérision, ainsi que les mots, ceux qui se mélangent à l’envi, familiers ou savants, populaires ou distingués (pour cela il ne faut pas hésiter à « chiner des mots qu’on ne connaît pas »). Oui, il reste la poésie, et celle de Jean-Baptiste Happe (dont il est recommandé de visiter périodiquement le Journal pour goudron, grumes, voix) est de celle qu’on lit avec un sourire complice et qui, sans résoudre les paradoxes du désenchantement, nous rassure quant à l’étrangeté de notre sort et nous donne « la force / de résister au jour ».
Jean-Pierre Longre
17/08/2018 | Lien permanent
Les drôles de ravages de l’amour-propre
 Jean-Jacques Nuel, Journal d’un mégalo, Cactus Inébranlable éditions, 2018
Jean-Jacques Nuel, Journal d’un mégalo, Cactus Inébranlable éditions, 2018
En cinq chapitres, comme cinq étapes d’une vie bien remplie par soi-même, le mégalo dévide ses aphorismes sur tous les tons, dans tous les registres, du premier degré (sait-on jamais ?) au énième, de la gloriole à l’autodérision en passant par l’autosatisfaction apparente ou l’absurde profond. Tout cela, bien sûr, conduit par l’amour des mots. Cet amour-là bien plus que l’amour-propre, d’ailleurs, avec un ludisme savoureux. Par exemple : « Je ne suis ici-bas que de passage, mais vous allez me sentir passer. » ; « Aussi loin qu’il m’en souvienne, j’ai voulu vivre au-dessus des moyens. » ; « À force d’attendre des jours meilleurs, le meilleur des jours est passé. ».
Ne nous leurrons pas. Chez tout écrivain, chez tout artiste, l’ego atteint une certaine dimension. Mais Jean-Jacques Nuel passe le sien au crible de l’humour, de la satire, de l’autobiographie, voire de la philosophie. L’humour ? Il fuse à tous les coins de pages, en général aux dépens du scripteur, jusqu’au bout : « Les rats de bibliothèque seront les derniers à veiller sur mon œuvre. ». La satire ? Surtout celle des personnalités en vogue : « Je signe, sans les lire, toutes les pétitions pour faire circuler mon nom. », ou encore : « Je veux bien soutenir gratuitement toutes les causes humanitaires et caritatives, à condition d’être bien placé sur la photo. ». L’autobiographie (ou passant pour telle) ? « Je n’ai pas d’ami d’enfance, car l’enfance ne fut pas une amie. ». La philosophie ? Celle qui recourt à la logique : « On naît sans expérience de la vie ; on meurt sans expérience de la mort. » ; « La fuite du temps prouve qu’il est coupable. », ou à la phénoménologie : « Fermant les yeux je congédie le monde. » et à l’absurde : « J’ai trouvé le secret de l’immortalité, que j’emporterai dans ma tombe. ». Le jeu des mots confine parfois à la morale pessimiste d’un La Rochefoucauld qui écrirait avec une verdeur d’aujourd’hui : « La convivialité, c’est vivre avec des cons. ».
Arrivé à ce stade, je m’aperçois que ma chronique n’en est pas une ; plutôt un patchwork de citations. Comment faire autrement ? Comment rendre la saveur de ces texticules dont chacun renferme sa propre originalité substantielle et comique ? En guise de conseil au lecteur, suivons pour conclure celui de l’auteur : « Lisez mon livre moins vite, pour faire durer votre plaisir. ».
Jean-Pierre Longre
15/10/2018 | Lien permanent
Le « vouloir-vivre » et le « bien-vivre »
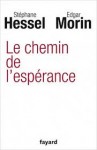 Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, Fayard, 2011
Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, Fayard, 2011
On sait le succès planétaire qu’a connu le petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous !. Un succès non seulement livresque, mais aussi, pour ainsi dire, existentiel et social, puisque les « Indignés » se manifestent un peu partout contre les aberrations du règne de la finance. On leur reproche parfois de ne pas aller au-delà de la contestation, de ne pas proposer de solutions concrètes aux impasses du capitalisme.
Le chemin de l’espérance est, délibérément ou non, une réponse à ces reproches. En moins de 60 pages, Stéphane Hessel et Edgar Morin (dont les essais politiques antérieurs représentent en l’occurrence une solide base de réflexion) proposent une « voie politique de salut public » contre ce « qui nous conduit au désastre » en Europe, dans le monde et, surtout, en France. Les transformations suggérées reposent sur un idéalisme qui n’est pas le contraire du réalisme. La Liberté, l’Égalité, la Fraternité sont à juste titre remises à l’ordre du jour comme soutiens de la nécessaire solidarité, qu’il faut « revitaliser » dans tous les domaines de la société. Cette revitalisation concerne la jeunesse, le travail et l’emploi, l’économie et la consommation, l’éducation, la culture, le fonctionnement de l’État, la démocratie.
Lutter pour un « vouloir-vivre » et un « bien-vivre », ensemble et individuellement, ne pourra se faire « si l’on n’entreprend pas de juguler la pieuvre du capitalisme financier et la barbarie de la purification nationale », ce qui n’ira pas sans des changements radicaux dans l’organisation sociale ni sans un apaisement des tensions et des divisions.
Il ne s’agit pas pour les deux auteurs de « fonder un parti nouveau », mais de régénérer la vie collective et de renouveler la politique. Ce n’est pas une utopie.
Jean-Pierre Longre
04/01/2012 | Lien permanent

