Rechercher : les mots du spectacle en politique
« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »
 Pascal Quignard, Dans ce jardin qu’on aimait, Grasset, 2017, Folio, 2019
Pascal Quignard, Dans ce jardin qu’on aimait, Grasset, 2017, Folio, 2019
Non seulement le révérend Simeon Pease Cheney entendait tout, comme le recommande Dieu dans Matthieu XIII, 9, mais il notait tout : le chant des oiseaux, et aussi « le seau, où la pluie s’égoutte, qui pleure sous la gouttière de zinc, près de la marche en pierre de la cuisine… ». Cette musique est un psaume, de même que « le vent quand il s’engouffre dans le portemanteau du corridor de la cure » est un Te Deum !
L’histoire racontée par Pascal Quignard est celle, réelle, du pasteur Cheney, dont la femme morte en couches trop jeune fait de sa part l’objet d’une passion exclusive, tellement exclusive qu’il chassera de la maison sa fille Rosemund, cause involontaire du décès de sa mère, lorsqu’elle aura dépassé l’âge de celle-ci… Resté seul dans le jardin conjugal, il transcrit indéfiniment les chants d’oiseaux (bien avant Messiaen), les bruits de la vie quotidienne – et c’est ce qui le rend heureux. « C’est cette maison, mon labyrinthe. C’est ce jardin, mon labyrinthe. Ce n’est pas elle, en personne, Eva, ta mère, bien sûr, je ne suis pas fou. Mais ce jardin, c’est elle qui l’a conçu, c’est son visage. […] Dédale de plus en plus beau dans lequel je me perds. […] Dont je me suis mis à noter tous les chants qui s’ébrouent et vivent sur les branches. ».

Pourtant, sa fille apparemment ne lui en tiendra pas rigueur. Revenue chez son père vieillissant, elle l’encourage à faire publier les vastes partitions issues de ses notations ; refus successifs des éditeurs – mais après la mort de son père en 1890, elle édite à compte d’auteur ces Wood Notes Wild que Dvorak, en particulier, prit tellement au sérieux qu’il en tira son Quatuor à cordes n° 12.
 De « cette double histoire », Pascal Quignard a fait non un roman linéaire, mais un récit théâtralisé, une sorte d’oratorio à trois voix : celles du « récitant » (auteur, metteur en scène, pianiste, narrateur…), de Simeon le pasteur, de Rosemund sa fille. Trois voix auxquelles s’ajoute celle, muette et omniprésente, d’Eva la tant aimée, dont l’alliance, comme un « rayon de lumière », ira finalement au doigt de sa fille. Long poème musical et littéraire, Dans ce jardin qu’on aimait se lit, se dit, se joue et se chante en mineur et se termine dans une lumière intense, avec un arc-en-ciel au fond du jardin. On a assisté à un concert original, émouvant et beau.
De « cette double histoire », Pascal Quignard a fait non un roman linéaire, mais un récit théâtralisé, une sorte d’oratorio à trois voix : celles du « récitant » (auteur, metteur en scène, pianiste, narrateur…), de Simeon le pasteur, de Rosemund sa fille. Trois voix auxquelles s’ajoute celle, muette et omniprésente, d’Eva la tant aimée, dont l’alliance, comme un « rayon de lumière », ira finalement au doigt de sa fille. Long poème musical et littéraire, Dans ce jardin qu’on aimait se lit, se dit, se joue et se chante en mineur et se termine dans une lumière intense, avec un arc-en-ciel au fond du jardin. On a assisté à un concert original, émouvant et beau.
Jean-Pierre Longre
05/03/2019 | Lien permanent
Bricoler dans l’essentiel
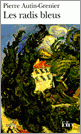 Pierre Autin-Grenier, Les radis bleus, Gallimard, Folio, 2005. Réédition augmentée de 11 inédits et d'une illustration en couverture de Georges Rubel, Les Carnets du Dessert de Lune, 2018
Pierre Autin-Grenier, Les radis bleus, Gallimard, Folio, 2005. Réédition augmentée de 11 inédits et d'une illustration en couverture de Georges Rubel, Les Carnets du Dessert de Lune, 2018
Dans Heinrich von Ofterdingen, le héros de Novalis disait : « C’est la Fleur Bleue que je meurs d’envie de découvrir ». Deux cents ans plus tard, Pierre Autin-Grenier se démarquait de toutes les fleurs bleues de la littérature mais restait dans la note en chantant la quête des « radis bleus », à la fois bien enracinés et si chimériques…
En chantant, et aussi en déchantant. Les joies de la vie – disons les brefs instants de bonheur – se combinent automatiquement avec le malheur (« Il m’arrive parfois – Oh ! rarement ! – d’être heureux. Ce sont alors des instants atroces. »), mais avec un malheur qui « engage à l’énergie », qui « est la matière même de toute création ». Voilà le secret, et le leitmotiv : le poète ne peut être que malheureux ; ou seuls les malheureux peuvent être poètes. Mais si ce n’était que cela, il n’y aurait rien de vraiment nouveau sous le soleil. L’originalité des Radis bleus, ce sont l’écriture, la facture, la tonalité du recueil. Chaque texte, fragment d’un journal qui déroule une année d’intimité, est un poème dense, dont la prose explore et fouille des instants intérieurs et fugaces, minuscules et secrets, qui se surprennent parfois à éclater en tableaux oniriques, fulgurants et fantastiques, découvrant par exemple, comme aurait pu le faire le Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand, « une armée de va-nu-pieds » qui « part pour la guerre ; cent culs-de-jatte qui s’entre-déchirent comme chiffonniers avec une bande de bossus ; des pendus grimaçant au clair de lune cependant que ripaille et rigole autour des gibets la foule des honnêtes gens ».
 Sur tout cela, monde intérieur et extérieur, moi et les autres, plane évidemment le faciès ricanant du temps. Le temps qui « s’étire à n’en plus finir telle une douleur au ventre » et qui « un jour, détachera les chiens », et avec lequel il faut bien se débrouiller : en perdant « efficacement tout notre temps à des riens », ou en triturant le calendrier de façon à retomber sur ses pattes du lundi 17 janvier au dimanche 16 janvier de l’année suivante, ou encore, dans un élan ironique, iconoclaste, filial ou plein d’espoir – c’est selon –, en assortissant la date de chaque jour du nom du saint correspondant… Qui parle du temps parle de la mort : « Tout ce qui est libre et qui chante, un jour tressaute, ricane et meurt ». Qui parle de la mort parle de la solitude : « Ce n’est pas la mort qui est insupportable ; mais plus précisément, de notre prime braiement à l’ultime râle, ces quelques années d’inutile solitude » (inutile comme l’éternité, d’ailleurs). On le voit, dans les moments de désespoir foncier, l’aphorisme se substitue volontiers au poème.
Sur tout cela, monde intérieur et extérieur, moi et les autres, plane évidemment le faciès ricanant du temps. Le temps qui « s’étire à n’en plus finir telle une douleur au ventre » et qui « un jour, détachera les chiens », et avec lequel il faut bien se débrouiller : en perdant « efficacement tout notre temps à des riens », ou en triturant le calendrier de façon à retomber sur ses pattes du lundi 17 janvier au dimanche 16 janvier de l’année suivante, ou encore, dans un élan ironique, iconoclaste, filial ou plein d’espoir – c’est selon –, en assortissant la date de chaque jour du nom du saint correspondant… Qui parle du temps parle de la mort : « Tout ce qui est libre et qui chante, un jour tressaute, ricane et meurt ». Qui parle de la mort parle de la solitude : « Ce n’est pas la mort qui est insupportable ; mais plus précisément, de notre prime braiement à l’ultime râle, ces quelques années d’inutile solitude » (inutile comme l’éternité, d’ailleurs). On le voit, dans les moments de désespoir foncier, l’aphorisme se substitue volontiers au poème.
Serait-ce donc que tout est vain ? Même l’écriture ? On pourrait en effet se laisser persuader que « le poète travaille en pure perte », qu’il n’apporte aucun réconfort, et « qu’écrire de la poésie, à notre époque, ce n’est guère mieux que cracher un tout petit peu dans l’eau ». Et pourtant, le rire et le sourire sont là, frémissants et tapis, pas toujours sarcastiques (telle évocation des quais de Saône et de Louis Guilloux traversant la place Bellecour, tel appel aux cigales pour qu’elles se calment, tel groupe d’enfants jouant à chat perché, tels chants d’oiseaux, tels arbres, telles fleurs, et la couleur bleue qui domine), effaçant fugitivement le pessimisme ambiant, faisant en sorte que le lecteur participe lui-même au poème, car « la poésie – toujours – tient les portes de la vie larges ouvertes ». En « bricolant dans l’essentiel », Pierre Autin-Grenier nous rappelle les grandioses malheurs de la vie et les vrais bonheurs de la lecture, et finalement, il nous les donne bel et bien à goûter, ses fameux radis bleus.
P.A.G. nous a quittés le 12 avril 2014. Merci aux Carnets du Dessert de Lune de l'avoir déniché dans son éternité!
Jean-Pierre Longre
13/12/2018 | Lien permanent
Prisonniers du bonheur
 Margaret Atwood, C’est le cœur qui lâche en dernier. Traduit de l’anglais (Canada) par Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont, 2017, 10/18, 2018
Margaret Atwood, C’est le cœur qui lâche en dernier. Traduit de l’anglais (Canada) par Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont, 2017, 10/18, 2018
Stan et Charmaine font partie des victimes de la crise. Sans ressources, ils sont obligés de vivre dans leur voiture, exposés à la misère et à tous les dangers de la rue. Jusqu’au jour où, attirés par une publicité, ils adhèrent au « Projet Positron », dont le slogan, « Une vie digne de ce nom », ne peut qu’attirer les laissés-pour-compte d’une société en déliquescence. « Consilience », où ils viennent vivre, est une sorte de cité idéale dans laquelle tout le monde a un logement, un travail, de quoi apprécier un bonheur matériel que le monde extérieur de peut plus offrir à chacun. Le principe ? « Tout le monde à Consilience vivra deux vies : prisonnier un mois, gardien ou employé de la ville le mois suivant. Tout le monde aura un Alternant. Les pavillons accueilleront donc quatre personnes au moins : le premier mois, ils seront occupés par les civils, le deuxième mois par les prisonniers du premier mois, qui s’y installeront en endossant le rôle de civils. Et ainsi de suite, mois après mois, à tour de rôle. Qu’ils imaginent les économies réalisées sur le coût de la vie ».
Entre pavillon confortable et prison relativement douce, la vie s’écoule paisiblement ; en apparence du moins, on s’en apercevra au fil des pages. Car le monde Consilience / Positron se révèle davantage comme « Le meilleur des mondes » sauce Aldous Huxley ou comme le 1984 de George Orwell que comme une vraie cité idéale. Et il y a donc les « Alternants », le couple qui occupe le logement lorsque Stan et Charmaine sont en prison, avec qui il est interdit d’avoir le moindre rapport. Mais la découverte d’un billet plus chaud que doux mal caché sous le réfrigérateur va précipiter notre gentil couple obéissant dans une spirale infernale. On découvre alors comment les dirigeants se débarrassent (en douceur) des indésirables, comment les habitants sont surveillés sans relâche (pour leur bien assurément), comment la fermeture complète de la cité empêche tout contact avec l’extérieur, comment le désir sexuel se fabrique à coups d’opérations et de robotisation, comme s’organise un sordide trafic d’organes…
S’ensuivent, sur le mode mi burlesque mi dramatique, des aventures rocambolesques. Fausses morts et fausses funérailles, amours en toc et escort boys déguisés en Elvis Presley agrémentés de simili Marylin Monroe – et voilà Charmaine et Stan, que l’on croyait séparés pour toujours, redevenus visiblement tourtereaux avec l’aide de quelques comparses et de Conor, le frère sans scrupules de Stan. Les péripéties de ce genre pourraient rapidement partir dans tous les sens et perdre le lecteur dans des ramifications sans issue. Mais Margaret Atwood maîtrise tout cela, l’humour noir fuse et la satire politico-sociale va bon train, dans une fable d’anticipation qui, tout bien réfléchi, n’anticipe pas outre mesure.
Jean-Pierre Longre
07/02/2019 | Lien permanent

