Rechercher : les mots du spectacle en politique
Le fabuleux destin de Laurent Mourguet
 Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
La mère de Paul Fournel, lorsqu’il était enfant, lui enjoignait d’arrêter de « faire Guignol ». Sans connaître le personnage, il se doutait qu’il « incarnait tout ce qui turbule, tout ce qui impertine, tout ce qui pique, tout ce qui ricane en souriant. ». Plus tard, intéressé entre autres par le fonctionnement des langues et du langage, il observa ce personnage de plus près, et fit des recherches poussées sur son histoire et celle de ses comparses, Gnafron, la Madelon et les autres. Il en fit même une thèse. Mais rassurez-vous, Faire Guignol (d’ailleurs qualifié de « roman ») n’est pas un pensum universitaire.
C’est au contraire le récit plein de verve, truffé de mots et d’expressions du parler lyonnais, d’une vie exceptionnelle : celle de l’inventeur de Guignol, Laurent Mourguet (1769-1844). Fils de canut, marié tout jeune à l’amoureuse, compréhensive et soucieuse Jeanne, père de famille nombreuse, il a tâté d’un peu tous les métiers pour faire bouillir la marmite. Crocheteur, marchand ambulant, arracheur de dents, il découvre finalement la manipulation des marionnettes, dont Polichinelle et Colombine sont de fameux représentants. De la manipulation à la fabrication, il n’y a qu’un pas : d’un bloc de bois naît un jour Gnafron, le cordonnier porté sur la bouteille ; puis arrive le personnage central, qui donne de l’air à son créateur, et qui vivra longtemps, très longtemps. « Chance et prix de votre patience, vous êtes les premiers à voir Guignol ! Le voici pour la première fois en son castelet, tout jeune et débutant. Mourguet l’a ganté sur sa main gauche, et de la droite il tient Gnafron. Ces deux lascars vont devenir inséparables. C’est juste un essai pour Mourguet, mais c’est un grand jour pour l’histoire du théâtre, et vous y assistez ! ».
 À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
Oui, cela se confirme à la lecture : la vie de Laurent Mourguet est un véritable roman, et l’œuvre qu’il nous a laissée (dont les textes ont été heureusement recueillis – car leur auteur ne savait pas écrire) est trop universelle pour être oubliée, trop vivante pour mourir. Paul Fournel nous en fournit d’ailleurs, ponctués de photos quasiment parlantes, quelques échantillons colorés, engagés et pétulants, tout en rappelant le contexte historique de son élaboration, et en glissant çà et là quelques anecdotes savoureuses, quelques détails bien utiles, comme la naissances des « mères », ces grandes dames de la cuisine lyonnaise (qui ont maintenant leur « parvis » du côté de la Part-Dieu), comme les révoltes des canuts, ou comme l’ouverture en 1836 de la brasserie Georges, « le plus grand restaurant de France ». Et puis à ce propos, n’hésitons pas à accepter ce que Paul Fournel, en fin connaisseur, nous offre : « Enfin, vous allez être récompensés et réchauffés par un bon repas. Il était temps. C’est le prix de votre patience. Lyon est le moyeu d’une roue gourmande qui n’en finit pas de tourner. Au nord les vins de Bourgogne et du Beaujolais, les viandes du Charolais. Ensuite et en tournant vers la droite, les volailles de Bresse, les poissons, écrevisses et grenouilles de la Dombes, les fromages de la Savoie, les noix de Grenoble, les fruits, les légumes, les fromages et les vins de la vallée du Rhône, les châtaignes de l’Ardèche, les saucissons, les jésus, les fromages et la prune de la Haute-Loire, les céréales de la Loire et les salaisons des monts du Lyonnais. La roue tourne et tout descend vers la ville et ses marchés. ».
Bon appétit, bonne lecture, bons spectacles !
Jean-Pierre Longre
10/09/2019 | Lien permanent
L’écriture contre la mort
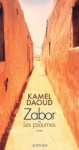 Lire, relire...
Lire, relire...
Kamel Daoud, Zabor ou Les psaumes, Actes Sud, 2017, Babel, 2019
Zabor ou Les psaumes est un livre si dense qu’une fois déverrouillée la lourde porte qui y donne accès on a du mal à en sortir, du mal aussi à en parler, a fortiori à le commenter. Il faudrait en citer des pans entiers pour rendre compte de son style, de sa teneur, de sa portée. Disons ceci : Zabor, presque trente ans, « célibataire et encore vierge » (même s’il porte un amour muet à sa voisine Djemila, répudiée par son mari donc socialement réprouvée), chassé par son père comme un bâtard et recueilli par sa tante Hadjer, compréhensive et aimante, vit en marge de la communauté de son village. Respecté parce que son père est un riche boucher, rejeté par ses demi-frères et moqué par les enfants, il est aussi une figure admirée, parce qu’il sait faire reculer la mort : lorsque quelqu’un en est proche, on fait appel à lui pour écrire au chevet du moribond, remplir un cahier de mots, de phrases, d’histoires dont lui seul a le secret. « Cela dure depuis des années, et j’ai fini par comprendre les règles du jeu, instaurer des rites et des ruses pour aboutir à cette formidable conclusion que ma maîtrise de la langue, cette langue fabriquée par mes soins, est non seulement une aventure mais surtout une obligation éthique. ».
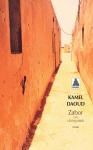 Les trois cents pages du roman tournent autour du récit de l’agonie de son père, Hadj Brahim. Malgré leur animosité, les demi-frères viennent en dernier recours chercher Zabor pour qu’il repousse sa mort. Mission quasiment sacrée : « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l’immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution. ». C’est à la fois sa puissance et son drame.
Les trois cents pages du roman tournent autour du récit de l’agonie de son père, Hadj Brahim. Malgré leur animosité, les demi-frères viennent en dernier recours chercher Zabor pour qu’il repousse sa mort. Mission quasiment sacrée : « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l’immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution. ». C’est à la fois sa puissance et son drame.
Comment ce don lui est-il venu ? Cloîtré dans sa chambre, ne sortant que la nuit, Zabor a déchiffré tous les livres qu’il trouvait dans la langue des anciens colons, le français. « Ce fut toute une aventure que d’apprendre, seul, en cachette, la troisième langue de l’ange, la pièce manquante à la loi de la Nécessité qui allait sauver tant de vies, ajouter mille et un jours à chaque rencontre, dans le secret, humblement, et dans l’art de l’écriture. ». Et plus loin : « Cette langue eut trois effets dans ma vie : elle guérit mes crises, m’initia au sexe et au dévoilement du féminin, et m’offrit le moyen de contourner le village et son étroitesse. C’étaient là les prémices de mon don, qui en fut la conséquence. ». À partir de là, ce sont des centaines de cahiers qu’il emplit de son écriture serrée, qu’il enterre la nuit dans la campagne environnante comme pour en nourrir la terre et les racines des arbres, et qui deviennent une œuvre inépuisable, flot continu faisant une sorte de suite au Coran, à la Bible, aux Mille et une Nuits, et même à Robinson Crusoë, à L'île au trésor ou à La chair de l’orchidée (pour ne citer que les titres les plus importants de son incomparable bagage).
La trame de Zabor propose des cheminements dans le dédale de l’existence, en trois étapes : « Le corps », « La langue », « L’extase ». On pourrait penser aussi : la mort, l’écriture, la vie (ou l’inverse ?). En tout cas, Kamel Daoud offre ici à chaque lecteur une nourriture inépuisable, un chant infini, des « psaumes » aux confins du profane et du sacré.
Jean-Pierre Longre
03/11/2019 | Lien permanent
« Nous sommes simplement de passage »
 Laurine Roux, Une immense sensation de calme, Les éditions du Sonneur, 2018, Folio, 2020. Prix SGDL Révélation 2018
Laurine Roux, Une immense sensation de calme, Les éditions du Sonneur, 2018, Folio, 2020. Prix SGDL Révélation 2018
Sur une terre à la sauvagerie sibérienne vivent tant bien que mal les descendants des rescapés d'une guerre qui n'a laissé que des femmes et quelques enfants devenus des "Invisibles", aveuglés par les gaz toxiques et élevés parmi les ours. Depuis, le "Grand Oubli" avait tenté d'effacer les souvenirs, pourtant restés gravés dans la mémoire des vieilles femmes. C'est dans ce monde que vit la narratrice, jeune fille errante qui, réfugiée chez des pêcheurs, rencontre un jour Igor : « Lorsqu'il descend de la falaise, Igor s'approche de moi. Tout près. Il me regarde sans un mot. Le bleu délavé de ses yeux a l'acuité du métal, mais il est surtout immense, comme si un bout du ciel s'était détaché pour tomber là en deux petites taches rondes et azurées. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, si cet homme me regarde ou voit au-delà, je sens juste mon pouls battre à tout rompre et ma tête se remplir d'un liquide bleuté noyant, au-delà de mes pensées, toute ma personne. ».
 C'est avec lui qu'elle va parcourir le pays jusqu'à ses confins, jusqu'à la mer, jusqu'à comprendre que « le temps n’est qu’une succession d’effondrements à l’infini » et que les humains, passagers de l’histoire ou de la légende, ne font qu’un avec les éléments. À l’intérieur du trajet narratif principal se glissent une série d’aventures qui le soutiennent, qui le nourrissent, histoires vécues ou légendes transmises. Malgré les promesses du « Grand Oubli », le passé ressurgit : la mort de la grand-mère Baba, les épisodes de la guerre qui a créé les « Invisibles », l’histoire de la vieille Grisha et du Dresseur d’ours qu’elle a connu dans sa jeunesse, liée à celle des Tsiganes, de la Tochka et de Tochko… Tout se rejoint dans la tradition des contes merveilleux et cruels, dans lesquels le bonheur et le malheur, la bonté et la méchanceté ne vont pas les uns sans les autres.
C'est avec lui qu'elle va parcourir le pays jusqu'à ses confins, jusqu'à la mer, jusqu'à comprendre que « le temps n’est qu’une succession d’effondrements à l’infini » et que les humains, passagers de l’histoire ou de la légende, ne font qu’un avec les éléments. À l’intérieur du trajet narratif principal se glissent une série d’aventures qui le soutiennent, qui le nourrissent, histoires vécues ou légendes transmises. Malgré les promesses du « Grand Oubli », le passé ressurgit : la mort de la grand-mère Baba, les épisodes de la guerre qui a créé les « Invisibles », l’histoire de la vieille Grisha et du Dresseur d’ours qu’elle a connu dans sa jeunesse, liée à celle des Tsiganes, de la Tochka et de Tochko… Tout se rejoint dans la tradition des contes merveilleux et cruels, dans lesquels le bonheur et le malheur, la bonté et la méchanceté ne vont pas les uns sans les autres.
Inséparable des personnages et de la narration, la présence de la nature, sans laquelle rien ni personne ne vivrait, une nature sublimée par le style âpre, sensuel et poétique de l’auteure : « Un rai de lune perce à travers les volets. Le feu s’est éteint. Tochko ronfle. Dans son sommeil, Igor semble moins agité. […] Nous parcourons la campagne, traversons les forêts, suivons les crêtes marneuses, longeons les rives du lac, et pendant tout ce temps notre vigueur reste en son enfance. Je suis une enfant qui fait l’amour avec Igor, mais aussi avec la forêt, le lac, les hirondelles du printemps, les grives de l’automne, qui se laisse choisir par la jouissance, les bras ouverts et la bouche continûment humide. Je crois pouvoir dire que nous sommes beaux. Chaque seconde explose en fruit gorgé, chaque jour est l’orée d’un commencement. ». Ainsi se construit un monde où se rejoignent le passé et le présent, le réel et le mythe, les tourments et cette « sensation de calme » annoncée par le titre et incarnée par Grisha : « Un instant sa beauté d’antan irradie le masque plissé de la vieillesse. Derrière le cuir et les rides, par-delà l’affaissement, on entraperçoit le visage clair comme l’eau de source, chantant et limpide, de la jeune fille qui s’éveille au désir. ».
Jean-Pierre Longre
13/06/2020 | Lien permanent
Le droit de s’emparer de tout
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Esthétique de l'Oulipo, Le Castor Astral, 2006.

« Existe-t-il une approche oulipienne de l’esthétique ? Une esthétique oulipienne ? Quitte à décevoir, affirmons-le : sous cette formulation brutale, certainement pas. Le groupe est lié par un refus commun, celui du hasard, et non par une quelconque théorie du beau ». Qu’est-ce à dire ? Hervé Le Tellier cultiverait-il le paradoxe gratuit ? La provocation ? Pas vraiment. Il n’y a pas de « beau » oulipien, mais il y a une « création » et une « réception » oulipiennes, qui peuvent être étudiées, et c’est à cette étude que se consacre l’un des piliers actuels de l’Ouvroir de Littérature Potentielle, dans une perspective à la fois vulgarisatrice, scientifique, et tout de même un peu ludique, forcément.
Cinq chapitres qui se succèdent dans un ordre logique (« Fondation et influences », « Univers (et niveaux) « naturels » de complicité », « Immédiatetés culturelles », « Lecteur, encore un effort », « La forme, la contrainte et le monde » (ou « Desseins et dessins », on ne sait pas bien)) convergent vers l’idée d’un oulipisme humaniste : le groupe que fondèrent légitimement Raymond Queneau et François Le Lionnais (avec quelques autres) et qui fonde sa légitimité sur les contraintes formelles serait l’un des ultimes lieux où l’homme trouverait une place, « parce que la potentialité de la littérature est une forme de revanche dérisoire sur celle de l’existence » ; lieu de complicité, « choix de création, ironique et désenchanté ».
Oui. Et comme « l’Oulipo revendique, avec d’autres, le droit des poètes à s’emparer de tout », Le Tellier poète laisse parler Le Tellier poéticien, analyste et théoricien. S’il recense les principaux procédés contraignants de la création oulipienne – des poèmes à forme fixe à l’homophonie (« l’homme aux faux nids ») en passant par le pastiche, la parodie, le contrepet, l’acrostiche, le palindrome, le lipogramme, le « S+7 » et quelques autres manipulations –, il les place dans le contexte général de la création. Et s’il étudie les rapports de l’Oulipo avec le surréalisme, avec les mathématiques, avec l’art, il rappelle que tout cela se situe dans un vaste cadre : celui de la littérature.
Alors, il ne paraît pas inutile qu’il participe aux tentatives de définition et d’évaluation de la littérature ; qu’il rappelle le rôle des mots et de la langue dans la poésie (« il y a chez tout poète cette utopie cratylienne de la langue »), ainsi que la richesse de la multiplicité linguistique (jeux lexicaux et orthographiques à l’appui) ; qu’il développe le concept d’intertextualité afin de montrer comment les textes oulipiens s’inscrivent dans la « généalogie de la littérature »… Et il ne paraît pas hors de propos d’affirmer que cette Esthétique de la littérature, destinée à la fois à faire le point sur 45 ans de vie commune, à replacer cette vie dans le champ littéraire général et à ouvrir des horizons nouveaux, est un ouvrage nécessaire.
Jean-Pierre Longre
01/12/2020 | Lien permanent
Paris-Bucarest-Paris. Journal d’un écrivain
 Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021
Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021
« Au moment même où je suis sur le point de devenir un écrivain professionnel (horribile dictu !), j’ai décidé, par un choix délibéré, de me prêter à cet exhibitionnisme autorisé (et inoffensif) qui est de tenir un journal. C’est pour cette raison que je suis à Paris ! » En 1970, au moment où il écrivait cela, Dumitru Tsepeneag ne savait pas qu’à partir de 1975, déchu de sa nationalité roumaine, il ne pourrait retourner dans son pays qu’après la chute de Ceauşescu. Ce journal, entrecoupé de « notes à la va-vite » datées de 1972, de notes sur un « voyage en Amérique » accompli en 1974, suivi d’un entretien avec Monica Lovinescu intitulé « La condition des intellectuels en Roumanie. Entre censure et corruption » (Radio Free Europe, 30 septembre 1973) et précédé d’une solide préface historico-biographique de Virgil Tanase, court de 1970 à 1978, avec quelques interruptions plus ou moins longues, et il est un vrai journal d’écrivain qui, la trentaine bien sonnée, s’est lancé dans la littérature de fiction.
Car si l’auteur s’adonne çà et là à quelques confidences personnelles (ses relations avec ses parents, son mariage…), c’est le monde intellectuel et artistique qu’il décrit avec beaucoup de précision et de diversité, notamment celui qui concerne les écrivains roumains, exilés ou restés au pays, dissidents ou s’accommodant du régime, notoires ou méconnus. Alors on croise à plusieurs reprises Cioran et Ionesco, Paul Goma (souvent) et Vintilă Horia (un peu), Virgil Tanase et Leonid Dimov, bien d’autres encore. Et aussi les Français Robbe-Grillet et Michel Deguy, le traducteur Alain Paruit, les éditeurs, dont Paul Otchakovsky (qui, devenu P.O.L., publiera les ouvrages de Tsepeneag, dont celui-ci), et encore Roland Barthes, sous la direction duquel il commença une thèse sur Gérard de Nerval. On en passe une multitude, tant ces 600 pages regorgent de rencontres et d’événements qui suscitent récits et réflexions.
Il y a bien sûr ce qui a trait à la situation en Roumanie et à sa dégradation vers plus de censure, d’hypocrisie, d’intimidations, de répression ; ce qui concerne, par extension, la situation internationale et les questions idéologiques (« Confusion des termes ! Quel rapport entre l’Union soviétique et le communisme ? Confusion qu’entretiennent aussi, cela va de soi, et par tous les moyens, les adversaires du communisme. ») ; et les mouvements littéraires, dont l’onirisme, bien sûr (que l’auteur, qui en fut le chef de file avec Dimov, distingue précisément du surréalisme), le nouveau roman et ses théories… Dans tous les cas, Dumitru Tsepeneag affirme nettement sa personnalité et ne mâche pas ses mots, conformément à son habitude (souvenons-nous de ses Frappes chirurgicales) : « Lorsque quelqu’un m’est antipathique, j’ai du mal à changer d’avis. » Même les gens qu’il apprécie sont parfois passés au crible, et cela concerne aussi ses propres écrits, dont ce journal, qui parfois lui pose problème : « À quoi bon ce journal ? Je ne le publierai jamais. Je ne suis même pas sûr de ne pas le détruire un jour ou l’autre. L’idée de me regarder plus tard dans un miroir (déformant) est stupide et je doute que l’envie m’en vienne un jour. D’autant plus que je note des impressions très superficielles, occasionnées par des événements extérieurs. »
Sévère voire injuste avec lui-même, l’auteur a beau dire, son journal est du plus haut intérêt pour toute une série de raisons, dont les conditions et le déroulement de la vie littéraire, collective et individuelle, n’est pas la moindre. Il n’est pas indifférent, loin s’en faut, de savoir par exemple comment sont nés, non sans difficultés, Les Cahiers de l’Est, ou comment se sont élaborés certains romans comme Les Noces nécessaires, Arpièges ou, surtout, Le Mot sablier, où « la langue roumaine s’écoulera dans la langue française comme à travers l’orifice d’un sablier. » Une belle image, qui résume la riche destinée linguistique et littéraire d’un écrivain qui, sans fausse pudeur ni étalage complaisant, montre comment l’exil a été un frein et un moteur de la création littéraire.
Jean-Pierre Longre
31/03/2021 | Lien permanent
« Un art du bonsaï »
 Brèves n° 117, 2020
Brèves n° 117, 2020
Décidément, la revue Brèves, dans un créneau que l’on pourrait considérer comme étroit, a l’art d’ouvrir des horizons littéraires infinis. Le genre de la nouvelle, loin de restreindre la lecture, permet au contraire de solliciter l’imagination en même temps que le sens esthétique et la réflexion. En l’occurrence, ce numéro 117 (rendons-nous compte : 117 numéros, un chiffre qui en dit long sur la ténacité des responsables de la revue…) est consacré à une forme plus que « brève » dont un pays lointain s’est fait une spécialité. La « micronouvelle », si elle est « un genre littéraire universel », est en Chine (et dans la diaspora chinoise) « un art vieux de vingt siècles », qui revêt plusieurs caractéristiques bien définies : la « brièveté » (« moins de 3000 mots »), « une chute finale, un faible nombre de personnages et un épisode narratif, un sens critique aigu de la société, et de l’ironie. »
Tout cela est développé par Grâce Honghuat Poizat, spécialiste de linguistique chinoise et traductrice littéraire, qui présente plusieurs auteurs, des revues, des associations, diverses manifestations, l’ensemble étant illustré par des textes d’écrivains représentatifs des différents tons et orientations de la micronouvelle. Il y a l’humour, l’onirisme, le drame, la poésie, la tradition, la modernité… Et chaque fois, une « chute » inattendue ou mystérieuse (voir, entre autres, celle de « Une rencontre fortuite » de Mo Yan, ou encore celle de « Ordiphage », de CHEN Lijiao).
La deuxième partie du recueil est consacrée à « Un maître du genre », LING Dingnian (né en 1951), auteur « très prolifique », qui « a déjà publié plus de cinq mille histoires dans diverses revues chinoises et étrangères, reprises et traduites en une dizaine de langues », mais jamais en français. C’est chose faite maintenant, puisque nous avons douze micronouvelles choisies, traduites et introduites par François-Karl Gschwend, traducteur du japonais et du chinois. Là encore, de vraies et belles découvertes à faire, dans des textes dont l’auteur excelle à placer la tradition dans le contexte contemporain, voire dans la science-fiction, à mêler la sensibilité à l’érudition, le romantisme au réalisme. Il se permet même de donner une suite à un conte d’Andersen, « Les habits neufs de l’Empereur », où il fait intervenir un détecteur de mensonges venu tout droit des États-Unis… Une grande variété de tons et de thèmes, et toujours l’attente d’une « chute » qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière phrase.
Comme toujours dans Brèves, les textes sont complétés par un beau cahier iconographique – photos d’écrivains, de paysages ruraux et urbains, de groupes humains –, et par une bibliographie ici naturellement consacrée à la nouvelle chinoise. Ce numéro, élaboré avec grand soin (ce qui est habituel, dira-t-on), présenté avec beaucoup de clarté, se lit avec le plaisir de la découverte et de la dégustation gourmande, et avec l’heureux vertige de l’infini, résumé par Grâce Honghuat Poizat : « La micronouvelle est un art du bonsaï. […] Tout comme un grain de sable peur contenir l’éternité, un grain de riz peut embrasser le monde. Le micro et le macro se rejoignent enfin. »
Jean-Pierre Longre
Brèves, 1, rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude
Tél. 04 68 69 50 30 ou 06 28 07 51 81
03/02/2021 | Lien permanent
L’art en mouvement
 Les Carnets d’Eucharis, Sur les routes du monde #3, 2021
Les Carnets d’Eucharis, Sur les routes du monde #3, 2021
Les Carnets d’Eucharis, c’est une belle revue à lire comme voyageait Montaigne, sur des modes divers et par étapes curieuses. Montaigne dont il est question avec d’autres, (Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Flaubert…) sous la plume de Patrick Boccard, Montaigne, l’un des premiers à pratiquer l’écriture « nomadisée » qui forme le thème du premier dossier de ce numéro. « Sur les routes du monde », nous rencontrons Nicolas Bouvier (avec Jean-Marcel Morlat), Lorenzo Postelli (avec Zoé Balthus), Homère, Kerouac, Lacarrière, Tesson etc. (avec P. Boccard), et nous suivons les itinéraires poétiques, descriptifs, narratifs, souvent illustrés, de Nicolas Boldych (à « Rome-en-Médoc »), Jean-Paul Bota (à Lisbonne), Zoé Balthus (au Japon), Jean-Paul Lerouge (en Ouzbékistan) – et nous nous imprégnons des pages que l’on découvre comme les écrivains-voyageurs se sont imprégnés des lieux qu’ils ont explorés.
Un autre dossier, coordonné comme le précédent par Nathalie Riera, est consacré à des « portraits de poètes et d’artistes », après un portfolio consacré à de vivantes « figures de la danse » (instantanés numériques de Zagros Mehrkian sur des chorégraphies d’Estelle Ladoux et Nathalie Riera). Comme entraîné dans ce mouvement, le premier portrait est consacré à Pina Bausch (par N. Riera) ; puis s’avancent Pierre Reverdy (présenté par Alain Fabre-Catalan), Pippo Delbono (par Martine Konorski), Gérard Titus-Carmel (par Claude Darras), Ilse Garnier (par Marianne Simon-Oikawa) et Kathleen Raine (par Martine Konorski). C’est encore de Kathleen Raine qu’il est question dans le premier des entretiens « à claire-voix » qui suivent : Michèle Duclos, sollicitée par Martine Konorski, analyse entre autres la conception de l’art à laquelle tenait l’écrivaine britannique (« L’art est la cité de l’âme ») ; puis c’est Armelle Leclercq qui interroge Camille Loivier, dont un beau poème est reproduit. Plus loin, un autre entretien s’attarde sur « une bibliothèque en mouvement » : celle de Jean-Paul Thibeau qui, questionné par Barbara Bourchenin, s’interroge (comme jadis Georges Perec) sur son « faire-bibliothèque », un espace qui est « une invitation à différentes expériences de lectures, d’écritures », et aussi « un lieu de jubilation, d’effervescence, de jouissance et de créativité. »
 Entretemps, « Au pas du lavoir » (beau programme annonçant la pureté du mouvement) nous aura donné des poèmes de Christophe Lamiot Enos, Irina Bretenstein, Gérard Cartier, Geneviève Liautard, Jennifer Grousselas, Michèle Kupélian, et « ClairVision » des « écrits contemporains sur les arts visuels & audiovisuels » par Richard Skryzak qui s’entretient avec Dominique Pautre (de l’atelier duquel sont montrées des vues colorées), après quoi Carla Lonzi, « critique en dissidence », est présentée par Nathalie Riera. Enfin les poèmes de Naomi Shihab Nye (traduits par Geneviève Liautard) et de Parizia Valduga (traduits par Jean-Charles Vegliante) sont suivis, dans un tranquille et ultime mouvement (« Et banc de feuilles descendant la rivière ») par des notes de lecture sur des parutions récentes de Paolo Rumiz, Adrienne Rich, Paul Stubbs, Martin de la Soudière, Nietzsche et Leonardo Sciascia.
Entretemps, « Au pas du lavoir » (beau programme annonçant la pureté du mouvement) nous aura donné des poèmes de Christophe Lamiot Enos, Irina Bretenstein, Gérard Cartier, Geneviève Liautard, Jennifer Grousselas, Michèle Kupélian, et « ClairVision » des « écrits contemporains sur les arts visuels & audiovisuels » par Richard Skryzak qui s’entretient avec Dominique Pautre (de l’atelier duquel sont montrées des vues colorées), après quoi Carla Lonzi, « critique en dissidence », est présentée par Nathalie Riera. Enfin les poèmes de Naomi Shihab Nye (traduits par Geneviève Liautard) et de Parizia Valduga (traduits par Jean-Charles Vegliante) sont suivis, dans un tranquille et ultime mouvement (« Et banc de feuilles descendant la rivière ») par des notes de lecture sur des parutions récentes de Paolo Rumiz, Adrienne Rich, Paul Stubbs, Martin de la Soudière, Nietzsche et Leonardo Sciascia.
Voyages au fil du temps, des routes et de l’eau, danses des corps et des mots, portraits en action, images vives, rien de ces pages ne peut nous laisser dans l’immobilité de l’indifférence.
Jean-Pierre Longre
07/02/2022 | Lien permanent
Le regard aigu de Queneau
 Raymond Queneau, Allez-y voir, Écrits sur la peinture, édition établie, présentée et annotée par Stéphane Massonet, Gallimard / Les cahiers de la NRF, 2024.
Raymond Queneau, Allez-y voir, Écrits sur la peinture, édition établie, présentée et annotée par Stéphane Massonet, Gallimard / Les cahiers de la NRF, 2024.
Raymond Queneau avait de nombreuses cordes à son arc, et parmi elles la fibre artistique vibrait généreusement. Ses propres œuvres ont été présentées par Dominique Charnay dans un bel ouvrage, Queneau, dessins, gouaches et aquarelles (Buchet-Chastel, 2003) – et n’oublions pas que son fils Jean-Marie fut lui-même peintre, graveur, illustrateur. On peut donc penser que lorsqu’il commente les œuvres des artistes de son temps, il le fait en connaissance de cause. Dans l’avant-propos d’Allez-y-voir, ce livre qui rassemble tous les textes de l’écrivain consacrés aux peintres, graphistes et sculpteurs, Stéphane Massonet analyse le cheminement critique de l’écrivain : « Lorsque Raymond Queneau écrit sur la peinture, il suit l’œil du peintre comme une dialectique du voir et du non-vu. L’œil du peintre est un révélateur. Il montre à l’amateur ce qu’il ne peut voir. » Queneau lui-même l’affirme, à propos de Mario Prassinos : « Si la fonction du peintre est de révéler dans l’univers ce que l’œil commun ne peut y voir et si, mieux même, elle oblige ce monde à se montrer objectivement tel que la sensibilité de l’artiste le transcrit d’avance au moyen de couleurs étalées sur une surface plane, alors Prassinos peut se dire peintre. »
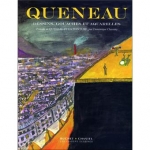 Dans cette perspective (et dans quelques autres), Queneau a ses préférences, ses amitiés aussi : outre Prassinos, Enrico Baj, Jean Hélion, Élie Lascaux, Picasso, Jean Dubuffet et bien sûr Joan Miró. Ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser à Maurice de Vlaminck, à Félix Labisse, à Gala Barbisan, à François Arnal et à quelques autres ; ni même de composer un poème sur « L’atelier de Brancusi », qui « a trouvé refuge dans un musée / mais le sculpteur arpente toujours le pavé »…
Dans cette perspective (et dans quelques autres), Queneau a ses préférences, ses amitiés aussi : outre Prassinos, Enrico Baj, Jean Hélion, Élie Lascaux, Picasso, Jean Dubuffet et bien sûr Joan Miró. Ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser à Maurice de Vlaminck, à Félix Labisse, à Gala Barbisan, à François Arnal et à quelques autres ; ni même de composer un poème sur « L’atelier de Brancusi », qui « a trouvé refuge dans un musée / mais le sculpteur arpente toujours le pavé »…
À quoi reconnaissons-nous l’écriture de Queneau ? À la précision du style, à l’emploi des mots adéquats, à l’originalité des sujets, à la combinaison du rire et du sérieux. C’est par exemple le parallélisme entre « Picabaj et Bacasso », l’un de « Barcelan », l’autre de « Milone », ou la mise en avant, à propos de Massin, de la S.P.A. ou « Société Protectrice de l’Alphabet », ou encore la confusion (jouée) entre Eric von Stroheim et Jean Dubuffet… Ne nous étonnons donc pas de lire, à propos de Baj : « Il équilibre parfaitement le sérieux et l’amusement, j’entends ce qui l’amuse (lui) et ce qu’il estime sérieux, et c’est ce jeu de forces qu’on ne peut expliquer, mais indicible, car c’est dans ce jeu que réside le secret. »
C’est aussi le secret de l’écriture de Queneau lui-même, qui n’hésite pas, parfois, à parler de lui, sans narcissisme et toujours pour aboutir à l’art – par exemple pour évoquer Élie Lascaux, leur amitié et l’œuvre du peintre. L’art, toujours, sous le regard aigu d’un écrivain qui sait reconnaître ce qui se tapit sous les apparences : « Un tableau de Lascaux a cette rare qualité que, se présentant comme la simple pellicule des choses, il conserve précisément toute la profondeur de la réalité : tout est devant nous. » C’est pourquoi, pour Queneau, peinture et poésie fusionnent, comme il l’écrit à propos de Miró (dont il est abondamment question dans le livre) : « La poésie de Miró n’est pas seulement dans cette technique et, si j’ai insisté sur tout cet aspect, explicable et construit, de ses toiles, ce n’est que pour en permettre la lecture. Un poème doit être lu dans sa langue originale : il faut apprendre le miró, et lorsqu’on sait (ou que l’on croit savoir) le miró, alors on peut se mettre à la lecture de ses poèmes. » Le titre est un bel encouragement, et la promesse implicite est tenue : ce livre donne une furieuse envie d’aller voir ou revoir avec des yeux neufs les œuvres dont il y est question.
Jean-Pierre Longre
21/04/2024 | Lien permanent
Une Europe sens dessus dessous
 Laurent Binet, Civilizations, Grasset, 2019, Le livre de poche, 2020
Laurent Binet, Civilizations, Grasset, 2019, Le livre de poche, 2020
Quatre fictions d’inégale longueur mais d’égale intensité jubilatoire composent le livre. « La saga de Freydis Eriksdottir » relate l’expédition que celle-ci (fille d’Erik le Rouge, comme son nom l’indique) fit au Xème siècle depuis le Groenland jusque vers le sud américain, devançant Christophe Colomb, auquel le deuxième épisode est consacré, nous livrant des fragments de son journal, selon lequel on devine que l’explorateur mourut, seul européen rescapé au milieu des indigènes, sur l’île de Cuba : « L’heure approche où mon âme va être rappelée à Dieu, et si je suis sans doute déjà oublié de l’autre côté de la mer Océane, je sais qu’il est au moins une personne qui se soucie encore de l’amiral déchu, et que la petite Higuénamota, qui sera reine un jour, ma dernière consolation ici-bas, sera auprès de moi pour me fermer les yeux. »
 Justement, la petite Higuénamota, on la retrouve adulte dans la troisième partie – le plus gros morceau de cette uchronie épique. À l’inverse de ce que nous ont appris les manuels, les Incas, après une guerre intestine, débarquent en Europe sous la direction d’Atahualpa qui montera sur le trône de Charles Quint, se frottera aux rivalités politiques et religieuses, apportera une forme de sérénité tolérante dans les relations humaines, bref imposera sa vision civilisatrice à un monde de violence et de cruauté tout en assurant un commerce prospère avec son continent d’origine. Un nombre incalculable de péripéties – dont la moindre n’est pas l’arrivée en Europe des « Mexicains » qui investissent le royaume de France – émaillent un récit aux ramifications politiques et internationales complexes, où les unions entre familles européennes et américaines offrent de nobles et fructueux métissages. Un exemple parmi d’autres : Quizquiz, général inca, à qui est dévolu le pouvoir sur une bonne partie de l’Italie, « épousa Catherine de Médicis, qui était la veuve d’Henri, fils de François Ier, laquelle lui donna neuf enfants. »
Justement, la petite Higuénamota, on la retrouve adulte dans la troisième partie – le plus gros morceau de cette uchronie épique. À l’inverse de ce que nous ont appris les manuels, les Incas, après une guerre intestine, débarquent en Europe sous la direction d’Atahualpa qui montera sur le trône de Charles Quint, se frottera aux rivalités politiques et religieuses, apportera une forme de sérénité tolérante dans les relations humaines, bref imposera sa vision civilisatrice à un monde de violence et de cruauté tout en assurant un commerce prospère avec son continent d’origine. Un nombre incalculable de péripéties – dont la moindre n’est pas l’arrivée en Europe des « Mexicains » qui investissent le royaume de France – émaillent un récit aux ramifications politiques et internationales complexes, où les unions entre familles européennes et américaines offrent de nobles et fructueux métissages. Un exemple parmi d’autres : Quizquiz, général inca, à qui est dévolu le pouvoir sur une bonne partie de l’Italie, « épousa Catherine de Médicis, qui était la veuve d’Henri, fils de François Ier, laquelle lui donna neuf enfants. »
Moins complexes mais bien mouvementées aussi, « Les aventures de Cervantès » (quatrième partie) s’insinuent dans l’histoire collective, et l’auteur n’hésite pas à fomenter une belle rencontre, à Bordeaux, entre le futur auteur de Don Quichotte et « Monsieur de Montaigne », qui lui offre l’hospitalité dans sa tour, où les discussions vont bon train et où la femme du Français ne laisse pas l’Espagnol indifférent…
À lire ces résumés, on pourrait croire que l’imagination de Laurent Binet tourne au débridé, voire au farfelu. Il n’en est rien. Tout est maîtrisé, fondé sur une connaissance érudite de l’Histoire et des personnages qui l’ont faite. Allusions, citations, références accrochent la narration à un réel dont on se dit qu’il peut être facilement transformé, renversé par telle péripétie, tel changement de détail. Malicieuse leçon historico-philosophique donc, mais aussi belle leçon littéraire : la succession des genres (récit, correspondance, journal, poésie…) et des tonalités souvent parodiques donne une coloration séduisante à une œuvre à la lecture de laquelle on se prend à penser (outre Cervantès et Montaigne) à Voltaire, à Montesquieu et à bien d’autres plumes du passé. Mais c’est bien du Laurent Binet.
Jean-Pierre Longre
23/09/2020 | Lien permanent
Descente aux Enfers
 Árpád Schilling, Éva Zabezsinszkij, Jour de colère, traduit du hongrois par Petra Körösi, éditions L’espace d’un instant, 2021
Árpád Schilling, Éva Zabezsinszkij, Jour de colère, traduit du hongrois par Petra Körösi, éditions L’espace d’un instant, 2021
« Lève-toi / Et marche ! / Indigne-toi ! / Manifeste pour tes droits ! » Deux infirmières, Niki et Erzsi, manifestent leur colère – ce qui va leur valoir, dans un mouvement ironique de récupération politique, d’être décorées par le ministre en personne. La fierté ne va pas durer, car on s’aperçoit vite que cette médaille n’est qu’un leurre : pas d’augmentation de salaire, suppression du service de néonatologie où travaillait Erzsi, qui se retrouve au chômage et ne va trouver qu’un travail subalterne.
Á partir de là, c’est pour elle la descente aux Enfers provoquée par les « anges » qui l’entourent sous la forme de personnages bien réels : le directeur de l’hôpital, l’ex-mari, le patron escroc etc. Erzsi va se débattre au milieu des difficultés pour tenter d’assurer une vie décente à sa mère Erzsébet et à sa fille Evelin. Elle ne mesure pas ses efforts, et comme lui dit sa mère : « Tu te crèves le cul au boulot pour deux fois rien, et regarde-toi dans une glace comment tu es à quarante ans ! » Pleine de sollicitude pour les autres, elle va connaître, d’étape en étape, de scène et scène, la déchéance et la solitude, jusqu’à la chute.
Il y a la dénonciation politique d’un régime, certes, mais aussi celle du libéralisme sans pitié, qui n’admet pas qu’on ait des états d’âme et qu’on tente d’aider les autres. Une pièce de théâtre engagée, au sens plein et large du terme, percutante, sans grandiloquence et sans concessions. Les couplets de la fin font écho à ceux du début, par exemple : « Remédiez / À la bonté maudite, / À l’épidémie / Des fausses moeurs ! / Détruisez / L’hypocrisie, / L’idole / De la dévotion ! ».
Jean-Pierre Longre
Autre parution aux éditions L’espace d’un instant :
Sarah Fourage, Affronter les ombres
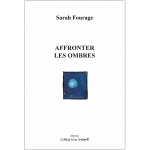 « Dans une petite ville du sud, « aux portes de la Méditerranée », deux femmes se rencontrent sur le parking d’un magasin de bricolage. Quelque chose se tenait là, qui n’y est plus. Une cité tout entière, des logements, des vies, des souvenirs, une mémoire. A-t-on le droit de réveiller un passé hanté par l’horreur de l’Histoire ? Doit-on le taire, tenter de le transmettre ? Librement inspirée de paroles recueillies auprès d’habitants de Lodève, la plupart descendants de harkis, cette fiction théâtrale tente d’évoquer les souvenirs de la Cité de la Gare, où furent logées une soixantaine de familles de harkis en 1962, la création de la Manufacture de la Savonnerie, et l’abandon par la France de ceux qui l’avaient servie. »
« Dans une petite ville du sud, « aux portes de la Méditerranée », deux femmes se rencontrent sur le parking d’un magasin de bricolage. Quelque chose se tenait là, qui n’y est plus. Une cité tout entière, des logements, des vies, des souvenirs, une mémoire. A-t-on le droit de réveiller un passé hanté par l’horreur de l’Histoire ? Doit-on le taire, tenter de le transmettre ? Librement inspirée de paroles recueillies auprès d’habitants de Lodève, la plupart descendants de harkis, cette fiction théâtrale tente d’évoquer les souvenirs de la Cité de la Gare, où furent logées une soixantaine de familles de harkis en 1962, la création de la Manufacture de la Savonnerie, et l’abandon par la France de ceux qui l’avaient servie. »
"Sarah Fourage est née à Nantes en 1975. Comédienne formée à l’Ensatt à Lyon dans les années 2000, elle se met au service d’écritures contemporaines, comme celles d’Emmanuel Darley, Nicoleta Esinencu, Jacques Rebotier… sous la direction de Dag Jeanneret, Véronique Kapoian, Michel Raskine… Dans le même temps elle écrit une quinzaine de pièces dont la plupart ont été commandées et représentées par différentes compagnies, telles que Délit de Façade, La Fédération, Machine Théâtre… Parmi ses thèmes de prédilection, la construction identitaire, l’inégalité sociale, la quête d’émancipation. Elle vit à Montpellier depuis 2005."
01/08/2021 | Lien permanent

