05/11/2025
À la recherche d’une figure perdue
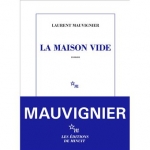 Laurent Mauvignier, La Maison vide, Les éditions de Minuit, 2025
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Les éditions de Minuit, 2025
Prix Goncourt 2025
Marie-Ernestine, l’arrière-grand-mère de l’auteur, était née Proust en 1885. Aucun lien de parenté avec Marcel, mais le vaste roman familial de Laurent Mauvignier est construit sur une recherche, celle de la figure perdue de Marguerite, sa grand-mère, une figure qui a été soigneusement ôtée de toutes les photos familiales, une figure sans doute maudite – on va savoir peu à peu pourquoi, grâce à des investigations qui tiennent à la fois de l’enquête minutieuse et de l’imagination. « Je ne fais que du roman –, mais je crois que si ce que j’écris ici est un monde que je découvre en partie en le rêvant, je ne l’invente pas tout à fait : je le reconstruis pièce à pièce, comme une machine d’un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour et qu’il suffit de le remonter pour qu’il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l’aveugle, en prenant trop de libertés, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens. »
On fait ainsi la connaissance de l’arrière-arrière-grand-père Firmin, propriétaire terrien autoritaire déçu par ses deux fils et mettant tous ses espoirs en sa « petite Boule d’Or », sa fille Marie-Ernestine qui, malgré des dons exceptionnels pour la musique et ses sentiments plus ou moins voilés pour son professeur de piano, devra se résigner à épouser en 1905 Jules, un employé zélé de son père ; le couple héritera ainsi des exploitations agricoles, de la scierie et d’une domination incontestée sur l’ensemble des possessions et du personnel. Après une longue attente, ce sera en 1913 la naissance de Marguerite, qui n’aura pas le temps de connaître son père tué en Argonne en 1916. Marguerite qui, de victime de la concupiscence masculine deviendra celle sur qui tombe le déshonneur familial, Marguerite qui, auparavant, aura découvert des secrets soigneusement celés par sa mère, cette mère qui refusera toujours de jouer du piano pour sa fille – qui l’écoutera en cachette, l’oreille collée contre le plancher…
Car la musique est au cœur de la relation secrète, presque inconsciente, entre la mère et la fille : « La musique lui parle même lorsque sa mère croit s’enfermer et éloigner sa fille, et c’est peut-être même en l’éloignant que sa mère s’approche au plus près de l’intimité de sa fille ; oui, dans l’esprit de l’enfant, la musique vient pour lui dire une parole que sa mère ne peut pas porter par les mots ni par les gestes ; la musique vient jusqu’à elle pour la bercer, la cajoler, la consoler, l’aimer, lui parler, lui murmurer un langage en-deçà des mots ; la douceur et la tendresse maternelle dont sa mère la prive viennent à elle à travers les poutres du grand salon, ils lui traversent le corps lorsqu’elle écoute, allongée sur le parquet, les doigts qui courent sur le clavier et la musique qui monte et imbibe l’air de la maison, et la maison elle-même, dans le corps même de ses murs et de ses fondations. »
Allons plus loin : l’histoire ici évoquée, « dont, écrit l’auteur, je capte seulement l’écho, la vibration dans l’image tremblante d’une fiction et d’un roman possible », est comparable à une symphonie. L’ampleur de la prose, les suspensions et reprises de son rythme, les mystérieuses résonances et harmonies que portent les phrases, tout cela suscite à la lecture l’émotion que provoque une musique profonde. La maison familiale, que la nouvelle génération a redécouverte après une longue période inoccupée, donne certes une impression de vide. Pourtant, au cœur de ce vide, outre les meubles, un « grand corps sombre trône dans la pièce du bas » : le piano, qui est comme un fil conducteur depuis la passion de Marie-Ernestine jusqu’à l’enfance de l’auteur. Pour celui-ci, la quête de la figure perdue de Marguerite… Oui, et pour les lecteurs la découverte d’un grand roman symphonique.
Jean-Pierre Longre
Pour lire des chroniques sur quelques autres livres de Laurent Mauvignier: http://jplongre.hautetfort.com/tag/laurent+mauvignier
11:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/01/2022
Questions d’identité
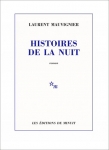 Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021
Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021
La trame de ces Histoires de la nuit a maintes fois été résumée, on ne répétera donc pas ici ce qui a déjà été écrit. Chez Laurent Mauvignier, le souffle de la syntaxe, les circonvolutions du style sont solidaires du récit, et inversement. En l’occurrence, l’intrigue aux apparences simples et aux allures de thriller est soutenue et étoffée par la voix de l’auteur qui laisse volontiers la place, en leur faisant écho, aux points de vue de ses personnages. Patrice le paysan, sa femme Marion au passé énigmatique, Ida leur fillette, Christine leur voisine artiste peintre, tous vivent dans le hameau isolé nommé « L’écart des trois filles seules » (nom mystérieux et légèrement angoissant). On suit chacun dans ses pensées et dans ses occupations d’une journée qui doit s’achever par la fête des quarante ans de Marion, jusqu’à l’irruption de l’inattendu et de l’effrayant, précédée par de mystérieuses lettres anonymes.
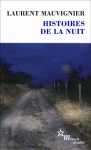 Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »
Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »
D’une manière détournée, voire insidieuse, les terribles aventures vécues par les personnages de Laurent Mauvignier, qui dans les journaux apparaitraient comme un fait divers, voilent et dévoilent l’interrogation que chacun se pose un jour ou l’autre : qui suis-je vraiment ?
Jean-Pierre Longre
09:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2011
« Pas maintenant, pas comme ça »
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, Les éditions de Minuit, 2011
Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, Les éditions de Minuit, 2011
En décembre 2009, des vigiles du supermarché Carrefour de Lyon La Part-Dieu, ayant surpris un jeune homme à voler une canette de bière, se défoulent sur lui jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ces quatre hommes n’en étaient sans doute pas à leurs premières brutalités, mais il n’étaient pas encore allés jusqu’à l’assassinat.
Ce dramatique fait divers a été librement adapté par Laurent Mauvignier, en soixante pages d’un seul élan – une seule phrase suspendue entre un non début et une non fin, entre inspiration et expiration, comme le dernier souffle de l’être qui ne veut pas vraiment y croire et se dit jusqu’au bout : « Pas maintenant, pas comme ça ».
La syntaxe audacieuse, tourmentée, précise, comme toujours chez Mauvignier, forge et nourrit les personnages et les événements, les sensations et la trame narrative. Adressé au frère de la victime, le récit incantatoire dévoile peu à peu ce qu’était la vie (réinventée, transposée) du jeune homme qui ne se doutait pas que, accomplissant l’acte anodin de pénétrer dans un grand magasin, il n’en ressortirait pas vivant ; sa modeste famille, ses piètres amours, ses petits boulots, tout le mène sans en avoir l’air vers la tragédie, qui est aussi celle, en quelque sorte, des quatre bourreaux dont le narrateur se demande « de quelle humiliation ils veulent se venger ».
Tragédie en un acte, en un souffle, Ce que j’appelle oubli prouve que la littérature est apte à mettre en scène la souffrance humaine, honteuse, révoltante, que l’art peut faire vivre intensément la parole toute simple d’un homme de loi : « et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière ».
Jean-Pierre Longre
09:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/08/2010
Méandres et secrets
 Laurent Mauvignier, Seuls, Les éditions de Minuit, 2004
Laurent Mauvignier, Seuls, Les éditions de Minuit, 2004
Pour vraiment parler du roman de Laurent Mauvignier, il faudrait analyser ce qui fait la spécificité de son style. Et pour analyser cette spécificité, il faudrait pouvoir rendre compte des méandres de la syntaxe se heurtant à l’abrupte verticalité d’un mur de silence ou d’un abîme de confusion, pouvoir rendre compte du suspens des phrases, du heurt des mots, bref d’une écriture qui se coule dans le moule de l’émotion obstinée, ressassante et redondante, qui s’y coule le plus entièrement possible, ne laissant pas un recoin vide, permettant au lecteur de pénétrer au plus intime de l’intimité des personnages. Un exemple entre tous :
« Il m’a regardé dans les yeux et il a dit, papa, tu sais ce qu’elle n’a pas deviné, jamais, c’est que, c’est seulement que,
et sa voix tout à coup s’est tue, coupée par une sorte de hoquet et de tic sur la lèvre […] ».
Ce que Tony n’arrive pas à dire, pour l’instant, à son père, et qu’il n’arrivera jamais à dire à Pauline son amie de toujours, c’est qu’il l’aime d’amour, et c’est ce qu’apparemment elle se refuse à comprendre. Étudiants, ils ont habité, bu et mangé ensemble, elle est partie en Amérique, il a arrêté ses études et pris un petit boulot, elle est revenue faire appartement commun avec lui en attendant autre chose, ayant quitté Guillaume son compagnon d’Amérique, et lui, Tony, oscille entre deux désirs contradictoires, dire l’amour et le cacher ; deux désirs qui sont aussi deux peurs : « Il a eu peur de ce regard qu’ils ont partagé et peur aussi qu’elle connaisse ce regard, que cette tension dans le regard Pauline l’ait reconnue comme elle l’avait vue déjà tant de fois sur les visages des hommes au moment où ceux-là vont basculer dans la gravité, quand ils vont parler d’amour et d’engagement, se préparer à offrir des bijoux et cette fidélité à laquelle le plus souvent ils manqueront, par ennui plus que par désir ». L’amour, les mots ne viennent pas pour le dire, les gestes artificiels, les attitudes fausses s’empressent de le cacher.
Á qui, à bout de forces et de grimaces, va-t-il pouvoir se confier ? Á son père, dont pourtant (ou est-ce une bonne raison ?) un contentieux pathétique et secret le sépare. C’est par ce père que nous, lecteurs, connaissons le drame de Tony, drame qui va se précipiter lorsque Pauline, en un accès de joie, va retomber dans les bras de Guillaume venu la retrouver, ultime personnage et ultime narrateur. Et c’est par ce père encore que Pauline va savoir, avec les mots qu’il doit pouvoir trouver.
Ils sont seuls. Tony avec son amour et son mutisme, Pauline avec son amitié et son refus, mais aussi le père avec ses secrets et sa douleur, Guillaume avec sa vie et ses remords, et finalement le lecteur lui-même, sollicité par la présence oppressante des personnages et de leurs énigmes, sollicité aussi par le « c’est moi » des narrateurs, dressant entre lui, le lecteur, et eux, les êtres fictifs, l’épaisseur d’un récit qui pourrait aussi bien être un miroir. Ils sont seuls, de cette solitude envahissante que fait couler en nous le courant irrépressible du soliloque.
Jean-Pierre Longre
http://www.leseditionsdeminuit.com
19:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

