23/09/2025
De la guerre à l’amour
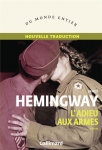 Ernest Hemingway, L’adieu aux armes, nouvelle traduction de l’anglais (États-Unis) et avant-propos par Philippe Jaworski, préface de l’auteur, Gallimard / Du monde entier, décembre 2024.
Ernest Hemingway, L’adieu aux armes, nouvelle traduction de l’anglais (États-Unis) et avant-propos par Philippe Jaworski, préface de l’auteur, Gallimard / Du monde entier, décembre 2024.
Le narrateur, Frederic Henry, est un officier américain engagé comme ambulancier dans l’armée italienne pendant la guerre de 14-18. Au cours de ses missions où, la boisson aidant, il se fait quelques bons compagnons et même quelques fidèles amis, comme le médecin Rinaldi, il rencontre une jeune et belle infirmière anglaise, Catherine Barkley, dont il s’éprend. Amour partagé de plus en plus intensément, surtout lorsque, après avoir été sérieusement blessé au cours d’une bataille sur le front autrichien, il est hospitalisé dans un établissement de Milan où Catherine assure le service de nuit. « Cet été-là, nous passâmes des moments merveilleux. Dès que je pus sortir, nous nous promenions dans le parc. Je me rappelle la voiture, le cheval qui allait au pas, et devant nous le dos du cocher avec son haut-de-forme verni, et Catherine Barkley assise à côté de moi. Il suffisait que nos mains se touchent, un simple effleurement de ma main sur la sienne, pour que nous soyons excités. »
Mais il faut retourner au front et redécouvrir les brutales réalités de la guerre. « Les blessés affluaient au poste, certains portés sur des brancards, d’autres marchaient, d’autres sur le dos de soldats qui arrivaient à travers champs. Ils étaient trempés jusqu’aux os, et tous étaient terrifiés. » À la faveur d’une difficile retraite des Italiens face aux Autrichiens, Frederic déserte avec d’autres et, après maintes péripéties, frôlant plusieurs fois la mort, il va rejoindre Catherine enceinte et mener avec elle « une vie délicieuse. »
D’où vient que ce roman dramatique, achevé aux dires de l’auteur à Paris en 1929 et nouvellement traduit, compte à juste titre au nombre des chefs-d’œuvre de la littérature américaine ? Écrit en une prose sans aucune concession au « beau style » et sans aucun pathos, le récit rapporte les faits tels que les vivent les personnages, en l’absence de tout commentaire ; Philippe Jaworski, le traducteur, l’explique très bien dans son avant-propos : « Des gestes, des sensations, des choses vues, sans nul obstacle entre le lecteur et la créature de fiction. L’écrivain demande au langage un outil sûr pour faire vivre ses personnages avec intensité en dehors de lui, comme s’il ne les connaissait pas, les laissant révéler d’eux-mêmes ce qu’ils veulent, se trahir dans un dialogue, par exemple, ou un monologue intérieur. » On pourrait alors croire à une sécheresse narrative qui émousse l’intérêt. C’est le contraire : le lecteur se laisse entraîner par la prose et n’a de cesse que de passer d’un événement à l’autre, d’un épisode à l’autre, sans s’attarder à autre chose qu’aux personnages et à ce qu’ils vivent, à les accompagner dans leur bonheur et leur malheur, à vivre avec eux dans le roman. C’est ainsi que l’on comprend en quoi Ernest Hemingway, prix Nobel de littérature 1954, est l’un des grands écrivains du XXe siècle.
Jean-Pierre Longre
19:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, ernest hemingway, philippe jaworski, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/09/2025
L’épopée du vulgaire
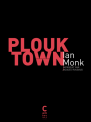
Ian Monk, né en 1960, décédé le 19 septembre 2025...
Ian Monk, Plouk Town, introduction de Jacques Roubaud, Éditions Cambourakis, 2007, rééd. 2011
Au commencement était la contrainte et la contrainte s’est faite verbe et le verbe s’est fait avalanche. Ainsi : Plouk Town est un long texte poétique en onze parties : la première contient un poème (x) d’un vers (x2) d’un mot (x), la seconde deux parties (x) de quatre vers (x2) de deux mots (x), la troisième trois poèmes (x) de neuf vers (x2) de trois mots (x) et ainsi de suite, jusqu’à la dernière partie contenant 11 poèmes de 121 vers de 11 mots… L’avalanche, extension du principe oulipien de « boule de neige », sert donc à l’auteur de contrainte rythmique, et au texte de cadre poétique, à l’intérieur duquel d’autres contraintes (anaphores, rimes et antérimes, recherche de toutes les combinaisons possibles d’un ensemble de 9 mots aboutissant à la composition de 81 vers (99)…) guident le texte.
Soit. Mais l’exercice n’est jamais gratuit. Plouk Town est un ouvrage abouti, qui ne relève pas que de l’expérimental formel, mais aussi et surtout de l’expérience fondamentale du quotidien. Dans la ville en question, les Plouks en question, c’est nous, c’est Monk, c’est tous ceux qui traînent leur cafard quotidien dans un paysage sans horizon. Sans précautions oratoires, en toute lucidité mentale et en toute verdeur lexicale, l’auteur chante en mineur la connerie des gens, les mômes pénibles, les parkings de supermarché, le Quick, l’alcoolisme, la Star Academy, la promiscuité, les appartements crasseux, la clochardisation… Ces scènes de la vie vulgaire sont certes localisées pour la circonstance, mais elles sont de partout : comme partout (à Bombay, Tombouctou, Londres ou New York), « la pauvreté te cogne la gueule à Plouk Town » ; comme partout, on embauche (des vigiles, des surveillants, des tortionnaires, des connards), on a peur, on aime, on se souvient, on pense, on déteste, on tâche de vivre, on est sûr de mourir.
Il y a tout à Plouk Town, et on y ressent tout ce que peuvent ressentir les humains. Il y a tout dans le livre de Ian Monk (après une fort plaisante et fort charpentée préface de Jacques Roubaud), en vers, en morceaux de dialogues, en bribes de monologues, en fragments réalistes, poétiques, comiques, tragiques, épiques. Il y a même des tentatives de réponse à l’angoisse collective et individuelle :
« moi qui vous le dis je m’entraîne
à l’écriture justement mais justement pour sortir
de cette idée de pourriture de ma vie ».
Jean-Pierre Longre
20:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, francophone, ian monk, jacques roubaud, oulipo, Éditions cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/09/2025
Une élégante venue de Rio
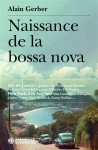 Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Alain Gerber, Naissance de la bossa nova, note de Patrick Frémeaux, postface d’Alain Lesage, Frémeaux & Associés, 2025
Une fois n’est pas coutume, l’auteur de cette chronique avoue n’avoir pratiquement rien connu de la bossa nova avant d’avoir lu le livre d’Alain Gerber. Ou alors ce n’est qu’une impression, tant ce livre lui a ouvert les yeux et les oreilles sur des rythmes et des harmonies qu’il avait en tête sans les identifier formellement. Tout cela pour dire que Naissance de la bossa nova est un titre bien modeste pour un ouvrage d’une érudition qui, certes, ne surprend pas de la part de l’auteur, mais se déploie d’un air si naturel qu’on ne se doute pas de la somme de travail qu’a sûrement nécessité la quantité de références précises qu’il propose.
Il y a la « genèse à Rio de Janeiro », avec les « pères fondateurs » (Vinicius de Moraes, Antônio Carlos « Tom » Jobim, Joấo Gilbert), un certain nombre de chanteurs et chanteuses comme Chico Buarque ou Nara Leấo, et il y a la « jeunesse à New York et ailleurs dans le monde », dont Dizzy Gillespie et Stan Getz sont des figures dominantes, mais non uniques. La première phrase de l’histoire résume un état des lieux implacable : « Grâce à Dizzy Gillespie surtout, le jazz s’est afrocubanisé dans les années 40. Grâce à Stan Getz entre autres, le jazz s’est brésilianisé au début des années 60. » On s’attend donc à apprendre beaucoup de choses au fil des pages, et cette attente n’est pas déçue ! On apprend, par exemple, que l’expression bossa-nova a été utilisée pour la première fois dans une chanson de Mendonça, et d’ailleurs qu’à l’origine les bossas-novas sont essentiellement des chansons avec des paroles qui « leur collent à la peau » ; que la « nonchalance » apparente du genre est loin d’être un « relâchement rythmique », que « des sanitaires ont servi de maternité à la bossa-nova », que la chanson Tu verras chantée par Nicole Croisille et Claude Nougaro est de Chico Buarque (O Que Sera), que Stan Getz a inventé le « Brésil universel », « un pays de nulle part, plein d’ombres et de reflets, de mirages et de réminiscences. »
On le voit, ce n’est pas parce qu’Alain Gerber nous fait partager ses connaissances qu’il abandonne son costume d’écrivain. Même dans un livre historique abondamment documenté, il s’adonne à des considérations bien pensées sur les mystères de « l’invention mélodique », sur la musique codifiée, sur « la science harmonique » qui n’explique pourtant pas « ce qui fait qu’un certain agencement de notes trouvera un écho sur la sensibilité universelle. » Et il ne se prive pas, pour notre plus grand plaisir, de laisser se développer son style ô combien séduisant. Au hasard, un exemple à propos du « L.A. Four » : « Prolifique, professionnel en diable, prodigue en performances instrumentales, délicieux sans conteste, mais aussi, comment dire ?... facultatif, essentiellement distractif. Sans faiblesses et sans reproche. Sans folie et sans nécessité non plus. […] La démagogie n’a pas cours chez les Quatre de Los Angeles. Et la mièvrerie ne pouvait compter sur eux pour s’épanouir : montrer leurs muscles ne fut pas leur préoccupation majeure ; en revanche leur musique en quête de raffinement restait en toute circonstance remarquablement articulée. » Ce ne sont là que quelques lignes parmi de nombreuses non moins prenantes, à la manière de la bossa nova elle-même que, pour changer un peu de plume, Patrick Frémeaux définit en quelques mots dans sa note liminaire : « La bossa nova incarne cette élégance nonchalante qui nous charme immédiatement et qui a vite su conquérir bien au-delà des frontières brésiliennes. » Laissons-nous prendre par cette musique comme par la prose élégante d’Alain Gerber.
Jean-Pierre Longre
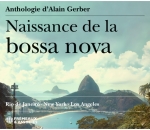 « La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
« La bossa nova est l’une des plus emblématiques des musiques populaires du XXe siècle. En plus d’avoir offert au grand répertoire quelques-uns de ses plus beaux fleurons elle a placé la musique brésilienne sur le devant de la scène internationale. En parallèle à son ouvrage, Alain Gerber sélectionne 45 des œuvres les plus emblématiques des débuts de la bossa nova entre Brésil et États-Unis. Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Johnny Alf, Luiz Bonfá, Carlos Lyra et Baden Powell font échos à Stan Getz, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck et Sonny Rollins. »
Patrick Frémeaux
- CD 1 - RIO DE JANEIRO : HEITOR VILLA-LOBOS : BACHIANA BRASILEIRA N° 5 • DICK FARNEY & LUCIO ALVES : TEREZA DA PRAIA • JOHNNY ALF : RAPAZ DE BEM • ANTÔNIO CARLOS JOBIM & VINÍCIUS DE MORAES : SE TÔDOS FÔSSEM IGUAIS A VOCÊ • LUIZ BONFA : LUZES DO RIO • JOÃO GILBERTO : UM ABRAÇO NO BONFÁ • ELIZETE CARDOSO : OUTRA VEZ • JOÃO GILBERTO : CHEGA DE SAUDADE • DORIVAL CAYMMI : SAMBA DA MINHA TERRA • JOÃO GILBERTO : SAMBA DA MINHA TERRA • TRIO CAMARA : MUITO A VONTADE • JOÃO GILBERTO : HO-BÁ-LÁ-LÁ • ELIZETE CARDOSO : SERENATA DE ADEUS • BADEN POWELL : SAMBA NOVO, PT. 2 • BADEN POWELL : PARA NÂO SOFRER • MAYSA (MATTARAZZO) : O BARQUINHO • SYLVIA TELLES : SE É TARDE ME PERDOA • JOÃO GILBERTO : LOBO BOBO • SYLVIA TELLES : DISCUSSÃO • JOÃO GILBERTO : SAMBA DE UMA NOTA SO • JOÃO GILBERTO : DESAFINADO • SYLVIA TELLES : CORCOVADO • CARLOS LYRA : COISA MAIS LINDA • CARLOS LYRA : MARIA NINGUÉM • OS CARIOCAS : TUDO É BOSSA • SÉRGIO RICARDO : MAXIMA CULPA • ANIBAL SARDINHA “GAROTO” : ALMA BRASILEIRA • OSCAR CASTRO-NEVES : AULA DE MATEMATICA.
CD 2 - (QUELQUE CHOSE SUR L’AMÉRIQUE DU NORD) : CURTIS FULLER : ONE NOTE SAMBA • DAVE BRUBECK : VENTO FRESCO • STAN GETZ & CHARLIE BYRD : É LUXO SÓ • CAL TJADER : SE É TARDE ME PERDOA • SONNY ROLLINS : THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES • DIZZY GILLESPIE : DESAFINADO • BOB BROOKMEYER : CHORA TUA TRISTEZA • STAN GETZ : BIM BOM • ZOOT SIMS : MARIA NINGUEM • QUINCY JONES : BLACK ORPHEUS • DAVE PIKE : PHILUMBA • COLEMAN HAWKINS : UM ABRAÇO NO BONFÁ • IKE QUEBEC : FAVELA • LALO SCHIFRIN : RAPAZ DE BEM • CHARLIE ROUSE : VELHOS TEMPOS • GEORGE SHEARING : MANHA DE CARNAVAL • BUD SHANK : PENSATIVA.
DIRECTION ARTISTIQUE : ALAIN GERBER
09:53 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, alain gerber, patrick frémeaux, alain lesage, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2025
Une entrée en littérature
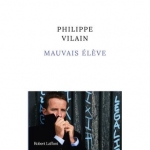 Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
« Mauvais élève », Philippe Vilain le fut toute son enfance, jusqu’à ce que, décidant d’échapper aux horizons limités offerts par le BEP, il découvre la littérature et la philosophie, passe le baccalauréat, puis entame des études de Lettres qui le mèneront jusqu’au doctorat.
Voilà qui est vite résumé, et qui ne ferait pas la matière d’un livre s’il n’y avait pas tout le reste, notamment la rencontre avec Annie Ernaux qui, après un échange de correspondance, s’éprit de lui et le fit entrer dans sa vie. C’est ainsi que, lui-même séduit, il fit avec elle de beaux voyages, côtoya l’aristocratie des Lettres, ne se privant pas d’observer d’un œil acéré ce monde tout nouveau pour lui : « Je savais, grâce à un discernement exercé, saisir la personnalité de chacun, identifier leur appartenance sociale, à leur diction, façon de s’exprimer, posture, manière de se coiffer, de se vêtir, de s’approprier certaines marques ; je pouvais rapidement distinguer les aristocrates, les nobles, les bourgeois, les petits-bourgeois, démasquer les imposteurs, remarquer ceux qui n’appartenaient pas à ces cercles, les opportunistes qui n’y avaient pas grandi mais qui y étaient tolérés, les parvenus qui l’avaient conquis par des relations, mais qu’une assurance surjouée trahissait, tous ceux-là jusqu’aux belles provinciales séductrices mais désargentées qui me souriaient. »
Si sa compagne, bien plus expérimentée que lui, lui fait découvrir ce nouveau monde, elle devient aussi sa maîtresse en écriture ; sous sa houlette, il découvre la « dimension stakhanoviste » d’une tâche « semblable à un travail musical de gammes ou de répétitions », et apprend que « l’écriture demande un investissement sans faille, un apprentissage de l’humilité, une obéissance à une méthode, offrant finalement peu de jubilation, peu de plaisir. » En filigrane, on devine une relation de dominante à dominé, d’aristocrate des Lettres à jeune « plouc » (le mot a été dit) qui, en y réfléchissant, s’aperçoit que celle qui se désigne comme une « transfuge de classe » l’est beaucoup moins que lui : « C’était une erreur de croire que nous avions vécu la même enfance, puisque, en réalité, et heureusement pour elle, elle n’avait pas subi directement la violence et la pauvreté des classes inférieures, des déshérités, elle n’avait pas affronté le licenciement économique de ses parents, les dettes et la saisie immobilière, l’alcoolisme d’un père, l’échec scolaire. »
L’objet principal de Mauvais élève n’est pas tant le récit d’une relation amoureuse initiatrice et hors normes que celui d’une accession à la littérature et à ses dimensions, en même temps qu’une réflexion sur l’écriture elle-même, en particulier sur l’écriture autobiographique, ses « stratégies », ses « distorsions », « la façon dont un écrivain peut transformer son histoire, l’infléchir dans un sens plutôt que dans un autre, instrumentaliser ses expériences par les ruses du genre. » Au-delà des aspects anecdotiques, l’important est là : l’exploration d’une entrée en littérature et la découverte de ses mystères.
Jean-Pierre Longre
21:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, philippe vilain, robert lafont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/09/2025
Hurlement de la vie, épuisement du langage

La publication du Cri du barbeau est l'occasion, pour les éditions Corti, de rééditer La Symphonie du loup, dont la chronique ci-dessous avait été publiée en septembre 2010.
Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 2007
Prix Robert Walser 2008, réédition éditions Corti, 2025
Marius Daniel Popescu est né en Roumanie et vit actuellement à Lausanne. Il s’est fait connaître il y a quelques années par ses Arrêts déplacés, recueil de poèmes où la vie quotidienne se décline en miniatures ciselées avec une amoureuse précision. Il rédige et publie en outre avec régularité Le Persil, journal atypique, inimitable, où fleurissent les mots du quotidien. Marius Daniel Popescu est un poète, et l’important roman qu’il vient de faire paraître en est une preuve supplémentaire.
 Car les 146 sections des 399 pages (soyons précis !) de La Symphonie du loup sont autant de poèmes en prose. Juxtaposition de tableaux, d’instantanés, de scènes représentant les petits et grands faits d’une existence, le texte est un puzzle à la Perec, une tentative d’épuisement du langage par la vie elle-même, qui devrait triompher des mots, les effacer purement et simplement, ces mots ressassés, réitérés, s’étalant sans vergogne sur la page, et qui « ne devraient pas exister » (leitmotiv tout aussi ressassant). Car ils sont de vrais pièges, des pièges à loup : « Tu as appris tôt la duplicité du monde, la duplicité des gens, la duplicité des mots. Tu as appris depuis petit que le même mot peut provoquer ou arrêter une bagarre. Même le mot cerisier, tu savais qu’il est à la fois donneur de vie et meurtrier ». Et encore : « Quand je lis des mots inscrits quelque part, dans des livres de toutes sortes, sur des murs, dans les journaux ou sur les affiches publicitaires, je ne m’approche pas de leur sens avec une envie de recevoir du plaisir. Je ne cherche pas le plaisir dans les mots ». Et plus on approche de la fin, plus les séquences deviennent brèves, réduites au minimum verbal, au squelette narratif, et le puzzle devient multiple, livré au hasard comme une partie de cartes.
Car les 146 sections des 399 pages (soyons précis !) de La Symphonie du loup sont autant de poèmes en prose. Juxtaposition de tableaux, d’instantanés, de scènes représentant les petits et grands faits d’une existence, le texte est un puzzle à la Perec, une tentative d’épuisement du langage par la vie elle-même, qui devrait triompher des mots, les effacer purement et simplement, ces mots ressassés, réitérés, s’étalant sans vergogne sur la page, et qui « ne devraient pas exister » (leitmotiv tout aussi ressassant). Car ils sont de vrais pièges, des pièges à loup : « Tu as appris tôt la duplicité du monde, la duplicité des gens, la duplicité des mots. Tu as appris depuis petit que le même mot peut provoquer ou arrêter une bagarre. Même le mot cerisier, tu savais qu’il est à la fois donneur de vie et meurtrier ». Et encore : « Quand je lis des mots inscrits quelque part, dans des livres de toutes sortes, sur des murs, dans les journaux ou sur les affiches publicitaires, je ne m’approche pas de leur sens avec une envie de recevoir du plaisir. Je ne cherche pas le plaisir dans les mots ». Et plus on approche de la fin, plus les séquences deviennent brèves, réduites au minimum verbal, au squelette narratif, et le puzzle devient multiple, livré au hasard comme une partie de cartes.
En même temps, La Symphonie du loup est un roman au souffle inépuisable, un souffle qui vous transporte entre passé et présent. L’enfant, le jeune homme qui, comme sa famille et ses compagnons, évoluait sous et malgré l’omniprésence de la dictature, est simultanément ce père de famille qui voit agir et fait grandir ses enfants, la « petite » et la « grande », dans son pays d’adoption. « L’école de la vie », qui signifie « tout ce qu’un être humain peut vivre et comprendre et apprendre sur la terre », est ici et là, en un constant va-et-vient entre là et ici. C’est une école qui enseigne tout, y compris la mort : celle du père, qui est au départ de la narration, celle de l’enfant à naître, relatée en des pages hallucinantes d’émotion contenue : « ce monde est fou, nous sommes des fous parmi les fous, je ne veux pas d’un enfant de fou dans un monde de fous ! », dit en pleurant la fiancée qui « souffrait beaucoup à cause de la vie que le parti unique avait instaurée au pays »… Ce « parti unique » est partout, transformant les hommes en « figurants » obligés de répondre « présent ! » alors que pour survivre ils ne peuvent qu’être mentalement ailleurs.
Le souffle du roman, c’est aussi le style, un style qui prend à la gorge. Le style c’est l’homme, a dit quelqu’un il y a quelques siècles ; mais l’homme est un loup pour l’homme, avait dit un autre un peu auparavant ; résultat de l’équation (qu’aurait donné le héros, féru de mathématiques) : le style, c’est le loup, dont le chant, murmuré ou hurlé, ne peut pas laisser indifférent. Roman à la deuxième personne, parole adressée par le grand-père à son petit-fils, La Symphonie du loup utilise le « tu » général, universel, mais le « je » et le « il » sont là, tout près, en embuscade dans le train du récit : « Tu es resté dans ce compartiment un peu plus d’une heure, presque endormi tu avais pensé à toi à la première personne, tu t’es vu à la deuxième personne, tu t’es regardé et tu t’es écouté à la troisième personne comme quelqu’un qui se regarde dans une glace et s’appelle soi-même, alternativement, par « je », par « tu » et par « il » ».
Transparente simplicité des faits, absurde complexité de la vie. Le loup dévore les mots, et cependant il les métamorphose en un chant aux insondables harmoniques et aux interminables échos.
Jean-Pierre Longre
17:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu, josé corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

