30/06/2025
Chute et jubilation
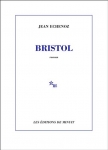 Jean Échenoz, Bristol, Les éditions de minuit, 2025
Jean Échenoz, Bristol, Les éditions de minuit, 2025
Souvenez-vous : dans Vie de Gérard Fulmard, on assistait à la chute de Mike Brant depuis le sixième étage de son immeuble. Voyez maintenant la première phrase du nouveau roman de Jean Échenoz : « Bristol vient de sortir de son immeuble quand le corps d’un homme nu, tombé de haut, s’écrase à huit mètres de lui. » En fait, on ne saura que très tard qui est cet homme, et en vérité ce n’est pas le plus important. Mais une chute initiale dans un roman n’est pas anodine, et on peut se dire qu’elle en préfigure d’autres, surtout lorsqu’on connaît un peu les ruses romanesques de l’auteur. Bristol ? Un réalisateur dont les films n’ont jamais connu un grand succès ; un simple « Clap de bronze » pour l’un d’entre eux, et pour son dernier film, celui dont il est question dans le livre et au tournage africain duquel on assiste, un ratage à peu près complet. La chute de Bristol, en quelque sorte.
Cela dit, le récit ne suit pas un fil continu, loin de là. Méandres, digressions, sauts inattendus d’un épisode à un autre ou d’un personnage à un autre, scènes imprévues comme sait en improviser Bristol au cours du tournage de son film, disparitions et enlèvements… Échenoz promène sans vergogne le lecteur dans la jungle des péripéties, et le lecteur, même si cela lui donne du travail et parfois le tournis, le lecteur, donc, est tout réjoui des surprises que lui réservent la prose de l’auteur et les personnages qu’il a créés. Il y a là, outre le protagoniste, différentes figures qui vont, viennent, disparaissent, réapparaissent : des actrices et acteurs comme Nadia Saint-Clair et Jacky Pasternac, un chauffeur aux divers métiers nommé Brubec, une assistante assez délurée, Marjorie Des Marais, écrivaine à succès qui impose sa protégée Céleste comme actrice dans le film de Bristol, un certain Julien Claveau, drôle de lieutenant de police, un éléphant bien dans son rôle, un commandant Milton Parker à la tête d’une milice armée jusqu’aux dents… Liste non exhaustive, mais visant à donner une idée de l’art de la dénomination (qui va de pair avec l’invention des titres de films), et surtout du bouillonnement narratif (qui va de pair avec la subtilité parodique).
Le bouillonnement narratif en question n’est pas sans s’organiser en mouvements cinématographiques (zooms, gros plans, travellings, panoramiques, plongées ou contreplongées, points de vue variés), avec passages sans transition d’une séquence à l’autre ou, parfois, comme une silhouette fugace en fondu enchaîné, une légère intervention du narrateur (fin d’un chapitre : « Ce qui ne nous arrange pas » ; début du chapitre suivant : « Cela ne fait pas du tout notre affaire… »). Mais le bouillonnement est aussi celui du langage, avec lequel l’auteur joue malicieusement, l’air de rien (« En dépit de toutes les recherches, l’affaire de l’inconnu tombé d’un dernier étage demeure pendante »). Sans parler des aspects ironiques, voire satiriques, de la tonalité. Bref, comme Jean Échenoz nous y a habitués, jamais on ne s’ennuie à la lecture de Bristol. Au contraire, on jubile. À chaque chapitre, à chaque page.
Jean-Pierre Longre
17:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean Échenoz, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/06/2025
Le roman vrai de quatre destinées
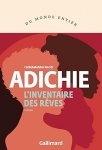 Chimamanda Ngozi Adichie, L’inventaire des rêves, traduit de l’anglais (Nigeria) par Blandine Longre, Gallimard / Du monde entier, 2025
Chimamanda Ngozi Adichie, L’inventaire des rêves, traduit de l’anglais (Nigeria) par Blandine Longre, Gallimard / Du monde entier, 2025
Vers la fin du livre, l’une des protagonistes lance à son interlocutrice : « L’inventaire de tes rêves est incomplet ! » Et quelques pages plus loin : « Quelle conclusion as-tu tirée de l’inventaire de tes rêves ? » C’est à ce moment-là que le titre prend toute sa signification, toute son ampleur, comme un point de convergence de tout ce qui précède – la relation de quatre destinées vécues en fonction des rêves qui y ont présidé.
Quatre femmes, donc, quatre Africaines qui ont en commun, outre les liens familiaux ou amicaux qui les unissent, la volonté d’accomplir leurs rêves, aussi différents soient-ils. Chiamaka, issue d’une riche famille nigériane, tente de satisfaire ses désirs amoureux sans vouloir s’attacher, ainsi que sa soif de voyages en faisant des reportages sur des régions méconnues du globe. On fait la connaissance de son amie Zikora en plein accouchement, elle qui effectivement rêvait mariage et enfants, et qui pourtant ne sera pas entièrement comblée. Omelogor, cousine de Chiamaka, est une femme d’affaires hors pair qui, tout étonnée de devenir millionnaire, va en faire profiter moins chanceux qu’elle : « Tout cet argent pouvait changer de si nombreuses vies. Il pouvait réaliser tant de rêves. » Toutes trois vont être scandalisées lorsque Kiamatou, jeune Guinéenne venue travailler au service de Chiamaka, puis comme femme de chambre dans un grand hôtel de Washington où elle subit une agression sexuelle de la part d’un client aussi célèbre qu’influent, va être déboutée lors du procès sous prétexte qu’elle a menti dans le passé.
Au-delà de leurs différences, les quatre femmes sont animées par des ambitions et des espoirs divers, chacune à sa mesure, chacune selon ses moyens et ses désirs, chacune avec ses tâtonnements, ses déceptions et sa persévérance. Sur fond de confinement dû au Covid et d’exil volontaire, Chimamanda Ngozi Adichie brosse des portraits en action avec un art précis de la description et un sens éprouvé de la narration, une narration tout en va-et-vient temporels et spatiaux, ce qui provoque à la lecture des attentes captivantes.
À propos du personnage de Kadiatou, l’autrice écrit : « L’art a pour objectif d’observer notre monde et d’en être ému, puis de s’engager à essayer de voir clairement ce monde, l’interpréter, le mettre en question. Une sorte de pureté d’intention doit présider à toutes ces formes d’engagement. Ce ne peut être un artifice, il faut que ce soit vrai à un certain niveau. Ce n’est qu’alors que nous pouvons atteindre une réflexion, une illumination et, finalement, espérons-le, une épiphanie. » On peut dire que cet objectif est parfaitement atteint. Les quatre protagonistes sont découvertes à partir de plusieurs points de vue : chacune se raconte elle-même, directement ou indirectement, et chacune est observée par les trois autres, ce qui en révèle d’autres facettes. Au lecteur, saisi par les épisodes ici rapportés, de reconstituer le puzzle présenté en plus de 600 pages. Ainsi comprendra-t-il l’humanité vraie, profondément vraie, de ces héroïnes de fiction en quête de soi, de l’amitié, de l’amour, et d’une place dans le monde. Un beau programme, développé avec brio par une romancière accomplie.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, nigeria, chimamanda ngozi adichie, blandine longre, gallimard | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/06/2025
Du songe et du théâtre
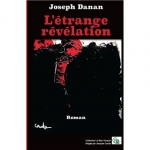 Joseph Danan, L’étrange révélation, éditions Douro, coll. Bleu Turquin, 2025
Joseph Danan, L’étrange révélation, éditions Douro, coll. Bleu Turquin, 2025
« À la fin de L’Illusion comique, […] Alcandre, sortant de sa coulisse comme un lapin de la manche d’un magicien, révèle que tout était théâtre. On aimerait bien. Ou que la vie soit un songe. Variante, d’ailleurs, plus plausible. Se réveiller et que, dans le ciel d’azur de nos enfances, une voix autorisée nous révèle, soulagés, que cette traversée insensée, au bout d’une nuit zébrée d’éclairs, n’était qu’un mauvais rêve. » Nous sommes là presque à la fin du livre, quasiment proches de cette « étrange révélation » que nous promet le titre. Disons que tout ce qui précède semble y converger.
Car avant que tout finisse (d’une manière provisoirement définitive), tout commence par le cauchemar que chacun fait parfois : se retrouver en dehors de chez soi, porte close, sans clefs, en peignoir de bain, obligé de circuler ainsi dans les rues pour, en l’occurrence, se rendre à un mariage. Pourquoi ? Parce qu’on a sorti inopportunément et prémonitoirement les poubelles : « Les ordures déboulèrent dans le conduit métallique… » Tiens ! Les premiers mots de Loin de Rueil de Raymond Queneau. Quelque chose à voir ? Oui : l’imbrication du rêve et du spectacle ; chez Queneau, le cinéma, ici, le théâtre, bien sûr – Joseph Danan étant avant tout un homme de théâtre.
Nous voilà embarqués avec le narrateur (qui aurait pu avoir une vie tranquille avec sa femme et ses enfants), de visions cauchemardesques en rencontres improbables, souvent accompagnés (le narrateur et nous) d’un homme-lapin débrouillard nommé Alfredo, péripéties dédaléennes dans lesquelles l’Université (bien connue de l’auteur) joue le rôle de lieu récurrent, avec son Président, ses étudiants et étudiantes (surtout) et ses drôles de programmes, telle « la nouvelle licence professionnelle des métiers du sexe et du soin relaxant (LPMSSR) »… Réapparaissent parfois Nora, l’épouse, et ses enfants, soit virtuellement (textos, messages téléphoniques), soit physiquement, mais c’est aussitôt pour une nouvelle séparation, bateau manqué ou porte encore fermée… Et parfois notre narrateur tente de faire le point : « La Route de l’Échec s’ouvre dans son évidence. Tandis qu’elle dévide son ruban dans la nuit trouée de la lumière des phares, c’est ma vie qui défile entre les platanes, sur les lambeaux déchirés du ciel. Tout ce qui aura été inaccompli remonte de l’abîme. Les rencontres avortées. Les promesses non tenues. Les livres non écrits. La vie non vécue. Tous ces cauchemars, comme celui de la veille au soir, en dépit du havre d’un souper et d’un sourire, qui ne le rendait que plus cruel, ces nuits perdues, ces voyages immémoriaux, ces pérégrinations sans fin. »
Terrible « sortie du labyrinthe » à prévoir. Heureusement, il y a tout le reste. Le suspense, certes, mais aussi les allusions, les références artistiques (littéraires, musicales…), les souvenirs de l’enfance, et l’humour, comique de situation et manipulations du langage, satire bienvenue et franches plaisanteries… Nous ne sommes pas loin du « pleurire » de Queneau (encore lui), et nous voilà saisis pour un bon moment par le plaisir de la lecture.
Jean-Pierre Longre
22:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, joseph danan, éditions douro, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2025
« Une histoire en cours »
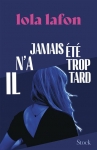 Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
Lola Lafon, Il n’a jamais été trop tard, Stock, 2025
C’est une série de chroniques mensuelles publiées entre fin 2023 et fin 2024 dans Libération, augmentées de plusieurs « P.-S. » prolongeant la réflexion. « Ces notes sont une matière, des couleurs et des textures, des humeurs disparates, un puzzle qui ne révèle aucun paysage connu. À quoi servent-elles, ces notes ? À rien de précis, les mots ne « servent » pas, ils ne sont pas à notre service. Ils se prêtent à nos tentatives. » Modestie de bon aloi, modestie véritable, excessive peut-être. Car ce « rien de précis » permet tout de même à l’esprit du lecteur d’élargir l’horizon de sa réflexion sur des sujets divers.
Il peut s’agir de l’amateurisme, qui « est ce que nous pratiquons le mieux, en toutes choses », car être amateur, c’est aimer ; cela à propos par exemple de la « pratique amateure de la maternité », occupation à plein temps. Ou encore de la « course à la haine » venant de l’extrême-gauche et de l’extrême-droite, alors qu’il faudrait pratiquer la « bienveillance pour ses semblables » et cultiver la perplexité plutôt que la certitude. Ou de l’évocation de la famille paternelle de l’autrice, « exterminée pendant la Shoah », résurgence et perte de la mémoire liées. Et aussi, dans l’actualité proche, du « procès de Mazan » et de ce que cette affaire révèle de terrifiant : « Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs peuvent apparemment être n’importe quel homme. »
Et de beaucoup de choses encore, révoltes ou doutes, incompréhensions ou lucides constatations, aberrations de notre civilisation ou confiance en l’humain… Et comme un rappel de la qualité d’écrivaine de Lola Lafon, le rôle joué par les mots, leur puissance qui est mise à mal lorsqu’ils sont transformés en instruments de pouvoir (« Les mots se dressent face à nous. Ils ne parlent plus, ils communiquent, ordonnent, réduits à menacer, à sanctionner un doigt d’honneur, une poêle à frire ou du sérum physiologique dans un sac à main. ») ou d’invectives (« Les mots seront sommés de décliner leur identité : de quel côté penchent-ils ? On sera renvoyée à son origine, à sa condition. Hashtag juive. Hashtag femme. Hashtag trop de gauche. Hashtag pas assez. »). Malgré tout, c’est eux, les mots, qui permettent de décliner toutes les nuances de la pensée, qui permettent de vagabonder dans l’imaginaire, de raconter « l’histoire en cours », celle qui fait avancer le monde. C’est tout cela que ce beau livre nous révèle.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, chroniques, francophone, lola lafon, stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/06/2025
Finalement on s’y retrouve, délicieusement
 François Salmon, Merci pour la tendresse, Asmodée Edern, 2024
François Salmon, Merci pour la tendresse, Asmodée Edern, 2024
Au bout de quelques pages, les questions commencent à fuser dans l’esprit du lecteur : que peuvent avoir à faire ensemble Érik Satie (qui a vraiment existé, comme on le sait) et une certaine Minique Brouillard (personnage de fiction, comme on s’en doute), une chanson d’Anne Sylvestre (belle et connue) et les histoires (belles et méconnues) qu’un certain Martin Laroche raconte à sa petite-fille Jeanne, la foudroyante apparition de Suzanne Valadon dans la vie de Satie et la disparition de l’étrange Sylwia, épouse de Lambert Laroche et mère de Jeanne, une épaisse et mystérieuse enveloppe que Minique reçoit dans sa boîte aux lettres et la piscine de Tournai…? Arrêtons ici l’énumération, car le futur lecteur risque de se dire que voilà un livre bien embrouillé, d’autant que l’auteur en personne n’hésite pas à relever la sauce en glissant son grain de sel parmi les ingrédients romanesques.
Arrêtons donc l’énumération, pour simplement dire que cet apparent désordre (comparable à celui que le grand-père de Jeanne entretient dans son appartement) procure une délicieuse lecture exploratoire, dans une alternance de faits avérés et d’événements inventés, de personnes réelles et de personnages fictifs, de lieux identifiés et de pays imaginaires. On apprend à connaître presque intimement Érik Satie dans sa relation brève mais passionnée avec Suzanne Valadon, musique et peinture en fusion ; par ailleurs on suit les tribulations de la famille Lambert et de Minique Brouillard, infirmière dévouée mais bien seule dans la vie, qui ne laisse pas de nous intéresser et de faire notre admiration ; et on se laisse entraîner dans les belles histoires racontées à Jeanne par son grand-père, puis par celle-là à celui-ci…
Finalement, ce que prévoit l’auteur va se réaliser : « Je l’admets : tout cela doit sembler bordélique. Qu’est-ce que c’est que ces notes sur Satie qui déboulent de nulle part alors que rien n’a encore vraiment commencé ! Et cette enveloppe de papier kraft qui n’en finit pas de ne pas tomber ! […] Je fais de mon mieux. Je prends les choses comme elles viennent, un peu dans le désordre c’est vrai, mais tout devrait s’organiser plus tard. Enfin, c’est l’idée… » Effectivement tout s’organise dans un roman malicieux, didactique, plein de péripéties, de personnages attachants, de musique, de drames, de sourires, d’humour et, comme l’annoncent le titre ainsi que, rythmant le récit, la chanson Les gens qui doutent, de tendresse.
Jean-Pierre Longre
22:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, belgique, françois salmon, asmodée edern, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2025
Un voyage insolite et nécessaire
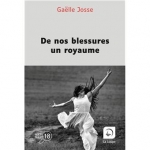 Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet-Chastel, 2025
Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet-Chastel, 2025
Après la dernière représentation, Agnès a décidé de « s’effacer », de quitter ses danseurs qu’elle a menés jusqu’au succès public, ses danseurs qu’elle appelle « mes estropiés, mes esquintés magnifiques, mes abîmés ». Elle qui a perdu Guillaume, son grand amour emporté par la maladie, elle part sur les traces des itinéraires qu’ils ont suivis ou voulu suivre ensemble, des villes visitées ou espérées. De Nice à Milan, de Milan à Trieste, de Trieste à Zagreb, un périple au gré des transports en bus et des hébergements hasardeux, avec « l’essentiel » dans son sac, le Livre : « En dépit de ses quelques centaines de grammes, à peine, il est lourd à porter. Trop lourd. Je le connais par cœur, page après page, il fait partie de moi, que je le veuille ou non. »
Car ce livre, le dernier que Guillaume a lu et s’est fait lire par Agnès, elle voudrait en faire une ultime preuve d’amour en le déposant dans un lieu dédié qui se trouve à Zagreb. Intitulé Quelques Éden, lettres à ma fille, ce vrai-faux roman est composé des lettres que Julien Lancelle adresse à sa fille Emma, née « différente », et qui ne connaît le bonheur que dehors, devant les fleurs et les arbres. Alors le récit qu’Agnès fait de son voyage et de ses souvenirs alterne avec les pages pleines d’amour et de délicatesse du père d’Emma.
Ne nous méprenons pas : ce double roman est entièrement de Gaëlle Josse, qui sait comme personne saisir en mots mûrement choisis et en phrases soigneusement composées les méandres de la sensibilité, la légèreté des instants heureux et le poids des moments désespérés. Sa narration s’adresse autant à Agnès et à son amour disparu qu’à la jeune Emma. Les mouvements de sa prose suivent de près ceux des corps et des cœurs fragiles, leur redonnent le goût de vivre, et il n’est pas indifférent que sa protagoniste-narratrice soit elle-même danseuse. En témoigne l’ultime scène, aussi fascinante pour les lecteurs que pour les passants qui y assistent, une scène tout en mouvements, en rythmes et en sonorités : « Elle danse les larmes et les caresses, les nuits d’insomnie et les jours heureux, elle a dansé les printemps qui reviennent, les nuages qui filent, les neiges dans le cœur des femmes et des hommes, elle danse la terre martyrisée et les cœurs épuisés, elle danse l’espérance et la chute, les voix qui se sont tues et celles qui vont chanter, elle danse ce qu’elle attend et qu’elle ignore. » Un roman ? Certes. Mais aussi un hymne à l’amour, à l’art, aux livres, à la danse… Comme un long poème à l’insolite beauté.
Jean-Pierre Longre
23:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, buchet-chastel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/06/2025
Mère coupable ?
Lire, relire... Laura Kasischke, Esprit d’hiver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet, Christian Bourgois éditeur, 2013, Le Livre de Poche, 2014, Folio, 2025
 Laura Kasischke enseigne l’art du roman, et cela se voit. Elle maîtrise à la perfection les techniques de la narration, les méthodes de construction d’une intrigue, en tenant compte des exigences du genre et en composant avec les contraintes qu’elle s’impose à elle-même.
Laura Kasischke enseigne l’art du roman, et cela se voit. Elle maîtrise à la perfection les techniques de la narration, les méthodes de construction d’une intrigue, en tenant compte des exigences du genre et en composant avec les contraintes qu’elle s’impose à elle-même.
Esprit d’hiver est un huis clos à suspense psychologique respectant les règles non seulement du roman, mais aussi de la tragédie classique : unité de temps (un seul jour, et pas n’importe lequel : celui de Noël) ; unité de lieu (l’intérieur chaleureux de la maison familiale, alors qu’au dehors sévit une tempête de neige) ; unité d’action (la dégradation des relations entre une mère aimante, Holly, et sa fille adoptive, Tatiana). Avec cela, 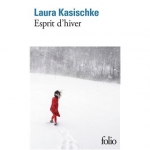 comme au théâtre, des échappées hors scène, dans le temps et dans l’espace, sous la forme d’images entêtantes : l’orphelinat de Sibérie où Holly et son mari Eric sont allés chercher leur petite fille, treize ans auparavant ; la ville et ses alentours, où la circulation est devenue périlleuse à cause du blizzard, et d’autres circonstances mystérieuses et déstabilisantes.
comme au théâtre, des échappées hors scène, dans le temps et dans l’espace, sous la forme d’images entêtantes : l’orphelinat de Sibérie où Holly et son mari Eric sont allés chercher leur petite fille, treize ans auparavant ; la ville et ses alentours, où la circulation est devenue périlleuse à cause du blizzard, et d’autres circonstances mystérieuses et déstabilisantes.
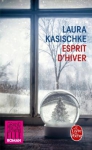 Après une longue phase introductive où, comme pour rassurer tout le monde, se bousculent les clichés américains traditionnels (préparation d’une belle fête de Noël avec famille et amis – désirés ou non –, maison accueillante et foyer aimant), et où seules quelques allusions, s’insinuant comme par hasard, annoncent insensiblement la suite (maladies congénitales et stérilité, ainsi qu’un refrain qui trotte dans l’esprit maternel : « Quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusque chez eux ? »), l’angoisse éclate, au sens quasiment littéral du verbe, en des scènes et des réminiscences dont les liens laissent peu à peu percer la vérité, cette vérité qui était restée enfouie au plus profond de l’esprit de Holly, et dont le lecteur prend conscience en même temps que le personnage. Glaçant.
Après une longue phase introductive où, comme pour rassurer tout le monde, se bousculent les clichés américains traditionnels (préparation d’une belle fête de Noël avec famille et amis – désirés ou non –, maison accueillante et foyer aimant), et où seules quelques allusions, s’insinuant comme par hasard, annoncent insensiblement la suite (maladies congénitales et stérilité, ainsi qu’un refrain qui trotte dans l’esprit maternel : « Quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusque chez eux ? »), l’angoisse éclate, au sens quasiment littéral du verbe, en des scènes et des réminiscences dont les liens laissent peu à peu percer la vérité, cette vérité qui était restée enfouie au plus profond de l’esprit de Holly, et dont le lecteur prend conscience en même temps que le personnage. Glaçant.
Jean-Pierre Longre
www.christianbourgois-editeur.com
11:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, laura kasischke, aurélie tronchet, christian bourgois éditeur, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/06/2025
Mais que savons-nous des « coutumes de la Terre » ?
 Ilarie Voronca, Souvenirs de la planète Terre, préface de Nicolas Cavaillès, Arfuyen, 2025
Ilarie Voronca, Souvenirs de la planète Terre, préface de Nicolas Cavaillès, Arfuyen, 2025
Né Eduard Marcus à Brăila, Ilarie Voronca (1903-1946) fait partie de ces artistes d’avant-garde qui, venus de Roumanie, ont enrichi la culture française de leur inventivité intellectuelle et esthétique, de leurs idées et de leurs œuvres ; on connaît sans doute mieux Tzara ou Fondane, mais Voronca a nourri la littérature d’une particulière modernité, et Souvenirs de la planète Terre, sorte de « testament littéraire » de l’inventeur de l’ « intégralisme », en témoigne singulièrement. Avec cet ouvrage, l’écrivain « offre une expérience littéraire unique, un dépassement des plus sombres constats dans une fausse naïveté conceptuelle et hallucinée qui à chaque page apporte de nouvelles formules merveilleuses », écrit Nicolas Cavaillès.
Le protagoniste du roman, Yves (un prénom manifestement issu des initiales de l’auteur), se voit comme « un voyageur venu d’une planète ou de quelque univers inconnu » et découvre notre monde en une vision qui rebat fondamentalement les cartes : les végétaux plus puissants que les hommes, ou ceux-ci aux ordres des animaux, qui, comme les ânes, sont capables de discuter poésie entre eux ; ou encore les machines (par exemple les moissonneuses-batteuses) à l’origine de la création de l’homme (y compris de son âme)… Yves, peu à peu, fait des découvertes étonnantes et angoissantes sur le monde et la société, sur l’injustice qui fixe les « hommes-vis » à des places dont ils ne peuvent s’extirper, sur l’absurdité de l’existence, sur la vanité humaine (« Tout cela est à démolir », semble-t-il en conclure) ; mais tout n’est pas perdu : « La machine bonne et affable se tiendra aux côtés de l’homme. Elle fera un avec l’homme. Et Yves eut la vision d’un nouveau centaure, d’une nouvelle mythologie. L’homme accouplé à la machine. » Vision en tout cas moins pessimiste qu’une prophétie précédente, pourtant vérifiée : « Ce sont les nouvelles machines qui poussent jusqu’à la dernière limite l’esclavage de l’homme et n’hésitent devant aucun obstacle pour satisfaire leurs caprices. »
Ce qui précède n’est qu’un des angles de lecture possibles. Écrivain de l’absurde, Ilarie Voronca se situe dans lignée de Lautréamont, Urmuz, Raymond Roussel et quelques autres inventeurs de l’absolu. Poète, aussi, et ce roman en porte la marque. Quelques exemples ? À propos des plantes : « Ô pacifiques reines, régnant sur la vie et sur la mort et dont les seules armes sont vos parfums et vos couleurs ! » ; à propos des batteuses : « Ce sont de grands oiseaux migrateurs qui font leur nid pendant les mois de soleil parmi les céréales » ; à propos de la nuit urbaine : « Oh, calme majesté des avenues sous la lune ! Jardins baignés d’une musique qui se déverse d’entre les cordes des arbres dont chacun porte une étoile comme une sourdine. » Et ce bel alexandrin concluant l’un des poèmes insérés dans la prose : « Mes os seront pareils aux herbes arrachées. » Absurde et poésie font aussi bon ménage avec un humour cachant plus ou moins bien l’angoisse, comme dans cette maxime : « Les hommes ne sont des hommes que parce qu’ils croient être des hommes. », ou dans la découverte d’une cruelle anthropophagie : « Yves s’aperçut que les maisons mangeaient. […] Plus elles étaient vieilles, plus elles tombaient en ruines, plus il leur fallait d’hommes, de femmes et d’enfants à mastiquer. »
Souvenirs de la planète Terre est une livre « intégral » où, par le truchement de la limpidité de la prose et du vertige de la poésie, se mêlent l’espoir et le désespoir, l’humour et la soif d’absolu, le mysticisme et la satire, la générosité et la dérision. La formule de Nicolas Cavaillès est parlante : Ilarie Voronca est un « Voyant inquiet », et c’est sans doute l’inquiétude qui l’a emporté.
Jean-Pierre Longre
18:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, ilarie voronca, nicolas cavaillès, arfuyen, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

