28/10/2025
Du sang et des livres
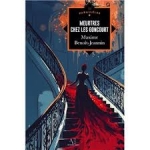 Maxime Benoît-Jeannin, Meurtres chez les Goncourt, Asmodée Edern, 2025
Maxime Benoît-Jeannin, Meurtres chez les Goncourt, Asmodée Edern, 2025
Il se passe des choses bizarres et dramatiques dans l’immeuble où habitent Edmond et Jules de Goncourt. Certes, la soirée promet d’être passionnante, réjouissante et fournie : dans l’appartement des fameux duettistes littéraires, vont se réunir quelques personnalités de l’époque : l’imposant Gustave Flaubert, Théophile Gautier avec femme et enfants, une comédienne à succès (pas seulement théâtral), quelques autres invités appartenant au monde du théâtre et du spectacle, et Léonce Jacquelain, un jeune auteur venu de Gand présenter son premier roman, La Passagère de la Méduse, dont Flaubert va faire une lecture « gueulée ». Cette lecture occupe tout ce monde, et aussi une part non négligeable du livre : une mise en abyme, un roman dans le roman, doublant l’intrigue.
Car de l’intrigue, il y en a… Le meurtre sanglant de la voisine de palier des Goncourt, une « très belle jeune femme exerçant le très antique métier qui console les hommes solitaires ou mariés, et parfois les hommes de lettres » – ce qui multiplie les suspects aux yeux du commissaire de quartier, un certain Fenouil, venu enquêter et soupçonner un peu tout le monde. On n’en restera pas là : le comte Dusseuil (on reste dans les éléments immobiliers…), qui habite au-dessus des Goncourt et dont l’épouse, comme par hasard, est la maîtresse de Jules, trouve la mort dans des circonstances compromettantes, qui pourront être cachées grâce à l’arrivée inopinée d’un peintre bohème et de son singe…
Autant dire que se multiplient des péripéties dans lesquelles mort violente et littérature, sans parler de quelques scènes dans lesquelles la sensualité se déploie sans vergogne, s’emboîtent avec beaucoup de vivacité, et souvent d'humour. Meurtres chez les Goncourt est un roman multiple, à lire comme un vrai « thriller littéraire ».
Jean-Pierre Longre
23:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maxime benoît-jeannin, asmodée edern, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/10/2025
Enquête sur un échec à répétition
 Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Bernard Cerquiglini, À qui la faute ?, « L’impossible (mais nécessaire) réforme de l’orthographe », Folio, 2025
Chacun s’est un jour posé des questions sur certaines anomalies de l’orthographe française : pourquoi écrire au pluriel des bijoux et des filous, des chevaux et des landaus, pourquoi dangereux fait-il dangereuse au féminin, ou pourquoi chanceler donne-t-il « il chancelle », mais modeler « il modèle » ? On pourrait multiplier les exemples dans lesquels interviennent non le souci étymologique, mais le hasard des graphies médiévales, voire plus tardives. Et qu’en est-il de la transcription de l’oral ? Eh bien, on constate que par exemple « la consonne /s/ s’écrit s, ss, t, c, ç » ; que « la voyelle nasale /in/ se rend par in, im, ain, aim, ein, yn, ym, etc. » Ne faudrait-il pas réformer tout cela ?
Oui, depuis le XVIe siècle jusqu’à notre époque, on ne compte pas les grammairiens, linguistes, enseignants, écrivains qui se sont lancés « à l’assaut de la forteresse orthographique », et qui ont subi un échec tantôt discret, tantôt retentissant. Bernard Cerquiglini, qui fut officiellement de la partie, mais qui, en bon oulipien, sait combiner le sérieux (universitaire) et le détachement (humoristique), sans négliger la discrète provocation, s’adonne dans ce bref mais dense volume à une enquête minutieuse sur cet échec maintes fois répété.
« À qui la faute ? » Le substantif du titre rappelle en filigrane que l’erreur orthographique connote « une idée de péché », tant les conventions d’écriture semblent revêtues d’un caractère sacré. Qui sont donc les responsables de l’impossibilité de réformer l’orthographe ? L’auteur les répartit en cinq catégories, sous la forme interrogative. Les « cuistres » ? Ce sont les pédants, « latinisants besogneux et souvent responsables d’un étymologisme inopportun », mais qui ne sont pas complètement étrangers aux progrès linguistiques. L’Académie française ? Chargée de « dire le droit en matière graphique », elle aménage la norme au long des siècles et des livraisons du dictionnaire. Jules Ferry ? « Lire, écrire, compter », telle est la mission de l’école, et les deux premières injonctions mettent en avant une graphie figée, donnant le pouvoir à ceux qui maîtrisent l’orthographe, mais aussi faisant surgir, aux alentours de 1900, un « camp de la réforme » qui se manifestera jusqu’aux « Rectifications orthographiques » de 1990, que pratiquement personne n’applique… Les réformateurs ? Depuis Louis Meigret et son « Traité » publié en 1550, les tentatives de simplification tendant à harmoniser l’écriture et la prononciation et à supprimer les anomalies évoquées au début de cette chronique ont été nombreuses, et parfois si excessives qu’elles ont suscité au pire de violentes réactions, au mieux l’indifférence. Charlemagne ? Nous remontons alors aux sources d’une langue française marquée par la « créolité », un mélange complexe d’idiomes qui font sa richesse et sa singularité, une complexité qui, selon l’auteur, demanderait malgré tout une rénovation bien comprise. Sera-t-elle possible ? En tout cas, Bernard Cerquiglini nous incite, sans pédantisme mais avec la science du spécialiste et le savoir-faire du pédagogue, à réfléchir sur le passé et le présent d’une langue qui doit assurer son avenir.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, bernard cerquiglini, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/10/2025
« Mourir à vingt ans pour la liberté »
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, Gallimard, 2024, Folio, 2025
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le nom sur le mur, Gallimard, 2024, Folio, 2025
Comme souvent, c’est le hasard qui fut le déclencheur. La suite est le fait de l’auteur et de son héros. Celui-ci, dont le nom fut découvert sur le mur de la maison qu’Hervé Le Tellier venait d’acheter dans la Drôme, est au nombre des jeunes gens qui décidèrent de combattre l’envahisseur nazi, et qui en moururent. André Chaix, né en 1924, a été tué en août 1944 à Grignan avec plusieurs de ses camarades par des mitrailleurs allemands, et enterré à Montmeyran, où il est né, après avoir vécu à La Paillette, près de Dieulefit.
Les quelques éléments recueillis – photos, témoignages, documents – permettent à Hervé Le Tellier de reconstituer par bribes (des « poussières », écrit-il) l’histoire du jeune homme, son enfance, sa jeunesse d’apprenti aux « Céramiques de Dieulefit », son amour pour Simone, son engagement dans les FTP. Même si, parfois, l’imagination se permet quelques libertés, ce livre n’est pas un roman, et les éléments biographiques sont assortis de retours sur le passé collectif : « L’Histoire est forcément là, puisqu’André en fut à la fois acteur, héros et victime. » Nous pouvons alors apprendre ou réapprendre, par exemple, la signification des abréviations désignant les mouvements de résistance (FTP, FFI et maints autres), avoir des précisions sur le rôle majeur joué par Dieulefit, comme par le Chambon-sur-Lignon, pendant l’occupation, sur le Maquis Morvan, sur certains épisodes de la guerre et sur les blindés de la IIe Panzerdivision (ceux qui ont tué André), ou sur ces anciens nazis français qui participèrent à la fondation du FN (devenu Rassemblement National)… Les rappels factuels fondent aussi des réflexions sur le nazisme, sur le phénomène de la « soumission à l’autorité, la pression des pairs » qui « fabriquent à la chaîne des tueurs sans états d’âme. »
 Face à cela, l’humain : l’amour d’André pour Simone, avec les photos et les mots, émouvants et parfois quasiment prémonitoires, qui le confirment (« Première photo avec toi ma chérie qui seras toujours pour moi la douce et pure Simone de mes amours. Avec toi nous parcourrons la vie dure parfois mais rien ne nous séparera à part la mort. Mes doux baisers. Ton Dédé de toujours. »), un amour qui entraîne quelques confidences de l’auteur lui-même ; l’évocation du fameux livre Le Tour de France de deux enfants, dont André gardait précieusement une page qui « raconte comment le savoir peut dompter la peur » ; une autre évocation, celle d’amis anciens de l’OULIPO (dont Hervé Le Tellier est le président), Italo Calvino, qui fut lui aussi maquisard de son côté, François Le Lionnais, qui fut déporté au camp de Dora, auquel je (l’auteur de cette chronique) ne peux penser sans une forte émotion, puisque mon oncle maternel Pierre Penel, résistant sous le nom de Marceau, y fut déporté après avoir été arrêté et torturé à Lyon, et y mourut à 22 ans, en janvier 1945 ; une rue de Saint-Genis Laval porte son nom, qui est aussi gravé sur une stèle du cimetière de Peyrus, village de la Drôme d’où la famille de Pierre (la mienne, donc) est originaire et où il allait souvent voir ses grands-parents, non loin du Montmeyran d’André… Deux destinées dont la proximité est trop flagrante pour ne pas être signalée…
Face à cela, l’humain : l’amour d’André pour Simone, avec les photos et les mots, émouvants et parfois quasiment prémonitoires, qui le confirment (« Première photo avec toi ma chérie qui seras toujours pour moi la douce et pure Simone de mes amours. Avec toi nous parcourrons la vie dure parfois mais rien ne nous séparera à part la mort. Mes doux baisers. Ton Dédé de toujours. »), un amour qui entraîne quelques confidences de l’auteur lui-même ; l’évocation du fameux livre Le Tour de France de deux enfants, dont André gardait précieusement une page qui « raconte comment le savoir peut dompter la peur » ; une autre évocation, celle d’amis anciens de l’OULIPO (dont Hervé Le Tellier est le président), Italo Calvino, qui fut lui aussi maquisard de son côté, François Le Lionnais, qui fut déporté au camp de Dora, auquel je (l’auteur de cette chronique) ne peux penser sans une forte émotion, puisque mon oncle maternel Pierre Penel, résistant sous le nom de Marceau, y fut déporté après avoir été arrêté et torturé à Lyon, et y mourut à 22 ans, en janvier 1945 ; une rue de Saint-Genis Laval porte son nom, qui est aussi gravé sur une stèle du cimetière de Peyrus, village de la Drôme d’où la famille de Pierre (la mienne, donc) est originaire et où il allait souvent voir ses grands-parents, non loin du Montmeyran d’André… Deux destinées dont la proximité est trop flagrante pour ne pas être signalée…
Trêve de confidences familiales… Je finirai, sans autre commentaire, par un paragraphe essentiel du livre : « L’année 2024 est celle du centenaire de la naissance d’André Chaix, et quatre-vingts années ont passé depuis sa mort. Mais à regarder le monde tel qu’il va, je ne doute pas qu’il faille toujours parler de l’Occupation, de la collaboration et du fascisme, du racisme et du rejet de l’autre jusqu’à sa destruction. Alors, je n’ai pas voulu que ce livre évite le monstre contre lequel André Chaix s’est battu, ne donne pas la parole aux idéaux pour lesquels il est mort et ne questionne pas notre nature profonde, notre désir d’appartenir à plus grand que nous, qui conduit au meilleur et au pire. »
Jean-Pierre Longre
11:38 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, biographie, hervé le tellier, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Pâtes italiennes
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Roman épistolaire, roman culinaire, roman oulipien, roman à tiroirs, roman d’investigation… Maintes caractéristiques génériques pourraient qualifier le dernier livre d’Hervé Le Tellier, qui se situe ici dans la droite (mais complexe) lignée des initiateurs de l’OuLiPo. Il y aurait à ajouter, aux limites du romanesque : la fiction autobiographique, l’érudition historique et artistique, la poésie italienne (et anglaise ou irlandaise), les jeux de l’amour (où le hasard, finalement, n’aura pas voix au chapitre), les malices intertextuelles, de Dante à Calvino et Roubaud.
 On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
Voilà le début, et on ne poursuivra pas le résumé ; car à partir de là, l’entrecroisement épistolaire, ponctué d’extraits du « Carnet de l’auteur » et de narrations culinaires, mène le lecteur, comme le narrateur, dans un labyrinthe de faux-semblants (vraisemblables au demeurant), de chemins de traverse, de jeux de piste, d’embûches intellectuelles et sentimentales. Qui dit vrai, qui ment ? Qui est le voleur, qui le volé ? Les « Caro Giovanni », « Cher Monsieur d’Arezzo », « Cher Giovanni », « Giovanni mio », « Carissimo Giovanni », les congratulations et remerciements mutuels sont des formules qui occultent à peine une guerre à pointes de moins en moins mouchetées où l’on n’hésite pas à se dérober des histoires personnelles, des souvenirs, des amours anciennes, des confidences, la « nostalgie » qu’évoque le titre.
Tout cela est un jeu ? En quelque sorte : jeu de l’arroseur arrosé, du piégeur piégé, du bourreau victime… Mais jeu qui, comme dans tout bon roman forgé à l’aune d’une construction rigoureusement préméditée (on ne peut manquer de penser, du côté épistolaire, aux Liaisons dangereuses, et du côté oulipien, à La vie mode d’emploi), engage une ou des existences à part entière ; celles des personnages, et celle du lecteur qui se laisse lui-même prendre au piège et ne peut s’empêcher de deviner que, sous ce qu’il a cursivement saisi, bien d’autres choses se tapissent dans les profondeurs dantesques de l’humaine comédie.
Jean-Pierre Longre
11:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/10/2025
La poésie des insomnies
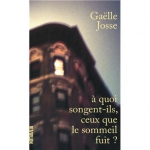 Lire, relire... Gaëlle Josse, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?, Les éditions Noir sur blanc / Notabilia, 2024, J'ai lu, 2025
Lire, relire... Gaëlle Josse, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?, Les éditions Noir sur blanc / Notabilia, 2024, J'ai lu, 2025
Chacun a son histoire, ses histoires, et la nuit est propice à faire surgir ces « quelques éclats [qui] demeurent au milieu des heures profondes, en veille. » Oui, « c’est l’heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l’attente. Ce sont les heures où le cœur tremble, où les corps se souviennent, peau à peau avec la nuit. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. » Alors Gaëlle Josse, qui sait si bien s’y prendre avec les mots intimes, évoque ces heures de veille qui sont des heures de manques, de chagrins, de pleurs parfois, mais aussi de joies discrètes et d’espoir serein.
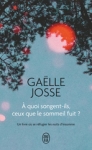 Ils sont là, ces hommes et ces femmes qui attendent une arrivée, un retour, qui pleurent un être cher, qui guettent des silhouettes entrevues, qui savent que la mort va arriver, ou qui ne savent pas ce qu’il va se passer, qui ont décidé d’aller chercher le bonheur ailleurs, ou de rompre, ou de renouer, ou tout simplement de vivre en se disant « que, parfois, tout est bien. »
Ils sont là, ces hommes et ces femmes qui attendent une arrivée, un retour, qui pleurent un être cher, qui guettent des silhouettes entrevues, qui savent que la mort va arriver, ou qui ne savent pas ce qu’il va se passer, qui ont décidé d’aller chercher le bonheur ailleurs, ou de rompre, ou de renouer, ou tout simplement de vivre en se disant « que, parfois, tout est bien. »
Ces brèves séquences, ces instantanés nocturnes se succèdent au rythme lent des émotions, comme des élégies, comme de délicates mélodies. On connaît la prédilection de Gaëlle Josse pour l’art, en particulier pour la musique, évoquée ici à plusieurs reprises : le « monde infini et clos » de l’aria des Variations Goldberg, le « dernier concert » d’un pianiste qui sent la virtuosité lui échapper… Mais la musique s’épanouit surtout dans la prose poétique d’une autrice qui cultive la nuance et l’harmonie, une harmonie dont la continuité est assurée par les brèves transitions entre les différentes séquences ; une ligne, deux lignes à peine comme des portées musicales, « la nuit amère, la nuit comme un gouffre, la nuit consolation », « la nuit colère, la nuit repos, la nuit ouverte, la nuit refuge », « la nuit où tombent les masques »… La tonique et son complément ici multiple, la dominante…
Et puis, parmi toutes ces « microfictions », il y en a une qui penche vers l’aveu autobiographique, qui se nourrit de l’expérience de l’écriture nocturne, qui en dit tout en quelques lignes, et par lequel on terminera cette chronique : « Parfois l’écriture l’emmène au bord du vide et la retient là, sur cette frontière, puis au dernier moment elle la sauve de l’effroi, de la tiédeur, du demi-jour et des colères tristes. Elle poursuit son travail obscur de sourcière. »
Jean-Pierre Longre
www.leseditionsnoirsurblanc.fr/catalogue-collection/notab...
08:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, poésie, francophone, gaëlle josse, les éditions noir sur blanc notabilia, jean-pierre longre, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

