28/02/2025
Suspense chez les témoins protégés
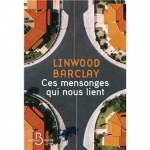 Linwood Barclay, Ces mensonges qui nous lient, traduit de l’anglais (Canada) par Renaud Morin, Belfond, 2025
Linwood Barclay, Ces mensonges qui nous lient, traduit de l’anglais (Canada) par Renaud Morin, Belfond, 2025
Jack se souvient et raconte : son père est parti un jour, définitivement semble-t-il, en lui disant : « Ton papa a tué des gens. » On apprend plus tard qu’il est allé vivre sous une nouvelle identité en tant que témoin protégé, car il a été à la solde d’un homme d’affaires véreux qui le chargeait des sales besognes – intimidations, menaces et meurtres – et aux foudres duquel il cherche à échapper.
Devenu écrivain au succès mitigé et cherchant à gagner sa vie en collaborant à des revues plutôt confidentielles, Jack est contacté par une certaine Gwen, U.S. Marshall s’occupant justement et comme par hasard de ces ex-criminels relevant du statut de témoins protégés, qui lui propose d’écrire contre bonne rémunération de fausses biographies de ces derniers afin de parfaire leur nouvelle personnalité en rapport avec leur nouvelle identité. Jack accepte un premier travail, non sans se poser des questions : « On ne m’avait pas donné beaucoup de grain à moudre. Mon premier sujet, d’après ce que m’avait dit Gwen, était de sexe masculin, blanc, et âgé de quarante ans. Par où commencer ? Quel genre d’existence voulais-je lui créer ? J’ignorais complètement ce qu’il avait fait jusqu’à maintenant – était-il boucher, boulanger, fabricant de bougies ? Et si, par hasard, l’histoire que je lui inventais était trop proche de son véritable passé ? Non, cela semblait improbable. »
Difficile de raconter la suite sans déflorer le suspense entretenu avec grande habileté par Linwood Barclay. Disons simplement que Jack a une petite amie journaliste qui va être impliquée de près dans le déroulement des événements, que l’U.S. Marshall Gwen et ses acolytes réservent des surprises de taille, que les victimes ne sont pas seulement celles du père de Jack, qui soit dit en passant n’a pas disparu pour toujours, que l’écrivain se retrouve avec deux pères, que l’on apprend à connaître le passé et le destin d’un certain nombre de personnages plus ou moins recommandables…
Thriller, roman d’action aux multiples rebondissements, récit à suspense, Ces mensonges qui nous lient est un bel et bon roman noir, qui ne se contente pas de relater une succession de faits inattendus et d’actions violentes. C’est aussi une captivante galerie de personnages qui, derrière leurs profils plus ou moins avérés de « bons » ou de « méchants », recèlent une épaisseur sociologique et psychologique qui les rend véritablement humains. Un vrai roman, donc, au sens plein du terme.
Jean-Pierre Longre
Linwood Barclay sera présent aux « Quais du Polar » à Lyon du 4 au 6 avril 2025: https://quaisdupolar.com/#latest-posts
21:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, thriller, anglophone, linwood barclay, renaud morin, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/02/2025
De l’art du balayage en musique
 Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Il y a un an (janvier 2024), Alain Gerber nous gratifiait d’une belle et indispensable « autobiographie de la batterie de jazz » (voir ici) en nous racontant l’histoire de Deux petits bouts de bois, de l’art desquels il est à la fois expert et pratiquant éclairé. Maintenant, il célèbre les « balayeurs célestes du jazz avec Shelly Manne en point de comparaison », ce grand « Sheldon Manne [qui] fut un des batteurs les plus « littéraires » de l’histoire de l’instrument : un homme recherchant en permanence l’équilibre instable, mais jamais perdu, entre les différentes valeurs des éléments mis en jeu, entre les nuances dynamiques, entre les couleurs sonores, entre les couleurs du temps , entre la distension et la contraction du temps qui passe, l’instinct de vie et son contraire. »
Affirmons-le sans réserve, nul mieux qu’Alain Gerber ne sait lier l’expérience personnelle et le savoir encyclopédique. Ici comme ailleurs, il commence par évoquer un souvenir, celui de l’acquisition de sa première batterie : caisse claire, baguettes, mailloches et… balais. « Depuis cette époque, je porte un amour fou à l’art des balais, ainsi qu’à ceux qui l’ont inventé de toutes pièces et fait évoluer de manière spectaculaire depuis la fin des années vingt ; si dévorante est cette passion qu’elle s’étend aux instruments eux-mêmes. » Et depuis la même époque, il a tout appris des « brosses », de leur pratique et de leurs virtuoses, et il nous en fait tout connaître.
N'oublions pas qu’Alain Gerber est un écrivain, l’un de ceux qui, sans jamais se hausser du col, font partie de l’élite des stylistes, et son érudition musicale ne l’empêche pas de nous faire profiter de sa pratique littéraire, en nous livrant par exemple « une réflexion au passage : en littérature, j’ai toujours penché en faveur des écrivains soucieux d’entretenir une pulsation dans leurs périodes, leurs paragraphes, leurs chapitres. Et d’abord dans chacune de leurs phrases. » Pour lui « c’est affaire de métrique », de « ponctuation » et, « métaphoriquement cette fois, d’accentuation et de nuances dynamiques. » Ou encore de considérations à la fois larges et acérées : « L’un des signes très sûrs de décivilisation est le renoncement massif à l’ironie au profit de la croyance. Il s’agit ici de l’ironie à usage interne et de la croyance sans condition, telle la capitulation du même nom. Je n’ai jamais eu l’âme d’un inconditionnel, et cela ne s’est pas arrangé avec le temps. Le statut de groupie n’aura exercé sur moi qu’une timide attirance. » Un dernier extrait, en guise d’encouragements : « Quels que soient votre âge, votre sexe, votre expérience et votre culture, votre morphologie, vos capacités physiques, votre bagage technique, votre projet esthétique, soyez assuré qu’il existe, ou qu’il existera, la paire de balais la mieux adaptée à votre personnalité. Celle qui va répondre à vos besoins comme si elle avait parié sur vous pour justifier son existence. » Voilà qui donne vie à une paire d’objets apparemment bien anodins mais ô combien précieux. Martine Palmé, agent des plus grands, l’a écrit : ce livre est un « véritable trésor. »
Jean-Pierre Longre
Une autre parution récente chez Frémeaux & associés: Stéphane Carini, Les alchimies discrètes d'Henri Crolla. Accompagné de deux CD.
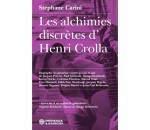 Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Patrick FRÉMEAUX
« APRÈS LUI, IL N’Y A PLUS DE GUITARISTES »
NAGUINE REINHARDT (ÉPOUSE DE DJANGO REINHARDT)
20:15 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, jazz, alain gerber, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/02/2025
« Je parle d’homme à homme »
 Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Verdier Poche, 2006, rééd. 2025
Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Verdier Poche, 2006, rééd. 2025
Né à Iaşi (Roumanie) en 1898, mort à Auschwitz en 1944, Benjamin Wechsler, devenu ensuite B. Fundoianu puis Benjamin Fondane, manifesta très tôt son intérêt pour la littérature française en publiant en roumain, en 1921, Images et livres de France, contenant des textes sur Baudelaire, Mallarmé, Gide et quelques autres, préfigurant des essais à venir publiés à Paris, où il s’installe dès 1923. « Importateur de culture européenne », selon la formule de Petre Raileanu, il joue un rôle décisif d’une part dans les mouvements de va-et-vient entre l’Est et l’Ouest, d’autre part dans la vie culturelle française et européenne. « De Dada à l’existentialisme, Benjamin Fondane a […] parcouru un long chemin avec la pensée de son temps. Témoin lucide et exigeant, il l’a accompagnée et bien souvent précédée, au risque de ne pas être entendu par ses contemporains », a écrit Michel Carassou.
Penseur, critique, homme de théâtre, Fondane fut aussi – et surtout, devrions-nous dire – un grand poète de langue française. La réunion et la réédition chez Verdier de ces cinq livres de poèmes est salutaire, et d’ailleurs conforme au désir exprimé par le poète dans une lettre envoyée à sa femme depuis le camp de Drancy, avant de partir vers la mort.
Cinq livres, donc : Ulysse (publié en 1933, remanié jusqu’en 1944), Le mal des fantômes (écrit en 1942-1943, resté inachevé), Titanic (1937), Exode (écrit vers 1934, complété en 1942 ou 1943), Au temps du poème (écrit entre 1940 et 1944).
En septembre 1943, Fondane écrivait :
Je pense au poète vieilli.
Voyez : il écrit un poème.
En a-t-il écrit, des poèmes !
Mais celui-là c’est le dernier.
Cette strophe, tirée d’un poème inédit publié par Monique Jutrin dans Poèmes retrouvés, est pour ainsi dire prémonitoire et n’est pas sans annoncer ce que dit Henri Meschonnic dans son « retour du fantôme » liminaire : « Benjamin Fondane s’écrit d’avance mort ». Mais aussi – toujours Henri Meschonnic – « pas un n’a écrit la révolte et le goût de vivre mêlé au sens de la mort comme Benjamin Fondane. Sa situation de fantôme lui-même y est sans doute pour quelque chose : un émigrant de la vie traqué sur les fleuves de Babylone ».
Ulysse / Fondane est le « Juif errant », celui qui se demande : « Est-ce arriver vraiment que d’arriver au port ? », celui qui, dans un perpétuel exode, chante l’Amérique et l’Argentine, et la mélancolie de l’exil :
Sur les fleuves de Babylone nous nous sommes assis et pleurâmes
que de fleuves déjà coulaient dans notre chair
que de fleuves futurs où nous allions pleurer
le visage couché sous l’eau,
celui qui interroge la légitimité du poème :
Quelle chanson chanterais-je sur une terre étrangère […]
car l’homme n’est pas chez lui sur cette terre.
L’émigrant chante, navigue et se souvient de ses origines :
Pourquoi l’océan me fait-il penser à ces plaines de Bessarabie
on y marchait longtemps et c’était long la vie.
Et s’il aspire au port, c’est sans illusions :
Nous ne parlons aucune langue
nous ne sommes d’aucun pays
notre terre c’est ce qui tangue
notre havre c’est le roulis.
De la fuite incessante à la révolte et à la résistance, le mouvement est naturel, comme l’avoue le « Non lieu » écrit par Fondane en guise de présentation du « Mal des fantômes » : « J’ai voulu écrire ces poèmes dans le goût dévorant de mon siècle. Si j’ai résisté, d’où m’est venue cette résistance ? »
La poésie de Benjamin Fondane est de toutes dimensions. Poésie du mythe et du sacré (L’Odyssée, La Bible…), poésie de l’amour pour « la frêle bergère » et « la fiancée promise et noire du Cantique des Cantiques », elle est avant tout poésie humaine :
Je parle d’homme à homme,
avec le peu en moi qui demeure de l’homme,
avec le peu de voix qui me reste au gosier.
Fondane, c’est un homme qui tente de se dire avec son universalité, ses contradictions, ses imperfections, dont le chant peut n’être « qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un poème parfait », mais qui tente de se donner « un visage d’homme, tout simplement ».
Jean-Pierre Longre
Sur Benjamin Fondane, voir aussi CECI et CELA
 Cahiers Benjamin Fondane n° 27, 2024. « L'art en questionS, années 20 ». Édition établie par Agnès Lhermitte et Serge Nicolas avec la collaboration de Monique Jutrin. Faux Traité d’esthétique, inédit de 1925.
Cahiers Benjamin Fondane n° 27, 2024. « L'art en questionS, années 20 ». Édition établie par Agnès Lhermitte et Serge Nicolas avec la collaboration de Monique Jutrin. Faux Traité d’esthétique, inédit de 1925.
Extrait de l’introduction par Agnès Lhermitte :
« En 1938, Fondane réutilise le titre de Faux Traité d’esthétique pour publier un essai qui a cette fois pour sous-titre « Essai sur la crise de réalité ». Il ne s’agit pas pour autant d’une reprise du manuscrit de 1925. Treize années ont passé, le contexte culturel a changé. Le jeune émigré récent encore incertain de ses orientations s’est nourri de nouvelles lectures. Il est devenu un poète maître de son art et un philosophe résolument existentiel qui aura approfondi et affermi sa pensée grâce à la rencontre de deux maîtres à penser. Chez Léon Chestov, qui guide ses lectures, il trouve la vision existentielle de la duplicité tragique de soi ; chez Lucien Lévy-Bruhl, la pensée de participation des primitifs, qui lui offre une voie d’accès au réel. Le sous-titre confirme la teneur nettement philosophique du nouvel essai.
Fondane y poursuit une réflexion qui récuse les problématiques esthétiques stricto sensu pour s’attaquer de front à la question primordiale : Pourquoi l’art ? Pourquoi justement l’art chez le seul animal raisonnable ? Il se concentre alors sur la poésie, son propre champ d’action et d’interrogation, dans un mouvement inverse de celui qui, en 1925, lui faisait élargir à l’art la crise de la littérature étudiée par Rivière. Bien des questions abordées alors, restées sans réponse ou devenues obsolètes à ses yeux, comme l’enracinement socio-historique de l’art ou la forme, encore liée à l’ordre, à la raison, auront été évacuées. Mais l’idée essentielle, déjà présente dans le manuscrit, d’un art vivant, sera devenue le principe du nouveau traité, présenté comme la mise au point vitale d’un enjeu existentiel, et où la poésie, expérience mystique du réel, se confond avec la vie de l’homme. »
Sommaire
Introduction, Agnès Lhermitte
Faux Traité d’esthétique (1925)
- La Crise du Concept de l’Art
- Erreur de l’art moderne « en tant que progrès »
- L’Idée de l’originalité
- « Deux excès : exclure la raison, n’admettre que la raison » : (Blaise Pascal)
- Règne de l’homme théorique
- L’Art autonome
- De Dada au surréalisme – ou de « l’idiotie pure » au suicide
Textes annexes
- Préface du Faux Traité d’esthétique
- Foi et dogme
- Le Concept du beau
- Faux concepts de l’art classique
Textes complémentaires
- « Faut-il brûler le Louvre ? »
- Réflexions sur le spectacle
Études
- L’Art en question : un premier cheminement philosophique, Serge Nicolas
- Une pensée en images, Agnès Lhermitte
19:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, francophone, roumanie, benjamin fondane, patrice beray, michel carassou, monique jutrin, henri meschonnic, agnès lhermitte, serge nicolas, non lieu, verdier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2025
Maternelle et tenace
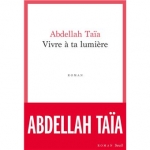 Lire, relire... Abdellah Taïa, Vivre à ta lumière, Le Seuil, 2022, Points 2025
Lire, relire... Abdellah Taïa, Vivre à ta lumière, Le Seuil, 2022, Points 2025
Abdellah Taïa joue franc jeu, dès la dédicace : « Pour ma mère : M’Barka Allai (1930-2010). Ce livre vient entièrement de toi. Son héroïne, Malika, parle et crie avec ta voix. » Histoire vraie, donc, mais devenue roman par le truchement des mots d’un écrivain donnant la parole à sa protagoniste qui monologue, se raconte, raconte les siens, ses proches et tout compte fait la vie du Maroc (d’un certain Maroc) de la fin du XXème siècle.
Une autobiographie en trois temps. À Béni Mellal, elle a trouvé toute jeune l’amour d’Allal, qu’elle épouse avec la bénédiction de son père et le consentement de sa belle-famille, mais qui part faire la guerre des Français en Indochine, pensant gagner suffisamment d’argent : « Un an ou deux de guerre et me voilà riche, un peu riche. » Il n’en reviendra pas, et Malika sera chassée par ses beaux-parents, qui avaient pourtant promis de la traiter comme leur fille.
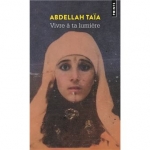 Nous la retrouvons à Rabat, bien des années plus tard, avec son second mari, un homme « gentil » qui l’a aidée à sortir de son complet dénuement et lui a fait de nombreux enfants. Mais c’est elle qui mène son monde, prend les initiatives et défend sa fille Khadija contre la mainmise de Monique, une Française qui voudrait prendre Khadija à son service. Non, Malika rêve que sa fille épouse un homme puissant et riche, un de ceux qui fréquentent le palais royal tout proche. Le destin en ira autrement.
Nous la retrouvons à Rabat, bien des années plus tard, avec son second mari, un homme « gentil » qui l’a aidée à sortir de son complet dénuement et lui a fait de nombreux enfants. Mais c’est elle qui mène son monde, prend les initiatives et défend sa fille Khadija contre la mainmise de Monique, une Française qui voudrait prendre Khadija à son service. Non, Malika rêve que sa fille épouse un homme puissant et riche, un de ceux qui fréquentent le palais royal tout proche. Le destin en ira autrement.
Le troisième épisode, qui se situe à Salé, est une confrontation entre Malika et Jaâfar, un jeune voisin tout juste sorti de prison qui la menace d’un couteau pour voler son argent. Elle lui tient tête, lui parle d’Ahmed, son fils parti en France qui ne donne plus de nouvelles. Impitoyable et maternelle, elle résiste au délinquant et au récit sordide de la vie des prisonniers marocains.
Malika est ce que d’autres appelleraient une « femme puissante ». Mais sa puissance n’est ni politique, même si d’importantes digressions évoquent Ben Barka et le roi Hassan II, ni économique, puisque sa famille vit dans les conditions les plus précaires, même si elle fait tout pour lui construire une maison et la nourrir. « Des années tous les onze dans une seule pièce. Onze ! J’ai économisé centime après centime. J’ai économisé tout ce que je pouvais. Certains mois, je ne leur préparais qu’un seul repas par jour. Ils râlaient. Ils criaient. Nous avons faim ! Nous avons faim, maman ! Je ne pouvais rien faire d’autre. Il fallait économiser encore et encore. Ils trouvaient tous que j’étais devenue impitoyable. Ce n’était pas grave. Un jour, ils comprendraient les sacrifices que j’avais faits pour eux. Les humiliations que j’avais subies à cause d’eux, pour leur donner un toit, une maison. Une vraie maison. » Quoi de plus parlant que ce qu’écrit Abdellah Taïa de cette mère lumineuse, volontaire, tenace ? « C’est Malika qui parle ici. Tout le temps. Elle raconte avec rage les stratégies pour échapper aux injustices de l’Histoire. Survivre. Avoir une petite place. » Son fils, par la magie de la littérature, lui a donné une vraie place.
Rappel: le récent livre du même auteur, Les Bastion des Larmes
Jean-Pierre Longre
10:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maroc, abdellah taïa, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/02/2025
Une jeunesse prometteuse : Le Persil a 20 ans
 Le Persil Journal, n° 222-223, juillet 2024 et 224-225-226-227-228, décembre 2024.
Le Persil Journal, n° 222-223, juillet 2024 et 224-225-226-227-228, décembre 2024.
En juillet 2024, Marius Daniel Popescu continuait à relater dans la suite du Cri du barbeau les anecdotes qui jalonnent sa vie passée et sa vie présente : « Tu es à la fois dans ton pays d’ici et ton pays de là-bas […], les mots naissent sans parents sur la feuille, ta mémoire les baptise encore et encore. » Ces mots lui servent à raconter par exemple la visite récente du plombier et sa conversation avec lui, ou les parties de pêche faites dans son enfance avec d’autres garçons… d’autres épisodes encore…
Quelques mois plus tard, paraît un numéro exceptionnel, celui des 20 ans de ce « journal qui pousse la littérature dans nos vies », « avec des textes et des images de plus de 1200 personnes en 228 numéros répartis en 99 publications et 3636 pages… » Avant des inédits de Heike Fiedler, Jean-Christophe Contini et Quentin Moron, avant l’historique de l’Association des Amis du Journal Le Persil, grâce à qui tout cela peut se faire, se multiplient les témoignages, à commencer par les débuts artisanaux racontés par celles, compagne et filles, qui ont accompagné Marius Daniel Popescu dans la création du journal. « En rentrant du travail, encore habillé de son uniforme des chauffeurs de bus, il a posé deux feuilles A3 sur la table pour y coller en lettres capitales LE PERSIL. Après avoir découpé et scotché les textes qu’il avait écrits, il les a ajustés à la mise en page. » C’est ainsi que tout a continué, et tous les souvenirs qui s’accumulent au fil des pages suivantes sont autant de preuves de l’obstination de son créateur à garder l’esprit et la manière des débuts.
Il est écrit dans ce numéro que Le Persil est d’une constante audace. Cette audace, c’est celle d’un accueil tous azimuts, d’une hospitalité littéraire sans discrimination ni censure, sans considérations de notoriété ni souci de gloriole. Les autrices et auteurs, néophytes ou expérimentés, disposent à leur guise des feuilles épanouies d’un journal obstinément « inédit », c’est-à-dire, avec tous les risques que cela comporte mais aussi les chances ainsi données, composé d’écrits toujours nouveaux. Pas de commentaires superflus, pas de prétentions analytiques, pas d’apparats critiques – rien que des textes littéraires (et aussi des illustrations) dans toute leur originalité, avec leurs tâtonnements inquiets ou leur tranquille maturité. Et si la pluralité des contributeurs et la diversité des styles favorisent la qualité et l’intérêt des publications, parfois une livraison est consacrée à un seul écrivain. Avec ténacité, brillamment, savoureusement, c’est de la belle et bonne lecture que nous offre Marius Daniel Popescu, dont l’origine roumaine se marie parfaitement avec l’esprit romand pour enrichir, avec une singularité parfois déroutante, toujours séduisante, le patrimoine littéraire européen.
Pour qui veut aller plus loin, les pages centrales offrent les listes bien instructives de tous les numéros publiés (dates et thèmes principaux) et de tous les contributeurs. Et une nouveauté : le site internet qui donne tous les renseignements possibles. Voir ci-dessous. Un Persil à consommer et un site à consulter sans modération…
Jean-Pierre Longre
19:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, le persil, francophone, suisse, roumanie, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/02/2025
La force des mots
 Ana Blandiana, Poèmes résistants, traduits du roumain par Hélène Lenz, édition bilingue révisée et présentée par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2024
Ana Blandiana, Poèmes résistants, traduits du roumain par Hélène Lenz, édition bilingue révisée et présentée par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2024
Comment résister à l’oppression ? Ouvertement, en s’exposant à la violence de la répression ; par l’exil, en espérant un avenir meilleur ; en luttant par les mots, en prose ou en poésie. Ana Blandiana a résisté de l’intérieur, au risque, à plusieurs reprises, de se voir interdite de publication, mais avec une notoriété de plus en plus grande dans son pays. Et si, dans la présentation de Poèmes résistants, Jean Poncet a raison d’écrire que « le combat de Blandiana fut toujours plus éthique que politique », il fait sentir à juste titre que ce combat est avant tout poétique. Ce recueil, qui donne à lire les textes en roumain et leur traduction en français par Hélène Lenz, reprend des poèmes parus en 1984 (quatre, publiés dans la revue Amfiteatru), 1985 (Étoile de proie) et 1990 (L’architecture des vagues, livre terminé en 1987 mais publié après la chute de Ceauşescu, et contenant des poèmes à propos desquels l’autrice écrivit significativement le 28 décembre 1989 : « Je les dédie à ceux qui, en mourant, ont rendu possible, à côté de bien d’autres choses, le retour de la poésie pour la poésie. »)
L’unité de l’ensemble est assurée par une tonalité commune qui laisse apparemment le pessimisme l’emporter sur l’espoir, la révolte sur la sérénité, les questionnements sans réponses sur les certitudes, et qui met en avant les hésitations concernant les formes de la résistance : « Le pouvoir de choisir / Entre être impliqué / Et être seul. / Le courage d’opter / Entre la souffrance du hurlement / Et celle du silence. /La force de décider / Entre la fuite au dehors / Et la fuite à l’intérieur. » L’une de ces formes est aussi l’ironie, lorsque la poésie s’écrie, en réponse à l’officiel « On doit tout faire pour réussir » : « Nous avons tout » : « Feuilles, mots, larmes, / Boîtes d’allumettes, chats, / Tramways quelquefois, queues pour la farine, / charançons, bouteilles vides, discours […] ».
Tout compte fait, l’unité est assurée par l’art que possède et pratique Ana Blandiana : celui de tout métamorphoser en poésie, en persistant « à répartir / les signes, les mots, les lettres… » L’œil se transforme en étoile, « Les atomes se changent en sable, / Le sable forme des cailloux, / Les cailloux deviennent des lettres. / Quant aux lettres, elles germent puis donnent des bourgeons, / Qui font des moissons de mots. » Et cette poésie, finalement, « Arrachant au chaos / La vague périssant après la vague », peut laisser entrevoir l’espoir : « À travers les yeux des menottes / Il y a le futur du verbe être. » Voilà le miracle des mots apprivoisés par Ana Blandiana. Comment résister ? Par la poésie.
Jean-Pierre Longre
http://jplongre.hautetfort.com/tag/ana+blandiana
Voir aussi: https://www.blackheraldpress.com/ma-patrie-a4-1
10:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, ana blandiana, hélène lenz, jean poncet, jacques andré éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

