06/09/2025
Une entrée en littérature
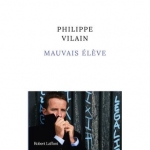 Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
Philippe Vilain, Mauvais élève, Robert Lafont, 2025
« Mauvais élève », Philippe Vilain le fut toute son enfance, jusqu’à ce que, décidant d’échapper aux horizons limités offerts par le BEP, il découvre la littérature et la philosophie, passe le baccalauréat, puis entame des études de Lettres qui le mèneront jusqu’au doctorat.
Voilà qui est vite résumé, et qui ne ferait pas la matière d’un livre s’il n’y avait pas tout le reste, notamment la rencontre avec Annie Ernaux qui, après un échange de correspondance, s’éprit de lui et le fit entrer dans sa vie. C’est ainsi que, lui-même séduit, il fit avec elle de beaux voyages, côtoya l’aristocratie des Lettres, ne se privant pas d’observer d’un œil acéré ce monde tout nouveau pour lui : « Je savais, grâce à un discernement exercé, saisir la personnalité de chacun, identifier leur appartenance sociale, à leur diction, façon de s’exprimer, posture, manière de se coiffer, de se vêtir, de s’approprier certaines marques ; je pouvais rapidement distinguer les aristocrates, les nobles, les bourgeois, les petits-bourgeois, démasquer les imposteurs, remarquer ceux qui n’appartenaient pas à ces cercles, les opportunistes qui n’y avaient pas grandi mais qui y étaient tolérés, les parvenus qui l’avaient conquis par des relations, mais qu’une assurance surjouée trahissait, tous ceux-là jusqu’aux belles provinciales séductrices mais désargentées qui me souriaient. »
Si sa compagne, bien plus expérimentée que lui, lui fait découvrir ce nouveau monde, elle devient aussi sa maîtresse en écriture ; sous sa houlette, il découvre la « dimension stakhanoviste » d’une tâche « semblable à un travail musical de gammes ou de répétitions », et apprend que « l’écriture demande un investissement sans faille, un apprentissage de l’humilité, une obéissance à une méthode, offrant finalement peu de jubilation, peu de plaisir. » En filigrane, on devine une relation de dominante à dominé, d’aristocrate des Lettres à jeune « plouc » (le mot a été dit) qui, en y réfléchissant, s’aperçoit que celle qui se désigne comme une « transfuge de classe » l’est beaucoup moins que lui : « C’était une erreur de croire que nous avions vécu la même enfance, puisque, en réalité, et heureusement pour elle, elle n’avait pas subi directement la violence et la pauvreté des classes inférieures, des déshérités, elle n’avait pas affronté le licenciement économique de ses parents, les dettes et la saisie immobilière, l’alcoolisme d’un père, l’échec scolaire. »
L’objet principal de Mauvais élève n’est pas tant le récit d’une relation amoureuse initiatrice et hors normes que celui d’une accession à la littérature et à ses dimensions, en même temps qu’une réflexion sur l’écriture elle-même, en particulier sur l’écriture autobiographique, ses « stratégies », ses « distorsions », « la façon dont un écrivain peut transformer son histoire, l’infléchir dans un sens plutôt que dans un autre, instrumentaliser ses expériences par les ruses du genre. » Au-delà des aspects anecdotiques, l’important est là : l’exploration d’une entrée en littérature et la découverte de ses mystères.
Jean-Pierre Longre
21:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, philippe vilain, robert lafont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/07/2019
Amour et disparition
 Philippe Vilain, Un matin d’hiver, Grasset, 2019
Philippe Vilain, Un matin d’hiver, Grasset, 2019
C’est une belle histoire d’amour qui se noue entre deux universitaires, elle (la narratrice) enseignante en littérature française, lui (Dan Peeters) sociologue américain en poste en France, bel homme, simple et bon. « Je ne trouvais pas à Dan de défauts importants, et je n’ai jamais décelé en lui de médiocrité. ». Une histoire d’amour racontée avec délicatesse, qui semble pouvoir se prolonger indéfiniment, dans une sorte de bonheur « consolidé » par le mariage et la naissance d’une petite fille, Mary. « Je songeais à la chance que j’avais d’avoir rencontré Dan et de partager sa vie, à la surprise de voir que notre couple résistait au temps. ».
Pour ses recherches sur la représentation du racisme, Dan doit périodiquement faire des voyages à Atlanta, et sa femme s’en accommode, même s’il ne lui dit rien de ce qu’il y fait. Un jour où il a accepté qu’elle l’accompagne à l’aéroport, il s’envole pour un énième voyage, et contrairement à son habitude ne donne pas de nouvelles. Il n’en donnera plus. Alors commence une longue quête angoissée qui n’aboutit à rien. Sur place, à Atlanta, elle se fait en compagnie et avec l’aide des parents de Dan ; à Paris, en épluchant ses courriers, ses mails, les études qu’il a publiées – et en égrenant toutes les hypothèses : il a pu être assassiné par un gang au cours de ses recherches ; il a peut-être décidé de changer complètement de vie ; aurait-il été un agent de la CIA infiltré dans des bandes criminelles ? Des années et des années d’attente, de suppositions, de tourments… Et comment faire admettre à la petite Mary, qui devient progressivement une adolescente, que son père ne réapparaîtra pas ? Ne pas penser que « sa disparition fût volontaire » : « C’est à cause de Mary que je n’ai pas voulu y penser, parce que je n’imagine pas qu’un père, aimant comme l’était Dan, puisse abandonner son enfant, pourtant cette probabilité existe bel et bien. ».
Ce roman, écrit avec une sobriété tendue par l’émotion, est dédié « à la confidente d’un jour », c’est-à-dire à cette femme qui a « confié son histoire » à l’auteur. Celui-ci s’est livré à un « travail de recomposition », en laissant le lecteur régler à sa manière le « suspens » des phrases, « des mots qui n’arrivent pas à se dire », mais un « suspens » que la narration aide à lever, sans résoudre l’énigme. Car, comme l’écrit Philippe Vilain, les histoires « sont simplement ce que nous faisons d’elles, je dirais même qu’elles sont belles de ce que nous faisons d’elles et de ce qu’elles font de nous : belles des surprises qu’elles nous offrent et des découvertes qu’elles nous font faire, […] belles des peurs qu’elles nous font surmonter, belles de ce qui nous arrive et de ce qu’elles nous font devenir. ».
Jean-Pierre Longre
19:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe vilain, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

