30/12/2024
Autour du silence
 Brèves n° 123, 2024
Brèves n° 123, 2024
Dans la rubrique « RElire », Éric Dussert présente un écrivain aussi modeste que méconnu, aussi spirituel que mystérieux (qui plus est, découvert par Raymond Queneau), Bernard Waller (1933-2010). La nouvelle qui illustre l’article, intitulée « La Maison sur la Nationale », raconte comment un certain M. Mandois, resté seul dans sa maison après le départ de sa femme et de sa fille, et après la construction d’un contournement routier, découvre le silence écrasant qui pèse sur lui.
« Silence », écrasant ou bienfaisant, soudain ou progressif, intérieur ou extérieur : c’est le thème qui, outre leur intérêt propre, a présidé au choix des textes dévoilés dans ce numéro de Brèves. Histoires de couples ou d’êtres solitaires, de quêtes amoureuses ou existentielles, nouvelles pseudo-fantastiques ou faussement réalistes, récits de vie et de mort… Chacun trouvera lecture à sa mesure et à son goût. Et bien sûr, la rubrique « Pas de roman, bonne nouvelle ! » livre pertinemment des idées supplémentaires de lectures, avant des hommages à deux écrivaines pour qui le genre de la nouvelle fut un support littéraire de prédilection, Claude Pujade-Renaud et Christiane Baroche.
Faire tourner autour d’un mot plusieurs nouvelles d’auteurs fort divers n’est pas chose aisée. Ce numéro de Brèves, encore une fois, y parvient brillamment. Mais attention : la revue papier, qui existe (un exploit) depuis 1981, va, pour diverses raisons bien compréhensibles, poursuivre son chemin sous forme de revue numérique, via Scopalto (taper « Scopalto brèves » sur un moteur de recherche). Pour être averti de la prochaine parution, écrire à editionsatelier@free.fr .
Jean-Pierre Longre
Les nouvelles et les auteurs du n°123 :
Les voisins
par Marie Ségala
Café Renaissance
par Corinne Borras
Insubmersible
par Clément Gramsch
Le bas-côté
par Livia Léri
L’agence
par Miguel Bermejo
Pitié pour la trace*
par ValérY MeYnadier
Poisson
par Anne Vérillaud
Les tombeaux de Charles Baudelaire
par Bernard Chevalier
Miséricorde
par Mathis Cornet
Fête nationale
par Luc Dagognet
Retour de vacances
par Anne Sénizergues
L’annonce
par Ingrid Thobois
Brèves, 1, rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude
Tél. 04 68 69 50 30
10:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle, francophone, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/12/2024
Formules à l’infini
 Michel Delhalle, Belgique, terre d’aphorismes, tome 2, préface d’Yves Namur, postface d’Alain Dantinne, Cactus inébranlable éditions, 2024
Michel Delhalle, Belgique, terre d’aphorismes, tome 2, préface d’Yves Namur, postface d’Alain Dantinne, Cactus inébranlable éditions, 2024
« L’aphorisme contemporain est un avatar de cette tradition ancienne, exprimant (ou détournant) des vérités morales sous forme de maxime, d’apophtegme, voire de proverbe, il profère une sentence (ou plutôt une pseudo-sentence) qui se veut indiscutable. C’est un énoncé isolé, en général une seule phrase, sans continuité discursive, relevant du mot d’esprit. » Les choses ont le mérite d’être claires dans la postface d’Alain Dantinne, et l’esprit est partout présent dans les quelque 280 pages d’aphorismes choisis par Michel Delhalle chez plusieurs centaines d’auteurs et d’autrices belges.
Si l’aphorisme est une spécialité du surréalisme de France et surtout de Belgique, le genre dépasse largement les limites du mouvement, de tous les mouvements artistiques et littéraires. Et si Scutenaire, Nougé, Chavée, Mesens, Goemans, Mariën, Dumont sont nommés, bien d’autres sont cités comme, excusez du peu, Fernand Crommelynck, Maurice Maeterlinck, Françoise Mallet-Joris, Marcel Moreau, Hubert Nyssen, Georges Rodenbach, Eugène Savistkaya, Jean-Philippe Toussaint, François Weyergans, Marguerite Yourcenar… Il y a même Amélie Nothomb, la chanteuse Maurane, l’acteur Benoît Poelevoorde, un certain Claude François (non, non ! pas de méprise : il s’agit d’un cinéaste proche des surréalistes), un Jean-Jacques Rousseau « cinéaste de l’absurde », et des centaines d’autres, dénichés à la suite de recherches sûrement acharnées, obstinées, tous logés à la même enseigne – une page pour chaque aphoriste.
On serait bien en peine de donner une idée du contenu ; cela ferait autant d’idées que de micro-textes. Alors, un peu au hasard : « La tolérance zéro est contagieuse » (La Brucellôse) ; « J’ai un compte en manque » (Bruno Coppens) ; « Écrire des riens plutôt que de ne rien écrire » (Jacques De Decker) ; « Quand le mal s’empare de la spiritualité, il en fait de la religion » (Jean Loubry) ; « Se dépasser pour s’atteindre » (Marcel Moreau) ; « J’ai suivi les mots à la trace, comme un pisteur de loup… » (Eugène Savistkaya)… Tout le reste à l’envi ! Servez-vous, à l’infini…
Jean-Pierre Longre
17:33 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aphorisme, michel delhalle, yves namur, alain dantinne, cactus inébranlable éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/12/2024
Conte de mort, de vie et d’amour
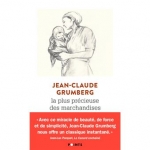 Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
Film franco-belge d'animation réalisé par Michel Hazanavicius, novembre 2024
« Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! », précisent les premières lignes. Pourtant, nous sommes dans une forêt, où un couple de bûcherons s’échine pour survivre : elle à la recherche du moindre morceau de bois, lui s’affairant à des « travaux d’intérêt public ». Sans enfants, donc sans bouche supplémentaire à nourrir, ni malheureusement à chérir… Très vite on comprend que la voix ferrée récemment construite à travers la forêt transporte des « marchandises » spéciales – hommes, femmes, enfants – vers une destination inconnue. Car tout autour de la forêt, c’est la guerre mondiale. « Pauvre bûcheronne », tous les matins, en ramassant les quelques branchages qu’elle trouve, va voir passer le train, attendant un signe, un cadeau, un miracle.
 Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.
Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.
Le conte nous dit que pendant ce temps la mère et le frère de la petite fille vont mourir, victimes des bourreaux, que seul le père en réchappera, espérant que son geste aura sauvé le bébé. Le récit avance à son rythme, faisant alterner les scènes de cruauté et de tendresse, de violence et d’amour, jusqu’à ce que le père, au hasard de ses recherches erratiques, devine que la fillette qui se trouvait devant lui, vendant des fromages avec sa « mère », était celle qu’il avait arrachée à la mort : « Un cri, un cri terrible, un cri de joie, de peine, de victoire, un cri se forma dans sa poitrine, mais rien, rien ne sortit de sa bouche. […] Il avait vaincu la mort, sauvé sa fille par ce geste insensé, il avait eu raison de la monstrueuse industrie de la mort. »
 Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».
Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».
Jean-Pierre Longre
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=274858.html
18:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, récit, histoire, francophone, jean-claude grumberg, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/12/2024
Disparition d’un foisonnant continent
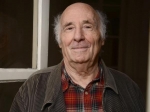 Jacques Roubaud, 1932-2024
Jacques Roubaud, 1932-2024
Né le 5 décembre 1932 à Caluire-et-Cuire, tout près de Lyon, Jacques Roubaud est mort le 5 décembre 2024 à Paris. Poète et mathématicien, membre actif de l’OULIPO, c’est un auteur tous azimuts, un foisonnant continent qui disparaît.
Pour lire des chroniques qui le concernent, en tout ou en partie, on peut suivre ce lien: http://jplongre.hautetfort.com/apps/search/?s=Roubaud
Voir aussi: https://www.lmda.net/2008-02-mat09016-jacques_roubaud?deb...
Et encore... :
 Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010
Jacques Roubaud « compositeur de mathématique et de poésie », sous la direction d’Agnès Disson et de Véronique Montémont, Éditions Absalon, 2010
À personne, parmi ses lecteurs, n’échappe le caractère étendu, complexe, hybride de l’œuvre de Jacques Roubaud, et il fallait bien une escouade de connaisseurs pour, sinon en faire le tour complet, du moins en sonder les strates superposées, en suivre les « courbes sinueuses, volutes, lignes serpentines, méandres, boucles nœuds et spirales » (Christine Jérusalem). Passionnés, spécialistes – dont l’écrivain lui-même fait partie, sous pseudonyme – explorent le « continent roubaldien », ses grands espaces, ses recoins et ses pièges, un continent où résonnent les échos conjoints « du verbe et du nombre », comme l’annonce le titre.
Les maîtresses d’œuvre, Agnès Disson et Véronique Montémont, ont réparti les études en cinq sections : Mathématique(s) et littérature, Question de genre(s), Retour aux sources, Poésie, Intermédialité. De quoi, donc, mettre en avant cinq facettes représentatives d’une œuvre dans laquelle les nombres et les structures, la polyvalence générique (poésie, prose, théâtre, autobiographie etc.), la richesse intertextuelle, l’attachement à des formes traditionnelles comme le sonnet, la variété des repères esthétiques, ne sont pas incompatibles, loin s’en faut, avec l’humour et la rigueur.
Parmi les références plus ou moins ouvertes, l’Oulipo et Queneau tiennent, bien sûr, une place prépondérante (y a-t-il eu TROu ou TOuR – c’est-à-dire Tournant Roubaldien de l’Oulipo ou Tournant Oulipien de Roubaud – ? Réponse dans la contribution de Marcel Bénabou). Mais pas seulement. La culture de Jacques Roubaud est immense : « J’ai la passion de la lecture. Je suis un liseur ; un liseur de livres surtout ». Et « la poésie est la mémoire de la langue ». C’est sur la mémoire des textes que se compose l’œuvre de Roubaud, même oralement, comme l’explique Florence Delay pour Graal Théâtre ; sur la variété des arts – peinture, photographie, musique, performance… – que se construit « l’hybridité » comme « principe structurant » de l’œuvre (Pierre Hyppolite). Mais c’est évidemment Jacques Roubaud lui-même qui, fort de la distance parodique et de l’investissement personnel qui le singularisent, est le premier et le dernier compositeur de son œuvre.
Dans la « réflexion collective » que propose cet ouvrage, complétée par quelques documents (manuscrits, tableaux) et une vaste bibliographie, chaque lecteur trouvera un chemin d’accès vers l’élucidation, au moins partielle, de quelques secrets roubaldiens.
Jean-Pierre Longre
10:57 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, jacques roubaud, oulipo, agnès disson, véronique montémont, éditions absalon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Merveilleux continent
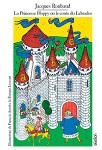 Lire, relire... Jacques Roubaud, La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador. Illustrations de François Ayroles et Étienne Lécroart,Éditions Absalon, 2008
Lire, relire... Jacques Roubaud, La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador. Illustrations de François Ayroles et Étienne Lécroart,Éditions Absalon, 2008
Que le lecteur ne compte pas sur le critique pour raconter le conte du Labrador ; il faut qu’il compte sur lui-même, le lecteur, pour se diriger dans le labyrinthe où Jacques Roubaud se complait à conter les aventures du Comte du Labrador, qu’il ne faut pas pour autant prendre pour argent comptant. Dans sa recherche, il sera peut-être content, le lecteur, de lire « L’épluchure du conte-oignon » d’Elvira Laskowski-Caujolle, qui contient un certain nombre d’explications complétant utilement « Le Conte conte le conte et compte » de Jacques Roubaud soi-même, rattachant clairement La Princesse Hoppy à l’influence de Queneau et aux contraintes oulipiennes.
On se contentera donc de saluer la réédition de cette œuvre commencée en 1972, jamais achevée mais paradoxalement et tout compte fait très complète. Car « le conte dit toujours vrai », et il le dit d’une manière exhaustive tout en s’amusant comme un enfant, en jouant oralement dès le titre (qui enferme le terme OuLiPo), en « complotant » une « compote » de jeux verbaux ou typographiques qui peuvent aller jusqu’à transcrire le langage « chien » ou « sauterelle », voire jusqu’à produire des schémas traduisant une nouvelle langue, le « canard postérieur ».
Inutile de dire que les mathématiques et la physique tiennent ici, comme toujours avec Roubaud, une place prépondérante, et que les énigmes sont telles qu’il faut parfois tout reprendre à zéro (ce à quoi nous incite, au passage, le chapitre 00). C’est ainsi que le lecteur, comme toujours avec Roubaud, est personnellement sollicité, intimement questionné, poussé dans ses retranchements, et qu’il est donc obligé non seulement de tout lire, mais encore de collaborer à la composition du conte.
Est-il utile, en outre, de dire que le livre est beau ? Beau par sa narration, par sa poésie, par l’attitude respectueuse que l’écriture adopte envers les œuvres et les auteurs du passé (Le Conte du Graal, Alice au pays des Merveilles, Baudelaire, Apollinaire, Queneau bien sûr, et beaucoup d’autres), beau par son non-conformisme et sa conformité aux règles du genre, beau par les illustrations colorées, médiévales, baroques, enfantines, savantes de François Ayroles et Etienne Lécroart, beau dans sa présentation générale.
Il est donc compréhensible qu’on tienne à recommander la délicieuse consommation de La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador, qui nous convie à explorer incontinent un pays contenant toutes sortes de merveilles – que dis-je, un pays ? Un continent !
Jean-Pierre Longre
http://www.editionsabsalon.com
10:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, francophone, illustration, jacques roubaud, françois ayroles, Étienne lécroart, oulipo, Éditions absalon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2024
Quel avenir ?
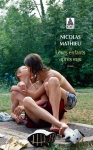 Lire, relire... et voir... Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Actes Sud, 2018, Babel, 2020. Prix Goncourt 2018
Lire, relire... et voir... Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Actes Sud, 2018, Babel, 2020. Prix Goncourt 2018
Film de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma, avec Paul Kircher, Angelina Woreth, Sayyid El Alami, décembre 2024
Il a déjà été beaucoup écrit sur ce gros roman foisonnant et mené tambour battant, Prix Goncourt oblige… On ne reviendra donc pas sur les détails de la vie d’Anthony et de ses parents, de Hacine et de son père, de Steph et de Clem, de tous les autres, de ces adolescents qui, issus d’un milieu ou d’un autre, paraissent végéter dans une région où les hauts-fourneaux éteints, les cités sans attrait, les bistrots bondés et même la nature écrasée de moiteur et de boue n’offrent qu’un horizon gris et limité ; de ces adolescents qui, dans l’alcool et la drogue, les amours éphémères et maladroites, les plaisirs de la transgression et la violence incontrôlée, tentent d’oublier que l’existence obscure que leur réserve l’avenir est à peu près celle que mènent leurs parents.
Justement, c’est bien là-dessus qu’il faut insister : le titre du livre est explicité par la citation placée en exergue, tirée de l’Ancien Testament (le livre de Ben Sira) :
Il en est dont il n’y a plus de souvenir,
Ils ont péri comme s’ils n’avaient jamais existé ;
Ils sont devenus comme s’ils n’étaient jamais nés,
Et, de même, leurs enfants après eux.
Le roman de Nicolas Mathieu, si plein de mouvement, de sève et de péripéties de toutes sortes, se lit avec l’avidité du désespoir. Ces enfants qui tentent d’accéder à une destinée autre se sortiront-ils de celle à laquelle semblent les avoir condamnés la société, la famille, leur tempérament ?
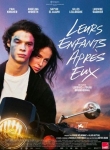 L’histoire, qui s’étale de 1992 à 1998, se déroule en quatre temps régulièrement répartis (1992, 1994, 1996, 1998), quatre temps estivaux et fortement marqués par des événements collectifs tels que le 14 juillet ou la coupe de monde de football, qui donnent lieu à des scènes festives, délirantes, à la brutalité mal contenue. Au milieu de tout cela, quelques individus se détachent, relevant d’un monde ou d’un autre, et en écoutant leurs pensées, leurs doutes, leurs velléités, leurs désespoirs, leurs espérances (habilement exprimés au style indirect libre), en les connaissant ainsi de mieux en mieux, on se prend à s’attacher à eux. L’écriture de Nicolas Mathieu, faite de vigueur narrative, de pittoresque descriptif, de solidité architecturale, de fine analyse sociologique, mêlée d’échos, entre autres, de Zola et de Bourdieu, cette écriture, donc, est pour beaucoup dans cet attachement.
L’histoire, qui s’étale de 1992 à 1998, se déroule en quatre temps régulièrement répartis (1992, 1994, 1996, 1998), quatre temps estivaux et fortement marqués par des événements collectifs tels que le 14 juillet ou la coupe de monde de football, qui donnent lieu à des scènes festives, délirantes, à la brutalité mal contenue. Au milieu de tout cela, quelques individus se détachent, relevant d’un monde ou d’un autre, et en écoutant leurs pensées, leurs doutes, leurs velléités, leurs désespoirs, leurs espérances (habilement exprimés au style indirect libre), en les connaissant ainsi de mieux en mieux, on se prend à s’attacher à eux. L’écriture de Nicolas Mathieu, faite de vigueur narrative, de pittoresque descriptif, de solidité architecturale, de fine analyse sociologique, mêlée d’échos, entre autres, de Zola et de Bourdieu, cette écriture, donc, est pour beaucoup dans cet attachement.
Jean-Pierre Longre
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=314779.html
09:38 Publié dans Film, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas mathieu, actes sud, babel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

