26/11/2024
La puissance onirique de la littérature
 Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024
Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024
Dans les années 1960, Dumitru Tsepeneag, avec quelques compagnons dont Leonid Dimov et Virgil Tanase, fonda à Bucarest le « groupe onirique », lieu de débat intellectuel, esthétique, littéraire se situant aux antipodes du totalitarisme pesant sur la Roumanie à cette époque. Il ne s’agissait pas de revenir aux conceptions romantiques ou surréalistes du rêve, mais de s’appuyer sur ses « critères » et son fonctionnement pour créer un nouveau réel littéraire. Les apparences du rêve, sa complexité, les retours d’images et de thèmes, les obsessions qu’il véhicule caractérisent ainsi les œuvres « oniriques », et les nouvelles rassemblées dans Mise en scène, composées à la fin des années 1960, qui n'ont pu être publiées qu’après 1989 et viennent d’être traduites en français par Nicolas Cavaillès, en sont un beau témoignage.
Le recueil est composé de onze textes qui, s’ils sont d’inégale longueur et abordent des thèmes variés, entrent en résonance les uns les autres grâce à une écriture portée par les caractéristiques structurelles du rêve et de ses apparences absurdes. Construire une montagne infinie de chaises ou creuser des fosses insondables, se laisser accaparer brutalement par une sorte de secte ou faire difficilement monter un âne dans un camion pour fuir avec lui, laisser pleurer un être étrange enfermé dans une armoire ou accueillir un petit homme grelottant de peur et de froid, se confronter à de multiples miroirs que l’on voudrait briser comme pour occulter l’image de soi ou partir dans un bateau en papier sur une « mer de sang », emmener une foule disparate sur un miroir piégé ou laisser un bel homme se faire étouffer par des serpents… Quelques mots ne suffisent évidemment pas à donner une image fidèle de la forme, du fond et de la dimension de ces textes.
Reste la longue nouvelle centrale, celle qui donne son titre au recueil, un titre annonçant une plongée dans le théâtre. Oui, le théâtre est bien là, donnant à la nouvelle une dimension scénique, avec des personnages, un auteur – metteur en scène, un va-et-vient entre le « réel » du récit et celui de la scène qui souvent se confondent, sans que l’on sache toujours ce qui relève de la réalité et de la fiction narratives, ce qui relève de la vérité et du mensonge, du « Theatrum mundi » et de la « mise en scène », de la présence de l’Auteur et de l’imposture. « Soit dit entre nous, tout ça, tous ces trucages, c’est bon pour le théâtre, ou pour le cinéma, encore mieux, mais ça n’a rien à voir avec la réalité. Des trucages ! […] Tout est fondé sur la suggestion. Vous comprenez, camarade colonel… Voilà le théâtre moderne : une métaphore incarnée puis commentée, destruction de la rampe, des coulisses… Une révolution complète ! » Antithèse du « réalisme socialiste », le récit / théâtre en profite pour d’adonner, en toute lucidité, à la satire profonde et métaphorique d’un régime fondé sur le mensonge et de ses sbires, ainsi qu’à une reprise parodique de la mort et de la résurrection du Christ, « l’Auteur » cloué sur sa chaise puis réapparaissant sous l’aspect du « Milicien » acclamé par le public…
Cette publication de textes anciens ajoute une étape importante au cheminement de l’un des plus importants écrivains roumains (ou franco-roumains) contemporains, et plus généralement à la puissance onirique de la littérature.
Jean-Pierre Longre
09:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/11/2024
Au creux d’une vallée perdue
 Marie-Hélène Lafon, Les sources, Buchet/Chastel, 2023, Le Livre de Poche, 2024
Marie-Hélène Lafon, Les sources, Buchet/Chastel, 2023, Le Livre de Poche, 2024
« Trente ans, trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles, deux filles et un garçon, sept, cinq et quatre ans, une ferme, une belle ferme, trente-trois hectares, une grande maison, vingt-sept vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. » En ce samedi 10 juin 1967, tout pourrait aller bien pour cette jeune mère de famille, d’autant que le lendemain, dimanche, ce sera la visite traditionnelle chez ses parents, à une heure et demie de route de là. Mais ce n’est qu’une apparence : l’atmosphère est lourde, comme son corps maintenant, elle ne veut pas penser à son mariage, il y a huit ans, avec cet homme qui s’est vite révélé exigeant et brutal, qui se déchaîne périodiquement contre elle, à lui donner ce qu’il appelle des roustes. Que faire contre cela, dans cette ferme éloignée de tout, au fond de la vallée perdue où il a voulu s’installer ? Tous vivent dans la peur, les enfants comme elle, et pourquoi rester ? « Elle ne comprend pas. » Cela dure jusqu’au moment où, n’en pouvant plus, elle se confie à sa mère, brièvement ; « elle raconte le pire tout de suite, sans pleurer, elle montre aussi les bleus, les traces… ». Braver le qu’en-dira-t-on, décider la séparation, le divorce.
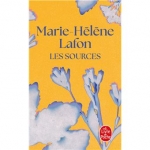 Le point de vue de la jeune mère constitue le premier chapitre, le plus long. Le suivant, qui se situe sept ans plus tard (19 mai 1974), est celui du père, qui s’occupe maintenant seul de la ferme, et qui ne voit ses enfants que de temps en temps – ses filles avec plaisir, elles dont il sait qu’elles vont faire de bonnes études, son fils avec plus de réticence, ce garçon moins brillant, un peu endormi, dont il perçoit mal l’avenir. En tout cas il sait que la ferme « n’aura pas de suite. » Effectivement, nous faisons un saut de presque cinquante ans (2 octobre 2021), lorsque Claire, la deuxième fille, revient sur les lieux de son enfance, remonte aux « sources », au moment où les enfants « liquident l’héritage » ; elle « respire l’odeur tiède et sucrée des feuilles alanguies. Alangui est ridicule, elle le sait, mais elle laisse ce mot monter et la déborder. Personne n’a jamais été vraiment alangui dans cette cour, en tout cas personne qu’elle connaisse. »
Le point de vue de la jeune mère constitue le premier chapitre, le plus long. Le suivant, qui se situe sept ans plus tard (19 mai 1974), est celui du père, qui s’occupe maintenant seul de la ferme, et qui ne voit ses enfants que de temps en temps – ses filles avec plaisir, elles dont il sait qu’elles vont faire de bonnes études, son fils avec plus de réticence, ce garçon moins brillant, un peu endormi, dont il perçoit mal l’avenir. En tout cas il sait que la ferme « n’aura pas de suite. » Effectivement, nous faisons un saut de presque cinquante ans (2 octobre 2021), lorsque Claire, la deuxième fille, revient sur les lieux de son enfance, remonte aux « sources », au moment où les enfants « liquident l’héritage » ; elle « respire l’odeur tiède et sucrée des feuilles alanguies. Alangui est ridicule, elle le sait, mais elle laisse ce mot monter et la déborder. Personne n’a jamais été vraiment alangui dans cette cour, en tout cas personne qu’elle connaisse. »
Trois actes de plus en plus brefs, trois points de vue rythmés par une prose sobre, sans fioritures, trois monologues indirects menés comme une tragédie classique (trois temps bien définis, un lieu central et constant, une histoire de famille…). La relation simple des gestes de l’existence donne, par la magie de l’écriture de Marie-Hélène Lafon, résonnante d'harmoniques, une densité particulière à l’émotion. Chaque personnage, s’exprimant avec son langage, sans artifices, représente l’humanité telle qu’elle est, avec ses drames plus ou moins cachés, ses sensations et ses incompréhensions. Sans parler de la poésie qui émane de tout cela, poésie de la nature et de la vie quotidienne, poésie du style et des mots, poésie du souvenir dont Claire, au prénom choisi, dans les dernières lignes, révèle la « lumière douce. »
Jean-Pierre Longre
10:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marie-hélène lafon, buchetchastel, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/11/2024
Un parcours louvoyant et pluriel
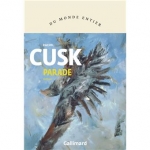 Rachel Cusk, Parade, traduit de l’anglais par Blandine Longre, « Du monde entier », Gallimard, 2024
Rachel Cusk, Parade, traduit de l’anglais par Blandine Longre, « Du monde entier », Gallimard, 2024
Tous sont désignés par l’initiale G, et tous un rapport étroit avec l’art. En quatre chapitres (« La cascadeuse », « La sage-femme », « Le plongeur », « L’espion »), à la première ou à la troisième personne, sont abordés à leur propos ou par leur propre voix de grands sujets, toujours en rapport avec l’art et toujours problématiques, tels que l’amour, les relations dans le couple et dans la famille, les enfants, la violence, la mort (voulue ou subie)… Si les lieux ne sont jamais nommés, sinon par leur statut (musée, voie publique, logement, atelier, restaurant…), ils sont déterminés par la présence des personnages, par leurs mouvements, par les rapports qu’ils entretiennent entre eux et par les incidents ou accidents qu’ils subissent ou provoquent.
Dans le troisième chapitre, sans doute le plus dense et le plus représentatif de l’ensemble, les discussions vont bon train autour de la directrice du musée qui a assisté, du haut du dernier étage où se tenait une rétrospective de la célèbre G, au mystérieux suicide d’un inconnu (d’où le titre du chapitre, « Le plongeur »). À cette occasion, sont disséqués tous les thèmes énumérés plus haut, en particulier celui du statut des femmes artistes, de la possibilité ou non pour les artistes d’avoir des enfants, des rapports entre l’art, la souffrance et la mort, et de son assimilation au sacré ou à la profanation, comme l’exprime la directrice : « À certaines heures de la journée, […] quand le musée n’est pas bondé, son atmosphère est semblable à celle d’une église. On voit bien que les gens attribuent un caractère sacré à ces œuvres d’art et des pouvoirs divins aux artistes qui les ont créées. À d’autres moments, le musée est comble et l’atmosphère change complètement. Les visiteurs se poussent et se bousculent pour essayer de voir, comme des badauds qui tentent d’apercevoir la scène d’un accident de voiture ou un spectacle tout aussi macabre. Ils prennent des photos avec leurs téléphones, à la manière de voyeurs et, à dire vrai, je crois parfois qu’ils ne savent même pas ce qu’ils photographient. »
On le constate, plus qu’un roman, le livre de Rachel Cusk est un ensemble d’essais ou d’ébauches d’essais semés de pensées développées ou d’aphorismes (par exemple : « L’art est le pacte que concluent des individus refusant que la société ait le dernier mot. »), cet ensemble tenant, au choix, du puzzle, du patchwork, de la « parade » louvoyante et plurielle, du parcours esthétique et philosophique, psychologique et sociétal. Il laisse ainsi une empreinte indélébile sur l’esprit du lecteur, qui n’a pas fini de prolonger la réflexion. D’autant que, si la première phrase évoque l’artiste G qui « entreprit de peindre à l’envers », comme pour trouver « l’avènement d’une réalité nouvelle », dans les dernières lignes les membres de la famille réunis autour de la dépouille de leur mère entrevoient la « vérité », la « réalité grise » et avouent : « tel était notre commencement. » À Chacun de continuer…
Jean-Pierre Longre
19:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, essai, anglophone, rachel cusk, blandine longre, gallimard | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/11/2024
« Le cœur en charpie »
 Olivier Adam, Des vents contraires, Éditions de l’Olivier, 2008
Olivier Adam, Des vents contraires, Éditions de l’Olivier, 2008
Grand Prix RTL-Lire 2009
Rééd. Points, 2010, 2023
Sarah a disparu sans laisser de traces, abandonnant son époux et ses deux jeunes enfants à leurs éternelles questions (Où est-elle ? A-t-elle fui ? A-t-elle été enlevée ? Est-elle morte ?) et, surtout, au vide désespéré de leur cœur. Paul Anderen, scénariste et romancier en mal d’écriture, décide alors de revenir avec Clément et Manon au pays de son enfance, dans cette Bretagne où les vents et la mer accompagnent et trahissent la violence des sentiments.
 Paul retrouve à Saint-Malo des souvenirs, le goût salé de l’océan, quelques êtres affectueux comme son frère Alex et sa belle-sœur Nadine (qui l’embauchent en douce dans leur auto-école), mais aussi la froide brutalité de la société et de ses institutions, auxquelles ses enfants et lui-même n’arrivent pas adapter leur existence. Le manque est toujours là, qu’ils tentent de pallier par l’amour inconditionnel qu’ils se vouent mutuellement. Plutôt rester tendrement blottis les uns contre les autres face au large, dans la bise glaciale, que de se heurter aux institutrices intraitables et aux parents d’élèves méfiants. Plutôt rire sans vergogne aux manèges de la fête foraine, ou aider sans arrière-pensée ceux qui ont aussi « le cœur en charpie » : un père privé de voir son enfant, une voisine attendant impatiemment son fils parti au loin depuis des mois, une vieille dame qui va mourir, un inspecteur de police que sa fille ne connaît pas… Paul est de ces originaux qui ne transigent pas avec la tendresse et la sincérité, et c’est ce qui lui vaut l’inimitié de la majorité (silencieuse ou non) ; faire face à la tempête, ne pas plier, quelles qu’en soient les conséquences ; la marginalité est son lot, mais peu importe : ce qui compte pour lui, c’est l’amour sans faille qu’il porte à ses enfants, qui le lui rendent bien, chacun à sa manière.
Paul retrouve à Saint-Malo des souvenirs, le goût salé de l’océan, quelques êtres affectueux comme son frère Alex et sa belle-sœur Nadine (qui l’embauchent en douce dans leur auto-école), mais aussi la froide brutalité de la société et de ses institutions, auxquelles ses enfants et lui-même n’arrivent pas adapter leur existence. Le manque est toujours là, qu’ils tentent de pallier par l’amour inconditionnel qu’ils se vouent mutuellement. Plutôt rester tendrement blottis les uns contre les autres face au large, dans la bise glaciale, que de se heurter aux institutrices intraitables et aux parents d’élèves méfiants. Plutôt rire sans vergogne aux manèges de la fête foraine, ou aider sans arrière-pensée ceux qui ont aussi « le cœur en charpie » : un père privé de voir son enfant, une voisine attendant impatiemment son fils parti au loin depuis des mois, une vieille dame qui va mourir, un inspecteur de police que sa fille ne connaît pas… Paul est de ces originaux qui ne transigent pas avec la tendresse et la sincérité, et c’est ce qui lui vaut l’inimitié de la majorité (silencieuse ou non) ; faire face à la tempête, ne pas plier, quelles qu’en soient les conséquences ; la marginalité est son lot, mais peu importe : ce qui compte pour lui, c’est l’amour sans faille qu’il porte à ses enfants, qui le lui rendent bien, chacun à sa manière.
« J’ai lu un de vos bouquins hier, dit un jour l’inspecteur à Paul. Ne prenez pas cet air étonné. Franchement j’ai trouvé ça pas mal. Un peu geignard mais pas mal. » Autocritique d’Olivier Adam ? En tout cas, tout était réuni pour bâtir un scénario « geignard » : la mère disparue, le père transi d’amour pour ses deux petits un peu perdus, la tempête hivernale sur les côtes bretonnes, la brutalité collective… Mais il y a d’une part l’épaisseur et la présence des personnages : celles de Paul Anderen dont la force affective est la faiblesse, et dont la faiblesse sociale est la force ; celles des deux enfants, qui sentent tout sans forcément comprendre ; celles des êtres qui, autour d’eux, font qu’on ne désespère pas complètement de l’homme. D’autre part l’écriture, qui suit les fluctuations des corps et des cœurs – accélérations, ralentissements –, une écriture n’abusant pas des artifices, collant au réel (les ciels, la mer, les paysages, les maisons, les sensations, les gestes, les conversations…), le perçant, le remuant jusqu’à le métamorphoser en matière romanesque.
https://www.editionspoints.com
21:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, olivier adam, Éditions de l’olivier | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/11/2024
L’individu et le parti
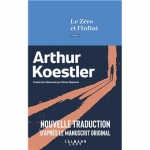 Lire, relire... Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni d’après le manuscrit original de 1940, Calmann Lévy, 2022, Le Livre de Poche, 2024
Lire, relire... Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni d’après le manuscrit original de 1940, Calmann Lévy, 2022, Le Livre de Poche, 2024
En 2015, Matthias Wessel découvrit à Zürich le tapuscrit original (en allemand) du fameux roman d’Arthur Koestler, Le Zéro et l’Infini, écrit entre janvier 1939 et mars 1940. Avant 2022, on ne pouvait lire en français que la traduction de la version anglaise elle-même publiée par la compagne de l’auteur en 1940. La nouvelle traduction, absolument fidèle au texte d’origine, est ainsi beaucoup plus fiable que la précédente.
 Le « Zéro », c’est l’individu, « l’Infini », c’est le parti : « Le parti refusait tout libre arbitre à l’individu – et dans le même temps, il exigeait de lui une abnégation absolue, il attendait qu’il lui soumette sa volonté. » Si à aucun moment le pays et ses dirigeants ne sont nommés, on devine que l’intrigue dénonce l’URSS de Staline et les « procès de Moscou » dont les accusés étaient jugés d’avance – et Arthur Koestler, fidèle au communisme jusqu’en 1938, en connaissait bien les rouages. Roubatchov, ancien dirigeant du parti, est arrêté et, dans la prison où il est enfermé, va subir trois interrogatoires avant d’être condamné. Son premier procureur, l’un de ses anciens amis, admet peu ou prou la discussion – et c’est ce qui le perdra lui-même. Roubatchov en profite pour émettre ses opinions sur les erreurs et les aberrations du régime : « Tout est enseveli, les gens, les découvertes, les espoirs. Vous avez tué le « nous », vous l’avez éradiqué. Tu affirmes que les masses vous soutiennent encore ? C’est aussi ce que prétendent quelques autres chefs d’État en Europe. […] Les masses sont redevenues sourdes et ne disent plus rien, elles sont le grand epsilon silencieux de l’histoire, aussi indifférent que la mer qui porte les bateaux. […] À l’époque, nous avons fait l’histoire. Aujourd’hui, vous faites de la politique. Toute la différence est là. »
Le « Zéro », c’est l’individu, « l’Infini », c’est le parti : « Le parti refusait tout libre arbitre à l’individu – et dans le même temps, il exigeait de lui une abnégation absolue, il attendait qu’il lui soumette sa volonté. » Si à aucun moment le pays et ses dirigeants ne sont nommés, on devine que l’intrigue dénonce l’URSS de Staline et les « procès de Moscou » dont les accusés étaient jugés d’avance – et Arthur Koestler, fidèle au communisme jusqu’en 1938, en connaissait bien les rouages. Roubatchov, ancien dirigeant du parti, est arrêté et, dans la prison où il est enfermé, va subir trois interrogatoires avant d’être condamné. Son premier procureur, l’un de ses anciens amis, admet peu ou prou la discussion – et c’est ce qui le perdra lui-même. Roubatchov en profite pour émettre ses opinions sur les erreurs et les aberrations du régime : « Tout est enseveli, les gens, les découvertes, les espoirs. Vous avez tué le « nous », vous l’avez éradiqué. Tu affirmes que les masses vous soutiennent encore ? C’est aussi ce que prétendent quelques autres chefs d’État en Europe. […] Les masses sont redevenues sourdes et ne disent plus rien, elles sont le grand epsilon silencieux de l’histoire, aussi indifférent que la mer qui porte les bateaux. […] À l’époque, nous avons fait l’histoire. Aujourd’hui, vous faites de la politique. Toute la différence est là. »
Roman emblématique, Le Zéro et l’Infini est certes fondé sur les agissements et l’idéologie implacable et meurtrière d’un pays et de son « N° 1 », à une époque donnée, et c’est ce qui a en partie fait son succès. Mais celui-ci est dû aussi à sa manière de démonter le fonctionnement de tous les totalitarismes, qui obéissent à un principe : la fin justifie les moyens. C’est ainsi que l’explique sans états d’âme Gletkine, le second procureur de Roubatchov : « Nous n’avons pas hésité à trahir nos amis et à pactiser avec nos ennemis pour conserver le bastion. Telle était la mission que nous avait assignée l’histoire du monde, à nous qui portions la première révolution victorieuse. Ceux qui avaient la vue courte, les beaux esprits, les moralistes ne l’ont pas compris. Mais le chef du mouvement avait compris que tout dépendait de ce point-là : avoir le plus de souffle face à l’Histoire, faire en sorte que ce soient les autres qui disparaissent, et pas nous. » Des affirmations que pourraient proférer les dictateurs de tous les temps, y compris du nôtre.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, histoire, arthur koestler, olivier mannoni, calmann lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

