13/10/2025
Pâtes italiennes
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Le voleur de nostalgie, Le Castor Astral, 2005, Folio, 2025
Roman épistolaire, roman culinaire, roman oulipien, roman à tiroirs, roman d’investigation… Maintes caractéristiques génériques pourraient qualifier le dernier livre d’Hervé Le Tellier, qui se situe ici dans la droite (mais complexe) lignée des initiateurs de l’OuLiPo. Il y aurait à ajouter, aux limites du romanesque : la fiction autobiographique, l’érudition historique et artistique, la poésie italienne (et anglaise ou irlandaise), les jeux de l’amour (où le hasard, finalement, n’aura pas voix au chapitre), les malices intertextuelles, de Dante à Calvino et Roubaud.
 On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
On aurait pu commencer par résumer, en disant par exemple : un chroniqueur gastronomique publie régulièrement dans un hebdomadaire français des recettes de pâtes italiennes sur fond d’anecdotes pittoresques, en usant du beau pseudonyme de Giovanni d’Arezzo ; un (vrai ?) Giovanni d’Arezzo, ayant découvert l’un de ces articles, lui écrit sans dévoiler son adresse, ce qui pousse le (faux) Giovanni à envoyer une réponse en trois exemplaires aux adresses de trois Giovanni d’Arezzo florentins trouvées grâce aux renseignements internationaux ; commence alors une abondante correspondance entre le narrateur et ses trois « homonymes », dont un retraité de l’enseignement et un jeune prisonnier.
Voilà le début, et on ne poursuivra pas le résumé ; car à partir de là, l’entrecroisement épistolaire, ponctué d’extraits du « Carnet de l’auteur » et de narrations culinaires, mène le lecteur, comme le narrateur, dans un labyrinthe de faux-semblants (vraisemblables au demeurant), de chemins de traverse, de jeux de piste, d’embûches intellectuelles et sentimentales. Qui dit vrai, qui ment ? Qui est le voleur, qui le volé ? Les « Caro Giovanni », « Cher Monsieur d’Arezzo », « Cher Giovanni », « Giovanni mio », « Carissimo Giovanni », les congratulations et remerciements mutuels sont des formules qui occultent à peine une guerre à pointes de moins en moins mouchetées où l’on n’hésite pas à se dérober des histoires personnelles, des souvenirs, des amours anciennes, des confidences, la « nostalgie » qu’évoque le titre.
Tout cela est un jeu ? En quelque sorte : jeu de l’arroseur arrosé, du piégeur piégé, du bourreau victime… Mais jeu qui, comme dans tout bon roman forgé à l’aune d’une construction rigoureusement préméditée (on ne peut manquer de penser, du côté épistolaire, aux Liaisons dangereuses, et du côté oulipien, à La vie mode d’emploi), engage une ou des existences à part entière ; celles des personnages, et celle du lecteur qui se laisse lui-même prendre au piège et ne peut s’empêcher de deviner que, sous ce qu’il a cursivement saisi, bien d’autres choses se tapissent dans les profondeurs dantesques de l’humaine comédie.
Jean-Pierre Longre
11:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/12/2020
Une vie en mille morceaux
 Lire, relire... Hervé Le Tellier, Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, Le Castor Astral, « Millésimes », 2005 (première édition : 1997)
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, Le Castor Astral, « Millésimes », 2005 (première édition : 1997)
Placé sous la double autorité du fameux Je me souviens de Perec et du (pas assez fameux) Mes inscriptions de Scutenaire, frappé par son titre du sceau d’une (vraie ?) modestie peu justifiée (l’auteur a sans doute raison de se dire « ce n’est sûrement pas avec un bouquin comme ça que je vais décrocher le Goncourt », mais ses pensées auraient-elles leur place « sur du papier hygiénique », sous prétexte « qu’on ne peut jamais dire exactement ce qu’on pense » ?), ce livre réussit à proposer mille réponses à une seule question : « A quoi tu penses ? » (à deux variations minimales près, au début et à la fin). Il obéit ainsi à une première contrainte, celle de la question unique ; à la réflexion, il y en a d’autres : la brièveté des réponses (une, deux, trois lignes, rarement plus) ; la dispersion thématique (même si quelques-unes ont l’air de bien s’entendre entre elles, comme celles qui mettent en abyme le motif central de la pensée, à distinguer d’ailleurs de la songerie, car « c’est dans les mauvais livres que l’on écrit "A quoi tu songes ?" ») ; l’autobiographie, faisant la part belle au « je », un « je » miroir dans lequel le lecteur peut se contempler sans vergogne, comme c’est le cas pour toute véritable autobiographie littéraire.
Se dessine, en filigrane ou en clair, l’histoire d’une vie en deux dimensions, extérieure et intérieure, avec les amours, les amitiés, les inimitiés, la tendresse paternelle, l’angoisse du temps qui file vers la mort, les questions que se pose un écrivain sur son écriture, mais aussi sur l’art, la religion, la politique, la philosophie… Livre on ne peut plus humain, donc, où les sentiments ont leur place, sans exclure l’humour et le jeu verbal. Hervé Le Tellier, éminent membre de l’Oulipo, n’hésite pas à invoquer implicitement ou explicitement les mânes de Queneau ou de Perec, et à leur suite à creuser profond dans l’âme humaine en se maintenant dans un cadre strict.
Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable fait partie de ces livres que le critique voudrait laisser parler. Alors, sans dévoiler ses charmes secrets, laissons-en deviner quelques contours en citant un cent vingt-cinquième (à peine) de l’ensemble :
« Je pense que lorsque je suis modeste au cours d’une conversation, j’ai peur que l’on ne s’en rende pas compte ».
« Je pense que je suis triste et je ne sais pas pourquoi ».
« Je pense que pour arriver à concilier l’amour et l’humour, il faut un peu d’amour et beaucoup d’humour ».
« Je pense que ce n’est pas en lisant qu’on devient liseron ».
« Je pense qu’à trente ans, j’ai vraiment compris la mort, mais que je ne l’ai toujours pas admise ».
« Je pense qu’il y a quelque chose d’inexplicable dans le fascisme, tout comme dans la connerie d’ailleurs ».
« Je pense que le malheur est la preuve négative du bonheur ».
« Je pense que j’aimerais bien partir en week-end avec Mme Bovary ».
Les quatre premiers titres de la nouvelle collection « Millésimes » du Castor Astral sont des rééditions d’Emmanuel Bove, de René Guy Cadou, de Francis Dannemark et d’Hervé Le Tellier. Excellentes remises en mémoire, parmi lesquelles le choix des mille pensées d’un « amnésique » s’imposait.
Jean-Pierre Longre
22:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Le droit de s’emparer de tout
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Esthétique de l'Oulipo, Le Castor Astral, 2006.

« Existe-t-il une approche oulipienne de l’esthétique ? Une esthétique oulipienne ? Quitte à décevoir, affirmons-le : sous cette formulation brutale, certainement pas. Le groupe est lié par un refus commun, celui du hasard, et non par une quelconque théorie du beau ». Qu’est-ce à dire ? Hervé Le Tellier cultiverait-il le paradoxe gratuit ? La provocation ? Pas vraiment. Il n’y a pas de « beau » oulipien, mais il y a une « création » et une « réception » oulipiennes, qui peuvent être étudiées, et c’est à cette étude que se consacre l’un des piliers actuels de l’Ouvroir de Littérature Potentielle, dans une perspective à la fois vulgarisatrice, scientifique, et tout de même un peu ludique, forcément.
Cinq chapitres qui se succèdent dans un ordre logique (« Fondation et influences », « Univers (et niveaux) « naturels » de complicité », « Immédiatetés culturelles », « Lecteur, encore un effort », « La forme, la contrainte et le monde » (ou « Desseins et dessins », on ne sait pas bien)) convergent vers l’idée d’un oulipisme humaniste : le groupe que fondèrent légitimement Raymond Queneau et François Le Lionnais (avec quelques autres) et qui fonde sa légitimité sur les contraintes formelles serait l’un des ultimes lieux où l’homme trouverait une place, « parce que la potentialité de la littérature est une forme de revanche dérisoire sur celle de l’existence » ; lieu de complicité, « choix de création, ironique et désenchanté ».
Oui. Et comme « l’Oulipo revendique, avec d’autres, le droit des poètes à s’emparer de tout », Le Tellier poète laisse parler Le Tellier poéticien, analyste et théoricien. S’il recense les principaux procédés contraignants de la création oulipienne – des poèmes à forme fixe à l’homophonie (« l’homme aux faux nids ») en passant par le pastiche, la parodie, le contrepet, l’acrostiche, le palindrome, le lipogramme, le « S+7 » et quelques autres manipulations –, il les place dans le contexte général de la création. Et s’il étudie les rapports de l’Oulipo avec le surréalisme, avec les mathématiques, avec l’art, il rappelle que tout cela se situe dans un vaste cadre : celui de la littérature.
Alors, il ne paraît pas inutile qu’il participe aux tentatives de définition et d’évaluation de la littérature ; qu’il rappelle le rôle des mots et de la langue dans la poésie (« il y a chez tout poète cette utopie cratylienne de la langue »), ainsi que la richesse de la multiplicité linguistique (jeux lexicaux et orthographiques à l’appui) ; qu’il développe le concept d’intertextualité afin de montrer comment les textes oulipiens s’inscrivent dans la « généalogie de la littérature »… Et il ne paraît pas hors de propos d’affirmer que cette Esthétique de la littérature, destinée à la fois à faire le point sur 45 ans de vie commune, à replacer cette vie dans le champ littéraire général et à ouvrir des horizons nouveaux, est un ouvrage nécessaire.
Jean-Pierre Longre
21:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/06/2017
Laisser dormir le passé
 Francis Dannemark, Martha ou la plus grande joie, Le Castor Astral, 2017
Francis Dannemark, Martha ou la plus grande joie, Le Castor Astral, 2017
Le passé de Martha est douloureux : son mari radiologue « mort d’un cancer foudroyant » en 2011, puis pour elle une grave chute qui a entraîné deux ans d’hospitalisation et de soins divers, ainsi qu’une mémoire défaillante et des réactions parfois déconcertantes. Malgré cela, avec ses gestes et ses mots inattendus et au fond si appropriés, son sourire contagieux et son regard curieux de tout, c’est un vrai bonheur qui émane de toute sa personne.
Avec son frère jumeau Martin (le narrateur), elle rend visite à Jeanne, une dame âgée qui vit dans l’Yonne et a des révélations à leur faire à propos de leur père. Des révélations qui vont plus loin que ce à quoi ils s’attendaient, donnant une dimension nouvelle à la vie et à la personnalité de leur père et de ses relations avec cette vieille femme d’autant plus attachante que son récit est d’une sincérité absolue, nécessaire et vitale : « Jeanne a cessé de parler. Je l’ai vue fermer les yeux, comme s’il s’agissait de se concentrer très fort. Quelques minutes plus tôt, j’avais senti monter en moi une peur sourde, allait-elle s’effondrer, ou s’éteindre comme une bougie ? Non, elle irait jusqu’au terme de son récit. C’est de la force que je sentais en elle maintenant, et j’en étais bouleversé. ».
Autour de l’histoire centrale en tournent quelques autres, en particulier celle de John, écrivain irlandais dont Martin traduit les œuvres, qui est bizarrement accusé de plagiat et qui s’est retiré du monde pour vivre en paix dans un petit village. L’auteur en fait à l’occasion son porte-parole stylistique : « J’ai peur des trop belles phrases. L’important, c’est qu’une phrase soit si juste qu’on en oublie qu’elle est belle. » – et voilà qui se vérifie à la lecture du roman de Francis Dannemark, dont l’écriture comme naturelle ne laisse rien au hasard.
Oublions donc la beauté des phrases pour apprécier celle des personnages et de leur monde. Malgré les accidents de la vie, les incertitudes de la volonté et les caprices du destin, aucun être n’est mauvais ; tous sont profondément humains : Jeanne à coup sûr, et les hommes qu’elle a connus ; Septime le garagiste au grand cœur, qui ravive celui de Martha ; le frère, la sœur et leur famille… Et ces êtres humains, dans leurs gestes, leurs paroles, donnent à l’ensemble une atmosphère apaisante dont l’oubli des fêlures est une condition : « Le passé a bien le droit de dormir maintenant. Moi, en tout cas, je n’ai plus envie de le réveiller. », dit Martha qui préfère contempler les fleurs bleues ; la fleur bleue, cet idéal que, depuis Novalis, beaucoup se sont échinés à chercher, et qui semble ne pouvoir se réaliser que si sa recherche s’accompagne de « la plus grande joie ». Et la vie va s’écouler, paisible comme l’Yonne.
Jean-Pierre Longre
23:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, francis dannemark, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/08/2010
Enfant espiègle et poète chevronné
 Francis Blanche, Mon oursin et moi, Le Castor Astral, coll. « Les inattendus », 2005
Francis Blanche, Mon oursin et moi, Le Castor Astral, coll. « Les inattendus », 2005
Homme des canulars téléphoniques et de Signé Furax, des seconds rôles comiques et des sketches débridés, complice de Pierre Dac et humoriste au énième degré, Francis Blanche (1921-1974) est en outre (ou avant tout ?) un sacré poète. Mon oursin et moi le prouverait s’il en était besoin, dans la tonalité particulière que donnent à l’ensemble les derniers vers du premier texte en forme d’autoportrait (qui prête son titre au recueil) :
« ce garçon est vraiment très bien
il réussit à être drôle
avec un oursin dans la main ! »
Francis Blanche est un mélancolique révolté (ou l’inverse), un idéaliste déçu, un clown en rupture de modernisme, qui rêve sa vie « les yeux grands ouverts » et chante les pleurs que les hommes suscitent en se faisant la guerre et en fabriquant des machines de mort, cette mort que l’on rencontre au coin des vers et dont les joies de l’enfance ne peuvent effacer l’obsession. Du lyrisme donc, entre chanson et poésie savante, agrémenté de pirouettes diverses (une belle et tendre évocation de la campagne, par exemple, pour rappeler l’essentiel : « Mais ramène surtout du beurre… et des œufs frais »), de jeux sonores et verbaux, de parodies et de calembours dont certains sont restés fameux (« Pour que l’école dure / amis, donnez ! »), dont d’autres concilient technique et rhétorique oratoire (« Mon Dieu qu’elle est polie Esther ! / Mon Dieu comme il est fort Mika ! »).
Aucune concession à la facilité dans ces textes où se côtoient et se recoupent l’absurde et le rire, le sourire et le désespoir. Francis Blanche n’hésite pas à se plier aux contraintes formelles, et la force de ses vers est d’autant plus efficace qu’elle se coule dans les formes traditionnelles : la fable dont la moralité ne laisse jamais indifférent, le bestiaire dont la fantaisie peut confiner au surréalisme, parodie et hommage confondus, le sonnet virtuose, le conte en vers et même l’acrostiche, le tout entrelardé de proverbes détournés mêlant la densité du haïku, le ludisme du choc verbal et la profondeur existentielle… Quelques exemples ? « Qui rit vendredi boira quarante jours plus tard » ; « La caravane passe… les aigris restent »… Et si par hasard quelques mauvais coucheurs mettaient en doute le talent littéraire de l’auteur, ils ne pourraient nier son acuité de lecteur : les allusions plus ou moins voilées aux grands anciens, La Fontaine, Rutebeuf, Apollinaire, Saint John Perse, Mallarmé et une ribambelle d’autres fondent l’écriture sur une culture de véritable érudit. Patrice Delbourg qui présente le volume, Armand Lanoux, Jean-Marie Blanche et Evelyne Tran qui signent les postfaces ne s’y trompent pas.
Voilà une édition sérieuse (d’ailleurs Francis Blanche en avait lui-même choisi les textes), utilement complétée par une biographie et une bibliographie, pour un faux naïf et un vrai écrivain qui faisait tout pour qu’on ne le prenne pas au sérieux, en toute lucidité :
« Ça ne tourne pas rond dans ma petite tête
Des fois j’ai des drôles
D’idées
C’est pas ma faute mais quand je m’embête
Faut que je fasse
Des conneries ».
Jean-Pierre Longre
18:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, francis blanche, le castor astral | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2010
Un bébé plein de potentialités
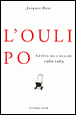 Jacques Bens, L’Oulipo, Genèse de l’Oulipo 1960-1963, Le Castor Astral, 2005.
Jacques Bens, L’Oulipo, Genèse de l’Oulipo 1960-1963, Le Castor Astral, 2005.
En 1980, Jacques Bens publiait chez Christian Bourgois ou li po 1960-1963, regroupant, précédés d’un « acte de naissance », les comptes rendus des réunions de l’Oulipo durant les trois premières années de son existence. Noël Arnaud, à la fin de sa préface, écrivait : « Nous voulions simplement représenter la photographie sans retouche du bébé OuLiPo à ses premiers pas mal assurés, s’essayant à articuler ses gazouillis, mais laissant déjà entendre à travers ses balbutiements des mots pleins de sens qui vont dicter son destin ».
La relation fidèle (même si non exhaustive) de cette « naissance » (terme qui en sous-titre eût été plus approprié que « genèse », qu’il faudrait réserver aux œuvres pré-oulipiennes – ou aux « plagiats par anticipation » – dont est parsemée l’histoire de la littérature depuis les temps les plus anciens), cette relation fidèle est reprise à bon escient par le Castor Astral. Dans sa préface et sa postface à cette nouvelle édition, Jacques Duchateau rappelle les circonstances de la création, par Raymond Queneau et François Le Lionnais, de ce groupe (« séminaire » ? « Olipo » ?... dénominations incertaines au départ) issu des discussions de la décade de Cerisy consacrée à Queneau en septembre 1960, en présence (réticente) de l’écrivain ; il insiste à juste titre sur la face mathématique des préoccupations de ses fondateurs (Le Lionnais était « écrivain scientifique » et Queneau féru de mathématiques), fondateurs dont les noms et les biographies sont rappelés : outre les sus-cités, Noël Arnaud, Jacques Bens (évidemment), Claude Berge, Jacques Duchateau (bien sûr), Latis, Jean Lescure, Jean Queval, Albert-Marie Schmidt. Depuis, l’eau a coulé, le bébé a grandi, les recherches se sont diversifiées, les chercheurs se sont renouvelés (citons au moins Georges Perec, Italo Calvino, Jacques Roubaud, François Caradec, Jacques Jouet, Marcel Bénabou, Paul Fournel, Hervé Le Tellier, Michelle Grangaud, Anne Garréta, et les autres… ; citons aussi des branches annexes comme l’Oulipopo – littérature policière –, l’Oupeinpo – peinture –, l’Oubapo – bande dessinée…).
Ouvrage des plus sérieux donc, document irremplaçable, prouvant sur le vif et avec la spontanéité du discours direct que les réunions de l’Oulipo n’étaient pas seulement l’occasion de réjouissances culinaires assorties d’une joie toute pataphysique, mais aussi et surtout de vraies séances de travail (ce qu’elles sont toujours), avec communications diverses, élaborations de contraintes nouvelles, composition de textes dont plusieurs sont annexés aux relations de ces séances. Certains des exercices ainsi pratiqués, fondés sur la polysémie, l’isovocalisme, l’isosyntaxisme, les jeux de rimes, de rythmes, de sonorités, de signes, de lettres sont restés gravés dans les annales du groupe, poursuivant leur chemin jubilatoire dans les territoires de la poésie.
S’il en était besoin, cette réédition enrichie montrerait que la vitalité qui caractérise l’Oulipo adulte n’est pas un hasard : elle est inscrite dans ses gènes.
Jean-Pierre Longre
22:42 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, oulipo, jacques bens, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/06/2010
Écriture rétrospective
 OuLiPo, Moments oulipiens, Le Castor Astral, 2004
OuLiPo, Moments oulipiens, Le Castor Astral, 2004
Que sont les « moments oulipiens » ? « Une sorte d’autobiographie collective de l’auteur collectif qu’est L’Oulipo », comme l’écrit Jacques Jouet ? Une espèce de suite d’ou li po 1960-1963 (Christian Bourgois éditeur, 1980), comptes rendus scrupuleux faits par Jacques Bens des réunions du groupe au cours de la période indiquée ? Projet romanesque de Raymond Queneau (découvert par Jacques Roubaud) transformant des personnes bien réelles, identifiées au moins par leurs initiales et par la table des matières, en matériau narratif et en personnages fictifs ? Reconnaissance de « traits de famille » (la famille Quenouillard) ? Quoi qu’il en soit, Anne F. Garréta avoue, à l’instar du secrétaire définitivement provisoire Marcel Bénabou, que « le moment oulipien n’est pas une forme », qu’il est « le moins oulipien des pratiques scripturaires », ce à quoi Paul Fournel répond par anticipation : « Il y a des moments oulipiens dont on voudrait se souvenir davantage. Il faut dire à leur décharge, qu’ils ne deviennent « moments » que plus tard. Sur le coup, ils sont légers comme la vie et se tissent dans la toile des choses communes ». En tout cas, « on ne se baigne jamais deux fois dans le même moment oulipien » (vérité bien sentie par Anne F. Garréta encore).
Trêve de citations. À l’abri des figures tutélaires de François Le Lionnais, Raymond Queneau et Georges Perec, onze oulipiens (dans l’ordre d’entrée en scène Jacques Roubaud, Marcel Bénabou, Paul Fournel, Harry Mathews, François Caradec, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier, Bernard Cerquiglini, Michelle Grangaud, Olivier Salon et Anne F. Garréta), onze oulipiens donc (11, « chiffre palindromique », rappelle Michelle Grangaud) s’adonnent aux joies des souvenirs (un peu, sous une autre forme ou en l’absence de forme déterminée, comme Perec avec ses « Je me souviens ») et à l’art de l’écriture rétrospective (car, rappelons-le, « il n’y a pas que la rigolade, il y a aussi l’art »). Episodes divers, qui parfois se recoupent (rien de plus normal : pour un groupe, les souvenirs individuels sont collectifs), relatant réunions, stages, lectures publiques (en France et à l’étranger), errances (temporelles et spatiales), ateliers, ripailles, funérailles, évoquant l’humour et les humeurs de certains membres, les émois et la foi des petits nouveaux… À la faveur de ces « moments », on prend plaisir et intérêt (tour à tour et/ou simultanément) à assister à quelques soirées ou voyages mouvementés, à entendre des calembours de l’almanach Vermot déclenchant le rire de Queneau, à tenter de percer les mystères de l’assassinat de Marcel Duchamp par François Caradec et Alphonse Allais ou ceux de l’identité d’un certain QB, à comprendre qu’un ordinateur ne peut faire la différence entre le substantif « couvent » et le verbe « couver » à la 3ème personne du pluriel, à saisir la contrainte « Canada-Dry » (ou « parapèterie » ou fausse contrepèterie), à se demander comment on peut combiner sans perdre la tête un atelier de l’OuLiPo et la finale de Roland-Garros, à rencontrer au cours des pérégrinations du groupe des personnalités aussi diverses que Paul Auster ou Fabrice Luchini, à mesurer l’insistance avec laquelle François Le Lionnais tient à préciser à Jacques Jouet qu’il est membre, entre autres, de la « société du jouet », à réfléchir sur le roman et les conceptions que Queneau en développe, à se rendre compte que L’OuLiPo peut, au même titre que Proust et Freud, susciter un irrésistible sentiment amoureux…
Pour tout dire, ces Moments oulipiens sont en général drôles, sérieux par instant, graves parfois, émouvants souvent ; ils prouvent en outre que l’Ouvroir est toujours vivant, toujours actif, que l’on y tricote la prose et débite les vers (ne cherchez pas, ce sont des parapèteries) avec toujours autant d’ardeur.
Jean-Pierre Longre
18:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, poésie, francophone, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/04/2010
Principes et nouveautés
 OuLiPo, La bibliothèque oulipienne, volume 6, Le Castor Astral, 2003.
OuLiPo, La bibliothèque oulipienne, volume 6, Le Castor Astral, 2003.
Dans le premier Manifeste de l’OuLiPo, François Le Lionnais, fondateur avec Raymond Queneau du fameux Ouvroir, définissait dans les recherches du groupe « deux tendances principales tournées respectivement vers l’Analyse et la Synthèse. La tendance analytique travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonné. [...] La tendance synthétique [...] constitue la vocation essentielle de l’OuLiPo. Il s’agit d’ouvrir de nouvelles voies inconnues de nos prédécesseurs. »
Le sixième volume de La Bibliothèque Oulipienne, lu dans ce double esprit, répond rigoureusement à « l’anoulipisme voué à la découverte » et au « synthoulipisme (voué) à l’invention ». Comme les précédents (publiés chez Seghers, puis au Castor Astral, de 1990 à 2000), il réunit plusieurs fascicules de textes issus des travaux du groupe et écrits entre 1995 et 1997. Conformément aux principes énoncés dès l’origine, les contraintes y sont diverses, nouvelles et renouvelées, suscitant la poursuite du « grand œuvre ».
Hervé Le Tellier ouvre la marche avec 300 « Pensées » (les « Premiers cents » sur mille), qui toutes commencent par « Je pense » (comme Perec, dans une perspective différente, additionna jadis les « Je me souviens ») ; pensées qui ne dédaignent pas d’être drôles (« Je pense que si tous les gars du monde se donnaient la main, toutes les filles du monde s’ennuieraient ferme ») tout en étant signifiantes (« Je pense que les Q majuscules ont une petite queue, alors que les petits q en ont une grande »), sincères (« Je pense que quand j’écrirai mes Mémoires, je mentirai sys-té-ma-ti-que-ment »), pointues (« Je pense que ce que certains apprécient en Céline, c’est aussi son odieuse folie antisémite, qui les protège du regret de ne pas avoir son génie), et en donnant au lecteur le délicieux sentiment de s’y couler (« Je pense à toi »). Quelques fascicules plus loin, Le Tellier reprend une tradition de la littérature avec 26 textes alphabétiques, tout en rendant au passage hommage au Queneau de Morale élémentaire (« À bas Carmen ! »). Morale élémentaire se glisse encore dans « Un sourire indéfinissable », qui évoque la Joconde selon les points de vue les plus divers (qui valent bien les moustaches de Duchamp).
D’autres hommages : ceux de Michelle Grangaud à ses éminents camarades de l’OuLiPo, avec ses « Sexanagrammatines » - hybridation de l’anagramme (formé sur les titres d’œuvres des susdits camarades) et de la sextine ; de la même à Du Bellay, avec « D’une petite haie, si possible belle, aux Regrets », recueil composé de 191 tercets en forme de haïku : chaque texte « fondu » y est constitué de mots extraits, dans un ordre ou dans un autre, de sonnets du poète de la Pléiade, ce qui donne de vraies belles trouvailles : « Pourquoi moi ? – Pour suivre / la raison. Et je sais bien / que je suis un autre. » ; « Si tu veux la clef, / tu dois changer de secret / avec ton amour. » ; « Que le ciel demeure / le même, notre âge change / d’heure et de saison. »... Hommage encore, collectif celui-là, à Paul Zumthor (« La guirlande de Paul »), compagnon de route de l’OuLiPo, à la mémoire duquel ses amis composèrent poèmes médiévaux ou de métro, anagrammes et autres...
Jacques Jouet, après avoir tenté de résoudre le « mysthème de la chambre close » grâce à une « connaissance approfondie de la littérature », et notamment de la sextine et de la méthode S+7, y va lui aussi de son hommage, à Georges Perec : émouvante énumération d’« exercices de la mémoire », qui rappellent s’il en est besoin « qu’en 1978, Georges Perec a publié un livre intitulé Je me souviens ».
Les anciens ( ?) se répartissent les autres rôles. Jacques Bens, désormais « excusé » des réunions de l’OuLiPo, fait un magistral « inventaire » des méthodes oulipiennes en 19 variations sur « L’art de la fuite » - clin d’œil et non véritable concurrence à Jean-Sébastien Bach – la concurrence se jouant plutôt entre le S+9, les mots croisés, le tireur à la ligne, « Morale élémentaire » (décidément très courtisée) ou permutations. Jacques Roubaud rumine trois fois, à propos de Cent mille milliards de poèmes (mathématiquement, comme il se doit), de l’année 1991, « année palindromique » (depuis, il y a eu 2002), et de « morale élémentaire » (décidément etc.) dans le but de créer une « morale élémentaire généralisée ». Une quatrième rumination, un peu plus tard, précède « La terre est plate, 99 dialogues dramatiques, mais brefs », où Roubaud s’adonne à la drôlerie (Queneau disait la « connerie ») du langage humain : « - Je est un autre / - Un autre que qui ? » ; « -La terre est ronde. / En Australie aussi ? / - Oui. » ; « - Au revoir. / - Au revoir. / - Tu trouves pas que c’est un peu court, comme dernier dialogue ? / - Oui, mais qu’est-ce que tu veux qu’on dise ? ».
Tout cela se termine par des considérations sur les travaux de l’OuLiPo, fragments d’Un certain disparate du cofondateur François Le Lionnais, suivies de considérations autres et un tantinet différentes de Jacques Roubaud – double manifestation de la diversité du groupe.
L’OuLiPo, « désormais dans son cinquième millénaire », est encore jeune et vigoureux ; souhaitons-lui de le rester.
Jean-Pierre Longre
P.S. : Signalons que le Castor Astral a aussi publié le septième numéro des Cahiers Georges Perec, intitulé « Antibiotiques », entièrement consacré à la biographie du grand Oulipien par David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (1993, traduction française 1994, Le Seuil).
18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

