01/08/2021
Descente aux Enfers
 Árpád Schilling, Éva Zabezsinszkij, Jour de colère, traduit du hongrois par Petra Körösi, éditions L’espace d’un instant, 2021
Árpád Schilling, Éva Zabezsinszkij, Jour de colère, traduit du hongrois par Petra Körösi, éditions L’espace d’un instant, 2021
« Lève-toi / Et marche ! / Indigne-toi ! / Manifeste pour tes droits ! » Deux infirmières, Niki et Erzsi, manifestent leur colère – ce qui va leur valoir, dans un mouvement ironique de récupération politique, d’être décorées par le ministre en personne. La fierté ne va pas durer, car on s’aperçoit vite que cette médaille n’est qu’un leurre : pas d’augmentation de salaire, suppression du service de néonatologie où travaillait Erzsi, qui se retrouve au chômage et ne va trouver qu’un travail subalterne.
Á partir de là, c’est pour elle la descente aux Enfers provoquée par les « anges » qui l’entourent sous la forme de personnages bien réels : le directeur de l’hôpital, l’ex-mari, le patron escroc etc. Erzsi va se débattre au milieu des difficultés pour tenter d’assurer une vie décente à sa mère Erzsébet et à sa fille Evelin. Elle ne mesure pas ses efforts, et comme lui dit sa mère : « Tu te crèves le cul au boulot pour deux fois rien, et regarde-toi dans une glace comment tu es à quarante ans ! » Pleine de sollicitude pour les autres, elle va connaître, d’étape en étape, de scène et scène, la déchéance et la solitude, jusqu’à la chute.
Il y a la dénonciation politique d’un régime, certes, mais aussi celle du libéralisme sans pitié, qui n’admet pas qu’on ait des états d’âme et qu’on tente d’aider les autres. Une pièce de théâtre engagée, au sens plein et large du terme, percutante, sans grandiloquence et sans concessions. Les couplets de la fin font écho à ceux du début, par exemple : « Remédiez / À la bonté maudite, / À l’épidémie / Des fausses moeurs ! / Détruisez / L’hypocrisie, / L’idole / De la dévotion ! ».
Jean-Pierre Longre
Autre parution aux éditions L’espace d’un instant :
Sarah Fourage, Affronter les ombres
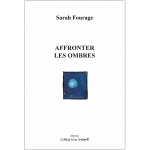 « Dans une petite ville du sud, « aux portes de la Méditerranée », deux femmes se rencontrent sur le parking d’un magasin de bricolage. Quelque chose se tenait là, qui n’y est plus. Une cité tout entière, des logements, des vies, des souvenirs, une mémoire. A-t-on le droit de réveiller un passé hanté par l’horreur de l’Histoire ? Doit-on le taire, tenter de le transmettre ? Librement inspirée de paroles recueillies auprès d’habitants de Lodève, la plupart descendants de harkis, cette fiction théâtrale tente d’évoquer les souvenirs de la Cité de la Gare, où furent logées une soixantaine de familles de harkis en 1962, la création de la Manufacture de la Savonnerie, et l’abandon par la France de ceux qui l’avaient servie. »
« Dans une petite ville du sud, « aux portes de la Méditerranée », deux femmes se rencontrent sur le parking d’un magasin de bricolage. Quelque chose se tenait là, qui n’y est plus. Une cité tout entière, des logements, des vies, des souvenirs, une mémoire. A-t-on le droit de réveiller un passé hanté par l’horreur de l’Histoire ? Doit-on le taire, tenter de le transmettre ? Librement inspirée de paroles recueillies auprès d’habitants de Lodève, la plupart descendants de harkis, cette fiction théâtrale tente d’évoquer les souvenirs de la Cité de la Gare, où furent logées une soixantaine de familles de harkis en 1962, la création de la Manufacture de la Savonnerie, et l’abandon par la France de ceux qui l’avaient servie. »
"Sarah Fourage est née à Nantes en 1975. Comédienne formée à l’Ensatt à Lyon dans les années 2000, elle se met au service d’écritures contemporaines, comme celles d’Emmanuel Darley, Nicoleta Esinencu, Jacques Rebotier… sous la direction de Dag Jeanneret, Véronique Kapoian, Michel Raskine… Dans le même temps elle écrit une quinzaine de pièces dont la plupart ont été commandées et représentées par différentes compagnies, telles que Délit de Façade, La Fédération, Machine Théâtre… Parmi ses thèmes de prédilection, la construction identitaire, l’inégalité sociale, la quête d’émancipation. Elle vit à Montpellier depuis 2005."
21:54 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, hongrie, Árpád schilling, Éva zabezsinszkij, petra körösi, sarah fourage, éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/04/2021
Survivre ensemble
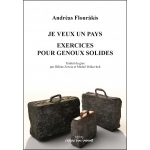 Andrèas Flouràkis, Je veux un pays, traduit du grec par Hélène Zervas, Exercices pour genoux solides, traduit de grec par Michel Volkovitch, préface d’Ekaterini Diamantakou, éditions L’espace d’un instant, 2020
Andrèas Flouràkis, Je veux un pays, traduit du grec par Hélène Zervas, Exercices pour genoux solides, traduit de grec par Michel Volkovitch, préface d’Ekaterini Diamantakou, éditions L’espace d’un instant, 2020
Andrèas Flouràkis, écrivain et homme de théâtre, est l’auteur de nombreuses pièces au rayonnement international. Les deux œuvres publiées dans ce volume sont de factures différentes, mais relèvent de préoccupations collectives et individuelles analogues : survivre à « la crise économique et migratoire » que la Grèce, l’Europe et le monde connaissent à notre époque. Ekaterini Diamantakou analyse parfaitement ces enjeux dans sa préface, « Une double recherche du pays ».
Pour Je veux un pays, les indications de l’auteur sont on ne peut plus simples, laissant toute latitude au metteur en scène : « Personnages : TOUS. Lieu : PAYS. » S’ensuit, sur plus de quarante pages, une série de courtes répliques qui se suivent et se répondent plus ou moins clairement, prononcées par un nombre indéterminé de personnages dont les gestes et les mouvements sont libres. Émigration, voyage sont au cœur des préoccupations, symbolisés par les valises apportées sur scène. « - Nous sommes arrivés au bord du gouffre. / - Il faut agir. / - Il n’y a pas de place pour nous ici. / - Il faut d’urgence trouver un autre pays. / - Émigrer ? » Résolution, rêves, désirs quasiment poétiques, prières contrecarrées, retours sur le passé, désillusions (« Ce pays qui est venu à la place du nôtre est à pleurer »), espoirs… Tout est théâtralement répertorié, tout peut (re)commencer : « Le commencement est la moitié de tout. »
Dans Exercices pour genoux solides, l’atmosphère est aussi différente que la structure. Quatre personnages (« La femme, L’homme, La jeune femme, Le jeune homme »), quatre lieux (« Bureau de la femme, Bureau de réception, Chambre du jeune homme, Chambre d’hôpital »). On passe très rapidement, sans crier gare, d’un lieu à l’autre, d’un dialogue à l’autre, dans une succession de trente-cinq scènes (ou plutôt séquences) parfois fort brèves. La femme, directrice de société, cherche à licencier l’un ou l’une de ses employés, et recourt pour cela à des procédés inavouables et sadiques, dont l’humiliation morale et physique, tout en cherchant à rééduquer son fils porté sur le fascisme et les jeux vidéo. Son absence se scrupules est total : « Mon chéri, l’argent n’a pas de frontières. Il n’a que des propriétaires. Nous virons des gens parce que nous pouvons le faire. Nous rognons les salaires puisque c’est possible. » Il faut donc avoir « les genoux solides » pour garder son emploi et sa place dans une société rongée par les inégalités, les rivalités, la course à la survie, mais aussi par les menaces politiques et les mystères que chacun recèle en soi.
Deux pièces « engagées », dira-t-on, mais dont l’engagement se nourrit d’une réflexion sans schématisation sur la complexité des âmes, des réactions et des destinées humaines, et s’exprime dans une poésie dramatique aux nombreuses ramifications.
Jean-Pierre Longre
Autres parutions récentes aux éditions L’espace d’un instant :
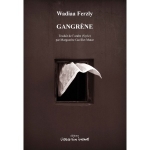 Wadiaa Ferzly, Gangrène, traduit de l'arabe (Syrie) par Marguerite Gavillet Matar, préface Marie Elias.
Wadiaa Ferzly, Gangrène, traduit de l'arabe (Syrie) par Marguerite Gavillet Matar, préface Marie Elias.
« Damas, 2015. Une famille « déplacée » loin des zones de combat. Loin de la maison qu’on a dû abandonner, mais que la mère continue à payer en cachette. Le mari qui perd son travail. Le fils qui sèche les cours, enchaîne les petits boulots et les humiliations. L’arbitraire, la corruption, les privations. La tension de la guerre imprègne le quotidien. La chaleur torride, les rires, les disputes. Et puis le drame. Telle la gangrène, la guerre a ravagé les corps et les âmes. Faut-il rester, s’accrocher à l’espoir de retourner un jour dans sa maison, ou s’endetter encore et prendre le dangereux chemin de l’exil ? Wadiaa Ferzly met en scène avec beaucoup de finesse et d’empathie la vie de ces Syriens victimes de la guerre. »
 Jeton Neziraj, Vol au-dessus du théâtre du Kosovo et Une pièce de théâtre avec quatre acteurs, avec quelques cochons, vaches, chevaux, un Premier ministre, une vache Milka, des inspecteurs locaux et internationaux, traduit de l'albanais (Kosovo) par Sébastien Gricourt et Evelyne Noygues, préface Patrick Penot.
Jeton Neziraj, Vol au-dessus du théâtre du Kosovo et Une pièce de théâtre avec quatre acteurs, avec quelques cochons, vaches, chevaux, un Premier ministre, une vache Milka, des inspecteurs locaux et internationaux, traduit de l'albanais (Kosovo) par Sébastien Gricourt et Evelyne Noygues, préface Patrick Penot.
« Près de dix ans après la fin de la guerre, le Kosovo s’apprête enfin à déclarer son indépendance. Le gouvernement demande alors au Théâtre national de préparer un spectacle pour le jour J. Mais le metteur en scène est soumis à tant de contraintes incompatibles que l’événement connaîtra de multiples rebondissements…
Le Royaume-Uni vient de sortir de l’Union européenne : il y a une place à prendre et le Kosovo vise à l’occuper avant la Serbie. Il s’agit de remplir au plus vite les critères d’accession, ce à quoi tâche de s’employer la boucherie Tony-Blair à Prishtina. C’est sans compter la corruption des fameux inspecteurs et la mobilisation des animaux… »
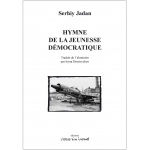 Serhiy Jadan, Hymne de la jeunesse démocratique, traduit de l'ukrainien par Iryna Dmytrychyn.
Serhiy Jadan, Hymne de la jeunesse démocratique, traduit de l'ukrainien par Iryna Dmytrychyn.
« Kharkiv, les années 90. Tout en continuant à écrire, San Sanytch décide de quitter son travail chez les Boxeurs pour la justice, pour se lancer dans le business. L’idée est d’ouvrir le premier club gay de la ville, sous couvert de « loisirs exotiques ». Un spécialiste du show-biz sur le retour est embauché, tandis qu’un partenariat est conclu avec l’administration municipale, qui en profite pour leur glisser un missionnaire australien dans les pattes, alors qu’il faut repousser les velléités de la mafia locale. Mais l’entreprise tourne au désastre. Derrière cette comédie quasi balkanique, qui conjugue absurde et burlesque, sont évidemment dénoncées l’intolérance et la corruption au sein d’une société post-révolutionnaire qui découvre la liberté et la démocratie à l’occidentale. »
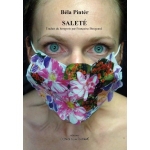 Béla Pintér, Saleté, traduit du hongrois par Françoise Bougeard, préface Béla Czuppon.
Béla Pintér, Saleté, traduit du hongrois par Françoise Bougeard, préface Béla Czuppon.
« Celle qui n’est pas aimée ne comprend pas vraiment pourquoi elle est « si peu » aimée. Elle blâme le monde pour cette injustice ou encore les gens pour leur apathie, alors qu’en fait tout le monde l’évite à cause de son intelligence émotionnelle aiguë, de son égoïsme et de son étroitesse d’esprit. Et l’éviter est bien ce qu’ils font tous. Ils n’ont pas vraiment envie de lui adresser la parole. Ne pas être aimé est une agonie. Sourcils froncés, on serre les dents, et les mains deviennent des poings. C’est dans des instants comme ceux-là qu’elle devient dangereuse. Elle, qui n’est pas aimée. »
11:19 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, grèce, syrie, kosovo, ukraine, hongrie, andrèas flouràkis, hélène zervas, michel volkovoitch, ekaterini diamantakou, wadiaa ferzly, marguerite gavillet matar, marie elias, jeton neziraj, sébastien gricourt, evelyne noygues patrick penot, serhiy jadan, iryna dmytrychyn, françoise bougeard, béla czuppon éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/02/2011
Mortelle réalité
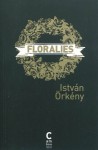 István Örkény, Floralies, traduit du hongrois par Jean-Michel Kalmbach, Cambourakis, 2010
István Örkény, Floralies, traduit du hongrois par Jean-Michel Kalmbach, Cambourakis, 2010
Les (a)mateurs des Loft story, Koh-Lanta et Îles de la tentation diverses supporteraient-ils de voir mourir sur leur écran des volontaires pour ce genre de télé-réalité ? Peut-être, puisque ça passerait à la télévision… C’est en tout cas ce que propose, bien avant l’invention de ce genre d’émission, et sous couvert d’une argumentation philosophico-humaniste un peu spécieuse, le héros du roman d’István Örkény (1912-1979), dont les livres méritent vraiment d’être connus.
Áron Korom, jeune réalisateur, frappe à différentes portes pour mener à bien son projet : montrer aux téléspectateurs « les dernières heures de trois malades incurables », dans la vérité de leur agonie. Il a trouvé trois personnes qui, contre rétribution (à leurs héritiers, bien sûr), acceptent de laisser filmer leurs derniers instants ; et au bout de ses démarches, ses supérieurs lui donnent l’autorisation de créer le documentaire Notre mort (titre qui, suprême ironie, sera changé en Floralies…). On s’en doute, tout ne va pas pour le mieux lors du tournage. En particulier, comment prévoir le moment précis du décès de chaque « acteur » ? Le premier a devancé l’appel, et c’est sa veuve qui raconte les derniers instants du personnage. Pour les deux autres, le film pourra se faire, mais au prix de compromis, d’anticipations, d’artifices, bref de l’hypocrisie télévisuelle que l’on connaît bien, mais qui, lorsque c’est la mort d’un humain qui est en jeu, paraît d’autant plus odieuse. Même s’« il suffit de vouloir fortement pour réussir », peut-on « pondre un infarctus conforme aux desideratas de la télévision » ?
Ce pourrait être morbide et dramatique, c’est plutôt vivace et cruel, satirique et drôle. Le traitement du sujet par l’absurde, le ton du récit, le découpage théâtral des scènes, l’allant des descriptions, le naturel des dialogues, tout cela fait de Floralies un exemple achevé de savoureux humour noir.
Jean-Pierre Longre
13:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, hongrie, istván Örkény, jean-michel kalmbach, cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

