28/01/2026
Les voix du corps, de l’âme et de l’esprit
 Alta Ifland, Voix de Glace / Voice of Ice, recueil bilingue français-anglais, préface de John Taylor, Les Figues / Puctumbooks, 2025
Alta Ifland, Voix de Glace / Voice of Ice, recueil bilingue français-anglais, préface de John Taylor, Les Figues / Puctumbooks, 2025
Le parcours biographique et linguistique d’Alta Ifland est singulier : de la Roumanie aux États-Unis, des États-Unis à la France, du roumain à l’anglais, de l’anglais au français. Les textes de cette « Voix de Glace » qu’elle fait entendre ici sont, en l’occurrence, présentés en français et en anglais, les deux langues de l’exil. Et, comme s’ils voulaient recouvrir une vie entière, ils commencent avec « Naissance » et finissent avec « Mort », en une sorte de lutte commune : « Nous luttons contre la mort et nous luttons contre la vie. »
Cette double lutte existentielle est d’ailleurs au cœur de certains textes invoquant un dédoublement de la personnalité, à la fois présence et reflet (comme dans la « glace », polysémie suggérée par le titre), corps et ombre, mère et enfant, « femme vêtue de blanc » et « homme en noir ». « Je sais que moi n’est que l’ombre douteuse et invraisemblable de mon double. » La référence à Rimbaud proposée par John Taylor dans sa préface est judicieuse – et l’on pourrait aussi penser à d’autres poètes comme Hector de Saint-Denys Garneau. Cela peut induire, clairement ou non, des tableaux fantastiques telle la mise à nu des corps devenus squelettes (« la chair épluchée »), les visions de la mort et de la destruction des êtres (« Les yeux crevés », « Les lépreux ») ou des choses (« Ses murs s’écroulent avec un bruit de neige blessée à vif »), et la quête désespérée de soi : « Quelque part derrière une porte dans une ville il y a un corps qui est le mien. Mais je ne saurai jamais lequel. » Ce qui n’exclut pas les images à caractère surréaliste, mettant en regard, par exemple, la « noblesse » et un « spectacle digestif », ou présentant des scènes où se côtoient « une bûche de Noël mangée par un chien inexistant », une « dentelle », le « bureau de Tourgueniev » et « un tournesol dont je n’ai rien à dire ». Le jeu sur les mots, parfois, forme une image étrangement cubiste : « Le nez de mon dos se reflète bizarrement dans l’œil de ma cheville. »
Voilà, dira-t-on, que l’humour n’est pas loin, et on aura raison. Il est là, parfois avec « la douceur des choses », parfois dans des scènes tournant au burlesque, parfois encore dans des portraits sarcastiques, comme ceux des « professeurs au nez pédant et hoquets ataviques » ou d’une voisine « le visage tendu par les nombreuses chirurgies esthétiques, la peau translucide à cause du sérum, la bouche ouverte dans la grimace permanente d’un sourire avorté… » Au-delà du sourire sans concessions, il y a le temps qui passe et les souvenirs qui nous rappellent qui est l’autrice, semblable à « cette émigrée dont je connais l’histoire, une jeune fille qui débarqua – pardon, atterrit – à New York un jour de septembre au début des années quatre-vingt-dix », elle qui se rappelle « la cuisine d’été » dans son pays natal : « Et le feu ne se lassait pas de se réfléchir dans ses yeux, y laissant les souvenirs à venir, et dans ses yeux le temps s’arrêtait et le présent coulait dans le passé et le passé dans l’avenir, riche de silence et de mots. »
Ensemble aux tonalités et aux genres divers, tenant tantôt (ou en même temps) du poème en prose et du récit, de l’évocation onirique et du réalisme morbide, du conte et du mythe, de la réflexion et de la parodie, cette Voix de Glace en appelle à l’esprit, à l’âme, au corps, et offre un concert très dense, quasiment inépuisable, auquel, une fois que l’on a commencé à l’écouter, on a du mal à se soustraire.
Jean-Pierre Longre
19:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, francophone, alta ifland, john taylor, les figues puctumbooks, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/01/2026
Après Le disparu du Caire, une publication à venir le 18 février 2026…
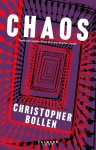 Christopher Bollen, Chaos, traduit de l’anglais par Blandine Longre, Calmann-Lévy, 2026
Christopher Bollen, Chaos, traduit de l’anglais par Blandine Longre, Calmann-Lévy, 2026
Présentation :
Maggie Burkhardt, 81 ans, veuve cosmopolite au tempérament bien trempé, arrive à l’hôtel Royal Karnak au Caire pour fuir un incident survenu en Suisse. Dans ce palace défraîchi au bord du Nil, elle trouve un semblant de paix : une suite confortable et quelques amis discrets. Tous les ingrédients nécessaires pour un nouveau départ, en incarnant le rôle de la gentille mamie de la chambre 309.
Mais un jour, une jeune mère fragile et son brillant fils de huit ans débarquent à l’hôtel et Maggie ne peut s’empêcher de s’immiscer dans l’intimité de cette famille. Peu à peu, Maggie va découvrir des éléments troublants sur ses nouveaux voisins et ce qui avait commencé comme un lien affectif deviendra vite une spirale infernale et violente.
Dans la chaleur écrasante de l’Égypte, une guerre psychologique s’engage, feutrée mais implacable. Qui en sortira vainqueur ?
19:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, christopher bollen, blandine longre, calmann-lévy | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/01/2026
Les mots de la terre
 Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
Lire, relire... Jean-Loup Trassard, Conversation avec le taupier, Le temps qu’il fait, 2007
"Défenseur de la mémoire rurale, de ses traditions, de sa langue et de ses métiers, Jean-Loup Trassard est décédé le 13 janvier à l’âge de 92 ans. Auteur d’une œuvre pour le moins originale dans le paysage littéraire contemporain – elle marie formes verbales et formes visuelles : récits, romans, relevés de témoignage, photographies, livres illustrés –, il a fait du bocage mayennais le centre matriciel de son écriture." ("La Lettre des anges", Le Matricule des anges, 21/12/2026)
Qui se soucie encore des taupes ? Quelques jardiniers, quelques vacanciers retraités soucieux de leur pelouse, quelques rares paysans ? En tout cas, foi de taupier, il y en a de moins en moins, de ces petites bêtes qu’on ne voit pas, qui marchent sous terre, creusant les galeries où elles trouvent leur pitance, laissant derrière elles ces petits monticules qui empêchent de faucher.
Autrefois, il n’y a tout compte fait pas si longtemps que ça, pour s’en débarrasser, les fermiers pouvaient engager un « taupier », sorte de « journalier » assez miséreux mais libre, vagabond mais quotidiennement attaché au même travail, aux mêmes champs, aux mêmes maisons, aux mêmes familles chez qui il se rendait régulièrement. C’est l’un d’entre eux, Joseph Heulot, que Jean-Loup Trassard a su faire parler et dont il a su restituer la vie, avec ses propres mots d’écrivain, avec ceux de son interlocuteur, avec ceux de la campagne – mots du terroir traduits en marge pour éclairer le citadin.
Par la grâce de cette « conversation » entre deux hommes qui s’entendent pour de bon, on apprend beaucoup. D’abord, comment chasser les taupes le plus efficacement possible, alors que certains ont tout essayé : le poison (dangereux pour le bétail et les poules), les boules de gaz (qui ne font que les repousser ailleurs), le fusil (qui en laisse trop)… Non. Il faut être méthodique, prendre son temps, ne pas regarder aux heures de marche et à la fatigue, ne pas hésiter à se salir, repérer les passages, et avoir de l’expérience. Poser les pinces et les « pièges américains » qui claquent juste quand il le faut, ce n’est pas donné à tout le monde ; chasser « à la houette », c’est plus rapide, mais il faut être là au bon moment. On apprend aussi beaucoup sur les taupes – c’est bien normal : sur leur vie, leur survie, leur mort – et leurs peaux que Joseph Heulot peut revendre pour se faire trois sous de plus, et qui servent à faire des manteaux aux dames. On apprend encore sur la vie dans les fermes – l’essentiel, mais juste ce qu’il faut ; car le taupier n’est pas bavard là-dessus, par nature sans doute, par nécessité surtout : ne pas s’immiscer dans la vie des gens, ne pas parler aux autres de ce qui se passe chez les uns, et vice-versa, c’est le seul moyen de rester en bons termes avec tous et de continuer à travailler chez tout le monde. On apprend enfin sur le taupier lui-même, homme pauvre, dont le logis « ressemble à un terrier », qui se nourrit de peu, mais qui garde en lui « chaque champ de son territoire », et qui nous permet, grâce à ses mots, de mieux comprendre les hommes et leur attachement à la terre.
Jean-Pierre Longre
10:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, jean-loup trassard, le temps qu’il fait | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/01/2026
Au-delà de la mort, l’amour
 Nikos Kokàntzis, Gioconda, traduit du grec par Michel Volkovitch, illustré par Anne Defréville, éditions de l’Aube, 2025
Nikos Kokàntzis, Gioconda, traduit du grec par Michel Volkovitch, illustré par Anne Defréville, éditions de l’Aube, 2025
« Ceci est une histoire vraie. » Telle est la première phrase du livre, et l’on peut croire son auteur, tant son récit respire la sincérité, et s’ancre dans l’Histoire de son pays. Nous sommes en Grèce, à Thessalonique, pendant l’occupation allemande. Deux familles voisines vivent en bonne entente, les enfants et les adolescents se retrouvent et s’amusent sur le terrain en friche qui sépare leurs deux maisons. C’est là que Nikos s’éprend de Gioconda, et que se manifeste un amour réciproque et irrépressible. Plaisir des jeux partagés, première crise de jalousie, premier baiser. « Je me souviens encore de ses lèvres contre les miennes, de ce frisson de bonheur. L’amour débordait par mes yeux, mes oreilles, ma bouche, le bout de mes doigts. Ma peau était amoureuse, mon cœur, ma gorge, tout mon corps. Et son amour à elle venait vers moi, j’étais traversé par cette vague chaude, lisse, affolante. Nous ne dîmes pas un mot. Nous étions si proches l’un de l’autre qu’il n’y avait pas de place pour des mots. »
« Amour des âmes, amour des corps », écrit le traducteur Michel Volkovitch dans sa postface. C’est exactement cela, et cet amour aurait pu durer, s’il n’y avait eu le contexte terribe : la présence de l’occupant (contre lequel Nikos s’engage en participant, à la mesure de son âge (15 ans), à la Résistance) ; et l’antisémitisme galopant. Car Gioconda est juive. Une fin d’après-midi, toute la famille est emmenée dans un camion militaire ; Nikos et Gioconda se disent un adieu déchirant : « Elle se mit à trembler tout entière, elle n’en pouvait plus, des sanglots silencieux montèrent à sa gorge, ses larmes débordèrent et s’unirent aux miennes sur nos visages collés l’un à l’autre – ultime contact, promesse, adieu ».
Pour Nikos Kokàntzis, qui rédige ce récit plus de trente ans après la disparition de Gioconda à Auschwitz, celle-ci « n’est plus qu’un rêve. » Mais un rêve qui reprend réalité dans son écriture, en des scènes à la fois réalistes et poétiques, à la saveur érotique et sentimentale, des scènes parfois même fantastiques, telle l’évocation des splendides incendies provoqués par les bombardements alliés sur les entrepôts investis par les Allemands. Les belles illustrations d’Anne Defréville, colorées ou sombres, évocatrices et suggestives, soulignent esthétiquement les épisodes importants d’une narration émouvante, pleine de sensibilité et d’intensité.
Jean-Pierre Longre
19:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, grèce, nikos kokàntzis, michel volkovitch, anne defréville, éditions de l’aube, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/01/2026
Un retour à Salé
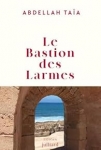 Lire, relire... Abdellah Taïa, Le Bastion des Larmes, Julliard, 2024, Folio, 2026
Lire, relire... Abdellah Taïa, Le Bastion des Larmes, Julliard, 2024, Folio, 2026
Dans Vivre à ta lumière, Abdellah Taïa relatait la vie de Malika, mère lumineuse et obstinée, qui avait économisé « encore et encore » pour construire une maison où faire vivre les onze personnes qui composaient la famille. Dans Le Bastion des Larmes, Youssef, devenu professeur en France, revient momentanément à Salé après le décès de cette mère volontaire (les changements de personnes, de noms et d’activités laissent transparaître, quoi qu’il en soit, le caractère autobiographique du roman) pour vendre le dernier appartement de la maison, dont ses sœurs ont déjà liquidé leurs parts, ces sœurs qui ne se privent d’ailleurs pas de faire des reproches aux fils exilés : « C’est nous qui faisons des efforts pour garder vivante cette mémoire. Pas vous, les garçons. Ni le grand frère Slimane qui nous a oubliées depuis longtemps. Ni toi, Youssef, là-bas, à Paris, en train de vivre je ne sais quoi de soi-disant libre et dont tu ne dis jamais rien. Ni Karim, parti du Maroc comme un voleur. Ce n’est pas vous, les garçons, mais nous, les sœurs, qui faisons tout pour que ce qui a été construit ne s’effondre pas d’un coup. »
 Mais le peu de temps que Youssef reste au Maroc fait ressurgir cette mémoire. Celle de Najib, son amant des années 1980 qui l’a trahi, qui est passé du côté de ceux qui les opprimaient parce qu’ils ne vivaient pas selon les normes, « ceux qui nous tuent tous, chaque jour et chaque nuit. » Najib qui a lui-même été trahi et qui, pour se venger de tous les supplices subis, de toutes les humiliations imposées, est devenu à Salé un trafiquant tout puissant, le roi de la drogue, mais un « Chérif », un saint, « le saint pédé de Salé », « la générosité même avec les habitants », emmenant tout le monde dans sa corruption, et dont les funérailles vont être suivies par une foule considérable. C’est par lui, par son fantôme, que Youssef va découvrir le « Bastion des Larmes », « le cœur même de la ville », là où il peut pleurer Najib, un « endroit magique » au pied de la muraille qui longe l’océan, et dont l’histoire remonte au XIIe siècle, lorsque les Castillans massacrèrent la population de Salé.
Mais le peu de temps que Youssef reste au Maroc fait ressurgir cette mémoire. Celle de Najib, son amant des années 1980 qui l’a trahi, qui est passé du côté de ceux qui les opprimaient parce qu’ils ne vivaient pas selon les normes, « ceux qui nous tuent tous, chaque jour et chaque nuit. » Najib qui a lui-même été trahi et qui, pour se venger de tous les supplices subis, de toutes les humiliations imposées, est devenu à Salé un trafiquant tout puissant, le roi de la drogue, mais un « Chérif », un saint, « le saint pédé de Salé », « la générosité même avec les habitants », emmenant tout le monde dans sa corruption, et dont les funérailles vont être suivies par une foule considérable. C’est par lui, par son fantôme, que Youssef va découvrir le « Bastion des Larmes », « le cœur même de la ville », là où il peut pleurer Najib, un « endroit magique » au pied de la muraille qui longe l’océan, et dont l’histoire remonte au XIIe siècle, lorsque les Castillans massacrèrent la population de Salé.
Livre d’une grande nostalgie et parfois d’une grande cruauté, où des scènes de tendresse voisinent avec quelques scènes difficilement soutenables, comme celles qui décrivent les viols collectifs de jeunes garçons connus comme homosexuels, Le Bastion des Larmes se termine par une lettre de Youssef à sa sœur Kamla, demeurant à Agadir, une lettre sans concessions pour le passé, ses beautés et ses turpitudes, les amours et les haines, mais une lettre magnifique qui veut le rêver, ce passé. « Depuis mon retour à Paris, je passe mes jours et mes nuits à me souvenir de nous autrefois, à revenir à notre lien. Notre pauvreté. Notre beauté. Notre paradis. Notre grande fiction. Je sais que je réécris et que je réinvente sans cesse ce passé. Malgré le noir et le désespoir en moi, malgré les traumatismes et les crises de panique, j’éprouve cette nostalgie étrange d’un espace qui n’a sans doute jamais existé comme aujourd’hui. Une force obscure me pousse à retrouver ce passé, à l’embellir. À ne voir que le printemps, les fleurs, les lilas, les mimosas, les marguerites. » La magie de la fiction, et de la plume d’Abdellah Taïa.
Jean-Pierre Longre
16:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maroc, abdellah taïa, julliard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

