30/11/2018
Chacun à sa place ?
 François Bégaudeau, En guerre, Verticales/Gallimard, 2018
François Bégaudeau, En guerre, Verticales/Gallimard, 2018
Rien ne prédisposait Romain et Louisa à se rencontrer. Lui, plutôt bobo, donnant dans le socio-culturel, elle, employée en CDD dans un entrepôt d’Amazon, habitent la même ville mais ne vivent pas dans le même monde. Leur rencontre fortuite est pourtant le déclencheur d’un certain nombre d’événements qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’amour. « L’entente de Louisa et Romain tient […] d’abord de la convergence d’intérêts. Elle ne feint pas d’être plus que cela. Elle ne se raconte pas d’histoires d’amour. Sa question n’est pas là. ».
Pour tout dire, En guerre n’est pas un roman sentimental. C’est un roman ironique et pessimiste sur la société d’aujourd’hui. D’une ironie cruelle et d’un pessimisme implacable. On peut être d’accord ou non avec le « rien ne peut changer » dans le système actuel, donc avec l’idée que c’est le système qu’il faut radicalement transformer. Mais on ne peut que se laisser porter par la manière incisive dont François Bégaudeau raconte et décrit le fonctionnement d’une société cloisonnée, en quête de vie ou de survie, une société « en guerre » – pendant que se joue, en fond de scène, une autre guerre, celle des attentats de 2015. La victime emblématique de cette guerre est Cristiano, « fort en gueule mais faible en mots », compagnon de Louisa, dont le destin bascule lorsque l’usine Ecolex, où il était employé, ferme et procède à un licenciement collectif. À partir de là, c’est une déchéance progressive – déprime, addiction au jeu, échec social et sentimental – et l’immolation publique. Qui incriminer ? Les patrons et actionnaires, la société, le capitalisme, la faiblesse des politiques, l’impuissance des syndicats, la compagne délaissée et son amant, le briquet qui a mis le feu, la personne qui a prêté le briquet ?
Il y a bien d’autres péripéties, bien d’autres histoires esquissées ou menées à terme – ce terme étant souvent un cul-de-sac. Dans cette fiction du réel, disons un récit dans lequel, autour de personnages fictifs, tourne, d’une manière parfois vertigineuse, le réel social d’aujourd’hui, l’auteur n’hésite pas, par le jeu d’une écriture où la satire du langage à la mode, des faux engagements et des bonnes consciences fuse vigoureusement, à prendre une sorte de distance humoristique confinant volontiers à l’autodérision, ce qui permet au lecteur de supporter la tragédie. Cette tragédie, c’est celle de la toute-puissance des uns, de l’impuissance des autres – impuissance à laquelle se résignent certains, comme la mère de Louisa : « Les pauvres parfois crient à l’injustice. Ils crient d’autant plus fort qu’au fond d’eux ils estiment leur sort justifié. Au début des temps un verdict juste a été rendu qui les assigne aux soutes. À leur disgrâce il y a une cause réelle et sérieuse. ». La leçon de tout cela, qui laisse peu de place à l’espoir, on pourrait la tirer de la conscience « frétillante » d’Alban, jeune homme de bonne famille qui a voulu devenir avocat spécialisé dans le droit du travail : « Le champ social est une scène d’opérette où les costumes drapent des vides, où les fonctions sont des leurres, où la distribution des places n’est pas plus fondée que l’agencement des bâtons de mikado. »
Jean-Pierre Longre
18:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, françois bégaudeau, verticales, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/11/2018
Misère et rédemption
 William Kennedy, L’herbe de fer, traduction de l’américain et postface de Marie-Claire Pasquier, Belfond, 2018
William Kennedy, L’herbe de fer, traduction de l’américain et postface de Marie-Claire Pasquier, Belfond, 2018
William Kennedy, né en 1928, journaliste et écrivain, est ce que l’on pourrait appeler un romancier « réaliste ». Entendons bien : la démarche « réaliste » en question ne se confond pas avec le récit journalistique, avec le pur reportage ou la simple enquête, même si elle s’attache à la vie quotidienne ; en l’occurrence celle d’un paria, ancien champion de base-ball, père de famille devenu alcoolique et vagabond urbain pendant la Grande Dépression, et celle de ses semblables et compagnons de rue. Le quotidien de ce Francis Phelan, fait d’errances, de rencontres, de la recherche de quelques dollars pour pouvoir manger, boire, trouver un coin où dormir ou tirer d’un mauvais pas sa compagne Helen, est aussi celui de ses souvenirs et de ses fantômes. Les rencontres, ce sont aussi celles des êtres qu’il fait sortir de leur tombe et avec qui il dialogue comme avec des vivants ; parmi eux, le briseur de grève qu’il tua autrefois d’un coup de pierre, ses compagnons de galère disparus avant lui, et surtout son bébé, Gerald, mort par sa faute : « Si je t’ai lâché, ce n’est pas parce que j’étais soûl. Quatre bières, et la quatrième, je ne l’ai même pas finie. […] Ta mère a dit deux mots : « Doux Jésus », et alors nous nous sommes accroupis tous les deux pour te relever. Mais on est tous les deux restés accroupis quand on a vu ton allure. ».
La mort est à l’origine de la fuite et de la clochardisation, mais le désir de vivre et d’aider les autres à vivre fait le reste. Car si la violence physique et sociale est profondément ancrée dans l’existence de Francis, la générosité, la volonté de se racheter, de retrouver les siens (sa femme Annie, ses autres enfants) sont au cœur du roman. « Francis, il l’avait maintenant compris, avait toujours été en guerre avec lui-même, il entretenait en lui des factions dressées les unes contre les autres. Et s’il devait survivre en fin de compte, ce ne serait pas grâce à tel ou tel dieu de la révolution, mais à force de garder la tête claire et un sens exigeant de la vérité. Cette culpabilité qu’il traînait ne méritait pas qu’on se laisse mourir à cause d’elle. Tout ce qu’elle reflétait, c’était les appétits sanguinaires de la nature. Il fallait vivre, au contraire, tenir le coup, tenir bon contre les débordements de la foule, et leur montrer à tous de quoi un homme est capable pour transformer le mal en bien une fois qu’il s’est fixé ce but. ».
Tout se passe à Albany, capitale de l’État de New York, une ville que William Kennedy connaît bien, puisqu’il y a grandi. Une ville dont les quartiers, les avenues, les rues, les arrière-cours, les coins et recoins sont les lieux vivants du récit, une ville qui est un peu ce que Dublin est à James Joyce ou Paris à Raymond Queneau et quelques autres. Les itinéraires tracés par les errances de Francis et de ses comparses forment un trajet poétique, soutenu par un style qui réserve de belles surprises littéraires, qui suggère des images d’une grande intensité, et qui donne, sous l’aspect monologique de la prose, une vision plurielle de l’être humain : au-delà de la misère, dépasser le désespoir pour trouver une forme de rédemption.
Jean-Pierre Longre
23:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), william kennedy, marie-claire pasquier, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/11/2018
Comment la littérature construit une ville
 Pierre-Julien Brunet, Roanne, regards d’écrivains, anthologie littéraire de Roanne et du pays roannais, illustration de couverture et photographies de Dominique Thoral, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2018
Pierre-Julien Brunet, Roanne, regards d’écrivains, anthologie littéraire de Roanne et du pays roannais, illustration de couverture et photographies de Dominique Thoral, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2018
Pierre-Julien Brunet avertit d’emblée le lecteur : l’entrée en littérature de Roanne, « ville moyenne à plus d’un titre », « ville-étape », voire « non-lieu » littéraire, s’est faite laborieusement, lentement, grâce à des écrivains de passage d’abord (le fleuve, la route, la voie ferrée y jouent un rôle primordial), puis à certains autres qui en ont fait l’un de leurs lieux de prédilection (au moins momentanément). La composition du livre, sans être complètement chronologique, témoigne de cette progression : trois grandes parties (« Une ville où l’on n’a (longtemps) fait que passer », « Une ville qui s’écrit (pour la première fois ») sous l’Occupation », « Une ville où l’on s’arrête (enfin) »), inaugurées par une entrée en matière de Christian Chavassieux, enfant de Roanne, qui parvient à donner poétiquement une somme d’informations sur l’histoire démographique, économique, politique de sa ville, et prolongées, après un beau poème autobiographique de Daniel Arsand, par la mention de « trois mystères littéraires », comme des points de suspension promettant des révélations à venir…
Si Roanne, donc, semble échapper au prestige littéraire, les « regards d’écrivains » n’en sont pas moins éloquents. Et quels regards ! Ceux de Laurence Sterne, Flora Tristan, Valery Larbaud, Antoine de Saint-Exupéry, Barbara, dans des styles et des genres différents, évoquent leurs passages fugaces ou durables dans la ville ou ses environs. Ceux de Joseph Joffo, Robert Sabatier, David Ponsonby, Georges Montardre-Montforez, Hélène Montardre se fixent sur la période de l’Occupation, les écrivains créant des itinéraires vers Roanne vue comme un but idéal, ou à l’intérieur de la ville (notamment Robert Sabatier et Georges Montardre-Montforez). À noter qu’ici, au milieu des français, se glisse étonnamment un auteur de langue anglaise, David Ponsonby, qui, traduit par Pierre-Julien Brunet, raconte avec verve la vie des autochtones, et, allant au-delà des apparences, « se crée sa propre Roanne ». Puis arrivent les écrivains qui « s’arrêtent » sur une ville devenue sous leur plume lieu romanesque (Michel Tournier et Daniel Arsand), lieu de fiction merveilleuse (Louis Mercier), lieu poétique (Francis Ponge et Christian Degoutte) ; au fil des pages, Roanne devient une véritable « construction littéraire ».
Au-delà de la simple recension (qui pourrait être bien plus longue), les textes de cette anthologie ont été choisis pour leur représentativité et leur valeur littéraires, leur capacité non seulement à intéresser le lecteur, à l’instruire et à le renseigner en détail grâce à des notices et à des notes très précises, mais aussi à l’émouvoir. Outre la présence urbaine et humaine de la ville (qui va de soi, dira-t-on), celle de la nature (l’eau, les arbres, les chemins de campagne) est pour beaucoup dans le charme et la profondeur poétiques de l’ouvrage. Ajoutons que celui-ci est un « beau livre », au plein sens de l’expression : le contenu bien sûr, mais aussi le format, la mise en page et, ponctuant les textes, les illustrations et photographies de Dominique Thoral.
Jean-Pierre Longre
22:28 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, pierre-julien brunet, dominique thoral, publications de l’université de saint-Étienne, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/11/2018
Humour trash et satire noire
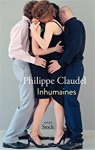 Philippe Claudel, Inhumaines, éditions Stock, 2017, Le livre de poche, 2018.
Philippe Claudel, Inhumaines, éditions Stock, 2017, Le livre de poche, 2018.
La quatrième de couverture annonce : « Nous sommes devenus des monstres. On pourrait s’en affliger. Mieux vaut en rire. ». Oui, on rit, mais plutôt jaune, voire jaune foncé. Dans ce « roman » composé de brefs récits rivalisant d’humour trash et de satire noire, Philippe Claudel s’en donne à cœur joie, jusqu’au défoulement sans bornes, sans ces bornes que nos sociétés apparemment policées se fixent hypocritement.
Des vacanciers insouciants genre Club Med s’amusent chaque soir, depuis leurs jolis bateaux, à voir se noyer des migrants africains. Un mari offre pour Noël à sa femme trois hommes-objets qui finiront au rebut. Un autre (ou le même ? C’est toujours un « je » masculin qui raconte) n’hésite pas à la vendre, sa femme, sur Internet. Lors d’une fête de Noël qui tourne à l’orgie, on assiste au massacre du père Noël ; les enfants sont de la partie, tout contents. La femme d’un suicidaire invite ses collègues de bureau à assister à la pendaison de son mari au cours d’un cocktail qui tourne au Grand Guignol. Par souci d’écologie, chacun doit manger ses morts familiaux (parents, grands-parents, enfants, au hasard des décès). Pour réduire la « fracture sociale », on parque les pauvres dans des camps de travail qui rappellent de terribles souvenirs et que les riches peuvent visiter comme on visite un zoo… On en passe…
 Le lecteur pourrait être écoeuré, s’il ne s’apercevait que ce que décrit l’auteur n’est que la réalité, poussée à l’extrême, de notre vie sociale, professionnelle, familiale, de ses aberrations et de ses absurdités. Le tout sur un rythme effréné, sans pauses, sans concessions. Une caricature ? Une horrible vérité ? Et « pourtant des gestes simples nous contentent : faire la vaisselle. Tondre une pelouse. Peindre une porte. Feindre de respirer. ». C’est ainsi que « la vie devient supportable ». Tentons donc de vivre malgré tout, et rions.
Le lecteur pourrait être écoeuré, s’il ne s’apercevait que ce que décrit l’auteur n’est que la réalité, poussée à l’extrême, de notre vie sociale, professionnelle, familiale, de ses aberrations et de ses absurdités. Le tout sur un rythme effréné, sans pauses, sans concessions. Une caricature ? Une horrible vérité ? Et « pourtant des gestes simples nous contentent : faire la vaisselle. Tondre une pelouse. Peindre une porte. Feindre de respirer. ». C’est ainsi que « la vie devient supportable ». Tentons donc de vivre malgré tout, et rions.
Jean-Pierre Longre
19:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe claudel, éditions stock, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2018
Méconnu et différent
 Erri De Luca, Une tête de nuage, traduit de l’italien par Danièle Valin, Gallimard, 2018
Erri De Luca, Une tête de nuage, traduit de l’italien par Danièle Valin, Gallimard, 2018
Iosèf, descendant de David, « épouse Miriàm enceinte mais pas de lui », et ainsi brave l’inexplicable et « fait front à la loi et à la médisance », anticipant ce que son fils Ièshu dira un jour pour défendre la femme adultère : « Que celui qui est sans erreur jette la première pierre ». La préface de ce court récit en trois étapes (« Une pièce de la cabane », « Une pièce de Jérusalem », « Sur le sommet du Golgotha ») annonce le sujet et donne le ton.
Le sujet : une énième « vie de Jésus » ? Non. Un choix original, tout en finesse et en clairvoyance, d’épisodes autour de la naissance, de la vie privée et publique, de la passion et de la réapparition d’un homme que les Juifs attendaient, en qui ils voyaient le Messie qui allait les libérer du joug de l’occupant, mais dont l’attitude sacrificielle les a déroutés. « Il démissionnait de leur attente. ». « Une tête de nuage est le destin de celui qui est pris pour quelqu’un d’autre. ». Le ton : celui du dialogue intime, tranquille, aimant, souriant entre Iosèf et Miriàm, et avec quelques autres personnages. Voyez par exemple la scène de la visite de « trois seigneurs » qui apportent des cadeaux au nouveau-né. Ou alors, dans un autre registre, lors de la légendaire « Fuite en Égypte » (plutôt, selon le terme grec, le retrait, le « pèlerinage du salut »), le dialogue entre Iosèf et le douanier, barrant le passage à la petite famille de réfugiés, les laissant finalement entrer en apprenant que l’homme est un artisan qualifié. Et le narrateur (l’auteur) d’expliquer ironiquement : « C’était une époque où un pays encourageait les flux migratoires de force de travail, qui augmentaient la production et la prospérité. Il n’existait alors aucun préjugé racial ni aucune discrimination sur la couleur de la peau. Les visages suspects pâles et blonds étaient accueillis eux aussi. ».
Gardons-nous de réduire Une tête de nuage à une actualisation simpliste des évangiles, ou à l’image d’un Christ naïvement contestataire. Erri De Luca, qui s’avoue non croyant, est un lecteur assidu de la Bible ; il en livre ici une vision incisive (retraduisant des mots clés au plus près de leur signification d’origine), poétique (d’une poésie précieuse et précise, annoncée par le titre), une vision qui va au-delà de l’exégèse pour mettre l’accent sur des aspects méconnus et dresser un portrait ineffaçable du fils de Miriàm et Iosèf. « Il était une personne hors du temps, comme c’est le cas des prophètes, des inventeurs, des explorateurs. Il était un résumé de ceux-là et de ce que produit le mieux l’espèce de l’Adàm. Il forçait la frontière du possible et du présent. ».
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, dialogue, essai, erri de luca, danièle valin, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/11/2018
Chercher à élucider
 Yves Wellens, Zones classées / Belgiques, Ker éditions, 2018
Yves Wellens, Zones classées / Belgiques, Ker éditions, 2018
La collection « Belgiques » (pluriel significatif) est consacrée à des recueils de nouvelles dont les auteurs, sur des tons variés, livrent leurs regards sur le pays. Pour Yves Wellens, il ne s’agit pas de dresser le portrait académique d’un pays qu’il connait bien de l’intérieur, avec lequel il entretient des relations sans concessions mais étroites, et dont il prédisait naguère, dans les récits de D’outre Belgique, la disparition. Ni une évocation abstraite, d’ailleurs. Il s’agit plutôt de poser des questions, souvent dénuées de réponses claires, sur certains aspects du pays et de ses habitants, dans une perspective majoritairement historique.
Cela dit, Zones classées n’est ni un essai historique ni un traité politique. C’est avant tout un recueil de nouvelles. Onze nouvelles qui toutes racontent des histoires, mettent en scène des personnages, faisant la part belle, au fil des narrations ou dans leur chute, au mystère et à l’étrange, sans pour autant tomber dans le fantastique ou dans ce que d’aucuns appellent abusivement le « surréalisme ». Il peut s’agir d’une enquête sur une photographie de groupe tronquée (« Je ne sais pas exactement ce que je cherche à élucider », dit le protagoniste), d’un fameux intellectuel accablé de plus en plus fréquemment d’une frénésie verbale compromettante, de retours sur le passé colonial de la Belgique, de changements de configurations urbaines, des méfaits récurrents d’un pickpocket et de ses fumeuses tractations, des tribulations d’une œuvre d’art destinée à une station de métro…
Ces récits (et d’autres), sur lesquels l’auteur laisse planer, comme il sait si bien le faire, des points d’interrogation lourds de significations cachées et de réponses voilées, ne donnent donc pas une description de la Belgique, mais suggèrent des atmosphères, esquissent des tendances, laissent planer des menaces. Celle du divorce (métaphorisé par l’intéressante expérience du « poisson-pilote ») : « Flamands et francophones se partagent le territoire, mais pas grand-chose d’autre. […] La proximité ne les rapproche pas. Même tout près, elles (les communautés) se regardent de loin, alors qu’on pourrait presque voir l’autre depuis sa fenêtre ou le pas de sa porte, comme le poisson de l’expérience peut voir au-delà d’une plaque de verre). » ; ou celle, tout crûment, de la mort du pays : « Personne ne se faisait d’illusion. Le spectre de la disparition du pays dont, un temps, le vol au-dessus des têtes était monté un rien plus haut, n’avait jamais été bien loin. ». Et toujours, la manière Yves Wellens, chez qui le motif de l’effacement, au propre comme au figuré, se combine habilement avec celui de l’art et avec des tentatives d’épuisement des lieux (à la Perec), d’actualisation du passé, et avec un style ciselé faisant résonner des harmoniques profondes et durables, en lien avec les illustrations qui inaugurent chaque texte.
Jean-Pierre Longre
19:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, yves wellens, ker éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/11/2018
Une trilogie épique d’aujourd’hui (et de demain)
 Virginie Despentes, Vernon Subutex, Grasset, 2015 à 2017, Le livre de poche, 2016 à 2018
Virginie Despentes, Vernon Subutex, Grasset, 2015 à 2017, Le livre de poche, 2016 à 2018
Trois tomes, soit plus de 1200 pages, cela ne se résume pas en quelques lignes. Autant s’en tenir au titre, qui donne d’emblée le fil conducteur : Vernon Subutex (dont le prénom rappelle Boris Vian, et le nom, sans détour, un substitut de la drogue), ancien rocker, ancien disquaire, ancien ami du grand Alexandre Bleach, chanteur à succès mort d’overdose, passe par différentes phases existentielles, psychologiques, morales, sociales. Expulsé de chez lui, accueilli (avec plus ou moins d’empressement) par de « vieilles connaissances », puis clochardisé, il va faire l’objet de recherches assidues de la part de gens en quête d’enregistrements secrets d’Alex Bleach, ainsi que de la part de ses anciens amis, qui vont former autour de lui un groupe solidaire. Cela va donner lieu à l’organisation de « convergences », rassemblements dont Vernon, mixeur génial, est la cheville musicale essentielle, entraînant des danses qui n’ont pas besoin du recours à la drogue pour être sans frein.
La trame, rigoureusement construite et menée sans répit, est primordiale ; mais elle est l’axe autour duquel tourne le plus important, le plus foisonnant, le plus passionnant : une description sans concessions mais toute en finesse, aussi brutale que précise, d’une société multiple qui repousse vers les extrêmes les limites de la cohabitation, une succession de portraits en action de personnages qui ont beaucoup vécu, qui ne sont plus tout jeunes mais qui cherchent plus ou moins consciemment une forme de bonheur collectif ; aussi divers qu’attachants, obsédants parfois, ils naviguent tant bien que mal entre les tempêtes de la société actuelle – drogue, alcool, sexe, argent, violence –, mais font preuve aussi de générosité, de désintéressement, d’amour. Du trader sans scrupules au SDF sans avenir, de la mère de famille attentive au transsexuel enfin bien dans sa peau, de l’ancienne prostituée au producteur véreux, de l’alcoolique invétéré à l’universitaire engagé (on en passe beaucoup d’autres), tous sont, en quelque sorte, les protagonistes successifs du roman. Virginie Despentes maîtrise au plus haut point l’art du portrait (et les rappels succincts et clairs placés en tête des tomes 2 et 3 sont bien utiles), mais un art bien à elle. Elle entre (et fait entrer le lecteur) dans toutes les peaux, dans tous les cerveaux, dans tous les cœurs, se démultiplie en personnages de tous bords, de toutes classes, de tous tempéraments, adaptant sans fards son style, son lexique, son niveau de langue à chacun d’entre eux. Bref, elle est la reine du discours indirect libre : c’est l’auteur qui écrit, mais c’est le personnage qui pense.
C’est ainsi que Vernon Subutex semble avoir les caractéristiques du roman réaliste ; d’ailleurs l’intrigue (surtout celle du tome 3) se déroule sur fond d’actualité (attentats de 2015, Nuit Debout, luttes sociales, guerres du Moyen Orient) ; mais c’est un roman qui, à la manière des épopées, poétise le réel sans l’idéaliser, le montrant dans ce qu’il a de désespérant et de prometteur, de violent et de bienveillant, de dur et de tendre, de repoussant et d’attirant, de tragique et de comique. Toutes les dimensions du réel et de ses avatars, donc, où périodiquement l’humour affleure, éclate parfois, dans la narration objective et dans la tête des personnages ; un humour qui relève de la satire, de la dérision, de l’ironie. Tenant de toutes ces tonalités et les dépassant toutes, le dénouement apocalyptique vire à l’épopée d’anticipation, au centre de laquelle Vernon et les « convergences » sont un point d’ancrage historique. Vernon Subutex est une fresque de grande ampleur, que l’on n’est pas près d’oublier.
Jean-Pierre Longre
12:18 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, virginie despentes, grasset, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

