12/10/2023
Une jeune Lyonnaise dans le Yunnan
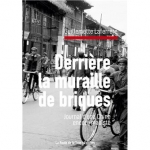 Guillemette Laferrère, Derrière la muraille de briques, « Journal d’une Chine encore maoïste », La Route de la Soie-Éditions, 2023
Guillemette Laferrère, Derrière la muraille de briques, « Journal d’une Chine encore maoïste », La Route de la Soie-Éditions, 2023
Août 1981 : Guillemettre Laferrère, 25 ans, diplômée de l’INALCO, débarque à Kunming, dans la pointe sud-ouest de la Chine, en tant qu’ « experte » : elle va enseigner le français à des adultes (enseignants, étudiants en ingénierie, futurs interprètes…). Par la même occasion, elle ira passer le CAPES de Chinois à Hong-Kong, et elle pourra « assouvir sa soif d’aventures ». Ayant tout récemment retrouvé le pays, et mesurant les « changements radicaux » qu’il a subis en quarante ans, elle a décidé d'attiser ses souvenirs grâce au journal qu’elle a tenu à l’époque et aux courriers envoyés à ses proches.
Cela donne un fort volume empli d’anecdotes émouvantes ou drôles, de descriptions pittoresques, de remarques personnelles ou générales, de réflexions sur la société, la politique, la culture, de tableaux pris sur le vif, de portraits attachants ou incisifs, de récits variés… Le lecteur suit avec un intérêt toujours renouvelé le cheminement quotidien de cette jeune femme en découvrant avec elle les us et coutumes du pays, les types de relations entre et avec les autochtones, les paysages urbains et ruraux, montagnards ou désertiques (au cours de ses escapades et de ses voyages).
Comment choisir ? Il y a les usages auxquels il faut se plier (par exemple, pour les femmes, ne pas être en nu-pieds, ne pas s’étonner devant la manière d’aspirer la nourriture, ne pas se scandaliser devant la mauvaise volonté des employés de commerce ou d’administration, se sortir indemne des bousculades et des coups reçus dans les côtes, n’entraînant pas la moindre excuse…), et ceux auxquels elle décide de s’opposer (demander aux étudiants de ne pas cracher par terre pendant les cours). Il y a le sentiment (fondé) d’être sans cesse espionné, dans le travail, la vie quotidienne, les trajets, et d’être dans un pays fermé : « D’après un étudiant, le seul service efficace en Chine est le service de sécurité. » Un pays fermé par la « muraille de briques », symbolisée par « le mur de briques qui s’élève autour de la maison » où résident les « experts » étrangers. Il y a les aléas du climat (montagnard et tropical), les difficultés de la vie quotidienne, avec son manque d’hygiène, la pollution, l’exiguïté des logements, la pauvreté, le nationalisme politique, mais il y a aussi l’amitié inoubliable de certaines personnes, les découvertes telles que la chirurgie sous acupuncture, les marchés grouillant de nourriture et d’odeurs, les séances de cinéma, les discussions, les visites familiales, les vastes paysages admirés au cours de randonnées, d’ascensions ou de longs voyages en train relatés dans la deuxième partie de l’ouvrage…
Voilà un document foisonnant de détails sur la vie en Chine dans les années 1980, à partir d’une expérience et d’une plongée personnelles au plus profond de cette vie. Mais ce n’est pas tout : la narration, fort bien menée, débouche sur une vision d’ensemble, une mise en perspective qui, malgré la modestie revendiquée du propos, pousse à la réflexion, à l’appui du texte et des photos très parlantes qui occupent les dernières pages : l’évolution technologique du pays, l’élévation du niveau de vie, mais aussi la dictature, la répression (celle des Ouïghours notamment), et plus généralement la question de savoir si les Chinois endurent toutes les vicissitudes de leur vie par passivité ou par endurance. Une interrogation qui dépasse d’ailleurs le cas particulier, et qui est laissée à la méditation de tous.
Jean-Pierre Longre
10:23 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, journal, correspondance, histoire, guillemette laferrère, la route de la soie-Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/05/2016
Journal de l’hypermarché
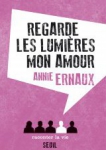 Lire, relire: Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Seuil, « Raconter la vie », 2014, Folio, 2016
Lire, relire: Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Seuil, « Raconter la vie », 2014, Folio, 2016
Rien de plus trivial, rien de plus nécessaire que de « faire ses courses » en grande surface, lieu de survie de l’espèce humaine dans le monde occidental actuel. De cette réalité quotidienne (ou, disons, hebdomadaire), Annie Ernaux a tiré une substance mi-sociologique mi-littéraire en tenant pendant un an le journal de ses passages à l’hypermarché Auchan de Cergy.
On retrouve dans cette relation régulière les sensations, les impressions que l’on éprouve en ces lieux sans leur prêter vraiment attention, en tout cas sans leur donner plus d’importance qu’aux gestes répétitifs d’une existence banale. On y retrouve aussi des contraintes et des agacements plus ou moins éprouvants (le caddie bancal, les bousculades dans des rayons surpeuplés, l’attente aux caisses, la déshumanisation des machines automatiques…), ainsi que la reproduction presque caricaturale des divisions sociales (hommes / femmes, jeunes / vieux, classes populaires / classes moyennes et supérieures). Paradoxalement, l’hypermarché est aussi comme un refuge, un lieu de plaisir personnel, sinon de fascination : « Je suis allée à Auchan au milieu de l’après-midi après avoir travaillé depuis le matin à mon livre en cours et en avoir ressenti du contentement. Comme un remplissage du vide qu’est, dans ce cas, le reste de la journée. Ou comme une récompense. Me désoeuvrer au sens littéral. Une distraction pure ». Une « distraction » qui fait prendre conscience de sa modestie et de son impuissance devant les interdictions diverses (de photographier, de consommer ou de lire sur place etc.) et devant le gigantisme : « L’hypermarché contient environ 50 000 références alimentaires. Considérant que je dois en utiliser 100, il en reste 49 900 que j’ignore ».
 Sociologie et littérature, donc, devant ce qui relève à la fois de l’observation de soi et des autres dans un contexte qui dépasse l’individu : l’auteure est à la fois, sans honte affichée ni fausse modestie, dans le monde (la foule des acheteurs) et hors du monde, puisqu’il s’agit pour elle de prendre du recul par l’écriture. « Voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence ».
Sociologie et littérature, donc, devant ce qui relève à la fois de l’observation de soi et des autres dans un contexte qui dépasse l’individu : l’auteure est à la fois, sans honte affichée ni fausse modestie, dans le monde (la foule des acheteurs) et hors du monde, puisqu’il s’agit pour elle de prendre du recul par l’écriture. « Voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence ».
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, journal, autobiographie, annie ernaux, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/05/2013
Dans l’intimité du Cantor
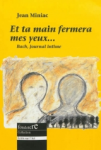 Jean Miniac, Et ta main fermera mes yeux… Bach, journal intime, Fondencre, 2013
Jean Miniac, Et ta main fermera mes yeux… Bach, journal intime, Fondencre, 2013
Le rayonnement de Jean-Sébastien Bach est tel que, souvent, on voudrait percer les secrets de son génie. Vœu irréalisable, bien sûr. Nous sommes voués à écouter (ou à jouer) sa musique, à nous laisser prendre par elle, tout en ayant conscience que jamais nous ne pourrons en mesurer la profondeur.
Percer les secrets du génie, non. L’imaginer dans ses réflexions, ses méditations, ses souvenirs, oui. Pour cela, il fallait un poète qui soit aussi un musicien (ou l’inverse). Jean Miniac, organiste et auteur de plusieurs recueils poétiques, réussit à plonger le lecteur dans l’intimité du Cantor – sans prétendre ni à l’exhaustivité ni à la vérité absolue, bien heureusement.
Et ta main fermera mes yeux… est donc le « journal intime » que Bach aurait pu écrire durant les derniers mois de sa vie. Il aurait pu tenter d’expliquer, par exemple, « pourquoi [il est] devenu musicien », se rappelant un air de son enfance qui le poursuit toujours et avouant sa « manie de la résolution » qui lui fait détester l’inachèvement. Il aurait pu écrire des pages sur le jeu de l’organiste, sur le contrepoint et les voix « mises en dialogue », sur l’univers clos du choral, sur la composition de la fugue, sur les fondements sacrés de sa musique… Il aurait pu évoquer avec pudeur et émotion la mort de Maria Barbara, sa première femme, ou la rencontre de la seconde, Anna Magdalena (en n’hésitant pas, pour l’occasion, à se décrire lui-même sur le mode burlesque).
Jean Miniac tient en quelque sorte la plume du compositeur, en connaisseur et en écrivain. La poésie et la musique fondent ces pages, comme elles fondent l’existence de Jean-Sébastien Bach. Qu’on en juge tout simplement par ces quelques lignes : « J’aime l’eau lustrale qui baigne les accords épanchés du fond du cœur. J’aime leur intense vibration parcourant les cordes qui relient le cœur à la structure même du clavier – et presque nonchalamment – déjà entaché de cette même vibration (les pleurs aussi la ravivent) ; j’aime tout ce qui nous fait bruire, sentir, résonner, palpiter, ondoyer, j’aime les pleurs de l’eau (ou ses murmures), la caresse du vent (ou sa colère), la fureur de l’océan (ou son apaisement) – tous ces excellents maîtres qu’enfant déjà j’aimais appeler : « Mes instituteurs sauvages ». Je leur dois la vie, comme à Dieu même ; tout le reste n’est que broutilles et poussière, acharnement de niais, conquête du vide ».
Jean-Pierre Longre
09:59 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, journal, musique, francophone, jean-sébastien bach, jean miniac, fondencre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/03/2013
Les déambulations d’un érudit
 Pierre Brunel, Rue des Martyrs, Les éditions du littéraire, 2012
Pierre Brunel, Rue des Martyrs, Les éditions du littéraire, 2012
En adoptant le genre, le rythme et le ton du journal personnel, Pierre Brunel s’écarte apparemment de sa vocation de professeur dont les multiples publications sont des références indispensables à la recherche littéraire. Mais il ne rompt pas avec elle. Car toutes les chroniques, tous les rappels, tous les mystères dévoilés qui peuplent ces pages sont d’un grand lecteur, d’un érudit sans cesse à l’affût d’anecdotes littéraires ou historiques, d’un érudit qui se plaît parfois à laisser échapper quelque confidence.
Profitant des promenades de l’auteur dans ce quartier de Montmartre (le Mont des Martyrs) qu’il affectionne, nous croisons aussi bien Rimbaud que Napoléon, Nerval qu’Octave Mirbeau, Mérimée que Victor Hugo, Dreyfus que Zola, Baudelaire que Péguy, André Breton que Georges Duhamel, Edgar Quinet qu’Offenbach (on en passe), et aussi nous faisons la connaissance de Jean-Claude le boucher, de Léon Cladel (auteur des Martyrs ridicule) et d’autres obscurs…
Comme on passe sans raison consciente d’une rue à l’autre, comme on tourne au hasard à gauche plutôt qu’à droite et inversement, Pierre Brunel nous fait passer d’un sujet à l’autre, au gré des rapprochements d’idées et des méandres de la mémoire.
« Et sans un plan sous les yeux
on ne comprendra plus
car tout ceci n’est qu’un jeu
et l’oubli d’un temps perdu »,
a écrit Queneau, qui comme Apollinaire s’y entendait en « antiopées » et a si bien couru les rues de Paris. Ici, le hasard, certes, joue son rôle ; mais il tourne toujours autour des martyrs et de leur rue.
C’est avec les délices mesurées des promenades à pas comptés que nous suivons les itinéraires dans l’espace et dans le temps proposés par l’auteur. À le lire, on a le sentiment que cette rue des Martyrs résonne de rencontres sans lesquelles notre patrimoine ne serait pas ce qu’il est. Et, semble-t-il, elle attire toujours autant qu’aux siècles passés, celle que chantait encore récemment François Hadji-Lazaro dans une rocailleuse et truculente chanson, « Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs ».
Jean-Pierre Longre
15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal, récit, francophone, pierre brunel, les éditions du littéraire, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

