10/02/2025
Maternelle et tenace
 Lire, relire... Abdellah Taïa, Vivre à ta lumière, Le Seuil, 2022, Points 2025
Lire, relire... Abdellah Taïa, Vivre à ta lumière, Le Seuil, 2022, Points 2025
Abdellah Taïa joue franc jeu, dès la dédicace : « Pour ma mère : M’Barka Allai (1930-2010). Ce livre vient entièrement de toi. Son héroïne, Malika, parle et crie avec ta voix. » Histoire vraie, donc, mais devenue roman par le truchement des mots d’un écrivain donnant la parole à sa protagoniste qui monologue, se raconte, raconte les siens, ses proches et tout compte fait la vie du Maroc (d’un certain Maroc) de la fin du XXème siècle.
Une autobiographie en trois temps. À Béni Mellal, elle a trouvé toute jeune l’amour d’Allal, qu’elle épouse avec la bénédiction de son père et le consentement de sa belle-famille, mais qui part faire la guerre des Français en Indochine, pensant gagner suffisamment d’argent : « Un an ou deux de guerre et me voilà riche, un peu riche. » Il n’en reviendra pas, et Malika sera chassée par ses beaux-parents, qui avaient pourtant promis de la traiter comme leur fille.
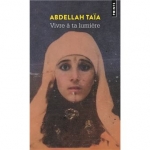 Nous la retrouvons à Rabat, bien des années plus tard, avec son second mari, un homme « gentil » qui l’a aidée à sortir de son complet dénuement et lui a fait de nombreux enfants. Mais c’est elle qui mène son monde, prend les initiatives et défend sa fille Khadija contre la mainmise de Monique, une Française qui voudrait prendre Khadija à son service. Non, Malika rêve que sa fille épouse un homme puissant et riche, un de ceux qui fréquentent le palais royal tout proche. Le destin en ira autrement.
Nous la retrouvons à Rabat, bien des années plus tard, avec son second mari, un homme « gentil » qui l’a aidée à sortir de son complet dénuement et lui a fait de nombreux enfants. Mais c’est elle qui mène son monde, prend les initiatives et défend sa fille Khadija contre la mainmise de Monique, une Française qui voudrait prendre Khadija à son service. Non, Malika rêve que sa fille épouse un homme puissant et riche, un de ceux qui fréquentent le palais royal tout proche. Le destin en ira autrement.
Le troisième épisode, qui se situe à Salé, est une confrontation entre Malika et Jaâfar, un jeune voisin tout juste sorti de prison qui la menace d’un couteau pour voler son argent. Elle lui tient tête, lui parle d’Ahmed, son fils parti en France qui ne donne plus de nouvelles. Impitoyable et maternelle, elle résiste au délinquant et au récit sordide de la vie des prisonniers marocains.
Malika est ce que d’autres appelleraient une « femme puissante ». Mais sa puissance n’est ni politique, même si d’importantes digressions évoquent Ben Barka et le roi Hassan II, ni économique, puisque sa famille vit dans les conditions les plus précaires, même si elle fait tout pour lui construire une maison et la nourrir. « Des années tous les onze dans une seule pièce. Onze ! J’ai économisé centime après centime. J’ai économisé tout ce que je pouvais. Certains mois, je ne leur préparais qu’un seul repas par jour. Ils râlaient. Ils criaient. Nous avons faim ! Nous avons faim, maman ! Je ne pouvais rien faire d’autre. Il fallait économiser encore et encore. Ils trouvaient tous que j’étais devenue impitoyable. Ce n’était pas grave. Un jour, ils comprendraient les sacrifices que j’avais faits pour eux. Les humiliations que j’avais subies à cause d’eux, pour leur donner un toit, une maison. Une vraie maison. » Quoi de plus parlant que ce qu’écrit Abdellah Taïa de cette mère lumineuse, volontaire, tenace ? « C’est Malika qui parle ici. Tout le temps. Elle raconte avec rage les stratégies pour échapper aux injustices de l’Histoire. Survivre. Avoir une petite place. » Son fils, par la magie de la littérature, lui a donné une vraie place.
Rappel: le récent livre du même auteur, Les Bastion des Larmes
Jean-Pierre Longre
10:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, maroc, abdellah taïa, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/12/2024
Conte de mort, de vie et d’amour
 Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
Lire, relire... et voir... Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
Film franco-belge d'animation réalisé par Michel Hazanavicius, novembre 2024
« Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! », précisent les premières lignes. Pourtant, nous sommes dans une forêt, où un couple de bûcherons s’échine pour survivre : elle à la recherche du moindre morceau de bois, lui s’affairant à des « travaux d’intérêt public ». Sans enfants, donc sans bouche supplémentaire à nourrir, ni malheureusement à chérir… Très vite on comprend que la voix ferrée récemment construite à travers la forêt transporte des « marchandises » spéciales – hommes, femmes, enfants – vers une destination inconnue. Car tout autour de la forêt, c’est la guerre mondiale. « Pauvre bûcheronne », tous les matins, en ramassant les quelques branchages qu’elle trouve, va voir passer le train, attendant un signe, un cadeau, un miracle.
 Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.
Dans l’un des wagons à bestiaux, un couple et ses jumeaux, Henri et Rose (Hershele et Rouhrele). La peur, la promiscuité, la saleté, la faim, le froid… Le père se dit que l’un des jumeaux pourrait changer de destination, et tant bien que mal, apercevant une silhouette au loin, il le dépose dans la neige par la lucarne du wagon. C’est alors « pauvre bûcheronne » qui prend en charge avec émerveillement et tendresse la « petite marchandise », et qui va tout faire pour nourrir ce bébé inconnu, malgré la colère de son mari – colère qui va peu à peu se muer en attachement paternel pour celle que la propagande de l’occupant disait faire partie du peuple des « sans cœurs », qu’il fallait éliminer.
Le conte nous dit que pendant ce temps la mère et le frère de la petite fille vont mourir, victimes des bourreaux, que seul le père en réchappera, espérant que son geste aura sauvé le bébé. Le récit avance à son rythme, faisant alterner les scènes de cruauté et de tendresse, de violence et d’amour, jusqu’à ce que le père, au hasard de ses recherches erratiques, devine que la fillette qui se trouvait devant lui, vendant des fromages avec sa « mère », était celle qu’il avait arrachée à la mort : « Un cri, un cri terrible, un cri de joie, de peine, de victoire, un cri se forma dans sa poitrine, mais rien, rien ne sortit de sa bouche. […] Il avait vaincu la mort, sauvé sa fille par ce geste insensé, il avait eu raison de la monstrueuse industrie de la mort. »
 Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».
Un vrai conte ? Le style de Jean-Claude Grumberg en donne toutes les apparences, ce style qui ménage l’attente et l’inattendu, la malheur et l’émerveillement : « Pauvre bûcheron tout comme pauvre bûcheronne ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. » Mais l’ « appendice pour amateurs d’histoires vraies » nous remet dans le contexte historique et familial, rappelant que les convois partis de Drancy ont mené à la mort la famille de l’auteur et, le 7 décembre 1943, la famille Wiesenfeld avec ses jumelles… Mais « l’amour […] fait que la vie continue ».
Jean-Pierre Longre
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=274858.html
18:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conte, récit, histoire, francophone, jean-claude grumberg, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/04/2024
« Trompettes de la Renommée » au temps des réseaux sociaux.
 Lydie Salvayre, Irréfutable essai de successologie, Seuil, 2023, Points, 2024
Lydie Salvayre, Irréfutable essai de successologie, Seuil, 2023, Points, 2024
On s’en souvient, Georges Brassens chanta naguère son refus de prêter le flanc à la « déesse aux cent bouches », de dévoiler les secrets (même fictifs) de sa vie privée ; on peut être sûr que s’il vivait actuellement, il refuserait tout autant de se répandre sur les réseaux sociaux. La veine satirique de Lydie Salvayre, si elle prend des itinéraires différents, poursuit le même but, celui dont Shakespeare, placé en exergue de cet « Irréfutable essai », montrait le chemin, sur lequel « les places d’honneur sont pour les plus indignes. »
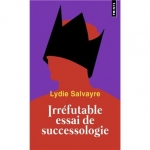 Comme son titre l’indique, l’ouvrage est un essai, c’est-à-dire qu’il analyse d’une manière méthodique les tenants et les aboutissants de son sujet : d’abord définir le succès, facteur en particulier de séduction et de richesse ; puis étudier les différentes familles de succès, portraits pittoresques à l’appui, ironiques à souhait, tels celui de « l’influenceuse bookstagrammeuse », passée forcément par Dubaï, et dont le principal mérite réside dans les formes rebondies de son physique refait, ou celui de « l’homme influent », héritier fortuné qui se pique d’être mécène, que l’on craint (« ça l’enchante »), que l’on « aime d’un amour apeuré »… Plusieurs chapitres sont, bien sûr, consacrés à la littérature : « Les diverses variétés d’écrivains », dont ceux et celles qui répètent à l'envi qu'ils ont trahi leur classe sociale, « Les critiques littéraires », qui peuvent être, par exemple, « tueurs en série » ou « consciencieux ». Et puis, ceci peut servir, « Comment obtenir un succès littéraire » (ou d’ailleurs « en tous domaines »), comment cultiver « l’art de paraître » (rien à voir avec le talent), comment utiliser les amis, les réseaux sociaux etc.
Comme son titre l’indique, l’ouvrage est un essai, c’est-à-dire qu’il analyse d’une manière méthodique les tenants et les aboutissants de son sujet : d’abord définir le succès, facteur en particulier de séduction et de richesse ; puis étudier les différentes familles de succès, portraits pittoresques à l’appui, ironiques à souhait, tels celui de « l’influenceuse bookstagrammeuse », passée forcément par Dubaï, et dont le principal mérite réside dans les formes rebondies de son physique refait, ou celui de « l’homme influent », héritier fortuné qui se pique d’être mécène, que l’on craint (« ça l’enchante »), que l’on « aime d’un amour apeuré »… Plusieurs chapitres sont, bien sûr, consacrés à la littérature : « Les diverses variétés d’écrivains », dont ceux et celles qui répètent à l'envi qu'ils ont trahi leur classe sociale, « Les critiques littéraires », qui peuvent être, par exemple, « tueurs en série » ou « consciencieux ». Et puis, ceci peut servir, « Comment obtenir un succès littéraire » (ou d’ailleurs « en tous domaines »), comment cultiver « l’art de paraître » (rien à voir avec le talent), comment utiliser les amis, les réseaux sociaux etc.
Ce livre est un chef-d’œuvre d’ironie, de second degré (pas sûr que la « bookstagrammeuse », qui comme quelques autres en prend pour son grade, sache ce qu’est le second degré, elle qui prend Sainte-Beuve pour une sainte ou le grand Chamfort du XVIIe siècle pour un chanteur.) À ce propos, Lydie Salvayre n’hésite pas à parsemer son argumentation de maximes bien senties ; quelques échantillons : « Tous les imbéciles aiment à être approuvés » ; « Un véritable ami est un bon placement » ; « Les humains d’aujourd’hui placent tous leur salut dans l’opinion publique » ; « Les gens de grand talent ne rencontrent de leur vivant qu’incompréhension et jalousies ». « Mais » (titre du dernier chapitre), elle n’hésite pas non plus, en apothéose finale, à oublier le second degré et à proclamer ce qui pour elle est la meilleure attitude à avoir : dire Non, notamment, « aux lois qui mènent censément au succès en vous mordant le cœur et en vous broyant l’âme », « Non à ces livres sans nerfs, sans os, sans chair, sans poids, ces livres sans bonté, sans joie, sans rage et sans exultation, ces livres sans épines, ces livres sans arêtes, ces livres bien prudents, bien polis, bien proprets, ces livres bien nippés, bien peignés, pommadés, ces livres écrits à l’eau tiède à l’usage des tièdes et qui châtrent, affadissent et dévoient toutes les choses qu’ils nomment. » Qu’on se le dise, surtout en période de « rentrée littéraire » !
Jean-Pierre Longre
18:44 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, satire, francophone, lydie salvayre, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/07/2022
Mystérieux champion
 Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Le jeune Paul a eu beau, tout au long de son enfance et des routes parcourues sur deux roues, se prendre pour son champion préféré (souvenons-nous, il y avait deux clans bien marqués, celui, plus populaire, des Poulidor et celui, plus élitiste, des Anquetil), jamais il n’a réussi jusqu’à présent à percer les mystères de celui pour qui « l’essentiel se joue dans la solitude ».

« Petit cycliste, j’avais des idées claires sur ce que devait être un champion. Elles étaient si claires que je les consignais dans un cahier d’écolier parmi les photos que je découpais dans les journaux et collais dans un ordre qui n’appartenait qu’à moi. Ce cahier était à la fois mon Panthéon et mes Commandements ». Devenu grand, Paul doit pourtant se poser les questions essentielles, résumées par le titre du chapitre central, « À quoi marche Anquetil ? » : à l’exploit, à l’amour du vélo, à l’argent, à la douleur, à la drogue, à la générosité ? À tout cela sans doute, ce qui le rend d’autant plus « énervant » qu’il reste très secret.
Paul Fournel, qui s’y connaît en vélo, sportivement, pratiquement, théoriquement et littérairement (voir Besoin de vélo, Méli-vélo etc.), livre dans Anquetil tout seul des réflexions qui ne doivent rien à l’hagiographie (même si Anquetil est devenu, comme d’autres et plus que d’autres, une légende, celle-ci n’occulte en rien les défauts humains qui ne lui ont pas été épargnés), rien à la complaisance, rien au moralisme, beaucoup tout de même à l’admiration inséparable de l’autobiographie. Des réflexions, et des variations : ce livre est la partition d’une cantate qui suit les rythmes variés d’une combinaison instrumentale élégante et indicible : l’homme et la bicyclette.
Jean-Pierre Longre
23:12 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, cyclisme, francophone, paul fournel, le seuil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/04/2022
Mère et fils
 Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022
Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022
Il a beau faire, beau dire, beau écrire, Édouard Louis n’en a pas tout à fait fini avec Eddy Bellegueule. Après son fameux livre de 2014, il a malgré tout pris en 2018 la défense de son père, violent mais maltraité par l’injustice sociale (Qui a tué mon père, Le Seuil), et trois ans plus tard il retrace ce qu’il appelle les « combats et métamorphoses » de sa mère.
Cette mère sur qui le malheur s’est acharné – deux maris au mieux indifférents, au pire violents, des grossesses répétées, la misère nourrie par l’alcool, la honte « de notre maison, de notre pauvreté »… Et malgré cela, la volonté de s’en sortir, la recherche d’un bonheur qui paraît illusoire, trompeur : « J’avais tellement l’habitude de la voir malheureuse à la maison, le bonheur sur son visage m’apparaissait comme un scandale, une duperie, un mensonge qu’il fallait démasquer le plus vite possible. » Pourtant elle le trouvera en rompant avec la résignation, en se rapprochant de son fils, en trouvant un emploi, en s’installant à Paris avec un nouveau compagnon, en s’adaptant à la vie citadine jusqu’à transformer son langage, en rencontrant d’autres gens (même Catherine Deneuve, le temps de fumer une cigarette avec elle !).
 Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.
Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.
Jean-Pierre Longre
23:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/01/2022
Du poison et des cadavres
 Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021
Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021
Léa Bernard, 23 ans, est découverte morte empoisonnée à son domicile. Visiblement, la jeune femme, dépressive, vivait seule et dans une absolue discrétion, consacrant scrupuleusement son temps à son travail intérimaire d’hôtesse d’accueil et à des ouvrages de broderie. Étonnant pour la commissaire Romano, son adjoint Tellier et accessoirement l’adjudant Clément, qui découvrent, renseignements pris, que Léa était « la jeune miraculée du vol AFI 587 », seule rescapée d’une catastrophe aérienne survenue au-dessus de l’Atlantique. Y aurait-il un lien entre ce crash et l’assassinat ? Les suppositions vont bon train, jusqu’au moment où l’on apprend que la victime a passé du temps à Genève comme hôtesse d’accueil d’une exposition prétendument pédagogique de cadavres plastinés.
La commissaire et son acolyte se rendent donc sur place, et découvrent peu à peu, outre les agréments de Genève et de son lac en été, un certain nombre d’éléments suspects concernant l’origine des cadavres exposés. Léa Bérard aurait-elle fait des découvertes dans le « marché du cadavre » qui se trame entre Chine, Russie, Europe (spécialement Genève et Annecy) ? L’enquête prend des dimensions insoupçonnées auparavant. « D’un côté, une demande qui explose, de l’autre, une offre qui stagne : c’est comme ça que naissent les circuits d’approvisionnement clandestins. ».
Malgré le côté macabre de l’intrigue (un autre assassinat va d’ailleurs avoir lieu), c’est avec un grand plaisir que nous retrouvons les personnages de Sophie Chabanel : Romano, qui, tout en étant harcelée par sa sœur en instance de divorce, ne vit que pour son travail mais ne dédaigne pas quelques plaisirs passagers, et qui est affublée d’un chat supplémentaire tout aussi destructeur que son comparse ; Tellier, ses scrupules, ses enfants et son moralisme rigide qui n’empêche pas son efficacité ; le divisionnaire Bertin, dont Romano moque volontiers le carriérisme forcené… L’emprise du chat est un polar au suspense prenant, à l’humour lucide, tantôt léger tantôt sans concession, aux allusions politiques claires et à l’engagement moral percutant. Une bonne lecture pour les frissons de l’âme, la détente de l’esprit et la moralisation de la conscience.
Jean-Pierre Longre
12:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, sophie chabanel, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/12/2021
La solitude d’une fleur bleue
 Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
« C’est l’histoire d’une fleur bleue qu’on trempe dans de l’acide. Adélaïde Berthel, c’est une femme comme une autre. Qui, à quarante-six ans, entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. » Une femme d’aujourd’hui, féministe et moderne, qui retrouve régulièrement un groupe d’amies partageant entre elles leurs problèmes sentimentaux, professionnels, existentiels – la « sororité » peut être un réconfort, mais ce n’est pas la panacée. Féministe et moderne, donc, mais, après plusieurs déboires amoureux, elle rêve de trouver enfin l’homme avec lequel elle partagera la deuxième partie de sa vie. Les tentatives sont peu concluantes. La « fleur bleue » devient « peur bleue », la « femme comme une autre » devient « faille comme une autre ».
Histoire banale d’une solitude mal assumée ? Cela se pourrait. Mais dans ce domaine, il n’y a pas de banalité. La plume de Chloé Delaume fait du destin d’Adélaïde un cas particulier, et nous suggère qu’en la matière chaque cas est bien particulier, chaque cœur aussi : « C’est le cœur d’Adélaïde, le héros de cette histoire. C’est lui qui cogne et saigne, exige et se déploie. C’est lui qui fait le deuil, englouti par le vide. » Car Adélaïde, elle, la femme de quarante-six ans, a par ailleurs d’autres vies : vie amicale, vie professionnelle : attachée de presse dans une importante maison d’édition, « passeuse », « elle doit aussi gérer les écrivains », ce qui s’accompagne de toute une série de contraintes, de déceptions, de mensonges, et ce qui donne l’occasion à l’autrice de savoureuses pages satiriques sur le monde de l’édition, rivalités et exigences commerciales, batailles d’égos et d’images…
 Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Jean-Pierre Longre
15:00 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, chloé delaume, le cœur synthétique, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2020
Vérités d’aujourd’hui
 Lire, relire...Philippe Delerm, L’extase du selfie, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
Lire, relire...Philippe Delerm, L’extase du selfie, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020
D’aucuns diront : toujours les mêmes recettes, les petits gestes et les petits objets de la vie quotidienne racontés dans des textes aussi brefs que généralisants… Pas si simple ! Il ne s’agit pas de recette, mais de contrainte fructueuse, qui combine la narration et la poésie, le sens de l’observation et la sociologie. Lorsque Philippe Delerm s’intéresse à l’index qui « se promène sur l’écran de la tablette ou du smartphone » pour y faire défiler des photos, c’est la mémoire qu’il met en jeu : « Du bout du doigt, on ne peut qu’approcher. Ou pas même. Il reste comme un doute dans cette proximité si lointaine. On fait glisser sur un miroir ceux qu’on a cru tenir, tout ce qu’on a pu faire. » Et le texte qui a donné son titre au recueil, « L’extase du selfie » débouche sur la question même de l’existence. Quant au geste ostensiblement désinvolte qui consiste à tourner le volant en se servant uniquement de la paume, il n’échappe ni à l’analyse ironique de la « sensualité de petit mec, qui juge les autres hommes timorés et pense que les femmes ont trouvé leur permis de conduire dans un baril de lessive », ni à une esquisse de morale : le « petit mec » « sait bien qu’il est vu. Mal vu. » Rien à voir avec « Conduire un caddie de supermarché » : « Vous croyez le conduire, et c’est lui qui vous mène. »
 Il y a aussi les gestes de toujours, voire ceux qui appartiennent complètement au passé : « Faire les carreaux », lire « l’heure au gousset », plier les draps (« On ressent dans tout son corps la chorégraphie ancestrale de ce pliage, de ce muet dialogue »), faire la gelée de groseilles, revenir au disque vinyle (« il paraît que c’est branché »). Et si jusqu’à présent vous n’avez remarqué, de la Joconde, que le sourire, profitez de la plume de Delerm pour regarder ses mains. Elles en disent long.
Il y a aussi les gestes de toujours, voire ceux qui appartiennent complètement au passé : « Faire les carreaux », lire « l’heure au gousset », plier les draps (« On ressent dans tout son corps la chorégraphie ancestrale de ce pliage, de ce muet dialogue »), faire la gelée de groseilles, revenir au disque vinyle (« il paraît que c’est branché »). Et si jusqu’à présent vous n’avez remarqué, de la Joconde, que le sourire, profitez de la plume de Delerm pour regarder ses mains. Elles en disent long.
Certes, on peut toujours se dire, comme l’annonce fièrement la quatrième de couverture : « Mais oui, bien sûr, c’est exactement cela ! » Mais c’est trop peu dire. La fine évocation des gestes et des objets, le choix minutieux des mots, leur agencement précis, la légère chute finale, tout cela relève de la prose poétique. On pense parfois à Francis Ponge, ou dans un registre un peu différent au regretté Pierre Autin-Grenier. Mais Philippe Delerm a bien sa manière à lui de saisir l’essence poétique de la vie quotidienne. Il l’écrit lui-même : « Les poètes disent toujours la vérité ».
Jean-Pierre Longre
www.editionspoints.com
12:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, philippe delerm, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/12/2019
Un polar malicieux
 Sophie Chabanel, Le Blues du chat, Le Seuil /Cadre noir, 2019
Sophie Chabanel, Le Blues du chat, Le Seuil /Cadre noir, 2019
Le chat n’est pas le héros de l’histoire, mais un comparse distrayant et problématique, dont le « blues » ira jusqu’à nécessiter la consultation d’un comportementaliste… Pour la commissaire Romano, le problème est cependant secondaire, car elle a sur les bras une enquête délicate ; elle concerne la mort d’un certain François-Xavier Tourtier, ancien banquier volage et véreux, qui paraît s’être assagi en s’intéressant à la fabrication de fours solaires. Empoisonné, semble-t-il, au jus de crevette… Sa jeune épouse Ariane, veuve rapidement consolable, un prêtre aussi séduisant que hors normes, un grand-père compréhensif, un associé idéaliste, un trader menaçant – les suspects ne manquent pas et la pression des autorités pèse de plus en plus sur les enquêteurs.
Romano, commissaire atypique, dont la vie professionnelle passe avant toutes considérations sentimentales, mais qui ne crache pas sur un aller-retour Lille-Porto pour une visite éclair à son amant du moment, Romano, donc, secondée par son adjoint Tellier, dont les opinions parfois exacerbées détonnent dans la police, et par Clément, aussi fidèle et timide que grassouillet, mène l’enquête avec une ardeur qui la fait parfois franchir les limites de la légalité, mais qui s’avère efficace. Elle s’en sort toujours, et ne se laisse pas abattre par les colères du divisionnaire Bertin.
Le suspense est habilement ménagé, le ton est plaisant, le style alerte. Un polar impeccablement écrit, malicieux, qui ne donne ni dans la violence excessive ni dans la mièvrerie, et que l’on peut trouver – qualificatif étonnant pour le genre, concédons-le – apaisant.
Jean-Pierre Longre
23:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, sophie chabanel, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/05/2016
Journal de l’hypermarché
 Lire, relire: Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Seuil, « Raconter la vie », 2014, Folio, 2016
Lire, relire: Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Seuil, « Raconter la vie », 2014, Folio, 2016
Rien de plus trivial, rien de plus nécessaire que de « faire ses courses » en grande surface, lieu de survie de l’espèce humaine dans le monde occidental actuel. De cette réalité quotidienne (ou, disons, hebdomadaire), Annie Ernaux a tiré une substance mi-sociologique mi-littéraire en tenant pendant un an le journal de ses passages à l’hypermarché Auchan de Cergy.
On retrouve dans cette relation régulière les sensations, les impressions que l’on éprouve en ces lieux sans leur prêter vraiment attention, en tout cas sans leur donner plus d’importance qu’aux gestes répétitifs d’une existence banale. On y retrouve aussi des contraintes et des agacements plus ou moins éprouvants (le caddie bancal, les bousculades dans des rayons surpeuplés, l’attente aux caisses, la déshumanisation des machines automatiques…), ainsi que la reproduction presque caricaturale des divisions sociales (hommes / femmes, jeunes / vieux, classes populaires / classes moyennes et supérieures). Paradoxalement, l’hypermarché est aussi comme un refuge, un lieu de plaisir personnel, sinon de fascination : « Je suis allée à Auchan au milieu de l’après-midi après avoir travaillé depuis le matin à mon livre en cours et en avoir ressenti du contentement. Comme un remplissage du vide qu’est, dans ce cas, le reste de la journée. Ou comme une récompense. Me désoeuvrer au sens littéral. Une distraction pure ». Une « distraction » qui fait prendre conscience de sa modestie et de son impuissance devant les interdictions diverses (de photographier, de consommer ou de lire sur place etc.) et devant le gigantisme : « L’hypermarché contient environ 50 000 références alimentaires. Considérant que je dois en utiliser 100, il en reste 49 900 que j’ignore ».
 Sociologie et littérature, donc, devant ce qui relève à la fois de l’observation de soi et des autres dans un contexte qui dépasse l’individu : l’auteure est à la fois, sans honte affichée ni fausse modestie, dans le monde (la foule des acheteurs) et hors du monde, puisqu’il s’agit pour elle de prendre du recul par l’écriture. « Voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence ».
Sociologie et littérature, donc, devant ce qui relève à la fois de l’observation de soi et des autres dans un contexte qui dépasse l’individu : l’auteure est à la fois, sans honte affichée ni fausse modestie, dans le monde (la foule des acheteurs) et hors du monde, puisqu’il s’agit pour elle de prendre du recul par l’écriture. « Voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence ».
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, journal, autobiographie, annie ernaux, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/03/2016
Le secret d’Elena
 Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016
Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016
Dans les années 1970-1980, la politique nataliste de Ceauşescu faisait des ravages : avortements clandestins, accouchements sous x, abandons d’enfants qui venaient remplir les orphelinats sordides. Dans ce contexte, Elena Cosma, sage-femme à Bucarest, célibataire en mal d’enfant, décide d’adopter le bébé de Zelda, l’une de ses patientes, avec l’accord de celle-ci. Au bout de quelque temps, Zelda devenant trop pressante auprès de l’enfant, Elena décide de demander sa mutation et de partir avec lui pour un « voyage sans retour » à l’autre bout du pays, dans un village de Moldavie, Prigor.
À partir de là, les événements vont s’enchaîner rapidement. Le petit Damian, « enfant de Dieu », dont la beauté fragile ne rappelle en rien la physionomie robuste de sa « mère », et sur lequel courent diverses rumeurs, devient le souffre-douleur de ses camarades, tandis qu’Elena, la seule soignante du village, remplit le mieux possible sa mission d’infirmière pour une population dominée par la frayeur qu’inspire le « Despote » Miron Ivanov, maire du village. Désireuse d’étendre son activité, et aussi de se couler dans le moule politico-social de l’époque tout en gardant son secret familial, Elena propose aux autorités de créer un orphelinat à Prigor. L’établissement, installé dans une forêt à l’écart du village, est comme toutes les « maisons d’enfants » du pays un enfer pour ses pensionnaires, appelés (par allusion à leur « père » à tous, Ceauşescu) « enfants du diable »), qui survivent tant bien que mal (et parfois meurent) sous la férule des surveillants, mal nourris, privés de l’hygiène élémentaire et de tout ce qui fait les petits bonheurs habituels des enfants. Certains orphelins, issus du village, sont au cœur des mystères qui tournent autour d’Elena, de Damian, du maire Ivanov – et c’est ainsi que l’intrigue se faufile entre la réalité dramatique de cette période et les personnages lourds de leurs souffrances, de leurs silences, de leurs relations ambiguës, de leurs résignations et de leurs révoltes.
Le récit foisonnant, mené d’une plume alerte et vigoureuse, court sur une bonne dizaine d’années. À travers les histoires individuelles et au-delà des profondeurs mystérieuses que recèlent les personnages, les événements et les lieux (le village reculé, la forêt, l’étang – motifs que l’on trouvait déjà dans Terre des affranchis), c’est aussi l’histoire de la Roumanie qui se déroule : la dictature, les malheurs de la population, surtout des enfants, la catastrophe de Tchernobyl dont le retentissement est clairement sensible, la « révolution » de fin 1989, l’apparition des « humanitaires », qui traînent eux aussi leurs ambiguïtés… Roman à la fois historique, social, psychologique, noir, Enfants du diable mêle avec bonheur la réalité et l’imaginaire, la narration sèche et les mystères de la poésie. Belle manifestation d’une écriture combinant la maîtrise consommée de la langue française et la perpétuation d’un certain esprit roumain.
Jean-Pierre Longre
22:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, liliana lazar, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2015
« La bonne éducation »
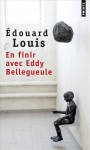 Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Chaque classe sociale a ses normes, ses règles, ses exigences, ses frontières hors desquelles on est considéré comme un paria. Pour échapper à l’ostracisme, seule la fuite semble être la solution. Fuir les autres, fuir la famille, fuir les insultes, les coups et les humiliations, fuir jusqu’à son nom, tel est l’argument du premier roman d’Édouard Louis, dont le succès lors de sa parution aux éditions du Seuil lui vaut maintenant une édition en poche (Points).
Un roman qui superpose et mêle plusieurs genres en une composition binaire : Livre 1, « Picardie (fin des années 1990 – début des années 2000) » ; Livre 2, « L’échec et la fuite ». Plusieurs genres, donc : roman social (l’auteur a lu et étudié Pierre Bourdieu), qui campe et analyse de l’intérieur le prolétariat de la fin du XXème et du début du XXIème siècle, à coups de descriptions sans concessions (mais sans jugement moral) et de citations orales – ce qui, stylistiquement parlant, a le mérite de mêler les registres de langue et de faire ressortir la crudité verbale que l’auteur a su mettre à distance. Le roman autobiographique, qui narre dans un mélange subtil d’objectivité et d’hypersensibilité le douloureux décalage que le jeune Eddy ressent par rapport à sa famille, à ses copains, et qu’il tente désespérément d’effacer. Le roman initiatique d’un garçon qui se sent rapidement différent des autres, féminin, dans un milieu où la virilité ostensible est la marque obligée du monde des hommes, un garçon qui voudrait ne pas être ce qu’il est, qui s’essaie à l’amour des filles mais ne peut échapper à l’opprobre de plus en plus ricanant et hostile de son environnement familial, villageois, scolaire, et qui finalement découvre qu’il y a d’autres manières de vivre que celle dans laquelle il était enfermé.
 En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
Jean-Pierre Longre
16:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2015
Kafka à l’Université
 Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Voulant d’urgence échapper (au moins quelques années) aux turbulences de l’enseignement en collège, Jeanne décide de s’inscrire en thèse. Après l’euphorie des débuts (bien qu’elle n’ait pu obtenir de financement), commence le parcours du combattant universitaire.
Combattant, ou soutier, comme on voudra. Franchie l’étape du dossier d’inscription, entravée par l’inertie dissuasive de la secrétaire ; celle de l’entretien avec le directeur de recherches, aussi charmant que silencieux, laissant passer six mois avant de répondre au moindre mail ; celle des cours à donner, dont la préparation mange tout le temps que l’on croyait réserver à la recherche, et qui finalement se révéleront aussi peu lucratifs qu’inutiles ; celles, successives, de la documentation bibliographique envahissante, de l’établissement d’un plan aussi labyrinthique que changeant, de la rédaction sans cesse repoussée mais à laquelle il faudra bien se mettre un jour… Sans compter l’incompréhension de l’entourage (le petit ami, la famille) qui ne s’explique pas pourquoi Jeanne se lance dans un travail qui ne rapporte rien, qui paraît totalement vain, voire irresponsable, et qui exacerbe son égocentrisme ; pas comme le cousin Alexandre qui, lui, va faire une thèse scientifique, utile au progrès de l’humanité, n’est-ce pas ; mais à quoi peut bien servir un travail sur la parabole de la loi dans Le Procès de Kafka ? Cela dit, lorsque Jeanne parviendra à sa soutenance, l’entourage en question sera aussi fier qu’il aura été sceptique et critique les années précédentes…
Tiphaine Rivière aurait pu écrire un roman autobiographique. Cela nous aurait privés du charme de ses dessins, qui tient au trait à la fois précis et nuancé, au mélange d’apparente candeur et d’ironie vraie, de réalisme et d’onirisme. Vignettes muettes ou dialogues vifs, couleurs contrastées ou teintes pastel, arrière-plans grisâtres ou animés, scènes de la vie quotidienne ou rêves éveillés, tout concourt à plonger le lecteur dans les affres intimes et cycliques de notre héroïne. Tout est bien vu, à l’image de cet édifice monstrueux (kafkaïen) aux coupoles interchangeables et aux murs instables qui représente le plan (de 64 pages) que Jeanne n’en finit pas de déconstruire et de reconstruire. Drôles et réalistes, vivants et oniriques, ces Carnets de thèse permettront à certains de s’y retrouver, à d’autres de se préparer, à tous de pendre plaisir à une histoire à la fois cauchemardesque et pleine d’humour.
Jean-Pierre Longre
10:14 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, dessin, autobiographie, tiphaine rivière, jean-pierre longre, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/04/2014
Ironiques interrogations
Arnaud Calvi, Bimbo, Le Seuil, 2014
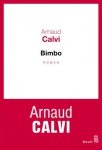 Si l’on veut ne s’en tenir qu'à la trame narrative, on la trouvera peut-être vacillante. Disons : le narrateur, jeune professeur de Lettres, entré un soir dans une boîte de strip-tease (sous les yeux, d’ailleurs, de l’un de ses élèves), se fait aborder par un « Slave » qui lui remet un étrange paquet, et le blesse ; une « bimbo » le soigne, le recueille, prend en charge le mystérieux paquet ; puis la narration tourne autour du travail (un peu) de notre personnage, de son couple problématique, d’un grand ami qui, s’il n’était pas mort, lui donnerait les conseils indispensables, d’un collègue suicidaire, d’une nouvelle rencontre (fantasmée ?) du « Slave », de la recherche presque désespérée de la Bimbo…
Si l’on veut ne s’en tenir qu'à la trame narrative, on la trouvera peut-être vacillante. Disons : le narrateur, jeune professeur de Lettres, entré un soir dans une boîte de strip-tease (sous les yeux, d’ailleurs, de l’un de ses élèves), se fait aborder par un « Slave » qui lui remet un étrange paquet, et le blesse ; une « bimbo » le soigne, le recueille, prend en charge le mystérieux paquet ; puis la narration tourne autour du travail (un peu) de notre personnage, de son couple problématique, d’un grand ami qui, s’il n’était pas mort, lui donnerait les conseils indispensables, d’un collègue suicidaire, d’une nouvelle rencontre (fantasmée ?) du « Slave », de la recherche presque désespérée de la Bimbo…
Les ingrédients d’un roman à succès sont là, au moins en germe : une dose d’érotisme, un soupçon d’arnaque sur fond éventuel d’espionnage, des esquisses de psycho-sociologie, les déchirures du couple, les souvenirs d’une amitié défunte… Ce serait trop facile. Notre (anti-)héros-narrateur, qui comme Julien Sorel tâche en mainte occasion de se référer (sinon de ressembler) aux grands hommes et aux esprits nobles, avoue perdre trop souvent les fils de l’existence. Impuissance décisionnelle et incertitude mentale semblent gouverner son quotidien, dans un monde fait d’artifices et de paraître – un monde, on l’aura compris, auquel une âme sincère ne peut s’adapter.
D’une tonalité doucement ironique, non exempt de naïveté assumée, ce premier roman pose d’une manière lancinante et maîtrisée des interrogations essentielles (et existentielles), en des circonvolutions syntaxiques où les parenthèses s’imposent comme primordiales. L’ensemble esquisse des récits volontairement avortés et laisse des questions en suspens : quelle est la portée du scandale qu’aurait pu produire auprès des élèves un professeur fréquentant ouvertement les boîtes de strip-tease ? Que va devenir le couple dudit professeur ? Quid de la Bimbo, du « Slave », du narrateur lui-même ? Comment conduire sa vie ? Tout cela sonne faussement romanesque (comme sonne souverainement faux le piano final), mais donne « forme et raison » à la réalité insaisissable du comportement humain. Un beau livre, qui ne laisse pas indifférent et qui donne de quoi attendre la suite…
Jean-Pierre Longre
18:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, francophone, arnaud calvi, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/06/2013
Une passion française
 Eun-Ja Kang, L’étrangère, Le Seuil, 2013
Eun-Ja Kang, L’étrangère, Le Seuil, 2013
« Le français a une âme […]. Je saisis ce qui vient de se produire : le français est entré dans ma chair et dans mon âme, tandis que l’anglais est resté sur ma peau. […] Je trouverai dans sa profondeur ce que je cherche. Ce que tu cherches ? Qu’est-ce que tu cherches ? Je ne sais pas. En tout cas, je sens que c’est dans le français que je le trouverai ». Ces considérations quasiment sensuelles n’émanent pas d’un éminent linguiste, ni même d’un étudiant avancé, mais d’une petite lycéenne née au fond de la campagne coréenne dans une famille pauvre, et dont la mère est analphabète… Tombée « amoureuse » du Petit Prince, elle va se prendre d’une passion inextinguible pour la langue de Saint-Exupéry, et pour cela va franchir tous les obstacles qui se dressent devant elle.
Car la société coréenne n’est pas tendre, c’est le moins que l’on puisse dire. À chaque étape de sa scolarité, Eun-Ja doit être la première de sa promotion pour obtenir ou conserver la bourse qui lui permet d’accéder au niveau supérieur. Elle raconte ainsi son enfance, avec ses malheurs et ses bonheurs, ses tristesses et ses joies, le dénuement et le labeur, la solidarité familiale, les relations avec ses camarades, les longs trajets à pied vers l’école, les espoirs et les déceptions, les peurs et les rires, les succès scolaires et la fierté qu’elle en ressent, le départ pour Séoul et l’université, la boulimie intellectuelle qui, comparable et parallèle à l’appétit sexuel, la jette tout entière dans l’étude de la langue qu’elle a choisie, jusqu’à ce que, au prix d’une ténacité sans faille, de décisions draconiennes et de sacrifices financiers (auxquels sa famille n’hésite pas à participer), elle puisse partir pour la France préparer son doctorat et écrire des romans…
Le simple résumé de cet itinéraire est impuissant à dire ce qu’il a d’étonnant, de bouleversant même. Mais l’écriture de l’auteur, qui ne dissimule rien, qui n’use d’aucun artifice, est en elle-même une démonstration probante de son caractère exceptionnel. Comme le fait l’eau d’un fleuve, elle coule, à la fois immuable et mouvante, fluctuante et transparente, inégale et imparable, dans une langue acquise à travers Stendhal et Proust (entre autres), une langue qui laisse sentir le poids de chaque mot, de chaque phrase, une langue dont la sincérité est à la mesure de l’enthousiasme que « l’étrangère » a mis à s’en pénétrer.
Jean-Pierre Longre
11:02 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, corée, eun-ja kang, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/08/2010
L’inquiétante silhouette de Géraldine Bouvier
 Marc Villemain, Et que morts s’ensuivent, Éditions du Seuil, 2009
Marc Villemain, Et que morts s’ensuivent, Éditions du Seuil, 2009
Grand Prix de la SGDL 2009
C’est à la fois morbide et drôle, satirique et tendre, terrifiant et attachant. Onze nouvelles, onze héros (ou anti-héros) condamnés à toutes sortes de morts, selon des progressions différentes mais implacables, jusqu’à l’« Exposition des corps », sorte d’appendice pseudo réaliste résumant la biographie de chacun. Parmi eux, soit dit en passant, un certain Matthieu Vilmin, dont la minutieuse description de la souffrance ne peut résulter que de l’expérience personnelle d’un certain Marc Villemain ; une certaine M.D., aussi, écrivain de son état, dont les histoires « se finissent toujours mal ». Le double de l’auteur n’est jamais loin…
La diversité des noms, des situations, des conditions sociales est contrebalancée non seulement par l’unité des destinées ultimes, mais encore par la présence constante, notoire ou discrète, d’une dame Géraldine Bouvier, témoin impavide ou actrice décisive, dont la silhouette se glisse dans les récits comme celle d’Hitchcock dans ses films. Fil conducteur comme l’est la mort, bourreau involontaire ou juge sans indulgence, Géraldine Bouvier ne laisse pas d’intriguer voire d’apeurer, par sa présence à la fois unique et multiple.
Et que morts s’ensuivent se lit délicieusement au second degré, et c’est bien ainsi. Chaque détail biographique, chaque remarque ironique ou sarcastique, chaque procédé narratif est pesé au gramme près pour le plaisir masochiste, la délectation mortifère du lecteur. Le Grand Prix de la nouvelle, attribué récemment par Société des Gens de Lettres à l’auteur pour son recueil, est mérité.
Jean-Pierre Longre
21:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, marc villemain, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/08/2010
Attachants instantanés
 Paul Fournel, Poils de Cairotes, Le Seuil, 2004, réédition Points, 2007.
Paul Fournel, Poils de Cairotes, Le Seuil, 2004, réédition Points, 2007.
« Le Caire fabrique du discontinu, de l’alternatif ». Cette constatation énoncée dans sa préface, Paul Fournel l’a mise en pratique en couchant par écrit à chaque lever du jour, du 12 novembre 2000 au 25 juin 2003, telle anecdote, telle évocation, telle impression, tel témoignage de l’attaché culturel qu’il fut durant cette période dans la capitale égyptienne.
Destinés à l’origine à donner des nouvelles électroniques quotidiennes à ses correspondants lointains, ces brefs textes composent un livre pittoresque et fin, où le trait humoristique côtoie l’observation ethnographique, où la saynète comique voisine volontiers avec la scène tragique. Sous la plume à la fois tendre et distanciée, perplexe et compréhensive de l’auteur, la vie foisonnante de la mégalopole nous saute aux yeux et aux oreilles ; nous sommes, comme lui, plongés en plein dedans tout en conservant la position de celui qui contemple avec un sourire mi-ironique mi-complice. Les bruits incessants (klaxons, moteurs et cris divers), les mouvements en tous sens, les pauses étonnantes, les combines insoupçonnées, l’enfermement citadin et les échappées vers les espaces désertiques, tout y est.
Même les contradictions, celles qui caractérisent les pays où la tradition s’accommode sans états d’âme de la modernité – richesse incomparable. Les exemples pullulent, comme le savoureux récit de l’installation d’une antenne parabolique à minuit par des techniciens attendus depuis le matin et qui, avec « un beau rire égyptien », rétorquent aux protestations du narrateur : « Nous on travaille avec les étoiles ».
Grâce à la contrainte quasi oulipienne de l’écriture matutinale, c’est la poésie qui naît, sous la plume aimante et acérée de celui qui a su conserver l’art décrire sans complètement se perdre dans les méandres de la vie cairote.
Jean-Pierre Longre
17:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, paul fournel, oulipo, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/05/2010
Farce tragique et totalitarismes

Norman Manea
Les clowns : le dictateur et l'artiste, traduit du roumain par Marily Le Nir et Odile Serre, Le Seuil, 2009.
L'enveloppe noire, traduit du roumain par Marily Le Nir, Le Seuil, « Fictions & Cie », 2009.
Les deux ouvrages de Norman Manea parus au Seuil en octobre 2009 peuvent se lire simultanément, en alternance, l'un après l'autre, selon l'humeur... L'un est un recueil d'essais qui, s'appuyant sur l'histoire récente de la Roumanie, aide à méditer non seulement sur le communisme et ses déviances (la dictature, le nationalisme), mais aussi sur des sujets plus généraux tels que les rapports de l'art avec le politique, la censure, l'ambiguïté des relations internationales, l'antisémitisme, le monde d'aujourd'hui et son « hystérie carnavalesque »... L'autre est un roman où l'étrange (des personnages et de leurs destinées) le dispute au réalisme (de la toile de fond, des situations), où l'imaginaire prend corps sur la cruelle absurdité des régimes dictatoriaux (des années 1940 et des années 1980).
Les clowns : le dictateur et l'artiste répond, selon l'auteur, à une urgence : celles de « décrire la vie sous la dictature roumaine » et d'en « tirer enseignement », notamment en ce qui concerne « la relation entre l'écrivain, l'idéologie et la société totalitaire ». Chaque texte vise ainsi à peindre la tyrannie (sous un jour tragique ou comique, burlesque ou insupportable), et à en tirer des réflexions qui se fondent sur l'expérience personnelle. Car Norman Manea a vécu, comme un certain nombre d'autres, le triple drame du siècle : « l'Holocauste, le totalitarisme, l'exil » ; son mérite exceptionnel est de ne jamais prendre la posture de la victime, de se donner suffisamment de recul pour analyser avec lucidité et vigueur, d'une plume implacable, parfois violente, voire sarcastique, les débats, les aberrations, les contradictions, les ridicules, les abus de la grotesque dictature de Ceauşescu. Sans négliger les échos et comparaisons (nazisme et communisme, Hitler et Staline), Norman Manea met en avant les spécificités roumaines des années 1980 - la volonté de cacher la diversité sous les proclamations nationalistes, les subtilités de la censure, la récupération des positions nationalistes de Mircea Eliade, l'antisémitisme, les rapports avec (et de) la Securitate, les hypocrisies (et les révoltes plus ou moins larvées) du monde intellectuel... Tout cela mis en perspective, selon le « mouvement simultané en avant - en arrière » qu'il revendique en tête de son essai sur le Journal de Mihail Sebastian. « Les fondements de l'avenir tiennent à la qualité et à la probité de l'appréhension du passé » : la dernière phrase est une belle synthèse de ce qui est mis en œuvre tout au long du livre.
L'enveloppe noire est, dans le domaine de la fiction, une sorte de caisse de résonance artistique des Clowns, dont l'un des chapitres relate d'ailleurs l'histoire de la difficile publication du roman, soumis à l'approbation pleine d'embûches du « Conseil de la Culture et de l'Éducation Socialistes - Service Lecture » (disons : la Censure) ; et ce n'est pas un hasard si, quelques mois après sa parution, en 1986, Norman Manea quittait la Roumanie.
Dans le roman, Anatol Dominic Vancea Voinov, dit plus simplement Tolia, a été privé de son poste de professeur pour se retrouver réceptionniste à l'hôtel TRANZIT ; confronté aux vicissitudes de la vie quotidienne sous la dictature et aux soubresauts de sa propre personnalité, il est en même temps en proie aux souvenirs et à la quête des circonstances de la mort de son père, « suicidé ou trucidé » sous une autre dictature, celle des années 1940 - et cela jusqu'à l'irruption du rêve dans les souvenirs et dans la vie, jusqu'à la folie. L'enveloppe noire est certes le roman d'un individu qui bute sur « les arêtes du concret », mais aussi celui d'une société, des relations humaines, et de l'histoire d'un demi-siècle ; le roman des destins individuels et de la destinée collective. On y assiste à la mise en scène, en instantanés tragi-comiques, des absurdités d'un système où « les poursuivants sont à leur tour poursuivis, la suspicion, la peur stimulent et font dévier leurs propres ondes », où « tout se dilate, glisse, s'effiloche », où le mieux considéré est, par exemple, « Toma, le sourd-muet exemplaire ! Qui voit tout, sait tout, est informé de tout, mais n'en parle qu'à qui de droit, quand il le faut ». Spectacle plein d'échos (dont celui de la fameuse pièce de Ion Luca Caragiale Une lettre perdue), écriture foisonnante et débordante, humour salutaire et absurde abyssal... Le roman de Norman Manea est une porte ouverte sur un hors-scène infini, « un vide grandiose » dont il est difficile de sortir indemne.
Jean-Pierre Longre
11:50 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, roumanie, norman manean marily le nir, odile serre, jean-pierre longre, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

