04/11/2024
« Le cœur en charpie »
 Olivier Adam, Des vents contraires, Éditions de l’Olivier, 2008
Olivier Adam, Des vents contraires, Éditions de l’Olivier, 2008
Grand Prix RTL-Lire 2009
Rééd. Points, 2010, 2023
Sarah a disparu sans laisser de traces, abandonnant son époux et ses deux jeunes enfants à leurs éternelles questions (Où est-elle ? A-t-elle fui ? A-t-elle été enlevée ? Est-elle morte ?) et, surtout, au vide désespéré de leur cœur. Paul Anderen, scénariste et romancier en mal d’écriture, décide alors de revenir avec Clément et Manon au pays de son enfance, dans cette Bretagne où les vents et la mer accompagnent et trahissent la violence des sentiments.
 Paul retrouve à Saint-Malo des souvenirs, le goût salé de l’océan, quelques êtres affectueux comme son frère Alex et sa belle-sœur Nadine (qui l’embauchent en douce dans leur auto-école), mais aussi la froide brutalité de la société et de ses institutions, auxquelles ses enfants et lui-même n’arrivent pas adapter leur existence. Le manque est toujours là, qu’ils tentent de pallier par l’amour inconditionnel qu’ils se vouent mutuellement. Plutôt rester tendrement blottis les uns contre les autres face au large, dans la bise glaciale, que de se heurter aux institutrices intraitables et aux parents d’élèves méfiants. Plutôt rire sans vergogne aux manèges de la fête foraine, ou aider sans arrière-pensée ceux qui ont aussi « le cœur en charpie » : un père privé de voir son enfant, une voisine attendant impatiemment son fils parti au loin depuis des mois, une vieille dame qui va mourir, un inspecteur de police que sa fille ne connaît pas… Paul est de ces originaux qui ne transigent pas avec la tendresse et la sincérité, et c’est ce qui lui vaut l’inimitié de la majorité (silencieuse ou non) ; faire face à la tempête, ne pas plier, quelles qu’en soient les conséquences ; la marginalité est son lot, mais peu importe : ce qui compte pour lui, c’est l’amour sans faille qu’il porte à ses enfants, qui le lui rendent bien, chacun à sa manière.
Paul retrouve à Saint-Malo des souvenirs, le goût salé de l’océan, quelques êtres affectueux comme son frère Alex et sa belle-sœur Nadine (qui l’embauchent en douce dans leur auto-école), mais aussi la froide brutalité de la société et de ses institutions, auxquelles ses enfants et lui-même n’arrivent pas adapter leur existence. Le manque est toujours là, qu’ils tentent de pallier par l’amour inconditionnel qu’ils se vouent mutuellement. Plutôt rester tendrement blottis les uns contre les autres face au large, dans la bise glaciale, que de se heurter aux institutrices intraitables et aux parents d’élèves méfiants. Plutôt rire sans vergogne aux manèges de la fête foraine, ou aider sans arrière-pensée ceux qui ont aussi « le cœur en charpie » : un père privé de voir son enfant, une voisine attendant impatiemment son fils parti au loin depuis des mois, une vieille dame qui va mourir, un inspecteur de police que sa fille ne connaît pas… Paul est de ces originaux qui ne transigent pas avec la tendresse et la sincérité, et c’est ce qui lui vaut l’inimitié de la majorité (silencieuse ou non) ; faire face à la tempête, ne pas plier, quelles qu’en soient les conséquences ; la marginalité est son lot, mais peu importe : ce qui compte pour lui, c’est l’amour sans faille qu’il porte à ses enfants, qui le lui rendent bien, chacun à sa manière.
« J’ai lu un de vos bouquins hier, dit un jour l’inspecteur à Paul. Ne prenez pas cet air étonné. Franchement j’ai trouvé ça pas mal. Un peu geignard mais pas mal. » Autocritique d’Olivier Adam ? En tout cas, tout était réuni pour bâtir un scénario « geignard » : la mère disparue, le père transi d’amour pour ses deux petits un peu perdus, la tempête hivernale sur les côtes bretonnes, la brutalité collective… Mais il y a d’une part l’épaisseur et la présence des personnages : celles de Paul Anderen dont la force affective est la faiblesse, et dont la faiblesse sociale est la force ; celles des deux enfants, qui sentent tout sans forcément comprendre ; celles des êtres qui, autour d’eux, font qu’on ne désespère pas complètement de l’homme. D’autre part l’écriture, qui suit les fluctuations des corps et des cœurs – accélérations, ralentissements –, une écriture n’abusant pas des artifices, collant au réel (les ciels, la mer, les paysages, les maisons, les sensations, les gestes, les conversations…), le perçant, le remuant jusqu’à le métamorphoser en matière romanesque.
https://www.editionspoints.com
21:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, olivier adam, Éditions de l’olivier | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/03/2024
La révolte et le mitard
 Jean-Pierre Martin, N’oublie rien, Éditions de l’Olivier, 2024
Jean-Pierre Martin, N’oublie rien, Éditions de l’Olivier, 2024
Après mai 1968, souvenons-nous, la révolte a continué. Les acquis et les accords n’ont pas empêché certains groupes de lutter contre l’oppression patronale, par exemple celle des chantiers navals de Saint-Nazaire chargés de construire des navires géants. Jean-Pierre Martin, qui avait abandonné ses études de philosophie pour s’établir comme ouvrier et qui militait au sein de la Gauche prolétarienne, n’a rien oublié du soutien aux actions symboliquement violentes ni des distributions de tracts, et de leurs conséquences : pour lui, deux mois d’isolement à la prison de Saint-Nazaire, « enfermé avec moi-même », écrit-il. « Mais pas question de ramollir. » « N’oublie pas les ouvriers blessés, mutilés ou morts à la tâche, victimes de guerre de la production, ceux qu’on sacrifie au tonnage d’un pétrolier ou au rendement d’une chaîne. »
Donc le mitard, seul avec soi-même, pour uniques distractions l’apparition régulière d’un gardien avec la gamelle de pitance, une lucarne laissant voir un petit bout de ciel (même pas le toit que pouvait apercevoir Verlaine), une araignée tissant sa toile et amicalement appelée Hélène, la promenade quotidienne entre quatre hauts murs, quelques bruits venus de l’extérieur… Mais cet isolement donne un relief et un goût particuliers aux rares entorses à la solitude : quelques livres, de quoi écrire, des gardiens qui, peu à peu, se mettent à parler, deux ou trois codétenus furtivement croisés, les visites de l’avocat (dont pourtant le prisonnier n’attend pas grand-chose), celles de la « visiteuse », une dame dont l’austérité bourgeoise se mue progressivement en sympathique compréhension, celle, une seule fois, des parents honteux de leur fils, l’écho sifflé de Laure, une camarade de lutte enfermée derrière le mur, côté femme… Et puis il y a le certificat qui manquait à notre prisonnier pour parfaire ses études, qu’il prépare en vitesse, et qui lui vaut la visite de son professeur et du doyen de la faculté, dignes messieurs venus tout exprès de Nantes pour l’occasion. Un beau morceau d’anthologie, cet oral passé dans le parloir avec à la clé la déclaration solennelle d’obtention de la maîtrise de philosophie !
Après le procès et son verdict (deux mois ferme), procès au cours duquel le prévenu n’a pas pu taire un discours militant, il reste quinze jours à tirer, les plus longs, les plus durs sans doute. « La sortie est comme une obsession. Ici, maintenant, est trop douloureux. Tu te sens plus que jamais claustrophobe. Tu aimerais dormir jusqu’à ta libération. » On le comprend, car jusqu’à présent on n’a pu qu’accompagner son récit attachant et poignant, enfermés avec lui dans son cachot humide et dans sa solitude révoltée, dont, promis, nous n’oublierons rien. Mais que l’on connaisse ou non Jean-Pierre Martin dans les parcours qu’il a menés par la suite, on le devine sensible à la complexité du monde : « D’un côté ton moi enfiévré et violent, de l’autre ton moi dissident, œcuménique et fraternel. […] Tout est politique, penses-tu comme tes camarades, et cependant, tu n’es pas tout à fait politique au sens strict. Plutôt affectif, affecté à fleur de peau, atteint d’une fièvre insurrectionnelle, révolté de l’intérieur par le monde tel qu’il est, désireux d’un monde tout autre. » Un monde peut-être promis par le paysage entrevu, au début du livre, à travers la vitre du fourgon pénitentiaire, et par cette « ligne d’horizon » qu’à la fin, une fois libéré, il redécouvre avec « l’œil d’un enfant ».
Jean-Pierre Longre
17:16 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, jean-pierre martin, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/01/2023
« Une vue globale du monde »
 Lire, relire... David Thomas, Seul entouré de chiens qui mordent, Éditions de l’Olivier, 2021, éditions Points, 2023
Lire, relire... David Thomas, Seul entouré de chiens qui mordent, Éditions de l’Olivier, 2021, éditions Points, 2023
« Le livre que vous écrivez doit être unique » : tel est le conseil que donne un éditeur à un auteur en mal d’inspiration, qui va alors consacrer son temps à écrire « le livre le plus dégueulasse ». Ce n’est pas le cas pour celui de David Thomas, qui est pourtant unique dans son inspiration et sa composition. D’innombrables histoires courtes nous font explorer le monde, la société, les caractères, les singularités de la vie humaine : solitaire ou en couple, artistique et laborieuse, enthousiaste ou dépressive, pleine de rires et de pleurs.
Il y a cette vieille dame hospitalisée qui, tombée amoureuse de son jeune et bel infirmier, lui demande avant de mourir de se mettre nu devant elle… Il y a ce marathonien sans succès qui trouve le bonheur de courir sous les applaudissements adressés au personnel soignant pendant le confinement du printemps 2020… Il y a ce jeune garçon qui, après une mention très bien au bac, avoue à son père que sa vocation est de devenir loueur de pédalo… Il y a cet écrivain qui pratique le « no kill » avec les pages de son manuscrit (« No kill » ? Le fait de remettre un poisson à l’eau après l’avoir pêché). Il y a les réussites et les échecs, les mensonges et les vérités…
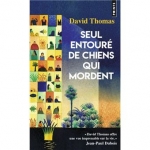 Il y a… On n’en finirait pas de glaner des anecdotes, des motifs de réflexion et de méditation dans cette mosaïque littéraire où l’humour le dispute au morbide, le paradoxal au rassurant, l’onirique au réel, le pessimisme à l’optimisme, la distance critique à l’émouvante empathie. Avec cela, un style alerte et jouissif, une prose qui se coule dans le moule de ce qu’elle évoque, à la première ou à la troisième personne, et qui nous sert périodiquement des formules d’une beauté pleine d’échos, du genre : « Ma vie de couple est dans le quotidien mais tant que ma femme sera dans le jour, le quotidien ne sera qu’un petit nain face au jour. » Ou bien : « Le bruit que font les autres sur le fil des secondes. » Ou encore : « Tu crois parler de la souffrance mais la pierre fendue par le gel en parle mieux que toi. » Tout cela pour dire que ce puzzle, pièce par pièce agencé, donne, pour reprendre le titre de l’un des textes, « une vision globale du monde ».
Il y a… On n’en finirait pas de glaner des anecdotes, des motifs de réflexion et de méditation dans cette mosaïque littéraire où l’humour le dispute au morbide, le paradoxal au rassurant, l’onirique au réel, le pessimisme à l’optimisme, la distance critique à l’émouvante empathie. Avec cela, un style alerte et jouissif, une prose qui se coule dans le moule de ce qu’elle évoque, à la première ou à la troisième personne, et qui nous sert périodiquement des formules d’une beauté pleine d’échos, du genre : « Ma vie de couple est dans le quotidien mais tant que ma femme sera dans le jour, le quotidien ne sera qu’un petit nain face au jour. » Ou bien : « Le bruit que font les autres sur le fil des secondes. » Ou encore : « Tu crois parler de la souffrance mais la pierre fendue par le gel en parle mieux que toi. » Tout cela pour dire que ce puzzle, pièce par pièce agencé, donne, pour reprendre le titre de l’un des textes, « une vision globale du monde ».
Jean-Pierre Longre
17:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, david thomas, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2022
Singularités d’un foisonnant patronyme
 Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin n’est pas Monsieur Ducon, loin s’en faut. Rappelez-vous ce texte de Jacques Prévert, chanté par Yves Montand, les Frères Jacques et sans doute quelques autres, où est contée l’histoire d’un homme triste, si triste parce qu’il s’appelle Ducon, et qui, ayant découvert dans un vieux Bottin qu’il est « le seul Ducon », change complètement d’humeur et « poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. » À l’opposé, il y a les Martin, qui « pullulent », « essaiment », « se multiplient ». Pour leur malheur ? En tout cas pour le bonheur du lecteur plongé dans l’ouvrage du prénommé Jean-Pierre qui, ne se contentant pas de son patronyme, l’étend à ses équivalents étrangers (Martins, Martinez, Martinson etc.). Mais rassurons-nous; sur le nombre incommensurable, et même s’il leur accorde plus de sept cents pages, il fait un choix : quarante et un chapitres consacrés à autant (disons un peu plus) de Martin, c’est déjà une épopée, un monument d’érudition, un multiple voyage dans le temps et dans l’espace.
Il avoue que « Nous, les Martin, nous formons un monde. Un monde inconnu de lui-même. » Son « Grand Récit » s’adresse donc aussi, et peut-être avant tout, à sa grande famille patronymique, où se sont illustrés voyageurs et baroudeurs, créateurs et découvreurs, mais aussi « Saints et Soldats plus souvent qu’à leur tour », à l’image du fameux Martinus (IVe siècle), celui que le geste de partager son manteau a rendu célèbre… Ce qui n’empêche pas l'hommage rendu à Sainte Martine, vierge et martyre du IIIe siècle – qui a donc précédé son pendant masculin… Si le « saint fondateur » est bien présent, il y a aussi le souci de rendre justice à des Martin méconnus et pourtant eux aussi fondateurs, en tout cas inventeurs : deux chapitres intitulés « L’invention de l’Amérique » consacrent Joseph Plumb Martin (« Martin yankee ») et Joseph Martin (« Martin cherokee »), un autre, intitulé « Naissance de l’Australie », évoque James Martin (ne pas confondre avec un autre James Martin, évadé de Botany Bay)…
C’est dire leur importance, voire leur puissance de création. Impossible évidemment (et inutile) de reprendre ici toutes les trouvailles, tous les détails historiques qui rythment ces pages. Je m’arrêterai un instant sur le chapitre consacré à Claude Martin, « dit le Major Martin », que les Lyonnais connaissent surtout comme le « fondateur de La Martinière », ces lycées dont il avait demandé la création dans son testament. On sait moins qu’il fut un grand voyageur, un aventurier, « négociant, financier et promoteur » : « Le sens des affaires, l’esprit d’entreprise qu’il se découvre doivent l’étonner lui-même. » Autre domaine : le Martin (Jean-Pierre) musicien ne pouvait faire l’impasse sur le Martinů (Bohuslav) compositeur, le « quatrième mousquetaire tchèque » (avec Dvořak, Janáček et Smetana), dont la biographie mouvementée (entre sa Bohême natale, Paris, New-York…) est à l’image de l’œuvre, abondante et multiple, en dehors des écoles et des modes – une originalité qui ne doit pas être pour déplaire à la tribu des Martin.
« Sept mille soixante-quatorze Martin, sans compter les disparus » : ils mériteraient d’être tous nommés, ces Martin morts dans les batailles et les tranchées de la guerre de 1914-1918 ; mais la liste en est si longue ! Hommage collectif, donc, et particulier pour Nelly Martin, une « diva » (pseudonyme Nelly Martyl), qui s’est engagée comme infirmière « sous la mitraille ». Et en matière d’engagement, nous avons deux Henri Martin représentant deux bords radicalement opposés, deux conceptions entre lesquelles l’auteur a manifestement choisi la deuxième (à bon escient), celle qui a produit le « saint laïc » en lutte contre le colonialisme et participant au roman national. Écoutez ce double hommage : « Dans mon lignage, tu es à la fois le contraire et le double de Thérèse Martin, dite de Lisieux : toi, Henri, le petit soldat réfractaire, et elle, Thérèse, la petite sainte de province, vous êtes deux icônes de notre tradition nationale. Vous appartenez à deux mémoires cloisonnées, vous plantez vos drapeaux dans deux régions antipodiques : les lendemains qui chantent ici-bas et le paradis du Très-Haut. » Cela dit, comme les Jean-Pierre (j’en connais plusieurs) ou les Jacques (même remarque), les Henri foisonnent ; outre les précédents, un peintre, un historien et homme politique (cher aux amateurs de Monopoly), et bien d’autres qu’il aurait été fastidieux de recenser, et qui ne le sont pas.
Jean-Pierre Martin (notre auteur) n’a vraiment pas rechigné. Son livre est le fruit, n’en doutons pas, d’un travail colossal, de recherches rigoureuses (livres, journaux, archives), de pêche en eaux profondes (martin-pêcheur… facile). Mais il ne s’agit pas que de cela. Jean-Pierre Martin est un écrivain, et même si l’on peut lire son livre « à sauts et à gambades », nous avons affaire à un roman riche en péripéties et en ramifications, ou à une série de romans qui, comme les Martin, peuvent se reproduire et se multiplier à l’infini.
Jean-Pierre Longre
19:04 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, histoire, francophone, jean-pierre martin, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/11/2021
Un lourd héritage
 Jean-Paul Dubois, La succession, Éditions de l’Olivier, 2016, Points, 2017, rééd. 2021
Jean-Paul Dubois, La succession, Éditions de l’Olivier, 2016, Points, 2017, rééd. 2021
En lisant ce roman de Jean-Paul Dubois, vous saurez tout sur la pelote basque et la vie des « pelotari » professionnels de Miami, leurs maigres salaires et la « grande grève » qu’ils menèrent en 1988. Vous saurez tout sur la Triumph Vitesse MK2, sur la Karmann Ghia, sur le dernier des quaggas, ces drôles de zèbres, sur le prétendu « complot des blouses blanches » fabriqué par Beria à la mort de Staline, sur la tentative d’assassinat de Roosevelt par le maçon Zangara, sur les hespérophanes et sur bien d’autres choses encore, dont l’art de se suicider.
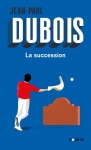 À part le dernier point, ce n’est pas l’essentiel, loin s’en faut, mais cela fait partie du tout romanesque. L’auteur a l’art de raconter des histoires ébouriffées tournant autour d’un axe solide, généralement un personnage prénommé Paul, menant ce qui est pour lui une vie normale, pour d’autres une vie étrange. « Qu’est-ce qui cloche chez toi ? », comme le répète régulièrement son amie Soraya au protagoniste de La succession. Paul Katrakilis, médecin sans patients et surtout joueur de pelote basque, se souvient des quatre années où il fut « un homme profondément heureux, comblé en toutes choses », entre 1983 et 1987. Il exerçait alors le seul métier qui lui plaisait, vivait en parfaite harmonie avec un petit chien qu’il avait sauvé de la noyade, jouissait de la solide amitié d’Epifanio, pelotari comme lui, était tombé sous le charme d’une splendide norvégienne en pleine maturité, menait avec jubilation sa Karmann sur les routes de Floride et son vieux petit bateau le long des côtes…
À part le dernier point, ce n’est pas l’essentiel, loin s’en faut, mais cela fait partie du tout romanesque. L’auteur a l’art de raconter des histoires ébouriffées tournant autour d’un axe solide, généralement un personnage prénommé Paul, menant ce qui est pour lui une vie normale, pour d’autres une vie étrange. « Qu’est-ce qui cloche chez toi ? », comme le répète régulièrement son amie Soraya au protagoniste de La succession. Paul Katrakilis, médecin sans patients et surtout joueur de pelote basque, se souvient des quatre années où il fut « un homme profondément heureux, comblé en toutes choses », entre 1983 et 1987. Il exerçait alors le seul métier qui lui plaisait, vivait en parfaite harmonie avec un petit chien qu’il avait sauvé de la noyade, jouissait de la solide amitié d’Epifanio, pelotari comme lui, était tombé sous le charme d’une splendide norvégienne en pleine maturité, menait avec jubilation sa Karmann sur les routes de Floride et son vieux petit bateau le long des côtes…
 Quatre années qui durent s’interrompre pour un retour à Toulouse, dans la grande maison pleine des fantômes familiaux. Un lourd héritage pèse sur Paul : les suicides de son grand-père, paraît-il ancien médecin de Staline, de sa mère et de son oncle qui ne pouvaient se passer l’un de l’autre, enfin de son père… Ce père médecin qui avait prévu que son fils prenne sa suite. C’est ce que Paul va se risquer à faire : rouvrir le cabinet Katrakilis, recevoir et visiter les malades, en une « succession » qui ira plus loin que ce qu’il avait pensé. « J’avais 44 ans, la vie sociale d’un guéridon, une vie amoureuse frappée du syndrome de Guillain-Barré et je pratiquais avec application et rigueur un métier estimable mais pour lequel je n’étais pas fait. ». Un métier qui le conduira jusqu'au partage des secrets de son père.
Quatre années qui durent s’interrompre pour un retour à Toulouse, dans la grande maison pleine des fantômes familiaux. Un lourd héritage pèse sur Paul : les suicides de son grand-père, paraît-il ancien médecin de Staline, de sa mère et de son oncle qui ne pouvaient se passer l’un de l’autre, enfin de son père… Ce père médecin qui avait prévu que son fils prenne sa suite. C’est ce que Paul va se risquer à faire : rouvrir le cabinet Katrakilis, recevoir et visiter les malades, en une « succession » qui ira plus loin que ce qu’il avait pensé. « J’avais 44 ans, la vie sociale d’un guéridon, une vie amoureuse frappée du syndrome de Guillain-Barré et je pratiquais avec application et rigueur un métier estimable mais pour lequel je n’étais pas fait. ». Un métier qui le conduira jusqu'au partage des secrets de son père.
Jean-Paul Dubois sait réunir dans un même mouvement narratif l’humour et le désespoir, sait superposer le bonheur d’exister et le malheur de vivre, la chaleur humaine et la méchanceté des hommes. La succession le prouve brillamment.
Jean-Pierre Longre
19:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, Éditions de l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/04/2021
Les paradoxes du malheur
 Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Éditions de l’Olivier, 2019, Points, 2021
Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Éditions de l’Olivier, 2019, Points, 2021
Prix Goncourt 2019
Une ou deux fois ne sont pas coutume. Il est rare dans ces pages de trouver une chronique sur un livre récompensé par le prix Goncourt. Mais en 2019, ouf ! Nous avons échappé à une intarissable fabricante de best-sellers qui se veut magicienne des Lettres et qui n’a pas besoin d’afficher des prix pour remplir les têtes de gondole. Bref, des deux, c’est bien Jean-Paul Dubois qui méritait la récompense, même si à juste titre on avait déjà beaucoup parlé de son roman.
 Cette notoriété m’évitera de donner un résumé de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Résumé qui d’ailleurs aurait du mal à rendre compte de toutes les aventures qui arrivent à Paul Hansen, et dont il fait lui-même le récit depuis sa cellule d’une prison de Montréal. Pourquoi est-il en prison, lui qui est l’altruisme même, au plein sens du terme ? On ne le saura que sur le tard (stratégie du suspense) ; disons que c’est l’aboutissement (heureusement non définitif) d’un long processus mouvementé : enfant toulousain d’un père danois et pasteur qui perd la foi, d’une mère magnifique, militante et lointaine, Paul va naviguer vers l’âge adulte en suivant son père au Canada, où il deviendra pour de nombreuses années « superintendant » (c’est-à-dire homme à tout faire) de L’Excelsior, une résidence sécurisée à l’américaine pour privilégiés actifs ou retraités – où il aura des amis, mais aussi un ennemi acharné qui le fera sortir de ses gonds. Une compagne idéale, une chienne affectueuse, un métier qui lui plait, qui lui permet de s’adonner à son empathie naturelle et à « son envie de réparer les choses, de bien les traiter, de les soigner, de les surveiller. »... L’auteur combine à merveille l’art du récit à rebondissements, l’art du portrait juste et révélateur, l’art de la surprise et du paradoxe. La cohabitation de Paul, par exemple, avec le détenu Patrick Horton, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos », un passionné de Harley Davidson qui a vraisemblablement assassiné un Hells Angel, pourrait être un enfer ; eh bien non, Patrick, cette force de la nature qui souffre pourtant de phobies inattendues, est d’une bienveillance toute protectrice… Le tout à l’avenant : le père, pasteur en pays catholique, se prend d’une passion fiévreuse et destructrice pour les jeux de hasard, le cinéma d’art et d’essai de la mère est devenu une salle spécialisée dans les films porno, la compagne d’origine algonquine pilote audacieusement un antique aéronef au-dessus des immensités glacées, le seul véritable ami (outre la chienne Nouk) que Paul se fait à l’Excelsior est « casualties adjuster », chargé d’évaluer le prix des morts pour les compagnies d’assurance…
Cette notoriété m’évitera de donner un résumé de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Résumé qui d’ailleurs aurait du mal à rendre compte de toutes les aventures qui arrivent à Paul Hansen, et dont il fait lui-même le récit depuis sa cellule d’une prison de Montréal. Pourquoi est-il en prison, lui qui est l’altruisme même, au plein sens du terme ? On ne le saura que sur le tard (stratégie du suspense) ; disons que c’est l’aboutissement (heureusement non définitif) d’un long processus mouvementé : enfant toulousain d’un père danois et pasteur qui perd la foi, d’une mère magnifique, militante et lointaine, Paul va naviguer vers l’âge adulte en suivant son père au Canada, où il deviendra pour de nombreuses années « superintendant » (c’est-à-dire homme à tout faire) de L’Excelsior, une résidence sécurisée à l’américaine pour privilégiés actifs ou retraités – où il aura des amis, mais aussi un ennemi acharné qui le fera sortir de ses gonds. Une compagne idéale, une chienne affectueuse, un métier qui lui plait, qui lui permet de s’adonner à son empathie naturelle et à « son envie de réparer les choses, de bien les traiter, de les soigner, de les surveiller. »... L’auteur combine à merveille l’art du récit à rebondissements, l’art du portrait juste et révélateur, l’art de la surprise et du paradoxe. La cohabitation de Paul, par exemple, avec le détenu Patrick Horton, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos », un passionné de Harley Davidson qui a vraisemblablement assassiné un Hells Angel, pourrait être un enfer ; eh bien non, Patrick, cette force de la nature qui souffre pourtant de phobies inattendues, est d’une bienveillance toute protectrice… Le tout à l’avenant : le père, pasteur en pays catholique, se prend d’une passion fiévreuse et destructrice pour les jeux de hasard, le cinéma d’art et d’essai de la mère est devenu une salle spécialisée dans les films porno, la compagne d’origine algonquine pilote audacieusement un antique aéronef au-dessus des immensités glacées, le seul véritable ami (outre la chienne Nouk) que Paul se fait à l’Excelsior est « casualties adjuster », chargé d’évaluer le prix des morts pour les compagnies d’assurance…
Mais les faits, les situations et les personnages ne sont paradoxaux qu’en apparence. Jean-Paul Dubois possède tout à la fois le sens de la construction narrative, l’audace du réalisme, l’ardeur de l’imagination et la richesse de la sensibilité. Certes, pour lui, d’une manière générale, la destinée humaine est vouée à l’échec et au malheur : « À l’intérieur d’un immeuble ou d’une communauté, le malheur s’installe généralement par période. Pendant plusieurs mois, il va rôder dans les étages, oeuvrant de porte en porte, croquant d’abord le faible, ruinant les espérants. Et puis, un jour, changer de rue, de quartier, poursuivant à l’aveugle son travail d’artisan. ». Progression similaire pour tous les individus. Mais l’écriture de Jean-Paul Dubois convoque toutes les ressources de la générosité, de l’amitié, de l’amour, de l’humour. Et la pilule passe à merveille. Chaleureuse et euphorisante.
Jean-Pierre Longre
23:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, éditions de l’olivier, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2021
D’une tempête à l’autre
Lire, relire... Jean-Paul Dubois, Une vie française, Éditions de l’Olivier, 2004, Points 2, 2011, rééd. Points 2021
 Comme en arrière-plan, s’écoule le temps politique, la succession des mandats présidentiels (De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand I, Mitterrand II, Chirac I, Chirac II…). Sur la scène elle-même, se joue la vie personnelle du narrateur, Paul Blick, avec les péripéties qui jalonnent une existence faite d’immobilisme et de tourments, de laisser-faire et de bonds en avant.
Comme en arrière-plan, s’écoule le temps politique, la succession des mandats présidentiels (De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand I, Mitterrand II, Chirac I, Chirac II…). Sur la scène elle-même, se joue la vie personnelle du narrateur, Paul Blick, avec les péripéties qui jalonnent une existence faite d’immobilisme et de tourments, de laisser-faire et de bonds en avant.
Mais les deux plans, le décor et la pièce qui se déploie sous nos yeux ne sont pas aussi distincts qu’il n’y paraît ; ils se rejoignent, se croisent, se superposent : on a bien affaire à une « vie française », celle d’un homme de notre époque et de notre contrée qui cherche sa voie, qui pense parfois l’avoir trouvée, qui la perd ou pense l’avoir perdue ; un homme qui déroule son histoire cahoteuse au milieu d’une Histoire dont le propre déroulement chaotique ne peut être enrayé.
Jean-Paul Dubois, donc, nous plonge directement dans les perturbations de la vie de Paul Blick, depuis la première tempête vécue par l’enfant – la mort de son frère – jusqu’à la dernière – la mort de sa femme dans des circonstances qu’il devra apprendre à maîtriser, puisqu’elle entraînera les désillusions, la ruine financière, la maladie de sa fille, et que l’autre femme de sa vie, sa mère, s’effacera à son tour en toute lucidité politique… Entre temps, il y aura eu mai 68, une jeunesse d’étudiant en sociologie (c’est-à-dire tournée vers beaucoup d’autres préoccupations que les études), les amours et les amitiés, la musique, les changements de cap, le mariage, les enfants et le travail d’homme au foyer, les courts et longs voyages à la recherche d’arbres à photographier, figés dans leur solitude orgueilleuse, une solitude dans laquelle Paul Blick se reconnaît lui-même, repoussant les sollicitations sociales, relationnelles, professionnelles et politiques (une drôle d’intervention de Mitterrand, notamment).
 Chronique du dernier demi-siècle, compte rendu d’une initiation (initiation au vieillissement et au désenchantement, et aussi à une vie qui ne demande qu’à se construire ou au moins à se dessiner), récit d’un naufrage auquel on tâche de réchapper tant bien que mal (et la véritable confrontation avec les éléments déchaînés subie par Paul et son beau-père une nuit d’orage méditerranéen s’impose comme une récapitulation concrète de la situation), tragi-comédie pathétique ou drame socio-familial, incessant questionnement individuel qui demeurera sans réponses, traversée d’un territoire parsemé de viaducs, de tunnels, de paysages lumineux et de sombres pièges… Une vie française est tout cela à la fois : sous un titre dont l’apparente simplicité annonce un programme dense et périlleux, un vrai roman d’aujourd’hui, personnel et universel.
Chronique du dernier demi-siècle, compte rendu d’une initiation (initiation au vieillissement et au désenchantement, et aussi à une vie qui ne demande qu’à se construire ou au moins à se dessiner), récit d’un naufrage auquel on tâche de réchapper tant bien que mal (et la véritable confrontation avec les éléments déchaînés subie par Paul et son beau-père une nuit d’orage méditerranéen s’impose comme une récapitulation concrète de la situation), tragi-comédie pathétique ou drame socio-familial, incessant questionnement individuel qui demeurera sans réponses, traversée d’un territoire parsemé de viaducs, de tunnels, de paysages lumineux et de sombres pièges… Une vie française est tout cela à la fois : sous un titre dont l’apparente simplicité annonce un programme dense et périlleux, un vrai roman d’aujourd’hui, personnel et universel.
Jean-Pierre Longre
http://www.editionsdelolivier.fr
19:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, éditions de l’olivier, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/08/2020
Avec les « corps errants »
 Jean-Pierre Martin, Mes fous, Éditions de l’Olivier, 2020
Jean-Pierre Martin, Mes fous, Éditions de l’Olivier, 2020
La famille de Sandor, vue de loin, ne sort pas des normes sociales actuelles. Une femme dont il est séparé mais avec laquelle les relations restent solidairement stables, quatre enfants harmonieusement échelonnés. Sauf que… Sa fille Constance souffre d’une folie qui le ronge perpétuellement ; quant à ses fils, l’un est addict aux écrans, un autre s’est mis en tête de « sauver la planète », et le dernier « est tellement adapté au monde qu’il s’est préservé de la profondeur comme de l’angoisse. » Bref, « nos enfants se sont mis sérieusement à dérailler les uns après les autres autour de la vingtaine, enfin au moins trois des quatre. » Quant à Sandor lui-même, qui a sans doute hérité de la mélancolie de son père, il est comme un aimant pour les fous, qui l’abordent dans les lieux publics comme s’il était l’un des leurs, et pour qui il ressent une sincère affection (« Mes fous », clame le titre).
Son récit est rythmé par ces rencontres dans les rues de Lyon, par les conversations parfois déroutantes qu’il a avec ceux qu’il appelle les « corps errants », et par l’épreuve que représentent pour lui l’état et les délires de Constance. Une « étrange coïncidence » lui permet de revoir avec plaisir Rachel, qui avait été étudiante avec lui, et dont le frère est lui aussi plongé dans la folie. « Avec Rachel, on s’est dit d’un commun accord : il y a deux catégories de personnes, celles qui ont eu affaire à la folie de près, et les autres. Je me suis trouvé une sœur de détresse. »
La folie est-elle un sujet de littérature ? Sans doute. Sandor assiste à un colloque universitaire intitulé « Littérature et folie » (l’occasion de légères pointes humoristiques) ; et les pages de son récit sont pleines d’allusions et de références à des personnages et à des écrivains qui ont eu à voir avec « le désordre mental ». Les surréalistes bien sûr (avec Nadja de Breton au premier plan), et aussi Artaud, Hölderlin, Flaubert, Balzac, Romain Gary etc. Il y a aussi la musique (il écoute et joue du Schumann, « rien que du Schumann », comme par hasard). On pourrait penser que, de même que Queneau a farci son roman Les enfants du limon d’extraits substantiels de son étude sur les « fous littéraires », de même Jean-Pierre Martin (fin connaisseur et adepte lucide du dit Queneau) a bâti une belle fiction qui lui permet de s’exprimer ouvertement sur la folie, en évitant les circonvolutions langagières de la philosophie et de la psychiatrie. Et il n’y a pas que cela. Il y a la vie, dont le retrait du monde (retrait mental ou physique) permet d’appréhender la vraie substance. « Notre vie est à la fois précaire et infinie. Il y a quelque chose d’enivrant dans cette histoire de fin du monde. C’est une occasion à saisir pour les âmes blessées. Pendant tous ces mois, j’ai de fait survécu. Je vais continuer à survivre, mais dans un autre sens. Je ne me soucie plus seulement de mes proches, de la folie dévastatrice ou des humains en général. Mon empathie s’étend à l’univers. ».
Jean-Pierre Longre
12:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-pierre martin, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/01/2019
Obscurs et fabuleux
 Richard Ford, Entre eux, traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun, Éditions de l’Olivier, 2017, Points, 2018
Richard Ford, Entre eux, traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun, Éditions de l’Olivier, 2017, Points, 2018
Les vies respectives et communes de Parker Ford et d’Edna Akin, mariés en 1928, n’eurent rien d’extraordinaire. Lui voyageur de commerce, elle l’accompagnant sur les routes du sud des États-Unis avant la naissance tardive (1944) de Richard, ils ont mené une existence sans histoires exceptionnelles jusqu’à la mort prématurée de Parker, qui a laissé un vrai vide – même si, du fait de son métier, il était absent à longueur de semaine, ne rejoignant sa femme et son fils que le vendredi soir. Pour l’enfant en tout cas, la vie familiale n’était pas source de problèmes majeurs. « Ai-je jamais senti le moindre malaise entre eux ? Non. Ma nature d’enfant me donnait à penser qu’en gros, tout allait bien. Néanmoins si le scénario de la vie tend toujours à lisser le quotidien, alors notre vie s’en démarquait. […] Ils m’aimaient, ils me protégeaient, mais dans ma vie tout bougeait, les événements, les objets, les êtres ; j’étais seul les trois quarts du temps, sur la touche. Ce qui ne me dérangeait pas, et ne me dérange pas davantage aujourd’hui. Mais dire que la vie était calme, non. ». Mieux, l’absence paternelle a peut-être permis à Richard de se « rêver une vie privée », et finalement d’être devenu écrivain ; et pourtant le regret est constant chez lui de n’avoir pas pu parler à son père « en adulte ».
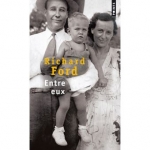 La construction du livre est claire : une moitié pour le père, une moitié pour la mère, qui a vécu bien plus longtemps que son mari, d’où les rapports privilégiés entretenus avec son fils. « A-t-on jamais une “relation” avec sa mère ? Je crois que non. Nous, ma mère et moi, n’avons jamais été unis par un lien classique, que ce lien repose sur le devoir, le regret, la culpabilité, la gêne ou la courtoisie. L’amour, qui n’est jamais classique, nous mettait à l’abri de tout. Nous pensions qu’il était solide et il l’était. ».
La construction du livre est claire : une moitié pour le père, une moitié pour la mère, qui a vécu bien plus longtemps que son mari, d’où les rapports privilégiés entretenus avec son fils. « A-t-on jamais une “relation” avec sa mère ? Je crois que non. Nous, ma mère et moi, n’avons jamais été unis par un lien classique, que ce lien repose sur le devoir, le regret, la culpabilité, la gêne ou la courtoisie. L’amour, qui n’est jamais classique, nous mettait à l’abri de tout. Nous pensions qu’il était solide et il l’était. ».
On s’en aperçoit, il ne s’agit pas seulement dans cette autobiographie d’un récit d’enfance. Il s’agit aussi d’une réflexion sur la vision que les enfants ont de leurs parents et sur la vérité des souvenirs – réflexion qui ponctue régulièrement le récit. « La vie de nos parents nous échappe en partie, pas de leur fait mais du nôtre, et dans ces conditions s’apercevoir qu’on ne sait pas tout est affaire de respect car les enfants rétrécissent le cadre de référence de tout ce à quoi ils appartiennent. Alors qu’être dans l’ignorance de la vie d’autrui, ou la réduire à un objet de spéculations, confère à cette vie une latitude qui rapproche de sa vérité. ». Et pour affirmer, vérifier en quelque sorte l’authenticité des faits et des sentiments ici rapportés, il y a les photographies : portraits, photos du couple avec ou sans le jeune Richard, de la famille (les « beaux-parents » Bennie et Essie), cliché joyeux de Richard avec sa femme, bien plus tard… Nostalgie et documents font bon ménage, ce qui n’exclut pas les nombreuses questions sur la relativité de l’existence et sur les aléas de la destinée.
Entre eux est à la fois questionnement et autobiographie, document et récit ; c’est surtout un bel hommage rendu à deux êtres à la fois ordinaires et singuliers, devenus dignes d’intérêt par la grâce de l’amour et de l’écriture, et un bel hommage à la vie. « Quand on m’interroge sur mon enfance, je réponds toujours qu’elle a été fabuleuse et que mes parents étaient fabuleux. Rien n’a changé sur ce point avec ce livre. Mais ce que j’ai compris en l’écrivant, c’est qu’à l’intérieur de ce cercle “fabuleux”, ce qu’il y avait de plus intime, de plus important, de plus satisfaisant et de plus nécessaire filtrait « entre eux », à l’exclusion de toute autre personne. Et, en particulier, de moi. On aurait tort de croire qu’un fils s’en porte nécessairement plus mal. À bien des égards, le constat est encourageant car il préserve ce mystère optimiste : pour attentif qu’on soit, une large part de ce qui advient nous échappe. ».
Jean-Pierre Longre
19:24 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, anglophone, richard ford, josée kamoun, Éditions de l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/10/2016
Comment s’en sortir ?
 Christian Oster, Le cœur du problème, Éditions de l’Olivier, 2015, Points, 2016
Christian Oster, Le cœur du problème, Éditions de l’Olivier, 2015, Points, 2016
Avec Christian Oster, on n’est jamais au bout de sa surprise. Dans ce roman (comme dans d’autres, rappelons-le), l’événement déconcertant intervient dès le départ : Simon, le narrateur, rentrant chez lui un soir, trouve dans son salon le cadavre d’un homme, visiblement tombé de la mezzanine dont la balustrade, déjà branlante auparavant, a cédé. Diane, sa compagne, qui prenait son bain, et dont l’inconnu était vraisemblablement l’amant, le quitte dans la foulée, le laissant se « débrouiller » avec l’encombrant colis. Que va-t-il en faire ? Après maintes tergiversations et divers transports dans le coffre de sa voiture, il décide de l’enterrer dans le potager, sous les plants de tomates.
D’autres, à partir de cette situation à suspense, auraient bâti un polar, voire un thriller, avec enquête à rebondissements multiples. On a bien affaire à un roman noir, mais le noir n’est pas celui des péripéties ; plutôt celui qui habite et ronge le personnage de l’intérieur, avec ses hésitations, ses doutes, sa solitude. Un personnage qui s’enfonce comme malgré lui, mais aussi avec une sorte de délectation, dans les difficultés, ne trouvant pas de porte de sortie. « J’ai eu pitié de moi, plus ça allait moins je trouvais de solution satisfaisante ». Ce genre de lucidité paraît commander son comportement. Fait marquant et significatif : la principale rencontre qu’il fait est celle d’un policier à la retraite, avec qui il va jouer au tennis, partir pour un improbable séjour chez la belle-sœur de son nouvel ami, y faire d’autres rencontres – toujours avec en lui le souvenir et le poids du cadavre qu’il a enterré.
 « Le cœur du problème » réside au premier degré dans ce cadavre non identifié. Mais il concerne surtout Simon, qui se tend des pièges à lui-même tout en les considérant avec une certaine distance. Saisi d’une culpabilité qui ne devait pas le concerner, il semble vouloir se laisser deviner. « Tout est normal. C’est-à-dire rien. En même temps, ça n’a pas tellement d’importance. J’ignore si je ressens quoi que ce soit, en fait. Quand j’arrive chez moi, c’est pareil. ». Et l’amour qu’il éprouve toujours malgré tout pour Diane n’est pas pour rien dans cette sorte d’indifférence à soi. L’auto-analyse est circonstanciée, dans une recherche incessante, et le style de Christian Oster colle à cette recherche, suit dans le détail les méandres de la pensée. Avec cela, l’important est suggéré, la narration se développe avec ses vides, ses non-dits. Au lecteur, sous le choc et sous le charme, de prendre en charge les angoisses de Simon.
« Le cœur du problème » réside au premier degré dans ce cadavre non identifié. Mais il concerne surtout Simon, qui se tend des pièges à lui-même tout en les considérant avec une certaine distance. Saisi d’une culpabilité qui ne devait pas le concerner, il semble vouloir se laisser deviner. « Tout est normal. C’est-à-dire rien. En même temps, ça n’a pas tellement d’importance. J’ignore si je ressens quoi que ce soit, en fait. Quand j’arrive chez moi, c’est pareil. ». Et l’amour qu’il éprouve toujours malgré tout pour Diane n’est pas pour rien dans cette sorte d’indifférence à soi. L’auto-analyse est circonstanciée, dans une recherche incessante, et le style de Christian Oster colle à cette recherche, suit dans le détail les méandres de la pensée. Avec cela, l’important est suggéré, la narration se développe avec ses vides, ses non-dits. Au lecteur, sous le choc et sous le charme, de prendre en charge les angoisses de Simon.
Jean-Pierre Longre
Rappel: Mon grand appartement. Lire ICI
17:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, christian oster, Éditions de l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/03/2016
L’eau de la mémoire
 Valérie Zenatti, Jacob, Jacob, Éditions de l’Olivier, 2014, Points, 2016.
Valérie Zenatti, Jacob, Jacob, Éditions de l’Olivier, 2014, Points, 2016.
Prix du Livre Inter 2015
Une famille juive de Constantine, pauvre, besogneuse, où les hommes (le père, Haïm, le fils aîné, Abraham) font la loi, dure aux femmes et aux enfants fragiles ou rebelles. Dans la promiscuité forcée du petit appartement, rempli de bruits et de disputes, la personnalité de Jacob, le dernier né de Rachel, est celle d’un garçon à part : sensible, tendre, grand lecteur, rêveur, affectueux, il est en retour aimé de tous, particulièrement de sa vieille mère, qui va verser toutes ses larmes en le voyant partir à l’armée en 1944. Elle ne sait pas encore (lui non plus) qu’il va participer au débarquement de Provence, remonter jusqu’en Alsace, où il va perdre la vie.
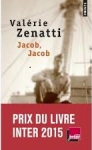 Volontiers solitaire, Jacob Melki n’est pas un misanthrope. De même qu’il avait pris sous son aile son neveu Gabriel, il s’attache au petit groupe qu’il forme avec ses camarades, et qui est représentatif de cette société algérienne où, malgré les disparités sociales, administratives et politiques entretenues par la France, juifs, musulmans, chrétiens cohabitaient en bonne entente. Ce petit groupe est uni jusque dans la souffrance et la mort par une solidarité mutuelle que symbolise la photo envoyée à la famille : « Avant de quitter la caserne d’Alger, Jacob s’est fait prendre en photo avec ses camarades devant une réplique du Normandie, et a posté le cliché à ses parents en griffonnant au dos Vive l’armée française ! De gauche à droite mes compagnons Ouabedssalam, Attali et Bonnin, vous me reconnaîtrez je pense, je n’ai pas tant changé. Je vous embrasse tous, chacun par son nom. Votre fils et frère Jacob. ».
Volontiers solitaire, Jacob Melki n’est pas un misanthrope. De même qu’il avait pris sous son aile son neveu Gabriel, il s’attache au petit groupe qu’il forme avec ses camarades, et qui est représentatif de cette société algérienne où, malgré les disparités sociales, administratives et politiques entretenues par la France, juifs, musulmans, chrétiens cohabitaient en bonne entente. Ce petit groupe est uni jusque dans la souffrance et la mort par une solidarité mutuelle que symbolise la photo envoyée à la famille : « Avant de quitter la caserne d’Alger, Jacob s’est fait prendre en photo avec ses camarades devant une réplique du Normandie, et a posté le cliché à ses parents en griffonnant au dos Vive l’armée française ! De gauche à droite mes compagnons Ouabedssalam, Attali et Bonnin, vous me reconnaîtrez je pense, je n’ai pas tant changé. Je vous embrasse tous, chacun par son nom. Votre fils et frère Jacob. ».
Le récit de Valérie Zenatti ne se termine pas avec la mort de Jacob, ni même avec le chagrin récurrent de Rachel, que la moindre image ramène à celle de son fils chéri. D’une guerre à l’autre, de 1944 à 1961, il rappelle les épreuves subies par l’Algérie et ses habitants, le douloureux départ de la famille de Rachel et Haïm pour la métropole. Mais ce n’est pas un roman historique. Le lien personnel de l’auteure avec Jacob et sa famille, révélé dans les dernières lignes, est en quelque sorte annoncé d’une manière voilée, sous-jacente, dans l’intimité narrative installée par le style. Comme si la sensibilité de Jacob avait déteint sur l’écriture, la force du récit est contenue dans des phrases sinueuses, dont la structure épouse celle des émotions humaines, ces émotions qui forment la trame véritable de l’histoire. Et la mémoire se révèle dans le tracé fluctuant de ces phrases, fluctuant comme l’eau qui passe sous le grand pont suspendu de Constantine qu’on ne franchit pas sans une « peur délicieuse », fluctuant comme cette Méditerranée qu’il faut traverser pour accomplir son destin.
Jean-Pierre Longre
17:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, valérie zenatti, Éditions de l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/10/2012
Après la chute
 Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Avec les héros de Jean-Paul Dubois, on ne risque pas de s’ennuyer – même si eux-mêmes plongent parfois dans le désespoir et la dépression. Paul Sneijder est, comme les précédents et comme l’annonce le titre, un « cas ». Mais pas tout de suite. Sa vie aurait pu rester dans des normes sociales conventionnelles : une femme du genre « executive woman », des jumeaux qui suivent les traces de leur mère, une fille d’un premier mariage, rejetée par la nouvelle famille, un exil au Québec pour la carrière de l’épouse, un intérêt particulier pour les morts collectives d’animaux (oiseaux, poissons)… Bref, une existence qui, sans être complètement ordinaire, n’est pas encore matière à roman.
 Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Paul Sneijder bascule, pour ainsi dire, vers la face cachée de l’humanité. Son obsession : étudier les divers mécanismes qui commandent les mouvements des ascenseurs, au point d’en devenir un spécialiste. Son occupation : promener les chiens des autres, au point de se prendre d’affection pour eux. Son culte : celui des cendres de Marie, dont il conserve précieusement l’urne sur son bureau. Son amusement : relever, par exemple, les nombres palindromiques trouvés par son patron. Ses souvenirs : précis, sans défauts (« Je me souviens de tout ce que j’ai fait, dit ou entendu » : telle est la première phrase du livre). Ces changements qui, aux yeux de sa femme et de ses  jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
Jean-Paul Dubois a l’art de dénicher des situations inattendues, de les cultiver, de les exploiter dans sa tonalité particulière, où tragédie et comédie se mêlent et se complètent à merveille.
Jean-Pierre Longre
13:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, Éditions de l’olivier, éditions a vue d'oeil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

