30/08/2012
« Les mots de la faim »
 Herta Müller, La bascule du souffle, traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, Gallimard 2010, Folio 2011
Herta Müller, La bascule du souffle, traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, Gallimard 2010, Folio 2011
En 1945, le jeune Léopold, comme tous les Allemands de Roumanie âgés de 17 à 45 ans, est déporté en Union Soviétique. Il restera cinq ans dans un camp, à y subir le travail forcé, les brimades, la faim, à y côtoyer la mort et la souffrance, à y chercher dans le moindre objet, dans le moindre croûton de pain, dans le moindre brin d’herbe une parcelle du bonheur dont ne peuvent se passer les humains.
Herta Müller l’explique en postface : l’histoire de Léopold est largement inspirée de celle d’Oskar Pastior, poète de langue allemande et d’origine roumaine, mort en 2006 après avoir vécu dans sa jeunesse la douloureuse expérience des camps soviétiques, exercé différents métiers, s’être enfin voué, une fois exilé en Autriche puis en Allemagne, à l’écriture littéraire.
Malgré les détails vécus, le livre n’est pas un document de plus sur le goulag. Les choses, les paysages, les gestes quotidiens, intimement incorporés au conscient et à l’inconscient, vivent leur vie, s’imposent au plus profond de l’âme, des rêves, des sensations du narrateur. « L’ange de la faim », leitmotiv qui mine le récit autant que les corps des prisonniers, est l’un de ces fantômes qui hantent leur existence et leurs relations. Les objets usuels (la pelle, le peigne à poux, le charbon, les parpaings, la cuiller…), tout en donnant rythme aux jours et aux nuits, ainsi qu’aux brefs chapitres qui sont comme des tranches de vie, sont les points d’ancrage qui permettent aux êtres de ne pas sombrer.
Et les mots sont les instruments qui non seulement transfigurent le malheur et son souvenir, mais aussi qui pèsent sur le narrateur et son propre récit. Objets poétiques, parfois inutiles et absurdes, ils sont comme le ciment qui, au camp, s’insinuait partout lorsqu’on ne le maîtrisait pas : « Il y a des mots qui font de moi ce qu’ils veulent. Ils sont très différents de moi, et leurs pensées sont différentes d’eux. S’ils me viennent à l’esprit, c’est pour me rappeler qu’il y a de premières choses qui en appellent des deuxièmes, même si je suis loin de le vouloir ».
Jean-Pierre Longre
Herta Müller est Prix Nobel de littérature 2009
12:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, allemagne, roumanie, herta müller, claire de oliveira, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2011
Le sacre du métèque
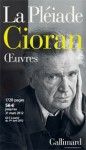 Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Venu des Carpates et des « cimes du désespoir », exilé à Paris, prisonnier volontaire d’une langue nouvelle et d’un pessimisme provocateur, Cioran est l’un des grands écrivains français du XXe siècle. Lui consacrer un volume de la Pléiade était justice, et la publication de ses Œuvres est un modèle du genre.
Les éditeurs ont choisi à bon escient de se limiter (si l’on peut dire) aux textes rédigés en langue française. Ce choix est dû à des raisons non seulement linguistiques et chronologiques, mais aussi philosophiques et littéraires. Les dix œuvres « françaises » publiées, présentées et annotées ici, même si elles n’échappent pas – et c’est heureux – à l’héritage roumain, forment un ensemble cohérent dans sa succession interne, tant du point de vue de la pensée que de celui du style.
On lira (ou relira) donc avec un bonheur non dénué d’une angoisse communicative Précis de décomposition, Syllogismes de l’amertume, La tentation d’exister, Histoire et utopie, La chute dans le temps, Le mauvais démiurge, De l’inconvénient d’être né, Écartèlement, Aveux et anathèmes, Exercices d’admiration, le tout complété, comme il se doit dans la Pléiade, par une préface, une biographie, une bibliographie, des notices, des notes, des appendices… Comme il se doit, et plus qu’il ne se doit : la préface, entre autres, offre, certes, une synthèse impeccable de l’œuvre de Cioran, une analyse limpide de son écriture, des ouvertures séduisantes sur les origines et les enjeux des textes, mais elle est aussi en elle-même un morceau de littérature ; à la fois enthousiaste et distanciée, construite et foisonnante, elle offre un bel exemple de « style comme aventure ».
Avec ce volume, le plaisir d’entendre une « voix [qui] accède à une pluralité de formes et de tons – de l’essai lyrique au lambeau delphique, de l’aphorisme ravageur à l’épître complice, de l’effigie destructrice à l’oraison non-violente… » est relevé par celui d’en apprendre beaucoup sur cette « voix », sur ce qui l’a construite et sapée, nourrie et affamée, encouragée et découragée, composée et décomposée. Au-delà de l’amertume ou des anathèmes, ce sont bien des « exercices d’admiration » que nous sommes amenés à pratiquer en l’écoutant, et en écoutant celles qui l’accompagnent.
Jean-Pierre Longre
19:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, francophone, roumanie, cioran, nicolas cavaillès, aurélien demars, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/09/2011
Se défaire du monde
 Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
« Nous avons été deux hommes juchés face au mal. J’ai su que vous souffriez comme je souffrais. Nous adressions à des dieux différents des lamentations qui n’empruntaient pas les mêmes mots. Je ne savais pas quelle peine vous avait conduit près de moi. Je ne pensais pas qu’il fût de peine qui valût la mienne. Mais vous étiez venu du bout de la terre. Nous fûmes une seule protestation et l’amour qui ne renonce pas ».
Ces deux hommes, Monsieur de la Tour et Lu Wei, n’étaient pas faits pour se connaître : le premier, noble français plus ou moins mêlé à la Fronde, et le second, dignitaire chinois déchu par les guerres et le renversement de la dynastie des Ming, sont séparés non seulement par les océans, mais aussi par leurs origines et leurs cultures. Pourtant, leur rencontre silencieuse et leur amitié précautionneuse sont le fruit d’une convergence qui les rend inévitables : Monsieur de la Tour, brûlant d’un amour coupable et partagé pour Madame de Clermont, fuit au-delà des mers et se retrouve, au bout d’un périple aussi hasardeux que dangereux, sur un îlot où s’est retiré Lu Wei, souffrant lui-même d’un désespérant mal d’amour pour son épouse disparue. Commencent douze années de condamnation volontaire, de réclusion ascétique, au cours desquelles la soif d’absolu tente de panser la blessure, où la quête du vide le dispute à l’espoir en Dieu, ce dieu que Monsieur de la Tour cherchera encore en France, réfugié à Port-Royal, dans le plus complet dénuement, dans cet « abandonnement » qui l’accompagnera jusqu’à la fin.
Le roman de Laurence Plazenet se déroule comme une longue litanie submergeant les heurts, les atrocités, les décompositions qu’il dévoile. Psalmodiées en un récitatif qui donne autant d’importance à la musique des mots qu’à leur contenu, les phrases, dont la sobriété toute classique s’accommode parfois de circonvolutions baroques, sont prenantes. La stylisation de la forme impose l’évidence des faits et des pensées, donne à la prose une profondeur qui révèle celle des âmes.
Jean-Pierre Longre
Laurence Plazenet vient de publier Disproportion de l'homme, Gallimard, 2011. Lecture et chronique à venir…
09:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurence plazenet, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2011
Odyssées urbaines
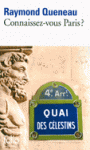 Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
« Ma chronique eut, je dois le dire en toute modestie, un certain succès. Elle dura plus de deux ans ; à raison de trois questions pas jour, cela en fit plus de deux mille que je posai au lecteur bénévole », écrit Queneau dans un article daté de 1955 et reproduit en tête de volume. Cette chronique, donc, parut quotidiennement dans L’Intransigeant du 23 novembre 1936 au 26 octobre 1938. Le livre publié par Odile Cortinovis et Emmanuël Souchier ne reproduit pas les 2102 questions–réponses, mais 456, selon un choix raisonné (c’est-à-dire en fonction des réponses qu’on peut leur apporter encore actuellement).
Quelques exemples ? « Qui était le Père Lachaise ? » ; « Quel est le plus ancien square de Paris ? » ; « Combien y a-t-il d’arcs de triomphe à Paris ? » ; « Quelle est la première voie parisienne qui fut pourvue de trottoirs ? » ; « Quel rapport existe-t-il entre l’église Saint-Séverin et la république d’Haïti ? » ; « Depuis quelle époque les bouquinistes sont-ils établis sur les quais ? » ; « De quand datent les premiers tramways à Paris ? » ; « Combien y avait-il d’édifices religieux à Paris en 1789 ? »… On trouvera les 448 autres questions et toutes les réponses en lisant Connaissez-vous Paris ?
Au-delà de l’encyclopédisme, il y a une vraie philosophie de la promenade urbaine (des « antiopées, ou déambulations citadines », comme le rappelle et l’explique Emmanuël Souchier) et un sens aigu de l’histoire, marques indélébiles de la vie et de la pensée de Queneau. Et, sans en avoir l’air, le goût des voyages : « Je me disais : comme c’est curieux, il me semble que j’ai fait un long… très long… voyage. J’avais visité Paris ». Nous aussi.
Jean-Pierre Longre
18:41 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, francophone, raymond queneau, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/05/2011
La contagion Queneau
 Jean-Pierre Martin, Queneau losophe, Gallimard, « L’un et l’autre », 2011
Jean-Pierre Martin, Queneau losophe, Gallimard, « L’un et l’autre », 2011
Quel présomptueux, ce Jean-Pierre Martin ! se dit-on. Le voilà qui, non content de publier trois livres quasiment en même temps*, se targue d’avoir été élu « meilleur lecteur de son œuvre » par Queneau lui-même, d’avoir entretenu avec lui une correspondance anthume et posthume aussi abondante qu’intime, d’être en quelque sorte le filleul du maître – que dis-je, le filleul : son égal, son conseiller, « sa chance » même ! Autant dire que sans Martin, Queneau n’existerait pas… Bon, tout ça, c’est pour de rire. Un peu. C’est en tout cas pour dire combien le lecteur se sent en phase avec un auteur qu’il admire depuis belle lurette.
Qu’il admire et qu’il comprend, autant qu’on puisse comprendre ce qui se trame derrière l’apparente fantaisie et la multiplicité des facettes qu’avec la discrétion qui le caractérise l’ami Raymond présente à ses observateurs. De même que Jean-Pierre Martin cache sous un ton plaisant une rigoureuse analyse de la « pensée » quenienne, de même Raymond Queneau cache sous le rire communicatif, la myopie sympathique et l’ironique légèreté de ses personnages une gravité tenant à la fois à la réalité de la souffrance et à la profondeur de la réflexion. Il y a bien une « correspondance » entre les deux auteurs, mais une correspondance qui dépasse la fiction des lettres échangées pour atteindre les secrets que recèle le travail littéraire.
Là, il faut bien en venir à la « losophie », qui est, disons, « la philosophie corrigée par le rire, le burlesque, le quotidien et le principe de relativité », ou encore ce qui « emprunte les formes de la littérature pour donner voix à une nébuleuse de pensées et de méditations qui n’ont place dans aucun système » (car, tout de même, « ça ne rigole pas toujours, la losophie »). Bref, pour plus de précisions sur ce concept, on lira avec profit le chapitre intitulé « Morceaux de losophie », sorte de petite anthologie mettant en bonne place quelques œuvres choisies comme Gueule de Pierre, Le Chiendent ou Les Derniers Jours. C’est cela : revenons-en toujours à l’écriture, à la langue, aux textes ; il nous est donné là une belle occasion de relire ceux-ci avec un regard renouvelé.
En mettant l’accent sur les relations intimes qu’il entretient avec Raymond Queneau, Jean-Pierre Martin procure un plaisir contagieux, tout en définissant mine de rien mais sérieusement les tendances (phi)losophiques de l’écrivain, et en livrant une vraie biographie littéraire et orientée de celui avec qui il rêve de faire du tandem sur la côte normande et à qui il n’hésite pas à dire : « Vous avez joué vos tripes tout en laissant tomber la musique guimauve, ce pourquoi on ne vous a pas toujours compris ».
Jean-Pierre Longre
* Outre Queneau losophe : Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2011 (voir ici) ; Les écrivains face à la doxa, essai sur le génie hérétique de la littérature, Éditions José Corti, 2011 (voir là).
15:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, raymond queneau, jean-pierre martin, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/08/2010
Juge et assassin sur la toile
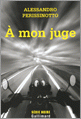 Alessandro Perissinotto, À mon juge. Traduit de l’italien par Patrick Vighetti, Gallimard, Série Noire, 2008
Alessandro Perissinotto, À mon juge. Traduit de l’italien par Patrick Vighetti, Gallimard, Série Noire, 2008
À l’instar de Meursault dans L’étranger, Luca a été poussé au meurtre comme malgré lui, dans un état second, pour un rien, une petite phrase prononcée par celui qui avait été son associé et qui l’avait trahi, ruiné, réduit à néant. Meurtre qui va le poursuivre, qui va l’obliger à fuir l’Italie pour la France, la Belgique, la Hollande… C’est en tout cas ce que nous devons croire, si nous-mêmes nous acceptons de le suivre dans le récit qu’il fait de ses tribulations de ville en ville à travers l’Europe, au cours desquelles la solitude et l’angoisse le disputent aux amitiés et aux amours de rencontre.
Mais la première personne qu’il veut persuader des raisons de son crime, auprès de laquelle il tente de se justifier tout en annonçant à plusieurs reprises qu’il tuera de nouveau, est son juge, « Madame le juge », avec qui il entame une correspondance électronique et qui va très vite jouer le jeu de cette correspondance quasiment intime. Le roman entier, jusqu’à l’adieu final, n’est constitué que de cet étonnant échange d’e-mails, marqué à la fois par la compréhension et l’incompréhension, la confiance et la défiance ; relation privilégiée, qui entraîne le lecteur vers une double identification, au juge et à l’assassin. Et voilà que comme le magistrat, il se met à se poser des questions, le lecteur : faut-il croire l’homme en fuite ? A-t-il vraiment subi ce qu’il prétend avoir subi ? S’est-il laissé piéger ou a-t-il piégé ? Se trompe-t-il ? Nous trompe-t-il ? Est-il bien là où il prétend être ?
Car Luca (adresse « angelo@nirvana.it »), informaticien hors pair, manie si bien les outils virtuels que le doute plane sur l’origine géographique de ses messages, et donc sur les informations qu’il y donne. En même temps, on se laisse volontiers prendre à ses aveux, à ses explications – et du statut de meurtrier il passe à celui de victime. Victime de la puissance économique, du pouvoir de la grande finance et de ses collusions avec le monde politique. Il reste pourtant dans cet univers des êtres doués d’humanité, des êtres simples et aimants, pour qui l’argent – qui souvent leur manque – n’est qu’un moyen d’existence. Mais survivront-ils au cynisme financier ? C’est la vraie question que pose le roman.
Jouant avec beaucoup d’habileté sur les potentialités du monde de l’Internet, tendant sur la toile mondiale les pièges de la virtualité, À mon juge se lit à des niveaux divers. Roman épistolaire d’aujourd’hui, roman policier, roman psychologique, roman social, roman politique… Comme les précédents ouvrages d’Alessandro Perissinotto, il s’agit là d’un roman au vrai sens du terme.
Jean-Pierre Longre
18:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alessandro perissinotto, À mon juge. traduit de l’italien par patrick vighetti, gallimard, série noire, 2008 | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/06/2010
L’inspiration et la contrainte
 Jacques Bens, De l’Oulipo et de la Chandelle verte, poésies complètes, Gallimard, 2004.
Jacques Bens, De l’Oulipo et de la Chandelle verte, poésies complètes, Gallimard, 2004.
Prosateur impénitent, chroniqueur et membre éminent, voire pilier de L’OuLiPo, dataire du Collège de Pataphysique, Jacques Bens refusait, en tout cas à la fin de sa vie, de se dire poète. Il a pourtant laissé un certain nombre de livres de ce qu’il appelle « prose versifiée », réunis dans ce fort volume édité et préfacé par deux de ses compagnons en invention littéraire.
Après lecture de ces « poésies complètes », que peut-on dire de plus que ce disent les textes eux-mêmes ? Peut-être ce qu’en écrit Jacques Roubaud dans sa préface méthodique, à savoir (pour en résumer quelques aspects) : la poésie de Jacques Bens est à la fois savante (par sa prosodie) et familière (par l’emploi du « langage cuit »), autobiographique et narrative (mais il faut distinguer le « je » de l’auteur et le « je » du personnage), douce et nostalgique, oulipienne et personnelle…
Une vraie technique d’artisan du vers, une belle sensibilité de poète, une inspiration née de la contrainte, conformément aux options de l’OuLiPo ; le recueil réunit travail et modestie, mélange des registres et des vers (avec une apparente prédilection pour le décasyllabe), récit de vie et verve chansonnière. « Tu mets quoi dans un poème ? […] – Des bruits, des sons, des mots, des pieds, des vers, des phrases ». Le programme est complet, et de la contrainte librement choisie par « l’écriveron » surgissent des vers que l’on retient :
« Mais le ciel reste bleu et l’horloge, muette
[…]
Mais ton œil reste bleu et ta gorge, muette ».
Variations minimales qui n’excluent pas la pensée, l’aphorisme mélancolique, à la limite du constat désespéré :
« Il fut un temps où l’on ne te permettait rien
parce que tu n’étais personne
Voici venir le temps où tu ne pourras rien te permettre
Parce que tu deviens quelqu’un. »
Jacques Bens est un écrivain cultivé, nourri de lectures multiples qui tracent un cheminement dans ses textes, les font résonner d’échos plus ou moins familiers. Au hasard et en vrac, nous rencontrons, croisons, frôlons Queneau (bien sûr, et à plusieurs reprises), Musset, Boileau, Apollinaire, Villon, Du Bellay, Cendrars, Hérédia, Jarry (évidemment), Prévert, Bach, Rimbaud, Homère… Et si l’on ne décèle pas tout, si l’on a le sentiment de ne jamais pouvoir arriver au bout, que l’on se rassure, c’est la même chose pour le poète :
« Le mot fin a posé sa goutte de sang tiède
Sur le sable gris de ta page inachevée. »
Jean-Pierre Longre
18:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, jacques bens, oulipo, pataphysique, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/05/2010
Les stances du Kid
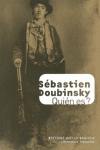 Sébastien Doubinsky
Sébastien Doubinsky
Quién es ?
Éditions Joëlle Losfeld / Gallimard, 2010
Billy the Kid, alias William Bonney, Henry Mc Carty, William Antrim, « qui est-ce » ? Un vulgaire voleur de chevaux (mais jamais pilleur de banques ou de trains) ? Un assassin sans scrupules ? Un adolescent inconscient ? Un enfant en quête de parents ? Un héros ? Une victime ? Un mythe ?
Sans doute tout cela à la fois, et davantage, et moins. Recherches historiques et récits fictifs n’ont rien de plus à nous apprendre. Il fallait donc autre chose, que Sébastien Doubinsky nous donne : un monologue, qui montre le personnage de l’intérieur, avec ses vérités, ses mensonges, ses illusions, ses témérités, ses brutalités, ses angoisses, ses souvenirs heureux et malheureux. Billy est tout simplement un être humain qui sans relâche cherche dans les recoins méconnus de son propre reflet ce qu’il n’a pas – la justice, un père, une ferme dans un coin tranquille, une famille avec des enfants –, qui aime danser avec les jolies filles, traîner avec ses amis, lire les gazettes, écouter la musique évoquant l’Irlande de sa mère, qui voudrait vaincre le temps, chasser le désespoir, éloigner les dangers dont seule sa « Winchester 73 » le protège. Tout simplement une existence qui, lorsqu’elle se devine arrivée au terme de la tragédie, n’a qu’une obsession, chercher par les mots le « vrai début » de ce qu’elle a fini par devenir.
Quién es est donc un monologue, mais aussi un poème, une suite de stances en prose – longues strophes ressassantes et résonantes rythmées en versets sinueux. Un peu comme Rodrigue (« percé jusques au fond du cœur… »), Billy the Kid se pose les vraies questions, celles qui demeurent toujours insolubles, mais qui par la grâce du langage redonnent vie et complexité à la figure figée par la légende.
Jean-Pierre Longre
16:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, poésie, francophone, sébastien doubinsky, joëlle losfeld, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

