03/06/2025
Mais que savons-nous des « coutumes de la Terre » ?
 Ilarie Voronca, Souvenirs de la planète Terre, préface de Nicolas Cavaillès, Arfuyen, 2025
Ilarie Voronca, Souvenirs de la planète Terre, préface de Nicolas Cavaillès, Arfuyen, 2025
Né Eduard Marcus à Brăila, Ilarie Voronca (1903-1946) fait partie de ces artistes d’avant-garde qui, venus de Roumanie, ont enrichi la culture française de leur inventivité intellectuelle et esthétique, de leurs idées et de leurs œuvres ; on connaît sans doute mieux Tzara ou Fondane, mais Voronca a nourri la littérature d’une particulière modernité, et Souvenirs de la planète Terre, sorte de « testament littéraire » de l’inventeur de l’ « intégralisme », en témoigne singulièrement. Avec cet ouvrage, l’écrivain « offre une expérience littéraire unique, un dépassement des plus sombres constats dans une fausse naïveté conceptuelle et hallucinée qui à chaque page apporte de nouvelles formules merveilleuses », écrit Nicolas Cavaillès.
Le protagoniste du roman, Yves (un prénom manifestement issu des initiales de l’auteur), se voit comme « un voyageur venu d’une planète ou de quelque univers inconnu » et découvre notre monde en une vision qui rebat fondamentalement les cartes : les végétaux plus puissants que les hommes, ou ceux-ci aux ordres des animaux, qui, comme les ânes, sont capables de discuter poésie entre eux ; ou encore les machines (par exemple les moissonneuses-batteuses) à l’origine de la création de l’homme (y compris de son âme)… Yves, peu à peu, fait des découvertes étonnantes et angoissantes sur le monde et la société, sur l’injustice qui fixe les « hommes-vis » à des places dont ils ne peuvent s’extirper, sur l’absurdité de l’existence, sur la vanité humaine (« Tout cela est à démolir », semble-t-il en conclure) ; mais tout n’est pas perdu : « La machine bonne et affable se tiendra aux côtés de l’homme. Elle fera un avec l’homme. Et Yves eut la vision d’un nouveau centaure, d’une nouvelle mythologie. L’homme accouplé à la machine. » Vision en tout cas moins pessimiste qu’une prophétie précédente, pourtant vérifiée : « Ce sont les nouvelles machines qui poussent jusqu’à la dernière limite l’esclavage de l’homme et n’hésitent devant aucun obstacle pour satisfaire leurs caprices. »
Ce qui précède n’est qu’un des angles de lecture possibles. Écrivain de l’absurde, Ilarie Voronca se situe dans lignée de Lautréamont, Urmuz, Raymond Roussel et quelques autres inventeurs de l’absolu. Poète, aussi, et ce roman en porte la marque. Quelques exemples ? À propos des plantes : « Ô pacifiques reines, régnant sur la vie et sur la mort et dont les seules armes sont vos parfums et vos couleurs ! » ; à propos des batteuses : « Ce sont de grands oiseaux migrateurs qui font leur nid pendant les mois de soleil parmi les céréales » ; à propos de la nuit urbaine : « Oh, calme majesté des avenues sous la lune ! Jardins baignés d’une musique qui se déverse d’entre les cordes des arbres dont chacun porte une étoile comme une sourdine. » Et ce bel alexandrin concluant l’un des poèmes insérés dans la prose : « Mes os seront pareils aux herbes arrachées. » Absurde et poésie font aussi bon ménage avec un humour cachant plus ou moins bien l’angoisse, comme dans cette maxime : « Les hommes ne sont des hommes que parce qu’ils croient être des hommes. », ou dans la découverte d’une cruelle anthropophagie : « Yves s’aperçut que les maisons mangeaient. […] Plus elles étaient vieilles, plus elles tombaient en ruines, plus il leur fallait d’hommes, de femmes et d’enfants à mastiquer. »
Souvenirs de la planète Terre est une livre « intégral » où, par le truchement de la limpidité de la prose et du vertige de la poésie, se mêlent l’espoir et le désespoir, l’humour et la soif d’absolu, le mysticisme et la satire, la générosité et la dérision. La formule de Nicolas Cavaillès est parlante : Ilarie Voronca est un « Voyant inquiet », et c’est sans doute l’inquiétude qui l’a emporté.
Jean-Pierre Longre
18:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, ilarie voronca, nicolas cavaillès, arfuyen, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/11/2024
La puissance onirique de la littérature
 Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024
Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024
Dans les années 1960, Dumitru Tsepeneag, avec quelques compagnons dont Leonid Dimov et Virgil Tanase, fonda à Bucarest le « groupe onirique », lieu de débat intellectuel, esthétique, littéraire se situant aux antipodes du totalitarisme pesant sur la Roumanie à cette époque. Il ne s’agissait pas de revenir aux conceptions romantiques ou surréalistes du rêve, mais de s’appuyer sur ses « critères » et son fonctionnement pour créer un nouveau réel littéraire. Les apparences du rêve, sa complexité, les retours d’images et de thèmes, les obsessions qu’il véhicule caractérisent ainsi les œuvres « oniriques », et les nouvelles rassemblées dans Mise en scène, composées à la fin des années 1960, qui n'ont pu être publiées qu’après 1989 et viennent d’être traduites en français par Nicolas Cavaillès, en sont un beau témoignage.
Le recueil est composé de onze textes qui, s’ils sont d’inégale longueur et abordent des thèmes variés, entrent en résonance les uns les autres grâce à une écriture portée par les caractéristiques structurelles du rêve et de ses apparences absurdes. Construire une montagne infinie de chaises ou creuser des fosses insondables, se laisser accaparer brutalement par une sorte de secte ou faire difficilement monter un âne dans un camion pour fuir avec lui, laisser pleurer un être étrange enfermé dans une armoire ou accueillir un petit homme grelottant de peur et de froid, se confronter à de multiples miroirs que l’on voudrait briser comme pour occulter l’image de soi ou partir dans un bateau en papier sur une « mer de sang », emmener une foule disparate sur un miroir piégé ou laisser un bel homme se faire étouffer par des serpents… Quelques mots ne suffisent évidemment pas à donner une image fidèle de la forme, du fond et de la dimension de ces textes.
Reste la longue nouvelle centrale, celle qui donne son titre au recueil, un titre annonçant une plongée dans le théâtre. Oui, le théâtre est bien là, donnant à la nouvelle une dimension scénique, avec des personnages, un auteur – metteur en scène, un va-et-vient entre le « réel » du récit et celui de la scène qui souvent se confondent, sans que l’on sache toujours ce qui relève de la réalité et de la fiction narratives, ce qui relève de la vérité et du mensonge, du « Theatrum mundi » et de la « mise en scène », de la présence de l’Auteur et de l’imposture. « Soit dit entre nous, tout ça, tous ces trucages, c’est bon pour le théâtre, ou pour le cinéma, encore mieux, mais ça n’a rien à voir avec la réalité. Des trucages ! […] Tout est fondé sur la suggestion. Vous comprenez, camarade colonel… Voilà le théâtre moderne : une métaphore incarnée puis commentée, destruction de la rampe, des coulisses… Une révolution complète ! » Antithèse du « réalisme socialiste », le récit / théâtre en profite pour d’adonner, en toute lucidité, à la satire profonde et métaphorique d’un régime fondé sur le mensonge et de ses sbires, ainsi qu’à une reprise parodique de la mort et de la résurrection du Christ, « l’Auteur » cloué sur sa chaise puis réapparaissant sous l’aspect du « Milicien » acclamé par le public…
Cette publication de textes anciens ajoute une étape importante au cheminement de l’un des plus importants écrivains roumains (ou franco-roumains) contemporains, et plus généralement à la puissance onirique de la littérature.
Jean-Pierre Longre
09:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/10/2024
Un « écrivain total »
 Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024
Ainsi parlait / Aşa grăit-a Mihai Eminescu, dits et maximes de vie choisis et traduits du roumain par Nicolas Cavaillès, édition bilingue, Arfuyen, 2024
De Mihai Eminescu, le grand public amateur connaît surtout la poésie fulgurante et désespérée, nourrie du fameux « dor » roumain, « sentiment douloureux et profond », rêve et regret à la fois ; il sait moins, ce grand public, que le chantre de « Luceăfarul », Lucifer le « porteur de lumière », est surtout un « écrivain total ». Nicolas Cavaillès, dans sa présentation au titre prometteur (« Un joyau de la littérature universelle »), explique parfaitement comment « cette étoile devint un phénomène culturel essentiel et incontournable en Roumanie et en Moldavie » ; à la fois « poète maudit » mort trop tôt, « écrivain prolifique et polygraphe », il est une figure encore trop méconnue des lecteurs francophones.
 Les morceaux ici choisis, précisément traduits et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »
Les morceaux ici choisis, précisément traduits et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »
Oui, l’ « écrivain total », qui, nous dit Nicolas Cavaillès, « n’aura pas connu l’union avec son contraire, principe originel de la vie humaine », est pourtant une « étoile paradoxale ». Pour le poète, « les antithèses sont la vie », et « on ne peut élever une butte sans engendrer à côté une fosse ». Eminescu, poète pessimiste par-dessus tout et malgré tout, hanté par le malheur et par la mort qui l’emportera très tôt, « grand esprit » pour qui « tout est problème » (selon ses propres mots), est aussi celui qui nous révèle « l’infinité du temps ».
Jean-Pierre Longre
17:46 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, roumanie, mihai eminescu, nicolas cavaillès, arfuyen, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/04/2024
Dans l’intimité du penseur
 Cioran, Manie épistolaire, Lettres choisies 1930-1991, édition établie par Nicolas Cavaillès, Gallimard, 2024
Cioran, Manie épistolaire, Lettres choisies 1930-1991, édition établie par Nicolas Cavaillès, Gallimard, 2024
Le 29 avril 1974, Cioran écrit à son ami d’enfance Bucur Țincu : « Mieux que personne, j’ai eu la vie que j’ai voulue : libre, sans les servitudes d’une profession, sans humiliations cuisantes ni soucis mesquins. Une vie presque rêvée, une vie d’oisif comme il en existe peu en ce siècle. » Un an plus tard (dans le volume, une page plus loin), à un autre ami, Arşavir Acterian : « Ma vie continue avec les inévitables ennuis dont je ne cesse de me plaindre. Je vois trop de monde. Je perds mon temps en conversations, en palabres, car les cinq continents s’étant donné rendez-vous dans cette ville, je dois, comme tout un chacun, en subir les conséquences. J’estime béni le jour sans visite. » Qu’en déduire ? Ce que l’on a déjà remarqué à la lecture des œuvres de l’auteur : adepte d’une écriture fragmentaire, il cultive le paradoxe – et ici il le fait jusque dans ses impressions intimes, qui n’échappent pas aux « flottements continuels ». La « manie épistolaire » est un terrain idéal pour cela.
Dès les premières lettres, alors qu’il est encore tout jeune, se signale comme en germe ce qui caractérisera Cioran et son œuvre : l’expression des tourments et de la douleur, l’aveu d’un narcissisme qui pourtant peut s’inscrire dans une vision collective : « Devant le destin individuel les formes historiques et politiques n’arrivent à rien. Hitlérisme ou communisme, les gens souffrent de la même manière et meurent de la même manière. Le destin, l’irréparable intérieur, voilà à quoi tout se réduit. » (1933). De même l’opposition entre l’esprit roumain, son « subjectivisme malheureux », et l’esprit français : « La France est le pseudonyme de l’intelligence. » D’où, entre autres raisons, l’adoption de la langue française : « Quoique le français soit ardu, je l’ai adopté, ne fût-ce que pour les difficultés que j’y rencontre : je n’écrirai plus jamais en roumain. » (1947), cela même en l’absence d’illusions : « Je ne serai écrivain dans aucune langue. Mon malheur est d’avoir cru que l’âme est tout, alors que les mots sont les véritables dieux. » (même lettre).
Ce choix de lettres (traduites du roumain pour les premières et plusieurs adressées à la famille ou à certains amis, quelques autres traduites de l’allemand, la plupart écrites directement en français) nous fait parcourir l’existence intime de Cioran entre ses 19 ans et ses 80 ans, avec ses fluctuations, ses évolutions (en amitié, en politique), ses difficultés matérielles et financières, ses maladies, ses rapports avec sa famille, ses sentiments, un ultime amour pour une admiratrice allemande, un surprenant engouement pour les travaux campagnards (« Rien ne me comble autant que ce genre de travaux pour lesquels – ne riez pas – j’ai été fait. »). Et bien sûr nous rencontrons ses amis (Bucur Țincu, Arşavir Acterian et sa sœur Jeni, Armel Guerne, Mircea Eliade…) et nous croisons des écrivains comme Eugène Ionesco, Benjamin Fondane, çà et là Flaubert, Valéry, Beckett et tant d’autres, sans parler des philosophes du passé et du présent. Même si les livres de Cioran laissent entrevoir des pans importants de sa personnalité, ces lettres, judicieusement choisies par Nicolas Cavaillès, révèlent la personne de l’auteur, son isolement farouche et ses compromis avec la société, ses aveux et ses vérités. Dans un style toujours impeccable, parfois délicieusement classique (voir par exemple l’expression « un livre de ma façon »), un apport majeur non seulement à la connaissance de l’homme, mais aussi à la compréhension de son œuvre.
Jean-Pierre Longre
18:51 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : correspondance, cioran, nicolas cavaillès, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/08/2023
L’envers des Lumières
 Nicolas Cavaillès, Les ombres opposées, éditions Corti, 2023
Nicolas Cavaillès, Les ombres opposées, éditions Corti, 2023
Ils ont beau être « opposés », les hommes que Nicolas Cavaillès a choisis comme protagonistes de son roman ont des points communs : tous deux ont bel et bien existé, fruits du Siècle des Lumières qui recèle tant de personnages méconnus, de passions disparates et de contradictions fructueuses ; tous deux sont originaires de Pont-de-Veyle, bourgade située non loin de Mâcon, côté Bresse, et traversée par la grande et la petite Veyle. Là s’arrêtent les similitudes. Car « l’un ne se mêla de rien, l’autre refit le monde ».
Le premier, Antoine de Ferriol, comte de Pont-de-Veyle, naquit avec à son chevet les privilèges de la noblesse, et n’en fit pas grand-chose – sans ambition sociale, aimant les loisirs, le théâtre, profitant de l’amitié de Voltaire et de madame du Deffand, de son lien familial avec madame de Tencin, de modestes dons pour la chanson et l’écriture comique, justifiant son existence sociale par quelques charges sans contraintes qui lui furent octroyées et lui permirent de préserver son indépendance, enfouissant son ennui dans le divertissement et son inutilité dans les fréquentations mondaines. Le second, Jean-Louis Carra, « jamais ne s’ennuya, lui. » Il mena une vie aventureuse, parcourut l’Europe de l’Angleterre à la Russie, de la Pologne à la Roumanie, participa activement à la Révolution, vota la mort du roi et, objet (selon lui) de calomnies, accusé de trahison, fut condamné à mort et guillotiné. Disciple de Rousseau, confrère de Chamfort, idéaliste sans doute, vantard et hâbleur à coup sûr, il mourut en se proclamant victime de la corruption, de « l’atmosphère empestée » de son époque.
La mise en regard de ces deux personnalités si différentes – différence accentuée par le traitement stylistique des deux biographies, puisque la première est narrée par une instance externe d’apparence objective, la seconde sous la forme d’un discours à la première personne –, cette mise en regard, donc, est pleine d’enseignements sur l’Histoire, les mouvements de la société (passée et présente) et la condition humaine. Nicolas Cavaillès, qui sait tirer de destins historiques méconnus l’essence romanesque, morale et philosophique de la vie, l’écrit magistralement : « Ainsi de Jean-Louis Carra et d’Antoine Ferriol, dit Pont-de-Veyle, derniers fruits acides et stériles de l’Ancien Régime, deux ombres opposées dans lesquelles les Lumières françaises se résorbèrent avec ironie. » Les « Lumières françaises » n’ont pas fini de laisser leurs ombres s’allonger sur l’humanité.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas cavaillès, éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/06/2023
Complexes destinées
 Gabriela Adameşteanu, Fontaine de Trevi, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Gallimard, « Du monde entier », 2022
Gabriela Adameşteanu, Fontaine de Trevi, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Gallimard, « Du monde entier », 2022
Letitia voudrait récupérer des biens immobiliers familiaux que le pouvoir communiste avait confisqués. Installée en France avec son mari Petru, ancien journaliste à Radio Free Europe, elle fait pour cela des voyages successifs à Bucarest, retrouvant des amis et de la famille, confrontant ses souvenirs à la réalité présente. Voilà le fil conducteur, le prétexte narratif d’un roman dans lequel on retrouve la protagoniste déjà présente dans les deux précédents (Vienne le jour, Situation provisoire), elle-même cherchant à publier ce qu’elle assume comme une « autofiction ».
On l’a connue jeune étudiante en proie aux difficultés matérielles et morales des années 1950-1960 dans ce pays, puis adulte, cherchant à oublier les contraintes de la vie conjugale et professionnelle, ainsi que les risques politiques, dans une relation amoureuse un peu compliquée… On la découvre maintenant retirée dans une bourgade française, dont elle quitte périodiquement la tranquillité pour se retrouver dans une Roumanie qui, toujours marquée par son passé, a ingurgité les ressorts et les compromissions du capitalisme débridé. Certes, il y a eu la « révolution », dont ses amis Morar, comme d’autres, déplorent la confiscation par les anciens apparatchiks et « sécuristes », et la parole et les déplacements – à condition qu’on en ait les moyens – y sont libres ; d’ailleurs, ceux qui le peuvent ne se privent pas d’aller travailler ou étudier à l’étranger, avec l’espoir d’en revenir mieux lotis (comme ceux qui, jetant une pièce dans la fontaine de Trevi, font le vœu de revenir à Rome). Les souvenirs personnels (amours, famille, amitiés) de Letitia se mêlent aux retours sur un passé collectif auquel le présent renvoie sans cesse, colorant les destinées des espoirs et des désespoirs qui en résultent, ces destinées qui se révèlent plus complexes qu’il n’y paraît, car tout n’y est jamais tout blanc ou complètement noir.
L’œuvre de Gabriela Adameşteanu n’est pas seulement narrative. Comme dans les fresques épiques, elle campe des atmosphères aussi diverses que le sont les époques décrites, les rues de Bucarest (l’allée Teilor ou les avenues grouillantes) et les maisons de l’allée des Tilleuls, en Touraine (en une évocation digne de Du Bellay), bien d'autres lieux encore, intimes ou publics, familiaux ou professionnels… La multiplicité des événements, les grandes disputes politiques, le foisonnement des personnages (tel que leur triple liste finale est d’une grande utilité), le fond de réalité historique sur lequel ils s’impriment en relief, l’ensemble est d’une écrivaine en pleine maturité de son art, dans la lignée de Balzac, d’un Balzac qui s’exprimerait à la première personne et qui se poserait des questions sur l’ambiguïté de son personnage : « Cette femme que Sorin observe bizarrement, l’esprit ailleurs, est-ce bien moi ? ou le personnage de mon livre ? Est-ce de ma vie que je me souviens, ou bien de celle que j’ai imaginée, à partir de la vraie ? » Disons-le : ce genre de livre, fruit d’un talent et d’un travail littéraires qui n’ont pas leur pareil, ne peut être traduit que par un écrivain, et c’est bien le cas. Nicolas Cavaillès a compris comment entrer et faire entrer les lecteurs dans le monde de Gabriela Adameşteanu, dont l’œuvre entre elle-même largement dans le patrimoine littéraire d’aujourd’hui.
Jean-Pierre Longre
23:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, gabriela adameşteanu, nicolas cavaillès, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/06/2021
Un astronome original
 Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021
Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021
Nicolas Cavaillès a l’art de dénicher des sujets et des personnages à la fois méconnus et porteurs de questionnements sans précédents, ouvrant de nouveaux horizons. Il y a eu la vie aventureuse de Monsieur Leguat, les destins particuliers des enfants Schumann, le tour de l’île Maurice par un âne portant un cadavre sur le dos, les sauts mystérieux des baleines (On trouvera sur http://jplongre.hautetfort.com/tag/nicolas+cavaill%C3%A8s des chroniques sur les ouvrages et les traductions de Nicolas Cavaillès)… Cette fois, c’est Tycho Brahe, astronome danois du XVIe siècle, qui occupe la centaine de pages d’un ouvrage tenant de la biographie et de la réflexion sur le rythme du temps.
 Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».
Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».
L’auteur ne s’en tient pas à l’histoire. Du récit de la vie et des trouvailles de son héros, il tire des anecdotes où il est question de Giordano Bruno, de Copernic, de Johannes Kepler (qui fut « l’un de ses proches collaborateurs »), et même de Shakespeare, puisque se pose la question de savoir si la Tragédie du prince Hamlet n’aurait pas quelque rapport avec le destin de Tycho… Bref, voilà un ouvrage à la fois savant et savoureux qui, dépassant le sujet d’une biographie déjà intéressante en soi et même d’une méditation sur le découpage temporel, nous mène vers des sphères insoupçonnées.
Jean-Pierre Longre
à paraître le 26 août 2021
17:11 Publié dans Essai, Littérature, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, francophone, tycho brahe, nicolas cavaillès, Éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2019
« Il n’est de solution à rien »
 Cioran, Divagations, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Arcades Gallimard, 2019
Cioran, Divagations, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Arcades Gallimard, 2019
Débusqué à Paris (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet), cet ensemble d’écrits, qui « date vraisemblablement de 1945 », selon Nicolas Cavaillès, est l’une des dernières œuvres rédigées par Cioran dans sa langue maternelle, avec d’autres « Divagations », publiées en 1949, ainsi que Fenêtre sur le Rien (voir ci-dessous). Ensuite, ce sera Précis de décomposition puis les autres grands textes écrits en français et publiés dans les Œuvres (Gallimard /Pléiade).
Cioran est adepte du fragment, et ce volume resté à l’état de brouillon lui permet, en pratiquant la brièveté, de s’exprimer en toute liberté, quitte à se contredire parfois – mais le paradoxe est l’une de ses figures favorites (voir : « Entre une affirmation et une négation, il n’y a qu’une différence d’honorabilité. Sur le plan logique comme sur le plan affectif, elles sont interchangeables. »). La brièveté va de pair avec le sens aigu de la formule tendant vers la perfection : « Les pensées devraient avoir la perfection impassible des eaux mortes ou la concision fatale de la foudre. » ; et quoi qu’il en soit, « il n’est de solution à rien ». Ce qui n’empêche pas qu’on surprenne ce sceptique absolu à explorer le versant poétique (bien que sombre) du monde en prenant part « aux funérailles indéfinies de la lumière » et à « la cérémonie finale du soleil », ou en découvrant « un sonnet indéchiffrable » dans « l’harmonie de l’univers ».
Bref (c’est le cas de l’écrire), les grands thèmes de la philosophie et de la morale cioraniennes se succèdent en ordre aléatoire au fil des pages : la vie (qui n’a « aucun sens », mais « nous vivons comme si elle en avait un »), la mort, Dieu (qui reste à « réaliser »), la révolte (« vaine », mais « la rébellion est un signe de vitalité »), la douleur, la solitude, la tristesse (engendrée notamment par « la pourriture secrète des organes »), cette tristesse inséparable du « dor » roumain, langueur, nostalgie, « ennui profond » de l’inoccupation – tout cela, que l’on pourrait énumérer en maintes citations, est à peine, parfois, adouci par l’idée d’un sursis : celui, par exemple, de l’amour, « notre suprême effort pour ne pas franchir le seuil de l’inanité », ou de la musique, capable de « nous consoler d’une terre impossible et d’un ciel désert », « la musique – mensonge sublime de toutes les impossibilités de vivre ».
Gardons donc l’espoir – en particulier celui de continuer à lire Cioran : il a beau être « en proie au vieux démon philosophique », gardons-le précieusement, brouillon ou pas, inachèvement ou non, roumain ou français, comme un inimitable écrivain.
Jean-Pierre Longre
 Simultanément, paraît chez le même éditeur un autre ouvrage de Cioran :
Simultanément, paraît chez le même éditeur un autre ouvrage de Cioran :
Fenêtre sur le rien, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Gallimard Arcades, 2019
Présentation de l’éditeur :
Avec Divagations, ce recueil exceptionnel constitue la dernière œuvre de Cioran écrite en roumain. Vaste ensemble de fragments probablement composés entre 1941 et 1945, ce recueil inachevé et inédit commence par une sentence programmatique : « L'imbécile fonde son existence seulement sur ce qui est. Il n'a pas découvert le possible, cette fenêtre sur le Rien... » Voilà sept ans que Cioran « [moisit] glorieusement dans le Quartier latin », la guerre a emporté avec elle ses opinions politiques et sa propre destinée a toutes les apparences d'un échec : le jeune intellectuel prodigieux de Bucarest a beaucoup vieilli en peu de temps, passé sa trentième année ; il erre dans l'anonymat des boulevards de Paris et noircit des centaines de pages dans de petites chambres d'hôtel éphémères. Fenêtre sur le Rien constitue un formidable foyer de textes à l'état brut, le long exutoire d'un écrivain de l'instant prodigieusement fécond. Dès les premières pages, un thème s'impose : La femme, l'amour et la sexualité - terme rare sous la plume de Cioran -, qui surprend d'autant plus qu'il est l'occasion de confessions exceptionnelles : « Je n'ai aimé avec de persistants regrets que le néant et les femmes », écrit-il. On lit aussi, tour à tour, des passages sur la solitude, la maladie, l'insomnie, la musique, le temps, la poésie, la tristesse. Chaque fragment se referme sur lui-même, et l'on note un souci croissant du bien-dire, du style. Peu de figures culturelles, réelles ou non, apparaissent ici, mais dessinent un univers contrasté et puissant : Niobé et Hécube, Adam et Ève, Bach (pour Cioran le seul être qui rende crédible l'existence de l'âme), Beethoven, Don Quichotte, Ruysbroeck, Mozart, Achille, Judas, Chopin, et les romantiques anglais. Errance métaphysique d'une âme hantée par le vide mais visitée par d'étonnantes tentations voulant la ramener du néant à l'existence, ce cheminement solitaire et amer trouve encore un compagnon de déroute en la figure du Diable, régulièrement invoqué, quand l'auteur n'adresse pas ses blasphèmes directement à Dieu...
11:23 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, cioran, divagations, nicolas cavaillès, arcades gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/07/2019
De qui Chestov est-il le nom ?
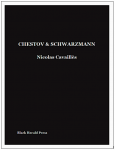 Nicolas Cavaillès, Chestov & Schwarzmann, Black Herald Press, 2019
Nicolas Cavaillès, Chestov & Schwarzmann, Black Herald Press, 2019
À la question ci-dessus, Nicolas Cavaillès, dont les livres ramassent et condensent en quelques dizaines de pages ce que d’autres développent en de gros traités ou de gras romans, répond d’une manière personnelle, originale et séduisante. D’aucuns diront que le « philosophe tragique » (selon Fondane), cet « obsédé de l’impossible » (selon Cavaillès) est vu par le petit bout de la lorgnette, ce que ne semble pas démentir l’introduction en forme de dédicace à Norman Manea, puisque l’auteur y annonce modestement des « scènes et anecdotes », des « singularités, incidents, faits divers puisés entre les lignes de sa légende » ; mais la lorgnette, tout de même, cherche à « illustrer l’incompréhensible ou l’insoluble », et y parvient parfaitement.
Il y a, oui, de petits morceaux d’existence de celui qui vécut « écartelé entre deux chutes connexes : celle d’une brique sur lui et sa propre glissade dans le néant » et avait peur, après avoir prononcé un discours, de « tomber à terre » parce qu’on lui aurait ôté sa chaise (supposition bouffonne mais angoissante), ce Chestov qui s’appelait en réalité Lev Isaakovitch Schwarzmann (et Nicolas Cavaillès ne se prive pas de décortiquer ce nom et les raisons supposées du changement), comme s’il y avait deux personnes en une, ou une personne « fissurée », divisée en deux : un Chestov « né Schwarzmann » ou un « Schwarzmann né en Chestov »… De quoi « se cogner le front contre le mur », mais surtout de quoi suivre les tribulations d’un philosophe qui aura tenté de franchir les murs qui enferment la liberté, de trouver la faille qui lui aura permis de partir « là-bas ».
Bref, à partir de là, le récit, qui adopte le tutoiement à la fois intime et respectueux, devient plus biographique. Le « là-bas » en question est la Palestine, où Chestov s’est rendu en 1936 avec « certaines attentes, informulées, inconscientes, invisibles », mais où « tu retrouves ta croix, ton épreuve intérieure, ton martyre personnel, aux yeux de tous car ils en font partie, mais surtout dans les sables mouvants de ta solitude. ». Chemin faisant, l’auteur nous gratifie de pages poétiques sur ce pays où la beauté des paysages n’occulte pas les incessants conflits dont ils sont le terrain depuis la nuit des temps, où on ne sait plus « qui est l’infidèle de qui ». C’est en tout cas une « Palestine intérieure », indescriptible, indicible, que Chestov (ou Schwarzmann ?) gardera de son périple, et nous de notre lecture.
Jean-Pierre Longre
21:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, francophone, nicolas cavaillès, chestov, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/03/2019
L’épopée de Nogent-le-Rotrou
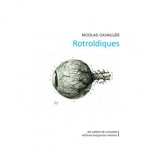 Nicolas Cavaillès, Rotroldiques, éditions Marguerite Waknine, « Les cahiers de curiosité », 2019
Nicolas Cavaillès, Rotroldiques, éditions Marguerite Waknine, « Les cahiers de curiosité », 2019
À la lecture de ce petit livre, on se dit que la collection dans laquelle il est publié, « les cabinets de curiosité », porte bien son nom. Au début, pourtant, la déprimante quotidienneté d’une scène de bistrot, inaugurée par une phrase aussi désespérément longue que poétiquement imagée, nous plonge dans un décor sans grâce et introduit des conversations, entre glauque et comique, dignes des Conversations dans le département de la Seine de Raymond Queneau. Des monologues et dialogues qui, tout compte fait, ne tournent pas à la pire des banalités, car il y est rapidement question des « huit péchés capitaux » que Nanard, le patron, et un buveur remarquable se plaisent à énumérer, suivant en cela et sans le préciser la liste instaurée par Bernard le Clunisien, moine au prieuré de Nogent-le-Rotrou, dans son De Octo vitiis (vers 1150) : luxure, indifférence, colère, orgueil, ambition, tristesse, gourmandise, avarice.
Tout cela dès les premières pages d’un ouvrage qui compte autant de chapitres que de péchés, donc huit, chaque chapitre étant précédé d’une citation dudit Bernard. Ainsi, Nicolas Cavaillès construit un récit rigoureusement structuré, un récit qui, pour le reste, suit un cheminement labyrinthique dans les rues et les ruelles de Nogent, mais s’échappe aussi vers des espaces intérieurs et extérieurs (jusqu’au Moyen-Orient) ou remonte le temps (jusqu’à Rotrou III, au onzième siècle), tout en délivrant des détails savants sur, par exemple, l’opération d’un œil (l’œil, motif récurrent qui induit celui du regard, et dont l’illustration de couverture et les épigraphes annoncent l’importance).
Les péripéties de ce cheminement labyrinthique ne seront pas dévoilées ici. Disons simplement que tout est déclenché par la rencontre improbable et suivie de rebondissements inattendus entre le narrateur et un certain Legrand, chômeur albinos, solitaire et révolté, malade et aboulique. Il y aura donc des propos de bistrot, de bonnes cuites, des bagarres épiques, des entrevues au pôle emploi, des échappées belles et de piètres retours à la réalité, des histoires d’amitié, d’amour, de souffrance, de mort, de famille, et il y a de l’ironie, de l’humour (volontiers noir), de l’aveuglement, de la lucidité… La petite ville de Nogent-le-Rotrou a-t-elle suscité beaucoup de littérature jusqu’à présent ? Quelle que soit la réponse, n’hésitons pas : avec Rotroldiques, elle a maintenant son épopée (en huit chants).
Jean-Pierre Longre
19:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, nicolas cavaillès, éditions marguerite waknine, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/03/2019
L'engagement de l’écrivain face à la complexité de l'histoire
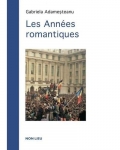 Gabriela Adameşteanu, Les Années romantiques, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, préface de Jean-Yves Potel, éditions Non Lieu, 2019
Gabriela Adameşteanu, Les Années romantiques, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, préface de Jean-Yves Potel, éditions Non Lieu, 2019
« Ce livre parle de moi, mais en l’écrivant j’espère bien que d’autres se reconnaîtront dans mes expériences, dans ce qu’il m’a été donné de vivre. ». La lecture de l’ouvrage nous montre, en effet, comment une écriture particulière peut largement transcender l’autobiographie, le récit personnel, pour offrir une vision à la fois générale et précise, une véritable somme historique, politique, sociologique, tout en ménageant l’intérêt narratif. Car le récit de ces « années romantiques » (expression à prendre sans doute avec un sourire de lucidité), de ces années qui ont accompagné et suivi ce que d’aucuns appellent « révolution », que Gabriela Adameşteanu, avec beaucoup d’autres, qualifie de « coup d’État », ce récit, donc, tient aussi bien de la littérature que de l’essai.
De nombreux fils tissent le texte, certains plus serrés que les autres. Cela commence par l’invitation faite à l’auteure par l’« International Writing Program » pour une résidence à Iowa City, quelques semaines au cours desquelles s’ouvre à elle cette Amérique dont elle ne rêvait pas vraiment (la France l’attirait plus), mais des semaines qui lui permettront, en particulier, d’interviewer à Chicago le dissident et disciple de Mircea Eliade Ioan Petru Culianu, réfugié aux USA après maintes tribulations, esprit particulièrement vif et réfléchi, homme d’une grande culture, qui mourra étrangement assassiné quelques semaines après cet entretien, non sans avoir fait découvrir à l’auteure et aux personnes qui le liront dans le journal d’opposition 22 le rôle meurtrier des manipulations du KGB, de la Securitate et des dirigeants communistes roumains dans un « scénario » destiné à chasser Ceauşescu, fin 1989, en faisant croire à une révolution populaire.
Autres fils conducteurs : l’accident survenu en février 1991 dans le Maramureş, en compagnie d’Emil Constantinescu (futur président d’« alternance » en 1996), accident qui vaudra à l’auteure de rester alitée plusieurs mois et de laisser libre cours à ses réflexions et à ses doutes ; le travail acharné pour l’organe du G.D.S. (« Groupe pour le dialogue social »), le journal 22, qu’elle a dirigé de 1991 à 2005 ; et, liée à cela, la contestation de la prise du pouvoir par Ion Iliescu, Petre Roman et quelques autres anciens dirigeants du parti communiste roumain – ce qui l’a conduite, comme la plupart des écrivains de l’époque, à laisser de côté la création : « Jusqu’en l’an 2000, environ, je n’ai plus écrit ni lu de prose : seulement la presse, roumaine ou étrangère, et des livres se rapportant de près ou de loin au journalisme. Quand j’échappais à l’obsession du journal, d’ordinaire pendant de courts voyages qui me conduisaient à des séminaires de presse, je prenais, sans projet précis, des notes, dans divers cahiers. ».
D’ailleurs, si plusieurs questions parcourent le livre (le rôle des politiciens dans la conduite des affaires et le destin du pays, le passé de la Roumanie avec ses compromissions, avec l’antisémitisme dont fut accusé, par exemple, Mircea Eliade, avec l’accession en force des communistes au pouvoir, avec les méfaits de la dictature sur les consciences et les relations humaines etc.), celle de l’engagement, de l’activité ou de la passivité des écrivains est récurrente. « Jusqu’où un écrivain peut-il aller dans les compromis, dans la vie, en littérature, dans le journalisme, et à partir de quel moment ces compromis affectent-ils la qualité de son écriture ? Si c’est bien le cas ? Sur ces questions, les verdicts sont plus nombreux que les débats. Les jeunes générations n’ont pas les moyens de comprendre la vie sous un régime totalitaire mieux que les citoyens des pays occidentaux qui n’ont pas fait cette expérience. À moi aussi il est arrivé d’émettre des jugements tranchés, sans nuances, avec cette condescendance, pour ne pas dire ce mépris, biologique, des jeunes envers la génération antérieure. J’ai longtemps repoussé in corpore les écrivains du réalisme socialiste, eux et toutes leurs œuvres. ». Un livre ponctué d’interrogations, donc, et qui décrit avec acuité, sans occulter ni les options ni les doutes personnels, la vie politique, intellectuelle, culturelle, littéraire d’une période tourmentée. Un livre où l’on croise beaucoup de personnalités marquantes ; pour n’en citer que quelques-unes : Paul Goma, exilé à Paris, la poétesse Ana Blandiana, figure, avec son mari Romulus Rusan, de l’Alliance Civique, I.P.Culianu déjà cité, Dumitru Ţepeneag, lui aussi exilé à Paris après avoir créé à Bucarest le groupe oniriste, Emil Constantinescu, Mircea Căratărescu, l’un des grands représentants avec Gabriela Adameşteanu de la littérature roumaine contemporaine, et qui séjourna en même temps qu’elle à Iowa City… Les noms foisonnent, les personnages abondent. Mais Les Années romantiques n’est pas une galerie de portraits, ni, seulement, une autobiographie ou un essai historico-politique. C’est vraiment une œuvre d’écrivain, dont la construction suit les méandres de la mémoire et de la vie personnelle et collective, rendant ainsi compte d’une période difficile.
Ajoutons que, à l’appui de cette construction mémorielle, le livre est un véritable traité d’anti-manichéisme : « La vie et la littérature ont contredit mon manichéisme. Mais il a résisté aux années romantiques. Dès mon enfance, j’ai senti qu’il était très mal d’“écrire pour le Parti”. J’ai atteint la liberté sans avoir “péché” par la moindre ligne de compromission, mais en portant toujours en moi, inversé, le manichéisme de mon éducation communiste. Il m’a fallu bien des années pour en sortir – si j’en suis vraiment sortie. […] Dans ce communisme qui a englouti les vies de nos parents et qui semblait prêt à durer plus longtemps que nos propres vies, une autre catégorie de gens a existé, beaucoup plus large : ceux qui s’efforçaient de mener une vie normale, en ne faisant que les compromis inévitables. Cette appréhension d’un monde disparu est plus complexe et moins intéressante pour ceux qui ne l’ont pas vécu – les Occidentaux et la majorité des jeunes d’aujourd’hui. ». C’est à cette « appréhension » « moins intéressante » que nous devons nous intéresser, et que doit nous intéresser la littérature, en nous mettant au cœur de la « complexité » de la vie.
Jean-Pierre Longre
10:08 Publié dans Essai, Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, histoire, roumanie, gabriela adameşteanu, nicolas cavaillès, jean-yves potel, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/12/2018
Et la vie continue, malgré tout
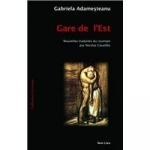 Gabriela Adameşteanu, Gare de l’Est. Nouvelles traduites du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2018.
Gabriela Adameşteanu, Gare de l’Est. Nouvelles traduites du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2018.
Les années 1970-1980, en Roumanie, ne furent pas des plus exaltantes, c’est le moins que l’on puisse dire. La pression sociale et psychologique, les pénuries, la méfiance mutuelle engendrée par l’espionnage politique, les libertés individuelles rigoureusement entravées – tout était le résultat d’une dictature particulièrement vicieuse qui s’insinuait dans l’esprit et le mode de vie des individus.
Dans Gare de l’Est, pas de dénonciations violentes, pas de cris de révolte ouverte, pas d’appels à l’insoumission radicale. Ce sont les vicissitudes matérielles, physiques et morales de la vie quotidienne, et aussi les quelques instants fugaces de plaisir, d’espoir et de satisfaction qui forment l’ossature narrative des sept nouvelles du volume. Gabriela Adameşteanu, l’une des grandes romancières roumaines d’aujourd’hui, maîtrise au plus haut point l’art du récit polyphonique, qui laisse filtrer la profondeur du malaise existentiel et la difficulté, voire l’impossibilité, de la communication entre les personnages. Malaise et difficulté exacerbés par l’atmosphère de suspicion mutuelle, par la surveillance constante exercée sur la vie privée. Malentendus, silences et incompréhensions dans le couple, séparations, vengeances, jalousies, sanctions et mesquineries professionnelles, tracas administratifs, rumeurs plus ou moins fondées, dégradation des relations entre membres d’une même famille ou entre amis, maltraitance féminine ou enfantine, indécision concernant l’avenir individuel et collectif… Tout est dit à travers les gestes et les paroles de personnages qui ne sont ni des héros ni des traitres, mais des êtres qui tentent de vivre dans un contexte oppressant. « On peut donc vivre ainsi, s’habituer à se percevoir comme un être-dénigré, comme un-homme-qui-a-un-mauvais-dossier, comme un-homme-d’un-autre-temps. Penser calmement apporte un apaisement extraordinaire, on écarte toutes les vaines ambitions, puisque l’on sait que les chances de succès sont désormais nulles. ». La vie continue, malgré tout.
Il n’y a pas que les humains. Les évocations des paysages (surtout urbains) subissent des variations et donnent une dimension à la fois significative et poétique au récit. « Une rue animée de gens et de voitures qui s’écoulaient dans le vrombissement d’un paisible soir d’été. Les fleuristes accroupies à côtés de leurs paniers multicolores, d’où jaillissaient des tulipes jaunes ou rouges, fermées, scintillantes d’eau. Le monde était plénitude et régularité, pulsation ordinaire, et lui le traversait, détendu, d’un point à un autre, heureux d’être arrivé jusqu’ici et d’y avoir trouvé ce qui devait s’y trouver. ». Et plus loin : « Les murs défraîchis, les chiens gris cendres écrasés de chaleur au pied des escaliers sales des immeubles aux façades maculées, les containers pleins à craquer, que la chaleur ambiante faisait suinter de leurs liquides fermentés, et cette sensation entêtante : qu’il n’avait pas réussi à quitter la périphérie de la bourgade maudite où il avait passé son enfance. ». Au-delà des conditions circonstancielles et des paysages mentaux, à travers les aléas de la vie quotidienne, c’est une thématique plus vaste qui se décline : la vie et la mort, l’espérance et l’angoisse, la souffrance et le plaisir, l’amour et la haine, l’amitié et la solitude… Sans effets oratoires, sans affectation ni artifice, Gabriela Adameşteanu suggère sans les imposer les grandes interrogations liées à la condition humaine.
Jean-Pierre Longre
18:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, roumanie, gabriela adameşteanu, nicolas cavaillès, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/03/2018
Sur les pas du « bourik »
 Nicolas Cavaillès, Le mort sur l’âne, Les éditions du Sonneur, 2018
Nicolas Cavaillès, Le mort sur l’âne, Les éditions du Sonneur, 2018
Image insolite : un âne chargé d’un cadavre humain si bien arrimé qu’il ne pourra pas s’en débarrasser parcourt l’île Maurice, ce « volcan surgi des eaux qui composa ses paysages par coulées de lave successives jusqu’au spectacle actuel (gangrené de béton) », une île qui, après avoir été un « désert généreux », est devenu le lieu de rassemblement d’un « peuple hétérogène – d’origine indienne, africaine, européenne et extrême-orientale – mais unanimement obsédé par sa petite géographie insulaire ».
Nous suivons donc, sur les pas de Nicolas Cavaillès, fin connaisseur des lieux, les traces de notre « bourik », qui commence par tourner en rond, puis qui se met à déambuler de coin en recoin, de ville en village. Et l’auteur profite de cette légende du « mort sur l’âne » pour plonger et nous faire plonger dans « l’obsédante géographie de l’île », et aussi dans son histoire, avec parfois une bonne digression qui a tout de même quelque chose à voir, telle celle qui rappelle la visite (forcée) du jeune Baudelaire à Port-Louis et dans les environs. Tant de villages aux noms pittoresques, parfois significatifs, parfois énigmatiques ; tant de lieux-dits, de quartiers, de figures et de groupes humains… Maurice apparaît comme un univers grouillant, dans l’espace et dans le temps, qui pose question : « Comment rendre l’île à sa nudité première, anonyme ? ». Et comment la faire sortir de la misère et de l’injustice, même après les émeutes évoquées vers la fin du récit ? « La vie reprit sa marche benoîte, à Beaux-Songes comme ailleurs – précisément comme l’âne affligé que nous avons laissé tantôt à l’entrée du village, après les vergers de Cressonville, au bord de la rivière… Pauvre bourik traînant jusqu’au bout de sa nuit son incompréhension et sa lourde fatigue, jusqu’au point du jour. ».
Dans une prose à fois impeccable, souple et poétique, dont chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre sont parfaitement pesés et rayonnent de multiples harmoniques, Nicolas Cavaillès ne se contente pas de décrire et de raconter. Il s’amuse parfois (lisez par exemple le chapitre 22 bis, où sont rapportées d’une manière impayable les dernières « aventures sensuelles » du baudet, une journée complète de débauche avec pouliches, ânesses, mules…), et souvent, prenant le lecteur à témoin, le sollicitant même, sollicitant aussi les images qui peuplent son esprit, s’adonne à la méditation et à l’interrogation : « Rien n’est à moi, nulle part le monde n’est ma maison, et tous les drapeaux que j’y plante ne flottent que dans le vent de mon égotisme, pour mieux retomber et s’enrouler autour de leur piquet lorsque mes illusions s’effritent. ». Le cadavre que notre âne trimballe au long des chemins est aussi celui de nos illusions. Reste à laisser chanter les oiseaux, en un « dialogue kreol-kreol, en plein cœur de l’île, alors qu’un ouragan s’approche. ».
Jean-Pierre Longre
10:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, île maurice, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/02/2017
Les vertiges de la mémoire
 Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017
Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017
Tout commence avec la mémoire, et se poursuit avec le rêve. Le rêve est d’ailleurs le titre sous lequel les cinq textes du livre parurent dans les années 1980, amputés de certains passages par la censure, puis traduits par Hélène Lenz et publiés en France en 1992 chez Climats (édition maintenant épuisée). La Nostalgie est donc un livre au passé déjà chargé, aussi chargé que les histoires qui s’y trament.
Cinq textes autonomes, donc, mais qui entretiennent entre eux des rapports plus ou moins cachés (retours de personnages, de motifs, de mystères, type de style, progressions parallèles…), rapports qui se tissent à mesure que l’on avance sur la toile narrative – le leitmotiv de l’araignée tissant sa toile et étendant ses longues pattes sur le paysage ou les personnages est l’une des marques saisissantes de l’ouvrage.
Le « Prologue » s’ouvre sur les états d’âme d’un vieil écrivain « pleurant de solitude » et attendant la mort en essayant de « réfléchir ». « Voilà pourquoi j’écris encore ces lignes : parce que je dois réfléchir, comme celui qui a été jeté dans un labyrinthe doit chercher une issue, ne serait-ce qu’un trou de souris, dans les parois souillées d’excréments ; c’est la seule raison. ». Et l’« Épilogue » se ferme sur un autre vieillissement, universel celui-là, anéantissement et renaissance se faisant suite. Entre les deux, les cinq nouvelles cheminent parmi souvenirs et imagination, dans un réalisme fantastique qui ne laisse ni l’auteur, ni ses personnages ni le lecteur en repos.
La « nostalgie » est une pathologie psychique liée au regret du passé, certes, mais aussi à celui d’une situation idéale inatteignable. De fait, ici, chaque récit part d’un point du passé, d’un souvenir qui se tourne vers un univers intérieur échappant à l’entendement ordinaire, voire vers un anéantissement de soi au profit d’une apothéose littéraire ; c’est le cas avec « Le Roulettiste », dont le personnage n’arrive pas à mourir. La seconde nouvelle, « Le Mendébile », tient véritablement du souvenir d’enfance, racontant les jeux plus ou moins violents d’une bande de copains à l’arrière cafardeux d’un immeuble bucarestois des années 1970, avec portraits sans concessions et rivalités sans pitié, jusqu’à la souffrance extrême. Avec « Les Gémeaux », qui ménage un suspense narratif et érotique intrigant, nous suivons une progression vers une double métamorphose, un transfert à la fois intime et terrifiant : « Nous nous sommes longtemps regardés, horrifiés, sans nous parler ni nous attirer. Nous étions trop fatigués, trop abasourdis pour réfléchir encore. […] Nos gestes hésitaient, nos mouvements balbutiaient, nos mains rataient ce qu’elles faisaient. Nous nous regardions comme des êtres venus de deux mondes différents, aux bases chimiques, biologiques et psychologiques totalement autres. ». « REM », le récit le plus long, est aussi le plus complexe, même si lui aussi est un récit d’enfance, celui d’une jeune femme qui déroule en une nuit à l’intention de son amant ses souvenirs de « choses qui se sont passées dans les années 1960, 1961, quand j’étais encore une petite fille. ». Jeux d’enfants chez une tante habitant aux limites de la ville, mystères liés à ces trois lettres, « REM » (la « chose » inexplicable, les Réminiscences de phénomènes dont l’étrangeté est liée à la rencontre entre la poésie de l’enfance et le gigantisme de la mémoire, entre la vie innocente et l’annonce de la mort, entre la quotidienneté du réel et l’étrangeté du songe – confrontations qui ne peuvent se résoudre que dans la création, littéraire en l’occurrence, aboutissement de la quête de ce Graal nouvelle version). « Il existe des livres secrets, écrits à la main, consacrés au REM, et il existe des sectes concurrentes qui reconnaissent le REM, mais qui ont des idées on ne peut plus différentes quant à sa signification. Certains soutiennent que le REM serait un appareil infini, un cerveau colossal qui règle et coordonne, selon un certain plan et en vue d’un certain but, tous les rêves des vivants, depuis les rêves inconcevables de l’amibe et du crocus, jusqu’aux rêves des humains. Le rêve serait, selon eux, la véritable réalité, dans laquelle se révèle la volonté de la Divinité cachée dans le REM. D’autres voient dans le REM une sorte de kaléidoscope dans lequel on peut lire tout l’univers, dans tous les détails de chaque instant de son développement, de sa genèse jusqu’à l’apocalypse. ».
Difficile d’en écrire davantage dans un simple compte rendu. Sinon que le dernier texte est comme une signature apocalyptique, celle de « l’architecte » dont l’influence musicale va s’étendre sur la « mentalité humaine » en transformation, sur le monde entier, sur « l’espace interstellaire » et « des constellations entières ». C’est ainsi que l’artiste complet (l’écrivain, comme l’architecte, le musicien ou tout autre) compose son univers vertigineux et le propose au public, qui a le choix de le suivre ou non sur les flots de son écriture et de son imagination. Avec Cărtărescu, difficile de ne pas se laisser embarquer, même si l’on redoute la tempête, les récifs et les courants.
Jean-Pierre Longre
18:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, mircea cărtărescu, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/05/2016
Le poids du génie
 Nicolas Cavaillès, Les huit enfants Schumann, Les éditions du Sonneur, 2016
Nicolas Cavaillès, Les huit enfants Schumann, Les éditions du Sonneur, 2016
Tout commence avec « la mort du père », compositeur de génie et « malheureux musicien », passionné, exalté, mort fou dans un asile, écarté des siens – après avoir aimé, avoir rêvé, aussi, d’un calme bonheur familial. Puis le livre égrène les morts successives, dans un ordre rigoureusement chronologique. Celles des « huit enfants », dont certains furent vite effacés, d’autres vécurent assez longtemps pour conserver la mémoire familiale et artistique : Émile, Julie, Félix (jeune poète disparu trop tôt), Ferdinand, Ludwig, Élise (elle-même pianiste de talent), Marie (qui « se dévoua tout entière » à sa mère), Eugénie (qui contribua à la pérennité de la mémoire familiale et paternelle par les livres qu’elle écrivit).
Au centre des huit chapitres consacrés aux enfants, il y a « La mort de la mère », Clara la fameuse pianiste, elle-même compositrice, qui poursuivit sa carrière tout en enchaînant les grossesses et les accouchements et en supportant durant un certain nombre d’années le génie exalté de son mari tant aimé. « Mère exigeante et défaitiste à la fois, peu généreuse mais énergique et tenace, mettant la sourdine à la sensibilité brillante dont elle fit montre sur scène, tendancieusement autoritaire mais avant tout soucieuse d’inculquer à ses garçons comme à ses filles le devoir d’indépendance morale et matérielle, Clara sembla, consciemment ou non, classer sa progéniture en deux catégories, la forte et la faible ». Et il y a Brahms, arrivé jeune homme dans le foyer, à qui Schumann avait « symboliquement » légué « sa très haute mission artistique – et avec elle, sans le dire explicitement, son épouse et ses enfants. », et qui fut pour la famille un ami, un conseiller, un frère, un oncle, un père de substitution…
De ce récit familial, de ces « drames redondants » parmi lesquels les petits bonheurs s’insinuent malgré tout, de ces « anecdotes », de ces « visages figés » par le temps, Nicolas Cavaillès tire, avec une tranquille économie de moyens rhétoriques, avec une justesse définitive et dans une prose nourrie de poésie, des réflexions sur la mort, la « reproduction » et l’aspiration au néant, sur la filiation et l’enfance, sur la « musique spirituelle » et les « angoisses latentes » qu’elle exprimait chez Schumann (comme chez d’autres), par opposition à celle « qui beugle aujourd’hui […] ses mélodies débiles au service du système consumériste » (oh la belle page de colère !). Sous les apparences d’une composition claire et sans ambiguïtés, Les huit enfants Schumann met en relief les mystères de l’enfance, de la vie et de la mort, ainsi que les exigences et les impératifs du génie musical, qui a investi l’existence entière de la famille Schumann. Dans ce beau livre, dont le thème principal et grave est la mort, le protagoniste est la musique, qui donne (d'une manière souvent sous-jacente, en tout cas discrète) à chaque chapitre/mouvement une tonalité différente.
Jean-Pierre Longre
18:19 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, musique, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2015
Irrésistibles élans
 Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, Les éditions du Sonneur, 2015
Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, Les éditions du Sonneur, 2015
La question est-elle absurde ? Pas plus que le geste sur lequel elle porte. Pas moins non plus. En réalité, écrit l’auteur, « nous ignorons pourquoi les baleines et autres cétacés effectuent parfois ces sauts stupéfiants au-dessus des mers et des océans, mais les hypothèses ne manquent pas, elles se renforcent même du fait que la question n’a pas été tranchée. ». Une fois évacuée (mais non définitivement écartée) l’éventualité du saut « quia absurdum », qui serait peut-être la preuve de l’esprit philosophique des baleines, nous avons droit, après une revue de « détail » des différentes familles de cétacés, au développement de toutes les réponses possibles à la question que posent les bonds étranges, inattendus, violents, différents selon les espèces, des baleines hors de l’eau.
Nicolas Cavaillès, pour l’occasion, se livre à toutes les hypothèses, depuis les explications (contestées) des Vikings (« Un moyen de se déplacer plus facilement, et de détruire les navires ») jusqu’aux élucubrations sur le caractère érotique des sauts collectifs (« orgies de caresses, ébats en groupe »). Chemin faisant, nous apprenons de bonnes et belles choses sur la vie et la mort, le tempérament et la physiologie de ces êtres fascinants, nous plongeons dans les études aristotéliciennes sur la locomotion animale, en surgissons pour tomber sur un chapitre hautement mathématique, empli de formules fondées sur la « poussée d’Archimède »…
Par-dessus tout, ce qui paraît être un bref essai scientifique mâtiné de rappels historiques et de détachement fantaisiste, voire humoristique, est aussi une méditation sous-tendue par la réflexion philosophique et le sentiment artistique. La Bible, Kierkegaard, Nietzsche sont sollicités, et aussi Herman Melville (bien sûr pour Moby Dick), Dostoïevski, Glenn Gould et son interprétation des Variations Goldberg… Cela pour dire que le mammifère aquatique voudrait aussi être aérien, aspire comme le mammifère humain, entre la naissance et la mort, à échapper à la « fadeur de l’existence » et à pénétrer dans « le Grand Tout homogène où le ciel et la mer ne font qu’un, sans hiérarchie ni haut ni bas, partageant de mêmes flux magnétiques sans distinction entre les quatre points cardinaux d’une planète ronde. ». Pourquoi Nicolas Cavaillès a-t-il cherché des réponses à la question du « saut des baleines » ? Sans doute pour mieux poser celle, tout aussi énigmatique, de l’existence humaine. Allez savoir…
Jean-Pierre Longre
Nicolas Cavaillès, spécialiste de Cioran, traducteur du roumain, éditeur, écrivain, a obtenu le Prix Goncourt de la nouvelle en 2014 pour Vie de Monsieur Leguat (Les éditions du Sonneur).
Voir http://jplongre.hautetfort.com/tag/nicolas+cavaillès
14:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, francophone, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/02/2015
« Bienvenue dans mon épopée »
 Mircea Cărtărescu, Le Levant, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2014
Mircea Cărtărescu, Le Levant, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2014
Faut-il définir le genre de l’ouvrage ? On parlera d’épopée. Douze chants, invocations aux Muses et à d’autres entités divinisées, exploits guerriers de courageux navigateurs, intrigues amoureuses, amitiés et inimitiés viriles, héros à la fois modernes et intemporels dont le but est de libérer leur patrie de l’occupant étranger, fond historique sur lequel se détachent des événements transfigurés en mythes, lyrisme tantôt échevelé tantôt intimiste, en prose ou en vers… La tonalité épique est bien une caractéristique fondamentale du récit, dont le protagoniste, Manoïl, n’a de cesse que de renverser la tyrannie levantine qui opprime la Valachie – et qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler, ici, la sombre dictature dont était victime le peuple roumain dans les années 1980, celles durant lesquelles l’auteur écrivait son livre.
Épopée, donc, mais travestie et burlesque, parodique et humoristique, aux inventions inattendues, que ce soit dans les descriptions, les situations ou l’écriture. Chaque page est une surprise nouvelle, chaque phrase recèle une trouvaille stylistique ou verbale. L’histoire du monde devient une fable pleine de paysages étonnants, de machines complexes, de péripéties fantaisistes, d’anachronismes audacieux, de rêves merveilleux ou terribles, d’illusions politiques, de voyages infinis, de tirades grandioses. Avec ses personnages en quête (plus ou moins consciente) d’un Graal oriental ou de ce que les surréalistes appelaient le « point suprême », la narration s’envole au-delà des « limites du monde », là où « le bien et le mal, les ténèbres et la lumière s’annihilent, petit et grand, infini et limité deviennent une même chose ». Comme ce sera le cas dans les romans à venir, notamment dans la trilogie Orbitor, Cărtărescu le magicien n’hésite pas à naviguer entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, donnant par exemple à Bucarest toutes ses dimensions dans une larme, et envisageant le monde depuis une nacelle de ballon dirigeable…
À l’instar de ce qui se produit dans les romans picaresques, Mircea l’écrivain intervient à tout moment en tant que tel dans son œuvre, la contemple, l’examine, ironise, s’efforce de la modifier, s’en éloigne pour mieux la commenter, s’adresse directement à ses personnages, se regarde travailler dans sa cuisine, accueille le lecteur à l’intérieur de ses pages en lui souhaitant la bienvenue. Non seulement le lecteur, mais nombre d’écrivains sur lesquels il s’appuie, qu’il prend à témoin avec un respect non dénué de familiarité. Il y a là Homère, bien sûr, et quelques autres antiques, mais aussi Shakespeare, Byron, Borges et quantité de modernes, roumains de préférence. Cărtărescu a beaucoup lu, cultive une imagination débordante, et pratique une écriture effervescente. Le Levant est une somme grouillante, un univers foisonnant, et surtout un hymne à la vie sous tous ses aspects, la vie réelle, la vie rêvée :
"Je lève ce verre lourd à la sainte Liberté,
À la douce Poésie, et à la Rêverie ailée."
Jean-Pierre Longre
15:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : épopée, roman, poésie, roumanie, mircea cartarescu, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/06/2014
Mouvante poésie
Ada Milea, Petit mouton, anthologie bilingue, traduction du roumain par Faustine Vega et Nicolas Cavaillès
Irina Mavrodin, Sang vert, anthologie bilingue, traduction du roumain par l’auteur
éditions hochroth Paris, 2014
 Ada Milea est une artiste aux talents multiples : théâtre, musique, chanson, et poésie. C’est de celle-ci, principalement, que relève Petit mouton, sans qu’il soit fait abstraction des autres genres esthétiques. La chanson, notamment, résonne à maintes reprises dans des textes dont l’oralité se manifeste sous les formes de la comptine détournée, du chant national parodié, de la légende travestie (au premier plan, celle de Mioritza, fameuse ballade populaire).
Ada Milea est une artiste aux talents multiples : théâtre, musique, chanson, et poésie. C’est de celle-ci, principalement, que relève Petit mouton, sans qu’il soit fait abstraction des autres genres esthétiques. La chanson, notamment, résonne à maintes reprises dans des textes dont l’oralité se manifeste sous les formes de la comptine détournée, du chant national parodié, de la légende travestie (au premier plan, celle de Mioritza, fameuse ballade populaire).
En quelques textes, se produit le mélange des tonalités et des motifs : l’absurde (si cher à la tradition folklorique roumaine, comme chez Urmuz), l’humour noir et la satire sociale voisinent en bonne entente avec la révolte contre le sort réservé aux peuples, aux femmes, aux petits de ce monde. Pas un instant on ne risque de se détourner d’une poésie qui lance ses appels : « - Oooo, Pastoureau / - Oo, Jouvenceau ! », et invite au rêve collectif : « D’un même mouvement les gens… rêvent tous. / Tous ensemble… rêvent tous ».
 Irina Mavrodin (1929-2012) est d’abord connue comme essayiste, théoricienne, critique, universitaire de haut vol, traductrice de Proust, Flaubert, Gide, Camus, Ponge et de nombreux autres écrivains ou essayistes… dont elle-même, puisqu’elle est l’auteur des versions roumaine et française des précieux poèmes ici réunis sous le titre de l’un d’eux, Sang vert.
Irina Mavrodin (1929-2012) est d’abord connue comme essayiste, théoricienne, critique, universitaire de haut vol, traductrice de Proust, Flaubert, Gide, Camus, Ponge et de nombreux autres écrivains ou essayistes… dont elle-même, puisqu’elle est l’auteur des versions roumaine et française des précieux poèmes ici réunis sous le titre de l’un d’eux, Sang vert.
Le sang du corps humain, le vert des « feuilles à nervures », selon une fusion récurrente qui se produit, dans ces courts et beaux textes, entre la nature et l’homme, « sous la peau chaude des pierres », ou bien là où « palpite le cœur des arbres ». Discrètement, l’amour (« écrit sur les ailes des oiseaux ») et la mort (« je ne sais plus / dans quel monde je vis / si je suis ici / ou de l’autre côté ») se glissent entre les « immobiles branches », donnant pérennité aux salutaires et nécessaires mouvements de la poésie et de la vie.
Quoi de commun, tout compte fait, entre Petit mouton et Sang vert ? Formellement, les deux ouvrages offrent de front leurs textes en roumain et en français, et tous deux sont des recueils poétiques. Surtout, leur voisinage dans cette chronique voudrait prouver que le domaine de la poésie est étonnamment étendu, varié, accidenté, inattendu, et montrer, encore une fois, les choix judicieux des éditions hochtoth Paris.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, francophone, ada milea, irina mavrodin, faustine vega, nicolas cavaillès, éditions hochroth paris, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/03/2014
Les tribulations d’un huguenot
 Nicolas Cavaillès, Vie de Monsieur Leguat, Les éditions du Sonneur, 2013
Nicolas Cavaillès, Vie de Monsieur Leguat, Les éditions du Sonneur, 2013
Prix Goncourt de la nouvelle 2014
En 1685, Louis XIV signe l’édit de Fontainebleau, qui révoque celui de Nantes, et jette sur les routes de l’exil des milliers de huguenots, entraînant les conséquences durables que l’on connaît.
Parmi eux, François Leguat, gentilhomme bressan déjà âgé de 50 ans, qui, fuyant ses terres, se réfugie en Hollande ; de là, vu la foule d’émigrés s’entassant dans le port d’Amsterdam, il décide de s’embarquer pour les îles lointaines. Premier départ à bord d’une frégate, avec quelques hommes qui deviendront forcément des compagnons de long voyage. Le roman retrace les tribulations de ces navigateurs malgré eux, les incidents, les maladies, les tempêtes, les trahisons, la survie sur des îles inconnues, les morts, les emprisonnements, les abandons… Leguat résiste à tout, au prix de combats inhumains contre l’adversité, contre les duretés de la nature et des hommes, entre océans et continents – et ne meurt qu’à 96 ans, dans les bas-fonds londoniens.
Nicolas Cavaillès, dans ce bref roman (ou longue nouvelle), ne se contente pas de raconter ce que son héros avait déjà narré dans son Voyage et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes des Indes orientales, publié en 1707 – suivant peut-être en cela la mode des récits exotiques de l’époque. En une prose limpide et riche, rythmée par les évocations poétiques, il entame une réflexion sur la nature et la destinée humaines, sur le sens de l’aventure, sur la souffrance, sur la mort, sur Dieu, sur la sincérité même de la narration autobiographique, sur « l’idéal littéraire de simple vérité » ; et il réhabilite ce bourlingueur qui « aura vécu trois vies », qui aura fréquenté « l’Éden original » et « la cité de l’Apocalypse » – et qui, tout compte fait, fut une homme « simple et sincère » et reste « un modèle à suivre ».
Jean-Pierre Longre
18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, biographie, nouvelle, francophone, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/05/2013
Poèmes en dialogue
 Pernette du Guillet, Maurice Scève, Heureuse peine et longue mort, éditions hochroth Paris, 2013
Pernette du Guillet, Maurice Scève, Heureuse peine et longue mort, éditions hochroth Paris, 2013
Parmi les couples qui parsèment l’histoire littéraire, celui que forment Pernette du Guillet et Maurice Scève est singulier. Couple poétique s’il en est, une vingtaine d’années les sépare ; lui est un poète savant qui laissa plusieurs recueils dont Délie, écrit pour elle, qui n’eut le temps que de laisser « quelques brouillons de Rymes » avant de mourir à 25 ans, bien avant lui.
Belle idée que de réunir quelques-uns de leurs textes et de les faire se répondre, en un dialogue amoureux et versifié. Beau choix anthologique, aussi, que celui de Nicolas Cavaillès, qui a eu soin de livrer les poèmes dans leur version originale, tels quels. Belle répartition, enfin, que cette alternance entre les dizains à la syntaxe et à la prosodie parfaites de Délie (dont le titre, rappelons-le, est l’anagramme de « l’Idée »), et les strophes musicales et sensuelles des Rymes. À la recherche platonicienne d’un idéal portée par le souvenir de Pétrarque répond l’harmonie pathétique du désir :
Si le servir merite recompense
Et recompense est la fin du desir,
Toujours vouldrois servir plus, qu’on ne pense,
Pour non venir au bout de mon plaisir.
Et puisque Pernette vient d’être citée, ne résistons pas au plaisir d’en faire autant avec Maurice, vrai « lionnois » :
Plus tost seront Rhosne, et Saone desjoinctz,
Que d’avec toy mon cœur se dessassemble :
Plus tost seront l’un, et l’aultre Mont joinctz,
Qu’avecques nous aulcun discord s’assemble :
Plus tost verrons et toy, et moy ensemble
Le Rhosne aller contremont lentement,
Saone monter tresviolentement,
Que ce mien feu, tant soit peu, diminue,
Ny que ma foy descroisse aulcunement.
Car ferme amour sans eulx est plus, que nue.
Vers précieux, aussi précieux que ce petit livre à l’esthétique à la fois sobre et très élaborée.
Jean-Pierre Longre
15:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, pernette du guillet, maurice scève, nicolas cavaillès, alice rambert, éditions hochroth paris, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/05/2012
Paris est un roman, la vie est un livre
 Matéi Visniec, Syndrome de panique dans la Ville lumière, roman traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2012
Matéi Visniec, Syndrome de panique dans la Ville lumière, roman traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2012
Comme celles de ses pièces de théâtre, l’intrigue du roman (le premier traduit en français) de Matéi Visniec ne peut être résumée. D’ailleurs il n’y en a pas, d’intrigue ; plutôt, elles sont multiples, cheminant et courant entre réalité et fiction : il y a le « journal réel » d’un écrivain qui, parvenant à sortir de la Roumanie de Ceauşescu, trouve refuge à Paris, et il y a les œuvres potentiellement écrites, sous la houlette d’un éditeur fantasque et tyrannique, par des êtres pouvant être aussi bien auteurs que personnages. Comme le dit l’observateur Georges, derrière son bar : « On dirait que nous nous trouvons ici précisément au point de passage de la frontière entre fiction et réalité ».
Le récit navigue comme un bateau dans une tempête, tantôt grimpant vers les sommets prestigieux des vagues (la gloire mondiale sur laquelle fantasme le narrateur), tantôt plongeant vers l’abîme du néant anonyme – le tout ponctué par un poème qui clôt le livre, « Le Navire », parabole de la lente destruction d’une… (ici, au lecteur de compléter).
Intrigues multiples, personnages multiples : outre l’auteur (qui n’hésite pas à se nommer en tant que personnage), l’éditeur « Monsieur Cambreleng », l’ami d’enfance Gogu Boltanski qui a suivi une autre voie, François, futur auteur malgré lui d’un « chef-d’œuvre », un étrange bossu, un guide aveugle, une jeune femme séduisante et sans cesse éclopée, tout un cheptel d’auteurs-personnages réunis dans un café de la rue Mouffetard… Il faut aussi compter avec les silhouettes d’illustres écrivains et artistes du passé lointain ou proche, de Voltaire à Sartre, d’Hugo à Breton, Beckett ou Queneau, sans oublier le trio roumain Cioran, Eliade, Ionesco…
Personnages multiples, sujets multiples : l’actualité politique, les dictatures d’Europe de l’Est, les bouleversements liés à la chute du Mur, et bien sûr Paris, la ville des lumières et des ombres, des bistrots et des librairies, des touristes et des autochtones aux origines mêlées, des enthousiasmes délirants et des déceptions amères, navire qui « fluctuat nec mergitur » malgré la houle, la ville qui est un livre vivant, plein de souvenirs et de surprises. Paris qui vit des mots, ces êtres traversant les frontières, passant « d’un cerveau à l’autre » : « Toute la ville était habitée par des mots. Je voyais autour de l’église Saint-Médard les mots des passants, d’autres mots qui sortaient des fenêtres ouvertes des immeubles, ou bien des portes des cafés. Partout où deux personnes se rencontraient et se mettaient à discuter, une nébuleuse de mots se formait autour d’eux ».
Chaque chapitre est un déroutement, au plein sens du terme, et le lecteur se laisse mener volontiers où il semble bon à l’auteur de le mener, dans les méandres de la « Ville lumière ». C’est cette instabilité qui paradoxalement fait l’unité du livre, comme dans la vie. Au-delà de la « panique » que peuvent provoquer les tempêtes et les errances, ce qui rassure, c’est le ton de Visniec, le style inimitable qui est le sien, la foi dans l’écriture, la confiance accordée aux mots. La littérature ne sombrera pas.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, matéi visniec, nicolas cavaillès, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2011
Le sacre du métèque
 Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Venu des Carpates et des « cimes du désespoir », exilé à Paris, prisonnier volontaire d’une langue nouvelle et d’un pessimisme provocateur, Cioran est l’un des grands écrivains français du XXe siècle. Lui consacrer un volume de la Pléiade était justice, et la publication de ses Œuvres est un modèle du genre.
Les éditeurs ont choisi à bon escient de se limiter (si l’on peut dire) aux textes rédigés en langue française. Ce choix est dû à des raisons non seulement linguistiques et chronologiques, mais aussi philosophiques et littéraires. Les dix œuvres « françaises » publiées, présentées et annotées ici, même si elles n’échappent pas – et c’est heureux – à l’héritage roumain, forment un ensemble cohérent dans sa succession interne, tant du point de vue de la pensée que de celui du style.
On lira (ou relira) donc avec un bonheur non dénué d’une angoisse communicative Précis de décomposition, Syllogismes de l’amertume, La tentation d’exister, Histoire et utopie, La chute dans le temps, Le mauvais démiurge, De l’inconvénient d’être né, Écartèlement, Aveux et anathèmes, Exercices d’admiration, le tout complété, comme il se doit dans la Pléiade, par une préface, une biographie, une bibliographie, des notices, des notes, des appendices… Comme il se doit, et plus qu’il ne se doit : la préface, entre autres, offre, certes, une synthèse impeccable de l’œuvre de Cioran, une analyse limpide de son écriture, des ouvertures séduisantes sur les origines et les enjeux des textes, mais elle est aussi en elle-même un morceau de littérature ; à la fois enthousiaste et distanciée, construite et foisonnante, elle offre un bel exemple de « style comme aventure ».
Avec ce volume, le plaisir d’entendre une « voix [qui] accède à une pluralité de formes et de tons – de l’essai lyrique au lambeau delphique, de l’aphorisme ravageur à l’épître complice, de l’effigie destructrice à l’oraison non-violente… » est relevé par celui d’en apprendre beaucoup sur cette « voix », sur ce qui l’a construite et sapée, nourrie et affamée, encouragée et découragée, composée et décomposée. Au-delà de l’amertume ou des anathèmes, ce sont bien des « exercices d’admiration » que nous sommes amenés à pratiquer en l’écoutant, et en écoutant celles qui l’accompagnent.
Jean-Pierre Longre
19:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, francophone, roumanie, cioran, nicolas cavaillès, aurélien demars, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2011
Les ruses du roman
 Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Précisément, s’agit-il d’un roman ? Certes, Dumitru Tsepeneag a depuis longtemps (au moins depuis Le mot sablier qui, publié en 1984, représente sous forme narrative le passage d’une langue à l’autre) commencé à dévoiler certains coins de son atelier à l’intention de ses lecteurs, sans leur en laisser découvrir tous les secrets. Mais jamais un de ses livres n’a autant mérité le sous-titre de « Chantier à ciel ouvert ».
À l’image des tranchées que quelques travailleurs s’échinent à creuser dans les rues, certains leitmotive d’œuvres précédentes se retrouvent dans Le camion bulgare, certains personnages aussi : Marianne, l’épouse partie se soigner de son étrange maladie en Amérique, et à qui l’écrivain demande sans cesse des conseils, Alain, l’ami et traducteur à l’agonie, qu’il va falloir remplacer. D’autres apparaissent au fil des pages, fondant une narration épisodique : Tzvetan, le camionneur bulgare qui, en, quelque sorte, succède au fameux « plombier polonais » (et, autre clin d’œil, transporte avec lui un dangereux parapluie) ; Béatrice, dont la route va croiser celle du précédent, après qu’ils auront accompli leur itinéraire érotique ; Milena, romancière originaire de Slovaquie (mais dont le modèle, semble-t-il, vient plutôt de Slovénie), Pastenague, le double de l’auteur/narrateur avec qui il échange parfois des impressions ; quelques autres encore, qui naviguent entre réel et imaginaire.
On ne fera pas ici la liste des thèmes et sujets dont le foisonnement tient à la fois de la marqueterie cubiste, de la musique expérimentale et de l’art consommé de la (fausse) digression, dans un texte qui avance comme un camion cahotant sur les routes européennes. Il est question de Marguerite Duras, de « littérature d’ordinateur » et d’amour par courrier électronique, de mythologie égyptienne, d’animaux divers, de la Bulgarie et de la Roumanie, de maladie et de vieillesse… La récurrence de ce dernier motif pourrait laisser entendre que Le camion bulgare est le roman de la dépossession, voire de la disparition. Mais n’est-ce pas une ruse, pour mieux conserver sa foi en la littérature ? Car c’est essentiellement de littérature qu’il est question ; de celle des autres, parfois (les délicieuses et impitoyables Frappes chirurgicales restent d’actualité), mais surtout de celle qui est en train de s’élaborer ici, maintenant : autocommentaire, autocritique, autobiographie littéraire (que d’« auto » pour un camion…), ou encore métalittérature, poétique du roman, mise en abîme de l’écriture… Patiemment, de livre en livre, bien mieux que dans n’importe quel traité théorique ou manuel universitaire, Dumitru Tsepeneag explore malicieusement l’art du récit et procède aux mises en ordre successives de ses découvertes. Attendons la suite.
« Je reconnais que je n’ai pas eu le courage d’écrire un véritable chantier : rassembler des matériaux de construction, placer côte à côte les briques narratives et les idées structurantes, et laisser le lecteur se faire son roman lui-même. Certes : je l’ai écrit, pour ainsi dire, sous ses yeux, il est témoin des efforts que je fais pour écrire encore un livre – le livre de trop, diront certains… ». Mais non !
Jean-Pierre Longre
14:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

