28/09/2010
Dans la « tombe humide »
 Laurent Gaudé, Ouragan, Actes Sud/Leméac, 2010
Laurent Gaudé, Ouragan, Actes Sud/Leméac, 2010
Il y a Joséphine Lincoln Steelson, « négresse depuis presque cent ans », rivée à sa ville, à sa terre et au souvenir de son mari jadis assassiné ; il y a Keanu Burns, qui a quitté sa plate-forme pétrolière et décidé, contre toute raison et contre le mouvement général de fuite, de partir retrouver Rose, son amour de toujours, mère du petit Byron ; il y a Buckeley et ses compagnons de prison, criminels endurcis, qui devront à toute force quitter leurs cellules pour échapper à la noyade ; il y a le pasteur, dont la folie meurtrière se substituera au devoir de charité chrétienne… Tous sont du peuple des anciens esclaves, et tous sont confrontés à la violente tempête qui ravage la Nouvelle-Orléans. Ils se croisent, se rencontrent, s’affrontent parfois, victimes non seulement des méfaits de la nature, mais aussi des injustices de la société.
Les monologues et les récits personnels s’entrecroisent comme les individus, s’entrechoquent comme les débris flottant sur l’eau, se frôlent comme les alligators s’insinuant dans les rues inondées, et l’écriture de Laurent Gaudé, d’une sensibilité qui confine au lyrisme, rend compte avec délicatesse, profondeur et force de l’intimité des êtres. Une vague d’amour enveloppe les retrouvailles de Keanu et Rose, une vague de révolte soulève Joséphine protestant contre la « misère du monde », une vague de solitude conduit Buckeley vers les bayous déserts, une vague de violence punitive submerge l’homme de Dieu. Le déchaînement des éléments met les âmes à nu, et chacun guide sa vie là où une forme de liberté retrouvée, fausse ou vraie, le lui suggère.
Ouragan est un puzzle romanesque dont les pièces peu à peu se mettent en place – pièces dont on sent pourtant qu’elles ne restent pas stables, livrées à la surface fluctuante des eaux omniprésentes et des destinées inéluctables.
Jean-Pierre Longre
18:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent gaudé, actes sud, leméac, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/09/2010
Hergé, images et mythes
 Jean-Marie Apostolidès, Dans la peau de Tintin, Les impressions nouvelles, 2010
Jean-Marie Apostolidès, Dans la peau de Tintin, Les impressions nouvelles, 2010
L’enjeu ? « Risquer une lecture autobiographique des aventures » de Tintin. Le pari est risqué, et tenu. Jean-Marie Apostolidès, en vingt-cinq chapitres très documentés, bourrés de références, n’occulte rien, ou plutôt fait surgir, d’une manière parfois audacieuse mais toujours séduisante, ce qui restait occulté – tout en laissant deviner que le chantier reste ouvert.
Les relations plus ou moins secrètes d’Hergé avec son protagoniste, mais aussi avec Milou, Haddock, La Castafiore et même Jo et Zette sont passées au crible d’une lecture scrupuleuse des albums les plus marquants, s’appuyant sur la vie du géniteur, sur ses relations avec sa famille (sa mère, son frère Paul), avec les femmes (notamment sa première épouse, Germaine), avec l’abbé Wallez, le « père » influent, voire tout-puissant. Le lecteur entre véritablement « dans la peau » du héros marqué d’une androgynie latente liée à une thématique constante, celle de la gémellité, de la dualité, qui concerne Tintin comme Hergé.
L’inconscient de Georges Rémi s’articule, selon Apostolidès, sur deux mythes : celui des jumeaux (le père et l’oncle, les Dupondt etc.) et celui de la relation Maître-fillette, tous deux issus du « fantasme fondamental qui structure le rapport complexe du masculin au féminin ». Il semble que l’argumentation générale du livre tourne autour de cet axe. De là, une étude psychanalytique poussée, qui établit un parallèle entre les grands épisodes de la vie d’Hergé et ceux des aventures de Tintin (par exemple les étapes que représentent Le Temple du Soleil et Les bijoux de la Castafiore). Cela tend à montrer la volonté de donner à l’être de papier une existence charnelle (à l’instar de celle de Tchang), existence qui a besoin d’une protection, dans le cercle restreint des compagnons d’aventures et à l’abri des murs de Moulinsart, contre le monde extérieur et ses désordres. Bref, « les aventures de Tintin se présentent à nous comme un système total, replié sur lui-même et pourtant ouvert sur le monde ». N’est-ce pas l’un des secrets du succès auprès du public « de sept à soixante-dix-sept ans » ?
Analyses convaincantes, exemples probants, Dans la peau de Tintin, qui ouvre aussi la réflexion sur la postérité de l’œuvre d’Hergé, est, dans la perspective psychanalytique, une somme aux résonances multiples, qu’il faut prendre le temps de méditer si l’on veut mesurer la portée des aventures du « petit reporter », et ainsi renouveler le plaisir que procure leur lecture.
Jean-Pierre Longre
15:42 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, hergé, jean-matie apostolidès, les impressions nouvelles, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/09/2010
Un « génie manqué » ?
 Pétrus Borel, Escales à Lycanthropolis, édition établie et présentée par Hugues Béesau et Karine Cnudde, clôture par Olivier Rossignot. Le Vampire Actif, « Les Rituels Pourpres », 2010
Pétrus Borel, Escales à Lycanthropolis, édition établie et présentée par Hugues Béesau et Karine Cnudde, clôture par Olivier Rossignot. Le Vampire Actif, « Les Rituels Pourpres », 2010
Les manuels de littérature, lorsqu’ils les évoquent, qualifient de « petits » ou de « mineurs » les Romantiques méconnus. Souvent, ils ne les évoquent même pas. C’est dire combien l’ouvrage publié par Le Vampire Actif (maison d’édition associative dont le nom colle si bien au sujet) est utile et bienvenu.
« Indéfectible révolté, désenchanté […], Borel exhale le refus permanent dans chacune de ses pages. […] Son écriture est militante, une écriture comme un acte de vie, dominée par la permanence du Mal dans toutes les acceptions du terme », écrit très justement Olivier Rossignot dans la « clôture » du livre. Le fil conducteur qui mène de Sade au surréalisme passe forcément par Pétrus Borel « le Lycanthrope », avant Lautréamont. Il faut par exemple se laisser prendre, dans Champavert. Contes immoraux, aux diatribes contre l’amour, qui devient « de la haine, des gémissements, des cris, de la honte, du deuil, du fer, des larmes, du sang, des cadavres, des ossements, des remords », ou aux pages de cruauté morbide et de désespoir qui ferment la même œuvre. Il faut connaître la « frénésie » qui saisit la famille du compte Josseran, dans Les Pressentimens, au récit des « effrayans présages » (orthographe d’origine respectée) planant sur une veillée commémorative. « La musique funèbre, les chants mélancoliques, les récits tristes et sombres peu à peu vous infiltrent la peur, ou plutôt une espèce d’inquiétude vague, de crainte surnaturelle, de superstition »… Il faut lire aussi le roman Madame Putiphar et son beau prologue en alexandrins, qui dévoile les trois faces caractéristiques du poète : le monde, la solitude, la mort. Il faut savourer encore l’étrange et juste plaidoyer contre les pillages archéologiques perpétrés par les pays occidentaux, dans L’obélisque du Louqsor…
Mais si la révolte est on ne peut plus sérieuse, passionnée, elle n’est pas dénuée d’humour. Humour noir, certes, celui du désespoir, dans telle scène de Passereau où « l’écolier » va demander au bourreau Sanson de le décapiter, ou dans les calculs imperturbablement débités en faveur d’un impôt sur les suicides. Et lorsque les rivaux Barraou et Juan, dans Jaquez Barraou le charpentier, mêlent les prières à leur massacre mutuel, doit on y voir un retour à la sauvagerie primitive ou le comble de l’humour sacrilège ? En tout cas, on rit franchement à la lecture des portraits pittoresques du Croque-mort et du « Gniaffe » (cordonnier), dans lesquels l’auteur s’en donne à cœur joie et s’amuse non seulement à la caricature, mais aussi aux jeux de langue et aux étymologies fantaisistes.
Les « Repères » et les « Quartiers » de Lycanthropolis, dans la structure de l’ouvrage, sont complétés par l’« Agora », qui dévoile avec beaucoup d’à-propos des jugements (d’autant plus intéressants qu’ils sont quelque peu contradictoires) de Baudelaire et de Breton sur Pétrus Borel, et une bibliographie intitulée « Fouilles ». Escales à Lycanthropolis est une anthologie essentielle, une incitation à aller voir de plus près l’œuvre d’un auteur qui dépasse les frontières du « Petit Cénacle », du Romantisme et des classifications génériques et historiques.
Jean-Pierre Longre
18:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, récits, francophone, pétrus borel, le vampire actif, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/09/2010
Les anges dans nos campagnes : une bonne nouvelle ?
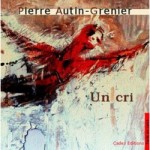 Pierre Autin-Grenier, Un cri, Cadex éditions, 2006
Pierre Autin-Grenier, Un cri, Cadex éditions, 2006
Faite en principe pour une lecture d’un instant, une vraie et bonne nouvelle se lit paradoxalement avec la lenteur savoureuse de la dégustation. Cette édition illustrée par Laurent Dierick, particulièrement soignée, met justement en valeur les qualités du texte.
Un cri est un récit bref qui prend son temps. Le cri en question est là dès le début, mais ce n’est qu’à la dernière ligne, au dernier mot que son mystère s’élucide, et encore… Le narrateur (un « nous » anonyme qui sollicite profondément le lecteur) a bien le dernier mot, mais ce dernier mot laisse à ce lecteur l’entière responsabilité de sa lecture. Entre temps, on fait la connaissance de Baptiste, paysan rude à la tâche, taciturne et bourru, qui mène la quête nocturne sur fond de ténébreuse terreur.
Chaque terme est à sa place, chaque phrase s’emboîte parfaitement dans une narration qui penche carrément vers la poésie : on entend le cri, on voit la lune et les étoiles, on devine les ombres des arbres, on perçoit même la sonorité des pas du « curieux cortège dans les profondeurs de quelque forêt fatale ».
De quoi rappeler que si la notoriété de Pierre Autin-Grenier repose sur ses récits, la valeur de ceux-ci repose sur la densité poétique de leur prose, sur ce que Dominique Fabre, dans la préface du présent opuscule, appelle la « langue riche et goûteuse » de cet écrivain « honnête homme et anarchiste », « inconsolable » et « comique », qui adopte volontiers et sans en avoir l’air une « posture de moraliste ». En somme, un écrivain marginal qui met la marge au cœur de nos préoccupations en nous menant quérir un cri poussé dans le lointain, au-delà des limites.
Jean-Pierre Longre
19:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, illustration, francophone, pierre autin-grenier, laurent dierick, cadex éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2010
Les secrets de la Messe en si
 Catherine Fuchs, La beauté du geste, Bernard Campiche Éditeur, 2010
Catherine Fuchs, La beauté du geste, Bernard Campiche Éditeur, 2010
Gianni Orsini, chef d’orchestre autour duquel tourne l’intrigue principale du roman, a comme suspendu son « geste ». Sa disparition laisse perplexe son entourage, parmi lequel les cinq héroïnes, qui ont toutes quelque chose à voir avec lui (musique, amour, rencontre de hasard…) et qui ont toutes à voir les unes avec les autres. Il y a donc Gianni, il y a Marianne, Isabelle, Tatiana, Katalin, Béatrice, et il y a Jean-Sébastien Bach, dont l’œuvre est « si puissamment rassurante », et envers qui Béatrice, entre autres, « se sent transportée de reconnaissance ».
Le roman de Catherine Fuchs, elle-même musicienne, est un concert. Les mots, « miraculeux assemblages qui exaltent le banal et disposent le merveilleux à hauteur d’homme », et les notes, qui n’expliquent rien mais dont la combinaison peut éclairer bien des choses, développent le même récit, suivent la même structure : celle de la fameuse Messe en si, avec ses cinq parties auxquelles correspondent les cinq sections du livre : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Le concert donné en la cathédrale de Genève est la caisse de résonance des souvenirs, des sentiments, des questionnements des protagonistes, interprètes ou auditrices, pour lesquelles les mots, dits ou tus, forment une chaîne traçant une continuité de l’une à l’autre. Continuité complexe, faite d’anticipations et de retours en arrière, de mouvements et tonalités divers, de reprises thématiques, par lesquels le lecteur, ne maîtrisant plus rien, ne peut que se laisser guider, comme par la musique.
Celle-ci permettra-t-elle de lever les mystères, celui de la disparition de Gianni comme ceux que chaque femme recèle en elle ? Au contraire, en augmentera-t-elle la puissance ? En tout cas, elle contient tout ce qui fait la vie, et ce que Marianne, chantant son dernier solo sur « Miserere nobis », évoque en son inconscient : « Prends pitié de toutes ces ébauches, de ces réconciliations impossibles, de ces amours inavouées, de ces timides amitiés, de ces jugements si vite définitifs ; regarde ces dévouements admirables, ces haines dévastatrices, ces promesses tenues, ces reniements quotidiens ».
Jean-Pierre Longre
07:35 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, catherine fuchs, bernard campiche Éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

