23/08/2010
Lire, relire... La tragédie et l’espérance, ou le roman d’une Rom
 Colum McCann, Zoli. Traduit de l’anglais (Irlande) par Jean-Luc Piningre, Belfond, 2007
Colum McCann, Zoli. Traduit de l’anglais (Irlande) par Jean-Luc Piningre, Belfond, 2007
Marienka Novotna, dite Zoli, restera pour toujours marquée par la tragédie inaugurale de son existence : le massacre de sa famille entière par les Hlinkas, ces fascistes qui dans les années 1930 en Slovaquie firent le lit des nazis. Seuls la petite fille de six ans et son grand-père échappèrent à la noyade sadique, et c’est ainsi que Zoli, sous la houlette du vieil homme sage et savant, commença une vie errante et exceptionnelle. Contrairement aux autres fillettes du peuple rom, elle apprit à lire et à écrire : « Très tôt, j’ai aimé tenir un crayon entre mes doigts ».
Après avoir survécu au nazisme, comment ne pas fêter dans les chants et la liesse la liberté apparemment revenue, Tziganes et « Gadje » au coude à coude ? Et Zoli, remarquée par le journaliste Stansky, séduite par l’idéaliste Stephen Swann venu s’installer dans la Tchécoslovaquie communiste et lui-même fasciné par la jeune femme, va devenir une idole officielle, applaudie par les foules et le régime bénissant ses poèmes qui chantent l’épopée rom :
« Lorsque la mort nous aura transformés en pluie,
Nous resterons au bord des nuages
Avant de continuer à pleuvoir.
Nous resterons dans l’ombre du chêne blanc
Où nous avons marché,
Pleuré, marché, au long des chemins. »
Mais lorsque le peuple errant, sédentarisé de force, fut parqué dans des « blocs » à la soviétique, Zoli, jugée coupable par les siens, trahie par son amour même, devenue paria chez les parias, fut de nouveau condamnée à la fuite, à la solitude, au calvaire et aux illusions. Franchir les frontières, traverser l’Europe, rêver de Paris, chercher refuge ici et là, rejetée par les siens et par les autres… Elle se fixera un jour, et elle pourra narrer à sa fille les péripéties de son existence : « C’est bien, ma fille, de pouvoir s’attendre aux surprises. […] Il est si étrange que ma vie soit arrivée si loin, mais je suis ébahie d’avoir découvert tant de beauté ».
Zoli, on s’en doute, n’est pas simplement un document sur la vie des Roms, ni une histoire de l’Europe ; c’est cela, et c’est bien plus : un roman, le roman d’une destinée certes représentative d’un peuple étrange, gênant et fascinant, mais d’une destinée à part, façonnée par la réalité des haines et la fluidité des rêves, par l’intransigeance de l’indépendance et la soumission aux sentiments, par l’obstination et l’ambiguïté. Un roman où, dans le va-et-vient historique, collectif et individuel entre les années 1930 et le début du XXIe siècle, la tragédie est inséparable de l’espérance : « J’ai gardé espoir jusqu’à la toute fin. L’espérance est une vieille habitude des Roms. Je ne l’ai peut-être jamais perdue ».
Jean-Pierre Longre
17:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, irlande, roms, colum mccann, jean-luc piningre, belfond | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/08/2010
Des conseils avisés
 Christian Cottet-Emard, Tu écris toujours ? Manuel de survie à l’usage de l’auteur et de son entourage, éditions Le Pont du Change, 2010
Christian Cottet-Emard, Tu écris toujours ? Manuel de survie à l’usage de l’auteur et de son entourage, éditions Le Pont du Change, 2010
« Pourquoi écrivez-vous ? ». La question est récurrente, et ne recevra jamais de réponse définitive, ni vraiment satisfaisante. Et par les temps qui courent, d’aucuns, dans leur caboche et même ouvertement, se demandent « pourquoi on peut se livrer à une activité aussi aberrante que l’écriture ». En l’absence donc de réponse, Christian Cottet-Emard se contente, si l’on peut dire, de donner des conseils aux écrivains.
Tout y passe, et tous sont concernés, de ceux qui sont « tentés par les prix et concours » à ceux « qui ont encore des amis non-écrivains et non-littéraires », en passant pas ceux « qui cherchent un emploi » (et « non un travail car tous les écrivains ont du travail »), ceux qui s’installent chez les « néo-ruraux », ceux qui sont « assignés à résidence » (d’auteur, évidemment), ceux qui cherchent une bourse, ou encore ceux qui se retrouvent sous le chapiteau d’une foire aux livres… Les anecdotes fourmillent, et l’on sent nettement pointer l’expérience de celui qui fait tout pour survivre dans un environnement hostile ou, au mieux, sceptique. Nous sommes là aux limites de la chronique autobiographique.
C’est enlevé, c’est drôle, c’est sincère. Pas d’amertume – ou s’il y en a, elle se cache sous l’humour et sous la satire. Le voisin, l’homme politique, le propriétaire de 4 x 4, le « grand écrivain », le structuraliste impénitent et quelques autres font les frais de la plume acérée de l’auteur, mais sans que celle-ci cède à la violence. Jean d’Ormesson et Philippe Sollers, par exemple, sont épinglés comme modèles des « écrivains qui veulent soigner leur image », aux antipodes de la modestie (vraie ? fausse ? entre les deux ?) de l’éternel inadapté qu’est celui qui aime, tout simplement et depuis l’enfance, raconter des histoires.
Tu écris toujours ? est le deuxième ouvrage publié par les éditions Le Pont du Change (après Simples choses de Roland Tixier). La création à Lyon d’une nouvelle maison d’éditions, ce n’est pas un mince événement. Écrivains ou non, profitons-en !
Jean-Pierre Longre
19:12 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, humour, francophone, christian cottet-emard, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Livres d’envergure en petit format
Fabio Pusterla, Histoires du tatou, traduit de l’italien par Mathilde Vischer
Friedrich Dürrenmatt, La panne, traduit de l’allemand par Hélène Mauler et René Zahnd
Minizoé, éditions Zoé, 2010
La caractéristique et l’avantage de la collection MINIZOÉ sont de présenter des textes de valeur en petit format, transportables et lisibles d’une traite, à n’importe quel moment. De grands auteurs de Suisse et d’ailleurs sont ainsi à la portée de tous : Nicolas Bouvier, Philippe Jaccottet, C.F. Ramuz, Robert Walser, Jean Starobinski, Jacques Chessex, Agota Kristof, Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Constant, Charles-Albert Cingria, et bien d’autres, dans tous les genres… Le seul embarras est celui du choix. Parmi les dernières livraisons, par exemple, nous trouvons un recueil poétique et une pièce de théâtre.
 Si vous n’êtes pas familier du tatou, ses Histoires racontées par Fabio Pusterla – en vers, s’il vous plaît, et en édition bilingue – ne vous diront pas grand-chose des mœurs animales de ce mammifère d’Amérique du sud à la carapace solide ; mais elles vous le rendront sympathique, cet amoureux des grands espaces, de l’eau, du vent et du vaste monde. Surtout, le tatou têtu, lecteur de Cervantès et poussant volontiers la chansonnette, « est un concept théorique ». Il est la figure du révolté, du rebelle, allant jusqu’au bout de son destin. Belle fable que celle du tatou, si proche de nous !
Si vous n’êtes pas familier du tatou, ses Histoires racontées par Fabio Pusterla – en vers, s’il vous plaît, et en édition bilingue – ne vous diront pas grand-chose des mœurs animales de ce mammifère d’Amérique du sud à la carapace solide ; mais elles vous le rendront sympathique, cet amoureux des grands espaces, de l’eau, du vent et du vaste monde. Surtout, le tatou têtu, lecteur de Cervantès et poussant volontiers la chansonnette, « est un concept théorique ». Il est la figure du révolté, du rebelle, allant jusqu’au bout de son destin. Belle fable que celle du tatou, si proche de nous !
La panne est en quelque sorte une autre fable, sous forme théâtrale. Friedrich Dürrenmatt, figure notoire de la littérature dramaturgique, met ici en scène une parodie de procès ; ou plutôt ce qui ressemble à une parodie, et qui est en réalité une recherche des crimes dont nous nous rendons coupables sans nous en rendre compte. Le jeu à l’intérieur du théâtre, le jeu de la vérité par l’illusion théâtrale. La progression dramatique est implacable, mâtinée d’humour noir et d’un sens aigu de l’absurde et du tragique. On respire quelque peu à la fin, mais on n’a pas la conscience tranquille…
de procès ; ou plutôt ce qui ressemble à une parodie, et qui est en réalité une recherche des crimes dont nous nous rendons coupables sans nous en rendre compte. Le jeu à l’intérieur du théâtre, le jeu de la vérité par l’illusion théâtrale. La progression dramatique est implacable, mâtinée d’humour noir et d’un sens aigu de l’absurde et du tragique. On respire quelque peu à la fin, mais on n’a pas la conscience tranquille…
Deux textes bien différents par la forme et par le sujet, mais qui ne laissent pas de répit au lecteur, puisque tout compte fait ils lui parlent de lui-même, comme le fait la vraie littérature.
Jean-Pierre Longre
19:07 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, théâtre, suisse, fabio pusterla, friedrich dürrenmatt, éditions zoé, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/08/2010
Mystérieuse et envoûtante
 Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine, traduit du roumain par Alain Paruit, P.O.L., 2006
Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine, traduit du roumain par Alain Paruit, P.O.L., 2006
À lire les premières pages, on aura tendance à se placer dans un décor typiquement parisien aux allures réalistes (le bistrot et ses habitués, le métro et ses faits divers, le Bois de Boulogne…). Plus loin, mais dans une vue rétrospective, on revivra les péripéties historiques de la chute du mur de Berlin et de l’agonie des régimes communistes. A vrai dire, au fil des pages, on sent bien qu’il ne s’agit pas de s’enfermer dans les stéréotypes rassurants et les scènes déjà connues et déchiffrées, qu’il ne s’agit même pas de suivre le déroulement narratif d’une histoire solidement racontée.
Car au milieu des pseudo réalités urbaines et européennes, au milieu de personnages dont la présence est apparemment fonctionnelle, tributaires et faire-valoir de l’héroïne (un bistrotier communiste et rêveur, un turfiste malchanceux, un Russe inquiétant, un peintre exigeant, un duo de philosophes allemands complices en tout, même en amour…), déambule la séduisante Ana ou Hannah, mystérieuse et envoûtante, liée à un invisible Mihai, blonde ou brune selon les pays, médecin ou infirmière, prostituée ou espionne, calculatrice ou naïve, dangereuse ou apeurée, amante fougueuse ou distante… Mythomane certainement, forgeant elle-même son mythe, selon la phrase de Novalis placée en exergue et revenant dans l’espace du récit : « La vie ne doit pas être un roman qui nous a été donné, mais un roman que nous avons fait nous-mêmes ».
Toutefois ce roman, le maîtrisera-t-elle jusqu’au bout ? Cherchant peut-être à leurrer les autres, ne se leurre-t-elle pas elle-même ? L’auteur nous laisse le privilège de l’imagination, un auteur qui est bien là, avec des intertextes plus ou moins voilés (Thomas Mann et quelques autres), des jeux plus ou moins explicites sur Elvire Popesco ou Ionesco, le marteau et la faucille, la vodka qui coule à flot dans les gosiers et fait parler « à brûle-pourpoint », et surtout les autoréférences : la présence d’Ed, jeune employé du bistrot, nous met sur la piste d’Ed Pastenague, anagramme de D. Tsepeneag, l’un et l’autre auteurs, sous un nom ou sous un autre, de romans et récits présents dans le texte (Pont des Arts, Attente, Roman de Gare, Hôtel Europa), d’un scénario de film résumé ici même. Jusqu’à l’obsession reviennent des leitmotive présents dans toute l’œuvre (un aigle en cage, une gare désertée, un sanatorium au-delà d’une forêt, les prénoms féminins Maria, Ana, Marianne, l’attente), le tout assorti d’une autodérision décapante, par exemple sur la Roumanie, « pays de tsiganes et d’escrocs », ou sur l’œuvre elle-même (Hôtel Europa défini comme un simple « thriller »)…
La Belle Roumaine n’est pas un roman ; c’est une multiplicité de romans en puissance : aventures, espionnage, amour, érotisme, politique, exotisme, philosophie, histoire se superposent, ou plutôt tournent autour d’un axe que l’on peut appeler – pour utiliser le nom d’un mouvement que Tsepeneag fonda autrefois avec quelques autres en Roumanie – onirisme. Les reprises, les répétitions d’événements, les épisodes cycliques, factuels ou imaginaires, le ressassement à caractère musical, tout cela relève de la préoccupation structurelle : « Le rêve ne peut pas être narré, on doit le présenter, le reconstituer, l’écrire, le récrire, le fabriquer de a à z. Le vrai songe, le songe nocturne, n’est pour la narration onirique rien de plus qu’un modèle. Il ne fournit que les lois et la structure, non la matière, c’est-à-dire le sujet… ». Comme tous les romans de Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine n’est pas un roman ; c’est un poème.
Jean-Pierre Longre
22:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, alain paruit, dumitru tsepeneag, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/08/2010
Transports en commun poétiques
 Marius Daniel Popescu, Arrêts déplacés, Antipodes, Lausanne, 2004.
Marius Daniel Popescu, Arrêts déplacés, Antipodes, Lausanne, 2004.
(Prix Rilke 2006)
Une fois n’est pas coutume : commençons par la fin. Il y a la table des matières, à elle seule tout un poème ; des titres en embuscade (« Bibelot en embuscade », comme le formule l’un d’entre eux), « petits grains » (autre titre dispersé çà et là) semés comme des énigmes et renvoyant à des textes aux allures de quotidien, de vie laborieuse, de vie de la rue, de vie familiale. Juste avant la table, il y a « Le tueur de livres », nouvelle-poème dans laquelle un lecteur impitoyable, qui expose dans son appartement les dépouilles de ses victimes, proclame que « n’importe qui peut comprendre qu’un livre peut brûler les gens ».
Marius Daniel Popescu est, nous dit-on, chauffeur de trolleybus ; profession rassurante, qui nous suggère qu’il ne brûlera ni ses lecteurs ni ses livres. Ses Arrêts déplacés, apparemment sortis tout chauds de ses observations, proposent de modestes scènes du théâtre intime et social, quelques images du passé (la grand-mère), beaucoup d’images du présent (le foyer, et surtout les gens qui montent dans le bus et en descendent, qui parlent et se dévoilent, ou qui demeurent dans le mutisme de leurs gestes). La vie est là : pas d’autobiographie dans ces poèmes, pas d’états d’âme de l’exilé venu de l’Est (si tant est que l’origine de l’auteur corresponde à ce que suggère la consonance de son nom), mais une biographie plurielle, visuelle et auditive, sensible et sentimentale, tendre et cruelle.
Certains textes sont des miniatures, décomposant la banalité des actes humains pour en extraire l’essence poétique, relatant en quelques phrases tel petit fait, telle conversation de coin de rue, telle confidence d’entre deux arrêts, tel rêve aussi qui vient colorer le réel citadin de visions oniriques et d’humour léger. D’autres utilisent le blanc de la page, en des figurations où le verbe s’associe au graphisme abstrait pour remplir l’espace, entre horizontalité et verticalité. Ailleurs encore, les mots se bousculent en collages, en listes, en inventaires compacts.
Je, tu, il, elle, tout se conjugue dans ces exercices de style pour faire accéder le lecteur à l’authentique métaphore, celle qui transporte littéralement et littérairement dans le secret des mots, secret qui, sous de discrètes notations et de simples constats, se cache au cœur de la poésie. « A la tombée du rideau », laissons l’auteur nous saluer :
« aujourd’hui tu dis au revoir aux lieux et aux gens,
tu dis au revoir au lac, à l’embarcadère et aux canards ;
tu démarres en avant, aujourd’hui tu oublies et tu gardes
une ligne de bus où le billet coûtait deux francs quarante
et la pluie était joyeuse et chaude et très marrante. »
Jean-Pierre Longre
14:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu, antipodes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/08/2010
L’Eau et le Feu
 Jacques Chauviré, La Terre et la Guerre, Le temps qu’il fait, 2008
Jacques Chauviré, La Terre et la Guerre, Le temps qu’il fait, 2008
Certains romanciers assaisonnés à la sauce médiatique actuelle devraient lire le discret docteur Jacques Chauviré (1915-2005), et particulièrement La Terre et La Guerre. Ils y verraient peut-être, s’ils en sont capables, comment un récit de fiction peut à la fois traduire et transfigurer la réalité, comment l’écriture peut investir événements et personnages, comment un vrai roman doit être une somme susceptible de planter dans l’esprit du lecteur les bouleversements du monde et des individus, et ainsi de bouleverser le lecteur lui-même.
La famille Calvière vit dans les Dombes, près de la Saône que l’auteur a bien connue et si bien évoquée dans d’autres livres. Du début à la fin de la guerre de 14-18, Jérôme et sa femme Lucie, leurs enfants Laurence, Jean et Amélie vont connaître et subir ce qu’ont connu et subi bien des familles françaises durant cette période : départs pour la guerre, blessures morales et physiques, deuils, changements imperceptibles ou éclatants dans la manière d’appréhender la vie. Chacun d’entre eux, chacun de ceux qui gravitent autour d’eux réagit à sa façon au désastre, et le couple Lucie – Jérôme est emblématique de ces écarts : la piété contre l’anticléricalisme, la rigidité morale contre l’humanisme, l’émotivité nerveuse contre le rationalisme… Chez d’autres, c’est la révolte (Amélie), la résignation (Laurence), la foi en l’avenir (Jean), le patriotisme exalté, la lâcheté inavouée, la ruse, l’égoïsme, la générosité, la peur, la honte, l’opportunisme, l’aveuglement, la lucidité, le repli sur soi ; et au fil des pages, nous recevons comme parties intégrantes du roman les discussions passionnées, les grands débats d’idées et les changements culturels décisifs (découverte de Freud et du rôle de l’inconscient, premiers pas de l’art moderne, progrès technologiques, popularisation du cinéma et de l’automobile…).
Voilà donc l’histoire de quatre années qui ont radicalement transformé la France et l’Europe, qui ont inauguré dans le sang l’ère contemporaine. Mais La Terre et le Guerre, même si l’on y suit les étapes de la grande boucherie, n’est pas un roman historique : on s’attache aux personnages et à leurs sentiments, à leurs haines, à leurs amours, on se prend à les aimer tels qu’ils sont, quels que soient leurs défauts. Cet attachement, que visiblement nous partageons avec l’auteur, est le fruit de son écriture : descriptions, dialogues, narration sont d’une précision incisive, un peu comme chez Maupassant ou Mauriac ; mais ils n’excluent ni l’ironie légère (contre les aberrations de la morale et de la société) ni le lyrisme – celui qui clame la souffrance et la mort des hommes, les éblouissements mortels de la guerre, celui qui chante la nature, la lumière humide des marais, le feu de bois dans la cheminée, la terre gorgée d’eau. Tout cela rappelle, si l’en était besoin, que Jacques Chauviré est un grand écrivain, et laisse espérer que l’on n’a pas fini de le (re)découvrir.
Jean-Pierre Longre
21:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jacques chauviré, le temps qu’il fait | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Comment effacer la vitre »
 Alain Gerber, Frankie, Le sultan des pâmoisons, Fayard, 2008
Alain Gerber, Frankie, Le sultan des pâmoisons, Fayard, 2008
On connaît l’érudition musicale d’Alain Gerber. On connaît les grands romans qu’il a consacrés au jazz et à certains de ses héros (Louis Armstrong, Chet Baker, Charlie Parker, Billie Holiday, Paul Desmond, Miles Davis…). Erudition et récit romanesque font encore bon ménage dans Frankie, dont l’auteur précise bien qu’il ne s’agit pas d’une biographie.
Effectivement. Le récit se fait portrait ; ou plutôt, les récits se font portraits : celui de Frank Sinatra, bien sûr, mais aussi – puisque, selon un type de composition maintenant bien ancré dans l’écriture de l’auteur, celui-ci donne la parole aux proches du héros – ceux des proches en question, triés sur le volet : Dolly, la mère aimante et décidée, Bernard « Buddy » Rich le batteur, Ava Gardner, pour qui il quitta la mère de ses enfants, Sam Giancana le mafieux. Autour de la vision que chacun offre de Sinatra, se dévoile en contrepoint plus ou moins délibéré la personnalité de chaque narrateur ; c’est ainsi que se dessine une rosace complexe et colorée, dans les courbes de laquelle on apprend beaucoup sur Frank (Frankie, Franco, The Voice, Z’yeux bleus, Le P’tit…), en particulier sur son opiniâtreté à croire au succès. Prêt à tout pour faire entendre sa voix dans les salles de concert et les studios d’enregistrement, il s’impose sans peur et sans regret, la violence (mafieuse ou non, à soi-même et aux autres, « directe ou par personne interposée ») faisant partie de son éducation et de son monde : « On a le droit de se battre, à condition d’avoir la garantie de l’emporter. Pour cela, il convient d’être le plus fort, par n’importe quel moyen. Un garçon qui respecte son orgueil ne lui laisse courir aucun risque ».
On en apprend beaucoup sur Frank et sur les autres, mais aussi sur l’histoire des USA ; car avec lui on est au centre des relations, par exemple, de la mafia avec J. F. Kennedy, dont on perçoit la vie dissolue ; ou bien l’on s’interroge sur la mort de Marilyn Monroe…
Mais le plus important est-il ce que l’on apprend, ou la manière dont on l’apprend ? Alain Gerber, comme de coutume, nous montre sans imposer, en son style impeccable dans l’allusif, plein d’échos mystérieux dans la clarté, audacieux dans le paradoxe : « Les gens font semblant d’être dupes. Francis Albert ne mange pas de ce pain-là : il s’est toujours montré sincère dans ses impostures. C’est pourquoi le remords n’a jamais eu raison de lui. C’est pourquoi il n’a jamais regretté ses regrets – l’une des formes subtiles de la trahison de soi-même ». Ces phrases qui privilégient la forme nous en apprennent plus sur le fond que n’importe quelle information « biographique » ; on pourrait en dire autant des images telles que celle, récurrente, de l’enfant derrière la vitre, contemplant le monde extérieur, espérant toujours que ce monde viendra à lui. La forme, toujours : celle d’expressions figées sans cesse renouvelées, comme pour signifier que le personnage ici fignolé ne serait rien, si, dans son exception même, il n’était pas représentatif de toute une gamme humaine : « Frank voulait mettre toutes les chances de son côté et ne craignait pas de mouiller sa chemise. Il était toujours sur la brèche. Il faisait feu de tout bois. Sautait sur les bonnes occasions ».
Frankie aurait pu s’appeler « Frank Sinatra et les autres » (reconnaissons-le toutefois : « Le sultan des pâmoisons », c’est beaucoup plus prometteur) ; comment être vu, entendu, reconnu, respecté, aimé par les autres : l’adulte comme l’enfant n’aura eu de cesse que de trouver « comment effacer la vitre » qui le sépare du monde.
Jean-Pierre Longre
21:49 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, fayard | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
L’inquiétante silhouette de Géraldine Bouvier
 Marc Villemain, Et que morts s’ensuivent, Éditions du Seuil, 2009
Marc Villemain, Et que morts s’ensuivent, Éditions du Seuil, 2009
Grand Prix de la SGDL 2009
C’est à la fois morbide et drôle, satirique et tendre, terrifiant et attachant. Onze nouvelles, onze héros (ou anti-héros) condamnés à toutes sortes de morts, selon des progressions différentes mais implacables, jusqu’à l’« Exposition des corps », sorte d’appendice pseudo réaliste résumant la biographie de chacun. Parmi eux, soit dit en passant, un certain Matthieu Vilmin, dont la minutieuse description de la souffrance ne peut résulter que de l’expérience personnelle d’un certain Marc Villemain ; une certaine M.D., aussi, écrivain de son état, dont les histoires « se finissent toujours mal ». Le double de l’auteur n’est jamais loin…
La diversité des noms, des situations, des conditions sociales est contrebalancée non seulement par l’unité des destinées ultimes, mais encore par la présence constante, notoire ou discrète, d’une dame Géraldine Bouvier, témoin impavide ou actrice décisive, dont la silhouette se glisse dans les récits comme celle d’Hitchcock dans ses films. Fil conducteur comme l’est la mort, bourreau involontaire ou juge sans indulgence, Géraldine Bouvier ne laisse pas d’intriguer voire d’apeurer, par sa présence à la fois unique et multiple.
Et que morts s’ensuivent se lit délicieusement au second degré, et c’est bien ainsi. Chaque détail biographique, chaque remarque ironique ou sarcastique, chaque procédé narratif est pesé au gramme près pour le plaisir masochiste, la délectation mortifère du lecteur. Le Grand Prix de la nouvelle, attribué récemment par Société des Gens de Lettres à l’auteur pour son recueil, est mérité.
Jean-Pierre Longre
21:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, marc villemain, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Saloperie d’existence »
 Jean-Pierre Martinet, Ceux qui n’en mènent pas large, Le Dilettante, 2008
Jean-Pierre Martinet, Ceux qui n’en mènent pas large, Le Dilettante, 2008
Sur la couverture du livre, un dessin de Tardi en noir et blanc campe non seulement l’atmosphère, mais, peut-on dire, la réalité de ce fulgurant roman désespéré : la tête entre les mains, un homme – Georges Maman, le (très) anti-héros – fait face à son imposant Frigidaire, que l’on devine aussi vide que le compte en banque de son propriétaire (il s’avérera qu’il n’est pas tout à fait vide, puisqu’il contient le dénouement du récit). Entre eux, quelques bouteilles de mauvais vin, une boîte de Canigou, le paysage déprimant d’une cuisine inutile.
Maman a pourtant connu une brève célébrité cinématographique et théâtrale, au temps où il semblait aimé de Marie Beretta, devenue vedette de papier glacé. De cette lointaine époque, il ne lui reste que la mémoire, les rêves et la présence à la fois haïe et recherchée de Dagonard, assistant à la télévision, et pour cette raison un peu moins démuni que son compagnon d’infortune. Ceux qui n’en mènent pas large raconte ainsi des heures nocturnes de déambulations, de perte de soi, de dégringolade, de larmes, d’hallucinations… Se réfugier dans l’alcool, dans le sommeil, dans les souvenirs illustrés par le grand écran, tout cela est-il utile ? C’est en tout cas le seul sursis, le seul moyen de nager sur les flots pourris de l’existence, un moment.
Le style de Jean-Pierre Martinet est parfaitement adapté aux êtres qu’il décrit, ces humbles ratés qui n’ont pas les moyens de se sauver du naufrage ; un style sans concessions, tout en violence et en émotion, qui frappa dur à la porte de notre indifférence. Il faut donc sauter sur l’occasion des rééditions qui sortent de l’oubli cet écrivain (1944-1993) qui fut assistant rélisateur, critique, marchand de journaux : Jérôme aux éditions Finitude, L’ombre des forêts à La Table Ronde et Ceux qui n’en mènent pas large au Dilettante ; et ne pas oublier de lire, à la fin de ce volume, « Au fond de la cour à droite », bel hommage de Martinet à Henri Calet, à « sa noirceur, sa dignité » ; Henri Calet, qui a dit l’essentiel : « Saloperie d’existence ».
Jean-Pierre Longre
21:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-pierre martinet, le dilettante | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Les dix-sept pieuvres du golfe de Guinée et leurs tentacules
 Raymond Queneau, Hazard et Fissile, Le Dilettante, 2008
Raymond Queneau, Hazard et Fissile, Le Dilettante, 2008
Raymond Queneau n’a pas dit son dernier mot. De nombreux textes élaborés ou non, achevés ou non dorment encore dans les cartons et les dossiers de ses œuvres complètes. Hazard et Fissile, roman inachevé, s’est donc réveillé pour le plus grand plaisir du lecteur curieux. Deux versions manuscrites non datées, dont la rédaction « semble remonter » à la fin des années 1920, selon ce que suggère Anne-Isabelle Queneau dans l’avant-propos (dommage qu’on ne puisse pas en savoir plus), donnent donc lieu au texte ici publié.
En 24 courts chapitres, nous tentons de suivre (en nous perdant avec délices, souvent) les aventures labyrinthiques non seulement des deux personnages choisis pour le titre, mais d’une multitude d’autres, qui se laissent guider de manière fluctuante par leur destinée aberrante, leurs choix inopinés, leurs décisions absurdes, leurs compagnons de déroute… et aussi et surtout par l’art consommé de l’auteur dans les domaines de la parodie, des jeux de langage, de la narration tortueuse, de la mise en scène insolite, de l’humour noir, de l’expression de l’absurde… Qui voudrait reconstruire l’échafaudage aurait du travail ; et tout autant qui voudrait déceler les éléments intertextuels. Car si Fantômas est au cœur de la mémoire du texte, la diversité des tons et des genres (dialogues, portraits, récits enchâssés, aventures exotiques, énigme policière, scènes épiques, poésie oratoire, images inattendues, adresses au lecteur) relève d’une réécriture on ne peut plus diverse.
A l’évidence, Queneau joue. Il joue avec les mots, les sons et l’orthographe, bien sûr (« claoun », Fissile et difficile, les vivres et les livres, le tabac et les rutabagas, « le Nain Jaune était vert », on en passe et des meilleurs – et parmi eux le goût pour les listes et les inventaires), il joue avec ses personnages, il joue avec le lecteur : à de nombreuses reprises, l’auteur passe la tête dans les interstices de la narration, des monologues ou des dialogues, et sollicite directement l’attention dudit lecteur, commentant la technique romanesque utilisée, avouant avec une feinte humilité son incapacité à « raconter une conversation », ou posant les questions qui le tarabustent : « Qu’attends-tu maintenant, lecteur à l’haleine tourmentée par les récits que tu viens de lire ? Que veux-tu que je fasse de ces personnages ramassés dans le sable un jour d’ennui et qui n’arrivent que péniblement à me distraire ? T’amusent-ils vraiment ? ».
A l’évidence aussi, nous retrouvons dans ce texte quelques-uns des motifs qui jalonnent l’œuvre quenienne tout entière : le cirque et la fête foraine, les déguisements et les masques, voire les bestioles du genre vers, scolopendres, poux… En plus grand format, ces animaux mystérieux qui étendent leurs tentacules dans tout le récit, les fameuses « pieuvres du golfe de Guinée », sur lesquelles le lecteur voudrait bien avoir plus de renseignements : « Tu désires peut-être que j’élucide tout le mystère que j’ai enroulé autour de mes chères pieuvres, comme le tonneau qui s’enroule autour du vin nouveau ? Mais c’est assez, et maintenant que je t’ai entraîné au milieu de cette page tu n’as plus qu’à suivre le dédale que je compose, tantôt avec peine et tantôt avec passion, avec les vingt-sept lettres de l’alphabet occidental ». Il le suit effectivement « tantôt avec peine et tantôt avec passion », le dédale, le lecteur… et il aurait aimé aller jusqu’au bout, s’il y en avait eu un. Qu’il se contente donc de jouir de ce que l’auteur lui a donné, et qu’il laisse courir son imagination.
Jean-Pierre Longre
18:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, raymond queneau, le dilettante | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Les deux sœurs
 Anca Visdei, L’exil d’Alexandra, Actes Sud, 2008
Anca Visdei, L’exil d’Alexandra, Actes Sud, 2008
Toujours ensemble, la devise des deux sœurs Popesco, est aussi le titre d’une pièce qui, depuis quelques années, est jouée dans plusieurs pays, parfois sous le titre de Puck en Roumanie. Le succès d’Anca Visdei, longuement mûri et largement justifié, est d’abord celui de son abondante œuvre théâtrale.
On ne s’étonnera donc pas de voir dans L’exil d’Alexandra, roman épistolaire, une sorte de mise en récit d’un dialogue aux accents dramaturgiques entre Alexandra et Ioana : la première a fui la dictature, la seconde, restée avec leur mère et leur grand-mère, tente tant bien que mal de se débrouiller dans le vide étouffant du règne de Ceausescu. Leur échange de lettres, sur une période de plus de 15 ans (avec une longue interruption) dit la tendresse, les anecdotes, les difficultés, les rancoeurs, les jalousies, l’amour de deux êtres qui voudraient ne rien se cacher, mais qui ne peuvent s’exprimer qu’à mots voilés : « Tante Prudence », l’odieuse et imbécile censure, veille, mais aussi, parfois, s’interposent les pudeurs et les remords… Cet échange dit aussi les métamorphoses de soi, ou plutôt du monde (« Je ne change pas. C’est la vie autour de moi qui change. Si on ne se durcit pas, on ne survit pas. Et c’est notre âge qui a changé »), la liberté retrouvée (« Dans mes rêves les plus fous, je n’espérais pas vivre ça »), mais la liberté trahie par une apparence de révolution, les faux-semblants politiques et les déceptions culturelles.
Le roman baigne entièrement dans le théâtre (et vice-versa). Alexandra et Ioana ont toutes deux, sous des aspects distincts et complémentaires (l’écriture, la scène), la même vocation, et c’est ce qui renforce leur complicité (leur rivalité parfois). Shakespeare et Puck, le lutin du Songe d’une nuit d’été, sont des points d’ancrage récurrents ; et assez naturellement, Alexandra se met à « tricoter une pièce à deux personnages, une pièce épistolaire dont tu devines les protagonistes » ; les lettres, la pièce, le roman (sans compter les éléments autobiographiques) : tout s’imbrique, dans une sorte de mise en abyme de l’expérience littéraire.
Autre fil conducteur, noué au précédent : la langue française, dont Alexandra fait peu à peu l’apprentissage, jusqu’à l’utiliser comme langue d’écriture littéraire, et comme langue maternelle de son fils. Apprentissage difficile : « Dire que j’ai choisi le français pour me faciliter la tâche ! Dès que j’ai une idée à exprimer, pas de problème, les mots sont là, limpides et précis. Mais dès que je m’attaque au moindre sentiment, le vocabulaire se dérobe. Pour traduire dor de tara, je n’ai trouvé que mal du pays. Et si on n’a précisément pas mal ? Si c’est plus insidieux que ça, précisément comme le dor ? Nostalgie, mélancolie, ça existe encore mais pour dor, cette tristesse de l’âme qui se languit, au-delà même de la souffrance, va chercher ». Il y a toutefois la volonté indéfectible de surmonter les obstacles, jusqu’au constat d’une maîtrise parfaite : au bout du compte, Ioana constate que les colères de sa sœur n’éclatent plus en roumain, mais bel et bien en français !
Au-delà du théâtre, de la langue, de l’écriture, c’est évidemment l’exil qui est au coeur de tout, le titre y insiste ; l’exil politique, géographique, linguistique, familial, sentimental… Mais le choix du genre, la subtilité et la limpidité de l’écriture, la profondeur et la complexité des personnages, l’imbrication de la narration dans l’histoire roumaine et européenne font de cet exil une richesse non seulement du point de vue littéraire, mais tout simplement du point de vue humain.
Jean-Pierre Longre
18:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, anca visdei, actes sud | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
La Grande Gidouille en minilivre
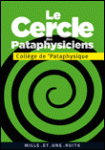 Collège de ’Pataphysique, Le Cercle des Pataphysiciens, Mille et une nuits, 2008
Collège de ’Pataphysique, Le Cercle des Pataphysiciens, Mille et une nuits, 2008
Pataphysiciens, nous le sommes tous, consciemment ou inconsciemment. « Science des solutions imaginaires » selon Alfred Jarry, « la ’Pataphysique est une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir », fait-il dire au Père Ubu. L’avantage, c’est que les définitions peuvent se multiplier et s’élargir sans préjudice pour ladite science (dont le nom, rappelons-le, doit s’orner d’une apostrophe initiale, alors que l’adjectif en est dispensé), au point que « le monde est dans toute sa dimension le véritable Collège de ’Pataphysique », ou que « la ’Pataphysique est une machine à explorer le monde ».
Mais les recherches ne doivent pas partir à vau l’eau, et le Collège est là pour régenter ce qui pourrait devenir, selon le vœu d’Umberto Eco, « la science des solutions inimaginables ». Le Collège de ’Pataphysique, fondé en 1948 (exactement le 1er décervelage 76 de l’ère pataphysique), est donc là, avec son immuable hiérarchie (dans l’ordre décroissant : le « Curateur Inamovible » - Jarry en personne -, le « Vice-Curateur » - chef suprême temporel - , puis les « Provéditeurs », « Satrapes », « Régents », « Dataires », et enfin les « Auditeurs » et « Correspondants »), ses « commissions », « sous-commissions », « intermissions », son Ordre de la Grande Gidouille, son Calendrier (qui commence à la Nativité d’Alfred Jarry), ses publications, ses membres…
L’objet du présent ouvrage est, en 120 pages, de donner au lecteur une idée de ce que sont les éminents membres du Collège de ’Pataphysique, dont la liste est fort longue, mais dont le choix, pour être judicieux, n’en est pas moins ici limité. Entre Alfred Jarry, qui ne connut jamais le Collège, mais en fut la cause inaugurale et illustre « patacesseur », et Sa Magnificence Lutembi, auguste crocodile du lac Victoria et « Quatrième Vice-Curateur », est répertorié un échantillon représentatif des sociétaires, avec leurs diverses occupations ((écrivains, peintres, actifs, oisifs), leurs diverses origines, leurs rangs divers. On apprend à mieux connaître, ou à pataphysiquement connaître, par exemple, Marcel Duchamp, Raymond Queneau (par ailleurs cofondateur de l’OuLiPo, qui n’est pas sans liens avec le Collège), Jacques Prévert, Boris Vian, Eugène Ionesco (dont l’élection à l’Académie Française ne contrecarra pas son appartenance au Collège de ’Pataphysique qui, déclara-t-il, « couronne toutes les académies passées, présentes et futures »), Jean Dubuffet, Fernando Arrabal… sans oublier le fameux Baron Mollet… Ajoutons que chaque notice a été rédigée par un membre du Collège (sous-commission du Grand Extérieur »), ce qui ne peut que mettre en confiance aussi bien le Patapysicien chevronné que le lecteur innocent qui, en quelques pages, a la possibilité de pénétrer dans le labyrinthe de la Gidouille. Il aura du mal à en sortir.
Jean-Pierre Longre
18:09 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, pataphysique, oulipo, Éditions mille et une nuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Juge et assassin sur la toile
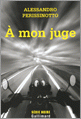 Alessandro Perissinotto, À mon juge. Traduit de l’italien par Patrick Vighetti, Gallimard, Série Noire, 2008
Alessandro Perissinotto, À mon juge. Traduit de l’italien par Patrick Vighetti, Gallimard, Série Noire, 2008
À l’instar de Meursault dans L’étranger, Luca a été poussé au meurtre comme malgré lui, dans un état second, pour un rien, une petite phrase prononcée par celui qui avait été son associé et qui l’avait trahi, ruiné, réduit à néant. Meurtre qui va le poursuivre, qui va l’obliger à fuir l’Italie pour la France, la Belgique, la Hollande… C’est en tout cas ce que nous devons croire, si nous-mêmes nous acceptons de le suivre dans le récit qu’il fait de ses tribulations de ville en ville à travers l’Europe, au cours desquelles la solitude et l’angoisse le disputent aux amitiés et aux amours de rencontre.
Mais la première personne qu’il veut persuader des raisons de son crime, auprès de laquelle il tente de se justifier tout en annonçant à plusieurs reprises qu’il tuera de nouveau, est son juge, « Madame le juge », avec qui il entame une correspondance électronique et qui va très vite jouer le jeu de cette correspondance quasiment intime. Le roman entier, jusqu’à l’adieu final, n’est constitué que de cet étonnant échange d’e-mails, marqué à la fois par la compréhension et l’incompréhension, la confiance et la défiance ; relation privilégiée, qui entraîne le lecteur vers une double identification, au juge et à l’assassin. Et voilà que comme le magistrat, il se met à se poser des questions, le lecteur : faut-il croire l’homme en fuite ? A-t-il vraiment subi ce qu’il prétend avoir subi ? S’est-il laissé piéger ou a-t-il piégé ? Se trompe-t-il ? Nous trompe-t-il ? Est-il bien là où il prétend être ?
Car Luca (adresse « angelo@nirvana.it »), informaticien hors pair, manie si bien les outils virtuels que le doute plane sur l’origine géographique de ses messages, et donc sur les informations qu’il y donne. En même temps, on se laisse volontiers prendre à ses aveux, à ses explications – et du statut de meurtrier il passe à celui de victime. Victime de la puissance économique, du pouvoir de la grande finance et de ses collusions avec le monde politique. Il reste pourtant dans cet univers des êtres doués d’humanité, des êtres simples et aimants, pour qui l’argent – qui souvent leur manque – n’est qu’un moyen d’existence. Mais survivront-ils au cynisme financier ? C’est la vraie question que pose le roman.
Jouant avec beaucoup d’habileté sur les potentialités du monde de l’Internet, tendant sur la toile mondiale les pièges de la virtualité, À mon juge se lit à des niveaux divers. Roman épistolaire d’aujourd’hui, roman policier, roman psychologique, roman social, roman politique… Comme les précédents ouvrages d’Alessandro Perissinotto, il s’agit là d’un roman au vrai sens du terme.
Jean-Pierre Longre
18:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alessandro perissinotto, À mon juge. traduit de l’italien par patrick vighetti, gallimard, série noire, 2008 | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Ce que nous dit le petit doigt de Caradec
 François Caradec, Le doigt coupé de la rue du Bison, Fayard Noir, 2008
François Caradec, Le doigt coupé de la rue du Bison, Fayard Noir, 2008
Il y a certes un « doigt coupé » de femme, dans ce faux roman policier (ou « rompol ») – et le commissaire Pauquet (« avec Pauquet, in the pocket ! ») est bel et bien chargé, à la suite d’obscures consignes ministérielles, d’enquêter sur ce mystère apparemment lié à des pratiques sectaires. Mais le titre ne dit pas tout, loin de là, et à mesure que l’intrigue (les intrigues) avance (nt), la comédie vire à l’évocation tragique du passé proche, celui de l’occupation et d’une diabolique invention nazie : le « Lebesborn » ou « source de vie », destiné à « créer la super-race nordique artificielle qui dominerait le monde pendant mille ans ».
Comment ces deux récits arrivent-ils à se superposer ? On le saura en allant jusqu’au bout de ce livre qui présente au demeurant bien d’autres intérêts. Caradec n’était pas à court d’inventions, et Le doigt coupé de la rue du Bison est comme une somme de ses talents divers : scènes de bistrot avec conversations tout azimut, jeux verbaux et orthographiques (en particulier dans la bouche d’un policier simplet), monologues induisant une pluralité de points de vue (celui d’un réfractaire au STO, celui d’une chienne, celui de la police etc.), dialogues à caractère théâtral, déambulations parisiennes, voyages lointains, inventaires en bonne et due forme… Sans compter que l’auteur nous fait rencontrer en personne quelques célébrités comme « Paul Léautaud assis sur un banc [du Luxembourg] à côté d’une jeune femme surveillant son bébé dans un landau », ou le baron Mollet sortant du Dôme « encadré par deux femmes élégantes » ; plus discrètement, par livres interposés, quelques autres comme Baudelaire, Jules Verne, Raymond Roussel, André Breton (dont les « Grands Transparents », apprenons-nous, sont en réalité une trouvaille de Victor Hugo) ; et aussi, à mots couverts et par allusions respectueuses, Raymond Queneau et sa bande, en un réseau serré de références qu’on serait bien en peine de déchiffrer intégralement.
Pataphysicien, Oulipien, biographe de Lautréamont, de Raymond Roussel, d’Alphonse Allais, de Willy, critique littéraire, essayiste, humoriste, François Caradec est mort en novembre 2008. Son ouvrage ultime est en même temps son seul roman : hasard ou préméditation ? À ce petit doigt malicieux, peut-être, de nous le dire.
Jean-Pierre Longre
http://www.oulipo.net/oulipiens/FC
P.S.: Le numéro 52-53 (décembre 2008) des Amis de Valentin Brû (Revue d'études sur Raymond Queneau) est intitulé Pour François Caradec. Sous la houlette de Daniel Delbreil, un hommage collectif accompagné de texte "inédits" et "déjà parus": avbqueneau@wanadoo.fr
18:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, françois caradec, pataphysique, oulipo, Éditions fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Mater dolorosa
 Marie Darrieussecq, Tom est mort, P.O.L., 2007
Marie Darrieussecq, Tom est mort, P.O.L., 2007
La mort brutale d’un enfant vécue, revécue, ressassée par sa mère peut-elle faire le sujet d’un roman ? Oui, lorsque ce roman relate la douleur universelle, la douleur folle de toute mère.
La narratrice, jeune épouse française d’un anglais qui, à cause de son travail, mène sa femme et ses trois enfants d’une extrémité à l’autre de la terre, de Vancouver à Sidney et Cambera, pourrait être toute mère endeuillée de n’importe quelle époque, de n’importe quel pays. Simplement, l’écriture est là, non pour purger l’être souffrant de son malheur, non pour lui procurer l’oubli et l’apaisement, mais pour lui permettre de rendre compte, de rendre des comptes à soi-même et, peut-être, aux autres.
La sphère infernale de la remémoration et du remords, d’un bout à l’autre de l’écriture, englobe tout, et les dernières phrases du livre, qui pourraient être une explication, ne dénouent rien ; au contraire, elles renvoient aux premiers mots déclencheurs : « Tom est mort. J’écris cette phrase ». Un peu comme dans certains récits de Marguerite Duras (mais avec la singularité de l’événement), les mots sont des cris, un seul cri trouant la surface des sentiments, les vidant de leur substance en une spirale sans fin. Les choses de la vie ne sont pas un recours : objets, déménagements, livres (y compris les grands auteurs, sauf peut-être Charlotte Delbo et Georges Perec), même les deux autres enfants, l’aîné et la benjamine (Tom était le cadet), même les proches – le mari traumatisé et aimant, les parents compréhensifs – , tout ce qui remplit l’existence quotidienne n’y peut rien. La mort de l’enfant fait qu’il sera toujours là, éternellement âgé de quatre ans et demi.
Tom est mort est un livre risqué pour l’auteur : risque humain de s’aliéner celles qui ont connu la pire des souffrances pour une femme : vivre la mort de celui à qui on a donné la vie ; risque littéraire de fabriquer de la mauvaise littérature avec un sujet grave. On peut dire que Marie Darrieussecq a composé là une œuvre littéraire vraie, en donnant à ses mots la mission de nous plonger au plus profond du cœur humain.
Jean-Pierre Longre
16:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marie darrieussecq, p.o.l. | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/08/2010
Attachants instantanés
 Paul Fournel, Poils de Cairotes, Le Seuil, 2004, réédition Points, 2007.
Paul Fournel, Poils de Cairotes, Le Seuil, 2004, réédition Points, 2007.
« Le Caire fabrique du discontinu, de l’alternatif ». Cette constatation énoncée dans sa préface, Paul Fournel l’a mise en pratique en couchant par écrit à chaque lever du jour, du 12 novembre 2000 au 25 juin 2003, telle anecdote, telle évocation, telle impression, tel témoignage de l’attaché culturel qu’il fut durant cette période dans la capitale égyptienne.
Destinés à l’origine à donner des nouvelles électroniques quotidiennes à ses correspondants lointains, ces brefs textes composent un livre pittoresque et fin, où le trait humoristique côtoie l’observation ethnographique, où la saynète comique voisine volontiers avec la scène tragique. Sous la plume à la fois tendre et distanciée, perplexe et compréhensive de l’auteur, la vie foisonnante de la mégalopole nous saute aux yeux et aux oreilles ; nous sommes, comme lui, plongés en plein dedans tout en conservant la position de celui qui contemple avec un sourire mi-ironique mi-complice. Les bruits incessants (klaxons, moteurs et cris divers), les mouvements en tous sens, les pauses étonnantes, les combines insoupçonnées, l’enfermement citadin et les échappées vers les espaces désertiques, tout y est.
Même les contradictions, celles qui caractérisent les pays où la tradition s’accommode sans états d’âme de la modernité – richesse incomparable. Les exemples pullulent, comme le savoureux récit de l’installation d’une antenne parabolique à minuit par des techniciens attendus depuis le matin et qui, avec « un beau rire égyptien », rétorquent aux protestations du narrateur : « Nous on travaille avec les étoiles ».
Grâce à la contrainte quasi oulipienne de l’écriture matutinale, c’est la poésie qui naît, sous la plume aimante et acérée de celui qui a su conserver l’art décrire sans complètement se perdre dans les méandres de la vie cairote.
Jean-Pierre Longre
17:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, paul fournel, oulipo, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/08/2010
Dans le secret des « armoires bleues »
 Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, P.O.L. / Imec, 2006
Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, P.O.L. / Imec, 2006
Il arrive que les dossiers de genèse, brouillons, avant textes et autres carnets préparatoires, souvent livrés maintenant à la légitime curiosité des lecteurs, ne donnent pas lieu à des publications passionnantes sur le plan littéraire ; ils restent dans ce cas des documents d’archive, témoignages de l’activité première d’un écrivain. Dans le cas des Cahiers de la guerre (ainsi nommés par Marguerite Duras elle-même), il y a plus : à en lire la plus grande part, on se sent déjà plongé dans l’atmosphère particulière des écrits élaborés, comme si la maturité de Marguerite Duras se dessinait dès les esquisses de Marguerite Donnadieu.
Les textes ici établis et présentés par Sophie Bogaert et Olivier Corpet constituent un choix judicieux dans les archives que Marguerite Duras a déposées, avant sa mort, à l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine). Leur composition s’est étalée entre 1943 et 1949. Quatre cahiers donc : le « Cahier rose marbré », qui est consacré d’une part à un récit autobiographique évoquant l’enfance et l’adolescence en Indochine, d’autre part à des ébauches de livres comme Un barrage contre le Pacifique (toujours lié au passé indochinois) ainsi qu’à des fragments narratifs situés au moment de la Libération et qui constitueront partiellement La douleur, cette pathétique relation de l’attente et du retour de camp de Robert Antelme ; La douleur, dont l’élaboration se poursuit dans le « Cahier Presses du XXe siècle » et dans le « Cahier de cent pages » ; le « Cahier beige », où l’autobiographie (la mort de l’enfant, des souvenirs d’Italie, la vie de la rue Saint-Benoît) côtoie les ébauches de fictions telles que Le marin de Gibraltar. Une dernière partie donne quatre textes autobiographiques (que les éditeurs datent de la fin des années 1930) et six nouvelles dont la tonalité annonce celle des Impudents et de La vie tranquille, les deux premiers romans de Marguerite Duras publiés en 1943 et 1944. De part et d’autre de cet ensemble, des reproductions de pages manuscrites assurent une émouvante matérialité à la production littéraire.
Rien n’est encore vraiment construit, tout est déjà là : le matériau, les faits, les mots, la fluidité, les heurts. La cruauté d’une enfance et d’une adolescence où les coups de la mère et du frère, où le désir d’aimer et le dégoût du premier baiser, où la solitude et la promiscuité constituent le socle d’une personnalité ; l’horreur de la torture, de l’attente et de la mort, la lutte pour le retour à la vie d’un rescapé (si peu rescapé) des camps nazis, l’espoir presque vain de l’amour… Et le ton ; le ton à la fois si prenant et si décalé, reconnaissable entre tous, les phrases dont l’harmonie est souvent rompue par une fissure, une faille, un trou, alors que la narration ressassante se creuse en introspection sans concessions.
« Je ne voudrais voir dans mon enfance que de l’enfance. Et pourtant, je ne le puis. Je n’y vois même aucun signe de l’enfance. Il y a dans ce passé quelque chose d’accompli et de parfaitement défini – et au sujet duquel aucun leurre n’est possible », écrit Marguerite Duras au début de « L’enfance illimitée ». Dans les « armoires bleues » de la maison de Neauphle-le-Château où étaient conservés ces cahiers, il y avait de même « quelque chose d’accompli ». L’écriture s’est élaborée dans ces textes de jeunesse, mais l’essentiel y était inscrit : la quête de la vérité indicible d’une vie où le « leurre » n’a pas sa place, où tout se joue à chaque rencontre, à chaque instant, à chaque mot.
Jean-Pierre Longre
18:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, francophone, marguerite duras, p.o.l. | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Enfant espiègle et poète chevronné
 Francis Blanche, Mon oursin et moi, Le Castor Astral, coll. « Les inattendus », 2005
Francis Blanche, Mon oursin et moi, Le Castor Astral, coll. « Les inattendus », 2005
Homme des canulars téléphoniques et de Signé Furax, des seconds rôles comiques et des sketches débridés, complice de Pierre Dac et humoriste au énième degré, Francis Blanche (1921-1974) est en outre (ou avant tout ?) un sacré poète. Mon oursin et moi le prouverait s’il en était besoin, dans la tonalité particulière que donnent à l’ensemble les derniers vers du premier texte en forme d’autoportrait (qui prête son titre au recueil) :
« ce garçon est vraiment très bien
il réussit à être drôle
avec un oursin dans la main ! »
Francis Blanche est un mélancolique révolté (ou l’inverse), un idéaliste déçu, un clown en rupture de modernisme, qui rêve sa vie « les yeux grands ouverts » et chante les pleurs que les hommes suscitent en se faisant la guerre et en fabriquant des machines de mort, cette mort que l’on rencontre au coin des vers et dont les joies de l’enfance ne peuvent effacer l’obsession. Du lyrisme donc, entre chanson et poésie savante, agrémenté de pirouettes diverses (une belle et tendre évocation de la campagne, par exemple, pour rappeler l’essentiel : « Mais ramène surtout du beurre… et des œufs frais »), de jeux sonores et verbaux, de parodies et de calembours dont certains sont restés fameux (« Pour que l’école dure / amis, donnez ! »), dont d’autres concilient technique et rhétorique oratoire (« Mon Dieu qu’elle est polie Esther ! / Mon Dieu comme il est fort Mika ! »).
Aucune concession à la facilité dans ces textes où se côtoient et se recoupent l’absurde et le rire, le sourire et le désespoir. Francis Blanche n’hésite pas à se plier aux contraintes formelles, et la force de ses vers est d’autant plus efficace qu’elle se coule dans les formes traditionnelles : la fable dont la moralité ne laisse jamais indifférent, le bestiaire dont la fantaisie peut confiner au surréalisme, parodie et hommage confondus, le sonnet virtuose, le conte en vers et même l’acrostiche, le tout entrelardé de proverbes détournés mêlant la densité du haïku, le ludisme du choc verbal et la profondeur existentielle… Quelques exemples ? « Qui rit vendredi boira quarante jours plus tard » ; « La caravane passe… les aigris restent »… Et si par hasard quelques mauvais coucheurs mettaient en doute le talent littéraire de l’auteur, ils ne pourraient nier son acuité de lecteur : les allusions plus ou moins voilées aux grands anciens, La Fontaine, Rutebeuf, Apollinaire, Saint John Perse, Mallarmé et une ribambelle d’autres fondent l’écriture sur une culture de véritable érudit. Patrice Delbourg qui présente le volume, Armand Lanoux, Jean-Marie Blanche et Evelyne Tran qui signent les postfaces ne s’y trompent pas.
Voilà une édition sérieuse (d’ailleurs Francis Blanche en avait lui-même choisi les textes), utilement complétée par une biographie et une bibliographie, pour un faux naïf et un vrai écrivain qui faisait tout pour qu’on ne le prenne pas au sérieux, en toute lucidité :
« Ça ne tourne pas rond dans ma petite tête
Des fois j’ai des drôles
D’idées
C’est pas ma faute mais quand je m’embête
Faut que je fasse
Des conneries ».
Jean-Pierre Longre
18:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, francis blanche, le castor astral | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/08/2010
Le goût de la reprise
Dany Laferrière, Je suis fatigué, Typo, 2005.
Vers le Sud, Grasset, 2006
 Dany Laferrière se dit fatigué, et voilà qu’à deux mois d’intervalle il publie deux livres. Certes, l’un est la réédition, revue et augmentée, d’un recueil paru en 2001 chez Lancrôt (à Montréal, déjà), et l’autre un ensemble de récits (réunis sous l’appellation générique de « roman », confirmant leur unité de ton, de lieu et de sujet), dont quelques-uns ont servi de scénario au film de Laurent Cantet. Gageons que si la fatigue de l’auteur est sincèrement proclamée, elle n’est pas stérile.
Dany Laferrière se dit fatigué, et voilà qu’à deux mois d’intervalle il publie deux livres. Certes, l’un est la réédition, revue et augmentée, d’un recueil paru en 2001 chez Lancrôt (à Montréal, déjà), et l’autre un ensemble de récits (réunis sous l’appellation générique de « roman », confirmant leur unité de ton, de lieu et de sujet), dont quelques-uns ont servi de scénario au film de Laurent Cantet. Gageons que si la fatigue de l’auteur est sincèrement proclamée, elle n’est pas stérile.
C’est d’ailleurs ce dont semble le persuader son éditeur, dans l’avant-propos plein d’humour de Je suis fatigué : « Quand il n’y a plus rien à dire, tu me conseilles de redire ? » Et qu’il redise ou qu’il ajoute, c’est toujours un régal pour le lecteur ; en douze chapitres (depuis « Le parc » jusqu’à « Un monde sec » – toute une géographie littéraire), se succèdent anecdotes, réflexions, dialogues avec soi-même, monologues, humeurs, souvenirs… Le tout, flottant sur une écriture limpide, navigue entre les trois villes où Laferrière a vécu, où il vit encore simultanément, par la présence physique ou mentale : « Port-au-Prince occupe mon cœur. Montréal, ma tête. Miami, mon corps. […] Moi, je ne quitte jamais une ville où j’ai vécu. Au moment où je mets les pieds dans une ville, je l’habite. Quand je pars, elle m’habite. » Pot-pourri, « pot-au-feu », comme le dit l’auteur, Je suis fatigué est un livre bouillonnant, dont le fumet tient ses promesses : une fois qu’on a soulevé le couvercle, on ne peut pas se lasser d’y goûter, même à brèves lampées.
 La lecture de Vers le Sud est un autre type de consommation. On y retrouve bien sûr la prédilection pour le lapidaire, puisqu’il s’agit là encore d’un ensemble de textes relativement brefs, mais dont l’assemblage, clairement narratif, est plus visiblement cohérent, autour du personnage de Fanfan, jeune « faune » à la peau noire d’Haïti. Tout se passe dans la chaleur sensuelle de l’île, où s’affrontent, s’attirent en des relations irrésistibles et passionnelles les corps blancs (souvent ceux de femmes en mal d’amour) et les corps noirs (ceux de jeunes garçons en quête de reconnaissance et d’argent). Le sexe a ses exigences, mais aussi la vie, tout simplement, avec ses évidences et ses mystères, les manques et les besoins du corps et du cœur ; et il y a ce Sud obsédant, avec la clarté de la mer, de la terre et du ciel, avec ses nuits torrides et angoissantes, avec son présent où se côtoient sans vergogne l’amour et le commerce, avec son passé colonial qui ressurgit lorsqu’on nous rappelle que pour un Noir, le corps blanc, même si on s’en éprend, reste encore « la chair du maître ».
La lecture de Vers le Sud est un autre type de consommation. On y retrouve bien sûr la prédilection pour le lapidaire, puisqu’il s’agit là encore d’un ensemble de textes relativement brefs, mais dont l’assemblage, clairement narratif, est plus visiblement cohérent, autour du personnage de Fanfan, jeune « faune » à la peau noire d’Haïti. Tout se passe dans la chaleur sensuelle de l’île, où s’affrontent, s’attirent en des relations irrésistibles et passionnelles les corps blancs (souvent ceux de femmes en mal d’amour) et les corps noirs (ceux de jeunes garçons en quête de reconnaissance et d’argent). Le sexe a ses exigences, mais aussi la vie, tout simplement, avec ses évidences et ses mystères, les manques et les besoins du corps et du cœur ; et il y a ce Sud obsédant, avec la clarté de la mer, de la terre et du ciel, avec ses nuits torrides et angoissantes, avec son présent où se côtoient sans vergogne l’amour et le commerce, avec son passé colonial qui ressurgit lorsqu’on nous rappelle que pour un Noir, le corps blanc, même si on s’en éprend, reste encore « la chair du maître ».
Deux livres différents quant à l’atmosphère, quant à la portée aussi, personnelle ou romanesque ; deux livres qui pourtant peuvent se lire coup sur coup ; deux livres qui, malgré les dénégations de l’auteur, en appellent d’autres.
Jean-Pierre Longre
22:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, essai, francophone, dany laferrière, typo, grasset | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Méandres et secrets
 Laurent Mauvignier, Seuls, Les éditions de Minuit, 2004
Laurent Mauvignier, Seuls, Les éditions de Minuit, 2004
Pour vraiment parler du roman de Laurent Mauvignier, il faudrait analyser ce qui fait la spécificité de son style. Et pour analyser cette spécificité, il faudrait pouvoir rendre compte des méandres de la syntaxe se heurtant à l’abrupte verticalité d’un mur de silence ou d’un abîme de confusion, pouvoir rendre compte du suspens des phrases, du heurt des mots, bref d’une écriture qui se coule dans le moule de l’émotion obstinée, ressassante et redondante, qui s’y coule le plus entièrement possible, ne laissant pas un recoin vide, permettant au lecteur de pénétrer au plus intime de l’intimité des personnages. Un exemple entre tous :
« Il m’a regardé dans les yeux et il a dit, papa, tu sais ce qu’elle n’a pas deviné, jamais, c’est que, c’est seulement que,
et sa voix tout à coup s’est tue, coupée par une sorte de hoquet et de tic sur la lèvre […] ».
Ce que Tony n’arrive pas à dire, pour l’instant, à son père, et qu’il n’arrivera jamais à dire à Pauline son amie de toujours, c’est qu’il l’aime d’amour, et c’est ce qu’apparemment elle se refuse à comprendre. Étudiants, ils ont habité, bu et mangé ensemble, elle est partie en Amérique, il a arrêté ses études et pris un petit boulot, elle est revenue faire appartement commun avec lui en attendant autre chose, ayant quitté Guillaume son compagnon d’Amérique, et lui, Tony, oscille entre deux désirs contradictoires, dire l’amour et le cacher ; deux désirs qui sont aussi deux peurs : « Il a eu peur de ce regard qu’ils ont partagé et peur aussi qu’elle connaisse ce regard, que cette tension dans le regard Pauline l’ait reconnue comme elle l’avait vue déjà tant de fois sur les visages des hommes au moment où ceux-là vont basculer dans la gravité, quand ils vont parler d’amour et d’engagement, se préparer à offrir des bijoux et cette fidélité à laquelle le plus souvent ils manqueront, par ennui plus que par désir ». L’amour, les mots ne viennent pas pour le dire, les gestes artificiels, les attitudes fausses s’empressent de le cacher.
Á qui, à bout de forces et de grimaces, va-t-il pouvoir se confier ? Á son père, dont pourtant (ou est-ce une bonne raison ?) un contentieux pathétique et secret le sépare. C’est par ce père que nous, lecteurs, connaissons le drame de Tony, drame qui va se précipiter lorsque Pauline, en un accès de joie, va retomber dans les bras de Guillaume venu la retrouver, ultime personnage et ultime narrateur. Et c’est par ce père encore que Pauline va savoir, avec les mots qu’il doit pouvoir trouver.
Ils sont seuls. Tony avec son amour et son mutisme, Pauline avec son amitié et son refus, mais aussi le père avec ses secrets et sa douleur, Guillaume avec sa vie et ses remords, et finalement le lecteur lui-même, sollicité par la présence oppressante des personnages et de leurs énigmes, sollicité aussi par le « c’est moi » des narrateurs, dressant entre lui, le lecteur, et eux, les êtres fictifs, l’épaisseur d’un récit qui pourrait aussi bien être un miroir. Ils sont seuls, de cette solitude envahissante que fait couler en nous le courant irrépressible du soliloque.
Jean-Pierre Longre
http://www.leseditionsdeminuit.com
19:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

