13/08/2025
« Ne pas tomber »
 Neige Sinno, Triste tigre, P.O.L., 2023, Folio, 2025
Neige Sinno, Triste tigre, P.O.L., 2023, Folio, 2025
Prix Femina 2023, Prix Goncourt des Lycéens 2023
Entre 7 et 14 ans, Neige a été violée par son beau-père d’une manière systématique, presque quotidiennement, sans que personne le sache. Jeune adulte, elle finit par porter plainte avec l’aide de sa mère à qui elle a tout raconté, et l’homme, qui reconnaît les faits, « comme s’il cherchait à se confesser », est condamné à neuf ans de prison – après quoi il se forgera une nouvelle vie, fondant une nouvelle famille. Neige, quant à elle, va faire des études, une thèse en littérature, et vivre au Mexique avec son compagnon et sa petite fille. Passé la quarantaine, elle publie Triste tigre.
 Voilà pour l’affaire, succinctement résumée. Un énième livre autobiographique sur l’inceste et le viol, et sur leurs conséquences ? En quelque sorte, mais avec beaucoup plus que cela. Car il y a tout le reste, tout ce que l’autrice cherche au-delà des faits. Dans cette tâche, elle sollicite l’aide de références littéraires – Lolita de Nabokov, L’Œil le plus bleu de Toni Morrison, Le Voyage dans l’Est de Christine Angot, Souvenirs de la Kolyma de Varlam Chalamov, bien d’autres encore, comme des supports sur lesquels s’appuyer, grâce auxquels se rassurer. Car comment vivre après cela ? « On ne peut pas se relever et se défaire de quelque chose qui nous constitue à ce point. Le monde entier est perçu à travers ce filtre. Pour celui qui n’a connu que cela, c’est depuis l’oppression que tout s’organise. Il n’existe pas un soi non-dominé, un équilibre auquel on pourrait retourner une fois la violence terminée. » Alors on cherche la « vérité » par la dénonciation, mais « Il faut être prêt à perdre beaucoup de choses quand on décide de parler. On perd sa famille, c’est évident, on perd son village aussi, on perd son enfance, ses souvenirs d’enfance, ses illusions d’enfance. »
Voilà pour l’affaire, succinctement résumée. Un énième livre autobiographique sur l’inceste et le viol, et sur leurs conséquences ? En quelque sorte, mais avec beaucoup plus que cela. Car il y a tout le reste, tout ce que l’autrice cherche au-delà des faits. Dans cette tâche, elle sollicite l’aide de références littéraires – Lolita de Nabokov, L’Œil le plus bleu de Toni Morrison, Le Voyage dans l’Est de Christine Angot, Souvenirs de la Kolyma de Varlam Chalamov, bien d’autres encore, comme des supports sur lesquels s’appuyer, grâce auxquels se rassurer. Car comment vivre après cela ? « On ne peut pas se relever et se défaire de quelque chose qui nous constitue à ce point. Le monde entier est perçu à travers ce filtre. Pour celui qui n’a connu que cela, c’est depuis l’oppression que tout s’organise. Il n’existe pas un soi non-dominé, un équilibre auquel on pourrait retourner une fois la violence terminée. » Alors on cherche la « vérité » par la dénonciation, mais « Il faut être prêt à perdre beaucoup de choses quand on décide de parler. On perd sa famille, c’est évident, on perd son village aussi, on perd son enfance, ses souvenirs d’enfance, ses illusions d’enfance. »
La deuxième partie du livre, « Fantômes » (la première s’intitule « Portraits ») entame une série de réflexions « trente ans plus tard » sur les conséquences du crime, la honte, les amalgames, le normal et l’anormal, et aussi sur le « comment écrire » à ce sujet. Faire de la littérature, afin de « transcender » « la simple et vulgaire expérience » ? « Mais, d’un autre côté, faire de l’art avec mon histoire me dégoûte. » L’essentiel ? Témoigner pour tenter de dire l’indicible, et, selon les derniers mots du livre, pour « ne pas tomber. » En l’occurrence, le témoignage est à la fois prenant, sombre et éblouissant.
Jean-Pierre Longre
10:17 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : témoignage, autobiographie, francophone, neige sinno, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/11/2024
La puissance onirique de la littérature
 Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024
Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024
Dans les années 1960, Dumitru Tsepeneag, avec quelques compagnons dont Leonid Dimov et Virgil Tanase, fonda à Bucarest le « groupe onirique », lieu de débat intellectuel, esthétique, littéraire se situant aux antipodes du totalitarisme pesant sur la Roumanie à cette époque. Il ne s’agissait pas de revenir aux conceptions romantiques ou surréalistes du rêve, mais de s’appuyer sur ses « critères » et son fonctionnement pour créer un nouveau réel littéraire. Les apparences du rêve, sa complexité, les retours d’images et de thèmes, les obsessions qu’il véhicule caractérisent ainsi les œuvres « oniriques », et les nouvelles rassemblées dans Mise en scène, composées à la fin des années 1960, qui n'ont pu être publiées qu’après 1989 et viennent d’être traduites en français par Nicolas Cavaillès, en sont un beau témoignage.
Le recueil est composé de onze textes qui, s’ils sont d’inégale longueur et abordent des thèmes variés, entrent en résonance les uns les autres grâce à une écriture portée par les caractéristiques structurelles du rêve et de ses apparences absurdes. Construire une montagne infinie de chaises ou creuser des fosses insondables, se laisser accaparer brutalement par une sorte de secte ou faire difficilement monter un âne dans un camion pour fuir avec lui, laisser pleurer un être étrange enfermé dans une armoire ou accueillir un petit homme grelottant de peur et de froid, se confronter à de multiples miroirs que l’on voudrait briser comme pour occulter l’image de soi ou partir dans un bateau en papier sur une « mer de sang », emmener une foule disparate sur un miroir piégé ou laisser un bel homme se faire étouffer par des serpents… Quelques mots ne suffisent évidemment pas à donner une image fidèle de la forme, du fond et de la dimension de ces textes.
Reste la longue nouvelle centrale, celle qui donne son titre au recueil, un titre annonçant une plongée dans le théâtre. Oui, le théâtre est bien là, donnant à la nouvelle une dimension scénique, avec des personnages, un auteur – metteur en scène, un va-et-vient entre le « réel » du récit et celui de la scène qui souvent se confondent, sans que l’on sache toujours ce qui relève de la réalité et de la fiction narratives, ce qui relève de la vérité et du mensonge, du « Theatrum mundi » et de la « mise en scène », de la présence de l’Auteur et de l’imposture. « Soit dit entre nous, tout ça, tous ces trucages, c’est bon pour le théâtre, ou pour le cinéma, encore mieux, mais ça n’a rien à voir avec la réalité. Des trucages ! […] Tout est fondé sur la suggestion. Vous comprenez, camarade colonel… Voilà le théâtre moderne : une métaphore incarnée puis commentée, destruction de la rampe, des coulisses… Une révolution complète ! » Antithèse du « réalisme socialiste », le récit / théâtre en profite pour d’adonner, en toute lucidité, à la satire profonde et métaphorique d’un régime fondé sur le mensonge et de ses sbires, ainsi qu’à une reprise parodique de la mort et de la résurrection du Christ, « l’Auteur » cloué sur sa chaise puis réapparaissant sous l’aspect du « Milicien » acclamé par le public…
Cette publication de textes anciens ajoute une étape importante au cheminement de l’un des plus importants écrivains roumains (ou franco-roumains) contemporains, et plus généralement à la puissance onirique de la littérature.
Jean-Pierre Longre
09:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/05/2023
« Voir un peu de la vraie vie »
 Paul Fournel, Le Livre de Gabert, P.O.L., 2023
Paul Fournel, Le Livre de Gabert, P.O.L., 2023
C’est à Chamoison (village imaginaire mais conforme à la réalité), en Haute-Loire (département bien connu de Paul Fournel) que Gabert, écrivain ventru lassé de Paris et des prix à payer pour y survivre, s’est retiré pour « écrire à pas cher » et développer son imagination pleine de visions fantastiques et monstrueuses. Sa vie s’organise, entre l’écriture nocturne de « polars ruraux » et la fréquentation progressive des gens du village, dont il découvre bon gré mal gré les habitudes, voire les petits secrets. Il fera même un peu l’écrivain public bénévole pour des courriers administratifs ou des lettres d’amour. Lors de ses déjeuners quotidiens dans le bistrot de Tréport, il rencontre les hommes importants du village jouant à la belote, discutant foot et télé… Côté féminin il y a Lune, qui fréquente assidûment les mâles et qui aime se promener dans la campagne avec Gabert, Lola, la voisine éleveuse de brebis et sa fille Magali, une Zazie rurale, qui vient très souvent au logis de Gabert se faire raconter des histoires.
Il faut dire que l’auteur a de la suite dans les idées et le sens du pittoresque humain. On retrouve dans Le Livre de Gabert des personnages bien connus des lecteurs de Paul Fournel : la grosse Claudine et ses propos acerbes, la veuve Waserman qui habite dans son garage, les frères Bandelmas et leur manège, d’autres encore, croisés dans Les grosses rêveuses, Foraine et ailleurs. Une vraie Comédie Humaine… Et puis, très important : Gabert retrouve Jeune-Vieille (Geneviève), amie d’enfance et collègue en écriture, qui fut la protagoniste d’un roman précédent – où d’ailleurs nous croisâmes Gabert. Ils se revoient à plusieurs reprises, passent ensemble de beaux moments d’amour, et parlent livres et éditeurs.
Car le roman est pour Paul Fournel une nouvelle occasion (sinon le propos essentiel) de nous faire pénétrer dans le monde mystérieux de l’édition. Écrire des romans noirs à petit succès, cela va un moment ; mais Jeune-Vieille est persuadée que son ami peut aller plus loin. Tandis qu’elle va chercher la gloire ailleurs, elle le confie à Robert Dubois, éditeur à l’ancienne, comme on l’a su dans un roman précédent, La Liseuse : « Geneviève m’a conseillé de te lire et de te faire écrire le contraire de ce que tu écris pour te tirer hors de tes routines et t’aérer la tête. Elle est sûre que tu caches un bon livre quelque part en toi et que tu dois le faire sortir. « Un livre d’amour », m’a-t-elle dit, le livre de Gabert. » On ne le connaîtra pas, ce livre ; on saura seulement qu’il l’écrira le jour, contrairement à ses romans noirs, et qu’il s’agira de « raconter juste ce qu’il voit, repousser ce qu’il imagine. » « Voir un peu de la vraie vie. Pendant trop longtemps, il n’avait pas su débusquer le mouvement dans l’immobilité, traquer le bruit dans le silence. Et puis, peu à peu, c’est ce monde qu’il ne voyait pas qui est venu se construire et s’imposer dans son livre. » Pour peu, on dirait bien que Le Livre de Gabert est « le Livre de Fournel ».
Jean-Pierre Longre
18:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, paul fournel, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/08/2021
« Personne n’est à l’abri du succès »
 Paul Fournel, Jeune-Vieille, P.O.L., 2021
Paul Fournel, Jeune-Vieille, P.O.L., 2021
Paul Fournel connaît bien le monde de l’édition, et Jeune-Vieille, comme une suite de La liseuse et de Jason Murphy, toujours dans le registre romanesque, en témoigne avec empathie et humour. Geneviève (qu’un camarade de classe original, Gabert, surnomme « Jeune-Vieille »), passionnée de cinéma et de littérature, rêve d’écrire. Au grand dam de sa mère, elle entame des études de Lettres, fréquente un groupe de jeunes gens intéressés par la littérature, fait les belles découvertes d’une vie estudiantine… Ses premières vraies pages, elle les écrit un matin pour faire passer un mal de ventre, et ça marche. Certes, c’est encore de l’amateurisme : « J’ai écrit une dizaine de pages en poussant devant moi des personnages imaginaires comme des troupeaux d’oies, sans vraiment savoir ce que j’écrivais ou ce que je désirais écrire au moment où je le faisais. » (allusion malicieuse à Raymond Queneau, que Paul Fournel connaît bien aussi…).
Et tout s’enchaîne. « Un matin de juillet 1986 », une simple petite idée lui fait commencer un roman, qu’elle tape en continu sur la machine à écrire Valentine offerte par son père, puis, offert par le même, sur un Macintosh. Rupture avec Marc, le petit ami, changement d’apparence, manuscrit porté chez quatre éditeurs, une lettre de refus, et enfin un rendez-vous donné par Robert Dubois, un éditeur à l’ancienne, un vrai, qui aime la littérature, ses auteurs, la bonne chère et les avertissements en forme de paradoxe, du genre : « N’oublie jamais que tout peut arriver dans ce métier et que personne n’est à l’abri du succès. »
Elle publie donc son premier livre, puis les suivants sous la houlette bienveillante et exigeante de Robert, tout en menant une « double vie » ; sa réalité d’épouse et de mère, et les évasions romanesques guidées par l’imaginaire. Des articles dans la presse générale ou spécialisée, des signatures un peu erratiques dans des salons du livre, un succès d’estime. Comme le lui dit son camarade Gabert, qui donne dans le « polar rural » et qu’elle a retrouvée lors de ces signatures : « Les ventes, c’est plutôt comme le Loto, un coup tu gagnes, mille coups tu perds. C’est le gâteau sous la cerise. […] Le succès, c’est la cerise. » Un jour, elle va se laisser séduire par les promesses du président d’un puissant groupe éditorial, un fort bel homme, d’ailleurs, ce président hyperaffairé, toujours entre deux avions, qui lui annonce des dizaines de milliers de ventes pour son roman, et au bout du compte une adaptation cinématographique. Et c’est l’engrenage.
Elle a bien sûr le sentiment d’avoir trahi Robert Dubois, qui apparemment ne lui en veut pas, ou voit cela d’un œil ironique et désabusé. Mais quand même il y a le succès, le vrai ! « Ayant été adoubée par la télé, Geneviève changea de camp et appartint à la race des seigneurs. Elle se retrouvait de façon systématique dans cette cohorte d’écrivains qu’on promène chaque week-end comme une colo, de fête du livre en fête du livre, pour les asseoir derrière les tables dans la cohue, mais cette fois avec une file de lecteurs qui l’attendaient pour faire signer leur livre et qui l’avaient vue dans le poste. » Et il y a le tournage du film, qui va peut-être lui ouvrir les yeux. On laissera au lecteur le soin de découvrir le dénouement. Disons simplement que l’auteur décrypte finement, en se mettant dans la tête de son héroïne, en prenant son point de vue et sa plume, l’opposition entre deux mondes éditoriaux, l’un traditionnel et solide, qui garantit la qualité sans forcément assurer la fortune (le côté « vieille »), l’autre, moderne et pailleté, qui considère les écrivains comme des producteurs d’objets éphémères (le côté « jeune »). Ce faisant, Paul Fournel nous fait comprendre et aimer « Jeune-Vieille », attachant personnage, tout en pratiquant le détachement ironique qui le caractérise.
Jean-Pierre Longre
17:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, paul fournel, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/04/2021
Les murs du silence
 Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, P.O.L., 2019, Folio, 2021
Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, P.O.L., 2019, Folio, 2021
Dans un entretien accordé à Thierry Guichard (Le Matricule des Anges n° 2016, septembre 2019), Santiago H. Amigorena disait : « Enfance laconique, jeunesse aphone, adolescence taciturne, maturité coite, vieillesse discrète… le silence fait partie de ma vie comme de mon écriture, et je savais, depuis de longues années, qu’il me faudrait un jour écrire sur le silence de Vicente Rosenberg, mon grand-père maternel. Mais ce n’est qu’il y a deux ans, en lisant les lettres que mon arrière-grand-mère lui avait écrites depuis le ghetto de Varsovie et Los Abuelos, un livre écrit par mon cousin, Martin Caparrós, que l’ai compris la forme et le ton que pourrait prendre Le ghetto intérieur. »
C’est en effet l’histoire de ce grand-père qui est ici racontée. Juif polonais arrivé en Argentine en 1928, Vicente Rosenberg se marie avec Rosita, issue d’une famille juive ukrainienne, a des enfants, une belle-famille accueillante, des amis, un magasin de meubles… Bref, la vie semble lui sourire, « mais quelque chose de pire que tout ce qu’il avait imaginé était en train d’arriver – et il ne pouvait rien faire. » L’occupation de la Pologne, Varsovie aux mains des nazis, sa famille restée là-bas, sa mère enfermée dans le ghetto, les lettres de plus en plus déchirantes qui mettent des mois à arriver… Alors Vicente, rongé par la culpabilité de n’avoir pas assez fait pour sauver sa mère, pour la faire sortir du pays, s’enferme lui aussi entre des murs, ceux du silence et de l’absence apparente de toute réaction à l’amour de sa femme et de ses enfants, à la compagnie de ses amis, aux exigences de son travail. Ce sont les fuites nocturnes du domicile familial, le jeu jusqu’à l’aube, acharné à perdre « tout ce que le magasin rapportait », les cauchemars au cours desquels il se voit enserré entre des murailles de plus en plus oppressantes…
L’écriture de Santiago H. Amigorena pénètre jusqu’au fond des choses : les ressassements intérieurs d’un homme qui semble vouloir rester sourd non seulement aux autres, mais à lui-même, à la vérité de l’horreur, à ses propres vérités, sont relatés avec l’émotion et l’empathie d’un écrivain que l’on sent intimement concerné. Et les questions existentielles, les considérations historiques sur le nazisme, sur l’industrie de la mort, sur l’aveuglement des démocraties, sur la Shoah viennent à l’appui des préoccupations personnelles de Vicente et de Santiago, qui a lui aussi quitté son pays, l’Argentine, pour fuir la dictature, et « pour retourner en Europe. » Mais lui, pour tenter d’exorciser la souffrance, a recours aux mots.
Jean-Pierre Longre
18:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, santiago h. amigorena, p.o.l., 2019, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/03/2021
Paris-Bucarest-Paris. Journal d’un écrivain
 Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021
Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021
« Au moment même où je suis sur le point de devenir un écrivain professionnel (horribile dictu !), j’ai décidé, par un choix délibéré, de me prêter à cet exhibitionnisme autorisé (et inoffensif) qui est de tenir un journal. C’est pour cette raison que je suis à Paris ! » En 1970, au moment où il écrivait cela, Dumitru Tsepeneag ne savait pas qu’à partir de 1975, déchu de sa nationalité roumaine, il ne pourrait retourner dans son pays qu’après la chute de Ceauşescu. Ce journal, entrecoupé de « notes à la va-vite » datées de 1972, de notes sur un « voyage en Amérique » accompli en 1974, suivi d’un entretien avec Monica Lovinescu intitulé « La condition des intellectuels en Roumanie. Entre censure et corruption » (Radio Free Europe, 30 septembre 1973) et précédé d’une solide préface historico-biographique de Virgil Tanase, court de 1970 à 1978, avec quelques interruptions plus ou moins longues, et il est un vrai journal d’écrivain qui, la trentaine bien sonnée, s’est lancé dans la littérature de fiction.
Car si l’auteur s’adonne çà et là à quelques confidences personnelles (ses relations avec ses parents, son mariage…), c’est le monde intellectuel et artistique qu’il décrit avec beaucoup de précision et de diversité, notamment celui qui concerne les écrivains roumains, exilés ou restés au pays, dissidents ou s’accommodant du régime, notoires ou méconnus. Alors on croise à plusieurs reprises Cioran et Ionesco, Paul Goma (souvent) et Vintilă Horia (un peu), Virgil Tanase et Leonid Dimov, bien d’autres encore. Et aussi les Français Robbe-Grillet et Michel Deguy, le traducteur Alain Paruit, les éditeurs, dont Paul Otchakovsky (qui, devenu P.O.L., publiera les ouvrages de Tsepeneag, dont celui-ci), et encore Roland Barthes, sous la direction duquel il commença une thèse sur Gérard de Nerval. On en passe une multitude, tant ces 600 pages regorgent de rencontres et d’événements qui suscitent récits et réflexions.
Il y a bien sûr ce qui a trait à la situation en Roumanie et à sa dégradation vers plus de censure, d’hypocrisie, d’intimidations, de répression ; ce qui concerne, par extension, la situation internationale et les questions idéologiques (« Confusion des termes ! Quel rapport entre l’Union soviétique et le communisme ? Confusion qu’entretiennent aussi, cela va de soi, et par tous les moyens, les adversaires du communisme. ») ; et les mouvements littéraires, dont l’onirisme, bien sûr (que l’auteur, qui en fut le chef de file avec Dimov, distingue précisément du surréalisme), le nouveau roman et ses théories… Dans tous les cas, Dumitru Tsepeneag affirme nettement sa personnalité et ne mâche pas ses mots, conformément à son habitude (souvenons-nous de ses Frappes chirurgicales) : « Lorsque quelqu’un m’est antipathique, j’ai du mal à changer d’avis. » Même les gens qu’il apprécie sont parfois passés au crible, et cela concerne aussi ses propres écrits, dont ce journal, qui parfois lui pose problème : « À quoi bon ce journal ? Je ne le publierai jamais. Je ne suis même pas sûr de ne pas le détruire un jour ou l’autre. L’idée de me regarder plus tard dans un miroir (déformant) est stupide et je doute que l’envie m’en vienne un jour. D’autant plus que je note des impressions très superficielles, occasionnées par des événements extérieurs. »
Sévère voire injuste avec lui-même, l’auteur a beau dire, son journal est du plus haut intérêt pour toute une série de raisons, dont les conditions et le déroulement de la vie littéraire, collective et individuelle, n’est pas la moindre. Il n’est pas indifférent, loin s’en faut, de savoir par exemple comment sont nés, non sans difficultés, Les Cahiers de l’Est, ou comment se sont élaborés certains romans comme Les Noces nécessaires, Arpièges ou, surtout, Le Mot sablier, où « la langue roumaine s’écoulera dans la langue française comme à travers l’orifice d’un sablier. » Une belle image, qui résume la riche destinée linguistique et littéraire d’un écrivain qui, sans fausse pudeur ni étalage complaisant, montre comment l’exil a été un frein et un moteur de la création littéraire.
Jean-Pierre Longre
18:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, roumanie, dumitru tsepeneag, virgil tanase, jean-pierre longre, p.o.l. | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2019
Le fabuleux destin de Laurent Mourguet
 Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
La mère de Paul Fournel, lorsqu’il était enfant, lui enjoignait d’arrêter de « faire Guignol ». Sans connaître le personnage, il se doutait qu’il « incarnait tout ce qui turbule, tout ce qui impertine, tout ce qui pique, tout ce qui ricane en souriant. ». Plus tard, intéressé entre autres par le fonctionnement des langues et du langage, il observa ce personnage de plus près, et fit des recherches poussées sur son histoire et celle de ses comparses, Gnafron, la Madelon et les autres. Il en fit même une thèse. Mais rassurez-vous, Faire Guignol (d’ailleurs qualifié de « roman ») n’est pas un pensum universitaire.
C’est au contraire le récit plein de verve, truffé de mots et d’expressions du parler lyonnais, d’une vie exceptionnelle : celle de l’inventeur de Guignol, Laurent Mourguet (1769-1844). Fils de canut, marié tout jeune à l’amoureuse, compréhensive et soucieuse Jeanne, père de famille nombreuse, il a tâté d’un peu tous les métiers pour faire bouillir la marmite. Crocheteur, marchand ambulant, arracheur de dents, il découvre finalement la manipulation des marionnettes, dont Polichinelle et Colombine sont de fameux représentants. De la manipulation à la fabrication, il n’y a qu’un pas : d’un bloc de bois naît un jour Gnafron, le cordonnier porté sur la bouteille ; puis arrive le personnage central, qui donne de l’air à son créateur, et qui vivra longtemps, très longtemps. « Chance et prix de votre patience, vous êtes les premiers à voir Guignol ! Le voici pour la première fois en son castelet, tout jeune et débutant. Mourguet l’a ganté sur sa main gauche, et de la droite il tient Gnafron. Ces deux lascars vont devenir inséparables. C’est juste un essai pour Mourguet, mais c’est un grand jour pour l’histoire du théâtre, et vous y assistez ! ».
 À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
Oui, cela se confirme à la lecture : la vie de Laurent Mourguet est un véritable roman, et l’œuvre qu’il nous a laissée (dont les textes ont été heureusement recueillis – car leur auteur ne savait pas écrire) est trop universelle pour être oubliée, trop vivante pour mourir. Paul Fournel nous en fournit d’ailleurs, ponctués de photos quasiment parlantes, quelques échantillons colorés, engagés et pétulants, tout en rappelant le contexte historique de son élaboration, et en glissant çà et là quelques anecdotes savoureuses, quelques détails bien utiles, comme la naissances des « mères », ces grandes dames de la cuisine lyonnaise (qui ont maintenant leur « parvis » du côté de la Part-Dieu), comme les révoltes des canuts, ou comme l’ouverture en 1836 de la brasserie Georges, « le plus grand restaurant de France ». Et puis à ce propos, n’hésitons pas à accepter ce que Paul Fournel, en fin connaisseur, nous offre : « Enfin, vous allez être récompensés et réchauffés par un bon repas. Il était temps. C’est le prix de votre patience. Lyon est le moyeu d’une roue gourmande qui n’en finit pas de tourner. Au nord les vins de Bourgogne et du Beaujolais, les viandes du Charolais. Ensuite et en tournant vers la droite, les volailles de Bresse, les poissons, écrevisses et grenouilles de la Dombes, les fromages de la Savoie, les noix de Grenoble, les fruits, les légumes, les fromages et les vins de la vallée du Rhône, les châtaignes de l’Ardèche, les saucissons, les jésus, les fromages et la prune de la Haute-Loire, les céréales de la Loire et les salaisons des monts du Lyonnais. La roue tourne et tout descend vers la ville et ses marchés. ».
Bon appétit, bonne lecture, bons spectacles !
Jean-Pierre Longre
17:10 Publié dans Essai, Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, biographie, francophone, lyon, paul fournel, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/03/2017
L’écume du malheur
 Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Dans l’avant-propos de L’écume des jours, Boris Vian proclame la primauté, dans la vie comme dans son livre, de l’amour (sans oublier une certaine musique de jazz), et dévoile son principe romanesque : « Les quelques pages de démonstration qui suivent tirent toute leur force du fait que l’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ». À la fin de sa présentation de D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère écrit ceci : « Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d’extrême pauvreté, de justice et surtout d’amour. Tout y est vrai ». Faut-il arrêter ici la comparaison ? Sans doute, mais si elle m’est venue à l’esprit malgré le paradoxe, c’est parce que dans les deux cas les récits sont profondément humains et profondément « vrais », l’humanité et la vérité empruntant des chemins littéraires différents – l’imaginaire fantaisiste et l’humour (noir) dans le premier, la relation précise et sans concessions des faits réels dans le second. L’amour, la tendresse, l’amitié, la maladie, la mort, le malheur sont en tout cas, dans l’un et l’autre roman, le substrat humain qui fonde le besoin d’écriture et le désir de lecture.
 On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
Événements pathétiques s’il en est, racontés sans pathos, avec des détails que l’on sent précisément choisis, dans leur apparente objectivité et à travers quelques exemples individuels, pour montrer la confiance que l’on peut avoir dans l’amour humain (ce sont bien, d’ailleurs, les malheurs dont ils sont témoins qui renforcent les sentiments que se portent l’auteur et sa compagne, et finalement sauvent leur couple). Les personnes réelles deviennent des personnages symboliques de l’humanité, dans tous les sens du terme. Ils sont modestes (petites familles, petits juges), les morts ne sont ni héroïques ni vraiment exceptionnelles (catastrophe naturelle, cancer), mais ce qui est représenté, c’est le pouvoir qu’a chaque être humain, confronté à la fatalité, de changer la vie, de combattre la souffrance, de ressouder les liens, et aussi de peser sur les contraintes sociales, de protéger les pauvres, de braver la puissance des groupes financiers quand on est un « petit juge de province » obstinément épris de justice… Dans l’écume du malheur, il y a toujours de la place pour l’expression poignante de l’amour, et d’une œuvre de « commande », il y a toujours de quoi faire un beau roman.
Jean-Pierre Longre
16:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, emmanuel carrère, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/02/2017
Les vertiges de la mémoire
 Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017
Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017
Tout commence avec la mémoire, et se poursuit avec le rêve. Le rêve est d’ailleurs le titre sous lequel les cinq textes du livre parurent dans les années 1980, amputés de certains passages par la censure, puis traduits par Hélène Lenz et publiés en France en 1992 chez Climats (édition maintenant épuisée). La Nostalgie est donc un livre au passé déjà chargé, aussi chargé que les histoires qui s’y trament.
Cinq textes autonomes, donc, mais qui entretiennent entre eux des rapports plus ou moins cachés (retours de personnages, de motifs, de mystères, type de style, progressions parallèles…), rapports qui se tissent à mesure que l’on avance sur la toile narrative – le leitmotiv de l’araignée tissant sa toile et étendant ses longues pattes sur le paysage ou les personnages est l’une des marques saisissantes de l’ouvrage.
Le « Prologue » s’ouvre sur les états d’âme d’un vieil écrivain « pleurant de solitude » et attendant la mort en essayant de « réfléchir ». « Voilà pourquoi j’écris encore ces lignes : parce que je dois réfléchir, comme celui qui a été jeté dans un labyrinthe doit chercher une issue, ne serait-ce qu’un trou de souris, dans les parois souillées d’excréments ; c’est la seule raison. ». Et l’« Épilogue » se ferme sur un autre vieillissement, universel celui-là, anéantissement et renaissance se faisant suite. Entre les deux, les cinq nouvelles cheminent parmi souvenirs et imagination, dans un réalisme fantastique qui ne laisse ni l’auteur, ni ses personnages ni le lecteur en repos.
La « nostalgie » est une pathologie psychique liée au regret du passé, certes, mais aussi à celui d’une situation idéale inatteignable. De fait, ici, chaque récit part d’un point du passé, d’un souvenir qui se tourne vers un univers intérieur échappant à l’entendement ordinaire, voire vers un anéantissement de soi au profit d’une apothéose littéraire ; c’est le cas avec « Le Roulettiste », dont le personnage n’arrive pas à mourir. La seconde nouvelle, « Le Mendébile », tient véritablement du souvenir d’enfance, racontant les jeux plus ou moins violents d’une bande de copains à l’arrière cafardeux d’un immeuble bucarestois des années 1970, avec portraits sans concessions et rivalités sans pitié, jusqu’à la souffrance extrême. Avec « Les Gémeaux », qui ménage un suspense narratif et érotique intrigant, nous suivons une progression vers une double métamorphose, un transfert à la fois intime et terrifiant : « Nous nous sommes longtemps regardés, horrifiés, sans nous parler ni nous attirer. Nous étions trop fatigués, trop abasourdis pour réfléchir encore. […] Nos gestes hésitaient, nos mouvements balbutiaient, nos mains rataient ce qu’elles faisaient. Nous nous regardions comme des êtres venus de deux mondes différents, aux bases chimiques, biologiques et psychologiques totalement autres. ». « REM », le récit le plus long, est aussi le plus complexe, même si lui aussi est un récit d’enfance, celui d’une jeune femme qui déroule en une nuit à l’intention de son amant ses souvenirs de « choses qui se sont passées dans les années 1960, 1961, quand j’étais encore une petite fille. ». Jeux d’enfants chez une tante habitant aux limites de la ville, mystères liés à ces trois lettres, « REM » (la « chose » inexplicable, les Réminiscences de phénomènes dont l’étrangeté est liée à la rencontre entre la poésie de l’enfance et le gigantisme de la mémoire, entre la vie innocente et l’annonce de la mort, entre la quotidienneté du réel et l’étrangeté du songe – confrontations qui ne peuvent se résoudre que dans la création, littéraire en l’occurrence, aboutissement de la quête de ce Graal nouvelle version). « Il existe des livres secrets, écrits à la main, consacrés au REM, et il existe des sectes concurrentes qui reconnaissent le REM, mais qui ont des idées on ne peut plus différentes quant à sa signification. Certains soutiennent que le REM serait un appareil infini, un cerveau colossal qui règle et coordonne, selon un certain plan et en vue d’un certain but, tous les rêves des vivants, depuis les rêves inconcevables de l’amibe et du crocus, jusqu’aux rêves des humains. Le rêve serait, selon eux, la véritable réalité, dans laquelle se révèle la volonté de la Divinité cachée dans le REM. D’autres voient dans le REM une sorte de kaléidoscope dans lequel on peut lire tout l’univers, dans tous les détails de chaque instant de son développement, de sa genèse jusqu’à l’apocalypse. ».
Difficile d’en écrire davantage dans un simple compte rendu. Sinon que le dernier texte est comme une signature apocalyptique, celle de « l’architecte » dont l’influence musicale va s’étendre sur la « mentalité humaine » en transformation, sur le monde entier, sur « l’espace interstellaire » et « des constellations entières ». C’est ainsi que l’artiste complet (l’écrivain, comme l’architecte, le musicien ou tout autre) compose son univers vertigineux et le propose au public, qui a le choix de le suivre ou non sur les flots de son écriture et de son imagination. Avec Cărtărescu, difficile de ne pas se laisser embarquer, même si l’on redoute la tempête, les récifs et les courants.
Jean-Pierre Longre
18:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, mircea cărtărescu, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/01/2016
Troubles en Transylvanie
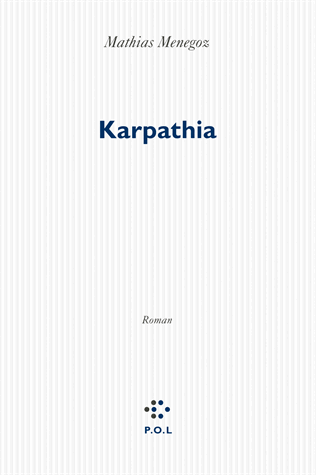 Mathias Menegoz, Karpathia, P.O.L., 2014, Folio, janvier 2016
Mathias Menegoz, Karpathia, P.O.L., 2014, Folio, janvier 2016
Prix Interallié 2014
Pour un jeune noble hongrois vivant à Vienne dans les années 1830 (comme pour beaucoup de nos contemporains), le nom même de Transylvanie recèle sa part de légendes, d’exotisme et de mystère. C’est pourtant là-bas, aux confins de l’empire austro-hongrois, que le comte Alexander Korvanyi, tout juste réchappé d’un duel meurtrier et fraîchement marié avec une jeune fille de bonne famille autrichienne, Charlotte (dite Cara) von Amprecht, décide d’aller s’installer avec son épouse, afin de reprendre en main le domaine familial, dont l’histoire tourmentée est liée à celle du pays entier.
Parvenu sur place, installé dans son château, le couple découvre une contrée aux aspects à la fois sauvages et inattendus, vastes pâturages, lac paisible, sombres forêts, villages modestes ou miséreux… Dans cette vallée de la Korvanya et sur les terres voisines se côtoient sans se mélanger les différentes communautés qui peuplent la Transylvanie, et dont la présence plus antagoniste qu’harmonieuse résulte des événements des siècles passés. Magyars (Hongrois), Széklers (Sicules), Saxons (Allemands), Valaques (Roumains), Tsiganes – chacun occupe sa place, dans son rôle social (seigneurs, militaires, domestiques, serfs, ouvriers itinérants, bergers, forestiers, contrebandiers...). Le fougueux Alexander décide de mettre sans ménagement tout ce monde au pas de ses décisions, se disant que les révoltes passées doivent être définitivement oubliées. Mais quelques événements étranges (des disparitions d’enfants tsiganes ou valaques, le viol d’une jeune hongroise, des attaques de loups – ou d’hommes ? – contre des troupeaux), s’ajoutant à l’intransigeance du jeune comte et à l’animosité d’une bande de contrebandiers, mettent le feu aux poudres, et ce qui était prévu comme un rassemblement de chasseurs tourne à l’explosion de violence et au massacre.
 Karpathia raconte des aventures mouvementées, laissant une part non négligeable à l’imaginaire, mais c’est aussi un roman historique, social et psychologique. Les espaces temporel et géographique y sont précisément délimités ; les noms hongrois des localités (mis à part celui de la fictive Korvanya), la cohabitation inamicale des communautés nationales et linguistiques, le pittoresque des paysages – tout correspond à une réalité vérifiable, fruit d’une sérieuse documentation. Les personnages, bien campés dans leurs individualités parfois complexes, dans leurs réactions contrastées, dans leur orgueil sans concessions, dans leurs passions, leurs ambitions ou leurs révoltes, avec leurs forces et leurs faiblesses, sont plus que des types humains : des êtres en proie à leurs doutes et à leurs convictions, à leurs superstitions et à leurs calculs, à leur sensibilité et à leur violence. La prose de Mathias Menegoz, à la fois élaborée et enlevée, classique et audacieuse, combinant le souci du détail et la rapidité de la narration, l’arrêt sur image et la vivacité de l’action, est celle d’un vrai romancier – traditionnel ? Sans doute, mais en l’occurrence ce n’est pas un défaut, au contraire. En tout cas, pour le lecteur, un plaisir auquel le tourment prend une belle part.
Karpathia raconte des aventures mouvementées, laissant une part non négligeable à l’imaginaire, mais c’est aussi un roman historique, social et psychologique. Les espaces temporel et géographique y sont précisément délimités ; les noms hongrois des localités (mis à part celui de la fictive Korvanya), la cohabitation inamicale des communautés nationales et linguistiques, le pittoresque des paysages – tout correspond à une réalité vérifiable, fruit d’une sérieuse documentation. Les personnages, bien campés dans leurs individualités parfois complexes, dans leurs réactions contrastées, dans leur orgueil sans concessions, dans leurs passions, leurs ambitions ou leurs révoltes, avec leurs forces et leurs faiblesses, sont plus que des types humains : des êtres en proie à leurs doutes et à leurs convictions, à leurs superstitions et à leurs calculs, à leur sensibilité et à leur violence. La prose de Mathias Menegoz, à la fois élaborée et enlevée, classique et audacieuse, combinant le souci du détail et la rapidité de la narration, l’arrêt sur image et la vivacité de l’action, est celle d’un vrai romancier – traditionnel ? Sans doute, mais en l’occurrence ce n’est pas un défaut, au contraire. En tout cas, pour le lecteur, un plaisir auquel le tourment prend une belle part.
Jean-Pierre Longre
18:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, mathias menegoz, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/03/2015
Hollywood, Afrique
Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes, P.O.L., 2013, Folio, 2015
Prix Médicis 2013
Dans le monde à la fois excentrique et fermé du cinéma hollywoodien, Solange, la jeune française de Clèves devenue actrice américaine, et Kouhouesso, second rôle dont la figure est cependant notoire, se rencontrent au cours d’une soirée. Cela aurait pu être « Coup de foudre chez George Clooney » – car c’est bien lors d’une réception chez la star que cela se passe. Cela aurait pu être aussi un drôle de roman à clés (outre Clooney, on y rencontre Matt Damon, Steven Soderbergh, Vincent Cassel et quelques autres), ou encore un roman de mœurs, un roman exotique, un roman psychologique…
 Bien sûr, ces lectures sont possibles, mais il y en d’autres, plus prégnantes. On pourrait parler de roman d’atmosphères (au pluriel), de roman parodique aussi, jouant avec les stéréotypes auxquels est confrontée l’héroïne : le cinéma, bien sûr, comme un miroir déformant et onirique ; la passion amoureuse, au premier plan, liée à l’attente – celle de l’homme qu’elle aime, qui n’a pas son pareil pour se faire désirer longuement et pour débarquer au moment inattendu ; le couple mixte (femme blanche, homme noir) et les clichés que, nonobstant l’évolution des mœurs et les apparences progressistes, cette alliance véhicule ; l’Afrique, sa chaleur, ses paysages et ses coutumes – où Kouhouesso va tourner Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
Bien sûr, ces lectures sont possibles, mais il y en d’autres, plus prégnantes. On pourrait parler de roman d’atmosphères (au pluriel), de roman parodique aussi, jouant avec les stéréotypes auxquels est confrontée l’héroïne : le cinéma, bien sûr, comme un miroir déformant et onirique ; la passion amoureuse, au premier plan, liée à l’attente – celle de l’homme qu’elle aime, qui n’a pas son pareil pour se faire désirer longuement et pour débarquer au moment inattendu ; le couple mixte (femme blanche, homme noir) et les clichés que, nonobstant l’évolution des mœurs et les apparences progressistes, cette alliance véhicule ; l’Afrique, sa chaleur, ses paysages et ses coutumes – où Kouhouesso va tourner Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
Dans un style où perce, entre autres, la « petite musique » de Marguerite Duras (à qui l’auteure a emprunté son titre), Marie Darrieussecq construit un récit très personnel, aux allures à la fois théâtrales et cinématographiques, tragédie en cinq actes ou film en cinq grandes séquences précédées d’un « générique » et complétées par un « bonus » (dix ans après…). Mais la différence entre un film ou une pièce de théâtre et un roman, c’est que celui-ci peut diversifier les points de vue, accéder directement à l’intériorité des personnages, mettre des mots sur les comportements et les attitudes, approcher par le verbe les mystères de la vie, les rêves des humains, le sens des silences et la poésie du monde. Tout cela, Il faut beaucoup aimer les hommes y parvient dans une prose à la fois retenue et fiévreuse, sensible et sensuelle, pleine d’images et d’échos, une prose qui laisse de belles traces dans la mémoire du lecteur.
Jean-Pierre Longre
12:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marie darrieussecq, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/02/2015
« Bienvenue dans mon épopée »
 Mircea Cărtărescu, Le Levant, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2014
Mircea Cărtărescu, Le Levant, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2014
Faut-il définir le genre de l’ouvrage ? On parlera d’épopée. Douze chants, invocations aux Muses et à d’autres entités divinisées, exploits guerriers de courageux navigateurs, intrigues amoureuses, amitiés et inimitiés viriles, héros à la fois modernes et intemporels dont le but est de libérer leur patrie de l’occupant étranger, fond historique sur lequel se détachent des événements transfigurés en mythes, lyrisme tantôt échevelé tantôt intimiste, en prose ou en vers… La tonalité épique est bien une caractéristique fondamentale du récit, dont le protagoniste, Manoïl, n’a de cesse que de renverser la tyrannie levantine qui opprime la Valachie – et qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler, ici, la sombre dictature dont était victime le peuple roumain dans les années 1980, celles durant lesquelles l’auteur écrivait son livre.
Épopée, donc, mais travestie et burlesque, parodique et humoristique, aux inventions inattendues, que ce soit dans les descriptions, les situations ou l’écriture. Chaque page est une surprise nouvelle, chaque phrase recèle une trouvaille stylistique ou verbale. L’histoire du monde devient une fable pleine de paysages étonnants, de machines complexes, de péripéties fantaisistes, d’anachronismes audacieux, de rêves merveilleux ou terribles, d’illusions politiques, de voyages infinis, de tirades grandioses. Avec ses personnages en quête (plus ou moins consciente) d’un Graal oriental ou de ce que les surréalistes appelaient le « point suprême », la narration s’envole au-delà des « limites du monde », là où « le bien et le mal, les ténèbres et la lumière s’annihilent, petit et grand, infini et limité deviennent une même chose ». Comme ce sera le cas dans les romans à venir, notamment dans la trilogie Orbitor, Cărtărescu le magicien n’hésite pas à naviguer entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, donnant par exemple à Bucarest toutes ses dimensions dans une larme, et envisageant le monde depuis une nacelle de ballon dirigeable…
À l’instar de ce qui se produit dans les romans picaresques, Mircea l’écrivain intervient à tout moment en tant que tel dans son œuvre, la contemple, l’examine, ironise, s’efforce de la modifier, s’en éloigne pour mieux la commenter, s’adresse directement à ses personnages, se regarde travailler dans sa cuisine, accueille le lecteur à l’intérieur de ses pages en lui souhaitant la bienvenue. Non seulement le lecteur, mais nombre d’écrivains sur lesquels il s’appuie, qu’il prend à témoin avec un respect non dénué de familiarité. Il y a là Homère, bien sûr, et quelques autres antiques, mais aussi Shakespeare, Byron, Borges et quantité de modernes, roumains de préférence. Cărtărescu a beaucoup lu, cultive une imagination débordante, et pratique une écriture effervescente. Le Levant est une somme grouillante, un univers foisonnant, et surtout un hymne à la vie sous tous ses aspects, la vie réelle, la vie rêvée :
"Je lève ce verre lourd à la sainte Liberté,
À la douce Poésie, et à la Rêverie ailée."
Jean-Pierre Longre
15:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : épopée, roman, poésie, roumanie, mircea cartarescu, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2013
Littérature poids léger
 Paul Fournel, La liseuse, P.O.L., 2012, Folio, 2013
Paul Fournel, La liseuse, P.O.L., 2012, Folio, 2013
Le troubadour Arnaut Daniel, poète influent du XIIe siècle, est dit-on l’inventeur d’un genre à forme fixe qui, pour complexe qu’il soit, a connu et connaît encore le succès : la sextine. Les six mots qui forment les rimes tournent sur eux-mêmes, revenant selon une savante rotation hélicoïdale à la fin des six vers de chacune des six strophes. En oulipien virtuose et en fidèle disciple de Queneau (qui construisait ses romans selon de rigoureux schémas préétablis), Paul Fournel a composé La liseuse selon la forme de la sextine, et il a même la gentillesse de nous livrer ce secret de fabrication à la fin de son roman.
Car La liseuse est bien un roman, dont chaque ensemble de six chapitres s’assimile à une strophe, ce qui fait que les trente-six chapitres équivalent à trente-six vers aux rimes constantes et tournantes : « lue, crème, éditeur, faute, moi, soir ». Qui plus est, les vers-chapitres sont d’une longueur régulièrement déclinante, de 7500 à 2500 signes, figurant ainsi le déclin progressif de la vie du protagoniste.
 Et ce roman en est bien un vrai, avec un personnage principal autour duquel se meuvent des personnages secondaires. Qui plus est, c’est un roman où il est question de romans, puisque Robert Dubois est un éditeur « à l’ancienne », qui regarde d’un œil malicieux s’agiter tout ce monde, et contemple de même sa propre vie, dont les innovations technologiques semblent vouloir bouleverser le cours. La « liseuse » en question, qu’on vient lui offrir, est une tablette électronique qui contient un nombre de livres tel qu’il ne pourra jamais en transporter dans son cartable. Il ne vire ni au vieux grincheux réfractaire ni à l’obsédé de l’écran, mais se prend au jeu, s’amuse à semer le désordre dans le monde éditorial en s’appuyant sur sa tablette et sur les stagiaires, ces êtres plus ou moins visibles sans lesquels la profession de l’édition ne pourrait pas subsister. S’observant, il en profite pour revenir sur sa vie de lecteur : « Je suis assis dans le canapé, ma tablette posée sur les genoux, je n’ai pas encore l’énergie d’appuyer pour la mettre en marche et faire jaillir le texte. Ce qui est dedans me menace. J’en veux à ce métier de m’avoir tant et tant empêché de lire l’essentiel, de lire des auteurs bâtis, des textes solidement fondés, au profit d’ébauches, de projets, de perspectives, de choses en devenir. Au profit de l’informe ». Un retour sur soi qui prépare le dénouement…
Et ce roman en est bien un vrai, avec un personnage principal autour duquel se meuvent des personnages secondaires. Qui plus est, c’est un roman où il est question de romans, puisque Robert Dubois est un éditeur « à l’ancienne », qui regarde d’un œil malicieux s’agiter tout ce monde, et contemple de même sa propre vie, dont les innovations technologiques semblent vouloir bouleverser le cours. La « liseuse » en question, qu’on vient lui offrir, est une tablette électronique qui contient un nombre de livres tel qu’il ne pourra jamais en transporter dans son cartable. Il ne vire ni au vieux grincheux réfractaire ni à l’obsédé de l’écran, mais se prend au jeu, s’amuse à semer le désordre dans le monde éditorial en s’appuyant sur sa tablette et sur les stagiaires, ces êtres plus ou moins visibles sans lesquels la profession de l’édition ne pourrait pas subsister. S’observant, il en profite pour revenir sur sa vie de lecteur : « Je suis assis dans le canapé, ma tablette posée sur les genoux, je n’ai pas encore l’énergie d’appuyer pour la mettre en marche et faire jaillir le texte. Ce qui est dedans me menace. J’en veux à ce métier de m’avoir tant et tant empêché de lire l’essentiel, de lire des auteurs bâtis, des textes solidement fondés, au profit d’ébauches, de projets, de perspectives, de choses en devenir. Au profit de l’informe ». Un retour sur soi qui prépare le dénouement…
Récit à contrainte, roman-poème, La liseuse se consomme à différents niveaux : l’histoire d’un homme vieillissant, bon vivant, aux petits soins avec sa femme, sujet aux regrets ; un portrait ironique des milieux éditoriaux et de la littérature médiatique ; une description des changements radicaux qu’imposent les inventions modernes ; une réflexion sur les rapports entre le livre et le lecteur, etc. Quoi qu’il en soit, c’est bourré de références et d’allusions (à l’histoire de la littérature, depuis le manuscrit médiéval jusqu’à l’écriture électronique en passant par l’invention de l’imprimerie, et aussi à une quantité d’auteurs, aux collègues de l’Oulipo, à Raymond Queneau…), c’est savant, c’est livresque, c’est léger, c’est profond, c’est drôle, c’est enlevé… C’est du Paul Fournel.
Jean-Pierre Longre
www.folio-lesite.fr
11:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, poésie, sextine, francophone, paul fournel, oulipo, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2013
En mémoire du fils
 Nicolas Fargues, Tu verras.Prix du livre France Culture Télérama 2011. P.O.L., 2011, Folio, 2012
Nicolas Fargues, Tu verras.Prix du livre France Culture Télérama 2011. P.O.L., 2011, Folio, 2012
Comme si le narrateur (dont on apprend très tard qu’il s’appelle Colin, un prénom qui sonne un peu comme celui de l’auteur) n’osait pas en arriver au fait, ne se résolvait pas à avouer ce qui le hante, ce n’est qu’après plusieurs longues pages d’évocations mélancoliques que l’on apprend le drame : Clément, son fils de 12 ans, est mort dans un accident de métro ; comment ? On ne le saura qu’après d’autres longues pages : en tombant sur la voie devant une rame. D’autres pages encore : est-ce vraiment un accident ? C’est en quelque sorte au détour de phrases torturées comme l’esprit de Colin que se manifestent les vérités – ou plutôt les demi-vérités, selon les perceptions des personnages.
 Nicolas Fargues ou l’art du non-dit révélateur. Colin a élevé son enfant quasiment seul, comme un père moderne, et n’a jamais rechigné à manifester une tendre complicité envers son fils ; en même temps, comme un père traditionnel, il ne reculait devant aucun reproche : la manière de s’habiller et de se comporter, les mauvaises notes, le choix des musiques etc. Maintenant que son fils est mort, cela le ronge, cela le mine, au point qu’il cherchera des dérivatifs fort inhabituels pour lui. L’Afrique, qui occupe les dernières pages, apportera peut-être la sérénité.
Nicolas Fargues ou l’art du non-dit révélateur. Colin a élevé son enfant quasiment seul, comme un père moderne, et n’a jamais rechigné à manifester une tendre complicité envers son fils ; en même temps, comme un père traditionnel, il ne reculait devant aucun reproche : la manière de s’habiller et de se comporter, les mauvaises notes, le choix des musiques etc. Maintenant que son fils est mort, cela le ronge, cela le mine, au point qu’il cherchera des dérivatifs fort inhabituels pour lui. L’Afrique, qui occupe les dernières pages, apportera peut-être la sérénité.
Tu verras – dont le titre reprend le lieu commun parental (« Tu verras plus tard, tu comprendras… ») – est le monologue éploré (mais non larmoyant) d’un homme qui tente de faire remonter par bribes ce qui restait enfoui au plus profond ; c’est la quête d’un être qui cherche à percer sa propre vérité, à s’ouvrir aux secrets de son fils, à ceux des autres et à leur amour.
Jean-Pierre Longre
17:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas fargues, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/03/2012
Présente et absente
 Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
PRIX FEMINA 2010
Rééd. Folio, 2012
« Il y a des circonstances où quoi qu’on fasse on va toujours nulle part ». En l’occurrence, dans le dernier roman de Patrick Lapeyre, on va et on vient entre passé et présent, entre ici et ailleurs, entre le réel quotidien et nulle part. Plus précisément, Nora Neville, jeune anglaise farouchement attachée à sa liberté, sans qu’elle éprouve le besoin de s’en justifier, va et vient entre Paris et Londres, entre Louis Blériot (qui n’est pas aviateur) et Murphy (qui est trader).
Et tout tourne autour d’elle, qu’elle soit physiquement présente ou absente, jusqu’à l’obsession, une obsession aux pouvoirs aussi absolus que mystérieux : « C’est à cette heure qu’autrefois Murphy aimait entrer en communication avec Nora. Il la retrouvait sagement assise, un livre à la main, à l’intérieur d’un café de Soho ou bien se promenant dans les allées de Green Park » ; une obsession qui peut suspendre le cours du monde, pour Blériot et pour les autres : « Le temps qu’elle pivote sur elle-même en le cherchant des yeux, il n’y a plus aucun bruit, on ne sent plus le souffle d’air, la rotation de la terre s’interrompt quelques nanosecondes ».
C ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
A l’instar du titre, évocateur et harmonieux, emprunté au poète japonais Issa, le style de Patrick Lapeyre est aéré et allusif, limpide et plein d’échos ; sous un apparent dépouillement, il ne dédaigne pas l’expressivité, la tournure imagée voire surprenante – comme est surprenante l’héroïne fraîche et tragique, présente et absente, attendue et imprévisible, réelle et irréelle – un peu comme si se retrouvaient dans le monde d’aujourd’hui la Manon Lescaut de l’abbé Prévost (dont l’auteur revendique d’ailleurs la paternité), mais aussi la Nadja d’André Breton.
Jean-Pierre Longre
16:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick lapeyre, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2011
Les ruses du roman
 Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Précisément, s’agit-il d’un roman ? Certes, Dumitru Tsepeneag a depuis longtemps (au moins depuis Le mot sablier qui, publié en 1984, représente sous forme narrative le passage d’une langue à l’autre) commencé à dévoiler certains coins de son atelier à l’intention de ses lecteurs, sans leur en laisser découvrir tous les secrets. Mais jamais un de ses livres n’a autant mérité le sous-titre de « Chantier à ciel ouvert ».
À l’image des tranchées que quelques travailleurs s’échinent à creuser dans les rues, certains leitmotive d’œuvres précédentes se retrouvent dans Le camion bulgare, certains personnages aussi : Marianne, l’épouse partie se soigner de son étrange maladie en Amérique, et à qui l’écrivain demande sans cesse des conseils, Alain, l’ami et traducteur à l’agonie, qu’il va falloir remplacer. D’autres apparaissent au fil des pages, fondant une narration épisodique : Tzvetan, le camionneur bulgare qui, en, quelque sorte, succède au fameux « plombier polonais » (et, autre clin d’œil, transporte avec lui un dangereux parapluie) ; Béatrice, dont la route va croiser celle du précédent, après qu’ils auront accompli leur itinéraire érotique ; Milena, romancière originaire de Slovaquie (mais dont le modèle, semble-t-il, vient plutôt de Slovénie), Pastenague, le double de l’auteur/narrateur avec qui il échange parfois des impressions ; quelques autres encore, qui naviguent entre réel et imaginaire.
On ne fera pas ici la liste des thèmes et sujets dont le foisonnement tient à la fois de la marqueterie cubiste, de la musique expérimentale et de l’art consommé de la (fausse) digression, dans un texte qui avance comme un camion cahotant sur les routes européennes. Il est question de Marguerite Duras, de « littérature d’ordinateur » et d’amour par courrier électronique, de mythologie égyptienne, d’animaux divers, de la Bulgarie et de la Roumanie, de maladie et de vieillesse… La récurrence de ce dernier motif pourrait laisser entendre que Le camion bulgare est le roman de la dépossession, voire de la disparition. Mais n’est-ce pas une ruse, pour mieux conserver sa foi en la littérature ? Car c’est essentiellement de littérature qu’il est question ; de celle des autres, parfois (les délicieuses et impitoyables Frappes chirurgicales restent d’actualité), mais surtout de celle qui est en train de s’élaborer ici, maintenant : autocommentaire, autocritique, autobiographie littéraire (que d’« auto » pour un camion…), ou encore métalittérature, poétique du roman, mise en abîme de l’écriture… Patiemment, de livre en livre, bien mieux que dans n’importe quel traité théorique ou manuel universitaire, Dumitru Tsepeneag explore malicieusement l’art du récit et procède aux mises en ordre successives de ses découvertes. Attendons la suite.
« Je reconnais que je n’ai pas eu le courage d’écrire un véritable chantier : rassembler des matériaux de construction, placer côte à côte les briques narratives et les idées structurantes, et laisser le lecteur se faire son roman lui-même. Certes : je l’ai écrit, pour ainsi dire, sous ses yeux, il est témoin des efforts que je fais pour écrire encore un livre – le livre de trop, diront certains… ». Mais non !
Jean-Pierre Longre
14:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/08/2010
Mystérieuse et envoûtante
 Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine, traduit du roumain par Alain Paruit, P.O.L., 2006
Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine, traduit du roumain par Alain Paruit, P.O.L., 2006
À lire les premières pages, on aura tendance à se placer dans un décor typiquement parisien aux allures réalistes (le bistrot et ses habitués, le métro et ses faits divers, le Bois de Boulogne…). Plus loin, mais dans une vue rétrospective, on revivra les péripéties historiques de la chute du mur de Berlin et de l’agonie des régimes communistes. A vrai dire, au fil des pages, on sent bien qu’il ne s’agit pas de s’enfermer dans les stéréotypes rassurants et les scènes déjà connues et déchiffrées, qu’il ne s’agit même pas de suivre le déroulement narratif d’une histoire solidement racontée.
Car au milieu des pseudo réalités urbaines et européennes, au milieu de personnages dont la présence est apparemment fonctionnelle, tributaires et faire-valoir de l’héroïne (un bistrotier communiste et rêveur, un turfiste malchanceux, un Russe inquiétant, un peintre exigeant, un duo de philosophes allemands complices en tout, même en amour…), déambule la séduisante Ana ou Hannah, mystérieuse et envoûtante, liée à un invisible Mihai, blonde ou brune selon les pays, médecin ou infirmière, prostituée ou espionne, calculatrice ou naïve, dangereuse ou apeurée, amante fougueuse ou distante… Mythomane certainement, forgeant elle-même son mythe, selon la phrase de Novalis placée en exergue et revenant dans l’espace du récit : « La vie ne doit pas être un roman qui nous a été donné, mais un roman que nous avons fait nous-mêmes ».
Toutefois ce roman, le maîtrisera-t-elle jusqu’au bout ? Cherchant peut-être à leurrer les autres, ne se leurre-t-elle pas elle-même ? L’auteur nous laisse le privilège de l’imagination, un auteur qui est bien là, avec des intertextes plus ou moins voilés (Thomas Mann et quelques autres), des jeux plus ou moins explicites sur Elvire Popesco ou Ionesco, le marteau et la faucille, la vodka qui coule à flot dans les gosiers et fait parler « à brûle-pourpoint », et surtout les autoréférences : la présence d’Ed, jeune employé du bistrot, nous met sur la piste d’Ed Pastenague, anagramme de D. Tsepeneag, l’un et l’autre auteurs, sous un nom ou sous un autre, de romans et récits présents dans le texte (Pont des Arts, Attente, Roman de Gare, Hôtel Europa), d’un scénario de film résumé ici même. Jusqu’à l’obsession reviennent des leitmotive présents dans toute l’œuvre (un aigle en cage, une gare désertée, un sanatorium au-delà d’une forêt, les prénoms féminins Maria, Ana, Marianne, l’attente), le tout assorti d’une autodérision décapante, par exemple sur la Roumanie, « pays de tsiganes et d’escrocs », ou sur l’œuvre elle-même (Hôtel Europa défini comme un simple « thriller »)…
La Belle Roumaine n’est pas un roman ; c’est une multiplicité de romans en puissance : aventures, espionnage, amour, érotisme, politique, exotisme, philosophie, histoire se superposent, ou plutôt tournent autour d’un axe que l’on peut appeler – pour utiliser le nom d’un mouvement que Tsepeneag fonda autrefois avec quelques autres en Roumanie – onirisme. Les reprises, les répétitions d’événements, les épisodes cycliques, factuels ou imaginaires, le ressassement à caractère musical, tout cela relève de la préoccupation structurelle : « Le rêve ne peut pas être narré, on doit le présenter, le reconstituer, l’écrire, le récrire, le fabriquer de a à z. Le vrai songe, le songe nocturne, n’est pour la narration onirique rien de plus qu’un modèle. Il ne fournit que les lois et la structure, non la matière, c’est-à-dire le sujet… ». Comme tous les romans de Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine n’est pas un roman ; c’est un poème.
Jean-Pierre Longre
22:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, alain paruit, dumitru tsepeneag, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/08/2010
Mater dolorosa
 Marie Darrieussecq, Tom est mort, P.O.L., 2007
Marie Darrieussecq, Tom est mort, P.O.L., 2007
La mort brutale d’un enfant vécue, revécue, ressassée par sa mère peut-elle faire le sujet d’un roman ? Oui, lorsque ce roman relate la douleur universelle, la douleur folle de toute mère.
La narratrice, jeune épouse française d’un anglais qui, à cause de son travail, mène sa femme et ses trois enfants d’une extrémité à l’autre de la terre, de Vancouver à Sidney et Cambera, pourrait être toute mère endeuillée de n’importe quelle époque, de n’importe quel pays. Simplement, l’écriture est là, non pour purger l’être souffrant de son malheur, non pour lui procurer l’oubli et l’apaisement, mais pour lui permettre de rendre compte, de rendre des comptes à soi-même et, peut-être, aux autres.
La sphère infernale de la remémoration et du remords, d’un bout à l’autre de l’écriture, englobe tout, et les dernières phrases du livre, qui pourraient être une explication, ne dénouent rien ; au contraire, elles renvoient aux premiers mots déclencheurs : « Tom est mort. J’écris cette phrase ». Un peu comme dans certains récits de Marguerite Duras (mais avec la singularité de l’événement), les mots sont des cris, un seul cri trouant la surface des sentiments, les vidant de leur substance en une spirale sans fin. Les choses de la vie ne sont pas un recours : objets, déménagements, livres (y compris les grands auteurs, sauf peut-être Charlotte Delbo et Georges Perec), même les deux autres enfants, l’aîné et la benjamine (Tom était le cadet), même les proches – le mari traumatisé et aimant, les parents compréhensifs – , tout ce qui remplit l’existence quotidienne n’y peut rien. La mort de l’enfant fait qu’il sera toujours là, éternellement âgé de quatre ans et demi.
Tom est mort est un livre risqué pour l’auteur : risque humain de s’aliéner celles qui ont connu la pire des souffrances pour une femme : vivre la mort de celui à qui on a donné la vie ; risque littéraire de fabriquer de la mauvaise littérature avec un sujet grave. On peut dire que Marie Darrieussecq a composé là une œuvre littéraire vraie, en donnant à ses mots la mission de nous plonger au plus profond du cœur humain.
Jean-Pierre Longre
16:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marie darrieussecq, p.o.l. | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/08/2010
Dans le secret des « armoires bleues »
 Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, P.O.L. / Imec, 2006
Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, P.O.L. / Imec, 2006
Il arrive que les dossiers de genèse, brouillons, avant textes et autres carnets préparatoires, souvent livrés maintenant à la légitime curiosité des lecteurs, ne donnent pas lieu à des publications passionnantes sur le plan littéraire ; ils restent dans ce cas des documents d’archive, témoignages de l’activité première d’un écrivain. Dans le cas des Cahiers de la guerre (ainsi nommés par Marguerite Duras elle-même), il y a plus : à en lire la plus grande part, on se sent déjà plongé dans l’atmosphère particulière des écrits élaborés, comme si la maturité de Marguerite Duras se dessinait dès les esquisses de Marguerite Donnadieu.
Les textes ici établis et présentés par Sophie Bogaert et Olivier Corpet constituent un choix judicieux dans les archives que Marguerite Duras a déposées, avant sa mort, à l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine). Leur composition s’est étalée entre 1943 et 1949. Quatre cahiers donc : le « Cahier rose marbré », qui est consacré d’une part à un récit autobiographique évoquant l’enfance et l’adolescence en Indochine, d’autre part à des ébauches de livres comme Un barrage contre le Pacifique (toujours lié au passé indochinois) ainsi qu’à des fragments narratifs situés au moment de la Libération et qui constitueront partiellement La douleur, cette pathétique relation de l’attente et du retour de camp de Robert Antelme ; La douleur, dont l’élaboration se poursuit dans le « Cahier Presses du XXe siècle » et dans le « Cahier de cent pages » ; le « Cahier beige », où l’autobiographie (la mort de l’enfant, des souvenirs d’Italie, la vie de la rue Saint-Benoît) côtoie les ébauches de fictions telles que Le marin de Gibraltar. Une dernière partie donne quatre textes autobiographiques (que les éditeurs datent de la fin des années 1930) et six nouvelles dont la tonalité annonce celle des Impudents et de La vie tranquille, les deux premiers romans de Marguerite Duras publiés en 1943 et 1944. De part et d’autre de cet ensemble, des reproductions de pages manuscrites assurent une émouvante matérialité à la production littéraire.
Rien n’est encore vraiment construit, tout est déjà là : le matériau, les faits, les mots, la fluidité, les heurts. La cruauté d’une enfance et d’une adolescence où les coups de la mère et du frère, où le désir d’aimer et le dégoût du premier baiser, où la solitude et la promiscuité constituent le socle d’une personnalité ; l’horreur de la torture, de l’attente et de la mort, la lutte pour le retour à la vie d’un rescapé (si peu rescapé) des camps nazis, l’espoir presque vain de l’amour… Et le ton ; le ton à la fois si prenant et si décalé, reconnaissable entre tous, les phrases dont l’harmonie est souvent rompue par une fissure, une faille, un trou, alors que la narration ressassante se creuse en introspection sans concessions.
« Je ne voudrais voir dans mon enfance que de l’enfance. Et pourtant, je ne le puis. Je n’y vois même aucun signe de l’enfance. Il y a dans ce passé quelque chose d’accompli et de parfaitement défini – et au sujet duquel aucun leurre n’est possible », écrit Marguerite Duras au début de « L’enfance illimitée ». Dans les « armoires bleues » de la maison de Neauphle-le-Château où étaient conservés ces cahiers, il y avait de même « quelque chose d’accompli ». L’écriture s’est élaborée dans ces textes de jeunesse, mais l’essentiel y était inscrit : la quête de la vérité indicible d’une vie où le « leurre » n’a pas sa place, où tout se joue à chaque rencontre, à chaque instant, à chaque mot.
Jean-Pierre Longre
18:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, francophone, marguerite duras, p.o.l. | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/06/2010
Variations sur des thèmes très humains
 Jacques Jouet, Cantates de proximité, « Scènes et portraits de groupes », P.O.L., 2005
Jacques Jouet, Cantates de proximité, « Scènes et portraits de groupes », P.O.L., 2005
Jacques Jouet aime les contraintes oulipiennes, les gens (dans le métro, dans la rue, en groupes), la musique des mots, Raymond Queneau et Jean-Sébastien Bach… En outre, il aime écrire (des essais, des récits, des poèmes), et les Cantates de proximité sont ici rassemblées comme des humains en société, mais comme eux peuvent être considérées individuellement.
Placées (entre autres) sous l’égide de Max Beckmann, « peintre d’histoire », dont les apparitions (ou plutôt celles de certaines de ses œuvres) rythment l’ensemble, ces cantates sont composées de variations sur des sujets collectifs. De même que beaucoup d’entre elles sont encadrées par des listes, des séries de mots clés qui ouvrent et ferment chaque unité textuelle, de même il est possible de résumer le tout en énumérant les thèmes. Il y a donc, dans le désordre et à quelques notes près : des élèves de collège et de terminale L, des étudiants, des militants associatifs, des prud’hommes en stage de formation, une équipe féminine de basket, la famille Bach, des habitants de Ouagadougou, des photographes, les permanents du Haut-Koenigsbourg, des architectes, des employés de l’usine Sollac de Biache ou d’une filature en fin de vie – les uns et les autres victimes de la dégradation sociale, la fête et les révoltes du 1er mai, Rostropovitch devant le mur de Berlin, les comédiens d’une pièce de Marivaux, des vaches, une rue de Calais, des syndicalistes, les morts du « Mémorial indien » (Pas-de-Calais)…
Et comment se combinent ces variations ? En phrases très brèves ou très longues (ces dernières posant, dans la tonalité du « à supposer que… », des hypothèses de travail), en récits, dictons, dialogues, portraits (poétiques) individuels ou collectifs, citations, comptes, chaînes, textes journalistiques, texte en blanc, questions qui persistent jusqu’à l’enterrement du livre en personne…Surtout, des poèmes à formes plus ou moins fixes – et leur liste en est un à elle seule : pantoums, monostiques, redondes, haïkus, « un seul mot », sextines, morale élémentaire, sonnets, quinines, poèmes de métro (spécialité jouetienne), bruits/cris, canto/cantate, chant patriotique, propositions nominales, « terza rima berrychonne », quenoum…
Cantates de proximité est une œuvre complète (comme on dit d’un menu), dont l’élaboration est en phase avec l’attachement à la littérature et à ses théories (Barthes avant Queneau, Perec et consorts), mais aussi pleinement aux humains, aux proches, à nous, interprètes, auditeurs, lecteurs. Comme le théâtre, comme la musique, la poésie est un miroir à peine déformant.
Jean-Pierre Longre
10:42 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, jacques jouet, oulipo, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/04/2010
Trouver le livre parfait ?
 Dumitru Tsepeneag, Frappes chirurgicales, P.O.L., 2009
Dumitru Tsepeneag, Frappes chirurgicales, P.O.L., 2009
Il est toujours utile de tenir compte de regards à la fois étrangers et avertis, extérieurs et intérieurs sur la vie littéraire et culturelle d’un pays, et il n’est pas indifférent que, concernant la France, sa langue et sa littérature, ces regards viennent d’écrivains qui ont la double expérience de la vie locale et de l’émigration. C’est en grande partie sur eux que l’on doit compter pour un véritable renouvellement de la langue et de la littérature.
Le dernier livre que l’écrivain franco-roumain Dumitru Tsepeneag vient de publier en français rassemble des articles critiques diffusés initialement en revue (Seine et Danube, puis La revue littéraire) entre 2003 et 2007. En toute subjectivité, l’écrivain multiplie avec un humour corrosif les angles d’attaque contre les abus de la mode artistique et littéraire, n’hésitant pas même à fustiger les opinions d’autres auteurs francophones : l’une de ses cibles, par exemple, est Nancy Huston, qui dans Professeurs de désespoir dénonce le nihilisme de certaines grandes figures de la littérature européenne comme Beckett, Cioran, Thomas Bernard ou Elfriede Jelinek, mais aussi celui de petites figures médiatisées comme Michel Houellebecq et Christine Angot : « C’est l’esprit démocratique à l’américaine de notre Nancy qui la pousse à mélanger génies et plumitifs ? Ou le populisme franchouillard qu’elle a appris depuis qu’elle vit ici ?», écrit-il avec une amicale rugosité.
Le jugement de Tsepeneag est à la fois partial, sans appel, spirituel (voir les remarques sur « l’ambulance » Philippe Labro) et intéressant, puisque, entre autres, il rappelle à sa manière deux versants de son écriture: le versant étranger et le versant français, leur point de jonction, leur sommet commun présentant l’avantage d’une double culture, double culture qui peut être aussi à double sens, comme ici : « J’ai fait un rêve. J’étais un vieux critique littéraire, je vivais en Roumanie et j’adorais la littérature française. C’était ma mère nourricière. J’essayais de me tenir au courant de ses dernières tendances. On m’avait dit que Frédéric Beigbeder passait aux yeux de ses lecteurs pour un grand écrivain. Tout le monde le lisait. Ceux qui n’avaient pas le temps de le lire le regardaient à la télé. Il était beau. Comment ne pas admirer son menton volontaire, sa chevelure rebelle, son regard perçant. En Roumanie on avait traduit tous ses livres. Il était venu une fois à Bucarest, les femmes se bousculaient devant lui, tentaient de le toucher, criaient, désespérées. Je me suis réveillé en sueur… »
Mais Frappes chirurgicales n’est pas une entreprise de démolition. À côté des tirs plus ou moins meurtriers, à côté de la défense de quelques livres comme Les Bienveillantes, d’auteurs comme Pierre Péju, Emmelene Landon et quelques autres, il y a une véritable réflexion sur certains aspects de la littérature passée, sur le phénomène des prix littéraires, sur le sort réservé de nos jours aux revues, sur l’Europe… Surtout, il y a le goût exigeant et communicatif de la lecture : « Je cherche le livre rare qui me plairait sans objection aucune, le livre dont je puisse dire, voilà, la vraie littérature française, toujours à la hauteur de sa grande renommée. Je lis, sinon comment pourrais-je trouver ce livre… »
Jean-Pierre Longre
17:06 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, roumanie, dumitru tsepeneag, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |


