24/02/2011
Marseille-Bruxelles, « espace insulaire »
 Jean-Pierre Martin, Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2010
Jean-Pierre Martin, Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2010
Connaissez-vous le théorème de Montgolfier ? Alors voici : « Plus une rencontre entre deux êtres humains apparaît comme tributaire du hasard, plus elle se délivre par là même de toute contingence ». Et savez-vous qui est ce Montgolfier ? Un « ethnologue du proche », qui – pour faire court – étudie le comportement sexuel des animaux, en particulier des humains, et dans ce but additionne les trajets ferroviaires entre Marseille et Bruxelles. Un personnage observateur, à la fois dans le récit et en dehors, voix in et voix off, tel qu’on en trouve dans certains romans de Queneau (dont on devinerait, si l’on ne le savait déjà, que Jean-Pierre Martin est un fervent lecteur). Un autre se trouve dans une situation similaire : « L’écrivain », qui est « en train d’écrire un roman sur la séduction, […] ou encore, d’une certaine façon, sur l’amour », et qui dévoile volontiers la genèse de ses oeuvres : « J’aime sonder le mystère des êtres qui passent et qui se croisent, s’aperçoivent, s’évitent, se renfrognent ou s’ouvrent les uns aux autres, se racontant leur vie le temps d’un voyage ».
Outre ces deux-là, qui donnent une sorte d’assise comportementaliste et littéraire au récit, il y a dans la voiture 16 du TGV 9864 Nice-Bruxelles beaucoup d’autres personnages dont on ne va pas établir la liste ici. Hommes et femmes, jeunes et vieux, beaux et laids, sûrs d’eux et timides, séducteurs et maussades, ce petit monde représentatif, disons, de la société européenne occidentale de la première décennie du XXIe siècle, échange et détourne des regards, monologue, bredouille des paroles, esquisse et esquive des gestes, ébauche des relations, amorce des aventures, comme dans « un espace insulaire, à l’abri des invasions du monde », dans une parenthèse de liberté qui se refermera à l’ouverture des portes. Plusieurs romans restent ainsi en suspens, tel celui d’Enzo le musicien avec Rachel la prof de fac, ou celui de Laurence Fischer la psychanalyste avec le contrôleur qui ressemble à Lambert Wilson, et cela se tisse au rythme d’Alice, le train en personne, qui n’hésite pas à s’exprimer en mots humains, et dont les vibrations, selon leur intensité, règlent le débit de la parole des passagers, attisent ou atténuent leurs désirs ; au rythme, aussi, des annonces originales et lettrées de Wassim l’employé du wagon-bar… De ce huis clos à grande vitesse, de ces intrigues sans dénouement, de cet enfermement libérateur, on ne sort pas inchangé ; et, paradoxalement, on tente provisoirement de s’en échapper, à l’occasion, par le téléphone (qui dérange les autres), la poésie plus ou moins bien accueillie de Wassim, les souvenirs plus ou moins nostalgiques, les anticipations plus ou moins réalistes, les rêves plus ou moins érotiques… et par l’humour. Car il faut le reconnaître : l’observation du genre humain est, ici, un plaisir ; n’en déplaise à l’écrivain (« Ne riez pas », ordonne-t-il), il nous amuse (et il s’amuse) avec son sujet sérieux ; son style alerte, vibrionnant, n’y est pas pour rien.
Hasard des lectures ? Signes d’une époque ? Air du temps ? Au cours des derniers mois, j’ai lu plusieurs romans récents prenant pour cadre ou pour centre de gravité les transports collectifs, lieux d’observation et d’introspection (sans parler de tout ce que le métro a produit). Certains, comme Apaiser la poussière de Tabish Kair (éditions du Sonneur) ou La croisade des enfants de Florina Ilis (éditions des Syrtes) sont remarquables, chacun dans sa forme et sa portée. J’y ajoute volontiers Les liaisons ferroviaires.
Jean-Pierre Longre
http://www.jeanpierremartin.net
Et un peu de publicité pour des romans ferroviaires ou routiers :
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/01/02/le-train-de-la-memoire.html
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/10/20/nouveaute-aux-editions-du-sonneur.html)
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/05/20/le-pouvoir-de-l-innocence.html
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/02/24/meurtres-sur-la-voie-ferree.html
11:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-pierre martin, Éditions champ vallon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/02/2011
Émotions à demi traits
 Myriam Gallot, Les cœurs suspendus, dessins de Jean-Philippe Bretin, Éditions Noviny44, 2010
Myriam Gallot, Les cœurs suspendus, dessins de Jean-Philippe Bretin, Éditions Noviny44, 2010
Qu’ont-ils d’exceptionnel, les personnages qui parcourent les quinze récits de Myriam Gallot ? Au premier abord, pas grand-chose : trois copines courant les lotos de village, des agriculteurs en faillite, un jeune chauffard emprisonné, un clochard embauché comme Père Noël, un vendeur ambulant, une jeune femme en quête de logement, un professeur de maths en rupture, un conducteur de limousine… Des gens ordinaires, de condition plutôt modeste – mis à part l’épouse d’un homme d’État avide de pouvoir et de richesse et un chien de luxe… En vérité, tous, y compris la femme privilégiée, ont en commun la solitude, une solitude qu’ils contiennent en eux-mêmes ou que le monde et les aléas de la vie leur imposent.
Les petits et grands malheurs, communs et particuliers, se dévoilent sans pathos, avec tendresse et cruauté, dans un entre-deux qui attache intimement le lecteur aux personnages. Ceux-ci représentent la collectivité humaine, saisie ici et maintenant, et chacun d’entre eux est un être saisi dans son individualité, sa spécificité.
La prose est moderne, composée de mots et d’expressions d’aujourd’hui, de la parole même des protagonistes, et sa tournure précise, incisive, laisse toutefois de la marge pour un je-ne-sais-quoi d’évanescent qui laisse planer un mystère sur les émotions, les événements, les caractères, les destinées. La société n’est pas épargnée, la satire affleure, le cynisme se laisse deviner ; mais il y a toujours une sorte de pudeur, un délicat suspens des sentiments (voir le titre) qui n’empêchent pas l’exploration des profondeurs plus ou moins secrètes de l’âme humaine, chacune à sa mesure. Une exploration sans limites, puisque les dénouements, chute ou absence de chute, ne sont jamais des fins.
La réussite d’une nouvelle tient à l’art de l’unité, de la concision et de la mise en situation, une situation qui, relevant du réel (social, actuel, quotidien), passe par le tamis de la fiction. Les cœurs suspendus est, en l’occurrence, un vrai et beau recueil de nouvelles. Le style, l’esthétique littéraire y servent le social et l’humain, et inversement, selon le point de vue que l’on adopte. Ajoutons que les dessins de Jean-Philippe Bretin, noir et blanc ou couleurs vives, accompagnent les récits, en se gardant de les illustrer directement, de leurs éclats, de leurs méandres, de leurs taches, de leurs formes suggérées. Comme dans le texte, suggestions à demi traits dont le lecteur peut prolonger les effets à sa guise.
Jean-Pierre Longre
17:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, illustration, francophone, myriam gallot, jean-philippe bretin, noviny44, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Face à la laideur
 Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Il y a quatre personnages : le narrateur, Luna, Victor et la jeune pianiste. Ajoutons les Niçois et la musique pour parfaire le compte. Pour raconter l’histoire, « on se parle à soi-même. C’est comme ça que ça commence. C’est comme ça qu’on dégénère ».
Et c’est « comme ça » que le lecteur est embarqué dans ce monologue intérieur, pris dans le tourbillon du soliloque, dans les lacets de la mémoire, dans la spirale de la parole intérieure, dans le piège de l’imagination, dans la folie des fantasmes. Ce qui guide le narrateur, et qui en même temps l’enferme, c’est son exigence. Exigence musicale se préservant « des méfaits de la compromission et du renoncement », face à l’ami Victor qui est devenu une « oie » ; exigence morale face à la corruption de la société, en particulier celle de la ville de Nice, qui est « devenue abjecte » ; exigence esthétique qui lui permet d’entendre les sonates inventées par Luna et de les retranscrire purement et simplement…
Tout aurait pu être beau : Nice et « le jardin d’Alsace-Lorraine », la musique enseignée au conservatoire, la visite de « la jeune pianiste », les demoiselles, les relations avec les autres, ceux qui l’appellent Le Dégénéré. Mais tout, dans la tête du narrateur en proie à lui-même et au monde, est dégénérescence. « C’est à se prendre la tête dans les mains et à ne jamais se la lâcher ». Et tout, dans ses phrases, dit qu’il faudra bien que cela finisse un jour, d’une manière ou d’une autre, comme dans les romans de Marguerite Duras ou dans les tragédies de Racine. Le dégénéré met en mots désespérants l’impuissance devant la laideur du monde et de l’âme humaine. Cela donne un roman angoissant, révolté, sombre, beau.
Jean-Pierre Longre
17:34 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jérôme bonnetto, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Mortelle réalité
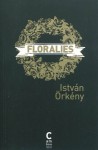 István Örkény, Floralies, traduit du hongrois par Jean-Michel Kalmbach, Cambourakis, 2010
István Örkény, Floralies, traduit du hongrois par Jean-Michel Kalmbach, Cambourakis, 2010
Les (a)mateurs des Loft story, Koh-Lanta et Îles de la tentation diverses supporteraient-ils de voir mourir sur leur écran des volontaires pour ce genre de télé-réalité ? Peut-être, puisque ça passerait à la télévision… C’est en tout cas ce que propose, bien avant l’invention de ce genre d’émission, et sous couvert d’une argumentation philosophico-humaniste un peu spécieuse, le héros du roman d’István Örkény (1912-1979), dont les livres méritent vraiment d’être connus.
Áron Korom, jeune réalisateur, frappe à différentes portes pour mener à bien son projet : montrer aux téléspectateurs « les dernières heures de trois malades incurables », dans la vérité de leur agonie. Il a trouvé trois personnes qui, contre rétribution (à leurs héritiers, bien sûr), acceptent de laisser filmer leurs derniers instants ; et au bout de ses démarches, ses supérieurs lui donnent l’autorisation de créer le documentaire Notre mort (titre qui, suprême ironie, sera changé en Floralies…). On s’en doute, tout ne va pas pour le mieux lors du tournage. En particulier, comment prévoir le moment précis du décès de chaque « acteur » ? Le premier a devancé l’appel, et c’est sa veuve qui raconte les derniers instants du personnage. Pour les deux autres, le film pourra se faire, mais au prix de compromis, d’anticipations, d’artifices, bref de l’hypocrisie télévisuelle que l’on connaît bien, mais qui, lorsque c’est la mort d’un humain qui est en jeu, paraît d’autant plus odieuse. Même s’« il suffit de vouloir fortement pour réussir », peut-on « pondre un infarctus conforme aux desideratas de la télévision » ?
Ce pourrait être morbide et dramatique, c’est plutôt vivace et cruel, satirique et drôle. Le traitement du sujet par l’absurde, le ton du récit, le découpage théâtral des scènes, l’allant des descriptions, le naturel des dialogues, tout cela fait de Floralies un exemple achevé de savoureux humour noir.
Jean-Pierre Longre
13:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, hongrie, istván Örkény, jean-michel kalmbach, cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« L’impromptu de Neuilly »
 Patrick Rambaud, Quatrième chronique du règne de Nicolas Ier, Grasset, 2011
Patrick Rambaud, Quatrième chronique du règne de Nicolas Ier, Grasset, 2011
Patrick Rambaud, romancier de talent (Prix Goncourt pour La bataille en 1997), s’y connaît aussi en Histoire récente et contemporaine, et a fait ses preuves en matière de parodie (rappelons, entre autres, ses pastiches de Roland Barthes ou de Marguerite Duras, et un savoureux Bernard Pivot reçoit… qui réunit et fait parler, chacun dans son style personnel, quelques grands écrivains du XXème siècle).
Tout cela pour dire qu’il n’est pas le premier venu, et qu’il était tout désigné pour être, à la manière de Saint-Simon, le chroniqueur de « Notre Nerveux Souverain », qui prête si bien le flanc à la moquerie et à la protestation, et qui toutefois en est à sa quatrième année de règne – ce qui nous vaut, pour nous divertir et nous remonter le moral le temps d’une lecture, le quatrième tome (été 2009 – été 2010) des aventures de celui qui est « désormais pour l’Histoire Nicolas le Névrosé », « à cause de son obsession inassouvie de la bougeotte ». Histoire individuelle, mais aussi histoire collective, comprenant le grouillement de ceux qui gravitent autour de « Notre Vibrionnant Monarque ». Voilà donc des portraits hauts en couleur, tels ceux du « comte Chatel, qui s’occupait des écoles de Sa Majesté », de M. le duc de Villepin, l’ennemi juré, de « Monsieur Fredo », nommé « marquis de Valois » pour régner sur la Culture, du « lieutenant criminel Besson », transfuge par excellence, du « chevalier d’Ouillet », sorte de colosse « fermement ancré dans la balourdise », de M. Raoult, « lieutenant général du Raincy », qui « servait deux maîtres, notre Phosphorescent Monarque et le tyran de Tunis, M. Ben Ali », et qui pensait que les écrivains obtenant le prix Goncourt ne devaient pas exprimer leurs opinions, de M. Woerth, « duc de Chantilly », de « la Grande Duchesse de Bettencourt »…
Il serait vain de rappeler tous les exploits accumulés en une année par Sa Majesté et ses courtisans, et relatés ici sur le mode satirique et néanmoins réaliste. L'art de Patrick Rambaud est de décrire les faits sans cacher ce qu’il en pense, de dénoncer les excès, les vanités, les incompétences, les mensonges et les ratages, le tout dans le style fleuri, métaphorique, ironique, pince-sans-rire et pour tout dire fort plaisant des prosateurs classiques. Il ne mâche pas ses mots, ne manque pas de dire leurs vérités aux puissants et aux riches qui nous gouvernent et de mettre au jour les injustices et les abus, mais il le fait toujours avec une élégance qui tranche furieusement sur les ânonnements de « Notre Bravache Souverain », avec un lexique choisi (les journaux sont les « gazettes », la télévision les « fenestrons », la Parti socialiste le « Parti Social » et l’UMP le « Parti Impérial », les autobus des « diligences » conduites par des « postillons » etc.) et un sens inégalable de la formule qui fait mouche (« Madame rentra tardivement du Bénin, où elle était allée regarder le sida »… Impayable et implacable « regarder »…).
Cette Quatrième chronique est dédiée, entre autres, « à M. Molière qui aurait écrit puis joué L’Impromptu de Neuilly, c’est-à-dire l’envers du décor ». Molière, La Bruyère, Saint-Simon, Voltaire… Patrick Rambaud a d’illustres maîtres, et sans conteste il en est digne.
Jean-Pierre Longre
10:15 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, francophone, patrick rambaud, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/02/2011
Un genre paradoxal
 Jean Nicolas De Surmont, Vers une théorie des objets-chansons, ENS Éditions, 2010
Jean Nicolas De Surmont, Vers une théorie des objets-chansons, ENS Éditions, 2010
Jean Nicolas De Surmont, spécialiste des théories et de l’histoire de la chanson (particulièrement française et québécoise), propose dans cet essai différentes approches du « phénomène chansonnier », en le considérant du point de vue lexicographique et dans un sens extensif : « Étudier la chanson revient […] à étudier des chansons, des objets esthétiques divers dans leur style […] ainsi que des objets changeants ».
En cinq chapitres (« La poésie vocale par monts et par vaux », « Des linéarités parallèles : la poésie et la musique », « Les mutations componentielles de l’objet-chanson », « Chanson populaire et sa « populaire » épithète », « Les clivages moraux et esthétiques »), il s’adonne donc à un examen des différentes couches de signification que recouvrent le concept et les qualificatifs qui lui ont été appliqués au cours des siècles. Si toutes les chansons ont comme point commun, en général, la brièveté et la simplicité, comment expliciter des adjectifs tels que « populaire », « folklorique », « signée », « commerciale », « lettrée », « intellectuelle » ou des syntagmes tels que « chanson de tradition orale », « chanson poétique d’auteur », « poésie chantée », « chanson à texte », dont beaucoup ont sémantiquement varié au fil du temps ? Et comment résoudre la complexité engendrée par le parallélisme entre texte et musique, ainsi que par les variations de ces deux ensembles ? « C’est essentiellement la variabilité des formes et des composants des objets-chansons qui définit les métissages », et seule une observation minutieuse permet d’identifier les « types de variations ». Le chapitre consacré à la chanson populaire illustre les difficultés d’identification : l’épithète en est ambiguë depuis le romantisme, et le substantif lui-même a plusieurs fois changé de portée depuis le Moyen Âge. Même type de plurivocité lorsqu’on parle de « musique populaire », ou lorsqu’on qualifie la chanson de « bonne » ou « mauvaise », sur les plans moral ou esthétique…
La chanson est un genre paradoxal, puisqu’il s’agit à la fois d’un « genre mineur de la littérature » et d’un « genre reconnu », notamment par le peuple, du « genre le plus consommé mais aussi le moins étudié ». La confusion nécessitait une clarification par l’approfondissement des notions. Ce livre, savant et documenté, y contribue largement.
Jean-Pierre Longre
10:12 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, chanson, jean nicolas de surmont, ens Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/02/2011
« Les taupes de Dieu »
 Horia Badescu, Parler silence, L’Arbre à paroles, 2010
Horia Badescu, Parler silence, L’Arbre à paroles, 2010
Parler silence comprend deux parties distinctes, « Les apocryphes du roi Salomon » et « Journal de souterrain ». Distinctes, mais pas si éloignées l’une de l’autre, ne serait-ce que par l’unité formelle des brefs textes en vers libre souvent sous-tendus par une dualité profonde. Ainsi, le recueil en un seul volume de ces deux ensembles poétiques n’est pas le fruit du hasard.
La dualité, c’est en fait celle de couples prenant leurs racines dans la thématique fondamentale de la vie et de la mort. Dès lors, ce peut être, dans la première partie, la complémentarité ou l’antagonisme corps/nature – le corps se nourrissant, tirant sa substance de la nature, ou celle-ci mettant en évidence l’impuissance de l’homme ; dans la deuxième partie la complémentarité ou l’antagonisme entre le haut et le bas, entre le monde des taupes et le jour céleste, entre la cécité du néant et l’attente d’un horizon. Et partout, çà et là, l’impossibilité de la mesure humaine :
« Ici, le temps n’existe pas,
l’espace non plus
[…]
un désert d’attente s’étend
entre la naissance et la mort ».
L’humanité est vouée au vieillissement, au silence des origines, à la mort s’approchant jour après jour. Existerait-il un espoir, une lumière éventuelle,
« quand la rosée des morts
allume sous nos paupières
l’œil de Dieu » ?
Il y a effectivement l’amour, l’osmose des êtres, les rêves de lumière ; mais la paix ne peut être que celle du néant :
« Entre rien et rien
se déroule notre vie ».
Les images de la nature et de la vie, les sonorités, la sobriété du style, le pouvoir d’évocation des résonances lexicales, tout tend à développer l’oxymore du titre, « parler silence », qui induit la dualité constante de ces poèmes (vie/mort, corps/nature, espoir/désespoir, guerre/paix, haut/bas, ombre/lumière, tout/rien…). Pour Horia Badescu, qui a déjà publié chez L’Arbre à paroles Un jour entier (2006) et Miradors de l’abîme (2007), la langue française est devenue un matériau dont il sait tirer, sans effets oratoires superflus, l’essence poétique.
Jean-Pierre Longre
www.maisondelapoesie.com/index.php?page=editions-arbre-a-paroles
11:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roumanie, horia badescu, l’arbre à paroles, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/02/2011
Animaux littéraires
 Pascal Herlem, Les chiens d’Echenoz, précédé d’un Avertissement de Jean Echenoz, Calliopées, 2010
Pascal Herlem, Les chiens d’Echenoz, précédé d’un Avertissement de Jean Echenoz, Calliopées, 2010
« Le chien littéraire constitue une race à part entière ». Voilà qui est clairement énoncé. Fort de cette vérité, Pascal Herlem trace sa route, explore, hume, flaire, s’arrête, écoute, repart, examine les écrits d’Echenoz jusque dans leurs moindres recoins, à travers le « maillage serré » d’une œuvre dans laquelle « le sens peut circuler dans toutes les dimensions possibles ». Auparavant, il aura pris soin d’étayer son point de départ : le chien est partout dans la littérature, aussi bien chez Alphonse Allais que chez Maupassant ou Tchekhov – et pas seulement chez La Fontaine, Buffon ou Jules Renard… Une mention spéciale pour Queneau, à la fois « chêne » et « chien »… Le chien est donc bien « littéraire », mais aussi « locutif », et le rappel de quelques expressions courantes intégrant l’animal métaphorique nous rafraîchit plaisamment la mémoire.
Alors se déroule, avec un sérieux humour pince-sans-rire, suivant une méthode imperturbable et infaillible, une « echenozographie canine » qui nous apprend beaucoup sur les chiens, sur l’écrivain, son oeuvre et ses personnages, mais aussi sur le monde et la condition humaine. En psychanalyste chevronné, en critique averti, en lecteur avisé (épithètes interchangeables ad libitum), Pascal Herlem parcourt les romans d’Echenoz selon une progression qui ne laisse rien au hasard. Après les « chiens de langue » (mentions allusives, comparatives, indirectes, fragmentaires) viennent les chiens « culturels », auxquels on se réfère pour retrouver « un certain équilibre du monde », puis les « chiens-objets », métaphores des choses de la vie, et l’on arrive au plat de résistance avec les chiens-personnages : les « petits seconds rôles » et « rôles de figurants » suscitant le sentiment d’abandon ou imposant leur utilité dans la garde des habitations et des fermes ; les chiens identifiables à leur race et/ou à leur nom – ce qui nous vaut des considérations animalières très documentées sur, par exemple, l’histoire des molosses ou l’origine des danois ; enfin, les chiens reconnaissables non seulement à leur race et à leur nom, mais aussi à l’identité de leur maître – faveur qui leur confère, à eux surtout, des fonctions précises : percer les secrets de l’âme humaine, assurer « une critique sociologique de première grandeur ».
Si l’auteur nous dévoile « l’art si particulier d’écrire en chien » d’un Echenoz qui, de son propre aveu, ne savait pas qu’il connaissait cette langue, s’il nous embarque dans certaines des « énigmes de l’univers romanesque d’Echenoz » (celle de Titov, entre autres, dans Nous trois), c’est à l’évidence pour mieux nous faire connaître les hommes, et pour nous faire deviner différents cheminements possibles à travers l’œuvre de l’un des meilleurs romanciers de notre époque. La route canine ouvre d’autres routes, à partir desquelles s’en entrouvrent d’autres encore, et ainsi de suite. Grâce à Pascal Herlem, nous avons plus de chances de nous rapprocher du « lecteur complet » qu’imagine Jean Rousset dans Forme et signification, ce lecteur qui, « tout en antennes et en regards, lira l’œuvre en tous sens, adoptera des perspectives variables mais toujours liées entre elles, discernera des parcours formels et spirituels, des tracés privilégiés, des trames de motifs ou de thèmes qu’il suivra dans leurs reprises et leurs métamorphoses, explorant les surfaces et creusant les dessous jusqu’à ce que lui apparaissent le centre ou les centres de convergence, le foyer d’où rayonnent toutes les structures et toutes les significations ».
Jean-Pierre Longre
22:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, francophone, pascal herlem, jean echenoz, editions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/02/2011
Une identité culturelle ?
 François Provenzano, Vies et mort de la francophonie, « Une politique française de la langue et de la littérature », Les Impressions Nouvelles, 2011
François Provenzano, Vies et mort de la francophonie, « Une politique française de la langue et de la littérature », Les Impressions Nouvelles, 2011
Le titre définit brutalement l’enjeu : la francophonie est-elle morte ? Si c’est le cas, il est bon de savoir pour quelles raisons, en examinant les « vies » (important pluriel) qu’elle a vécues. C’est ce que propose François Provenzano, selon un parcours historique qui permet « d’analyser les discours sur la « francophonie » en tant qu’ils dessinent toute une politique de la littérature, en permanente évolution ». En six chapitres et en un examen attentif, sont étudiés les « histoires en jeu », les contextes de la naissance et de l’évolution du phénomène francophone (la colonisation et la décolonisation, l’invention du concept et ce qu’il en reste), ses dimensions politique, économique, idéologique, culturelle, littéraire…
Surtout, l’ouvrage introduit un nouveau terme permettant de mettre en perspective celui de « francophonie » : la « francodoxie », qui désigne « l’ensemble des […] procédés rhétoriques auxquels puise le discours » sur la francophonie. Autrement dit, il y a ici une volonté d’étudier comment et pourquoi la francophonie désigne à la fois une institution et une production littéraire, aussi diverse soit-elle. Depuis la conceptualisation, au XIXe siècle, par le géographe Onésime Reclus, lui-même héritier d’auteurs précédents, de l’idée d’une utilisation du français à l’extérieur de la France, jusqu’aux discours modernes non exempts de condescendance et de paternalisme à l’égard des anciens colonisés (tel le fameux « discours de Dakar » prononcé par Nicolas Sarkozy en 2007), en passant par les premiers congrès du XXe siècle, l’institutionnalisation de la « Francophonie », l’instauration des « Sommets », l’idéologie de la « négritude » dans le contexte post-colonial, la satire du « franglais » par Étiemble, le débat engagé par la revue Esprit, la tendance critique illustrée par Les voleurs de langue de Jean-Louis Joubert, les vies de la francophonie sont passées au crible, sans indulgence et sans parti pris, dans un ensemble richement documenté et solidement charpenté.
La démarche est universitaire, mais le profane averti trouvera là matière à réflexion, en s’appuyant sur les « cinq ensembles de représentation » que l’auteur récapitule dans sa conclusion : représentation de la « langue », de la « France », de la « valeur littéraire », de la « société », de l’« histoire ». Ainsi la « mort » ou la « dissolution » de la francophonie peut donner lieu, dans un renouvellement des enjeux, à une « redéfinition » et à une « renaissance ».
Jean-Pierre Longre
15:34 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, françois provenzano, les impressions nouvelles, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/02/2011
Qui sommes-nous ?
 Vidosav Stevanović, Jeanne du métro, Purification ethnique, Répétition permanente, pièces traduites du serbe par Mauricette Begić et Angélique Ristić, éditions L’espace d’un instant, 2010
Vidosav Stevanović, Jeanne du métro, Purification ethnique, Répétition permanente, pièces traduites du serbe par Mauricette Begić et Angélique Ristić, éditions L’espace d’un instant, 2010
Vidosav Stevanović, né en 1942 en Serbie, s’est très tôt opposé à Milošević et à ses options nationalistes et guerrières, ce qui l’a obligé à quitter son pays au début des années 1990, puis à demander l’asile politique à la France en 1998. Beaucoup de ses œuvres ont été traduites en français, ainsi qu’en une vingtaine d’autres langues. Les trois pièces rassemblées dans ce volume tournent, chacune selon sa forme et son registre, autour de la guerre yougoslave, des conflits individuels et collectifs, de la perte des repères humains…
Jeanne du métro est un « monodrame », le long soliloque d’une jeune fille qui, réfugiée dans les souterrains du métro parisien, « cherche [sa] terre », raconte la disparition de sa famille aux origines mêlées, évoque la guerre et ce qu’elle a provoqué : non seulement les tueries et les ruines, mais une sensation de solitude absolue, la fuite, la perte de l’amour, le sentiment de l’absurdité foncière des actes humains, comme ce prétendu patriotisme guidé par l’intérêt personnel : « Quatre fois il a été serbe et quatre fois croate, chaque fois pour quelques mois seulement […]. Des deux côtés il demandait à être payé pour son patriotisme. À la fin, irrité contre les deux peuples qui payaient mal, il est devenu slovène et l’est resté plusieurs semaines ».
Dans Purification ethnique, quelques personnages – que l’auteur regroupe significativement sous l’appellation « parties en conflit » – sont enfermés dans une cave. Les courts tableaux qui se succèdent prennent la forme d’une tragédie (unités de lieu, de temps, d’action, comme dans les deux autres pièces), qui elle-même tourne à l’absurde. C’est la guerre en miniature et, dans un hors scène fantomatique, en grandeur nature, qui se joue sous nos yeux, la guerre sans issue (on ne peut pas rester là, on ne peut pas sortir), la séparation des familles, les meurtres, la perte d’identité à force d’en vouloir une, immuable et pure :
« Le père – Nous ne sommes donc pas ensemble contre les Musulmans, Croate ?
La mère – Si. Mais chacun pour soi, Serbe. »
Répétition permanente reprend le procédé baroque du théâtre dans le théâtre, les personnages étant des comédien(ne)s tentant de monter une pièce et jouant, sans en avoir conscience, les prémices de la guerre, dans une violence qui augmente à mesure que le temps passe et que les passions s’exacerbent. Là encore, le nationalisme pousse ses tentacules jusqu’à l’absurde, les relations humaines deviennent des actes purement animaux (manger / boire / violer / tuer…), le grotesque masque à peine la cruauté, et tout cela se dresse comme un cauchemar contre un idéal bien simple : « Je voulais être l’épouse de quelqu’un. Et la mère de plusieurs enfants. Et avoir une jolie petite maison à moi. Avec de l’herbe verte dans le jardin ».
Des motifs obsessionnels, on l’aura compris, sont communs à ces trois textes, et la violence aveugle de la guerre n’est pas le moindre d’entre eux. Mais ces motifs ne sont pas purement circonstanciels : au-delà du conflit yougoslave, les pièces de Vidosav Stevanović sont porteuses de la question « Qui sommes-nous ? », ainsi que des thèmes qui divisent l’humanité : les disparités sociales, les rivalités « ethniques », religieuses, sexuelles, politiques, la prétendue « identité nationale ». Et c’est bien à une dénonciation par l’excès et par l’absurde des dérives ainsi entraînées que se livre l’auteur.
Jean-Pierre Longre
08:54 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, serbie, vidosav stevanović, mauricette begić, angélique ristić, l’espace d’un instant, maison d’europe et d’orient, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

