29/12/2015
Impasses de la littérature ?
 Maxime Decout, En toute mauvaise foi. Sur un paradoxe littéraire, Les éditions de Minuit, 2015
Maxime Decout, En toute mauvaise foi. Sur un paradoxe littéraire, Les éditions de Minuit, 2015
« La mauvaise foi est la chose du monde la mieux partagée. Elle se range de prime abord à côté des mensonges, haines, hontes, colères ou autres sentiments violents qui constituent la matière même de l’humain. ». Autrement dit, elle est « inscrite dans la structure même de l’être. ». D’emblée le lecteur est mis en condition, prévenu : les cinq chapitres du livre vont montrer que la littérature, l’une des formes esthétiques les plus fréquentées, l’un des modes d’expression les plus répandus, est une incessante manifestation de mauvaise foi.
Il ne faut pas, comme on le fait souvent, confondre mauvaise foi et mensonge. « La littérature ment », certes – la fiction et la poésie le font naturellement –, mais il s’agit ici de développer l’idée que quelles que soient les postures de ses acteurs, y compris celles des autobiographes, voire des « sincéromanes exaltés », le discours littéraire respire la mauvaise foi dans son fonctionnement, même lorsque celle-ci est reconnue, avouée. Il suffit d’« ouvrir le ventre du texte, [d’] ausculter sa circulation et sa respiration » pour le constater.
Maxime Decout ne s’en prive pas. Son essai n’a rien d’un pensum théorique : tous les constats, toute l'argumentation s’appuient sur les œuvres d’auteurs choisis, dont certains ont leur place naturellement désignée par le sujet (Montaigne, Rousseau, Stendhal, Dostoïevski, Leiris, Sartre, Blanchot, Sarraute, Perec…), mais dont d’autres sont sollicités d’une manière moins attendue, cependant pleinement convaincante (Madame de Lafayette, Molière, Zola, Mauriac, Queneau, la liste complète serait trop longue), et le recours au roman policier n’est pas négligé. Cela va, par exemple, jusqu’à une « querelle de la mauvaise foi » qui se joue en trois actes entre certains pratiquants et/ou théoriciens. Et en guise d’épilogue, une « petite histoire de (la) mauvaise foi » (remarquer la subtile et plaisante équivoque de la présence ou de l’absence d’article), qui nous mène du XVIIème siècle à nos jours, comme un vrai manuel littéraire.
Un essai ? Un traité ? Une histoire littéraire ? Oui à toutes les questions, mais aussi un dialogue avec le lecteur, dans lequel l’auteur n’hésite pas à se mettre en scène, jouant avec les références, les vrais-faux aveux (« Prenez donc garde, lecteur, de ne pas vous fier au texte que vous avez entre les mains »), les vraies-fausses questions (« Est-il possible d’envisager un personnage sans mauvaise foi ? Vous avez envie de répondre oui. Moi aussi ». Espoir ruiné dans les lignes qui suivent, bien sûr…). Et si les impasses sont implacablement constatées (par l’auteur, par le lecteur), l’étude du « paradoxe littéraire » ici déployée est une fine analyse, en général, de ce qu’est la littérature et, en particulier, de la « fécondité sans pareille qui innerve une multitude de trajets d’écriture. ».
Jean-Pierre Longre
17:40 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, maxime decout, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/12/2015
Vibrants instantanés
 Catherine Leblanc, Il n’est pas d’étrangers, L’Amourier, 2015
Catherine Leblanc, Il n’est pas d’étrangers, L’Amourier, 2015
« Les mots écrits ne sont pas les mêmes que les mots parlés. Ce sont des mots gardés, des mots goûtés, des mots sauvés, des mots choisis un à un pour former une flèche touchant au cœur. Les mots écrits préservent le silence. ». Le dernier texte, en guise de postface à ce délicat petit livre, est en quelque sorte une justification de tout ce qui précède (au cas où elle soit nécessaire), une reprise de son essence même ; car ici les mots écrits « touchent des gens qu’on ne connaît pas, qu’on ne voit jamais, des gens qui sont brûlés ou blessés, des gens qu’il ne faut pas approcher en criant. ».
En quatre sections (« Passants », « Parole première », « Pages volantes », « N’être »), Catherine Leblanc présente tout en finesse, dans de courtes pages empathiques, des êtres qu’elle a croisés dans la rue ou ailleurs, ou qu’elle a connus plus personnellement lors de consultations psychologiques ; elle se présente aussi elle-même à la première personne (« J,e, deux petites lettres pour échapper aux crocs »), avec ses souvenirs et ses impressions. Ceux dont elle parle sont des êtres souvent fragiles, ou sous influence : une petite vieille qui traverse la rue, un garçon contrôlé au faciès par la police, un enfant trop sage pour ne pas être violent au fond de lui, un cheval à la fois puissant et docile, un adolescent perturbé…
Ce ne sont pas des portraits en forme, ni des récits de vie, ni des nouvelles, mais un peu tout cela. « Proses brèves », dit le sous-titre, auquel il faudrait ajouter : poèmes. Une poésie composée d’instantanés qui, loin de figer les existences, les traduit en images vibrantes, comme des « bulles irisées » qui « s’éparpillent » et « s’évaporent », cependant que « l’image reste, indissoluble, indestructible. ».
Jean-Pierre Longre
09:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : portraits, poésie, francophone, catherine leblanc, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2015
« La bonne éducation »
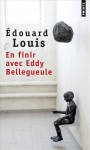 Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Chaque classe sociale a ses normes, ses règles, ses exigences, ses frontières hors desquelles on est considéré comme un paria. Pour échapper à l’ostracisme, seule la fuite semble être la solution. Fuir les autres, fuir la famille, fuir les insultes, les coups et les humiliations, fuir jusqu’à son nom, tel est l’argument du premier roman d’Édouard Louis, dont le succès lors de sa parution aux éditions du Seuil lui vaut maintenant une édition en poche (Points).
Un roman qui superpose et mêle plusieurs genres en une composition binaire : Livre 1, « Picardie (fin des années 1990 – début des années 2000) » ; Livre 2, « L’échec et la fuite ». Plusieurs genres, donc : roman social (l’auteur a lu et étudié Pierre Bourdieu), qui campe et analyse de l’intérieur le prolétariat de la fin du XXème et du début du XXIème siècle, à coups de descriptions sans concessions (mais sans jugement moral) et de citations orales – ce qui, stylistiquement parlant, a le mérite de mêler les registres de langue et de faire ressortir la crudité verbale que l’auteur a su mettre à distance. Le roman autobiographique, qui narre dans un mélange subtil d’objectivité et d’hypersensibilité le douloureux décalage que le jeune Eddy ressent par rapport à sa famille, à ses copains, et qu’il tente désespérément d’effacer. Le roman initiatique d’un garçon qui se sent rapidement différent des autres, féminin, dans un milieu où la virilité ostensible est la marque obligée du monde des hommes, un garçon qui voudrait ne pas être ce qu’il est, qui s’essaie à l’amour des filles mais ne peut échapper à l’opprobre de plus en plus ricanant et hostile de son environnement familial, villageois, scolaire, et qui finalement découvre qu’il y a d’autres manières de vivre que celle dans laquelle il était enfermé.
 En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
Jean-Pierre Longre
16:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Un père, malgré tout?
Pascal Bruckner, Un bon fils, Grasset, 2014 , Le Livre de Poche, 2015
, Le Livre de Poche, 2015
« Mon père m’a permis de penser mieux en pensant contre lui. Je suis sa défaite : c’est le plus beau cadeau qu’il m’ait fait ». Tel est le point de convergence des souvenirs et des réflexions dont est composé Un bon fils. Récit de vie paternelle ? Autobiographie ? Règlement de compte ? Essai de psychologie familiale ? Il n’y a pas à choisir : le livre est un peu tout cela, qui, entre narration discontinue et mosaïque de maximes philosophiques, en fait une œuvre littéraire.
En trois parties (« Le détestable et le merveilleux », « L’échappée belle », « Pour solde de tout compte ») et un épilogue-surprise, Pascal Bruckner développe le paradoxe du « bon fils » d’un père qui, dirait-on, fait tout pour être haï : mari brutal, pervers et infidèle, antisémite, xénophobe, pronazi s’empressant d’aller travailler pour l’ennemi, être despotique et imprévisible, puis exemple encore vivant de la décrépitude physique – s’accrochant envers et contre tout à son fils unique qui, en réaction, s’éloigne avec vigueur et passion d’une enfance inquiète. « Je me suis allégé de ma famille en m’alourdissant d’autres liens qui m’ont enrichi ».
 Le salut, pour le fils du tyran, ce sera d’abord la lecture. « Dans les livres, enfin, j’apprends la grammaire de la liberté grâce aux dieux de ma jeunesse, Sartre, Gide, Malraux, Michaux, Queneau, Breton, Camus. Je me construis à travers eux une forteresse inexpugnable ». Ce sera aussi la prise de l’indépendance et de la liberté (les voyages, les amours, le rejet des contraintes de l’existence bourgeoise). Et ce sera, bien sûr, l’écriture, ces livres qui font de Pascal Bruckner un auteur original, à la fois penseur (de ceux que l’on rangeait naguère parmi les « nouveaux philosophes ») et auteur de belles fictions romanesques. « Tant qu’on crée, tant qu’on aime, on demeure vivant ». Ce récit initiatique, qui ne s’arrête pas au simple dévoilement de secrets de famille, mais élargit le champ d’investigation à l’apprentissage de la vie, le prouve avec limpidité.
Le salut, pour le fils du tyran, ce sera d’abord la lecture. « Dans les livres, enfin, j’apprends la grammaire de la liberté grâce aux dieux de ma jeunesse, Sartre, Gide, Malraux, Michaux, Queneau, Breton, Camus. Je me construis à travers eux une forteresse inexpugnable ». Ce sera aussi la prise de l’indépendance et de la liberté (les voyages, les amours, le rejet des contraintes de l’existence bourgeoise). Et ce sera, bien sûr, l’écriture, ces livres qui font de Pascal Bruckner un auteur original, à la fois penseur (de ceux que l’on rangeait naguère parmi les « nouveaux philosophes ») et auteur de belles fictions romanesques. « Tant qu’on crée, tant qu’on aime, on demeure vivant ». Ce récit initiatique, qui ne s’arrête pas au simple dévoilement de secrets de famille, mais élargit le champ d’investigation à l’apprentissage de la vie, le prouve avec limpidité.
Jean-Pierre Longre
14:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, récit, pascal bruckner, grasset, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/12/2015
Boccace au bistrot
 Melvin Van Peebles, Le Chinois du XIVe. Préface d’André Hardellet, illustrations de Topor, Wombat, 2015
Melvin Van Peebles, Le Chinois du XIVe. Préface d’André Hardellet, illustrations de Topor, Wombat, 2015
Dans le Décaméron, Boccace (1313-1375) imagine que dix jeunes gens et jeunes filles, isolés dans une villa à cause de la peste qui sévit à Florence, consacrent dix journées à se raconter des histoires de toutes sortes. Dans Le Chinois du XIVe, la villa de Toscane est remplacée par Mon Moulin, bistrot du quatorzième arrondissement de Paris, la peste devient une coupure d’électricité provoquée par la grève, et les conteurs sont des « petits », des gens du peuple parisien des années 1960, dont les histoires sont tirées de leur expérience, de leurs rêves, de leur imagination…
Il y a là, par exemple, un veilleur de nuit inquiet de la puissance des savants, un clochard qui a laissé filer le grand amour par ambition, un représentant suggérant mine de rien le moyen de régler radicalement les problèmes familiaux, une bonne à tout faire réincarnation de l’immaculée conception, le patron du troquet et sa femme, aux souvenirs d’enfance où les chiens jouent un rôle, d’autres encore… Le fameux Chinois, lui, joue les Arlésiennes dès le début ; il a disparu de la circulation, et finalement au bout de quelques jours il n’est plus question de lui, sinon dans le titre du livre.
Un livre par ailleurs impossible à résumer – ou alors il faudrait raconter toutes les histoires qu’échangent les convives autour d’une table éclairée par une lampe à pétrole. Des histoires dans lesquelles la réalité, avec ses grand malheurs et ses petits bonheurs, ses tristesses et ses joies, avec les colères et la solidarité que tout cela suscite, la réalité, donc, côtoie allègrement les rêves d’une autre vie, les fantasmes et les cauchemars. Le Chinois du XIVe est un livre d’atmosphère (à laquelle contribuent largement les illustrations de Topor), écrit par un Américain éclectique, musicien, cinéaste, traducteur et, bien sûr écrivain « d’expression française », une « expression » originale, dans tous les sens du terme – disons à la fois de pure origine populaire et sortant de l’ordinaire. Narration et poésie, burlesque et pathétique, suspense et sagesse, étrange et pittoresque – un beau mélange des genres pour une lecture d’une réjouissante variété.
Jean-Pierre Longre
22:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, conte, francophone, melvin van peebles, andré hardellet, topor, wombat, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
À la poursuite du vibrion cholérique
 Anne Roiphe, L’insaisissable, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Les éditions du Sonneur, 2015
Anne Roiphe, L’insaisissable, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Les éditions du Sonneur, 2015
En 1883, une épidémie de choléra sévit à Alexandrie. Louis Pasteur confie à de jeunes chercheurs français la mission de partir dans la ville égyptienne afin de traquer et d’identifier le microbe responsable de la maladie qui a ravagé de nombreuses régions du monde au cours des siècles. À partir de ce fait scientifique, Anne Roiphe, journaliste et écrivain née en 1935 aux États-Unis, a composé une épopée romanesque dans laquelle vérité historique et suspense narratif se répondent et se mêlent intimement.
Le contexte géographique, campé avec précision et pittoresque, est donc celui d’Alexandrie à la fin du XIXe siècle, ville grouillante de vie malgré l’épidémie, cité où se mêlent l’antique et l’actuel, port cosmopolite où se côtoient les communautés de diverses origines, de diverses religions – avec ce que cela implique d’amitiés sincères mais aussi de rivalités et de trafics en tous genres. Il y a encore le contexte médical, dans lequel émergent des personnes réelles (l’équipe des chercheurs français et celle des chercheurs allemands menée par le fameux Robert Koch), mais aussi des personnages fictifs comme le docteur Malina, honorable médecin juif renommé dans la ville, qui avec sa famille sera victime du machiavélisme des Anglais, et dont la fille, Este, va devenir l’héroïne féminine du roman. Car un amour réciproque naît peu à peu entre la jeune fille et Louis Thuillier, membre du petit groupe de français qui a installé son laboratoire dans l’hôpital européen de la ville – et cet amour va de pair avec l’intérêt grandissant d’Este pour le travail de recherche médicale. D’autres personnages nés sous la plume de la romancière jouent des rôles qui, bien qu’ils paraissent secondaires, changent radicalement le cours du récit : tels le jeune Marcus, aide de laboratoire en quête de fortunes faciles, Eric Fortmann, aventurier hâbleur et sans scrupules, ou Albert, initialement fiancé à Este…
Pour historique qu’il soit, L’insaisissable est donc un vrai roman, une fiction dans laquelle les sentiments, les passions et les manœuvres nouent des destins dramatiques. De surcroît, l’aspect documentaire, assuré par des extraits de lettres de Pasteur et d’ouvrages spécialisés, ainsi que par de minutieuses descriptions des corps malades et des expériences de laboratoire, est rehaussé par les épisodes qui font du mystérieux microbe un être vivant et invisible s’insinuant dans l’eau, les humeurs, les tissus, les organes, les moindres recoins de la ville, des rues, des maisons et des corps, une sorte de fantôme morbide et diabolique qui exerce ses ravages de manière subreptice, imprévisible et fatale. Et ceux qui le traquent risquent bien d’être à leur tour traqués, d’en devenir les victimes. Insaisissable, jusqu’au bout.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, anne roiphe, blandine longre, choléra, louis pasteur, robert koch, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Parvenir à quelque chose »
 Sophie Divry, Quand le diable sortit de la salle de bain, Notabilia / Les Éditions Noir sur Blanc, 2015
Sophie Divry, Quand le diable sortit de la salle de bain, Notabilia / Les Éditions Noir sur Blanc, 2015
Voilà bien un roman contemporain, dans tous les sens du qualificatif. Sa période de publication correspond fidèlement à la condition de nombreux trentenaires d’aujourd’hui : combiner les contraintes du dénuement financier (le chômage, les factures qui continuent d’arriver, la recherche de nourriture et de vêtements, les reproches ou les interrogations de la famille, les comptes pathétiques de fin de mois…) avec les exigences culturelles et sociales d’une âme généreuse, d’un esprit lucide et critique, d’un cœur en quête d’affection et d’amitié.
Entendons-nous : Quand le diable sortit de la salle de bain n’est pas une étude sociologique. C’est mieux que cela. La narratrice comble sa misère matérielle en racontant, sur un mode plus humoristique que dramatique, ses déboires, ses espoirs, ses déceptions, ses joies aussi, l’amitié parfois éprouvante qui la lie à Hector (gentil obsédé sexuel), les apparitions de Lorchus, son démon littéraire, les interruptions imaginaires ou réelles de ses proches (sa mère surtout), les visites à Pôle Emploi, le séjour méridional dans le cocon nourricier de la famille, le retour à Lyon, les difficultés du métier de serveuse – car il faut bien, un jour, se mettre à travailler en renonçant à « toute ambition personnelle », en tentant tout de même de « parvenir à quelque chose ».
Roman très actuel, donc, qui se lit avec un pur plaisir. Récit en trois parties, « roman improvisé, interruptif et pas sérieux » (sous-titre donné par l’auteure elle-même) ? « Improvisé » en apparence, en réalité construit ; « interruptif », certes, mais avec un bon fil conducteur ; « pas sérieux », tout est relatif : le sujet est grave, le style alerte, l’allure rieuse, la narration pleine de références littéraires, et toutes les ressources de la typographie sont mises à contribution: tableaux, calligrammes, listes, colonnes, dialogues simultanés, schématisation – insérée dans l’écriture – des positions corporelles et des dispositions mentales (sur un lit, par exemple, le personnage désespéré contemplant le plafond), sigles et signes divers… Et, comme dans les DVD, un « bonus » avec « index des principaux auteurs cités, pillés ou dissous », traces d’une quatrième partie, « note d’intention ». Sophie Divry a du métier et, bien plus, du talent.
Jean-Pierre Longre
13:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, sophie divry, notabilia, les Éditions noir sur blanc, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« En faveur de la lecture »
 Jean-Jacques Nuel, Billets d’absence, Le Pont du Change, 2015
Jean-Jacques Nuel, Billets d’absence, Le Pont du Change, 2015
Il y a eu les Courts métrages, il y a maintenant les Billets d’absence, comme de petits mots signalant que l’on est toujours là, même si la « séparation de corps » (titre du premier texte) signale un éloignement de soi, une prise d’indépendance. Jean-Jacques Nuel est toujours présent, dans une sorte de dédoublement, le trait d’union entre Jean et Jacques prenant parfois de drôles d’allure et le choix entre l’espace et le temps étant parfois difficile à faire.
La longueur des textes varie entre trois lignes et une page. C’est suffisant pour que s’y logent les surprises, l’humour (noir, rose ou les deux à la fois), les réflexions sous forme d’anecdotes légères ou tragiques (en particulier sur le livre, la littérature, la lecture), l’absurde, la poésie. Oui, quelques mots suffisent pour laisser une belle image onirique s’imposer à l’esprit (par exemple : « La ligne de flottaison du rêve était si basse que le dormeur risquait à tout moment, s’il se retournait trop fort dans son lit, de sombrer. ») ; ou pour livrer quelques confidences sur le temps qui passe, sur la mort, sur la vie, confidences qui, si personnelles qu’elles soient, concernent tout un chacun ; ou encore pour cibler quelque défaut flagrant de la société humaine.
Passent au fil des pages quelques auteurs fameux : Schopenhauer, Emily Brontë, Faulkner, Isidore Ducasse (en compagnon de route), Kafka (bien sûr), Jacques Sternberg (sans doute, en filigrane) ; mais surtout Jean-Jacques Nuel, qui, comme naguère l’ami Pierre Autin-Grenier, voue une sorte de culte mitigé au ratage, à l’échec, jusqu’à s’étonner d’être lu : « Le timide succès qui semble commencer à se dessiner aujourd’hui me perturbe et ne laisse pas de m’inquiéter : quelle erreur ai-je bien pu commettre pour plaire enfin et trouver sur le tard un public ? ». Eh bien, cher écrivain, pas d’étonnement ! Si succès il y a, il est mérité. Et vos « billets d’absence » participent sans conteste à « une politique en faveur de la lecture ».
Jean-Pierre Longre
12:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, poésie, francophone, jean-jacques nuel, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2015
Irrésistibles élans
 Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, Les éditions du Sonneur, 2015
Nicolas Cavaillès, Pourquoi le saut des baleines, Les éditions du Sonneur, 2015
La question est-elle absurde ? Pas plus que le geste sur lequel elle porte. Pas moins non plus. En réalité, écrit l’auteur, « nous ignorons pourquoi les baleines et autres cétacés effectuent parfois ces sauts stupéfiants au-dessus des mers et des océans, mais les hypothèses ne manquent pas, elles se renforcent même du fait que la question n’a pas été tranchée. ». Une fois évacuée (mais non définitivement écartée) l’éventualité du saut « quia absurdum », qui serait peut-être la preuve de l’esprit philosophique des baleines, nous avons droit, après une revue de « détail » des différentes familles de cétacés, au développement de toutes les réponses possibles à la question que posent les bonds étranges, inattendus, violents, différents selon les espèces, des baleines hors de l’eau.
Nicolas Cavaillès, pour l’occasion, se livre à toutes les hypothèses, depuis les explications (contestées) des Vikings (« Un moyen de se déplacer plus facilement, et de détruire les navires ») jusqu’aux élucubrations sur le caractère érotique des sauts collectifs (« orgies de caresses, ébats en groupe »). Chemin faisant, nous apprenons de bonnes et belles choses sur la vie et la mort, le tempérament et la physiologie de ces êtres fascinants, nous plongeons dans les études aristotéliciennes sur la locomotion animale, en surgissons pour tomber sur un chapitre hautement mathématique, empli de formules fondées sur la « poussée d’Archimède »…
Par-dessus tout, ce qui paraît être un bref essai scientifique mâtiné de rappels historiques et de détachement fantaisiste, voire humoristique, est aussi une méditation sous-tendue par la réflexion philosophique et le sentiment artistique. La Bible, Kierkegaard, Nietzsche sont sollicités, et aussi Herman Melville (bien sûr pour Moby Dick), Dostoïevski, Glenn Gould et son interprétation des Variations Goldberg… Cela pour dire que le mammifère aquatique voudrait aussi être aérien, aspire comme le mammifère humain, entre la naissance et la mort, à échapper à la « fadeur de l’existence » et à pénétrer dans « le Grand Tout homogène où le ciel et la mer ne font qu’un, sans hiérarchie ni haut ni bas, partageant de mêmes flux magnétiques sans distinction entre les quatre points cardinaux d’une planète ronde. ». Pourquoi Nicolas Cavaillès a-t-il cherché des réponses à la question du « saut des baleines » ? Sans doute pour mieux poser celle, tout aussi énigmatique, de l’existence humaine. Allez savoir…
Jean-Pierre Longre
Nicolas Cavaillès, spécialiste de Cioran, traducteur du roumain, éditeur, écrivain, a obtenu le Prix Goncourt de la nouvelle en 2014 pour Vie de Monsieur Leguat (Les éditions du Sonneur).
Voir http://jplongre.hautetfort.com/tag/nicolas+cavaillès
14:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, francophone, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Une assourdissante absence
 Pascal Herlem, La soeur, L’arbalète Gallimard, 2015
Pascal Herlem, La soeur, L’arbalète Gallimard, 2015
Le premier mot du titre, en deux lettres, en dit déjà long : ni « ma », ni « notre » ; « la » sœur n’appartient à personne, à peine à la famille, cette « sœur aînée, presque une inconnue. Une sœur qu’en croyant bien faire on a lobotomisée », cette sœur dont l’auteur écrit : « Je l’ai toujours connue ainsi, absente ».
Absente, mais sans cesse présente d’une manière ou d’une autre, pendant et après l’enfance, dans une famille dominée par « la » mère (toujours cette non appartenance). Pascal Herlem puise dans ses souvenirs d’enfant et d’adulte, mais aussi dans trois récits laissés par la mère, « trois récits glaçants » qui composent quelque peu avec la vérité, sans occulter les faits : la lobotomie qui ne résoudra rien, les hospitalisations, les périodes de crise, la disparition de Françoise dans différentes maisons où elle restera enfermée loin de ses deux frères qui paraissent s’accommoder de cette absence, de ce silence en réalité assourdissant. Une sorte de mort par anticipation – et la découverte finale en est pour ainsi dire une attestation.
Racontant l’histoire de Françoise, l’auteur raconte sa propre histoire et celle des siens, remontant aux « origines » d’une famille déclassée, dans laquelle la bâtardise, la mort, la folie voudraient être effacées par les rêves de réhabilitation sociale de la mère, comme par les « arrangements », les non-dits et l’enfouissement des secrets. De surcroît, l’étrange (ou compréhensible ?) effacement du père devant l’omniprésence de la mère est une constante, jusqu’à la fin : « Papa n’est pas là, il est ailleurs, on ne sait pas où ». Bref, tout cela méritait d’être raconté, et Pascal Herlem le fait avec une courageuse sincérité, sans complaisance mais sans animosité, avec une sensibilité tout en retenue qui n’exclut ni la prise de distance, ni l’esquisse d’explications socio-psychologiques, ni, surtout, un travail de mise en ordre littéraire. La force du sujet et de son traitement qui laisse percer de tendres et tenaces regrets, le choix précis des mots, la belle et suggestive limpidité du style font de La sœur un livre que l’on ne peut oublier.
Jean-Pierre Longre
10:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, pascal herlem, gallimard, l’arbalète, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/12/2015
Explosante-fixe
 Irina Teodorescu, Les étrangères, Gaïa, 2015
Irina Teodorescu, Les étrangères, Gaïa, 2015
Le nouveau roman d’Irina Teodorescu ne laisse pas le lecteur en repos ; c’est tant mieux. De l’image à jamais fixe de la photographie à l’incessant mouvement circulaire de la danse, il doit se frayer son chemin, le lecteur. Et entre les deux formes artistiques, une troisième s’impose, qui fait le lien : la musique, sonore ou silencieuse. En outre, il y a les voyages, les va-et-vient entre Bucarest et Paris, entre la ville étrange et reposante de Kalior (la plus belle, sans doute) et l’Europe – et par-dessus tout, l’amour.
La narration est multiple, en instantanés, en spirales, en arrêts sur image, en bonds, autour des deux protagonistes. Il y a d’abord Joséphine, petite puis jeune fille franco-roumaine, élevée sous la dictature de Ceauşescu mais pouvant circuler, avec ses parents, entre la Roumanie et la France. Amoureuse de sa professeure de violon, puis passionnée de photographie, elle sacrifie ses études et ses diplômes à cette passion qui lui vaut un succès international. Et c’est le grand amour : celui de Nadia, la ronde danseuse, avec qui elle va tout partager (la vie, l’art, les voyages, les confidences), et qui va peu à peu se raconter elle-même, raconter leur existence fusionnelle. « Pendant quatre ans, Joséphine et moi fûmes un seul corps. Comme des amantes siamoises. ». Puis les séparations, les retours, la fuite solitaire vers un ailleurs situé entre veille et rêve, un espace à la fois mouvant et immobile.
Les étrangères (aux autres, à elles-mêmes, au monde) est un roman de l’entre-deux (entre deux pays, entre deux langues, entre deux arts, entre deux femmes, entre réel et imaginaire, entre fusion et séparation…) et de la quête d’un absolu artistique : photographier l’invisible (la musique, l’intérieur des gens), danser sur le silence, fixer le mouvement – comme l’image « explosante-fixe » de la « beauté convulsive » chère à André Breton. C’est aussi, et surtout, le roman d’une écriture ; celle d’une auteure qui a appris la langue française à l’âge de 19 ans, et qui quinze ans plus tard parvient à la maîtriser au point de la rendre malléable, et, tout au long de ces 200 pages, d’adapter son style à celui des protagonistes, de leur âge, de leurs préoccupations, de leur tempérament. Laisser leur liberté d’expression à ses personnages, voilà un bel idéal romanesque.
Jean-Pierre Longre
http://www.arte.tv/magazine/metropolis/fr/irina-teodoresc...
16:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, irina teodorescu, gaïa-éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Lointain familier
 Jean-Luc Sahagian, Varduhi Sahagian, Gumri, Arménie, si loin du ciel… Ab irato, 2015
Jean-Luc Sahagian, Varduhi Sahagian, Gumri, Arménie, si loin du ciel… Ab irato, 2015
La grand-mère (« Tamam ») de Jean-Luc Sahagian, fuyant la Turquie après le génocide des Arméniens en 1915, se retrouva un jour à Marseille, et c’est ainsi que son petit-fils est un Arménien de France (ou un Français d’origine arménienne ?). Longtemps après, il décide de partir pour Gumri, ville du Nord-Ouest de l’Arménie, où son père s’était rendu après le tremblement de terre de 1988, peu avant la fin de l’Union Soviétique.
L’Arménie est pour lui « non pas une terre d’identité, de racines, mais une étrangeté peut-être familière ». Accueilli avec la bienveillance orientale que l’on manifeste là-bas aux visiteurs, Jean-Luc raconte ses découvertes, ses rencontres – dont celle de l’amour – et ce livre est le fruit « de deux regards » complémentaires, le sien et celui de « Rose » (Varduhi), qui donne en artiste sa vision dessinée de Gumri, vue de l’intérieur.
Il ne s’agit ni pour l’un ni pour l’autre de verser dans le pittoresque exotique, mais de décrire avec vivacité, tendresse, humour la vie quotidienne d’une ville qui a été durement éprouvée par la dictature soviétique, le tremblement de terre meurtrier et destructeur, le capitalisme sauvage entraînant l’émergence des mafias et des disparités sociales – sans parler du souvenir latent du génocide –, une ville où beaucoup rêvent d’ailleurs, mais à laquelle la solidarité, un « fort sentiment de communauté », le sens de la fête et du rire donnent une coloration pleinement humaine. L’auteur, dans ses allées et venues à Gumri, au-delà de tous les inconforts, de toutes les contraintes matérielles, va s’y trouver « en pays de connaissance » et s’y attacher profondément. « Bien sûr, l’Arménie est dure à vivre pour ses habitants et cette dureté est renforcée encore par la douleur profonde de son histoire. Mais on trouve aussi tellement de raisons d’y être heureux malgré tout… ». Bien mieux qu’un guide touristique, ce beau livre, texte et dessins combinés, incite à aller voir là-bas, « à quatre mille kilomètres de la France. ».
Jean-Pierre Longre
14:02 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, dessin, francophone, arménie, jean-luc sahagian, varduhi sahagian, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Nous n’irons plus nus »
 Christophe Girard, Le linceul du vieux monde. La révolte des canuts, livre 3, Les enfants rouges, novembre 2014
Christophe Girard, Le linceul du vieux monde. La révolte des canuts, livre 3, Les enfants rouges, novembre 2014
Novembre 1831 fut, à Lyon, un mois particulièrement tourmenté, fiévreux, sanglant, un mois qui a marqué une étape décisive dans l’histoire de la ville comme dans celle du mouvement ouvrier. Les deux premiers livres de La révolte des canuts racontaient les prémices de cette révolte, les injustices, les premières manifestations, la répression dans des images et des dialogues aussi expressifs que vigoureux (voir ici).
Cette vigueur et cette expressivité, on les retrouve, toujours en noir et blanc, dans le livre 3 sous-titré « À l’aube du rêve ». Un rêve qui, dans l’immédiat, restera à l’état de belle illusion pour laquelle tant de sang d’ouvriers (mais aussi de soldats et de « victimes collatérales ») aura coulé. Un rêve, tout de même, que les dernières images (un dialogue, trente ans plus tard, entre Karl Marx et le journaliste Pétretin) signalent comme les débuts de la défense du prolétariat ; un rêve que chantera, encore plus tard, Aristide Bruant : « Mais notre règne arrivera / Quand votre règne finira ».
Voilà donc un album historiquement décisif, plein d’enseignements sur la tournure qu’ont prise les événements : violences, rivalités humaines et politiques, clivage entre l’idéal républicain et les revendications catégorielles, mainmise des pouvoirs locaux et surtout du pouvoir central incarné par Louis-Philippe et par ses envoyés… L’histoire est complexe, les rebondissements et les revirements sont nombreux, les événements s’imbriquent les uns dans les autres, mais le genre de la bande dessinée aide à s’y retrouver – à condition, comme c’est le cas ici, que le texte soutienne abondamment le dessin, explicitant les enjeux, les manœuvres, les indignations, mettant en relief les portraits pittoresques aux traits marqués. Et au milieu des noms plus ou moins connus, des souvenirs plus ou moins effacés, se glissent quelques allusions malicieuses à des situations encore bien actuelles, tel le cumul des mandats (« Vous faites partie de cette nouvelle espèce de parlementaires, ces cumulards qui prospèrent et qui à force de trop vouloir faire ne font rien mais gagnent beaucoup »), ou des détournements d’œuvres notoires comme L’Angélus de Millet…
Avec les trois livres du Linceul du vieux monde, Christophe Girard met en perspective le passé local et national, rend l’Histoire accessible à tous. Instruire en divertissant, c’est toujours la bonne formule…
Jean-Pierre Longre
10:07 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, histoire, lyon, christophe girard, les enfants rouges, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2015
Le petit blond en Syrie
 Riad Sattouf, L’Arabe du futur 2. Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985), Allary Éditions, 2015
Riad Sattouf, L’Arabe du futur 2. Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985), Allary Éditions, 2015
La renommée de Riad Sattouf n’est plus à faire (voir par exemple La vie secrète des jeunes, Ma circoncision ou Les cahiers d’Esther,l’impayable feuilleton hebdomadaire du Nouvel Observateur), et le deuxième volume de L’Arabe du futur la justifie encore, cette renommée. Dans la Syrie de 1984, sous le règne d’Hafez Al-Assad, le petit Riad, six ans, fait ses débuts à l’école sous la férule de maîtres intraitables, se frotte à la vie sociale et à ses vicissitudes, à la vie familiale entre une mère bretonne et un père arabe, des cousins, des oncles et tantes, quelques représentants de classes sociales intrigantes (dans tous les sens du terme)…
 Il faut voir et lire cette autobiographie savoureusement dessinée, vivement dialoguée, cette autoreprésentation d’un petit garçon qui découvre la vie de sa hauteur, avec une naïveté malicieuse, d’un petit garçon qui s’étonne, s’adapte, s’amuse, s’émeut, comprend avec sa finesse d’enfant certains rouages de la société. Et tout cela sans parti-pris, sans manichéisme, mais avec une tendresse qui n’exclut ni le pittoresque des personnages, ni les regards lucides, ni les sous-entendus satiriques. Comme le petit Riad, avec lui, on s’étonne, on s’amuse, on s’émeut, on comprend toutes sortes de choses, et ces 150 pages de BD (ou roman graphique), à leur manière, nous en apprennent au moins autant qu’un ouvrage d’histoire contemporaine ou un reportage – le rire et le sourire en prime. Vivement la suite (et en attendant, relisons le premier volume)…
Il faut voir et lire cette autobiographie savoureusement dessinée, vivement dialoguée, cette autoreprésentation d’un petit garçon qui découvre la vie de sa hauteur, avec une naïveté malicieuse, d’un petit garçon qui s’étonne, s’adapte, s’amuse, s’émeut, comprend avec sa finesse d’enfant certains rouages de la société. Et tout cela sans parti-pris, sans manichéisme, mais avec une tendresse qui n’exclut ni le pittoresque des personnages, ni les regards lucides, ni les sous-entendus satiriques. Comme le petit Riad, avec lui, on s’étonne, on s’amuse, on s’émeut, on comprend toutes sortes de choses, et ces 150 pages de BD (ou roman graphique), à leur manière, nous en apprennent au moins autant qu’un ouvrage d’histoire contemporaine ou un reportage – le rire et le sourire en prime. Vivement la suite (et en attendant, relisons le premier volume)…
Jean-Pierre Longre
20:03 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, riad sattouf, allary Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« L’étincelle de nos espoirs »
 Jacques Baujard, Panaït Istrati. L’amitié vagabonde, Transboréal, 2015
Jacques Baujard, Panaït Istrati. L’amitié vagabonde, Transboréal, 2015
Une biographie supplémentaire de Panaït Istrati ? Celle de Monique Jutrin, récemment rééditée (voir ici ou là) ne suffisait-elle pas ? Sur le plan documentaire, si, bien sûr. C’est une somme. Mais le livre de Jacques Baujard est d’un autre genre – outre le fait qu’il confirme la renaissance d’un écrivain qui, c’est justice, reprend sa place dans le paysage littéraire européen.
Un écrivain qui est aussi un personnage romanesque. Et de fait, cette biographie, tout en répondant aux critères du genre (les grands événements de la vie, les ouvrages, la chronologie, des documents, une carte des voyages…), se lit comme un roman. Car l’auteur ne se contente pas de reconstituer la vie d’un autre. Il raconte comment lui-même ressent cette vie, comment Panaït Istrati, qu’il a découvert, jeune libraire, par le hasard d’une commande faite par un client négligent, est devenu pour lui un ami qu’il a suivi à la trace dans ses œuvres et, sur place, dans son pays d’origine, qu’il a parcouru par la même occasion.
La destinée d’Istrati, on le sait, est pleine de péripéties, de malheurs, de bonheurs, de désespoirs, d’espoirs, de rebonds. L’homme a souffert, a aimé, a beaucoup travaillé, bourlingué, s’est toujours battu – pour vivre, pour apprendre le français, pour changer le monde, pour les autres –, en dehors des sentiers battus, des dogmes et des schémas tout faits (ou disons que de ceux-ci, il est revenu, constatant que la liberté et l’amitié sont les vrais critères, ce qui lui a valu la haine des idéologues de tous bords). Jacques Baujard nous rappelle tout cela, se référant maintes fois à l’œuvre du conteur, à sa correspondance, à ses réflexions, et nous donnant en prime, en de beaux et émouvants mélanges finaux, des aperçus de « l’univers de Panaït Istrati » - ses amis, ses amours, ses lectures, ses métiers, ses personnages, bien d’autres choses encore.
Surtout, on sent une profonde connivence entre le libraire libertaire d’aujourd’hui et l’écrivain vagabond mort en 1935. C’est un dialogue entre amis qui s’établit, en des écritures qui tendent à se confondre, départagées par les seuls guillemets, le tout aboutissant à une profession de foi commune. « De la même manière que Panaït Istrati, il vaut mieux se concentrer sur des valeurs universelles. Prôner la tolérance afin de se rassembler plutôt que de se déchirer. Vagabonder à travers les différentes cultures de la planète pour élargir nos horizons et comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit. Plus que toute autre chose, hisser bien haut l’étendard de l’amitié. La donner au premier venu avec passion. La partager au milieu des verres, des rires, des pleurs et des beaux souvenirs. Avoir confiance en l’homme et ses limites, plutôt qu’en la machine. […] Et ma foi, malgré le désespoir ambiant et même si la partie semble jouée d’avance, il faut à tout prix avoir confiance en ses capacités et entretenir l’étincelle de nos espoirs. ».
Jean-Pierre Longre
18:44 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, biographie, francophone, roumanie, jacques baujard, panaït istrati, transboréal, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Images d’une passion musicale
 Sandrine Revel, Glenn Gould. Une vie à contretemps, Dargaud, 2015
Sandrine Revel, Glenn Gould. Une vie à contretemps, Dargaud, 2015
Est-il possible de percer « le mystère Glenn Gould » (disons plutôt les mystères, tant le personnage paraît complexe)? Pas vraiment. Mais l’album graphique de Sandrine Revel fournit des approches à la fois esthétiquement séduisantes et intellectuellement convaincantes. Il est rare qu’une biographie de célébrité pénètre à ce point dans la personnalité, dans les secrets même de son protagoniste. L’auteure, dans cette perspective, utilise avec à-propos et talent les ressources de la bande dessinée.
La narration ne se contente pas de raconter. Ou si elle le fait, c’est dans un constant va-et-vient entre les différentes périodes (enfance, concerts, enregistrements, voyages, accidents de santé, relations amicales et amoureuses, fuites, retours…), entre la vie réelle avec ses vicissitudes et ses instants de bonheur, et la vie rêvée avec ses illusions et ses cauchemars, entre les interviews du musicien et les témoignages de ses proches. Ainsi, l’essentiel est dit, à la fois dans le texte écrit et dans le silence des dessins.
Car l’avantage du genre bien exploité est de faire passer par l’image ce que les mots ne peuvent pas exprimer : les visions, les délires, les souvenirs, l’hypocondrie, l’isolement (qu’accompagnent l’amour des animaux, le goût pour les immensités, « l’aspect nordique de l’être humain » et « les ciels nuageux »). Surtout – et ce peut être considéré comme une gageure – l’image (traits, dessins, couleurs, dimensions) réussit à montrer la musique : attitudes physiques du pianiste dans toute leur originalité, expressivité du visage, mouvements des mains sur le clavier (des planches entières montrent les différentes positions des doigts, si bien observées, si bien reproduites), sans parler de l’exigence absolue de Glenn Gould dans le choix de son piano, de son siège, des appareils d’enregistrement…
Pas d’explications rationnelles, pas de détails superflus, pas de descriptions gratuites, pas de récit linéaire. Mais l’album suggère parfaitement cette « vie à contretemps » d’un être pour qui la perfection musicale est un idéal, une passion, voire une obsession vers lesquels tendent tous les instants de son existence, jusqu’à l’effacement. Et l’ultime but, qu’il définit lui-même : « La musique pour l’auditeur comme pour l’interprète doit amener à la contemplation. ».
Jean-Pierre Longre
16:29 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, biographie, musique, glenn gould, sandrine revel, dargaud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Le mystère d’Edward Hopper »
 Michel Arcens, La maison d’Hannah et autres fictions, Alter Ego Éditions, 2015
Michel Arcens, La maison d’Hannah et autres fictions, Alter Ego Éditions, 2015
Les vingt textes que Michel Arcens propose « dans la lumière d’Edward Hopper » ne sont ni des descriptions ni des commentaires de tableaux. Serait-il d’ailleurs possible pour un écrivain de traduire en mots ce que seule la peinture sait dire et sous-entendre ? L’artiste lui-même jugeait vaine toute tentative de ce genre. Non : l’intention avouée de Michel Arcens est de « pénétrer dans la peinture de Hopper » en lui apportant une part « mystérieuse », « inconnue », secrète de soi-même.
Pas de méprise : il ne s’agit pas de confession intime, de journal personnel ou esthétique. Il s’agit de rester dans les limites imposées par les toiles ici reproduites, dans leur immobilité, leur luminosité, leurs couleurs, leurs perspectives, leurs motifs (personnages en attente, bâtisses isolées, étendues marines ou campagnardes, paysages citadins…). Mais dans ces limites mêmes, la profondeur des tableaux sollicite l’imagination, la puissance du rêve, le mouvement narratif, qui eux-mêmes suscitent la poésie et le récit.
Cela donne des nouvelles qui sont comme des illustrations verbales, de délicats prolongements de l’œuvre peinte, et qui provoquent chez celle-ci des pulsions parfois inattendues. De ces toiles qui en surface paraissent figées (ce que confirment le style et la teneur des extraits descriptifs), l’auteur sait, à partir de sa propre expérience, de sa sensibilité personnelle et de références littéraires identifiées, extirper l’histoire singulière de personnages plus ou moins inventés, les sensations physiques, les mouvements de la nature cosmique, minérale, végétale, ceux du temps qui passe, voire les parfums, la musique et la danse. Illusions ? Sans doute, mais illusions heureuses. Hannah a disparu, mais : « C’est un prodige étrange qu’Hannah soit ici, maintenant, présente, vibrante, heureuse. Elle passe lentement ses doigts sur mes paupières, puis ma bouche, jusqu’au menton. Elle pose ses lèvres sur les miennes, entrouvertes de tant de merveilles… ». Ces merveilles, ce sont celles de la peinture et de l’écriture conjuguées.
Jean-Pierre Longre
14:11 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, peinture, edward hopper, michel arcens, alter égo éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Kafka à l’Université
 Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Voulant d’urgence échapper (au moins quelques années) aux turbulences de l’enseignement en collège, Jeanne décide de s’inscrire en thèse. Après l’euphorie des débuts (bien qu’elle n’ait pu obtenir de financement), commence le parcours du combattant universitaire.
Combattant, ou soutier, comme on voudra. Franchie l’étape du dossier d’inscription, entravée par l’inertie dissuasive de la secrétaire ; celle de l’entretien avec le directeur de recherches, aussi charmant que silencieux, laissant passer six mois avant de répondre au moindre mail ; celle des cours à donner, dont la préparation mange tout le temps que l’on croyait réserver à la recherche, et qui finalement se révéleront aussi peu lucratifs qu’inutiles ; celles, successives, de la documentation bibliographique envahissante, de l’établissement d’un plan aussi labyrinthique que changeant, de la rédaction sans cesse repoussée mais à laquelle il faudra bien se mettre un jour… Sans compter l’incompréhension de l’entourage (le petit ami, la famille) qui ne s’explique pas pourquoi Jeanne se lance dans un travail qui ne rapporte rien, qui paraît totalement vain, voire irresponsable, et qui exacerbe son égocentrisme ; pas comme le cousin Alexandre qui, lui, va faire une thèse scientifique, utile au progrès de l’humanité, n’est-ce pas ; mais à quoi peut bien servir un travail sur la parabole de la loi dans Le Procès de Kafka ? Cela dit, lorsque Jeanne parviendra à sa soutenance, l’entourage en question sera aussi fier qu’il aura été sceptique et critique les années précédentes…
Tiphaine Rivière aurait pu écrire un roman autobiographique. Cela nous aurait privés du charme de ses dessins, qui tient au trait à la fois précis et nuancé, au mélange d’apparente candeur et d’ironie vraie, de réalisme et d’onirisme. Vignettes muettes ou dialogues vifs, couleurs contrastées ou teintes pastel, arrière-plans grisâtres ou animés, scènes de la vie quotidienne ou rêves éveillés, tout concourt à plonger le lecteur dans les affres intimes et cycliques de notre héroïne. Tout est bien vu, à l’image de cet édifice monstrueux (kafkaïen) aux coupoles interchangeables et aux murs instables qui représente le plan (de 64 pages) que Jeanne n’en finit pas de déconstruire et de reconstruire. Drôles et réalistes, vivants et oniriques, ces Carnets de thèse permettront à certains de s’y retrouver, à d’autres de se préparer, à tous de pendre plaisir à une histoire à la fois cauchemardesque et pleine d’humour.
Jean-Pierre Longre
10:14 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, dessin, autobiographie, tiphaine rivière, jean-pierre longre, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/12/2015
Libre abécédaire de la presse
 Serge July, Dictionnaire amoureux du journalisme, Plon, 2015
Serge July, Dictionnaire amoureux du journalisme, Plon, 2015
Si l’on se fie à l’épaisseur du livre (plus de 900 pages), et surtout à la mine de renseignements et d’idées qu’il contient, on se dit que l’amour de Serge July pour le journalisme est incommensurable – et lorsqu’on pense à sa propre carrière – voir entre autres l’entrée July (Serge) –, on se dit qu’il ne pouvait en être autrement. Même si, tout amoureux qu’il est, il parvient à prendre le recul nécessaire pour avoir un regard relativement objectif sur le métier (il rappelle volontiers cette « vérité essentielle » de Bernard Voyenne : « Aucun journal n’est objectif, la presse l’est »). Recul, donc, et distance souriante : le premier article, intitulé « À bas les journalistes », cite les phrases satiriques qui, du XVIIe siècle à nos jours, ont fleuri sous la plume de certains auteurs (Voltaire, Balzac, Flaubert, Henry James, Montherlant, Bourdieu…). Pour le plaisir, George Bernard Shaw : « Journal : institution incapable de faire la différence entre un accident de bicyclette et l’effondrement de la civilisation. ».
Puis commencent les choses sérieuses : une revue détaillée de tout ce qui a trait au journalisme : son histoire et celle des grands organes de presse (Libération bien sûr, les autres aussi), une histoire non dénuée des engagements propres à l’auteur ; en témoignent les textes sur Henri Alleg, sur les grands « bidonnages », sur la mort de Roger Salengro, sur la « révolution » roumaine, sur les populismes… Évidemment, les éléments biographiques abondent, notamment ceux qui concernent les grands journalistes comme Beuve-Méry, et le premier de tous, Théophraste Renaudot, journalistes qui comptent parmi eux nombre d’écrivains sur lesquels Serge July prend parfois plaisir à s’attarder ; d’Hérodote à Camus et Sartre, en passant par Daniel Defoe, Voltaire, Alexandre Dumas, Zola, Hemingway, Kessel, Mauriac, Simenon – on en passe –, ils illustrent tous l’idée que journalisme et littérature, s’ils présentent des différences notables, ont au moins un point commun : la communication verbale.
Ce dictionnaire ne se contente d’ailleurs pas de donner des définitions, ni de déclarer son amour à la profession. Il présente des articles de fond, amorçant des réflexions sur, par exemple et justement, la communication, « le propre de l’espèce humaine », avec tous ses enjeux dans le cadre politique et international. Réflexions aussi sur l’immédiateté et la « distanciation » ironique, sur le « lynchage médiatique », sur ce qu’on appelle le « quatrième pouvoir », sur la puissance néfaste de la « rumeur », sur 1968 et, dans la foulée, 1973 (naissance de Libération)… Pouvoir de réflexion ne va pas sans précision sémantique : on sort de cette lecture avec le sentiment d’être plus instruit, en tout cas de mieux connaître (ou d’avoir tout bêtement appris) certains mots spécialisés (« marbre, marronniers, ménages, tabloïd, offset, mécascriptophile »), voire l’origine de certains autres (« reportage »), le contenu précis de termes comme « feuillet » (25 lignes de 60 signes, soit 1500 signes, ou 250 mots)…
Et il n’est pas indifférent, pour le lecteur, de se dire que l’auteur n’a pas perdu un certain sens de l’humour, parlant de la « pensée Dassault » sous le titre « Café du Commerce », évoquant les grands canulars à l’image de celui d’Orson Welles faisant croire à une invasion de Martiens, rappelant aussi, dans un autre domaine, ce que fut l’acronyme NDLC (note de la claviste, qui autrefois avait le droit de faire des commentaires dans les articles de Libé), ou encore citant Jules Renard : « Le comble pour un journaliste, c’est d’être à l’article de la mort. ». Belle pratique de l’humour libre dans un livre d’amour. Pour notre part, souhaitons que le journalisme demeure tel que le conçoit Serge July, malgré tous les dévoiements qui le guettent.
Jean-Pierre Longre
14:31 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dictionnaire, essai, francophone, journalisme, serge july, plon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

