06/09/2011
« Vous vous souvenez ? »
 Gianina Carbunariu, Avant-hier, après demain, Nouvelles du futur. Traduit du roumain par Mirella Patureau, éditions L’espace d’un instant, 2011
Gianina Carbunariu, Avant-hier, après demain, Nouvelles du futur. Traduit du roumain par Mirella Patureau, éditions L’espace d’un instant, 2011
Dans ces quatre scènes, ponctuées de « micro-séquences » laissées à l’initiative du réel et des acteurs, Gianina Carbunariu anticipe. Beaucoup l’ont fait avant elle, beaucoup le feront après, dira-t-on. C’est un fait. Comme on le voit chez d’autres auteurs, les défauts, les excès, les tabous, les interdits, les vides du monde actuel sont ici poussés à un tel degré qu’ils deviennent à la fois absurdes, odieux et destructeurs. Ne le sont-ils pas déjà ? Les fumeurs deviennent des criminels, les animaux des compagnons adulés, les gadgets électroniques disparaissent sous la montée des eaux, la misère pousse à chercher tous les moyens de survie : finalement, peu de différence entre les XXIe et XXIIe siècles.
Mais il ne s’agit pas seulement de dénoncer les abus de nos sociétés, d’exercer son esprit critique, de s’adonner à la satire (souvent savoureuse, salutaire et parfaitement ciblée, au demeurant) des mœurs d’aujourd’hui. Nous avons affaire à du théâtre, un théâtre polyphonique à souhait, permettant à l’auteur, aux personnages, aux comédiens, aux spectateurs / lecteurs de (se) rendre compte, d’une manière concrète et stylisée, de ce qu’est la réalité. Le langage théâtral, à la fois maîtrisé et libéré, assure la mise en perspective burlesque, morbide, tragique de l’Histoire, et ce langage, s’il est multiple, est d’abord celui des mots. Mots accumulés, mots perdus et recherchés, mots ambigus, mots crus, mots à la mode, mots de toujours (saluons au passage le travail de la traductrice)… Ces « nouvelles du futur » sont aussi – pour reprendre une formule de Ghérasim Luca dans Levée d’écrou – « des nouvelles inquiétantes sur le langage ».
Avant-hier, après demain, à travers les va-et-vient de la mémoire, montre, suggère et pose des questions qui concernent non seulement notre actualité, mais aussi les moyens que nous avons de dire cette actualité, de suivre la marche du monde passé, présent et à venir. Donner à voir et à entendre le réel, dans les interstices et les harmoniques de la fiction verbale et scénique : c’est bien ce que l’on attend du théâtre.
Jean-Pierre Longre
10:58 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, roumanie, gianina carbunariu, mirella patureau, l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/05/2011
Du fond des insomnies
 Radu Bata, Mines de petits riens sur un lit à baldaquin, Éditions Galimatias, 2011.
Radu Bata, Mines de petits riens sur un lit à baldaquin, Éditions Galimatias, 2011.
À paraître en mai 2011
Voilà de « petits riens » qui disent beaucoup, venus comme par la grâce du rêve, comme saisis en plein sommeil, en réalité vus, revus, travaillés, retravaillés dans un style qui ne doit rien au hasard. Le nom de l’éditeur, d’ailleurs, s’il cède au plaisir de la parodie, évoque par antiphrase l’amour d’une langue acquise tendrement et obstinément, avec laquelle on peut se permettre de jouer sans lui manquer de respect – comme en témoignent la dédicace et plusieurs mentions contenues dans le recueil.
Le recueil ? Comment nommer autrement un ouvrage aux genres aussi divers que les sujets abordés – même si tous sont attachés par les liens du sommeil et des images qui le peuplent, ce sommeil qui fait l’objet d’autant de définitions que, devine-t-on, de nuits passées à l’élucider, comme on passe sa vie à tenter de percer le mystère de la mort. Genres divers : journal nocturne, souvenirs fantasmés, essai cioranesque, conte merveilleux, nouvelle fantastique, fable morale, récit de rêve, jeu verbal, poésie versifiée, prose introspective, traduction… Le tout assorti d’un goût avéré pour les définitions, les inventaires, les listes, dans une tentative d’épuisement des significations : non seulement celles du grand sommeil noir et de ses accessoires, mais aussi celles de l’insomnie, d’où tout provient.
La diversité générique s’assortit, comme on peut s’y attendre, d’une pluralité thématique. Surgissant des profondeurs de la vie nocturne, viennent nous faire signe, çà et là, un ange gardien, le vin vivant sa vie multiple, de beaux hommages (à Ben Corlaciu, écrivain, ami de la famille, à Enrique Vila-Matas…), des bribes d’existence quotidienne, et bien sûr de nombreuses résonances autobiographiques, où l’enfance, la Roumanie, « l’exil permanent » prennent une place discrète et émouvante. Résonances autobiographiques et, dirons-nous, autolinguistiques. Car le changement de langue, le « troc linguistique » est au cœur des textes. « Hormis quelques moments d’enchantement, le passage dans une autre langue est un exercice douloureux ».
Ce « journal de bord judicieusement déraisonnable » met en scène un « amour immodéré pour les mots » que Radu Bata fait abondamment partager à son lecteur. Vu de l’entre-deux-langues, le français se prête à la redécouverte, à la mise en perspective, aux effets d’assonances et d’allitérations, à l’« orage lexical », aux détournements, aux variations sémantiques et typographiques, dans une jubilation qu’entache à peine la désagrégation finale. Et le renouvellement de la langue s’assortit d’une intertextualité tout azimut : l’écriture est celle d’un grand lecteur, qui ne se prive pas de glisser la littérature universelle entre les lignes de son invention : allusions, citations, références, démarquage, parodie voire satire, tout y passe et beaucoup, sûrement, nous échappe.
Radu Bata, dont les publications précédentes (Fausse couche d’ozone, Le rêve d’étain) avaient déjà réjoui un public choisi, propose ici une réflexion en forme de puzzle, dans laquelle se livrent combat le pessimisme et la joie de vivre, la résignation et l’espoir, le cauchemar et l’utopie, le sommeil et la veille. Au bout du compte, le gagnant est le langage, cet « idiome intérieur » que l’auteur, généreusement, laisse à notre disposition.
Jean-Pierre Longre
15:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, récit, poésie, aphorisme, francophone, roumanie, radu bata, éditions galimatias, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2011
Littérature en vert
 Le persil journal, Lausanne
Le persil journal, Lausanne
Marius Daniel Popescu, poète du quotidien réel et imaginaire, de l’évidence et du non-dit, du passé roumain, du présent suisse, chauffeur de bus (mais « on n’a pas besoin d’être chauffeur de bus pour aimer les gens qui prennent le bus »), auteur du recueil Arrêts déplacés (Antipodes, Lausanne, 2004) et du roman La symphonie du loup (José Corti, 2007), publie depuis plusieurs années ce journal au drôle de titre, édité en Suisse, où réside son créateur.
Poèmes et autres textes s’y glissent discrètement, s’y étalent orgueilleusement, s’y côtoient, s’y répondent avec, depuis un certain temps, une nouveauté de taille : le rédacteur en chef n’en est plus l’unique signataire ; ses pages sont généreusement prêtées à d’autres, Suisses ou Français, jeunes ou vieux, célèbres ou méconnus, qui les ouvrent sur des paysages multiples et divers. Le numéro 38 de février 2011, par exemple, donne carte blanche à Olivier Sillig, romancier, peintre, réalisateur, qui lui-même offre une bonne place à des textes de Daisy Nachevez et Daisy Neddi… Dans un terreau fertile, Le persil prospère en branches multiples, en bouquets serrés, « à la fois parole et silence ».
Jean-Pierre Longre
Le persil journal, Marius Daniel Popescu, avenue de Floréal 16, 1008 Prilly, Suisse.
Tél. 0041.21.626.18.79. E-mail : mdpecrivain@yahoo.fr
Association ses Amis du journal Le persil : lepersil@hotmail.com
Pour rappel :
La symphonie du loup : http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/08/04/hurlement-de-la-vie-epuisement-du-langage.html
Arrêts déplacés : http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/03/16/transports-en-commun-poetiques.html
15:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, poésie, suisse, roumanie, marius daniel popescu, olivier stillig, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/02/2011
« Les taupes de Dieu »
 Horia Badescu, Parler silence, L’Arbre à paroles, 2010
Horia Badescu, Parler silence, L’Arbre à paroles, 2010
Parler silence comprend deux parties distinctes, « Les apocryphes du roi Salomon » et « Journal de souterrain ». Distinctes, mais pas si éloignées l’une de l’autre, ne serait-ce que par l’unité formelle des brefs textes en vers libre souvent sous-tendus par une dualité profonde. Ainsi, le recueil en un seul volume de ces deux ensembles poétiques n’est pas le fruit du hasard.
La dualité, c’est en fait celle de couples prenant leurs racines dans la thématique fondamentale de la vie et de la mort. Dès lors, ce peut être, dans la première partie, la complémentarité ou l’antagonisme corps/nature – le corps se nourrissant, tirant sa substance de la nature, ou celle-ci mettant en évidence l’impuissance de l’homme ; dans la deuxième partie la complémentarité ou l’antagonisme entre le haut et le bas, entre le monde des taupes et le jour céleste, entre la cécité du néant et l’attente d’un horizon. Et partout, çà et là, l’impossibilité de la mesure humaine :
« Ici, le temps n’existe pas,
l’espace non plus
[…]
un désert d’attente s’étend
entre la naissance et la mort ».
L’humanité est vouée au vieillissement, au silence des origines, à la mort s’approchant jour après jour. Existerait-il un espoir, une lumière éventuelle,
« quand la rosée des morts
allume sous nos paupières
l’œil de Dieu » ?
Il y a effectivement l’amour, l’osmose des êtres, les rêves de lumière ; mais la paix ne peut être que celle du néant :
« Entre rien et rien
se déroule notre vie ».
Les images de la nature et de la vie, les sonorités, la sobriété du style, le pouvoir d’évocation des résonances lexicales, tout tend à développer l’oxymore du titre, « parler silence », qui induit la dualité constante de ces poèmes (vie/mort, corps/nature, espoir/désespoir, guerre/paix, haut/bas, ombre/lumière, tout/rien…). Pour Horia Badescu, qui a déjà publié chez L’Arbre à paroles Un jour entier (2006) et Miradors de l’abîme (2007), la langue française est devenue un matériau dont il sait tirer, sans effets oratoires superflus, l’essence poétique.
Jean-Pierre Longre
www.maisondelapoesie.com/index.php?page=editions-arbre-a-paroles
11:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roumanie, horia badescu, l’arbre à paroles, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/01/2011
Les mystères de la Fosse aux Lions
 Liliana Lazar
Liliana Lazar
Terre des affranchis
Gaïa, 2009
Réédition Actes Sud (Babel), février 2011
Il se passe d’étranges choses entre le village de Slobozia (dont le nom évoque la liberté, la libération) et la Fosse aux Lions (naguère « La Fosse aux Turcs », en souvenir des victoires d’Etienne le Grand contre les Ottomans) : des crimes, des disparitions mystérieuses, des apparitions de « moroï » ou morts vivants… Nous sommes à la fois dans la Roumanie ancestrale, au plus profond de la province de Moldavie où les légendes ont la vie dure, et dans la Roumanie d’aujourd’hui, celle qui a vu les méfaits de la dictature, la chute de Ceausescu et l’accession au pouvoir et aux richesses de nouveaux maîtres – pas si nouveaux que cela pourtant.
l’accession au pouvoir et aux richesses de nouveaux maîtres – pas si nouveaux que cela pourtant.
Victor Luca recèle en lui les paradoxes d’un corps robuste et d’une âme fragile – la violence irrépressible et la volonté de se racheter, la soif de liberté et l’enfermement dans la solitude – et les personnages qui l’entourent (sa mère, sa sœur, Ilie le prêtre, Ismaïl le Tsigane, Gabriel l’ermite) tenteront jusqu’au bout de le protéger des autres et surtout de le sauver de lui-même. A lui seul il synthétise les contradictions d’un pays et de ses habitants : l’indéfectible fidélité à des mythes païens mêlés de religion chrétienne et l’adaptation plus ou moins consentie aux apports de la modernité, la quête d’un bonheur illusoire et la morbide réalité des relations humaines ; plus généralement encore, dans une atmosphère qui peut faire penser à celle des romans de Virgil Gheorghiu (voir Les noirs chevaux des Carpates), Victor synthétise les paradoxes humains, le mensonge des apparences et la brutalité du réel (en matière politique et religieuse par exemple, mais pas seulement).
Liliana Lazar connaît bien la localité appelée Slobozia, sa forêt et ses collines, puisqu’elle y a vécu son enfance, nous dit-on. Après son installation en France, son premier roman (écrit en français), aux frontières du fantastique, de la poésie et du réalisme, donne la mesure d’un vrai talent littéraire appuyé sur une culture traditionnelle et populaire. A suivre…
Jean-Pierre Longre
19:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, liliana lazar, jean-pierre longre, gaia-éditions | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/01/2011
Un théâtre bien vivant
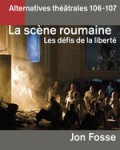 Alternatives théâtrales n° 106-107, « La scène roumaine. Les défis de la liberté », 4e trimestre 2010
Alternatives théâtrales n° 106-107, « La scène roumaine. Les défis de la liberté », 4e trimestre 2010
Depuis vingt ans, la vie intellectuelle et artistique roumaine s’est évidemment libérée, animée, étendue, diversifiée. Rien de tel que les arts du spectacle, notamment le théâtre, pour illustrer ce phénomène. Forte de ce constat, la revue belge Alternatives théâtrales consacre son dernier numéro à « la scène roumaine », sous l’égide de Georges Banu et Mirella Patureau, très bien placés pour cela, puisque leur point de vue est à la fois extérieur et intérieur (respectivement professeur à la Sorbonne Nouvelle et chercheur au CNRS, ils vivent en France tout en étant fortement impliqués dans l’univers théâtral roumain).
Il était sans doute nécessaire de rappeler au public d’Europe occidentale, aux « lecteurs d’ailleurs », qu’en Roumanie le théâtre est bien vivant, et qu’en ce qui concerne le répertoire « la scène roumaine se montre nettement plus ouverte que la scène française » ! Si la censure, jusqu’en 1989, a imposé un cadre rigide à la création scénique (comme à toute création), elle n’a pas interdit le théâtre, et l’éclatement libérateur des années 1990 n’est pas une rupture complète, mais une métamorphose dans la continuité. C’est en tout cas ce qu’explique Georges Banu dans son introduction, en analysant les différentes formes du spectacle théâtral qui s’élabore depuis, dans un « archipel des solitudes » s’épanouissant sans conflit mais dans une infinité d’identités, en dépit des contraintes économiques entraînant des restrictions budgétaires.
Les deux grandes parties de ce numéro (« Repères pour un paysage théâtral », « Paroles et portraits d’artistes ») permettent un tour d’horizon, sinon exhaustif, du moins très détaillé, de ce qui se fait en matière de réalisation et d’écriture scéniques à Bucarest et dans les grandes métropoles culturelles du pays. Le répertoire dans toute sa variété – de la tragédie antique à la jeune avant-garde, des pièces roumaines aux œuvres internationales, de la tradition à la provocation – est passé en revue par les critiques ou par les acteurs (au sens général), et les grands événements évoqués montrent l’étendue géographique du renouveau : Festival national de théâtre de Bucarest, Festival de Sibiu, Festival Shakespeare de Craiova, Théâtre Ariel de Târgu-Mureş… Le tour d’horizon est largement complété, à bon escient, par des réflexions en profondeur sur des phénomènes marquants : l’enseignement du théâtre, qui tend à multiplier le nombre de comédiens diplômés ; la fameuse « ostalgie », dont les jeunes dramaturges se dégagent pour faire porter leurs critiques non seulement sur le passé communiste, mais aussi sur le présent capitaliste ; l’expérimentation originale souffrant du « synchronisme », c’est-à-dire du désir d’adaptation aux modes européennes ; l’importance du rôle joué par le groupe du « dramAcum », sous la houlette de Nicolae Mandea… Il était primordial, en outre, de donner la parole aux grands créateurs, metteurs en scène et dramaturges, directement ou sous la forme d’entretiens. Cette parole tient une place révélatrice d’un état des lieux et d’une dynamique. Le tout se termine par un bref panorama du cinéma roumain, plusieurs fois récompensé, et qui pose des questions, en tout cas qui « entame avec nous un dialogue ».
Les textes fouillés, les synthèses, les témoignages, tous signés de critiques avertis, d’universitaires, de metteurs en scène, de comédiens, d’écrivains, sont ponctués de belles et larges photos de mises en scène, pour la plupart proposées par Mihaela Marin, spécialisée dans les arts du spectacle. Cette combinaison du textuel et du visuel compose un très bel ensemble, complété, signalons-le, par un dossier sur le norvégien Jon Fosse, et par un article de Bernard Debroux, codirecteur de la revue avec Georges Banu, sur « les langues d’Europe » examinées dans la perspective théâtrale.
Ce numéro dévoile les richesses et les potentialités de la « scène roumaine » actuelle dans toutes ses dimensions, avec ses paradoxes, ses enjeux, ses héritages, son esprit créateur, ses expériences, ses mutations… Un ensemble indispensable à l’exploration du paysage théâtral et artistique européen.
Jean-Pierre Longre
15:05 Publié dans Littérature, Revue, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, revue, roumanie, alternatives théâtrales, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/01/2011
« L’oiseau bicéphale »
 Ici é là, revue de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 13, 2010
Ici é là, revue de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 13, 2010
Ici é là, revue publiée sous la responsabilité, entre autres, de Jacques Fournier, se signale d’abord par son format original, sa mise en page soignée, ses coloris variés, et le choix des textes qu’elle propose, dans une présentation séduisante. Un bel objet poétique.
Le n° 13, dédié à Arlette Albert-Birot, disparue l’été dernier, tient les promesses de son intitulé. Dans ses quatre sections, de la création, des articles de fond, des notes et recensions diverses, et, tout particulièrement, un dossier (« si près é si loin ») consacré aux « poètes roumains d’expression française ». Dans une introduction qui fait la part belle à un historique des relations entre la Roumanie et la langue française, Linda Maria Baros décrit « l’oiseau bicéphale », image forte qui figure pour elle la poésie roumaine francophone, dans une série d’aller-retour entre « ici » et « là », au cours desquels se croisent et se mêlent les cultures.
Successivement, les poèmes de Horia Badescu, Sebastian Reichmann, Valeriu Stancu, Marlena Braester, Matéi Visniec, Rodica Draghincescu et Linda Maria Baros elle-même offrent des exemples de la diversité verbale et prosodique d'auteurs dont les préoccupations passent par une singulière maîtrise de la langue française, cette langue qu’ils ont délibérément choisie sans renier leurs origines. Comme leurs prédécesseurs, ils n’hésitent pas à se confronter à la difficulté ; ainsi que l’écrit Matéi Visniec, « il y a des jours où les mots ne veulent plus sortir / il y a des jours où les mots se replient au fond de nous-mêmes / dégoûtés de nous et surtout de nous-mêmes » ; mais lorsqu’ils veulent bien venir, ils nourrissent des textes dont la forme et la teneur ne sont ni roumaines ni françaises, mais les deux à la fois et, tout compte fait, universelles. « On ne naît pas une langue collée au front », écrit encore Linda Maria Baros.
Tout en fournissant de belles lectures dans un cadre esthétique harmonieux, ici é là incite à aller plus loin, chercher d’autres auteurs, d’autres textes, suivre des chemins nouveaux, trouver « l’écriture en images » (Rodica Draghincescu), franchir des « portes obscures » (Horia Badescu) vers des « traînées de lumière » (Marlena Braester).
Jean-Pierre Longre
11:08 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, poésie, francophone, roumanie, linda maria baros, maison de la poésie de saint-quentin-en-yvelines, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/01/2011
Le train de la mémoire
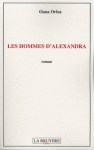 Oana Orlea, Les hommes d’Alexandra, Éditions La Bruyère, 2010
Oana Orlea, Les hommes d’Alexandra, Éditions La Bruyère, 2010
Oana Orlea (Maria-Ioana Cantacuzino), née en Roumanie en 1936, a connu dès 1952 les geôles et les camps de travail de la dictature communiste, puis les petits métiers auxquels étaient voués les intellectuels rétifs et les rejetons de familles naguère trop en vue (elle était de la famille de Georges Enesco, et son père avait été un grand aviateur). Après avoir publié plusieurs ouvrages dans les années de relative ouverture (60-70), elle s’installe en France à partir de 1980 et se signale par des parutions en français : Un sosie en cavale (Le Seuil, 1986), Les années volées (Le Seuil, 1991), Rencontres sur le fil du rasoir (L’Arpenteur, 2007).
Dans Les hommes d’Alexandra, les souvenirs se succèdent au rythme d’un trajet en train auquel des événements déconcertants et des rencontres inattendues donnent une dimension quasiment fantastique. Périodiquement, un grand cheval aubère galope le long de la voie ferrée, comme s’il faisait signe à l’héroïne d’avancer avec lui ; une étrange femme aux cheveux rouges vient la harceler, comme pour la faire renoncer à poursuivre le voyage ; un jeune homme obèse, une jambe dans le plâtre, semble vouloir la protéger… Un par un se déclenchent les souvenirs des hommes qu’elle a connus, aimés brièvement ou longuement, superficiellement ou profondément, et qui viennent hanter sa mémoire vagabonde.
Les deux couches principales du récit (Alexandra à la troisième personne dans son wagon, Alexandra à la première personne dans les scènes d’autrefois) permettent l’évocation des sentiments intimes, de la diversité des amours ; elles permettent aussi celle du passé sociopolitique dans un pays en proie au totalitarisme, à la misère, au travail forcé, aux brimades, et malgré tout celle des petits plaisirs et des grandes émotions, des espoirs et des révoltes. L’atmosphère d’antan, les ambiances contrastées peuplent une mémoire saturée : « D’autres images s’avancent, coquillages flottant à la dérive dans la galaxie de la mémoire, s’entrechoquent, explosent, volent en éclats, se dispersent en mille morceaux qui jamais ne retrouveront une cohérence ». Les hommes d’Alexandra est un roman riche de l’expérience d’une vie plurielle, un roman qui, dans son foisonnement, en contient plusieurs.
Jean-Pierre Longre
11:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, oana orlea, Éditions la bruyère, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/12/2010
« Le cœur de l’autre Europe »
 L’atelier du roman n° 64, « Les Roumains et le roman », Flammarion, décembre 2010
L’atelier du roman n° 64, « Les Roumains et le roman », Flammarion, décembre 2010
Fidèle à ses principes, la revue et ses rédacteurs déambulent, observent et s’arrêtent là où il leur semble qu’il se passe quelque chose d’important, d’original, de séduisant. Cela donne, pour ce numéro 64, un bel ensemble à la fois varié et révélateur de la littérature roumaine, telle qu’elle s’est constituée, telle qu’elle se constitue actuellement ; en majorité dans le domaine du roman, mais aussi, de-ci de-là, dans ceux du théâtre, de l’essai, des périodiques…
C’est ainsi qu’au fil des articles nous fréquentons quelques grands du passé (Eliade, Rebreanu, Istrati, Cioran) et, selon des choix lucides, quelques grands du présent : Norman Manea, virtuose de l’humour dévastateur, Dumitru Tsepeneag, maître de l’onirisme et de l’expérimentation, entre ses deux langues, Gabriela Adameşteanu, arpenteuse des différentes dimensions du temps, Mircea Cărtărescu qui, dans sa trilogie, dépasse de loin les traditions du genre romanesque, Horia Ursu, discret perfectionniste, Alexandre Vona, auteur unique d’un unique roman, Florina Iliş, qui a droit à juste titre à deux articles, tant son dernier roman, La croisade des enfants, marque l’actualité littéraire européenne.
À côté de cela, Georges Banu écoute les échos dont résonne La lettre internationale, Radu Cosaşu fait part de deux de ses chroniques de l’hebdomadaire culturel Dilema Veche, Adrian Mihalache de ses réflexions sur la revue Observator cultural de Bucarest, et un entretien de Denis Wetterwald avec Matéi Visniec permet à celui que l’on connaît surtout comme l’un des grands dramaturges contemporains de parler du roman et de son choix de la langue française. Il manquerait évidemment quelque chose s’il n’y avait pas la création elle-même, inaugurée par un savoureux « Blog-Notes d’Outre-Tombe » de Ionesco, par A. Mihalache. Suit un choix de textes littéraires de Ion Luca Caragiale, maître de la comédie, de Razvan Petrescu, de Joël Roussiez (en visite chez Nosferatu), de H. Ursu, de M. Visniec…, le tout assez représentatif d’une tonalité roumaine, celle de la dérision et du sens de l’absurde, venue en zigzag d’ancêtres comme Urmuz ou d’avant-gardistes dont le plus célèbre est Tristan Tzara. Et la fraîcheur des dessins de Sempé n’en est finalement pas très éloignée.
Les auteurs de ce volume ont bien compris que le roman roumain est d’une facture et d’une ampleur telles qu’il ne demande qu’à dépasser ses limites génériques, que la littérature roumaine déborde largement ses frontières géographiques, politiques, linguistiques (puisque beaucoup d’écrivains ont adopté plus ou moins durablement le français, par exemple, mais pas seulement – voir Herta Müller). Ce numéro de L’atelier du roman le rappelle : il est temps que la littérature roumaine prenne toute sa place dans l’espace européen. L’ouverture le proclame : « Pourquoi la Roumanie ? Parce que là-bas, et c’est l’essentiel, bat encore, d’après des indices qui ne trompent pas, le coeur de l’autre Europe, de l’Europe que partout ailleurs nous avons enterrée. L’Europe de la folie, du doute et de l’insoumission aux modes et aux oukases de nos pontes culturels ».
Jean-Pierre Longre
http://www.editions.flammarion.com
et pour en lire plus sur la littérature roumaine, voir ici : http://jplongre.hautetfort.com/archives/tag/roumanie.html
et là: http://rhone.roumanie.free.fr/rhone-roumanie/index.php?op...
16:00 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, francophone, roumanie, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2010
Guerre et musique
 Matéi Visniec, Les chevaux à la fenêtre – Mais qu’est-ce qu’on fait du violoncelle ? Traduit du roumain par l’auteur, L’espace d’un instant, 2010
Matéi Visniec, Les chevaux à la fenêtre – Mais qu’est-ce qu’on fait du violoncelle ? Traduit du roumain par l’auteur, L’espace d’un instant, 2010
Quand des chevaux fous passent devant la fenêtre, se rassemblent pour occuper les abattoirs et deviennent des bêtes féroces, faut-il s’attendre à ce que les hommes fassent preuve de sagesse ? La folie des animaux est comme un signal de celle des hommes. Ce sont alors des dialogues de sourds entre préoccupations quotidiennes et vaines illusions de l’héroïsme, l’angoisse devant le temps détraqué, le recours désespéré à la discipline militaire, le sombre constat de l’éternelle obscurité qui entoure la destinée humaine… Et, rythmant le tout, l’imperturbable litanie des guerres que se sont livrées les hommes au cours de leur histoire.
Si Les chevaux à la fenêtre met en scène les velléités du patriotisme et de la gloriole dans un espace-temps illusoire, Mais qu’est-ce qu’on fait du violoncelle ? est un huis clos tout aussi désespérant. Dans une salle d’attente, devant le jeu répétitif et obstiné d’un violoncelliste, l’attitude de personnages bien ordinaires, prêts aux concessions et aux compromis, tourne à la folie furieuse et débridée, jusqu’au rejet total. Existe-t-il des remèdes à l’enfer des autres, à la solitude et à l’absurdité ? « L’homme ? Un grain de poussière… Un rien… Mais, malgré tout, tout est possible ».
Avec ces deux pièces – la première datant de 1987, et à l’époque interdite en Roumanie, la seconde datant de 1990 – Matéi Visniec confirme la portée à la fois très humaine et universelle d’une œuvre théâtrale dans laquelle le sens de l’absurde et de la révolte, la combinaison du tragique et de l’humour ne peuvent pas laisser indifférent.
Jean-Pierre Longre
Campagne de financement solidaire pour le projet de publication:
"Mérignac - Beaudésert" récits sur la déportation et l’internement de Tsiganes français sous l’Occupation (1940-1945) aux éditions l'Espace d'un instant. Soutenez directement ce projet via la plateforme Babeldoor. (Les dons deviennent effectifs lorsque l'objectif de 2 000 € est atteint.... 100 personnes faisant un don de 20 € par exemple.) http://www.babeldoor.com/merignac-beau-desert/dashboard?b... Maison d'Europe et d'Orient Centre Culturel pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale [Librairie / Galerie / Studio / Bibliothèque Christiane Montécot - Réseau Européen de traduction - Editions l'Espace d'un instant - Théâtre national de Syldavie ] 3 passage Hennel - 75012 Paris - Tel 33 1 40 24 00 55
18:25 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, francophone, roumanie, matéi visniec, l’espace d’un instant, maison d’europe et d’orient, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2010
Trois recueils de poésie roumaine (avec leur traduction)
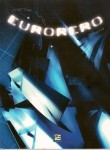 Marcel Turcu, Eurorero, édition trilingue roumain – allemand - français. Traduction française de Marius Turcu. Editura Mirton, Timişoara, Roumanie, 2010
Marcel Turcu, Eurorero, édition trilingue roumain – allemand - français. Traduction française de Marius Turcu. Editura Mirton, Timişoara, Roumanie, 2010
Un automatisme maîtrisé
Dès le poème inaugural, nous sommes avertis : « Juste le monologue sans sens ». Tout disparaît, sauf le langage. Seuls, les mots, imposant leurs images audacieuses, leurs rapprochements aléatoires, dans une écriture qui doit beaucoup à l’automatisme ; mais à un automatisme médité, maîtrisé, pour ainsi dire ordonné.
« Mon Dieu, prends soin de ma compréhension », dit l’un des textes. Si compréhension il y a, elle repose principalement sur les harmoniques verbales (et, au passage, saluons le mérite du traducteur, qui a dû se glisser dans la profondeur de ces harmoniques), elles-mêmes tributaires du jeu des mots, relevant d’un souci de précision dans les sollicitations du hasard. Les mots sont « injectés », « accrochés » entre eux selon un rythme significatif, en une « vive rigueur », cette rigueur sans laquelle il n’y a pas de poésie.
Les échos littéraires et artistiques (le surréalisme bien sûr, Baudelaire aussi, d’autres encore) donnent au recueil un souffle, une résonance, un espace. C’est d’ailleurs bien à une poésie de l’espace que nous avons affaire : l’espace européen, entre Loire et Weser, entre Nord et Sud (aux poèmes de la France et de l’Allemagne succèdent, à la fin, ceux de la Grèce, du retour vers l’Orient et vers la culture byzantine) ; et lorsqu’il est question du temps, c’est encore sur l’espace qu’il agit : si « l’horloge marche avec exactitude […], les astres s’ouvrent ».
Marcel Turcu, né le 13 avril 1940 dans le département de Timis, membre de l’Union des écrivains de Roumanie, a publié dans son pays de nombreux recueils poétiques, entre 1969 et 2009. La traduction française d’Eurorero devrait faire connaître dans la sphère francophone, espérons-le, non seulement le recueil, mais aussi un auteur qui vaut la peine d’être connu bien au-delà des limites de son pays.
 Carmen Veronica Steiciuc, Vitrina cu dimineţi circulare / La vitrine aux matins circulaires, édition bilingue, traduction française Florina Liliana Mihalovici Paralela 45, Roumanie, 2010
Carmen Veronica Steiciuc, Vitrina cu dimineţi circulare / La vitrine aux matins circulaires, édition bilingue, traduction française Florina Liliana Mihalovici Paralela 45, Roumanie, 2010
« Des incertitudes en forme d’aile »
« Le mot
qui t’aime de l’intérieur
ne vient jamais seul ».
Les mots, êtres de chair et de sensibilité, formés de « lettres au corps clair » mais aussi de « lettres secrètes », sont les personnages fluctuants, parfois énigmatiques, des scènes poétiques qui composent ce recueil. Des scènes dans lesquelles « les silences ont pris place / aux premières loges », dans lesquelles « les naufragés écoutent du Mozart », dans lesquelles le lyrisme naît de motifs récurrents allant et venant sous les yeux du spectateur (scripteur et lecteur) en un rituel quasiment sacré, intimement lié à la nature (les herbes, la pluie, les chevaux, les papillons…), aux sentiments (l’amour, la solitude), aux sensations qui touchent l’être dans ses dimensions cosmiques et telluriques. Pas de dénouement, uniquement des questions (« qui t’aime maintenant ? ») et « des incertitudes en forme d’aile » (le titre et le dernier vers du dernier poème).
Pas de dénouement, mais une musique suggestive, qui laisse au plus profond de la mémoire des visions, des cadences, des sonorités. Dans son avant-propos intitulé « Lettres d’amour », Mircea Ghiţulescu évoque à juste titre « la technique musicale du canon ». Les reprises (de syntagmes, de mots, d’images souvent séduisantes par leur audace), les échos résonnent d’un poème à l’autre, traçant des réseaux à l’intérieur du livre ; et cela figure comme une extension de ce qui se produit à l’intérieur des textes eux-mêmes, où les enjambements, les répétitions, les refrains rythment les strophes, sans parler des harmoniques fondées sur des mots et des vers à sens multiple. « Ma solitude est habitée par un poème qui m’est inconnu », par exemple : voilà un vers (et un titre) dont l’épaisseur polyphonique laisse entendre une foule de choses irréductibles à toute explication.
Une édition bilingue présente toujours un risque : celui de la confrontation entre deux langues, entre deux textes, avec les écarts inévitables entre les choix de l’auteur, du traducteur et du lecteur (en supposant ce lecteur bilingue). C’est aussi un atout : celui de s’adresser à un double public, et ici, en l’occurrence, de faire apprécier au public francophone des poèmes venus d’une langue et d’une culture à la fois lointaines et voisines, dans lesquels le travail de la forme est en parfaite adéquation avec l’intention lyrique.
 Ioan Es. Pop, Sans issue / Fără ieşire, anthologie poétique. Choix et traduction du roumain par Linda Maria Baros, L’Oreille du Loup, 2010
Ioan Es. Pop, Sans issue / Fără ieşire, anthologie poétique. Choix et traduction du roumain par Linda Maria Baros, L’Oreille du Loup, 2010
Dans le labyrinthe
Ioan Es. Pop, né en 1958, a publié de nombreux recueils en Roumanie, où il est devenu une figure marquante de la poésie, par la force et par l’originalité de son écriture. Pour le faire connaître du public francophone, il fallait opérer un choix représentatif, et en présenter une traduction fidèle à la lettre et à l’esprit, en regard du texte roumain. C’est chose faite, grâce à Linda Maria Baros, elle-même poétesse.
Il n’était sans doute pas aisé de restituer les proses rythmées, les vers brisés, les images surprenantes, les tableaux sanglants qui caractérisent les huit parties de cette anthologie. La poésie de Ioan Es. Pop est un incessant piège tendu au réalisme quotidien, au pittoresque citadin, à la description et à la narration classiques, à l’art du portrait. Toute tradition y est détournée au profit du fantastique, du morbide, de la trivialité ricanante. Une personnification, par exemple, peut tourner à la métamorphose désespérée :
« dans la chambre il y a une horloge que hans nourrit en cachette.
tourne plus vite, lui murmure-t-il, tourne plus vite. »
ou encore :
« la nuit un oiseau est entré par la fenêtre
j’étais sûr qu’il s’agissait de hans.
l’oiseau était chauve comme lui et ivre mort. »
La boisson omniprésente, un recours ? Plutôt une fuite vers la mort, vers le néant : même « l’ami », sorte de Christ dévoyé, « se soûle et dort où ça lui prend » ; Dieu lui-même, comparable à celui de Lautréamont,
« sentira diablement mauvais et le monde
l’évitera de loin.
il aura faim et on le trouvera allongé
derrière la HLM, la bouche grande ouverte
ruisselant d’abcès. »
Avec cela, inutile de préciser que le titre se justifie. La seule « issue » est l’absence d’issue, le seul chemin un labyrinthe. Toutefois, mènerait-il au néant, ce chemin existe et nous devons le suivre, suivre les mots du poète qui nous mènent là où nous devons aller, « même si c’est nulle part » :
« nous devons nous y rendre, mon cher compagnon,
même si momfa n’existe pas.
mais même si momfa n’existe pas
ou même si elle n’existe pas encore,
nous en approchons à chacun de nos pas. »
Resterait-il quelque espoir ?
www.loreilleduloup.blogspot.com
Jean-Pierre Longre
11:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, marcel turcu, editura mirton, carmen veronica steiciuc, florina liliana mihalovici, editura paralela 45, ioan es. pop, linda maria baros, l’oreille du loup, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/08/2010
Mystérieuse et envoûtante
 Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine, traduit du roumain par Alain Paruit, P.O.L., 2006
Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine, traduit du roumain par Alain Paruit, P.O.L., 2006
À lire les premières pages, on aura tendance à se placer dans un décor typiquement parisien aux allures réalistes (le bistrot et ses habitués, le métro et ses faits divers, le Bois de Boulogne…). Plus loin, mais dans une vue rétrospective, on revivra les péripéties historiques de la chute du mur de Berlin et de l’agonie des régimes communistes. A vrai dire, au fil des pages, on sent bien qu’il ne s’agit pas de s’enfermer dans les stéréotypes rassurants et les scènes déjà connues et déchiffrées, qu’il ne s’agit même pas de suivre le déroulement narratif d’une histoire solidement racontée.
Car au milieu des pseudo réalités urbaines et européennes, au milieu de personnages dont la présence est apparemment fonctionnelle, tributaires et faire-valoir de l’héroïne (un bistrotier communiste et rêveur, un turfiste malchanceux, un Russe inquiétant, un peintre exigeant, un duo de philosophes allemands complices en tout, même en amour…), déambule la séduisante Ana ou Hannah, mystérieuse et envoûtante, liée à un invisible Mihai, blonde ou brune selon les pays, médecin ou infirmière, prostituée ou espionne, calculatrice ou naïve, dangereuse ou apeurée, amante fougueuse ou distante… Mythomane certainement, forgeant elle-même son mythe, selon la phrase de Novalis placée en exergue et revenant dans l’espace du récit : « La vie ne doit pas être un roman qui nous a été donné, mais un roman que nous avons fait nous-mêmes ».
Toutefois ce roman, le maîtrisera-t-elle jusqu’au bout ? Cherchant peut-être à leurrer les autres, ne se leurre-t-elle pas elle-même ? L’auteur nous laisse le privilège de l’imagination, un auteur qui est bien là, avec des intertextes plus ou moins voilés (Thomas Mann et quelques autres), des jeux plus ou moins explicites sur Elvire Popesco ou Ionesco, le marteau et la faucille, la vodka qui coule à flot dans les gosiers et fait parler « à brûle-pourpoint », et surtout les autoréférences : la présence d’Ed, jeune employé du bistrot, nous met sur la piste d’Ed Pastenague, anagramme de D. Tsepeneag, l’un et l’autre auteurs, sous un nom ou sous un autre, de romans et récits présents dans le texte (Pont des Arts, Attente, Roman de Gare, Hôtel Europa), d’un scénario de film résumé ici même. Jusqu’à l’obsession reviennent des leitmotive présents dans toute l’œuvre (un aigle en cage, une gare désertée, un sanatorium au-delà d’une forêt, les prénoms féminins Maria, Ana, Marianne, l’attente), le tout assorti d’une autodérision décapante, par exemple sur la Roumanie, « pays de tsiganes et d’escrocs », ou sur l’œuvre elle-même (Hôtel Europa défini comme un simple « thriller »)…
La Belle Roumaine n’est pas un roman ; c’est une multiplicité de romans en puissance : aventures, espionnage, amour, érotisme, politique, exotisme, philosophie, histoire se superposent, ou plutôt tournent autour d’un axe que l’on peut appeler – pour utiliser le nom d’un mouvement que Tsepeneag fonda autrefois avec quelques autres en Roumanie – onirisme. Les reprises, les répétitions d’événements, les épisodes cycliques, factuels ou imaginaires, le ressassement à caractère musical, tout cela relève de la préoccupation structurelle : « Le rêve ne peut pas être narré, on doit le présenter, le reconstituer, l’écrire, le récrire, le fabriquer de a à z. Le vrai songe, le songe nocturne, n’est pour la narration onirique rien de plus qu’un modèle. Il ne fournit que les lois et la structure, non la matière, c’est-à-dire le sujet… ». Comme tous les romans de Dumitru Tsepeneag, La Belle Roumaine n’est pas un roman ; c’est un poème.
Jean-Pierre Longre
22:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, alain paruit, dumitru tsepeneag, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/08/2010
Transports en commun poétiques
 Marius Daniel Popescu, Arrêts déplacés, Antipodes, Lausanne, 2004.
Marius Daniel Popescu, Arrêts déplacés, Antipodes, Lausanne, 2004.
(Prix Rilke 2006)
Une fois n’est pas coutume : commençons par la fin. Il y a la table des matières, à elle seule tout un poème ; des titres en embuscade (« Bibelot en embuscade », comme le formule l’un d’entre eux), « petits grains » (autre titre dispersé çà et là) semés comme des énigmes et renvoyant à des textes aux allures de quotidien, de vie laborieuse, de vie de la rue, de vie familiale. Juste avant la table, il y a « Le tueur de livres », nouvelle-poème dans laquelle un lecteur impitoyable, qui expose dans son appartement les dépouilles de ses victimes, proclame que « n’importe qui peut comprendre qu’un livre peut brûler les gens ».
Marius Daniel Popescu est, nous dit-on, chauffeur de trolleybus ; profession rassurante, qui nous suggère qu’il ne brûlera ni ses lecteurs ni ses livres. Ses Arrêts déplacés, apparemment sortis tout chauds de ses observations, proposent de modestes scènes du théâtre intime et social, quelques images du passé (la grand-mère), beaucoup d’images du présent (le foyer, et surtout les gens qui montent dans le bus et en descendent, qui parlent et se dévoilent, ou qui demeurent dans le mutisme de leurs gestes). La vie est là : pas d’autobiographie dans ces poèmes, pas d’états d’âme de l’exilé venu de l’Est (si tant est que l’origine de l’auteur corresponde à ce que suggère la consonance de son nom), mais une biographie plurielle, visuelle et auditive, sensible et sentimentale, tendre et cruelle.
Certains textes sont des miniatures, décomposant la banalité des actes humains pour en extraire l’essence poétique, relatant en quelques phrases tel petit fait, telle conversation de coin de rue, telle confidence d’entre deux arrêts, tel rêve aussi qui vient colorer le réel citadin de visions oniriques et d’humour léger. D’autres utilisent le blanc de la page, en des figurations où le verbe s’associe au graphisme abstrait pour remplir l’espace, entre horizontalité et verticalité. Ailleurs encore, les mots se bousculent en collages, en listes, en inventaires compacts.
Je, tu, il, elle, tout se conjugue dans ces exercices de style pour faire accéder le lecteur à l’authentique métaphore, celle qui transporte littéralement et littérairement dans le secret des mots, secret qui, sous de discrètes notations et de simples constats, se cache au cœur de la poésie. « A la tombée du rideau », laissons l’auteur nous saluer :
« aujourd’hui tu dis au revoir aux lieux et aux gens,
tu dis au revoir au lac, à l’embarcadère et aux canards ;
tu démarres en avant, aujourd’hui tu oublies et tu gardes
une ligne de bus où le billet coûtait deux francs quarante
et la pluie était joyeuse et chaude et très marrante. »
Jean-Pierre Longre
14:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu, antipodes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/08/2010
Les deux sœurs
 Anca Visdei, L’exil d’Alexandra, Actes Sud, 2008
Anca Visdei, L’exil d’Alexandra, Actes Sud, 2008
Toujours ensemble, la devise des deux sœurs Popesco, est aussi le titre d’une pièce qui, depuis quelques années, est jouée dans plusieurs pays, parfois sous le titre de Puck en Roumanie. Le succès d’Anca Visdei, longuement mûri et largement justifié, est d’abord celui de son abondante œuvre théâtrale.
On ne s’étonnera donc pas de voir dans L’exil d’Alexandra, roman épistolaire, une sorte de mise en récit d’un dialogue aux accents dramaturgiques entre Alexandra et Ioana : la première a fui la dictature, la seconde, restée avec leur mère et leur grand-mère, tente tant bien que mal de se débrouiller dans le vide étouffant du règne de Ceausescu. Leur échange de lettres, sur une période de plus de 15 ans (avec une longue interruption) dit la tendresse, les anecdotes, les difficultés, les rancoeurs, les jalousies, l’amour de deux êtres qui voudraient ne rien se cacher, mais qui ne peuvent s’exprimer qu’à mots voilés : « Tante Prudence », l’odieuse et imbécile censure, veille, mais aussi, parfois, s’interposent les pudeurs et les remords… Cet échange dit aussi les métamorphoses de soi, ou plutôt du monde (« Je ne change pas. C’est la vie autour de moi qui change. Si on ne se durcit pas, on ne survit pas. Et c’est notre âge qui a changé »), la liberté retrouvée (« Dans mes rêves les plus fous, je n’espérais pas vivre ça »), mais la liberté trahie par une apparence de révolution, les faux-semblants politiques et les déceptions culturelles.
Le roman baigne entièrement dans le théâtre (et vice-versa). Alexandra et Ioana ont toutes deux, sous des aspects distincts et complémentaires (l’écriture, la scène), la même vocation, et c’est ce qui renforce leur complicité (leur rivalité parfois). Shakespeare et Puck, le lutin du Songe d’une nuit d’été, sont des points d’ancrage récurrents ; et assez naturellement, Alexandra se met à « tricoter une pièce à deux personnages, une pièce épistolaire dont tu devines les protagonistes » ; les lettres, la pièce, le roman (sans compter les éléments autobiographiques) : tout s’imbrique, dans une sorte de mise en abyme de l’expérience littéraire.
Autre fil conducteur, noué au précédent : la langue française, dont Alexandra fait peu à peu l’apprentissage, jusqu’à l’utiliser comme langue d’écriture littéraire, et comme langue maternelle de son fils. Apprentissage difficile : « Dire que j’ai choisi le français pour me faciliter la tâche ! Dès que j’ai une idée à exprimer, pas de problème, les mots sont là, limpides et précis. Mais dès que je m’attaque au moindre sentiment, le vocabulaire se dérobe. Pour traduire dor de tara, je n’ai trouvé que mal du pays. Et si on n’a précisément pas mal ? Si c’est plus insidieux que ça, précisément comme le dor ? Nostalgie, mélancolie, ça existe encore mais pour dor, cette tristesse de l’âme qui se languit, au-delà même de la souffrance, va chercher ». Il y a toutefois la volonté indéfectible de surmonter les obstacles, jusqu’au constat d’une maîtrise parfaite : au bout du compte, Ioana constate que les colères de sa sœur n’éclatent plus en roumain, mais bel et bien en français !
Au-delà du théâtre, de la langue, de l’écriture, c’est évidemment l’exil qui est au coeur de tout, le titre y insiste ; l’exil politique, géographique, linguistique, familial, sentimental… Mais le choix du genre, la subtilité et la limpidité de l’écriture, la profondeur et la complexité des personnages, l’imbrication de la narration dans l’histoire roumaine et européenne font de cet exil une richesse non seulement du point de vue littéraire, mais tout simplement du point de vue humain.
Jean-Pierre Longre
18:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, anca visdei, actes sud | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/07/2010
La Roumanie européenne
 Mircea Vasilescu, Eurotextes, le continent qui nous sépare, traduit du roumain par Ioana Bot, MétisPresses, Genève, 2010
Mircea Vasilescu, Eurotextes, le continent qui nous sépare, traduit du roumain par Ioana Bot, MétisPresses, Genève, 2010
Mircea Vasilescu, universitaire, traducteur, journaliste, fondateur de la revue Dilema, a visiblement beaucoup réfléchi à la position actuelle de la Roumanie dans l’Europe, en s’appuyant sur l’histoire particulière du pays et sur les contradictions que révèle la confrontation entre son passé trouble, son présent instable et son futur incertain. Dans ce recueil d’articles initialement publiés dans des journaux – surtout Lettre internationale et Dilema veche – il est donc question de la Roumanie et de ses problèmes spécifiques, mais aussi de l’Europe et de ses problèmes généraux. On s’aperçoit alors que les contradictions internes du pays sont parallèles à celles du « continent ».
L’auteur aborde sans a priori les questions les plus cruciales, en deux parties aux titres parlants : « Les nouvelles guerres du fromage » et « Le continent qui nous sépare ». Il s’agit, par exemple, de la « distance entre les intellectuels et les ouvriers » et de la nécessité de « reconstituer la classe moyenne », des difficultés engendrées par les normes européennes (réelles ou prétendues) en matière alimentaire (la « tzuika », le porc, le fromage ! et les traditions ?), de la place de la minorité hongroise, avec sa langue et sa culture, du contraste entre le développement urbain et la stagnation rurale… Compte tenu de ces constats, l’indispensable relation des Roumains avec l’Union Européenne paraît problématique : attirance et répulsion, méfiance mutuelle et conscience des nécessaires échanges économiques et culturels. Le texte sur « le marché du travail dans l’Union Européenne et les problèmes de chez nous » est, entre autres, particulièrement pertinent, de même que tout ce qui concerne le fonctionnement de l’Europe et, plus généralement encore, tout ce qui concerne la politique, au sens large du terme ; à signaler, à ce sujet, l’article qui, partant du succès du film 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Cristian Mungiu, dénonce la « logique perverse selon laquelle l’idéologie prime sur la convention artistique » (logique dont ceux qui, à l’Est, ont subi les dictatures communistes sont bien revenus…).
On constate donc que, traitant de la Roumanie, ce livre traite aussi de l’Europe occidentale ; on devine que le « continent » nous sépare de moins en moins : même s’il faut relativiser, la corruption des élites n’a-t-elle pas cours en France (ou ailleurs), et pas seulement en Roumanie ? La méfiance à l’encontre des règlements européens n’est-elle pas similaire en France (ou ailleurs)? Gageons que la Roumanie réussira ce qu’il est convenu d’appeler son « intégration », tout en conservant son côté fascinant aux yeux des « étrangers qui viennent jusqu’à elle ». Mircea Vasilescu le reconnaît à juste titre : « C’est un pays avec de nombreux problèmes, où les standards de l’Union Européenne ne sont pas toujours respectés. Mais c’est aussi un pays avec une vie intellectuelle dynamique et intense, avec une jeune génération qui a su assimiler les valeurs européennes et le comportement public de type européen, avec une tradition culturelle consistante et intéressante. C’est surtout un pays doté d’un grand potentiel d’adaptation ».
Jean-Pierre Longre
13:22 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, roumanie, europe, mircea vasilescu, ioana bot, métispresses, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/06/2010
Grandeur de la décadence
 Cioran, De la France. Traduction du roumain revue et corrigée par Alain Paruit. Éditions de l’Herne, 2009.
Cioran, De la France. Traduction du roumain revue et corrigée par Alain Paruit. Éditions de l’Herne, 2009.
En 1941, installé à Paris, Cioran se transforme. Séduit un temps par le brutal apparat de la « Garde de fer » roumaine et par la force nazie, il se transforme et opte plus ou moins implicitement et très heureusement pour le camp adverse. Cette « métamorphose » se laisse entrevoir dans De la France, petit livre écrit au crayon, exhumé, traduit à un moment où, vieux de 68 ans, il reste d’une singulière actualité. « Livre charnière », « ode à la France », comme l’écrit Alain Paruit dans sa présentation, l’ouvrage est une frontière : entre totalitarisme et libéralisme (au sens politique), entre roumain et français (la langue roumaine est parsemée d’expressions françaises), entre hymne à la grandeur et éloge de la décadence…
Car Cioran, opérant des comparaisons avec d’autres pays, développe le paradoxe suivant : la France est grande, et la preuve en est sa décadence immuable. Selon le processus d’écriture qui lui est cher, les fragments de pensées s’agglutinent, s’additionnent, entraînant le doute et la conviction. Chaque lecteur y trouve son compte, s’arrêtant à son gré sur des termes récurrents (« ennui, cafard, décadence, XVIIIe siècle, goût, sociabilité, raison, expérience, progrès, mesure »…) définissant la France selon Cioran, cette France de l’esprit contre le cœur, où le culte du repas tient lieu de liturgie quotidienne, et dont la perfection tient à des « riens ». « Pays d’êtres humains et non d’individus », « la France est une occasion éclatante de vérifier les expériences négatives ».
À l’heure où quelques politiciens en mal de popularité cherchent à définir une identité « nationale », il est bon de lire cet hymne à la France étrangère écrit par un de ces immigrés à qui nous devons de magnifiques pages de notre patrimoine littéraire. Ecoutons rêver le petit Roumain : « Y a-t-il au monde un pays ayant eu autant de patriotes issus d’un autre sang et d’autres coutumes ? […] N’avons-nous pas aimé la France avec plus d’ardeur que ses fils, ne nous sommes-nous pas élevés ou humiliés dans une passion compréhensible et toutefois inexplicable ? N’avons-nous pas été nombreux, en provenance d’autres espaces, à l’embrasser comme le seul rêve terrestre de notre désir ? Pour nous qui arrivions de toutes sortes de pays, de pays malchanceux, la rencontre d’une humanité aboutie nous séduisait en nous offrant l’image d’un foyer idéal. » L’illusion opère toujours.
Jean-Pierre Longre
19:18 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, cioran, alain paruit, editions de l'herne, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/06/2010
Suite et convergence
 Elena-Brânduşa Steiciuc, Fragments francophones, éditions Junimea, Iaşi, 2010. Préface de Michel Beniamino.
Elena-Brânduşa Steiciuc, Fragments francophones, éditions Junimea, Iaşi, 2010. Préface de Michel Beniamino.
La francophonie implique des va-et-vient, des « déplacements » permettant « la rencontre des cultures, l’émergence d’un universalisme concret et d’un nouveau cosmopolitisme », comme l’écrit Michel Beniamino dans sa préface. Et c’est bien dans cet esprit qu’Elena-Brânduşa Steiciuc, poursuivant sa quête littéraire, a composé son nouvel ouvrage.
Par-delà la diversité des voix, des auteurs, des pays, des points de vue, Fragments francophones est un ensemble convergent. Entre deux développements sur les aspects universitaires et didactiques débouchant sur la combinaison identité / universalité, la littérature de langue française est envisagée selon de grands espaces géographiques, de l’est à l’ouest, du nord au sud : la Grèce avec Vassilis Alexakis, la Roumanie avec Oana Orlea, Lena Constante, Marthe Bibesco, Paul Miclău, Irina Mavrodin, Felicia Mihaili, cette dernière formant transition avec le Québec et Réjean Ducharme, puis la France avec Patrick Modiano et J.-M.-G. Le Clézio, le Maghreb avec Boualem Sansal, Tahar Ben Jelloun et Ahmed Beroho.
Diversité apparente des auteurs, et aussi des genres (souvenirs, dénonciation de l’univers concentrationnaire, roman individuel ou collectif, poésie, jeux de langage…), mais unité de fait autour de l’axe essentiel : la réflexion sur la francophonie littéraire, un concept « ambigu », selon Tahar Ben Jelloun, mais riche d’un passé, d’un présent et (espérons-le) d’un avenir universels ; un concept, en tout cas, que l’auteur, qui lui a déjà consacré plusieurs ouvrages, continue à explorer avec perspicacité.
Jean-Pierre Longre
http://www.sitartmag.com/francophonieauf%E9minin.htm
09:26 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, roumanie, elena-brânduşa steiciuc, éditions junimea, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2010
Les miroirs de la mémoire
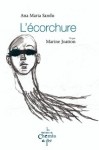 Ana Maria Sandu, L’écorchure. Vu par Marine Joatton. Traduit du roumain par Fanny Chartres. Les éditions du Chemin de Fer, 2010.
Ana Maria Sandu, L’écorchure. Vu par Marine Joatton. Traduit du roumain par Fanny Chartres. Les éditions du Chemin de Fer, 2010.
En vers libres (ou en prose rythmée), une succession de tableaux tentent de fixer sur la page les fluctuations de la mémoire. Il ne s’agit pas vraiment d’autobiographie, mais plutôt de souvenirs poétisés, dans lesquels l’imaginaire et l’écriture de jeunesse tiennent aussi leur place, souvenirs oscillant entre la première, la deuxième et la troisième personne, comme si le miroir, en fragments divers, multipliait les angles de vue et nous donnait à voir plusieurs « petites ana » dont chacune a « une histoire à raconter ».
Les histoires, ces divers va-et-vient dans le passé, entre la petite enfance, avec ses jeux et ses travaux, et la période des études, avec ses amours et ses débuts littéraires, nous mènent vers « ces choses simples et insignifiantes », parfois heureuses, souvent douloureuses, qui font l’intimité d’une petite fille et d’une femme. Les jeux de l’enfance, notamment, ne sont pas dénués de violence et de sexualité naissante. Les plaisirs, les brimades, les amitiés, les inimitiés, les modes de vie, les coutumes du passé dans la Roumanie des années 1970-1980, tout est dit sans fausse pudeur, sans complaisance non plus. Et cela contribue à la poétisation de la vie, dans ses dimensions physiques et mentales, réalistes et oniriques.
Les dessins de Marine Joatton, à gros traits côtoyant les mots, s’y superposant parfois, les « écorchant » au passage, renforcent l’aspect visuel du texte. Ils ne l’illustrent pas, mais lui ajoutent leur dimension, à la limite du fantastique. Les qualités poétique et plastique, l’étroite complémentarité des arts font de L’écorchure ce qu’on peut appeler un beau livre.
Jean-Pierre Longre
09:33 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, illustration, francophone, roumanie, ana maria sandu, marine joatton, les éditions du chemin de fer, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/06/2010
Les fondements et l’essor d’un patrimoine
![arton98[1].gif](http://jplongre.hautetfort.com/media/02/02/690389068.gif) Andreia Roman, Litteratura româna / Littérature roumaine, tomes I et II,
Andreia Roman, Litteratura româna / Littérature roumaine, tomes I et II,
éditions Non Lieu, 2010
La littérature, au sens moderne du terme, est relativement jeune en Roumanie. Comme le précise l’auteur dans son introduction, elle « connaît une germination lente et ses œuvres importantes ne paraissent que vers la fin du XIXe siècle ». Jeune, mais d’une originalité, d’une diversité, d’une qualité qui nécessitaient une présentation à la fois accessible et détaillée, destinée au grand public. Andreia Roman nous la propose, dans ces deux premiers volumes : Des origines à 1848 (consultant pour la version française : Philippe Loubière) ; De l’époque des « grands classiques » à la Première Guerre mondiale (consultante pour la version française : Lorène Vanini).
La chronologie mène le lecteur du Moyen Âge tardif au début du XXe siècle, selon trois axes complémentaires : une histoire synthétique, de brèves monographies sur les principaux écrivains et un ensemble de textes dont le choix, forcément tributaire d’une certaine subjectivité, est pourtant motivé par la volonté de donner à lire une anthologie représentative des grands moments et des grands courants de la littérature roumaine.
Ces deux volumes obéissent donc visiblement à une intention didactique : faire connaître clairement l’histoire et les productions d’un patrimoine littéraire que les lecteurs français, sauf exception, ne connaissent pas. Mais cette intention n’exclut pas l’analyse de ce qui le fonde et le constitue. Par exemple les « acculturations successives » (slavo-byzantine, grecque, latine, austro-hongroise, allemande, française), les liens avec l’histoire politique et la conquête d’une identité nationale, avec l’affirmation d’une langue spécifique, avec le folklore… On apprend à connaître les querelles qui divisèrent les tenants d’une autonomie culturelle, critiquant les « formes sans fond » et créant en 1864 la société littéraire Junimea, et les admirateurs des cultures étrangères (notamment française), qui s’inspiraient de la révolution de 1848 et de ce qui l’accompagnait en matière artistique. On mesure combien l’essor de la littérature est lié au renouvellement, voire à la création, au XIXe siècle, d’une langue roumaine moderne et des institutions qui favorisent son enseignement… Et l’on comprend qu’au-delà des grandes individualités dites « classiques » (Mihail Eminescu, Alexandru Macedonski, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ion Slavici), les groupements et les revues telles que Viaţa românească ont joué un rôle capital.
Rappelons que ces deux volumes sont bilingues, et qu’ainsi ceux qui possèdent et le roumain et le français peuvent lire les textes dans les deux langues, depuis « La Lettre de Neacşu de Câmpulung » (1521), premier texte connu en langue roumaine, jusqu’aux poèmes symbolistes et expressionnistes de George Bacovia (1881-1957). Cela en attendant le troisième volume, qui nous aidera à tracer notre chemin dans le foisonnement de la littérature contemporaine.
Jean-Pierre Longre
15:22 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire littéraire, roumanie, andreia roman, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2010
Qui est la cantatrice chauve ? ou la dénonciation par l’absurde
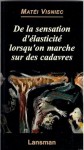
Matéi Visniec
De la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres
Lansman, 2009
D’emblée, Matéi Visniec annonce que sa pièce « est née du désir de rendre hommage à Eugène Ionesco ». C’est effectivement un bel hommage au dramaturge franco-roumain, mais aussi à d’autres grands personnages de l’histoire littéraire récente (Lautréamont, Radiguet, Gide, Tzara, Breton, Queneau etc.) et à toute la littérature, la vraie, celle qui n’est pas aux ordres du pouvoir.
Le protagoniste de la pièce, « le poète », tente de vivre entre ses rencontres avec des fantômes qu’il est le seul à voir – ceux des écrivains qu’il admire – et les brimades de la dictature staliniste qui cherche à imposer en Roumanie, comme ailleurs, les uniques productions du « réalisme socialiste », quitte à marcher sur des cadavres. Évidemment, le théâtre dit « de l’absurde », les bonnes blagues politiques, les jeux verbaux, la liberté artistique, tout cela est incompatible avec le totalitarisme, et les tentatives de décryptage des prétendus messages codés que contient La cantatrice chauve donnent une scène d’un délire indescriptible… La mise en abyme de l’écriture de Ionesco dans celle de Visniec est une trouvaille qui vaut toutes les explications de texte : comme mode de dénonciation de la cruauté humaine et de la bêtise politique, il n’y a pas mieux. En même temps, la pièce baigne dans une atmosphère de nostalgie poétique et d’idéalisme littéraire dont le point de convergence ne peut être que Paris, la « patrie mentale » de ces Roumains qui ont longtemps rêvé de l’« acte culturel » consistant à « boire un café à Paris, sur une terrasse » avant d’aller flâner chez les bouquinistes.
C’est d’ailleurs sur cette vision que s’achève De la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres, si l’on ne tient pas compte des « scènes supplémentaires » que l’auteur propose à la lecture, à juste titre. Il faut lire l’interview de Sanda Stolojan relatant la visite de De Gaulle en Roumanie en 1968, ainsi que les développements d’un doctorant soutenant que les génies conjugués du « trio infernal Ionesco-Cioran-Eliade » ont bloqué la création roumaine, et il faut assister à l’apothéose fictive de Ionesco à qui l’on remet les 7 000 pages de son dossier de la Securitate, summum de l’absurde au service de la nullité politique.
Jean-Pierre Longre
Avignon, Espace Alya - jeudi 15 juillet 19h45 - Carte Blanche : Matéi Visniec
Matéi Visniec - Lecture, débat, rencontre autour de son œuvre poétique inconnue à ce jour en France.
Avant le théâtre, il y avait la poésie. Matéi Visniec a écrit de la poésie pendant une bonne vingtaine d'années avant de passer au théâtre. Son œuvre poétique, connue et apprécie en Roumanie, vient d'être traduite en français par Nicolas Cavaillès. Matéi Visniec, entouré par des amis comédiens, vous propose un voyage dans un univers poétique qui annonçait déjà, par son côté iconoclaste, son théâtre. Venez nombreux, chacun partira avec un poème de Visniec dans l'âme.
Espace 40, lecture(s) et librairie, 40 rue Thiers, 84000 Avignon : rencontre avec Matéi Visniec, vendredi 16 juillet à 12 h - autour de sa dernière pièce éditée chez Lansman, De la sensation d'élasticité lorsqu'on marche sur des cadavres
16:09 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théâtre, francophone, roumanie, matéi visniec, lansman, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Le pouvoir de l’innocence
 Florina Ilis, La croisade des enfants. Traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2010.
Florina Ilis, La croisade des enfants. Traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2010.
Une chaude journée d’été, en gare de Cluj ; prêts au départ, l’express pour Bucarest, et le « train spécial » pour la Mer Noire, emmenant une troupe d’enfants en colonie de vacances, sous la houlette de leurs professeurs. Cela commence bien, chacun joue son rôle. Une série de portraits montre les voyageurs et autres protagonistes en action, chacun représentant un type de personnage que l’on s’attache à suivre successivement et périodiquement.
Le grain de sable, c’est Calman, enfant des rues et des égouts de Bucarest, dont l’esprit de révolte et de liberté va se mêler à l’imaginaire des écoliers nourri de cinéma, de télévision et d’Internet. Mélange explosif, transformant les enfants en « croisés » du train, dont ils s’emparent et qu’ils arrêtent en pleine campagne, après avoir eu soin d’enfermer les professeurs dans leur compartiment. À partir de là, tout bascule dans l’épopée. Les enfants sans famille convergent de tout le pays vers le train forteresse, les revendications de toutes sortes fusent, la police, l’armée, la mafia, les médias, le gouvernement sont de plus en plus impliqués dans l’affaire, violence et tentatives de négociations alternent dans la plus grande confusion.
Roman collectif, odyssée devenant iliade, La croisade des enfants est aussi une série de romans individuels dont le point de ralliement est un coin de forêt dans la vallée de la Prahova. Enfants-héros, enfants-victimes, parents inquiets ou affolés, professeurs indignés ou compréhensifs, journalistes critiques ou démagogues, trafiquants de drogue et d’êtres humains, religieux thaumaturge, Tzigane cartomancienne, députés et ministres experts en langue de bois, on en passe… La galerie est immense, colorée, exubérante, savoureuse… Chacun, poussé dans ses retranchements, semble redécouvrir le monde et la vie, le monde et la vie mêmes semblent se métamorphoser. Jusqu’où ? Chaque lecteur se donnera ses limites.
Inséparable du récit, se coulant en lui (et inversement), le style de Florina Ilis triture les mots, les phrases, la ponctuation, et l’auteure manie avec grande dextérité l’art du second degré. Les séquences se suivent avec naturel tout en se superposant, en un souffle ininterrompu auquel on ne peut se soustraire.
Jean-Pierre Longre
09:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, florina ilis, marily le nir, éditions des syrtes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/05/2010
Farce tragique et totalitarismes

Norman Manea
Les clowns : le dictateur et l'artiste, traduit du roumain par Marily Le Nir et Odile Serre, Le Seuil, 2009.
L'enveloppe noire, traduit du roumain par Marily Le Nir, Le Seuil, « Fictions & Cie », 2009.
Les deux ouvrages de Norman Manea parus au Seuil en octobre 2009 peuvent se lire simultanément, en alternance, l'un après l'autre, selon l'humeur... L'un est un recueil d'essais qui, s'appuyant sur l'histoire récente de la Roumanie, aide à méditer non seulement sur le communisme et ses déviances (la dictature, le nationalisme), mais aussi sur des sujets plus généraux tels que les rapports de l'art avec le politique, la censure, l'ambiguïté des relations internationales, l'antisémitisme, le monde d'aujourd'hui et son « hystérie carnavalesque »... L'autre est un roman où l'étrange (des personnages et de leurs destinées) le dispute au réalisme (de la toile de fond, des situations), où l'imaginaire prend corps sur la cruelle absurdité des régimes dictatoriaux (des années 1940 et des années 1980).
Les clowns : le dictateur et l'artiste répond, selon l'auteur, à une urgence : celles de « décrire la vie sous la dictature roumaine » et d'en « tirer enseignement », notamment en ce qui concerne « la relation entre l'écrivain, l'idéologie et la société totalitaire ». Chaque texte vise ainsi à peindre la tyrannie (sous un jour tragique ou comique, burlesque ou insupportable), et à en tirer des réflexions qui se fondent sur l'expérience personnelle. Car Norman Manea a vécu, comme un certain nombre d'autres, le triple drame du siècle : « l'Holocauste, le totalitarisme, l'exil » ; son mérite exceptionnel est de ne jamais prendre la posture de la victime, de se donner suffisamment de recul pour analyser avec lucidité et vigueur, d'une plume implacable, parfois violente, voire sarcastique, les débats, les aberrations, les contradictions, les ridicules, les abus de la grotesque dictature de Ceauşescu. Sans négliger les échos et comparaisons (nazisme et communisme, Hitler et Staline), Norman Manea met en avant les spécificités roumaines des années 1980 - la volonté de cacher la diversité sous les proclamations nationalistes, les subtilités de la censure, la récupération des positions nationalistes de Mircea Eliade, l'antisémitisme, les rapports avec (et de) la Securitate, les hypocrisies (et les révoltes plus ou moins larvées) du monde intellectuel... Tout cela mis en perspective, selon le « mouvement simultané en avant - en arrière » qu'il revendique en tête de son essai sur le Journal de Mihail Sebastian. « Les fondements de l'avenir tiennent à la qualité et à la probité de l'appréhension du passé » : la dernière phrase est une belle synthèse de ce qui est mis en œuvre tout au long du livre.
L'enveloppe noire est, dans le domaine de la fiction, une sorte de caisse de résonance artistique des Clowns, dont l'un des chapitres relate d'ailleurs l'histoire de la difficile publication du roman, soumis à l'approbation pleine d'embûches du « Conseil de la Culture et de l'Éducation Socialistes - Service Lecture » (disons : la Censure) ; et ce n'est pas un hasard si, quelques mois après sa parution, en 1986, Norman Manea quittait la Roumanie.
Dans le roman, Anatol Dominic Vancea Voinov, dit plus simplement Tolia, a été privé de son poste de professeur pour se retrouver réceptionniste à l'hôtel TRANZIT ; confronté aux vicissitudes de la vie quotidienne sous la dictature et aux soubresauts de sa propre personnalité, il est en même temps en proie aux souvenirs et à la quête des circonstances de la mort de son père, « suicidé ou trucidé » sous une autre dictature, celle des années 1940 - et cela jusqu'à l'irruption du rêve dans les souvenirs et dans la vie, jusqu'à la folie. L'enveloppe noire est certes le roman d'un individu qui bute sur « les arêtes du concret », mais aussi celui d'une société, des relations humaines, et de l'histoire d'un demi-siècle ; le roman des destins individuels et de la destinée collective. On y assiste à la mise en scène, en instantanés tragi-comiques, des absurdités d'un système où « les poursuivants sont à leur tour poursuivis, la suspicion, la peur stimulent et font dévier leurs propres ondes », où « tout se dilate, glisse, s'effiloche », où le mieux considéré est, par exemple, « Toma, le sourd-muet exemplaire ! Qui voit tout, sait tout, est informé de tout, mais n'en parle qu'à qui de droit, quand il le faut ». Spectacle plein d'échos (dont celui de la fameuse pièce de Ion Luca Caragiale Une lettre perdue), écriture foisonnante et débordante, humour salutaire et absurde abyssal... Le roman de Norman Manea est une porte ouverte sur un hors-scène infini, « un vide grandiose » dont il est difficile de sortir indemne.
Jean-Pierre Longre
11:50 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, roumanie, norman manean marily le nir, odile serre, jean-pierre longre, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/04/2010
Le jeune Fundoianu
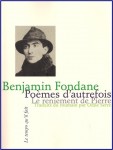 Benjamin Fondane
Benjamin Fondane
Poèmes d’autrefois, Le reniement de Pierre. Traduits du roumain par Odile Serre.
Le Temps qu’il fait, 2010.
Pour ceux qui connaissent peu ou prou les œuvres que Benjamin Fondane a écrites en français, la lecture de ces textes de jeunesse traduits du roumain offre une belle vision de la genèse de son écriture et de ses préoccupations ; et pour ceux qui n’ont encore rien lu de lui, voilà une entrée en matière qui non seulement respecte la chronologie, mais surtout donne un avant-goût prometteur. Deux grandes parties dans ce volume : des poèmes d’adolescence et de jeunesse, soit publiés à partir de 1914 dans des revues soit inédits, puis un « poème dramatique » publié en 1918 et, ici, éclairé par une postface de Monique Jutrin. La traduction d’Odile Serre, dont le rythme et les sonorités s’adaptent parfaitement à la tonalité d’ensemble, confère une valeur supplémentaire au talent naissant du poète.
L’inspiration biblique est le principal facteur d’unité de l’ouvrage : Le reniement de Pierre, qui donne une version personnelle, « amorale » d’un épisode fameux du Nouveau Testament, préfigure les questions que l’auteur se posera toute sa vie. Et beaucoup des poèmes qui précèdent, aux titres sans ambiguïté (« Psaumes », « Monastères », « Élévation », « Bible »…), donnent une idée de sa culture, de ses incertitudes, de sa quête mystique, et aussi de l’émancipation de l’homme n’hésitant pas à reprocher à Dieu de ne jamais être « descendu par ici » et à lui dire : « C’est plus beau à la campagne, Seigneur, que là où tu es, au ciel ».
Car l’autre espace poétique est celui de la campagne, d’une nature qui doit beaucoup aux « paysages » roumains, aux personnages qui les peuplent, humains et animaux, aux forêts et aux prairies, à l’odeur des fleurs, au silence des forêts, à la lumière du soleil, aux bruissements de la pluie… Tableaux impressionnistes, saynètes plaisantes, évocations sentimentales traduisent la sensibilité du jeune poète qui, nourri de livres (Baudelaire et d’autres en filigrane çà et là), laisse s’épanouir sa personnalité en un symbolisme maîtrisé, d’ailleurs revendiqué et défini dans l’« éclaircissement » qui précède Le reniement de Pierre : « Originalité, bon sens, profondeur, absence d’imitation, de modèle, subconscient, nouveau et parfois sain ». Ces Poèmes d’autrefois sont déjà des poèmes de maturité.
Jean-Pierre Longre
16:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, benjamin fondane, odile serre, jean-pierre longre, le temps qu'il fait | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Révolutions hallucinées
 Mircea Cartarescu
Mircea Cartarescu
L’aile tatouée. Roman traduit du roumain par Laure Hinckel.
Denoël, 2009.
« Ce n’est pas l’oiseau, mais le papillon qui a été pour les Grecs et pour ceux qui les ont précédés le symbole de l’âme et de l’immortalité. […] Le papillon a inventé l’âme humaine ».
Troisième volume d’une trilogie monumentale, après Orbitor et L’œil en feu, L’aile tatouée relève de la même écriture foisonnante, vertigineuse que les deux précédents romans. S’il y est toujours question de Bucarest, c’est cette fois sous l’angle de la « révolution » de décembre 1989, de la pitoyable chute de Nicolae et Elena Ceausescu, de la misère et de la révolte, de la rapide prise du pouvoir par une autre (ou la même) nomenclature… Ce n’est cependant pas un roman historique – ou alors dépassant très largement l’histoire événementielle, pour rejoindre celle de l’Homme, du Monde, de l’Univers… Il y a certes des descriptions pittoresques du Bucarest de naguère, l’évocation des blagues populaires sur le couple de tyrans, les traces amères de la Securitate ; mais les souvenirs ponctués de vols de papillons et de froids regards d’araignées, d’éclairs fulgurants et d’ombres menaçantes, de mêlent aux hallucinations et aux visions d’apocalypse. Bucarest, ville où la vie quotidienne se présente dans toute sa dégradation, devient aussi une cité transfigurée, point de départ pour des voyages vers toutes les autres cités du monde.
Au cœur du récit, Mircea en personne, enfant, jeune homme, écrivain face aux feuillets de son manuscrit, Mircea observé de plusieurs points de vue, le sien, ceux de quelques autres, celui du miroir qui reflète son image (ou serait-ce celle de Victor, son jumeau disparu ?) ; Mircea et son avenir, Mircea et son passé, même ses ancêtres Csartarowski… Beaucoup de mystères, beaucoup de questions dans les explorations fantastiques des souterrains glauques et dans les fantasmes du futur adulte, beaucoup de pistes aussi pour le lecteur qui se laisse entraîner par un flot qu’il ne maîtrise plus.
Mircea Cartarescu possède au plus haut degré l’art de concilier l’infime et le grandiose, de manier le microscope aussi bien que le télescope, d’observer les plus petits objets comme les paysages hallucinés, les jouets d’enfants ou les instruments de cuisine comme les firmaments mystiques de l’espace et du temps. Son écriture est celle de toutes les révolutions : politiques, intimes, terrestres, célestes.
Jean-Pierre Longre
Liens :
15:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, mircea cartarescu, laure hinckel, jean-pierre longre, denoël | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/04/2010
Trouver le livre parfait ?
 Dumitru Tsepeneag, Frappes chirurgicales, P.O.L., 2009
Dumitru Tsepeneag, Frappes chirurgicales, P.O.L., 2009
Il est toujours utile de tenir compte de regards à la fois étrangers et avertis, extérieurs et intérieurs sur la vie littéraire et culturelle d’un pays, et il n’est pas indifférent que, concernant la France, sa langue et sa littérature, ces regards viennent d’écrivains qui ont la double expérience de la vie locale et de l’émigration. C’est en grande partie sur eux que l’on doit compter pour un véritable renouvellement de la langue et de la littérature.
Le dernier livre que l’écrivain franco-roumain Dumitru Tsepeneag vient de publier en français rassemble des articles critiques diffusés initialement en revue (Seine et Danube, puis La revue littéraire) entre 2003 et 2007. En toute subjectivité, l’écrivain multiplie avec un humour corrosif les angles d’attaque contre les abus de la mode artistique et littéraire, n’hésitant pas même à fustiger les opinions d’autres auteurs francophones : l’une de ses cibles, par exemple, est Nancy Huston, qui dans Professeurs de désespoir dénonce le nihilisme de certaines grandes figures de la littérature européenne comme Beckett, Cioran, Thomas Bernard ou Elfriede Jelinek, mais aussi celui de petites figures médiatisées comme Michel Houellebecq et Christine Angot : « C’est l’esprit démocratique à l’américaine de notre Nancy qui la pousse à mélanger génies et plumitifs ? Ou le populisme franchouillard qu’elle a appris depuis qu’elle vit ici ?», écrit-il avec une amicale rugosité.
Le jugement de Tsepeneag est à la fois partial, sans appel, spirituel (voir les remarques sur « l’ambulance » Philippe Labro) et intéressant, puisque, entre autres, il rappelle à sa manière deux versants de son écriture: le versant étranger et le versant français, leur point de jonction, leur sommet commun présentant l’avantage d’une double culture, double culture qui peut être aussi à double sens, comme ici : « J’ai fait un rêve. J’étais un vieux critique littéraire, je vivais en Roumanie et j’adorais la littérature française. C’était ma mère nourricière. J’essayais de me tenir au courant de ses dernières tendances. On m’avait dit que Frédéric Beigbeder passait aux yeux de ses lecteurs pour un grand écrivain. Tout le monde le lisait. Ceux qui n’avaient pas le temps de le lire le regardaient à la télé. Il était beau. Comment ne pas admirer son menton volontaire, sa chevelure rebelle, son regard perçant. En Roumanie on avait traduit tous ses livres. Il était venu une fois à Bucarest, les femmes se bousculaient devant lui, tentaient de le toucher, criaient, désespérées. Je me suis réveillé en sueur… »
Mais Frappes chirurgicales n’est pas une entreprise de démolition. À côté des tirs plus ou moins meurtriers, à côté de la défense de quelques livres comme Les Bienveillantes, d’auteurs comme Pierre Péju, Emmelene Landon et quelques autres, il y a une véritable réflexion sur certains aspects de la littérature passée, sur le phénomène des prix littéraires, sur le sort réservé de nos jours aux revues, sur l’Europe… Surtout, il y a le goût exigeant et communicatif de la lecture : « Je cherche le livre rare qui me plairait sans objection aucune, le livre dont je puisse dire, voilà, la vraie littérature française, toujours à la hauteur de sa grande renommée. Je lis, sinon comment pourrais-je trouver ce livre… »
Jean-Pierre Longre
17:06 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, roumanie, dumitru tsepeneag, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

