21/05/2018
Ne jamais renoncer
 Eva Mozes Kor et Lisa Rojany Buccieri, Survivre un jour de plus. Le récit d’une jumelle de Mengele à Auschwitz. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Notes de nuit, 2018.
Eva Mozes Kor et Lisa Rojany Buccieri, Survivre un jour de plus. Le récit d’une jumelle de Mengele à Auschwitz. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Notes de nuit, 2018.
On ne s’habituera jamais à l’horreur, et chaque témoignage sur les camps d’extermination apporte son lot de questions sur « l’espèce humaine », à la suite de celles que se pose Robert Antelme. En lisant Survivre un jour de plus, on se demande comment des hommes, des médecins devenus bourreaux, ont pu se rendre coupables des atrocités infligées à leurs victimes sous prétexte d’expérimentations médicales, et comment les victimes – du moins certaines d’entre elles – ont pu résister aux souffrances. Cette résistance, Eva Mozes Kor l’explique par l’amour que sa jumelle Miriam et elle se portaient mutuellement, ce qui constituait un soutien inébranlable : « Nous nous raccrochions l’une à l’autre parce que nous étions des jumelles. Nous comptions l’une sur l’autre parce que nous étions des sœurs. Et parce que nous appartenions à la même famille, nous ne renoncions pas. ». Ajoutons à cela une force de caractère exceptionnelle : « Je ne suis pas morte, me répétais-je. Je refuse de mourir. Je vais me montrer plus futée que ces docteurs, prouver à Mengele qu’il a tort, et sortir d’ici vivante. ».
Âgées de dix ans, Eva et Miriam, Juives nées en Roumanie, ont été déportées à Auschwitz avec leur famille – leurs parents et leurs deux sœurs, qu’elles ne reverront pas. C’est leur long calvaire qu’avec l’étroite collaboration de Lisa Rojany Buccieri l’auteure relate ici : le départ forcé de leur village sous le regard muet d’une population rongée par l’antisémitisme, l’arrivée brutale au camp, les expériences inhumaines faites sur les jumeaux, et donc sur Eva et Miriam, par Mengele et ses sbires, les maladies, la faim, la peur incessante de la séparation et de la mort, mais le courage inaltérable. Enfin la déroute nazie, la libération par les Russes (qui ne manquent pas de mettre en scène le film de la sortie du camp), et la question de l’avenir qui se pose aux deux fillettes maintenant seules : « Nous avions survécu à Auschwitz. Nous avions onze ans. Nous n’avions désormais qu’une question en tête : comment allions-nous rentrer chez nous ? ». Après maints détours, c’est le retour au village de Porţ, le malaise qui les prend en réalisant que ce ne sera plus jamais comme avant, et la volonté de se construire « une nouvelle vie ». Pendant cinq ans elles vivront à Cluj chez leur tante, puis, avec les difficultés que l’on devine sous le régime roumain de l’époque, ce sera le départ pour Israël.
Devenue par la suite américaine, Eva Mozes Kor a fondé « une association de soutien aux jumeaux ayant survécu aux expérimentations de Josef Mengele, et a aidé à faire pression sur plusieurs gouvernements afin que soit retrouvé ce dernier. ». Après le décès de Miriam, elle a ouvert à sa mémoire le « Musée et centre éducatif de la Shoah », et est devenue une ambassadrice de la paix et du pardon – conformément à ce qu’elle espère transmettre aux jeunes générations et qui conclut l’ouvrage : ne jamais renoncer, et pardonner à ses ennemis. Ce livre poignant, illustré par d’émouvantes photos, est à la fois témoignage nécessaire, leçon de courage et « message de pardon ».
Jean-Pierre Longre
22:32 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, anglophone (États-unis), eva mozes kor, lisa rojany buccieri, blandine longre, notes de nuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/07/2017
Perec, la réapparition
 Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Claude Burgelin, Album Georges Perec, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Une parution en Pléiade, c’est à la fois un moment et un monument. À plus forte raison en ce qui concerne Georges Perec – et Christelle Reggiani commence son introduction, « Un peintre de la vie moderne », en insistant sur la combinaison entre « l’éternel et l’éphémère » qui apparaît, par exemple, dans Les Revenentes, mais aussi un peu partout. L’écrivain lui-même voyait dans son oeuvre « quatre champs différents, quatre modes d’interrogation » : les interrogations « sociologique », « autobiographique », « ludique » et « romanesque ». Ce qui réfère par exemple, pour évoquer les œuvres les plus connues, aux Choses, à W ou le souvenir d’enfance, à La disparition et à l’Oulipo, à La vie mode d’emploi. On pourrait ajouter que toute l’œuvre est traversée par le « rapport à l’histoire » et par « la mise sous contrainte de l’écriture », dont les liens sont étroits. Cela dit, Christelle Reggiani complète ces quatre « champs » par « deux pôles contraires » dans l’écriture : celui de la « blancheur » ou de la « platitude » et celui de « l’hermétisme affiché de la poésie hypercontrainte ».
 Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…
Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…
Et pour parfaire l’ensemble, Claude Burgelin, qui a bien connu l’écrivain, signe un très bel Album Georges Perec. Selon le modèle du genre, la biographie de l’auteur est parsemée de photos, de documents qui ne peuvent laisser indifférent, car ils mettent en avant une autre sorte de dualité de l’homme et de son œuvre, résumée dans ce paragraphe : « Perec a fait s’écrouler de rire des milliers de lecteurs ou d’auditeurs. Sa verve, sa drôlerie, sa façon de rendre sublime l’art du calembour sont étincelantes. En même temps son œuvre est issue d’une des pires barbaries de l’Histoire. Perec ne l’a jamais laissé oublier. Il n’a cessé de réfléchir à ce que fut le crime nazi et aux catastrophes qu’il a provoquées. Sa manière de faire tournoyer la force du comique, de l’ironie, et la violence de la tragédie met en place un ressort d’une rare puissance. ». C’est ainsi que l’écriture absolument maîtrisée de Perec est aussi une écriture de l’émotion absolue.
Jean-Pierre Longre
En complément, une réédition récente :
 Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017
Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017
Un rival de la littérature
Né en Chine, introduit au Japon en l’an 735, le jeu de Go est à la fois « esthétique, polémique et cérébral ». Rival de l’art et de la littérature, il demande un bon entraînement et des facultés intellectuelles avérées, et a parfois remplacé, nous dit-on, la guerre elle-même. En tout cas, il paraît que l’attaque de Pearl Harbor et l’occupation du Pacifique par les Japonais relèvent de ce jeu. Duel mené à coups de pièces noires et blanches sur une sorte de damier (le Go Ban), le Go pourrait faire penser aux Dames ou aux Échecs ; non, nous disent les auteurs, c’est un jeu beaucoup plus subtil, consistant non pas à détruire les adversaires, mais à occuper le plus de terrain possible avec le minimum de pièces (ou pierres).
 Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...
Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...
Évidemment encore, l’ouvrage n’est pas exempt de cet esprit oulipien qui guide les auteurs, dans leur perspective à la fois sérieuse et récréative. Aux définitions, aux éléments de tactique, au traitement des problèmes stratégiques, aux conseils décisifs se mêlent des intermèdes narratifs, des jeux verbaux, des imitations (un beau pastiche de Kipling), des allusions littéraires etc. Voilà qui contribue grandement au plaisir que nous éprouvons à lire ce livre, quel que soit notre passé, notre présent et notre avenir dans la pratique du jeu de Go. Et si celui-ci rivalise avec la littérature, n’hésitons pas à affirmer que ledit livre est autant une œuvre littéraire qu’un « petit traité ».
Jean-Pierre Longre
www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-P...
http://associationgeorgesperec.fr
10:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, poésie, autobiographie, essai, francophone, georges perec, christelle reggiani, dominique bertelli, claude burgelin, florence de chalonge, maxime decout, maryline heck, jean-luc joly, yannick séité, pierre lusson, jacques roubaud, christian bourgois, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2017
« Le goût des mots »

Dany Laferrière, L’art presque perdu de ne rien faire, Grasset, 2014, Le livre de poche, 2017
Ne nous y trompons pas. Même si, çà et là, y figurent des textes intitulés « L’amateur de sieste », « Éloge de la lenteur » ou « L’art de dormir dans un hamac », même si la nonchalance y est avec bonheur communicative, le livre de Dany Laferrière n’est pas un livre de vrai paresseux. C’est une somme de réflexions, de méditations, de variations, de confidences, d’analyses sur des sujets liés à l’existence humaine en général et à l’expérience de l’écrivain en particulier, et pour lesquels, certes, la tranquillité est de mise.
Vingt-trois chapitres eux-mêmes composés de plusieurs textes autonomes, que l’on peut lire comme les Essais de Montaigne, « à sauts et à gambades », avec la lenteur voulue, que l’on peut savourer, garder en bouche tout en se laissant aller aux rêveries et aux pensées qu’ils suscitent. C’est un choix infini de thèmes et de motifs qui nous est proposé : le temps, les rapports sociaux, l’amour, la mort, les voyages, la culture, le plaisir, la peur, la violence, le pouvoir, la nostalgie, l’art et, bien sûr, les livres et les écrivains préférés – le tout n’étant pas exempt de quelques épisodes autobiographiques, de quelques souvenirs intimes. Cerise sur le gâteau, chaque chapitre est ponctué par un texte en vers libres, qui donne à ce que l’on peut considérer comme une mosaïque d’essais une belle touche poétique.
 Non que la prose de l’académicien Dany Laferrière soit aride, bien au contraire. Comme toujours chez lui, elle se caractérise par son pouvoir d’évocation et d’émotion, d’empathie et d’ironie, par sa sensualité, son humour, son « goût des mots » – pour reprendre le titre d’un texte inclus dans un chapitre ô combien prometteur, « Un orgasme par les mots »…
Non que la prose de l’académicien Dany Laferrière soit aride, bien au contraire. Comme toujours chez lui, elle se caractérise par son pouvoir d’évocation et d’émotion, d’empathie et d’ironie, par sa sensualité, son humour, son « goût des mots » – pour reprendre le titre d’un texte inclus dans un chapitre ô combien prometteur, « Un orgasme par les mots »…
On voudrait tout retenir de ce traité de vie, ou mieux, de ce roman de la vie. Car il s’agit bien de cela : Dany Laferrière se et nous raconte des histoires, des histoires qui donnent à penser, qui nous rendent intelligents, pour peu qu’on puisse l’être, des histoires qui aident à vivre. « J’ai toujours vu un lien entre la librairie et le cimetière », écrit-il. L’art presque perdu de ne rien faire nous fait retrouver l’idée que les livres nous aident à attendre calmement et délicieusement la mort.
Jean-Pierre Longre
22:43 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, francophone, dany laferrière, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2017
Lire, relire... L’amour et la barbarie
 Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon, Et tu n’es pas revenu, Grasset, 2015, Le livre de poche, 2016. Suivi d'un dossier d'Annette Wievorka. Grand prix des lectrices de Elle - Document.
Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon, Et tu n’es pas revenu, Grasset, 2015, Le livre de poche, 2016. Suivi d'un dossier d'Annette Wievorka. Grand prix des lectrices de Elle - Document.
Arrêtés en mars 1944 à Bollène, passés par Drancy, Froim Rozenberg et sa fille Marceline ont été déportés à Auschwitz. Séparés dès l’arrivés (lui à Auschwitz, elle à Birkenau), ils ne se sont revus que furtivement, de manière risquée – et lui n’est jamais revenu. Le récit que Marceline fait de cette tragédie bien des années plus tard est une extraordinaire lettre ouverte à son père tant aimé ; comme une amorce épistolaire, cette lettre débute par l’évocation d’un mot que son père avait réussi à lui faire passer là-bas et qui commençait par « ma chère petite fille », et le livre se termine par une terrible question posée par sa belle-sœur : « Maintenant que la vie se termine, tu penses qu’on a bien fait de revenir des camps ? »…
La réponse est contenue par anticipation dans ces cent pages denses, qui racontent l’horreur vécue par une jeune fille de 16 ans, dans le côtoiement quotidien des chambres à gaz et des cadavres, dans la famine et le gel, sous les coups de la cruauté nazie. Elles racontent aussi le retour, l’absence si lourde de celui qui lui avait prédit : « Tu reviendras, Marceline, parce que tu es jeune », un retour auprès d’une mère qui « ne voulait pas comprendre » et d’une famille qui a sa vie, malgré tout, et la tentation du suicide, de l’effacement désespéré.
 Il y aura les mariages – le deuxième avec Joris Ivens, pionnier du cinéma, fameux documentariste, avec qui elle vivra l’engagement, les réussites, les erreurs, les voyages, la création. « Imagine le monde après Auschwitz. Quand la pulsion de vie succède à la pulsion de mort. Quand la liberté retrouvée contamine la planète entière et décrète de nouvelles batailles. ». Chant d’amour filial écrit à l’âge de 86 ans, où on lit entre autres cette phrase bouleversante : « Je t’aimais tellement que je suis contente d’avoir été déportée avec toi. », Et tu n’es pas revenu est aussi une belle leçon d’humanité, de courage et d’intransigeance dans le combat contre la barbarie.
Il y aura les mariages – le deuxième avec Joris Ivens, pionnier du cinéma, fameux documentariste, avec qui elle vivra l’engagement, les réussites, les erreurs, les voyages, la création. « Imagine le monde après Auschwitz. Quand la pulsion de vie succède à la pulsion de mort. Quand la liberté retrouvée contamine la planète entière et décrète de nouvelles batailles. ». Chant d’amour filial écrit à l’âge de 86 ans, où on lit entre autres cette phrase bouleversante : « Je t’aimais tellement que je suis contente d’avoir été déportée avec toi. », Et tu n’es pas revenu est aussi une belle leçon d’humanité, de courage et d’intransigeance dans le combat contre la barbarie.
Jean-Pierre Longre
15:58 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, récit, francophone, marceline loridan-ivens, judith perrignon, grasset, jean-pierre longre, annette wieviorka, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/01/2017
Après le massacre
 Catherine Meurisse, La légèreté, Dargaud, 2016
Catherine Meurisse, La légèreté, Dargaud, 2016
Catherine Meurisse était depuis dix ans dessinatrice à Charlie-Hebdo. Le 7 janvier 2015, quittée par son amoureux, elle est restée tard au lit, plongée dans les bulles de cette déception sentimentale. Et cela lui a sans doute sauvé la vie, mais ne l’a pas exonérée de la dépression qui a suivi le massacre de ses compagnons de travail par les frères Kouachi.
La légèreté est le récit graphique (et autobiographique) de ce qui a suivi : pannes de dessin, participation au numéro « des survivants », différents modes de psychothérapie, cauchemars, cohabitation avec les gardes du corps et la presse, soirée au théâtre (Oblomov, avec comme des correspondances entre la pièce et la vie), séjours à la campagne, à la mer, à la montagne, retours en arrière, décision d’aller à Rome éprouver le « syndrome de Stendhal » (le vertige dont l’homme peut être pris « face à un déluge de beauté »), donc séjour à la Villa Médicis et confrontation à l’art de toutes les époques…
Le titre de l’album est particulièrement parlant. C’était une sorte de pari : comment retrouver « la légèreté » après une si lourde tragédie ? Comment retrouver la beauté après la laideur de la stupidité sanguinaire ? Par le dessin, l’autoportrait, l’observation de soi et des autres, l’émotion révélée, l’humour renouvelé, l’amitié célébrée, la discrète variété des couleurs, la finesse du trait, l’éveil progressif à la vie réinvestie, à des sensations variées, à l’humanité. « Une fois le chaos éloigné, la raison se ranime et l’équilibre avec la perception est retrouvé. On voit moins intensément, mais on se souvient d’avoir vu… Je compte bien rester éveillée, attentive au moindre signe de beauté… Cette beauté qui me sauve, en me rendant la légèreté. ». Paroles sur fond bleu clair de ciel et de mer, et la frêle silhouette de l’auteure qui regarde passer ses pensées. Un très beau tableau.
Jean-Pierre Longre
18:08 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman graphique, autobiographie, francophone, catherine meurisse, dargaud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/10/2016
Sortir de la zone
 Louis Calaferte, Requiem des innocents, Folio, 2016
Louis Calaferte, Requiem des innocents, Folio, 2016
La grande ville n’est jamais nommée mais le caractère autobiographique du récit laisse deviner qu’il s’agit de Lyon. Peu importe. Comme partout et comme toujours, en marge de la cité il existe une « zone » grouillante de crasse et de vermine, envahie par la misère et l’alcoolisme, par la violence et la débauche, un ghetto peuplé d’êtres humains pourtant. C’est une longue rue boueuse bordée de taudis où les lieux de rassemblement sont des bistrots sordides, un terrain vague ou de vieux wagons au rancart, et qui vit d’une vie quasiment autonome, avec ses petits et grands trafics et son désoeuvrement.
Il y a là une bande de gamins parmi lesquels le jeune Calaferte est une personnalité, disons le second du chef. Derrière les mauvais coups reçus et donnés, se manifeste une solidarité de petits délinquants, une amitié de terrain vague que le fils non désiré d’immigrés italiens qui a pu s’extirper de la fange n’oubliera jamais. « Je sais d’où je viens. Je n’ai pas renié ma race. Je sais que là-bas la vie était pareille à la terre, noire, sale. Qu’elle ne pardonnait pas. Ni le mal ni le bien. Je sais que tout y était sujet à ordure et à désespérance. Je sais qu’on n’empoigne pas le malheur. Qu’on ne lui fracasse pas la tête. Que ce n’est pas une question de force. Vous pouvez amener demain vos pitoyables dépouilles : je pleurerai en vous accueillant, les bras ouverts. Vous pouvez m’appeler, je n’aime bien que la misère des hommes. C’est un bout de notre vérité, la misère. Ça vous fait tenir les yeux écarquillés. Ça vous dérange. Ça vous détruit. Ça vous réforme. C’est mâle, la misère. Faut écouter ou s’en aller. C’est exigeant. Vous pouvez m’appeler. Je vous reconnaîtrai. ». Mauvais garçons, mais amis bénis, alors qu’une malédiction vengeresse tombe sur les parents indignes : « Toi, ma mère, garce […]. Si tu savais ce que c’est qu’une mère. Rien de commun avec toi, femelle éprise, qui livra ses entrailles au plaisir et m’enfanta par erreur. ». Et pour le père : « Ridicule embryon, toi, Calaferte, je sais où te trouver. […] Un jour dans cette rue à mendier ton pain, demain ailleurs à t’enivrer. Rien n’était peut-être de ta faute. Je te ressemble. Nous subissons la vie sans trop songer à nous révolter. ». (Voilà de longues citations, mais de vrais échantillons d’un style hors du commun).
 S’il ne s’est pas révolté, comment le jeune Calaferte est-il sorti de ce cloaque ? Pas de mystère : par l’école. Pas n’importe laquelle. Surtout, par un maître, Lobe, qui « avant tout était un homme. Pour lui, la vie était une chose. Les diplômes en étaient une autre. ». Lorsqu’il apprend que, seul de la bande, il a réussi le certificat d’études, et ne trouve pas mieux pour garder l’estime de ses camarades que de déchirer son papier, le garçon garde intacte l’affection de ce Lobe, qui « était exactement le pédagogue qu’il nous fallait », qui a su faire confiance à ceux qui, auparavant, étaient objets des pires contrôles et d’une cruauté sadique.
S’il ne s’est pas révolté, comment le jeune Calaferte est-il sorti de ce cloaque ? Pas de mystère : par l’école. Pas n’importe laquelle. Surtout, par un maître, Lobe, qui « avant tout était un homme. Pour lui, la vie était une chose. Les diplômes en étaient une autre. ». Lorsqu’il apprend que, seul de la bande, il a réussi le certificat d’études, et ne trouve pas mieux pour garder l’estime de ses camarades que de déchirer son papier, le garçon garde intacte l’affection de ce Lobe, qui « était exactement le pédagogue qu’il nous fallait », qui a su faire confiance à ceux qui, auparavant, étaient objets des pires contrôles et d’une cruauté sadique.
Si tout est vrai dans ce livre qui « n’est pas un roman », qui n’invente rien, sa prose directe, aussi brutale que ce qu’elle raconte, aussi pathétique dans sa sécheresse voulue que la souffrance qu’elle décrit, est la preuve que la littérature n’est pas une question de fioritures, l’art pas une question d’artifices. Le jeune homme qu’était Louis Calaferte (1928-1994) lorsqu’il mena cette entreprise autobiographique (première publication chez Julliard en 1952) réussit, comme subrepticement, à composer une œuvre qui, par sa puissance émotionnelle, risque bien de laisser une trace indélébile dans le cœur du lecteur.
Jean-Pierre Longre
17:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, récit, francophone, louis calaferte, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2016
Retour au village
 Lire, relire: Pierre Jourde, La première pierre, Gallimard, 2013, Folio, 2015
Lire, relire: Pierre Jourde, La première pierre, Gallimard, 2013, Folio, 2015
Les faits, plus ou moins déformés, ont suffisamment défrayé la chronique pour qu’on n’y revienne pas en détail. Un écrivain publie un livre sur le village de ses origines et de ses vacances, un certain nombre d’habitants prennent mal ce qu’il en a écrit, et l’été suivant, l’auteur et sa famille sont pris physiquement à partie dès leur arrivée devant la maison : coups échangés, bébé blessé, enfants affolés, fuite éperdue sous les jets de pierre – le tout vécu dans une double dimension temporelle, accélération des événements, étirement du temps. Le récit se poursuit avec ses nécessaires conséquences : plainte chez les gendarmes, dépositions des uns et des autres, procès (intenté essentiellement pour le traumatisme vécu par les enfants), médiatisation, et surtout, avec le souvenir indélébile, la rupture irrémédiable avec les anciens compagnons du « pays perdu », ceux qui vous ont fait naguère partager leurs travaux et leurs jeux, leurs soirées conviviales et la rudesse de la montagne.
 Ils y sont remontés depuis, l’auteur et sa famille, dans le hameau resserré, au bout des lacets de la route, parmi les regards fuyants et les figures fermées, définitivement considérés comme inexistants, et acceptés comme tels par eux-mêmes. « Comment peut-on supposer que tu accueillerais tout content, reconnaissant presque, les signes de dégel, les embryons d’échange, les tentatives de pacification ? Après les pierres aux enfants, le mur du silence refermé sur des gens qui n’y peuvent rien, les étrangers circonvenus, les dos tournés de ceux qui n’étaient même pas concernés ? C’est terminé, et à jamais, et c’est très bien ainsi. Il y a le sang d’un gamin d’un an entre nous. ». Et il y a le sang familial qui attache définitivement à la terre des ancêtres, celle qui est au cœur du livre et dans le cœur de ceux qui l’habitent ou l’ont habitée. Ce livre, qui ne tient pas du règlement de comptes, mais de l’explication, de l’examen des faits comme vus de l’extérieur (le "tu" que le narrateur s’applique à lui-même est celui de l’observation de soi), finalement d’un « tout compte fait » à caractère profondément littéraire et humain, ce livre donc est aussi un hymne à ce coin de montagne auvergnate, aux anciennes estives, aux derniers hameaux avant les sommets, à la vie rude de leurs habitants, au silence des paysages, et nous vaut de poétiques évocations : les pentes du volcan avec « toute une végétation rase où se détachent par intervalles les hautes tiges des gentianes […], un vieux bois de pins tout tordus, où l’on imagine que doivent se réunir des magiciens par les nuits de pleine lune. ».
Ils y sont remontés depuis, l’auteur et sa famille, dans le hameau resserré, au bout des lacets de la route, parmi les regards fuyants et les figures fermées, définitivement considérés comme inexistants, et acceptés comme tels par eux-mêmes. « Comment peut-on supposer que tu accueillerais tout content, reconnaissant presque, les signes de dégel, les embryons d’échange, les tentatives de pacification ? Après les pierres aux enfants, le mur du silence refermé sur des gens qui n’y peuvent rien, les étrangers circonvenus, les dos tournés de ceux qui n’étaient même pas concernés ? C’est terminé, et à jamais, et c’est très bien ainsi. Il y a le sang d’un gamin d’un an entre nous. ». Et il y a le sang familial qui attache définitivement à la terre des ancêtres, celle qui est au cœur du livre et dans le cœur de ceux qui l’habitent ou l’ont habitée. Ce livre, qui ne tient pas du règlement de comptes, mais de l’explication, de l’examen des faits comme vus de l’extérieur (le "tu" que le narrateur s’applique à lui-même est celui de l’observation de soi), finalement d’un « tout compte fait » à caractère profondément littéraire et humain, ce livre donc est aussi un hymne à ce coin de montagne auvergnate, aux anciennes estives, aux derniers hameaux avant les sommets, à la vie rude de leurs habitants, au silence des paysages, et nous vaut de poétiques évocations : les pentes du volcan avec « toute une végétation rase où se détachent par intervalles les hautes tiges des gentianes […], un vieux bois de pins tout tordus, où l’on imagine que doivent se réunir des magiciens par les nuits de pleine lune. ».
Lieu étrange et familier, si lointain et si proche, « le pays est un exil et un égarement. Ici, la terre montre la trame, le paysage est une violence en voie d’effacement. C’est au moment où il va s’évanouir que l’être nous saisit dans son évidence et son mystère. Voilà ce qui retient, sur ces grands plateaux entaillés de gorges profondes, où le vent ne cesse d’énoncer un appel incompréhensible. ». La première pierre est un beau livre qui ne lève pas les mystères, mais qui met au jour les paradoxes de l’attachement au pays et la complexité des comportements humains.
Jean-Pierre Longre
16:12 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, pierre jourde, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/05/2016
Journal de l’hypermarché
 Lire, relire: Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Seuil, « Raconter la vie », 2014, Folio, 2016
Lire, relire: Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Seuil, « Raconter la vie », 2014, Folio, 2016
Rien de plus trivial, rien de plus nécessaire que de « faire ses courses » en grande surface, lieu de survie de l’espèce humaine dans le monde occidental actuel. De cette réalité quotidienne (ou, disons, hebdomadaire), Annie Ernaux a tiré une substance mi-sociologique mi-littéraire en tenant pendant un an le journal de ses passages à l’hypermarché Auchan de Cergy.
On retrouve dans cette relation régulière les sensations, les impressions que l’on éprouve en ces lieux sans leur prêter vraiment attention, en tout cas sans leur donner plus d’importance qu’aux gestes répétitifs d’une existence banale. On y retrouve aussi des contraintes et des agacements plus ou moins éprouvants (le caddie bancal, les bousculades dans des rayons surpeuplés, l’attente aux caisses, la déshumanisation des machines automatiques…), ainsi que la reproduction presque caricaturale des divisions sociales (hommes / femmes, jeunes / vieux, classes populaires / classes moyennes et supérieures). Paradoxalement, l’hypermarché est aussi comme un refuge, un lieu de plaisir personnel, sinon de fascination : « Je suis allée à Auchan au milieu de l’après-midi après avoir travaillé depuis le matin à mon livre en cours et en avoir ressenti du contentement. Comme un remplissage du vide qu’est, dans ce cas, le reste de la journée. Ou comme une récompense. Me désoeuvrer au sens littéral. Une distraction pure ». Une « distraction » qui fait prendre conscience de sa modestie et de son impuissance devant les interdictions diverses (de photographier, de consommer ou de lire sur place etc.) et devant le gigantisme : « L’hypermarché contient environ 50 000 références alimentaires. Considérant que je dois en utiliser 100, il en reste 49 900 que j’ignore ».
 Sociologie et littérature, donc, devant ce qui relève à la fois de l’observation de soi et des autres dans un contexte qui dépasse l’individu : l’auteure est à la fois, sans honte affichée ni fausse modestie, dans le monde (la foule des acheteurs) et hors du monde, puisqu’il s’agit pour elle de prendre du recul par l’écriture. « Voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence ».
Sociologie et littérature, donc, devant ce qui relève à la fois de l’observation de soi et des autres dans un contexte qui dépasse l’individu : l’auteure est à la fois, sans honte affichée ni fausse modestie, dans le monde (la foule des acheteurs) et hors du monde, puisqu’il s’agit pour elle de prendre du recul par l’écriture. « Voir pour écrire, c’est voir autrement. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur conférer valeur d’existence ».
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, journal, autobiographie, annie ernaux, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/05/2016
« Qui me réveillera ? »
 Max Blecher, Aventures dans l’irréalité immédiate, suivi de Cœurs cicatrisés, traduit du roumain par Elena Guritanu, préface de Claro, postface de Hugo Pradelle, Éditions de l’Ogre, 2015
Max Blecher, Aventures dans l’irréalité immédiate, suivi de Cœurs cicatrisés, traduit du roumain par Elena Guritanu, préface de Claro, postface de Hugo Pradelle, Éditions de l’Ogre, 2015
« L’impression générale et essentielle de théâtralité devenait une véritable terreur dès que je pénétrais dans un cabinet de curiosités exposant des figures de cire. À mon effroi se mêlaient une vague ondulation de plaisir et la sensation étrange, que nous éprouvons tous parfois, d’avoir déjà vécu la même chose, dans le même décor. Si jamais naissait en moi le sentiment d’un but existentiel et si cette ébauche était véritablement liée à quelque chose de profond, d’essentiel et d’irrémédiable, alors mon corps devrait se transformer en une statue de cire dans un musée et ma vie en une contemplation sans fin de ses vitrines. ». Telle est la prose d’un écrivain encore trop méconnu, né dans le nord de la Roumanie, mort en 1938 à l’âge de 29 ans après avoir vécu pendant 10 ans atteint par le « mal de Pott », tuberculose osseuse qui l’obligea à interrompre ses études de médecine à Paris et à passer son existence dans divers sanatoriums.
Trop méconnu, et pourtant plusieurs fois traduit en français (par Mariana Şora, Georgeta Horodinca, Hélène Fleury, Gabrielle Danoux…). Ce volume, qui réunit deux ouvrages différents traduits par Elena Guritanu, témoigne d’une écriture à la fois introspective et expressive, qui met en relation étroite le rêve et la réalité, l’hallucination et la sensation. Aventures dans l’irréalité immédiate est l’exploration d’une âme en proie à la perception d’un monde à la fois étrange et familier, défiguré par la douleur et recomposé par la poésie des mots et des phrases, une âme qui, comme une spectatrice de théâtre, est à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, observatrice et observée. Ce premier récit, en va-et-vient et en circonvolutions, est un pathétique et admirable appel à la survie, malgré tous les obstacles : « Je me débats, je crie, je m’agite. Qui me réveillera ? ».
Cœurs cicatrisés, de facture plus narrative, est le récit du séjour d’Emanuel (le double de l’auteur) dans un sanatorium de Berck. La maladie y est certes omniprésente, pensionnaires enserrés dans leur corset de plâtre, couchés nuit et jour, transportés en calèche, souffrant de mille maux – mais pensionnaires vivants. Emanuel, comme les autres, participe à des fêtes clandestines et alcoolisées, noue des amitiés solides, connaît des aventures amoureuses, fait de longues promenades dans les dunes ; il recherche aussi la solitude, découvre les Chants de Maldoror, rêve, voit disparaître certains de ses compagnons, jusqu’à son propre départ vers une autre destination, un autre sanatorium, d’autres espérances. Sous la linéarité du récit, se tissent les aventures intérieures, ainsi qu’une sorte de commentaire voilé, fruit d’une observation de soi et des autres qui n’exclut ni l’humour (noir ou morbide) ni la satire (discrète) ni bien sûr l’introspection.
Ainsi saisit-on le bien-fondé de cette double publication : sous deux formes différentes, Max Blecher est un écrivain de la relation intime que l’individu entretient avec lui-même et avec ce qui l’entoure, entre imaginaire et réel transfigurés.
Jean-Pierre Longre
08:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, roumanie, max blecher, elena guritanu, claro, hugo pradelle, Éditions de l’ogre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2015
« La bonne éducation »
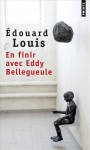 Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Le Seuil, 2014, Points, 2015
Chaque classe sociale a ses normes, ses règles, ses exigences, ses frontières hors desquelles on est considéré comme un paria. Pour échapper à l’ostracisme, seule la fuite semble être la solution. Fuir les autres, fuir la famille, fuir les insultes, les coups et les humiliations, fuir jusqu’à son nom, tel est l’argument du premier roman d’Édouard Louis, dont le succès lors de sa parution aux éditions du Seuil lui vaut maintenant une édition en poche (Points).
Un roman qui superpose et mêle plusieurs genres en une composition binaire : Livre 1, « Picardie (fin des années 1990 – début des années 2000) » ; Livre 2, « L’échec et la fuite ». Plusieurs genres, donc : roman social (l’auteur a lu et étudié Pierre Bourdieu), qui campe et analyse de l’intérieur le prolétariat de la fin du XXème et du début du XXIème siècle, à coups de descriptions sans concessions (mais sans jugement moral) et de citations orales – ce qui, stylistiquement parlant, a le mérite de mêler les registres de langue et de faire ressortir la crudité verbale que l’auteur a su mettre à distance. Le roman autobiographique, qui narre dans un mélange subtil d’objectivité et d’hypersensibilité le douloureux décalage que le jeune Eddy ressent par rapport à sa famille, à ses copains, et qu’il tente désespérément d’effacer. Le roman initiatique d’un garçon qui se sent rapidement différent des autres, féminin, dans un milieu où la virilité ostensible est la marque obligée du monde des hommes, un garçon qui voudrait ne pas être ce qu’il est, qui s’essaie à l’amour des filles mais ne peut échapper à l’opprobre de plus en plus ricanant et hostile de son environnement familial, villageois, scolaire, et qui finalement découvre qu’il y a d’autres manières de vivre que celle dans laquelle il était enfermé.
 En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
En finir avec Eddy Bellegueule est une œuvre courageuse qui, à la manière des autobiographies de Michel Leiris, ne cherche pas à échapper aux risques personnels, qui les provoque même. Mais c’est aussi et surtout l’œuvre d’un écrivain. S’il y a du Zola dans l’évocation de la misère sociale, du Jules Renard (celui de Poil de Carotte) dans celle de l’enfance malheureuse, la division en brèves séquences donne à l’ensemble une visibilité théâtrale, quasiment cinématographique, tout en préservant le relief de la réalité. Souffrir et jouir, aimer et rejeter, s’attacher et fuir, mépriser et admirer – Édouard Louis, avec une précoce maturité, sait restituer toute la complexité des comportements humains.
Jean-Pierre Longre
16:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Un père, malgré tout?
Pascal Bruckner, Un bon fils, Grasset, 2014 , Le Livre de Poche, 2015
, Le Livre de Poche, 2015
« Mon père m’a permis de penser mieux en pensant contre lui. Je suis sa défaite : c’est le plus beau cadeau qu’il m’ait fait ». Tel est le point de convergence des souvenirs et des réflexions dont est composé Un bon fils. Récit de vie paternelle ? Autobiographie ? Règlement de compte ? Essai de psychologie familiale ? Il n’y a pas à choisir : le livre est un peu tout cela, qui, entre narration discontinue et mosaïque de maximes philosophiques, en fait une œuvre littéraire.
En trois parties (« Le détestable et le merveilleux », « L’échappée belle », « Pour solde de tout compte ») et un épilogue-surprise, Pascal Bruckner développe le paradoxe du « bon fils » d’un père qui, dirait-on, fait tout pour être haï : mari brutal, pervers et infidèle, antisémite, xénophobe, pronazi s’empressant d’aller travailler pour l’ennemi, être despotique et imprévisible, puis exemple encore vivant de la décrépitude physique – s’accrochant envers et contre tout à son fils unique qui, en réaction, s’éloigne avec vigueur et passion d’une enfance inquiète. « Je me suis allégé de ma famille en m’alourdissant d’autres liens qui m’ont enrichi ».
 Le salut, pour le fils du tyran, ce sera d’abord la lecture. « Dans les livres, enfin, j’apprends la grammaire de la liberté grâce aux dieux de ma jeunesse, Sartre, Gide, Malraux, Michaux, Queneau, Breton, Camus. Je me construis à travers eux une forteresse inexpugnable ». Ce sera aussi la prise de l’indépendance et de la liberté (les voyages, les amours, le rejet des contraintes de l’existence bourgeoise). Et ce sera, bien sûr, l’écriture, ces livres qui font de Pascal Bruckner un auteur original, à la fois penseur (de ceux que l’on rangeait naguère parmi les « nouveaux philosophes ») et auteur de belles fictions romanesques. « Tant qu’on crée, tant qu’on aime, on demeure vivant ». Ce récit initiatique, qui ne s’arrête pas au simple dévoilement de secrets de famille, mais élargit le champ d’investigation à l’apprentissage de la vie, le prouve avec limpidité.
Le salut, pour le fils du tyran, ce sera d’abord la lecture. « Dans les livres, enfin, j’apprends la grammaire de la liberté grâce aux dieux de ma jeunesse, Sartre, Gide, Malraux, Michaux, Queneau, Breton, Camus. Je me construis à travers eux une forteresse inexpugnable ». Ce sera aussi la prise de l’indépendance et de la liberté (les voyages, les amours, le rejet des contraintes de l’existence bourgeoise). Et ce sera, bien sûr, l’écriture, ces livres qui font de Pascal Bruckner un auteur original, à la fois penseur (de ceux que l’on rangeait naguère parmi les « nouveaux philosophes ») et auteur de belles fictions romanesques. « Tant qu’on crée, tant qu’on aime, on demeure vivant ». Ce récit initiatique, qui ne s’arrête pas au simple dévoilement de secrets de famille, mais élargit le champ d’investigation à l’apprentissage de la vie, le prouve avec limpidité.
Jean-Pierre Longre
14:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, récit, pascal bruckner, grasset, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2015
Une assourdissante absence
 Pascal Herlem, La soeur, L’arbalète Gallimard, 2015
Pascal Herlem, La soeur, L’arbalète Gallimard, 2015
Le premier mot du titre, en deux lettres, en dit déjà long : ni « ma », ni « notre » ; « la » sœur n’appartient à personne, à peine à la famille, cette « sœur aînée, presque une inconnue. Une sœur qu’en croyant bien faire on a lobotomisée », cette sœur dont l’auteur écrit : « Je l’ai toujours connue ainsi, absente ».
Absente, mais sans cesse présente d’une manière ou d’une autre, pendant et après l’enfance, dans une famille dominée par « la » mère (toujours cette non appartenance). Pascal Herlem puise dans ses souvenirs d’enfant et d’adulte, mais aussi dans trois récits laissés par la mère, « trois récits glaçants » qui composent quelque peu avec la vérité, sans occulter les faits : la lobotomie qui ne résoudra rien, les hospitalisations, les périodes de crise, la disparition de Françoise dans différentes maisons où elle restera enfermée loin de ses deux frères qui paraissent s’accommoder de cette absence, de ce silence en réalité assourdissant. Une sorte de mort par anticipation – et la découverte finale en est pour ainsi dire une attestation.
Racontant l’histoire de Françoise, l’auteur raconte sa propre histoire et celle des siens, remontant aux « origines » d’une famille déclassée, dans laquelle la bâtardise, la mort, la folie voudraient être effacées par les rêves de réhabilitation sociale de la mère, comme par les « arrangements », les non-dits et l’enfouissement des secrets. De surcroît, l’étrange (ou compréhensible ?) effacement du père devant l’omniprésence de la mère est une constante, jusqu’à la fin : « Papa n’est pas là, il est ailleurs, on ne sait pas où ». Bref, tout cela méritait d’être raconté, et Pascal Herlem le fait avec une courageuse sincérité, sans complaisance mais sans animosité, avec une sensibilité tout en retenue qui n’exclut ni la prise de distance, ni l’esquisse d’explications socio-psychologiques, ni, surtout, un travail de mise en ordre littéraire. La force du sujet et de son traitement qui laisse percer de tendres et tenaces regrets, le choix précis des mots, la belle et suggestive limpidité du style font de La sœur un livre que l’on ne peut oublier.
Jean-Pierre Longre
10:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, pascal herlem, gallimard, l’arbalète, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2015
Kafka à l’Université
 Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Voulant d’urgence échapper (au moins quelques années) aux turbulences de l’enseignement en collège, Jeanne décide de s’inscrire en thèse. Après l’euphorie des débuts (bien qu’elle n’ait pu obtenir de financement), commence le parcours du combattant universitaire.
Combattant, ou soutier, comme on voudra. Franchie l’étape du dossier d’inscription, entravée par l’inertie dissuasive de la secrétaire ; celle de l’entretien avec le directeur de recherches, aussi charmant que silencieux, laissant passer six mois avant de répondre au moindre mail ; celle des cours à donner, dont la préparation mange tout le temps que l’on croyait réserver à la recherche, et qui finalement se révéleront aussi peu lucratifs qu’inutiles ; celles, successives, de la documentation bibliographique envahissante, de l’établissement d’un plan aussi labyrinthique que changeant, de la rédaction sans cesse repoussée mais à laquelle il faudra bien se mettre un jour… Sans compter l’incompréhension de l’entourage (le petit ami, la famille) qui ne s’explique pas pourquoi Jeanne se lance dans un travail qui ne rapporte rien, qui paraît totalement vain, voire irresponsable, et qui exacerbe son égocentrisme ; pas comme le cousin Alexandre qui, lui, va faire une thèse scientifique, utile au progrès de l’humanité, n’est-ce pas ; mais à quoi peut bien servir un travail sur la parabole de la loi dans Le Procès de Kafka ? Cela dit, lorsque Jeanne parviendra à sa soutenance, l’entourage en question sera aussi fier qu’il aura été sceptique et critique les années précédentes…
Tiphaine Rivière aurait pu écrire un roman autobiographique. Cela nous aurait privés du charme de ses dessins, qui tient au trait à la fois précis et nuancé, au mélange d’apparente candeur et d’ironie vraie, de réalisme et d’onirisme. Vignettes muettes ou dialogues vifs, couleurs contrastées ou teintes pastel, arrière-plans grisâtres ou animés, scènes de la vie quotidienne ou rêves éveillés, tout concourt à plonger le lecteur dans les affres intimes et cycliques de notre héroïne. Tout est bien vu, à l’image de cet édifice monstrueux (kafkaïen) aux coupoles interchangeables et aux murs instables qui représente le plan (de 64 pages) que Jeanne n’en finit pas de déconstruire et de reconstruire. Drôles et réalistes, vivants et oniriques, ces Carnets de thèse permettront à certains de s’y retrouver, à d’autres de se préparer, à tous de pendre plaisir à une histoire à la fois cauchemardesque et pleine d’humour.
Jean-Pierre Longre
10:14 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, dessin, autobiographie, tiphaine rivière, jean-pierre longre, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/12/2014
« J’espère en ton jardin »
Jacques Chauviré, Fils et mère, Le temps qu’il fait, 2014
Jacques Chauviré, né en 1915, mort en 2005, a connu ce qu’ont connu beaucoup d’enfants de sa génération : le père tué, la mère, devenue veuve de guerre, obligée d’élever seule ses enfants – en l’occurrence, comme souvent, avec l’aide des grands-parents. En 1985, celui qui est devenu depuis longtemps médecin et écrivain sollicite sa mémoire toujours vive, rédigeant un vaste portrait, original et passionné, de celle qui le considérait comme « la chair de sa chair », résurgence presque sensuelle de son époux, allant jusqu’à donner à l’enfant le prénom du défunt, Ivan, brouillant inconsciemment les identités.
Ce récit rétrospectif d’un fils à la fois aimant et lucide a la forme d’une lettre (de plus de cent pages) adressée à celle qui a été marquée, dans son cœur et dans son corps, par la mort et l’absence, qui en a marqué son dernier fils, et qui a lutté avec obstination et simplicité contre le vide. « Le jardin témoigne de l’ordre que tu souhaites sur la terre. Dans son ordonnance, il s’est opposé aux fureurs de la guerre, maintenant il t’apporte une certaine paix. ». Rien n’est figé : l’adoration filiale quasiment charnelle, au fil des ans, devient amour, dévouement, révolte parfois (notamment devant la jalousie exacerbée d’une mère trop possessive) – rapports tourmentés de deux êtres à qui il arrive de vivre des « drames de la passion », successions de scènes violentes et de réconciliations.
Plusieurs années après la disparition de Jacques Chauviré, c’est un plaisir toujours neuf de retrouver la prose à la fois limpide et poétique d’un écrivain qui sait comme personne chanter les paysages humides des bords de Saône, les saisons brumeuses et les arbres penchés des campagnes lyonnaises, mais aussi les rues et les couloirs sombres de la ville et de ses maisons. D’un écrivain qui sait comme personne évoquer l’espoir et l’apaisement de l’âme au contact de la nature, sans toutefois hésiter à écrire sans vergogne, par exemple : « La mort de grand-mère, en plein juillet, me fut une fête ». Les bienfaits et les scandales de la vie, tout uniment, et les doutes qui en résultent. « Ma mère, toi seule me relie à l’au-delà. C’est dans l’espoir de te retrouver que vacille une faible lueur. Tout, sans toi, me porte au doute. ».
Jean-Pierre Longre
Pour retrouver Jacques Chauviré:
Jacques Chauviré, quelques livres.pdf
et ici
17:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, jacques chauviré, le temps qu’il fait, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2014
Les reliefs de la mémoire
 Yves Wellens, Vert bouteille, Ker éditions, 2014
Yves Wellens, Vert bouteille, Ker éditions, 2014
« Chaque personne est singulière, et c’est bien ainsi. Et son histoire. Et sa mémoire ; et son expression pour la dire. ». Yves Wellens, dans sa postface, ajoute plus ou moins explicitement que l’autobiographie à laquelle il s’est livré dans ce livre, loin d’être un récit gratuit et narcissique, a pour finalité d’explorer la genèse de l’œuvre littéraire – de dire « contre quoi elle devait être construite », après qu’il eut quitté le « vert paradis de l’enfance » (démarquage ironique du « vert bouteille » cher au père).
Cela dit, Vert bouteille est aussi, en soi, une construction qui fonde son esthétique sur ce que Michel Leiris appelait l’authenticité, celle qui commande une narration épousant le rythme du souvenir, les saillies de la mémoire. C’est par touches éparses, par taches mises en relief sur le blanc de la page que l’écrivain raconte la partie de son enfance qui, dans les années 1960 à Bruxelles, a semble-t-il le plus influé sur sa vie et sur son écriture à venir. L’isolement, les malheurs familiaux, les lectures, le cinéma, les violences, la confrontation à l’alcoolisme, à la séparation, à la mort – parfois souvenirs de souvenirs (à propos des grands-parents). Périodiquement, sous l’artifice typographique des caractères italiques, apparaissent des évocations moins personnelles, ou à la fois personnelles et collectives : actualités, livres, émissions télévisées, sport, événements de mai 68 – rien que du tangible, comme des témoins de la vérité.
Cette vérité, c’est bien celle de la « personne singulière » qui raconte et qui se met en scène au milieu des autres (la liste des personnages qui ouvre le livre et les dessins de Noam Van Cutsem donnent un espace quasiment théâtral à la narration). Et la singularité, comment la rendre à la fois dans sa subjectivité et avec le détachement nécessaire à la relation objective ? Par la distorsion grammaticale : première et troisième personnes confondues, « Lui, c’est Je ». Ici, « Je » n’est pas un autre, mais le même qui se raconte en tant que moi et que lui, sujet et objet du récit, observé et observateur, et c’est en cela que la constante et scrupuleuse fidélité à la mémoire construit par tableaux successifs et autonomes l’œuvre littéraire.
Voilà l’un des fondements de l’écriture à venir : dès Le cas de figure, elle se manifeste par une quête qui, sous des allures objectives et lacunaires, procède à l’exploration personnelle de l’humain. On peut ainsi constater que la première œuvre de « Je » est une rédaction scolaire dans laquelle « l’événement important, qui était le thème de l’exercice, n’était ici en réalité jamais vraiment exposé ». Et lorsque le professeur, séduit par ce texte, le lisait devant la classe, « Je gardait la tête baissée » ; l’image est parlante, qui n’occulte pas complètement (et même pas du tout) la tête levée de l’artiste vers la réalité, une réalité que, comme son passé, l’on ne pourra jamais connaître complètement.
Jean-Pierre Longre
06:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, yves wellens, noam van cutsem, ker éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/09/2013
La souffrance et l’espoir
 Judith Martin, Chauve, La Taillanderie / Léandre, 2013
Judith Martin, Chauve, La Taillanderie / Léandre, 2013
Judith Martin, originaire de Cluj, en Roumanie, a publié aux éditions Noir sur Blanc deux livres dont l’élaboration littéraire n’occulte pas la sensibilité (au contraire), et dont les protagonistes sont le père (Pli urgent, 2001) et la mère (Elle va parler, 2005). Avec Chauve, que son mari a mis tout son soin et toute son énergie à faire éditer, c’est le « Je » qui est au centre du récit, un « Je » dont l’espérance, qui donne sa « violence » aux dernières lignes (et au dernier chapitre, intitulé « L’Espoir »), n’a pu enrayer la force destructrice du cancer.
Le titre se réfère clairement à la chute des cheveux, symbole central de la maladie, de la souffrance et de la perte de soi : « Je devrais me dire que les cheveux ne sont qu’une parure extérieure à mon être. Non ! cela fait partie de moi-même. Leur perte constitue une blessure narcissique ! ». Ainsi, plusieurs épisodes tournent autour de cette préoccupation lancinante : la coiffure, la chevelure, la perruque, le chapeau – comme s’il y allait de la santé perdue ou retrouvée.
La santé, la douleur, le cancer… On aurait pu s’attendre à un récit morbide, mortifère, désespérant. Il n’en est rien. Comme le dit René Martin dans la préface, l’écriture permet à l’auteure de se prémunir, de « tenir [la maladie] à distance », de s’éloigner des « turpitudes du traitement et de l’angoisse du mal ». Il y a le travail narratif et descriptif, l’émotion des souvenirs, de l’affection, de l’amitié, de l’amour, il y a l’humour même, qui traverse et écorne sans vergogne la souffrance morale et physique, et la poésie : celle qui résulte du choix des mots, des phrases, celle qui émane des images évoquées, celle qui emplit la mémoire de la narratrice et les pages du livre : les comptines de l’enfance en Transylvanie, les vers d’Ana Blandiana, de Mihai Eminescu ou d’Attila József, ceux de Judith Martin elle-même, dont le fameux « Racines », qui évoque sa triple origine (roumaine, hongroise, juive) et sa foi en l’Europe – et qui clôt avec bonheur ce beau livre émouvant et courageux.
Jean-Pierre Longre
16:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, poésie, francophone, judith martin, éditions la taillanderie léandre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/07/2013
Une vie d’écriture
 Benjamin Fondane, Poèmes retrouvés 1925-1944, « Édition sans fin » établie et présentée par Monique Jutrin, Parole et silence, 2013
Benjamin Fondane, Poèmes retrouvés 1925-1944, « Édition sans fin » établie et présentée par Monique Jutrin, Parole et silence, 2013
Benjamin Fondane, Comment je suis né, textes de jeunesses traduits du roumain par Marlena Braester, Hélène Lenz, Carmen Oszi, Odile Serre, présentés par Monique Jutrin, Caractères, « Cahiers latins », 2013
Le premier trimestre 2013, si riche en publications franco-roumaines, richesse à laquelle le Salon du Livre de Paris ne fut pas étranger, a vu paraître coup sur coup deux ouvrages réunissant des textes de Benjamin Fondane présentés par Monique Jutrin, qui connaît parfaitement l’écrivain et son œuvre.
Le premier, Poèmes retrouvés 1925-1944, porte le beau sous-titre que l’auteur avait donné à sa deuxième version d’Ulysse, « Édition sans fin », qui « pourrait convenir à l’œuvre tout entière ». Pour ce volume, Monique Jutrin a opéré un choix à la fois draconien et significatif parmi les nombreux manuscrits que la sœur de Fondane lui confia un beau jour de 1996. Composés entre 1925 et 1944, ces poèmes en français sont « une prise authentique sur le réel », ce réel dont font partie les brouillons, corrections, repentirs et reprises dont l’œuvre finale est le résultat. Ainsi nous sont livrés un certain nombre des « premiers poèmes en français », de même que des textes « en marge » des grands recueils, Titanic, L’Exode, Ulysse, Le Mal des Fantômes. Le tout, augmenté de « poèmes épars » et des « vestiges d’un recueil abandonné », donne une belle idée du travail d’écriture d’un homme dont la poésie, pour primordiale qu’elle fût, n’était que l’une des nombreuses activités intellectuelles et artistiques.
 Le second, Comment je suis né, réunit des textes de jeunesse traduits par Marlena Braester, Hélène Lenz, Carmen Oszi, Odile Serre. Comme le rappelle Monique Jutrin, Benjamin Weschler, devenu B. Fundoianu puis Benjamin Fondane, fut un écrivain particulièrement précoce, puisqu’il commença à publier dès 1912, à l’âge de 14 ans. Pas étonnant, donc, qu’il ait fallu faire le tri « parmi la centaine de textes publiés et de manuscrits inédits datant des années 1912-1922 ». Répartis en trois sections (« Textes autobiographiques », « Lectures », « Poèmes en prose »), ces écrits d’adolescence et de jeunesse sont déjà, ou presque, des productions d’écrivain adulte, faisant montre d’un recul étonnant par rapport à son activité (« J’écris des mémoires. Je tiens probablement à contredire Faguet, qui pense que seuls les vieux écrivent des mémoires. »), voire d’un humour d’homme déjà mûr (« Hertza est une petite bourgade de 3.000 habitants, comptant 4.000 tavernes, un maire, 20 kiosques, deux sergents de police, et d’innombrables voleurs. »). En même temps, c’est d’un sens certain de ce qu’est la littérature, d’une culture à toute épreuve, d’un esprit critique sans concessions que fait preuve le jeune homme, qui fréquente assidûment et intimement l’œuvre d’écrivains français de son époque, ainsi que les « livres anciens », et qui n’hésite pas à écrire par exemple : « Personne ne lit plus, personne ne se livre plus au plaisir ni à la souffrance ; personne ne se tourmente plus pour faire jaillir de lui une passion plus pure – et cependant l’admiration pour les grands artistes se perpétue avec une ardeur éloquente – et pieuse. ».
Le second, Comment je suis né, réunit des textes de jeunesse traduits par Marlena Braester, Hélène Lenz, Carmen Oszi, Odile Serre. Comme le rappelle Monique Jutrin, Benjamin Weschler, devenu B. Fundoianu puis Benjamin Fondane, fut un écrivain particulièrement précoce, puisqu’il commença à publier dès 1912, à l’âge de 14 ans. Pas étonnant, donc, qu’il ait fallu faire le tri « parmi la centaine de textes publiés et de manuscrits inédits datant des années 1912-1922 ». Répartis en trois sections (« Textes autobiographiques », « Lectures », « Poèmes en prose »), ces écrits d’adolescence et de jeunesse sont déjà, ou presque, des productions d’écrivain adulte, faisant montre d’un recul étonnant par rapport à son activité (« J’écris des mémoires. Je tiens probablement à contredire Faguet, qui pense que seuls les vieux écrivent des mémoires. »), voire d’un humour d’homme déjà mûr (« Hertza est une petite bourgade de 3.000 habitants, comptant 4.000 tavernes, un maire, 20 kiosques, deux sergents de police, et d’innombrables voleurs. »). En même temps, c’est d’un sens certain de ce qu’est la littérature, d’une culture à toute épreuve, d’un esprit critique sans concessions que fait preuve le jeune homme, qui fréquente assidûment et intimement l’œuvre d’écrivains français de son époque, ainsi que les « livres anciens », et qui n’hésite pas à écrire par exemple : « Personne ne lit plus, personne ne se livre plus au plaisir ni à la souffrance ; personne ne se tourmente plus pour faire jaillir de lui une passion plus pure – et cependant l’admiration pour les grands artistes se perpétue avec une ardeur éloquente – et pieuse. ».
Ces deux publications sont plus que des compléments aux livres de Benjamin Fondane ; elles sont des pièces à part entière de l’œuvre à la fois abondante et diverse d’un jeune Juif roumain qui, devenu écrivain français par conviction et vocation, a tant apporté à sa culture d’adoption.
Jean-Pierre Longre
16:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, autobiographie, essai, francophone, roumanie, benjamin fondane, monique jutrin, marlena braester, hélène lenz, carmen oszi, odile serre, parole et silence, caractères, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/06/2013
Une passion française
 Eun-Ja Kang, L’étrangère, Le Seuil, 2013
Eun-Ja Kang, L’étrangère, Le Seuil, 2013
« Le français a une âme […]. Je saisis ce qui vient de se produire : le français est entré dans ma chair et dans mon âme, tandis que l’anglais est resté sur ma peau. […] Je trouverai dans sa profondeur ce que je cherche. Ce que tu cherches ? Qu’est-ce que tu cherches ? Je ne sais pas. En tout cas, je sens que c’est dans le français que je le trouverai ». Ces considérations quasiment sensuelles n’émanent pas d’un éminent linguiste, ni même d’un étudiant avancé, mais d’une petite lycéenne née au fond de la campagne coréenne dans une famille pauvre, et dont la mère est analphabète… Tombée « amoureuse » du Petit Prince, elle va se prendre d’une passion inextinguible pour la langue de Saint-Exupéry, et pour cela va franchir tous les obstacles qui se dressent devant elle.
Car la société coréenne n’est pas tendre, c’est le moins que l’on puisse dire. À chaque étape de sa scolarité, Eun-Ja doit être la première de sa promotion pour obtenir ou conserver la bourse qui lui permet d’accéder au niveau supérieur. Elle raconte ainsi son enfance, avec ses malheurs et ses bonheurs, ses tristesses et ses joies, le dénuement et le labeur, la solidarité familiale, les relations avec ses camarades, les longs trajets à pied vers l’école, les espoirs et les déceptions, les peurs et les rires, les succès scolaires et la fierté qu’elle en ressent, le départ pour Séoul et l’université, la boulimie intellectuelle qui, comparable et parallèle à l’appétit sexuel, la jette tout entière dans l’étude de la langue qu’elle a choisie, jusqu’à ce que, au prix d’une ténacité sans faille, de décisions draconiennes et de sacrifices financiers (auxquels sa famille n’hésite pas à participer), elle puisse partir pour la France préparer son doctorat et écrire des romans…
Le simple résumé de cet itinéraire est impuissant à dire ce qu’il a d’étonnant, de bouleversant même. Mais l’écriture de l’auteur, qui ne dissimule rien, qui n’use d’aucun artifice, est en elle-même une démonstration probante de son caractère exceptionnel. Comme le fait l’eau d’un fleuve, elle coule, à la fois immuable et mouvante, fluctuante et transparente, inégale et imparable, dans une langue acquise à travers Stendhal et Proust (entre autres), une langue qui laisse sentir le poids de chaque mot, de chaque phrase, une langue dont la sincérité est à la mesure de l’enthousiasme que « l’étrangère » a mis à s’en pénétrer.
Jean-Pierre Longre
11:02 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, corée, eun-ja kang, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/10/2012
« L’excès de l’absence »
 Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Olivier allait avoir six ans lorsqu’il fut tué par un chauffard. Sa mort priva Jérôme, son frère jumeau, d’un autre soi-même, de son double, d’une présence nécessaire. « À chaque anniversaire, le même trouble me saisit : j’ai l’impression que je ne suis pas seul ». Et ce livre, pour la première fois, fait confidence de cet « excès de l’absence » (pour reprendre une formule de L’instant fatal de Queneau), de cette présence en creux qui a modelé ses attitudes face à la vie.
La solitude a donné à l’enfant, à l’adolescent, à l’adulte le goût de l’isolement, du grand air, des randonnées équestres dans la campagne ; les secrets enfouis de la gémellité perdue lui ont donné le goût du silence, de la pudeur muette et nouée. De là, la nécessité d’écrire : « Parmi tout ce que tu m’as appris, il y a d’abord ceci : on écrit pour exprimer ce dont on ne peut pas parler, pour libérer tout ce qui, en nous, était empêché, claquemuré, prisonnier d’une invisible geôle ». L’environnement familial et les choix délibérés aidant, la moitié vide de son existence a vite aspiré Jérôme vers les livres, toutes sortes de livres, parmi lesquels émergent ceux qui relatent l’« expérience du deuil ». Vers les livres à lire, vers les livres à commenter, vers les livres à écrire.
 Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Jean-Pierre Longre
22:37 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, jérôme garcin, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/06/2011
Les parenthèses de l’existence
Alain Gerber, Longueur du temps, Alter ego éditions, 2011 
Alain Gerber et la musique, c’est tout un roman ; une somme de romans. Et malgré les apparences, Longueur du temps ne déroge pas : comme dans les livres précédents, il y a la matière biographique, la narration menée sur fond d’images fortes, l’invention verbale, les thématiques musicales (avec les silhouettes de fameux jazzmen passant à l’arrière-plan, parfois même jusque sur le devant de la scène), l’évocation de pays lointains et de rues toutes proches, Bavilliers et Ouagadougou, Paris et Montréal, Belfort et Corfou, le beau pays d’« Enfrance » et le légendaire Mexique – odyssées dans l’espace et dans le temps.
À part cela, il faut bien distinguer : la matière biographique est tout ce qu’il y a de personnel, même si, mettant à contribution le couple et l’univers environnant, elle ne doit rien à l’égotisme ; et la narration est versifiée – comme Chêne et chien, « roman en vers » dans lequel Raymond Queneau se raconte sans fards. La comparaison n’est pas hasardeuse : chez l’un comme chez l’autre les vers sont la composante nécessaire de la forme romanesque ; ils lui donnent sa ponctuation, son rythme, ses mesures, ses syncopes… Syntagmes sonores, phrases coupées, listes, inventaires, mots martelés, l’écriture au plus fondamental de sa composition est musicale, à la recherche de
« la formule cinglante / le sésame /qui lève l’écrou et brise les scellés / du Temps »,
le temps, incessant leitmotiv, qui donne leur « tempo » aux souvenirs.
Si la musique est partout, n’oublions pas que tout passe par la littérature. Ce sont les mots, combinés entre eux, qui tentent de lever les voiles de la mémoire, « ce lac sourd plein de rumeurs », et de « l’imaginaire incarné ». Et, comme celles des jazzmen, on voit passer tout près les silhouettes des romans de jadis, La couleur orange, Le plaisir des sens, Le faubourg des coups-de-trique, Une sorte de bleu…
Plutôt que de gloser, le commentateur ne rêve que de céder la place au soliste, pour quelques chorus bien sentis :
« Il est faux que l’on naisse mortel / on le devient seulement après quelques années ».
« Il y aura dès lors / un temps pour écrire / un temps pour voir le monde / comme si c’était un roman / qu’on lit en se déchiffrant soi-même ».
« Sur son propre compte / l’existence nous en dit plus dans ses parenthèses / et notes anodines au bas de la page / que dans les périodes les tropes / sourates sorites et tapageurs épichérèmes /qu’elle nous jette au visage ».
« Le but ultime des voyages est / qu’en passant / la vie va vous frôler / au lieu de vous passer à travers ».
Le reste à l’avenant, au rythme des mots, de la lecture et de la vie.
Jean-Pierre Longre
13:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, poésie, musique, francophone, alain gerber, alter ego éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

