13/03/2020
Des airs qui pleurent, des airs qui rient
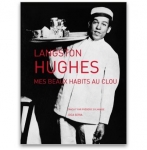 Langston Hughes, Mes beaux habits au clou, traduction de l’anglais (États-Unis) et postface de Frédéric Sylvanise, éditions Joca Seria, 2019
Langston Hughes, Mes beaux habits au clou, traduction de l’anglais (États-Unis) et postface de Frédéric Sylvanise, éditions Joca Seria, 2019
Le blues n’est pas seulement une musique. Du moins, sa musique peut être celle des mots, et Langston Hughes l’a prouvé, en suivant les règles strictes du genre : répétition des premiers vers, vers impairs avec rimes, langue populaire mais utilisée avec respect… Comme l’écrit Frédéric Sylvanise dans sa postface : « Le blues vient de la rue, mais il ne faudrait pas lui ôter toute dignité. […] Même dans le malheur, le bluesman cherche lui aussi à s’élever ».
Si le blues en tant que genre et en tant qu’état d’esprit est dominant dans ce recueil, il n’en est qu’un aspect. D’autres formes poétiques s’y épanouissent, avec des textes à la musicalité tout aussi suggestive, aux rythmes et aux sonorités tout aussi prégnants, aux thèmes tout aussi populaires. La misère sociale, le racisme et ses conséquences, le malheur et la mort, l’alcool et la méchanceté, les plaintes en forme de prières, les anecdotes domestiques, la nostalgie et les rêves inaccomplis, et bien sûr les sentiments humains – l’amitié et surtout l’amour, le plus souvent malheureux, mais donnant çà et là l’occasion d’une allusion au bonheur et à l’érotisme souriant d’une fille « trop jolie »… Chants de fidélité et de souffrance à la fois :
« Quand un type aime vraiment sa femme
I’ la quitte pas en plein hiver.
I’ m’a dit qu’i’m’aimait.
Mais il a sûrement menti.
I’ m’a dit qu’i’m’aimait.
Il a sûrement menti.
Mais c’est l’seul homme que j’aimerai
Jusqu’à la fin d’ma vie. »
Poésie du peuple, Mes beaux habits au clou (le titre annonce la dominante) est un recueil d’une grande beauté, où le désespoir et l’espoir se côtoient comme naturellement, où les pleurs et les rires se mêlent sans vergogne, où la brutalité n’empêche pas la plus grande douceur de s’exprimer, où l’idée de la mort fait partie de la vie.
« J’attends ma maman,
C’est la Mort.
Dis-le tout doux,
Dis-le tout doux si tu veux bien.
« J’attends ma maman,
La Mort. ».
Jean-Pierre Longre
16:07 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, États-unis, langston hughes, frédéric sylvanise, éditions joca seria, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/12/2019
Tableaux poétiques
 Paul Stubbs, Visions de l’outre-monde, recueil bilingue, traduction de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, éditions hochroth Paris, 2019
Paul Stubbs, Visions de l’outre-monde, recueil bilingue, traduction de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, éditions hochroth Paris, 2019
Inspirés par des tableaux de Francis Bacon, les textes ici traduits sont extraits de The End of the Trial of Man (Arc, 2015), inédit en français (Ceux de l’outre-monde).
Paul Stubbs, poète et éditeur britannique, est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes et d’essais poétiques.
Extrait :
– Aussi, quel est au juste ce lieu
où je suis détenu ? une sacristie
secrète et souterraine
du Vatican ?
une cage de paille dans un zoo ? ou simplement
quelque laboratoire ?
10:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, paul stubbs, blandine longre, éditions hochroth paris | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2019
L’ardeur et la sensibilité
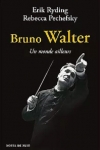 Erik Ryding, Rebecca Pechefsky, Bruno Walter. Un monde ailleurs, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Notes de nuit, 2019.
Erik Ryding, Rebecca Pechefsky, Bruno Walter. Un monde ailleurs, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Notes de nuit, 2019.
« Selon Walter, la propriété essentielle de la musique était sa capacité à tirer hommes et femmes hors de leur vie quotidienne et à les transporter vers un niveau supérieur d’existence. Tout en accomplissant sa mission première, celle d’exister en tant qu’art pur, la musique faisait aussi du monde un endroit meilleur. ». Ou « un monde ailleurs », selon le sous-titre du livre, emprunté à Shakespeare. Un livre qui, s’il est bien une biographie détaillée du fameux chef d’orchestre, se tisse autour du fil conducteur de « la force morale » de la musique et du « message d’espoir » qu’elle porte.
Une biographie détaillée, donc ; c’est le moins que l’on puisse dire. La vie et la carrière de Bruno Walter (1876-1962) sont décrites en détail, « presque jour par jour », jusqu’à la fin. Soutenu par une documentation fournie (comme les notes abondantes l’attestent), faite de références précises, de nombreuses lettres citées en tout ou en partie, d’articles de presse, de textes critiques, l’ouvrage d’Erik Ryding et Rebecca Pechefsky est une mine de renseignements. Nous y suivons l’apprentissage de l’enfant qui pensait avoir un avenir de pianiste, tant il faisait preuve de dons et d’originalité, avant de vouloir se consacrer à la direction d’orchestre en découvrant le chef Hans von Bülow et la musique de Wagner ; puis sa rencontre avec Mahler fut décisive, marquant « le début d’une amitié et d’une collaboration artistiques étroites », et lui valant son premier poste officiel de chef d’orchestre à Breslau (ce qui l’obligea de changer son nom de Bruno Schlesinger en Bruno Walter).
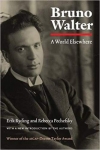 C’est ensuite une longue succession de prestations brillantes souvent accueillies avec succès, de tournées internationales, de nominations à des postes de plus en plus prestigieux, de bonheurs et de malheurs personnels, le tout dans différents pays. La montée du nazisme en Allemagne obligea Bruno Walter et sa famille à s’exiler, d’abord en Autriche, ensuite en France, enfin aux États-Unis – ce qui fait que né allemand, il prit les nationalités française et américaine. On ne détaillera pas ici les péripéties d’une vie particulièrement remplie, celle d’un musicien complet (chef d’orchestre, mais aussi pianiste, compositeur, directeur de chœur, conseiller musical) qui s’intéressait en outre à la littérature et à l’écriture (qu’il pratiquait), qui traversa une période historique particulièrement troublée et violente, lui-même victime de l’antisémitisme et des manœuvres angoissantes du pouvoir hitlérien.
C’est ensuite une longue succession de prestations brillantes souvent accueillies avec succès, de tournées internationales, de nominations à des postes de plus en plus prestigieux, de bonheurs et de malheurs personnels, le tout dans différents pays. La montée du nazisme en Allemagne obligea Bruno Walter et sa famille à s’exiler, d’abord en Autriche, ensuite en France, enfin aux États-Unis – ce qui fait que né allemand, il prit les nationalités française et américaine. On ne détaillera pas ici les péripéties d’une vie particulièrement remplie, celle d’un musicien complet (chef d’orchestre, mais aussi pianiste, compositeur, directeur de chœur, conseiller musical) qui s’intéressait en outre à la littérature et à l’écriture (qu’il pratiquait), qui traversa une période historique particulièrement troublée et violente, lui-même victime de l’antisémitisme et des manœuvres angoissantes du pouvoir hitlérien.
Au fil des pages, les auteurs nous renseignent sur les faits relatés d’une manière scrupuleuse, mais aussi sur les goûts musicaux de Bruno Walter, dont la nature le portait plutôt vers le XIXème siècle et le tournant du XXème (Beethoven, les Romantiques, Schubert, Brahms, Bruckner, Wagner, Mahler bien sûr, Richard Strauss, Enesco…), mais aussi vers la musique nouvelle (Schoenberg, Chostakovitch), sans négliger Mozart, dont il dirigea entre autres le Requiem et de nombreux opéras, ni Bach, dont il considérait l’œuvre comme « un pilier de notre culture ». Pour faire bref, il faudrait plutôt recenser les compositeurs qui n’ont pas figuré à son répertoire.
Nous faisons aussi connaissance avec le tempérament d’un chef aux idées généreuses, ouvertes et avancées (par exemple sur la mixité dans les orchestres), un chef qui dirigeait non en « despote », mais en communiquant à l’orchestre une ardeur et une sensibilité fondées sur la liberté et la persuasion, à en croire notamment le critique Adolf Aber : « Il n’a pas à imposer ses pensées à l’orchestre à chaque noire et à chaque croche ; il s’autorise même à se laisser porter un instant par les vagues puis, le point culminant approchant, il reprend la barre avec une plus grande fermeté encore et tire le maximum de ses musiciens. Une telle interprétation exige de l’orchestre une joie prodigieusement mûrie à jouer de la musique et qui lui soit propre, une ardeur qui lui soit tout aussi propre. », ou encore Olin Downes : « Quand une phrase musicale est réellement ressentie par le chef d’orchestre, et quand les musiciens la ressentent avec lui, l’orchestre respire, et cette respiration rythmique naturelle, profonde, des instruments est l’une des qualités inaliénables d’une bonne interprétation. ». La souplesse et la sensibilité de Bruno Walter dans l’exercice de son métier ne sont pas sans rapport avec sa spiritualité ; si selon lui la musique doit apporter à l’humanité « un message d’espoir », elle ne doit toutefois pas être « descriptive », mais dans sa pureté conserver un « pouvoir émotionnel […] illimité. ». Cette spiritualité le fit d’ailleurs adhérer, à partir des années 1950, aux théories de l’anthroposophie développées par Rudolf Steiner ; insistant sur « l’importance spirituelle de la musique et les dangers du matérialisme », il fut attiré par le domaine de la « thérapie musicale, une discipline alors en développement et qui recoupait l’un de ses centres d’intérêt, l’anthroposophie, et ses écrits plus anciens sur les forces morales de la musique. ».
Le livre d’Erik Ryding et Rebecca Pechefsky est, disions-nous, une mine. Les nombreux enregistrements que Walter a laissés (répertoriés dans les « discographies recommandées » en fin de volume) et la filmographie établie par Charles Barber complètent parfaitement ce qui est, en soi, une somme biographique et musicale montrant que Bruno Walter fut non seulement l’un des plus grands chefs du XXème siècle, mais aussi une personnalité hors du commun, ouvrant le chemin d’« un monde ailleurs ».
Jean-Pierre Longre
20:44 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, anglophone, bruno walter, eryk ryding, rebecca pechefsky, blandine longre, notes de nuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/09/2019
Deux cent quarante nuances de bleu
 Maggie Nelson, Bleuets, traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy, Éditions du sous-sol, 2019
Maggie Nelson, Bleuets, traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy, Éditions du sous-sol, 2019
« Pourquoi le bleu ? Les gens me posent souvent cette question. Je ne sais jamais comment y répondre. Il ne nous est pas donné de choisir qui l’on aime, ai-je envie de dire. Nous n’avons pas le choix, voilà tout. ». Car oui, Maggie Nelson l’avoue d’emblée, elle est « tombée amoureuse d’une couleur » – le bleu, donc. Et voilà que, sous sa plume, naissent des anecdotes, des citations, des adresses à un amant absent, des citations, des fragments poétiques, maintes pensées qui, à l’instar de celles de Pascal, se posent sur la page sans suite apparente, mais dont le double fil conducteur est bien composé du couple formé par le bleu et l’amour.
Certes, il n’en est pas toujours question ; les propos peuvent porter sur la maladie, la dépression, la mort, le sexe, l’absence, l’art, la peinture, la littérature, les phénomènes linguistiques, et sur le regard, celui qui perçoit le monde et en tire des impressions inattendues – comme celles de cet homme qui, ayant recouvré la vue à la suite d’une opération, ne cacha pas sa déception : « Il trouvait le monde terne, les écailles de peinture et autres imperfections le contrariaient ; il aimait les couleurs vives et les voir perdre de leur éclat le déprimait. » ; finalement, « il mourut de tristesse ». Mais immédiatement après, l’auteure écrit tout de même que « ça vaut la peine de garder les yeux ouverts. ».
Les paradoxes de ce genre sont fréquents dans l’ouvrage. Voyons entre autres l’évocation de la « petite fleur bleue » que le héros du roman de Novalis Henri d’Ofterdingen passe sa vie à chercher : c’est sa grande aventure, son grand espoir. Or les fleurs bleues, nous dit encore Maggie Nelson, sont peut-être « un bouquet de mensonges éhontés » (perspective à prendre en compte, par exemple, dans le roman de Queneau Les fleurs bleues…).
Livre scintillant de ses 240 facettes, livre en couleurs, livre d’amour (perdu ? retrouvé ?), Bleuets a toutes les caractéristiques de l’œuvre d’art, au plein sens du terme. Une œuvre d’art qui se contemple en surface et en profondeur, en long et en large, et dans laquelle le regard et l’esprit n’en finissent pas de trouver, avec méthode ou au hasard, en allers et en retours, de nouvelles lumières.
Jean-Pierre Longre
23:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, anglophone, maggie nelson, céline leroy, Éditions du sous-sol, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/08/2019
Les amours et les livres
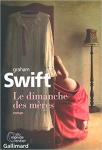 Graham Swift, Le dimanche des mères, traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek, Gallimard, 2017, Folio, 2019
Graham Swift, Le dimanche des mères, traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek, Gallimard, 2017, Folio, 2019
Jane et Paul sont amants. Amants cachés, car elle est une petite servante, et lui un jeune aristocrate destiné à épouser Emma, de même classe sociale que lui. Jane et Paul « avaient fait des tas de choses ensemble, dans des tas de lieux secrets. ». Mais ce 30 mars 1924, leurs ébats sont exceptionnels : c’est le « dimanche des mères », jour de l’année où les domestiques sont en congé pour la journée. Jane n’ayant pas de mère à voir, puisqu’elle a été abandonnée toute petite, les deux jeunes gens ont une matinée entière pour se voir, sans doute pour la dernière fois : Paul doit se marier deux semaines après. Elle le sait, et tous deux vont en profiter le plus intensément possible. Après quoi Paul va partir retrouver sa fiancée, laissant Jane seule dans la grande demeure familiale, qu’elle va explorer minutieusement dans le plus simple appareil, comme pour y laisser la trace indélébile de son corps.
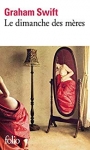 Des événements imprévus et dramatiques vont marquer ce dimanche, discrètement annoncés au détour de certaines phrases. Le destin de Jane, devenue naturellement servante après avoir été élevée à l’orphelinat, et qui a découvert les livres dans la bibliothèque de ses maîtres, va changer à partir de là. La lecture des grands auteurs (Joseph Conrad en particulier) et l’écriture littéraire vont être son avenir, jusqu’à un âge avancé. « Née en 1901 – l’année, au moins, devait être exacte –, elle grandirait pour devenir domestique, ce que le premier venu aurait pu prédire. Mais qu’elle devînt écrivain, cela, personne ne l’aurait prédit. Y compris les membres bienveillants de la direction de l’orphelinat qui l’avaient fait naître un premier mai sous le nom de Jane Fairchild. Et sa mère encore moins que quiconque. ».
Des événements imprévus et dramatiques vont marquer ce dimanche, discrètement annoncés au détour de certaines phrases. Le destin de Jane, devenue naturellement servante après avoir été élevée à l’orphelinat, et qui a découvert les livres dans la bibliothèque de ses maîtres, va changer à partir de là. La lecture des grands auteurs (Joseph Conrad en particulier) et l’écriture littéraire vont être son avenir, jusqu’à un âge avancé. « Née en 1901 – l’année, au moins, devait être exacte –, elle grandirait pour devenir domestique, ce que le premier venu aurait pu prédire. Mais qu’elle devînt écrivain, cela, personne ne l’aurait prédit. Y compris les membres bienveillants de la direction de l’orphelinat qui l’avaient fait naître un premier mai sous le nom de Jane Fairchild. Et sa mère encore moins que quiconque. ».
Graham Swift a l’art de décrire des événements apparemment simples en allant au fond des choses, en posant les questions justes et en esquissant des réponses laissées à la réflexion des lecteurs : sur l’amour, la mort, la société, la littérature, sur les rapports entre réalité et fiction… Et Le dimanche des mères est certes un roman, mais un roman qui, comme dans le théâtre classique, obéit à la règle des trois unités : unités de temps (un seul jour), de lieu (entre deux maisons de maîtres, Beechwood et Upleigh), d’action (le basculement du destin de Jane). Surtout, cette journée unique dans la vie de la petite servante lui a fait franchir des barrières et lui a ouvert un bel avenir.
Jean-Pierre Longre
23:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, graham swift, marie-odile fortier-masek, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/05/2019
Francis Bacon et Matthias Grünewald, souffrance et transformation.
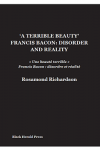 Rosamond Richardson, « A terrible beauty ». Francis Bacon : discorder and reality / « Une beauté terrible ». Francis Bacon : désordre et réalité. Ouvrage bilingue, traduit de l’anglais par Blandine Longre. Postfaces de Paul Stubbs et Will Stone. Black Herald Press, 2019.
Rosamond Richardson, « A terrible beauty ». Francis Bacon : discorder and reality / « Une beauté terrible ». Francis Bacon : désordre et réalité. Ouvrage bilingue, traduit de l’anglais par Blandine Longre. Postfaces de Paul Stubbs et Will Stone. Black Herald Press, 2019.
Rosamond Richardson (1945-2017), écrivaine éclectique, spécialiste entre autres de Dante et de T. S. Eliot, établit ici un rapport circonstancié entre les tableaux de Francis Bacon (1909-1992) et le retable d’Issenheim, de Matthias Grünewald (1475-1528), « œuvre hyperréaliste » dont Bacon, bien qu’athée, reconnut d’emblée « la grandeur ». Pour lui, écrit Rosamond Richardson, la chair souffrante est inextricablement liée à l’expérience de la vie même. « L’horreur de la crucifixion de Grünewald nous contraint à ressentir ce qu’être crucifié peut représenter, tout comme les toiles de Bacon nous contraignent à éprouver la noirceur et la violence de la condition humaine. Deux expériences également choquantes. ». La violence en question est toutefois source de transformation, et celle que Bacon décèle dans le retable et pratique dans ses œuvres peut être considérée comme une quête d’ordre religieux – et l’on sait combien le crucifix fut pour le peintre une image importante. Rosamond Richardson conclut son essai en imaginant « l’artiste vieillissant » voyant « des images de l’homme vaincu, mais aussi, dans les figures aux épouvantables difformités, la vision d’un esprit qui affronte et défie les Furies. ».

Un essai principal et deux textes qui le complètent et se complètent entre eux : ce volume dense en forme de triptyque offre plusieurs pistes de réflexion : sur Francis Bacon et son cheminement artistique, sur le retable d’Issenheim et l’œuvre de Matthias Grünewald, et, surtout, sur la pensée de Rosamond Richardson, dans des perspectives essentiellement esthétiques et spirituelles.
Jean-Pierre Longre
09:25 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, anglophone, art, francis bacon, rosamund richardson, blandine longre, paul stubbs, will stone, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/01/2019
Obscurs et fabuleux
 Richard Ford, Entre eux, traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun, Éditions de l’Olivier, 2017, Points, 2018
Richard Ford, Entre eux, traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun, Éditions de l’Olivier, 2017, Points, 2018
Les vies respectives et communes de Parker Ford et d’Edna Akin, mariés en 1928, n’eurent rien d’extraordinaire. Lui voyageur de commerce, elle l’accompagnant sur les routes du sud des États-Unis avant la naissance tardive (1944) de Richard, ils ont mené une existence sans histoires exceptionnelles jusqu’à la mort prématurée de Parker, qui a laissé un vrai vide – même si, du fait de son métier, il était absent à longueur de semaine, ne rejoignant sa femme et son fils que le vendredi soir. Pour l’enfant en tout cas, la vie familiale n’était pas source de problèmes majeurs. « Ai-je jamais senti le moindre malaise entre eux ? Non. Ma nature d’enfant me donnait à penser qu’en gros, tout allait bien. Néanmoins si le scénario de la vie tend toujours à lisser le quotidien, alors notre vie s’en démarquait. […] Ils m’aimaient, ils me protégeaient, mais dans ma vie tout bougeait, les événements, les objets, les êtres ; j’étais seul les trois quarts du temps, sur la touche. Ce qui ne me dérangeait pas, et ne me dérange pas davantage aujourd’hui. Mais dire que la vie était calme, non. ». Mieux, l’absence paternelle a peut-être permis à Richard de se « rêver une vie privée », et finalement d’être devenu écrivain ; et pourtant le regret est constant chez lui de n’avoir pas pu parler à son père « en adulte ».
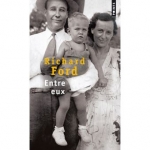 La construction du livre est claire : une moitié pour le père, une moitié pour la mère, qui a vécu bien plus longtemps que son mari, d’où les rapports privilégiés entretenus avec son fils. « A-t-on jamais une “relation” avec sa mère ? Je crois que non. Nous, ma mère et moi, n’avons jamais été unis par un lien classique, que ce lien repose sur le devoir, le regret, la culpabilité, la gêne ou la courtoisie. L’amour, qui n’est jamais classique, nous mettait à l’abri de tout. Nous pensions qu’il était solide et il l’était. ».
La construction du livre est claire : une moitié pour le père, une moitié pour la mère, qui a vécu bien plus longtemps que son mari, d’où les rapports privilégiés entretenus avec son fils. « A-t-on jamais une “relation” avec sa mère ? Je crois que non. Nous, ma mère et moi, n’avons jamais été unis par un lien classique, que ce lien repose sur le devoir, le regret, la culpabilité, la gêne ou la courtoisie. L’amour, qui n’est jamais classique, nous mettait à l’abri de tout. Nous pensions qu’il était solide et il l’était. ».
On s’en aperçoit, il ne s’agit pas seulement dans cette autobiographie d’un récit d’enfance. Il s’agit aussi d’une réflexion sur la vision que les enfants ont de leurs parents et sur la vérité des souvenirs – réflexion qui ponctue régulièrement le récit. « La vie de nos parents nous échappe en partie, pas de leur fait mais du nôtre, et dans ces conditions s’apercevoir qu’on ne sait pas tout est affaire de respect car les enfants rétrécissent le cadre de référence de tout ce à quoi ils appartiennent. Alors qu’être dans l’ignorance de la vie d’autrui, ou la réduire à un objet de spéculations, confère à cette vie une latitude qui rapproche de sa vérité. ». Et pour affirmer, vérifier en quelque sorte l’authenticité des faits et des sentiments ici rapportés, il y a les photographies : portraits, photos du couple avec ou sans le jeune Richard, de la famille (les « beaux-parents » Bennie et Essie), cliché joyeux de Richard avec sa femme, bien plus tard… Nostalgie et documents font bon ménage, ce qui n’exclut pas les nombreuses questions sur la relativité de l’existence et sur les aléas de la destinée.
Entre eux est à la fois questionnement et autobiographie, document et récit ; c’est surtout un bel hommage rendu à deux êtres à la fois ordinaires et singuliers, devenus dignes d’intérêt par la grâce de l’amour et de l’écriture, et un bel hommage à la vie. « Quand on m’interroge sur mon enfance, je réponds toujours qu’elle a été fabuleuse et que mes parents étaient fabuleux. Rien n’a changé sur ce point avec ce livre. Mais ce que j’ai compris en l’écrivant, c’est qu’à l’intérieur de ce cercle “fabuleux”, ce qu’il y avait de plus intime, de plus important, de plus satisfaisant et de plus nécessaire filtrait « entre eux », à l’exclusion de toute autre personne. Et, en particulier, de moi. On aurait tort de croire qu’un fils s’en porte nécessairement plus mal. À bien des égards, le constat est encourageant car il préserve ce mystère optimiste : pour attentif qu’on soit, une large part de ce qui advient nous échappe. ».
Jean-Pierre Longre
19:24 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, anglophone, richard ford, josée kamoun, Éditions de l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2018
Le « qui » et le « pourquoi »
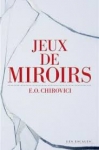 E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018
E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018
« Quelqu’un a dit un jour qu’une histoire n’a en réalité ni début ni fin ; ce ne sont que des moments choisis subjectivement par le narrateur pour aider le lecteur à situer un événement dans le temps. ». Cette phrase, par laquelle débute un chapitre de Jeux de miroirs, est une bonne approche de la stratégie narrative de l’auteur, mais n’en dit pas toute la complexité. Car trois voix se relaient pour composer un récit qui tourne autour du même événement, l’assassinat de Joseph Wieder, professeur à Princeton, « dans la nuit du 21 au 22 décembre 1987. ». Assassinat jamais élucidé, mais qui aura fait couler beaucoup d’encre.
La première de ces trois voix est celle de Richard Flynn, alors étudiant à l’université en question, épris de sa colocataire, Laura Baines, elle-même très proche du professeur Wieder, une jeune femme troublante qui deviendra un personnage pivot. Longtemps après les événements, Richard décide d’écrire un livre relatant ceux-ci, mais meurt après n’avoir remis que la première partie de son manuscrit à un agent littéraire, la suite restant introuvable. L’agent confie donc l’enquête à un journaliste (la deuxième voix), qui va suivre des pistes biaisées et se heurter à des obstacles inattendus et à des contradictions nombreuses. « J’étais perdu dans une sorte de dédale sans fin. Je m’étais lancé sur la piste du manuscrit de Richard Flynn, et non seulement je ne l’avais pas trouvé, mais j’étais maintenant enseveli sous une montagne de détails à propos de personnes et de faits qui refusaient de s’assembler pour former une image cohérente. ». La troisième voix est celle du policier maintenant à la retraite qui, à l’époque des faits, n’a pu trouver le meurtrier et qui, pour différentes raisons, reprend l’enquête et fait apparaître d’autres protagonistes. Les trois points de vue, bien sûr, éclairent les événements sous des angles fort différents, suggérant des réponses dans lesquelles le lecteur devra trouver sa part de vérité.
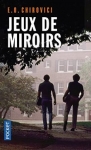 On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié avec succès plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».
On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié avec succès plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».
Jean-Pierre Longre
12:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, usa, roumanie, e. o. chirovici, isabelle maillet, les escales, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2017
« Accepter le chaos véritable qui nous compose »
 D.H. Lawrence, Le Chaos en poésie / Chaos in poetry, introduit et traduit de l’anglais par Blandine Longre, Black Herald Press, 2017
D.H. Lawrence, Le Chaos en poésie / Chaos in poetry, introduit et traduit de l’anglais par Blandine Longre, Black Herald Press, 2017
Présentation :
Si D. H. Lawrence (1885-1930) a toujours écrit sur la poésie, Chaos in Poetry, composé en 1928 à la demande de Harry Crosby, cofondateur de la maison d’édition parisienne Black Sun Press, est peut-être l’un des textes les plus importants qu’il ait jamais consacrés au sujet. En exposant ses vues sur la « vraie » poésie et en développant la notion du « chaos vivant » que celle-ci serait censée révéler, Lawrence s’inscrit dans la tradition du poète visionnaire qui dévoile des mondes insoupçonnés, terrifiants – visions éblouissantes du chaos que l’humanité préfère occulter, un chaos cosmique, divin et intime qu’il faut rapprocher des notions d’élan vital et de flux protéiforme, traits essentiels de la créativité lawrencienne que l’on retrouve dans ce texte infiniment poétique.
Citations :
« La poésie a pour qualité essentielle de produire un nouvel effort d’attention et de “découvrir” un monde nouveau au sein du monde connu. L’homme, les animaux, les fleurs, tous vivent dans un chaos étrange et à jamais houleux. Le chaos auquel nous nous sommes accoutumés, nous l’appelons cosmos. L’indicible chaos intérieur qui nous compose, nous l’appelons conscience, esprit, et même civilisation. Mais il est, au bout du compte, chaos, qu’il soit ou non illuminé par des visions. ».
« Mais l’homme ne peut vivre dans le chaos. (…) L’homme doit s’envelopper dans une vision, se bâtir une demeure à la forme, à la stabilité, à la fixité apparentes. Dans sa terreur du chaos, il place d’abord une ombrelle entre lui et l’éternel tourbillon. Puis il peint l’intérieur de cette ombrelle comme un firmament. Ensuite il parade, vit et meurt sous son ombrelle. ».
10:31 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, anglophone, d.h. lawrence, blandine longre, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/11/2017
Un Shakespeare travesti
 Christopher Moore, Fou !, traduit de l’américain par Anne Sylvie Homassel, L’œil d’or, 2017
Christopher Moore, Fou !, traduit de l’américain par Anne Sylvie Homassel, L’œil d’or, 2017
De même que Scarron a écrit son Virgile travesti parodiant L’Enéide, Christopher Moore nous gratifie d’un « Shakespeare travesti », une parodie romanesque du Roi Lear incluant toutes sortes de références plus ou moins patentes à d’autres pièces du dramaturge, avec lequel il entretient une relation à la fois admirative et familière, comme l’attestent ses explications finales : « Quand vous maniez [la] langue anglaise – et surtout si vous la maniez depuis aussi bougrement longtemps que moi, vous tombez sur les œuvres de Will quasiment à tous les coins de page. Quelles que soient vos intentions narratives, vous pouvez être sûr que, quatre siècles avant vous, Will les aura exprimées avec plus d’élégance, plus d’économie, plus de lyrisme […]. S’il est impossible de récrire ce qu’il a composé, on peut du moins reconnaître le génie à l’œuvre. ».
Nous voilà donc embarqués avec nos deux écrivains pour un hommage « à la comédie anglaise ». Un hommage burlesque, où la paillardise le dispute à l’audace, la salacité à la familiarité, la rigolade à l’immoralité, la truculence à l’érudition. Un hommage en forme de « journal d’un fou » qui n’a pas grand-chose à voir avec celui de Gogol. Ce n’est pas non plus du vrai Shakespeare, et pourtant nous avons là tous les personnages présents dans le drame : le roi lui-même, bien sûr, ses trois filles Goneril, Regan et Cordelia, leurs époux respectifs, les amis Kent et Gloucester, les malfaisants et les bienfaisants, et surtout Pochette le fou du roi, qui est à la fois narrateur et tireur de ficelles (de ficelles et aussi, dévoilons-le, de certaines gracieuses personnes) ; sans compter un « foutu spectre » qui intervient périodiquement, et les personnages secondaires, petites gens, serviteurs, chevaliers, ainsi que Bave, l’apprenti bouffon, aussi grand et mal dégrossi que Pochette est petit et plein de vivacité ; les deux compères, maître et élève, vont et viennent d’un château l’autre, parcourent forêts inhospitalières et campagnes humides, enfilent les aventures (et aussi, dévoilons-le… mais bon, ce serait lourd d’insister davantage).
Voilà beaucoup de monde, beaucoup de péripéties, et tout cela grouille, complote, se brouille, se réconcilie, trahit, se bat, se débat… Passons sur les histoires individuelles de chacun (celle du roi, faible, excessif, maudit, celle, particulièrement originale et rebondissante, de Pochette, et d’autres encore). Le récit est alerte, comique, grivois, tragique, dramatique – et bien sûr on s’aperçoit que le plus « fou » de tous n’est pas celui qui en fait métier, et que les plus nobles ne sont pas ceux (ou celles) que leurs origines désignent. Comme l’indique le titre du dernier chapitre, « le roi un fou sera ». Et le lecteur en sera tout esbaudi.
Jean-Pierre Longre
10:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, christopher moore, anne sylvie homassel, shakespeare, l’œil d’or, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/09/2017
« Comment les sauver tous ? »
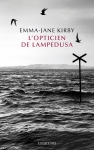 Emma-Jane Kirby, L’opticien de Lampedusa, traduit de l’anglais par Mathias Mézard, Équateurs, 2016, J'ai lu, 2017
Emma-Jane Kirby, L’opticien de Lampedusa, traduit de l’anglais par Mathias Mézard, Équateurs, 2016, J'ai lu, 2017
« Je ne souhaitais pas raconter cette histoire. Je m’étais promis de ne jamais la raconter. Ce n’est pas un conte de fées. Ils étaient trop nombreux. Je voulais y retourner pour les sauver, tous. Je voulais y retourner. ». Ainsi s’exprime le protagoniste de ce récit, homme ordinaire qui vit sa vie familiale, affective et professionnelle d’opticien sans se soucier outre mesure des réfugiés qui abordent la petite île italienne de Lampedusa, si proche des côtes africaines.
C’est un jour prometteur de joie amicale et de grand air maritime que sa vie bascule. Partis pour une promenade en mer, ses amis, sa femme et lui ne comprennent pas tout de suite d’où proviennent les drôles de cris qu'ils prennent d’abord pour d’étranges "miaulements" de mouettes, et dont ils perçoivent finalement l’horrible vérité : des hurlements d’hommes, de femmes, d’enfants naufragés en train de se noyer. Pas d’hésitations, pas de discussion entre eux : tous se mettent avec acharnement aux tentatives de sauvetage, jusqu’à l’épuisement, jusqu’à la limite du danger pour eux et pour leur bateau, et avec le sentiment de ne pouvoir accomplir complètement leur devoir : « Il apparaît clairement que, pour l’opticien, le sauvetage n’est pas terminé. Il sonde du regard les eaux alentours : il cherche encore, sans relâche. ».
Ce récit sans fioritures romanesques, forcément vrai, qui puise sa force dans une terrible réalité, n’a rien de moralisateur, rien de politique non plus. Il n’est pas question de se demander pourquoi ces gens fuient leur pays : la guerre, les persécutions, la misère, le rêve, l’illusion ? Ils sont là, dénués de tout, au bord de la mort, et il faut les sauver, les accueillir, les héberger. Une histoire humaine, tout simplement, avec tout ce qu’elle implique de courage et d’abnégation. Un héroïsme discret qui ne cherche ni la gloriole ni même la reconnaissance, mais qui est guidé par la puissance de l’émotion, de la révolte et de la colère, et par des sentiments qui ont beaucoup à voir avec la solidarité, l’amitié, l’amour du genre humain. Rien de moralisateur donc, mais L’opticien de Lampedusa est un livre qui devrait donner à penser à tous les tenants de la fermeture des frontières et à tous ceux qui dressent des murs et des barbelés prétendument protecteurs.
Jean-Pierre Longre
11:14 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, anglophone, emma-jane kirby mathias mézard, Équateurs, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/08/2017
Les paradoxes du réel
Egon Bondy, Réalisme total / Totální realismus, traduit du tchèque par Eurydice Antolin, édition bilingue, Black Herald Press, 2017
Kathleen Raine, David Gascoyne et la fonction prophétique / David Gascoyne and the Prophetic Role, traduit de l’anglais par Michèle Duclos, édition bilingue, Black Herald Press, 2017
 Egon Bondy (Zbyněk Fišer), né à Prague en 1930, mort à Bratislava en 2007, est de ces poètes trop méconnus en France, et qui dans leur pays ont eu un impact décisif. Influencé par le dadaïsme et le surréalisme, devenu par la suite prosateur, essayiste, historien de la philosophie, il fut à partir des années 1970 « une figure tutélaire de l’underground tchèque », ainsi qu’un personnage des œuvres de Bohumil Hrabal, qui l’appelait « mon ami le poète Egon Bondy ». Publié pour la première fois en 1951 dans la Collection Minuit, maison d’édition clandestine, Réalisme total réapparut au grand jour en 1992, et la traduction d’Eurydice Antolin est la première en français, contribuant ainsi à la connaissance d’une œuvre qui n’a été publiée dans notre langue que par bribes.
Egon Bondy (Zbyněk Fišer), né à Prague en 1930, mort à Bratislava en 2007, est de ces poètes trop méconnus en France, et qui dans leur pays ont eu un impact décisif. Influencé par le dadaïsme et le surréalisme, devenu par la suite prosateur, essayiste, historien de la philosophie, il fut à partir des années 1970 « une figure tutélaire de l’underground tchèque », ainsi qu’un personnage des œuvres de Bohumil Hrabal, qui l’appelait « mon ami le poète Egon Bondy ». Publié pour la première fois en 1951 dans la Collection Minuit, maison d’édition clandestine, Réalisme total réapparut au grand jour en 1992, et la traduction d’Eurydice Antolin est la première en français, contribuant ainsi à la connaissance d’une œuvre qui n’a été publiée dans notre langue que par bribes.
Le « réalisme total » est une réaction poétique au « réalisme socialiste » qui envahissait la vie pseudo-culturelle de la Tchécoslovaquie et des autres pays tentant de vivre sous la dictature staliniste. La tentative, en l’occurrence, est celle qui consiste à trouver dans toutes les combinaisons verbales (le premier poème en est une démonstration formelle) la dimension nécessaire à la vie : « Et nous devons recommencer / si de fait nous ne voulons pas mourir ». Les scènes de l’existence quotidienne, les tableaux montrant les êtres, les objets et les paysages familiers (le tramway, un vieillard, les rues de Prague, Noël, l’achat d’un livre…) sont soumis à l’ironie mordante, aux confrontations choquantes, telle celle des femmes « bien habillées » des officiers et des détenus « mal vêtus » des commissariats. Les chants d’amour fou pour « Marie » sont aussi les plus implacables des paradoxes : « Elle me hait encore plus que je ne la hais / car moi en même temps je l’aime ».
À l’opposé des promesses de lendemains qui chantent et de grands soirs, l’engagement poétique d’Egon Bondy donne du réel une vision à la fois complexe et transparente, provocatrice et désespérée. Le « tout est vain » qui émane de sa poésie est lié à ses « monstrueux cauchemars », ses « épouvantables lassitudes », et à la révolte contre un régime qui peut faire dire, au comble du cynisme : « Il n’est pas besoin d’attendre longtemps / conseillait la camarade dans la file d’attente du Comité national / Si vous cherchez un appartement d’emprisonné / il vous sera attribué sans délai ». Dix ans après la mort d’Egon Bondy, on n’en a pas fini avec le « réalisme total ».
Jean-Pierre Longre
J
 Juste avant Réalisme total, Black Herald Press a publié David Gascoyne et la fonction prophétique, de Kathleen Raine, traduit par Michèle Duclos. À la suite des précédentes publications de David Gascoyne (La vie de l'homme est cette viande et Pensées nocturnes), cet essai d’une amie du poète, poète elle aussi, permet de mettre en perspective l’œuvre d’un écrivain attiré par « l’aspect messianique du surréalisme », et dont les « poèmes sont parmi les rares poèmes de notre temps à témoigner aussi éloquemment de la vérité de l’imagination au nom de laquelle ils parlent. ».
Juste avant Réalisme total, Black Herald Press a publié David Gascoyne et la fonction prophétique, de Kathleen Raine, traduit par Michèle Duclos. À la suite des précédentes publications de David Gascoyne (La vie de l'homme est cette viande et Pensées nocturnes), cet essai d’une amie du poète, poète elle aussi, permet de mettre en perspective l’œuvre d’un écrivain attiré par « l’aspect messianique du surréalisme », et dont les « poèmes sont parmi les rares poèmes de notre temps à témoigner aussi éloquemment de la vérité de l’imagination au nom de laquelle ils parlent. ».
J.-P. L.
15:30 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, tchèque, anglophone, egon bondy, eurydice antolin, david gascoyne, kathleen raine, michèle duclos, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/05/2017
Black Herald, nouveautés 2017
Black Herald Press
Mai 2017
À paraître
Réalisme total
Totální realismus
Egon Bondy
Poème traduit du tchèque par Eurydice Antolin
Black Herald Press, mai 2017 – 58 pages – 6 €
Ouvrage bilingue (tchèque-français)

Comme je suis le plus grand poète vivant
je songeais à la poésie
Qui se mesure à l’aune seule des secondes
que je passe dans l’impuissance
Egon Bondy (1930-2007), de son vrai nom Zbyněk Fišer, fut dans un premier temps poète, influencé par Dada et le surréalisme, puis prosateur et essayiste. Réalisme total, écrit en 1950 et d’abord publié clandestinement en 1951 par la maison d’édition fondée par Bondy et son ami Ivo Vodseďálek, marque la première rupture esthétique et poétique de son œuvre. Il devient également la figure tutélaire de l’underground tchèque des années 1970, quand nombre de ses textes sont repris par le groupe de musique The Plastic People of the Universe, et jusqu’à nos jours par d’autres musiciens tchèques proches de la musique expérimentale. Il a également influencé l’écrivain Bohumil Hrabal qui, de son propre aveu, s’est inspiré de son réalisme total pour écrire la prose total-réaliste Jarmilka (1952). Marginal inclassable et provocateur, Bondy reste aujourd’hui encore un personnage emblématique de la littérature tchèque.
https://blackheraldpress.wordpress.com/books/realisme-total-totalni-realismus-egon-bondy
Pour précommander l’ouvrage / to pre-order the book:
http://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles
***
Derniers ouvrages parus
David Gascoyne et la fonction prophétique
Kathleen Raine
Traduit de l’anglais par Michèle Duclos
David Gascoyne and the Prophetic Role
Black Herald Press, mai 2017 – 118 pages – 9 €
Ouvrage bilingue – bilingual book

Après la publication de La vie de l’homme est cette viande, deuxième recueil de David Gascoyne (1916-2001), et de son poème radiophonique Pensées nocturnes, diffusé en 1955 par la BBC, Black Herald Press propose un essai consacré au poète et à son parcours si singulier. Dans ce texte paru en 1966 et jusqu’à présent inédit en français, la poète Kathleen Raine (1908-2003), par ailleurs héritière spirituelle de William Blake, rend hommage au cheminement poétique, littéraire et métaphysique de son ami David Gascoyne.
***
The Return to Silence
and other poetical essays
Paul Stubbs
(on Baruch Spinoza, Friedrich Hölderlin, Simone Weil, Arthur Rimbaud, Yves Bonnefoy, and E. M. Cioran)
Black Herald Press – 138 pages – 12 €
‘For nearly two decades (or perhaps millennia) Paul Stubbs has been engaged in the task of imagining what lies beyond the imagination…there is no guardrail to this kind of project, no literary guide or physical limit, only exploration.’—Alice Oswald (The Poetry Review)
https://blackheraldpress.wordpress.com/books/thereturntosilence
***
Pensées nocturnes / Night Thoughts
David Gascoyne
ouvrage bilingue – bilingual book
traduit de l’anglais par Michèle Duclos – Postface / Afterword by Roger Scott
Black Herald Press – 156 pages – 16 €
https://blackheraldpress.wordpress.com/books/pensees-nocturnes-night-thoughts-david-gascoyne
Pour commander les ouvrages
http://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles
***
Marché de la Poésie, Paris
Black Herald Press participera au 35e Marché de la Poésie, du 7 au 11 juin 2017, place Saint-Sulpice (Paris Ve), stand 710, en compagnie des Carnets d’Eucharis & du Visage Vert.
*
Black Herald Press
Paris • London
Black Herald Press publie une revue de littérature bilingue, des ouvrages de poésie et des essais.
Black Herald Press publishes a bilingual magazine, poetry books, and essays.
http://blackheraldpress.wordpress.com
08:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, tchèque, francophone, bilingue, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/11/2016
« Mégalométropolis »
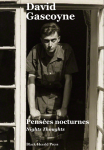 David Gascoyne, Pensées nocturnes, ouvrage bilingue – bilingual book, traduit de l’anglais par Michèle Duclos. Postface / Afterword by Roger Scott, Black Herald Press, 2016
David Gascoyne, Pensées nocturnes, ouvrage bilingue – bilingual book, traduit de l’anglais par Michèle Duclos. Postface / Afterword by Roger Scott, Black Herald Press, 2016
Après la parution en français de La vie de l’homme est cette viande (Man’s Life Is This Meat) de David Gascoyne (1916-2001), dont on fête cette année le centenaire de la naissance, Black Herald Press propose une édition bilingue de son poème radiophonique, Pensées nocturnes, diffusé en 1955 par le Third Programme de la BBC. Au sommaire : le poème en trois volets (« Les Veilleurs de Nuit », « Carnaval Mégalométropolitain », « Rencontre avec le Silence »), « Le Poète et la Ville » (1981), essai de Gascoyne inédit en français, et une postface de Roger Scott – ami, archiviste, éditeur du poète et spécialiste de son œuvre ; le tout dans une traduction de Michèle Duclos.
After the publication of a bilingual edition of Man’s Life Is This Meat (La vie de l’homme est cette viande) by David Gascoyne (1916-2001), the centenary of whose birth is celebrated this year, Black Herald Press releases a bilingual edition of his radiophonic poem Night Thoughts, broadcast in 1955 by the Third Programme (BBC). This book includes the three-part poem (‘The Nightwatchers’, ‘Megalometropolitan Carnival’, ‘Encounter with Silence’), an essay by Gascoyne ‘The Poet and the City’ (1981), and an afterword by Roger Scott—a friend, archivist, and editor of the poet, and a specialist of his work; French translation by Michèle Duclos.
*
Diffusé en 1955 par le Third Programme de la BBC et publié en 1956 en Grande-Bretagne, Pensées nocturnes, poème radiophonique pour plusieurs voix de David Gascoyne (1916-2001), se présente comme une déambulation en trois volets dans une ville nocturne – en l’occurrence, Londres – qui revêt des formes multiples : cité réelle, rêvée et assoupie, puis fantasmagorique et hallucinatoire, enfer souterrain et ultra-mécanisé, enfin silencieuse et apaisée, rendue à la Nature, à l’espoir et à la renaissance. Partant du thème de la Cité primitive et mythique devenue « Mégalométropolis », le poète dépeint tant « le vide éthique qui est au cœur de notre monde » que la figure du Solitaire perdu dans la multitude, tantôt « privé d’âme et d’individualité », tantôt luttant pour préserver son humanité. À travers cette exploration tour à tour tragique, satirique et existentielle de la Ville, le poète entend aborder « la nuit spirituelle » inextricablement liée à la civilisation moderne et souligner sa quête incessante de lumière, seule capable « d’écarter l’obscurité du Vide », pour citer Roger Scott, et de nous permettre d’accéder à une « solitude partagée ». En complément, deux textes, l’un de David Gascoyne, « Le Poète et la Ville », l’autre de Roger Scott, en postface, retracent la genèse de ce triptyque poétique et ses influences, parmi lesquelles les « Villes » de Rimbaud, le Paradis perdu de Milton, l’Enfer de Dante, ou encore La Terre vaine de T. S. Eliot.
David Gascoyne, l’un des grands poètes britanniques du xxe siècle, est l’auteur de plusieurs recueils – dont Roman Balcony, paru alors qu’il n’a que 16 ans, La vie de l’homme est cette viande, La Folie de Hölderlin et Poems, 1937-42. Dès 1933, lors de ses séjours en France, il fréquente de nombreux artistes et écrivains (Breton, Dalí, Ernst, Éluard…) avant de lier amitié avec Benjamin Fondane et Pierre Jean Jouve. D’abord influencé par le surréalisme (on lui doit le premier ouvrage en anglais consacré à ce mouvement et la traduction des Champs magnétiques de Breton et Soupault), Gascoyne s’en détachera pour se consacrer à une poésie humaniste et spirituelle. Son œuvre, d’une originalité saisissante et visionnaire, est marquée par une profonde angoisse existentielle, empreinte d’un mysticisme prophétique et tourmenté.
*
Broadcast in 1955 by the Third Programme (BBC) and published in Great-Britain in 1956, Night Thoughts, a radiophonic poem by David Gascoyne, is a three-part quest in a nocturnal city—in this case, London—which dons various forms: a real, dreamed, and sleeping city, then a phantasmagorical and hallucinatory one, like an underground and mechanized inferno, and lastly silent and appeased, restored to Nature, hope and rebirth. Taking as a starting point the theme of the primaeval and mythic City turned into a “Megalometropolis”, the poet depicts “the ethical emptiness at the core of our…world” as well as the figure of the Solitary, either “soulless” and “devoid of all individuality”, or struggling to preserve his humanity. Through this alternately tragic, satirical, and existential exploration, the poet intends to confront the “spiritual night” inextricably associated with modern civilisation and insists on “his constant search for the light to displace the darkness of the Void” (as Roger Scott writes in his afterword), a search that may allow us to reach “a shared solitude”. This book comprises two additional texts, “The Poet and the City” by David Gascoyne and an afterword by Roger Scott: they unveil the genesis of this poetical triptych and its influences—among them the “Villes” texts by Rimbaud, Milton’s Paradise Lost, Dante’s Inferno, and T. S. Eliot’s The Waste Land.
David Gascoyne (1916-2001), one of the great British poets of the 20th century, is the author of several collections—Roman Balcony, published when he was only 16 years old, Man’s Life Is This Meat, Hölderlin’s Madness and Poems, 1937-42, while his New Collected Poems, edited and introduced by Roger Scott, was released in 2014 (Enitharmon Press). From 1933 onwards, while staying in France, he met many artists and writers (Breton, Dali, Ernst, Éluard...) before befriending the Romanian-French poet and philosopher Benjamin Fondane and the French poet Pierre Jean Jouve. At first influenced by Surrealism (he wrote the first book in English dedicated to this movement and translated into English The Magnetic Fields by Breton and Soupault), by the late 1930s Gascoyne distanced himself from it and began to write a more humanistic and spiritual poetry. Imbued with a startling and visionary originality, his work is marked by a deep existential angst while being fraught with a prophetic, tormented mysticism.
*
Black Herald Press
https://blackheraldpress.wordpress.com/books/pensees-noct...
To pre-order the book / Pour précommander l’ouvrage
09:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, david gascoyne, michèle duclos, roger scott, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/09/2016
Une voix « autre »
 Michael Lee Ratigan, Hiraeth, recueil bilingue traduit de l’anglais par Blandine Longre, Black Herald Press, 2016
Michael Lee Ratigan, Hiraeth, recueil bilingue traduit de l’anglais par Blandine Longre, Black Herald Press, 2016
‘Poetry is the other voice’, wrote Octavio Paz, referring to what is re-created in silence, beyond history, and to what governs man’s conversations and etymological thrusts. Michael Lee Rattigan also has been seeking to pinpoint that ‘other’ voice, as each of his poems seems to exist only to advancesilence, or at least our unmediated access to it—for this poet does not shape a merely verbal language, but establishes an impalpable syntax of listening. In this collection, he succeeds in crossing what the poet Philippe Jaccottet described as ‘the unique uncrossable space’, a no-place of conflicting truths, a living territory of the soul and of the poetic mind, on which the imagination can be projected anew.
*
« La poésie est l’autre voix », écrivait Octavio Paz, faisant référence à ce qui est recréé en silence, au-delà de l’histoire, à ce qui régit les discours et les élans étymologiques de l’humain. Michael Lee Rattigan s’efforce lui aussi de localiser cette voix « autre », et chacun de ses poèmes ne semble exister que pour accroître le silence – ou du moins pour nous permettre d’y accéder directement ; car le poète ne se contente pas de modeler un langage verbal, mais bâtit également une syntaxe impalpable de l’écoute. Dans ce recueil, il réussit à franchir ce que Philippe Jaccottet appelle « l’unique espace infranchissable », un non-lieu de vérités conflictuelles, territoire vivant de l’âme et de l’esprit poétique sur lequel l’imagination peut se projeter et se renouveler.
*
précommander l’ouvrage / pre-order the book
*
Michael Lee Rattigan has lived and taught in Mexico and Spain, and translated the complete collection of Fernando Pessoa’s Alberto Caeiro Poems (Rufus Books, 2007). More translations have appeared in The Los Angeles Review, Asymptote Magazine, The Black Herald, The Fiend Journal, and in Selected Writings of César Vallejo (ed. Joseph Mulligan, Wesleyan University Press, 2015). His poetry collection Liminal was published in 2012 (Rufus Books).
Michael Lee Rattigan est poète et traducteur. Plusieurs traductions ont paru dans The Los Angeles Review, Asymptote Magazine, The Black Herald, The Fiend Journal, et dans l’anthologie Selected Writings of César Vallejo (éd. Joseph Mulligan, Wesleyan University Press, 2015). Un précédent recueil de poèmes, Liminal, a paru en 2012 (Rufus Books).
16:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, michael lee ratigan, blandine longre, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/08/2016
Prémonitions
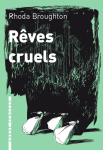 Rhoda Broughton, Rêves cruels, traduit de l’anglais par Patrick Reumaux, illustrations de Frédéric Bézian, L’arbre vengeur, 2014
Rhoda Broughton, Rêves cruels, traduit de l’anglais par Patrick Reumaux, illustrations de Frédéric Bézian, L’arbre vengeur, 2014
Les rêves peuvent-ils être prémonitoires ? Les trois nouvelles tragiques qui composent ce livre tendent à nous en persuader. En tout cas si nous les considérons comme des relations fidèles de la réalité – ce que les descriptions, les portraits, la couleur locale, l’atmosphère, les péripéties, l’écriture contribuent à nous laisser croire.
Trois nouvelles, donc, qui mettent en scène (expression particulièrement appropriée à la première) des personnages de la société anglaise aisée (affichant avec naturel leur savoir-vivre et leur mépris pour les petites gens) au tournant des XIXe et XXe siècles. C’est le premier point commun. Le second – la thématique principale –, ce sont les rêves annonçant d’horribles meurtres. Une mère de famille décide, malgré les remontrances de ses filles et les rigueurs de l’hiver, de partir voir une quasi-inconnue pour l’avertir du cauchemar qu’elle a fait à son sujet. Le second rêve, celui d’une jeune femme en visite chez une amie, laisse présager un dénouement tout aussi « cruel ». Dans le troisième récit, le rêve énigmatique d’une sœur montrera qu’il n’annonçait rien de bon pour son frère adoré militaire aux Indes…
Même si l’on s’attend, au moins en substance, aux dénouements de ces nouvelles, leur construction laisse planer mystère et suspense, entretenus par un sens aigu de la narration, l’art de camper des personnages, de les faire parler, le tout accentué par les gravures inquiétantes de Frédéric Bézian. De quoi s’effrayer délicieusement.
Jean-Pierre Longre
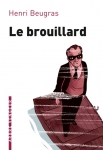 À lire, dans une autre veine mais toujours dans l’esprit qui guide les éditions de l’Arbre vengeur, Le brouillard de Henri Beugras (avec des illustrations d’Alfred) (2013). Une belle et terrible fable fantastique à caractère social et universel.
À lire, dans une autre veine mais toujours dans l’esprit qui guide les éditions de l’Arbre vengeur, Le brouillard de Henri Beugras (avec des illustrations d’Alfred) (2013). Une belle et terrible fable fantastique à caractère social et universel.
19:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelles, anglophone, rhoda broughton, patrick reumaux, frédéric bézian, henri beugras, l’arbre vengeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/06/2016
Black Herald Press
Du 8 au 12 juin, Black Herald Press sera au Marché de la poésie, place Saint-Sulpice, 75006 Paris. Stand 710, en compagnie du Visage Vert et des Carnets d'Eucharis.

Présence aussi du 3 au 13 juin au festival Les Éternels FMR, Halle Saint-Pierre, 2 rue Ronsard, 72018 Paris.

https://www.evensi.fr/les-eternels-fmr-de-juin-halle-sain...
09:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, anglophone, black herald press, marché de la poésie, les éternels fmr | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/04/2016
Cruels itinéraires
 Iain Banks, Un chant de pierre, traduit de l’anglais par Anne Sylvie Homassel, gravures de Frédéric Coché, L’œil d’or, 2016
Iain Banks, Un chant de pierre, traduit de l’anglais par Anne Sylvie Homassel, gravures de Frédéric Coché, L’œil d’or, 2016
L’œuvre de l’écrivain écossais Iain Banks (1954-2013) relève de plusieurs genres : la science-fiction (sous la signature de Iain M. Banks), l’essai, la fiction. Un chant de pierre appartient à cette dernière catégorie – sous de fausses allures de réalisme historique mêlé de merveilleux sanglant et d’onirisme poétique.
Abel, le narrateur et protagoniste, aristocrate en butte à une guerre dévastant le pays et jetant la population sur les routes, fuit le domaine familial avec sa sœur-amante (à qui le récit s’adresse), avant d’être arrêté par une Lieutenant qui les ramène de force à leur point de départ, investit le château avec ses sbires et ne lâchera plus le couple, le séduisant et le séparant, provoquant un mélange d’attirance et de répulsion, de séduction et de cruauté. Une cruauté qui n’épargne personne, ni le peuple venu se réfugier sous les murailles, ni les soldats, ni les pillards, ni les domestiques, ni les maîtres ; la torture, la souffrance, la mort menacent chacun dans un conflit dont on ne perçoit ni les tenants ni les aboutissants, et auquel on participe à faible hauteur d’homme, comme Fabrice del Dongo à Waterloo. Un conflit à la fois moderne (il y a des jeeps, des pistolets, des grenades) et d’apparence médiévale (il y a des épées, des armures, des potences), dans lequel la nature végétale ou minérale et les constructions humaines (les pierres…) jouent des rôles importants, un conflit, surtout, à l’absurdité intemporelle : « Je ne comprends pas leur guerre, ne sais plus maintenant qui combat contre qui, ni pour quelle raison. Nous pourrions être à n’importe quelle époque, n’importe quel endroit ; n’importe quelle cause produirait les mêmes résultats, les mêmes fins, incertaines ou définitives, gagnées ou perdues. ». Un conflit qui donne des occasions de retours sur le passé, sur soi, sur la destinée : « Chacun d’entre nous contient l’univers dans son être, l’existence dans sa totalité contenue par tout ce dont il nous faut tirer du sens […]. Peut-être inventons-nous nos propres destins, de sorte qu’en un sens nous méritons ce qui nous arrive, n’ayant pas eu assez d’esprit pour nous figurer mieux. ».
Roman inclassable, entre fable (im)morale et conte fantastique, Un chant de pierre tient aussi du récit d’aventures, de la fantaisie morbide, du roman d’analyse, de l’érotisme sadien et de la parodie ducassienne, comme en témoignent certaines évocations qui mènent le lecteur sur des chemins inattendus : « Le matin arrive, radieux ; l’aube aux doigts de sang de sa lueur zélée incendie des océans célestes et courbe vers la terre un autre commencement factice. Mes yeux s’ouvrent comme des bleuets, se collent, encroûtés de leur propre rosée rance puis absorbent cette lumière. ». Roman poétique, pourrait-on dire, d’une poésie sans concessions, violente, oppressante, déroutante, fascinante.
Jean-Pierre Longre
17:50 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, ilustration, iain banks, anne-sylvie homassel, frédéric coché, l’œil d’or, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/02/2016
« Un poète français qui écrit en anglais »
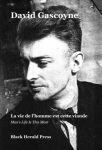 David Gascoyne, La vie de l’homme est cette viande, Black Herald Press éditions, janvier 2016, recueil bilingue traduit de l’anglais par Blandine Longre, avec des autotraductions de David Gascoyne
David Gascoyne, La vie de l’homme est cette viande, Black Herald Press éditions, janvier 2016, recueil bilingue traduit de l’anglais par Blandine Longre, avec des autotraductions de David Gascoyne
Postface de Will Stone
Man’s Life Is This Meat
bilingual book
Afterword by Will Stone
Pour commander l’ouvrage : https://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles
*
David Gascoyne (1916-2001), l’un des grands poètes britanniques du XXe siècle, est l’auteur de plusieurs recueils – dont Roman Balcony, le premier, paraît alors qu’il n’est âgé que de 16 ans. Il lit très tôt Rimbaud et les surréalistes, puis, à partir de 1933, lors de ses séjours en France, fréquente de nombreux artistes et écrivains (dont Breton, Dalí, Ernst, Éluard…) avant de lier amitié avec Benjamin Fondane, qui lui fera découvrir la philosophie de Léon Chestov, et avec Pierre Jean Jouve, dont l’œuvre le marquera durablement et à laquelle il devra la découverte de Hölderlin. D’abord influencé par le surréalisme (on lui doit le premier ouvrage en anglais consacré au surréalisme français ainsi que le « Premier Manifeste Anglais du Surréalisme »), Gascoyne s’en détache dès la fin des années 1930 pour se consacrer à une poésie à tendance humaniste et spirituelle (Breton lui-même, jugeant ses écrits trop « catholiques », l’« excommuniera » du groupe des surréalistes en 1947). Le recueil Man’s Life Is This Meat, publié en mai 1936 et proposé pour la première fois en français dans son intégralité (le complète un choix de poèmes écrits à la même époque, dont certains traduits par Gascoyne lui-même), appartient bien à la période surréaliste de David Gascoyne, mais témoigne déjà d’une originalité saisissante et d’une imagination hors du commun : marqué par une profonde angoisse existentielle, il comprend des poèmes sculpturaux, crépusculaires, empreints d’un mysticisme prophétique et tourmenté qui participe de l’œuvre visionnaire à venir.
*
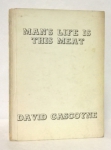 David Gascoyne (1916-2001), one of the great British poets of the 20th century, is the author of several collections—the first one, Roman Balcony, was published when he was only 16 years old; still in his teens, he began to read Rimbaud and the Surrealists, then, from 1933 onwards, while staying in France, he met a number of artists and writers (Breton, Dali, Ernst, Éluard…) before befriending Benjamin Fondane (through whom he discovered the philosophy of Léon Chestov) and the French poet Pierre Jean Jouve, whose work made a deep impression on him—thanks to this writer, Gascoyne discovered Hölderlin’s work. At first influenced by Surrealism (he wrote the first book in English dedicated to this French movement and the “First Manifesto of English Surrealism”), Gascoyne moved away from it by the late 1930s to write a more humanistic and spiritual poetry (Breton himself, judging his writings too “catholic”, “excommunicated” him from the surrealist group in 1947). Man’s Life Is This Meat, a collection published in May 1936 and presented here for the first time in French in its entirety (in addition with a selection of other poems that Gascoyne self-translated), certainly belongs to his surrealist period, but also bears testimony to his already startling originality and rare imagination: marked by a deep existential angst, it includes sculptural and crepuscular poems, fraught with a prophetic, tormented mysticism which heralds his future visionary work.
David Gascoyne (1916-2001), one of the great British poets of the 20th century, is the author of several collections—the first one, Roman Balcony, was published when he was only 16 years old; still in his teens, he began to read Rimbaud and the Surrealists, then, from 1933 onwards, while staying in France, he met a number of artists and writers (Breton, Dali, Ernst, Éluard…) before befriending Benjamin Fondane (through whom he discovered the philosophy of Léon Chestov) and the French poet Pierre Jean Jouve, whose work made a deep impression on him—thanks to this writer, Gascoyne discovered Hölderlin’s work. At first influenced by Surrealism (he wrote the first book in English dedicated to this French movement and the “First Manifesto of English Surrealism”), Gascoyne moved away from it by the late 1930s to write a more humanistic and spiritual poetry (Breton himself, judging his writings too “catholic”, “excommunicated” him from the surrealist group in 1947). Man’s Life Is This Meat, a collection published in May 1936 and presented here for the first time in French in its entirety (in addition with a selection of other poems that Gascoyne self-translated), certainly belongs to his surrealist period, but also bears testimony to his already startling originality and rare imagination: marked by a deep existential angst, it includes sculptural and crepuscular poems, fraught with a prophetic, tormented mysticism which heralds his future visionary work.
*
Beyond that savage pretence of knowledge
Beyond that posture of oblivious dream
Into the divided terrain of anguish
Where one walks with bound hands
Where one walks with knotted hair
With eyes searching the zenith
Where one walks like Sebastian
(«Purified Disgust»)
Au-delà de ce simulacre sauvage du savoir
Au-delà de cette posture de rêve oublieux
Dans le terrain morcelé de l’angoisse
Où l’on marche les mains liées
Où l’on marche les cheveux emmêlés
En fouillant des yeux le zénith
Où l’on marche comme Sébastien
(« Dégoût Purifié » 1935)
But the last head is safe in its vegetable dome:
The last head is wrapped in its oiled silk sheath,
While the pale tepid flame of its ichorous brain
Consumes all its body’s dry shells.
(«The Last Head»)
Mais la dernière tête est à l’abri dans son dôme végétal :
La dernière tête est enveloppée dans son fourreau de soie huilée,
Tandis que la flamme tiède et pâle de son cerveau ichoreux
Consume toutes les coquilles sèches de son corps.
(« La Dernière Tête » 1936)
*
« David is not an English poet, he is a French poet writing in English. »
Philippe Soupault about David Gascoyne (in conversation with Kathleen Raine)
« David n’est pas un poète anglais, mais un poète français qui écrit en anglais. »
Philippe Soupault à propos de David Gascoyne (lors d’une conversation avec Kathleen Raine)
22:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, surréalisme, david gascoyne, blandine longre, wille stone, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/12/2015
À la poursuite du vibrion cholérique
 Anne Roiphe, L’insaisissable, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Les éditions du Sonneur, 2015
Anne Roiphe, L’insaisissable, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Les éditions du Sonneur, 2015
En 1883, une épidémie de choléra sévit à Alexandrie. Louis Pasteur confie à de jeunes chercheurs français la mission de partir dans la ville égyptienne afin de traquer et d’identifier le microbe responsable de la maladie qui a ravagé de nombreuses régions du monde au cours des siècles. À partir de ce fait scientifique, Anne Roiphe, journaliste et écrivain née en 1935 aux États-Unis, a composé une épopée romanesque dans laquelle vérité historique et suspense narratif se répondent et se mêlent intimement.
Le contexte géographique, campé avec précision et pittoresque, est donc celui d’Alexandrie à la fin du XIXe siècle, ville grouillante de vie malgré l’épidémie, cité où se mêlent l’antique et l’actuel, port cosmopolite où se côtoient les communautés de diverses origines, de diverses religions – avec ce que cela implique d’amitiés sincères mais aussi de rivalités et de trafics en tous genres. Il y a encore le contexte médical, dans lequel émergent des personnes réelles (l’équipe des chercheurs français et celle des chercheurs allemands menée par le fameux Robert Koch), mais aussi des personnages fictifs comme le docteur Malina, honorable médecin juif renommé dans la ville, qui avec sa famille sera victime du machiavélisme des Anglais, et dont la fille, Este, va devenir l’héroïne féminine du roman. Car un amour réciproque naît peu à peu entre la jeune fille et Louis Thuillier, membre du petit groupe de français qui a installé son laboratoire dans l’hôpital européen de la ville – et cet amour va de pair avec l’intérêt grandissant d’Este pour le travail de recherche médicale. D’autres personnages nés sous la plume de la romancière jouent des rôles qui, bien qu’ils paraissent secondaires, changent radicalement le cours du récit : tels le jeune Marcus, aide de laboratoire en quête de fortunes faciles, Eric Fortmann, aventurier hâbleur et sans scrupules, ou Albert, initialement fiancé à Este…
Pour historique qu’il soit, L’insaisissable est donc un vrai roman, une fiction dans laquelle les sentiments, les passions et les manœuvres nouent des destins dramatiques. De surcroît, l’aspect documentaire, assuré par des extraits de lettres de Pasteur et d’ouvrages spécialisés, ainsi que par de minutieuses descriptions des corps malades et des expériences de laboratoire, est rehaussé par les épisodes qui font du mystérieux microbe un être vivant et invisible s’insinuant dans l’eau, les humeurs, les tissus, les organes, les moindres recoins de la ville, des rues, des maisons et des corps, une sorte de fantôme morbide et diabolique qui exerce ses ravages de manière subreptice, imprévisible et fatale. Et ceux qui le traquent risquent bien d’être à leur tour traqués, d’en devenir les victimes. Insaisissable, jusqu’au bout.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, anne roiphe, blandine longre, choléra, louis pasteur, robert koch, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2015
Noir c’est noir
 Thomas Ligotti, Chants du cauchemar et de la nuit, Nouvelles choisies, présentées et traduites de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel, Dystopia Workshop, 2014
Thomas Ligotti, Chants du cauchemar et de la nuit, Nouvelles choisies, présentées et traduites de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel, Dystopia Workshop, 2014
Thomas Ligotti, né en 1953 à Detroit, est – aux dires mêmes de sa traductrice – un héritier de Lovecraft et d’Edgar Poe (dont il se revendique par des allusions et des références parfois claires). Et même si on n’en était pas averti, on s’en apercevrait rapidement à la lecture de ces nouvelles (bien) choisies, qui jouent sur tous les tons de la littérature que l’on qualifie généralement, pour faire vite, de fantastique, sans négliger la parodie.
Onze nouvelles, donc, qui mènent le lecteur aux confins du réel, aux frontières entre la vie éveillée et la vie rêvée, entre le tangible et l’imaginaire, entre l’ici-bas et l’au-delà. On y rencontre des figures attendues (vampires, assassins, savants fous), mais aussi des êtres humains devenus pantins privés de toute liberté, de toute volonté – ainsi la prose de Ligotti contient-elle en filigrane (voire en sombre transparence) un pessimisme existentiel qui ne dépare pas dans l’obscurité environnante.
Cette obscurité visuelle qui laisse entrevoir « l’ombre au fond du monde » (titre de l’une des nouvelles) et « l’art perdu du crépuscule » (autre titre) laisse aussi filtrer « des sons venus par-delà quelque grise brume, ou cieux de pluie sifflante, comme si, en quelques ailleurs, des esprits ténus se convulsaient en un monde obscur et oublié de tous. ». Les sensations physiques sont instables, les corps sont soumis à des forces non maîtrisées, comme en rêve : « Dans ces moments où il rêvait, tout passait sous la coupe de puissances qui n’admettaient ni loi, ni raison ; rien n’avait de nature propre, d’essence : tout n’était qu’un masque posé sur le visage des ténèbres absolues, d’une noirceur que nul n’avait jamais vue. ». Mais ne s’agit-il que de cauchemars ? Le lecteur, lui aussi, à mesure qu’il avance dans son exploration du recueil, dans l’audition de ces « chants », éprouve le délicieux malaise que provoquent les mondes méconnus mais vivants, étranges et familiers.
Jean-Pierre Longre
15:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, anglophone, thomas ligotti, anne-sylvie homassel, dystopia workshop, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/06/2015
Une revue, deux livres, trois volumes…
Les publications du Black Herald, printemps 2015
Le Black Herald sera présent au Marché de la Poésie, Place Saint-Sulpice, Paris 6ème, du 10 au 14 juin 2015.
 The Black Herald n° 5
The Black Herald n° 5
Literary magazine – Revue de littérature
Issue #5 – Spring 2015 – printemps 2015
160 pages – 15€ – ISBN 978-2-919582-12-9 (ISSN 2266-1913)
With / avec David Gascoyne, Olive Moore, Egon Bondy, Rosemary Lloyd, Pierre Cendors, Andrew Fentham, Peter Oswald, Charles Nodier, Alistair Ian Blyth, Emil Cioran, Bensalem Himmich, Paul Stubbs, Eurydice Antolin, Afonso Cruz, Heller Levinson, Anne-Sylvie Homassel, Philippe Annocque, David Spittle, Cécile Lombard, Jos Roy, Michael Lee Rattigan, Yves et Ada Rémy, Victor Segalen, César Vallejo, Anthony Seidman, Edward Gauvin, Blandine Longre.
Interview with Emil Cioran / Entretien (inédit) avec Emil Cioran.
Contents & contributors / Sommaire et contributeurs
*
The Black Herald’s editors are Paul Stubbs and Blandine Longre.
Comité de Rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre.
To order the issue / Pour commander le numéro
 DITS DES XHUXHA’I
DITS DES XHUXHA’I
ANNE-SYLVIE SALZMAN
Tales of the xhuxha’i
bilingual book
translated from the French by the author
recueil bilingue
Black Herald Press, mai 2015
58 pages – 9 € – ISBN 978-2-919582-11-2
« La femme (la xhuxha’i) se retire dans la hutte menstruelle.
Médite le monde.
Elle reviendra dans un corps fait de sang. »
Au fil de contes, de chants, de témoignages mais aussi de quelques malédictions, Anne-Sylvie Salzman, en ethnologue de l’imaginaire, sonde les mœurs et les corps des femmes xhuxha’i – qui parlent aux bêtes, peignent les pierres de leurs menstrues et qui, selon les khyang, auraient pour déesse une matrice séchée. Dits des xhuxha’i esquisse entre les mots la fresque fabuleuse, atemporelle, d’une peuplade dont la chair mythique et immatérielle, à mesure que l’on pense en pénétrer le cœur et l’opaque nature, ne cesse de se dérober à nous ainsi qu’à toute interprétation raisonnée.
*
“The woman (the xhuxha’i) takes herself to the menstrual shack.
Broods over the world.
She will come back in a body made of blood.”
Through various tales, songs, eyewitness accounts and a few curses, Anne-Sylvie Salzman, as an ethnologist of the imaginary, explores the customs and the bodies of the xhuxha’i women—who talk to beasts, paint stones with their menstrual blood and whose goddess, according to the khyang, is a dried womb. Tales of the xhuxha’i outlines the legendary portrait of a timeless tribe and its mythical, immaterial flesh—whose core and opaque nature we imagine we can grasp, yet which constantly evades us, escaping any reasoned interpretation.
commander l’ouvrage / order the book
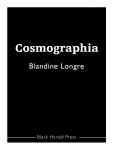 COSMOGRAPHIA
COSMOGRAPHIA
& other poems
BLANDINE LONGRE
with an introduction by Paul Stubbs
Black Herald Press, may 2015
70 pages – 9 € – ISBN 978-2-919582-10-5
These poems are ploughing new territories outside of the compulsion to portray any particular emotion or feeling, for what each of them demands of itself is not just ‘expression’ or an escape from expression, but to uproot the very trunk of the language which has already outgrown such things. Blandine Longre, in carving away at the object of the idol of her own primordial will, draws blood fresh from the fingertips of any reader who might happen to pick up and inspect the rough-hewn contours of her truest self—that is from the detritus of each imaginary torso-in-the-making that may float inside of our brains soon after reading her: ‘senses maddened into bone-tales distold: / fronting the words of thick-wet / their loose skeleton only savant mimicry’. (Paul Stubbs)
order the book
09:42 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, récit, francophone, anglophone, anne-sylvie salzman, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/04/2015
Le « meilleur des mondes » ?
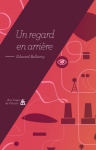 Edward Bellamy, Un regard en arrière, traduit de l’anglais par Francis Guévremont, préface de Manuel Cervera-Marzal, Aux forges de Vulcain, 2014
Edward Bellamy, Un regard en arrière, traduit de l’anglais par Francis Guévremont, préface de Manuel Cervera-Marzal, Aux forges de Vulcain, 2014
30 mai 1887, Boston : Julian West, 30 ans, riche et très joliment fiancé, s’endort dans la chambre souterraine que, par souci de tranquillité, il s’est fait aménager chez lui. 10 septembre 2000, Boston : le même Julian West est découvert, en un parfait état de conservation, endormi mais toujours vivant, dans la même chambre oubliée à la suite de l’incendie de sa maison. Il se retrouve au sein d’une charmante famille (le père, la mère, la fille), chaleureusement accueillante et respirant le bonheur, comme d’ailleurs le reste de la société bostonienne et américaine.
Rêve merveilleux ou fantastique bond en avant ? La fin du XXème siècle apparaît comme un âge d’or, dans un monde radicalement transformé par un assemblage parfait (trop parfait ?) des divers rouages de la société. Sous la houlette bienveillante du docteur Leete, son hôte, et de sa fille Edith (qui porte étrangement le même prénom que sa fiancée d’autrefois), Julian apprend à connaître avec un étonnement grandissant ce qui fait fonctionner à merveille l’industrie, le commerce, les relations humaines, la condition féminine, le travail, la finance (en tout cas ce qui en tient lieu), la vie intellectuelle et culturelle, les loisirs, la politique, la justice, la religion… Tout y passe, d’une manière systématique, jusqu’aux sentiments et serments amoureux qui viennent couronner cette revue intégrale.
C’est à un voyage complexe dans le temps que nous invite l’auteur : lecteurs de 2015, nous découvrons ce qu’un auteur de la fin du XIXème siècle prévoyait comme un monde parfait à la fin du XXème siècle : une organisation irréprochable au service d’hommes et de femmes coulés dans le moule d’un bonheur uniforme et indéfectible. Une utopie, une uchronie (comme le précise à juste titre Manuel Cervera-Marzal), dont on se doute qu’elle est et restera du domaine de la spéculation. Mais comment ne pas remarquer combien, hormis les progrès techniques et les améliorations du confort quotidien, le fonctionnement de la société n’a pas changé en presque 130 ans ? On en juge aux comparaisons triomphantes faites par le docteur Leete entre les XIXème et XXème siècles. Par exemple : « Votre système subissait des convulsions périodiques, qui s’emparaient aussi bien des sages que des imbéciles, des égorgeurs que de leurs victimes. Je veux parler de ces crises économiques, qui se produisaient tous les cinq ou dix ans ; elles détruisaient les industries de la nation, accablaient les compagnies qui étaient faibles et mutilaient les plus fortes. Après, il fallait traverser de longues périodes de léthargie, qui pouvaient durer plusieurs années ; les capitalistes en profitaient pour regagner les forces qu’ils avaient perdues ; les classes ouvrières crevaient de faim ou se déchaînaient en émeutes. Alors enfin arrivait une brève période de prospérité, suivie d’une nouvelle crise et d’une nouvelle léthargie. Au fur et à mesure que le commerce se développait, les nations devenaient interdépendantes, les crises s’étendaient au globe tout entier… ». Rien de plus actuel que cette condamnation du libéralisme économique et du règne de la finance ; cette première traduction intégrale et cette réédition d’un livre qui en son temps connut un succès comparable à celui de La case de l’oncle Tom sont salutaires.
Voilà donc un « regard en arrière » plein d’enseignements sur l’évolution (plutôt la stagnation) de l’humanité, de même que sur ses aspirations … À ce titre, il relève de l’essai. Mais c’est aussi un beau récit, avec des personnages auxquels on s’attache – même si certains tendent vers une vision manichéiste de l’Histoire. Un beau récit qui réserve des surprises, d’étranges liens entre le passé et le présent, entre le rêve et la réalité.
Jean-Pierre Longre
23:28 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, essai, anglophone, edward bellamy, francis guévremont, manuel cervera-marzal, aux forges de vulcain, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/11/2014
« Chercher la réponse »
 Gregory Corso, Le joyeux anniversaire de la mort / The Happy Birthday of Death, édition bilingue de poèmes choisis, traduits de l’anglais par Blandine Longre. Introduction de Paul Stubbs, postface de Kirby Olson, Black Herald Press, 2014
Gregory Corso, Le joyeux anniversaire de la mort / The Happy Birthday of Death, édition bilingue de poèmes choisis, traduits de l’anglais par Blandine Longre. Introduction de Paul Stubbs, postface de Kirby Olson, Black Herald Press, 2014
Gregory Corso (1930-2011), poète de la « Beat Generation » (celle d’Allen Ginsberg, Jack Kerouac et William S. Burroughs), est aussi “un iconoclaste capable de détruire ou de se soustraire à tout système de pensée, à tout système critique », selon les mots de Kirby Olson. Poète singulier, qui a donc un cheminement propre, non sans rapports avec son destin particulier. C’est en prison qu’il découvre la littérature et l’écriture, et tout au long de « sa vie chaotique », c’est la poésie qui l’a soutenu – sinon fait vivre.
Le volume bilingue publié par Black Herald Press, qui donne un large choix de textes tirés de The Happy Birthday of Death, un recueil écrit lorsqu’il vivait à Paris et publié en 1960, contribue à faire apprécier un poète jusque-là méconnu en France, puisque son œuvre n’y a été traduite et publiée que sporadiquement, par courts échantillons, peut-être à cause de cette originalité qui le caractérise, entre tradition et modernisme, entre classicisme et surréalisme. Paul Stubbs le précise dans son introduction : « Bien qu’il ait toujours été un poète moderne, voire enraciné dans son époque, Corso demeure avant tout un « ancien », doté d’une conscience pré-mythique, d’un mode d’expression pré-cognitif et, en fin de compte, excentrique » ; et les textes choisis sont une probante et belle illustration du caractère parfois surprenant d’une écriture qui « s’évertuait à atteindre les limites de l’imagination ».
Il y a du vagabondage dans cette écriture, qui évoque ici et là la Crète, Rome, Paris, L’Odyssée (mais tout de même, « Ulysse est mort », lui qui « aveugla créature d’immortalité ») ; il y a aussi du désespoir, du moins momentanément, dans les évocations de la mort et de la guerre, ou dans le constat du vide :
« Il n’y a pas de nous, il n’y a pas de monde, pas d’univers,
il n’y a pas de vie, pas de mort, pas de néant – rien n’a de sens,
et ceci aussi est mensonge – Ô maudite année 1959 ! »
Mais cela n’exclut ni l’humour (celui, par exemple, des « Poètes auto-stoppeurs sur l’autoroute ») ni l’ironie sociale que manie le long poème intitulé « Mariage » et qui commence par une série de questions : « Devrais-je me marier ? Devrais-je être bon garçon ? / Sidérer la jeune voisine avec mon complet de velours et ma cagoule faustienne ? »
Questions en suspens – et heureusement, car, on le sait, la poésie est aux antipodes de la certitude :
« La poésie c’est chercher la réponse
La joie c’est savoir qu’une réponse existe
La mort c’est connaître la réponse ».
Jean-Pierre Longre
10:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, gregory corso, blandine longre, paul stubbs, kirby olson, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/09/2014
« Une histoire rude »
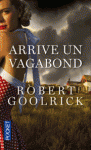 Robert Goolrick, Arrive un vagabond, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de Prémonville, Éditions Anne Carrière, 2012, Pocket, 2014
Robert Goolrick, Arrive un vagabond, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de Prémonville, Éditions Anne Carrière, 2012, Pocket, 2014
Pendant la première moitié du roman, on se sent bien. Blotties dans l’atmosphère sereine d’un petit bourg de Virginie, peu après la deuxième guerre mondiale, quelques familles vivent en harmonie dans des maisons bien rangées autour de boutiques où l’on trouve tout le nécessaire. Cette tranquillité tient certes à la bienveillance de chacun, mais aussi à l’autorité des pasteurs dans la bouche desquels l’enfer est une menace permanente, à un repli instinctif sur soi et à une ségrégation caractéristique des États-Unis d’Amérique de cette époque : chacun chez soi, les Blancs en ville, les Noirs en périphérie.
 Quand « arrive un vagabond », ce Charlie Beale épris de liberté, de la nature et des grands espaces, il est accueilli avec une curiosité un peu méfiante, mais sans animosité. Il est même pris en amitié par Will le boucher, sa femme Alma et surtout leur fils Sam, un petit garçon de cinq ans auquel il fait découvrir des tas de choses que recèle la campagne environnante et que ses parents n’ont pas le temps de lui montrer. Tout se passe d’une manière lisse, jusqu’au jour où Charlie s’éprend de Sylvan, jeune femme à peine tirée de l’enfance et de sa campagne reculée par un homme brutal qui l’a carrément achetée à ses parents afin de l’épouser. Sylvan, qui par films et magazines interposés ne rêve que de Hollywood et de robes de stars, voit le beau Charlie à travers le prisme du cinéma et de ses rêves. Elle n’a donc pas de mal à se laisser aimer passionnément par le nouveau venu. À partir de là commence la descente ; le mal s’insinue d’abord sournoisement, puis les destins vont basculer de plus en plus tragiquement, sous les yeux du petit garçon lié à Charlie par une promesse tenace.
Quand « arrive un vagabond », ce Charlie Beale épris de liberté, de la nature et des grands espaces, il est accueilli avec une curiosité un peu méfiante, mais sans animosité. Il est même pris en amitié par Will le boucher, sa femme Alma et surtout leur fils Sam, un petit garçon de cinq ans auquel il fait découvrir des tas de choses que recèle la campagne environnante et que ses parents n’ont pas le temps de lui montrer. Tout se passe d’une manière lisse, jusqu’au jour où Charlie s’éprend de Sylvan, jeune femme à peine tirée de l’enfance et de sa campagne reculée par un homme brutal qui l’a carrément achetée à ses parents afin de l’épouser. Sylvan, qui par films et magazines interposés ne rêve que de Hollywood et de robes de stars, voit le beau Charlie à travers le prisme du cinéma et de ses rêves. Elle n’a donc pas de mal à se laisser aimer passionnément par le nouveau venu. À partir de là commence la descente ; le mal s’insinue d’abord sournoisement, puis les destins vont basculer de plus en plus tragiquement, sous les yeux du petit garçon lié à Charlie par une promesse tenace.
L’art de Robert Goolrick tient du piège et de l’accélération. D’abord la mise en confiance, qui confine à la monotonie rassurante, puis des péripéties apparemment sans conséquences et restant dans les normes du comportement humain (l’amitié solide, l’amour joyeusement fou), enfin le drame, qui arrive presque sans crier gare et qui laissera des traces indélébiles. Comme l’explique le narrateur final, cinquante ans après, à de nouveaux venus dans le pays : « C’est une histoire rude. Aussi accueillant qu’il paraisse, ce n’est pas un pays facile. Mais on ne peut vivre de la terre sans la connaître, on ne peut la fouler sans se rappeler que nos pas ne sont pas les premiers ». Oui, une histoire rude, d’amour, de terre et de sang.
Jean-Pierre Longre
11:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, états-unis, robert goolrick, marie de prémonville, éditions anne carrière, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/09/2014
Paradoxes et vérité
Russell Banks, Lointain souvenir de la peau. Traduit de l’américain par Pierre Furlan, Actes Sud, 2012, Babel, 2013
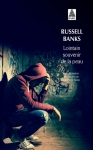
Premier paradoxe : aux États-Unis d’Amérique, les délinquants sexuels condamnés puis libérés ne doivent pas sortir des limites de leur comté, et ont interdiction de résider à moins de 800 mètres d’un lieu susceptible d’être fréquenté par des enfants (école, bibliothèque, centre de loisirs etc.). En Floride, dans le comté de Calusa (nom sous lequel ne se cache pas vraiment celui de Miami), quelles solutions leur reste-t-il ? L’aéroport, les marais ou le viaduc qui relie la ville à la mer, et sous lequel vit effectivement une colonie de parias.
Second paradoxe : le Kid, 21 ans, bracelet électronique à la cheville, fait partie de ces parias, et a planté sa tente sous ce viaduc. Pourtant, il est vierge. Son addiction au sexe, qui le tient depuis l’enfance, est purement virtuelle, passant par des sites internet qui n’ont aucun secret pour lui ; la seule incursion qu’il a faite dans le monde réel n’a été qu’une tentative minable, un lamentable piège, et lui a valu sa condamnation. Vierge sexuellement, il l’est aussi socialement ; sans attache parentale, ses seuls amis sont un iguane, puis une chienne et un perroquet ; ses compagnons d’infortune ne sont que des voisins plus ou moins clochardisés, puis ou moins sympathiques, obéissant au « chacun pour soi » des exclus. Frotté à la dure réalité, le Kid perdra sa naïveté, aura l’occasion de mettre son intelligence à l’épreuve, de toucher du doigt la complexité de l’existence : « À présent, lentement, il commence à se rendre compte qu’il pourrait ne pas être quelqu’un d’exceptionnel mais qu’au moins il a une importance par le simple fait d’être qui il est, qu’en réalité il n’est pas comme la masse de l’humanité telle qu’elle était à ses débuts, comme ces gens dont la vie entière, tout ce qu’ils décidaient de faire ou de ne pas faire, était déterminée par des facteurs extérieurs, par les conditions et les circonstances de leur naissance et par les gens qu’ils trouvaient là pour les accompagner dans leur vie ».
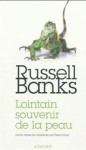
Cette démarche et cette transformation sont déclenchées par l’arrivée dans la vie du Kid d’un étrange personnage, le « Professeur », qui dans le cadre de ses recherches sociologiques s’intéresse particulièrement au jeune homme. Sans dévoiler les mystères de son propre passé ni les secrets de son présent, le « Professeur » parvient à faire parler son protégé, à lui faire prendre conscience de la vie, des sentiments, des relations humaines, mais aussi de la difficulté, voire de l’impossibilité de connaître la vérité, comme il est impossible de savoir si le trésor des pirates de jadis est vraiment caché quelque part.
Voilà une des questions centrales de ce grand roman : peut-on croire sans savoir ? « Ouais, bon, moi, il faut que je sache si cette histoire est vraie ou pas. Parce que s’il s’agit juste de croire, je peux aller d’un côté comme de l’autre. Et si je vais d’un côté, mon « comportement humain » sera pas le même que si je vais de l’autre et vice versa. Quel que soit le côté où je vais, j’aurai peur que ce soit pas le bon côté, et mon comportement humain sera pas bon non plus. On est pas dans un roman ou un film, tu comprends, où des conneries de ce genre n’ont aucune importance puisqu’à la fin on sait ce qui s’est réellement passé ». Dernier enchaînement de paradoxes : Lointain souvenir de la peau est bien un roman, mais un roman qui interroge la réalité sans forcément trouver de réponse, une fiction que l’on peut ranger dans la catégorie du réalisme social, mais qui met en avant les mensonges d’une société disparaissant sous les illusions du monde virtuel des écrans d’ordinateurs. « Ce qu’il sait pourtant, c’est que si rien n’est vrai, alors rien n’est réel. La logique le lui dit. Et si rien n’est réel, alors rien n’a d’importance ».
Jean-Pierre Longre
18:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, états-unis, russel banks, pierre furlan, actes sud, leméac, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/09/2014
La perfection, jusqu’à la perte.
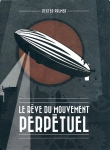 Dexter Palmer, Le rêve du mouvement perpétuel, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel et Blandine Longre, Passage du Nord-Ouest, 2014
Dexter Palmer, Le rêve du mouvement perpétuel, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel et Blandine Longre, Passage du Nord-Ouest, 2014
Enfermé dans le « vaillant navire Chrysalide », vaste zeppelin censé fonctionner pour l’éternité, Harold Winslow, jeune homme ordinaire, héros malgré lui d’aventures extraordinaires, narrateur scrupuleux et acteur étonné, couche par écrit ses souvenirs – c’est-à-dire tout ce qui l’a mené à s’embarquer dans le monstrueux véhicule aérien.
Récit touffu, plein de péripéties inattendues et de personnages étranges, Le rêve du mouvement perpétuel met en scène Prospero Taligent, « le plus prodigieux et le plus doué des inventeurs du XXème siècle », qui règne sur Xéroville dominée par l’immense tour où, pour la protéger des ravages du monde et du temps, il a enfermé sa trop aimée fille Miranda, et où l’on découvrira aussi son « fils » Caliban, créature difforme et complexe. Il y a aussi Astrid, la sœur de Harold, artiste au cheminement absolu et suicidaire. Il y a encore les robots (vrais ou faux, c’est selon) fabriqués par Prospero, qui de plus en plus envahissants s’adonnent aux tâches nécessaires à la vie collective, et dont on ne sait s’ils vont atteindre le niveau d’intelligence et d’initiative des humains… Voilà, entre autres phénomènes, qui suscite des réflexions poussées sur l’âme, l’esprit, le progrès, les rapports des hommes entre eux…
Comment qualifier le genre de ce rebondissant roman ? Science-fiction ou anticipation ? Dans ce cas, c’est de la rétro-anticipation (rétrofuturisme, dira-t-on), puisque tout se passe dans un XXe siècle tel qu’aurait pu l’imaginer le XIXème. Fantastique ? Merveilleux ? Il est vrai que les actes terribles et hors normes auxquels conduit l’amour fou de Prospero pour sa fille n’occultent pas par exemple les aspects merveilleux de l’enfance qu’elle a vécue, auxquels Harold n'est pas étranger. De même, la relation dramatique des événements n’exclut pas la distance humoristique et satirique de certains chapitres. Il faut aussi évoquer le démarquage littéraire, évident, revendiqué, puisque les protagonistes de La Tempête de Shakespeare sont là : Prospero, Miranda, Caliban… Un Prospero qui ne vieillit pas : « Je n’ai pas de passé. Vous pouvez toujours imaginer que je fus un jour petit, jeune et sans sagesse, comme vous autrefois, mais j’ai toujours été tel que je vous apparais aujourd’hui. Un vieux magicien en exil, depuis toujours ». Un magicien vieux sans doute, mais moderne, et dont la quête de perfection ne peut mener qu’à la mort figée ou à l’enfermement onirique. Souvenons-nous de La Tempête, acte IV, scène 1 : « Nous sommes faits de la même étoffe que les songes, et notre petite vie, un songe la parachève ».
Jean-Pierre Longre
http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/-Passage-du-Nord-O...
18:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, dexter palmer, anne-sylvie homassel, blandine longre, passage du nord-ouest, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/03/2014
Le souffle et les serpents
 Donna Tartt, Le petit copain, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch, Plon, 2003, Pocket, 2014
Donna Tartt, Le petit copain, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch, Plon, 2003, Pocket, 2014
Un roman tous les dix ans (Le maître des illusions en 1992, Le petit copain en 2002, Le chardonneret en 2013)… Donna Tartt n’est pas de ces écrivains dont la production annuelle s’assimile à l’entreprise industrielle (chacun a des noms en tête). La rareté, chez elle, est proportionnelle à l’ampleur et à la densité de ses livres.
On a récemment beaucoup écrit sur Le chardonneret, qui vient de paraître en traduction française. Restons donc un instant, pour changer, sur le roman précédent, Le petit copain, dont la version française vient d’être redonnée en collection de poche. Huit cent quarante pages serrées, qui à aucun moment ne suscitent l’ennui. Dans le Mississipi, que l’auteure, pour y être née, connaît bien, la famille Cleve Dufresne a été traumatisée par la mort (accidentelle ? criminelle ?) de Robin, âgé d’une dizaine d’années, retrouvé pendu à un arbre de la propriété. Mère dépressive, père absent, sœur occupée d’elle-même, Harriett, qui était un bébé lors de la tragédie, ne trouve réconfort qu’auprès d’une grand-mère à la forte personnalité, de quelques tantes et de son « petit copain » Hely. Plus de dix ans après, la fillette décide de trouver l’assassin de son frère et de faire justice.
Son entêtement, son goût du risque, les imprudences d’Hely (les siennes aussi) l’entraînent dans un univers inconnu, où les adultes se découvrent peu à peu comme des êtres fermés ou dangereux, faibles ou brutaux, frénétiques ou apathiques, et où la vie repose sur la lâcheté, les supercheries, les illusions, l’absence de scrupules – avec toutefois quelques parenthèses de joie sincère et de fraîcheur spontanée (celle-ci fort bien venue dans l’atmosphère étouffante où évoluent les personnages). Harriett mène la danse, une danse qu’elle ne maîtrise pas toujours, qui serpente et se désarticule jusqu’aux limites du souffle vital (les serpents et le souffle, deux motifs récurrents du récit, deux piliers de la narration).
Roman pointilliste et haletant, Le petit copain est un patchwork et une symphonie. Portraits multiples, incisifs et pittoresques, tableaux familiaux et sociaux d’un naturalisme grouillant, descriptions poétiques d’une nature glauque et hostile, évocations de rêves envahissants, aventures à rebondissement, suspense narratif angoissant, tout cela n’occulte en rien la sensibilité à fleur de peau d’une fillette attachante et futée, nourrie de souvenirs inquiets et des récits de Kipling ou Stevenson, et dont le cheminement vers la vie adulte se fait dans l’obstination et les tourments. Comme chez certains grands écrivains américains, comme chez certains grands écrivains russes, le souffle romanesque de Donna Tartt ne laisse pas le lecteur en repos.
Jean-Pierre Longre
14:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, donna tartt, anne rabinovitch, plon, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/02/2014
Métamorphose de la bande dessinée
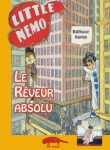
Balthazar Kaplan, Little Nemo, le rêveur absolu, Ab irato, 2014
Winsor McCay (1869-1934) est un pionnier, et son Little Nemo in Slumberland, créé en septembre 1905, publié en feuilleton à partir de cette date, renouvelle radicalement l’esthétique de la bande dessinée, en en faisant un genre à part entière, distinct du récit illustré. Cela, Balthazar Kaplan le rappelle, bien sûr, mais ne s’en contente pas : il analyse aussi d’une manière explicite et détaillée, quasiment exhaustive, ce qu’il faut savoir sur une œuvre que l’on peut considérer comme la première bande dessinée moderne.
En deux grandes parties, « Préambule au rêve » et « Au cœur du rêve », l’exploration du monde imaginaire de Little Nemo se fait de plus en plus incisive, de plus en plus pénétrante. Il y a, comme il se doit, l’ancrage dans une Histoire, l’héritage culturel – Jules Verne, Lewis Carroll, Andersen, les mythes populaires… Il y a l’humour, lié aux dysfonctionnements et aux transformations, l’onirisme évidemment, puisque les rêves et la fantaisie, le merveilleux et le monstrueux, l’illusion et la théâtralité sont autant de ressorts de la fiction.
Mais Little Nemo ne donne pas prise aux simplifications. Si l’imaginaire en est une constante, il cohabite avec le réel, en une subtile dialectique ; de même pour ce qui est de celle qui commande les relations entre « construction » et « perturbation » du monde. « Rien n’est stable, tout se transforme – être, chose, lieu », écrit l’auteur. Ajoutons à ces considérations celles qui concernent le dessin, toujours en mouvement (lignes et couleurs). Car « ce qui est fascinant avec McCay est qu’il ait si tôt et si vite compris les possibilités de la bande dessinée ». Le « génie » du dessinateur réside, entre autres, dans le jeu sur les cadres et sur les planches elles-mêmes, qu’il envisage d’une manière globale.
Faute d’entrer dans les détails de cette étude, disons qu’elle est à la fois savante et accessible, complète et éclairante, et que les illustrations (planches entières ou détails de dessins) qui la ponctuent, outre le rôle de preuves qu’elles jouent régulièrement, accentuent le plaisir de la lecture.
Jean-Pierre Longre
http://abiratoeditions.wordpress.com
Voir aussi Little Nemo 1905-2005, un siècle de rêves, album collectif, Les Impressions nouvelles : http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/little-n...
09:26 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, bande dessinée, francophone, anglophone, winsormccay, balthazar kaplan, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/01/2014
Chasse à la baleine
 Jeremiah N. Reynolds, Mocha Dick. Traduction de l’anglais (États-Unis) et préface de Thierry Gillyboeuf, Les éditions du Sonneur, 2013
Jeremiah N. Reynolds, Mocha Dick. Traduction de l’anglais (États-Unis) et préface de Thierry Gillyboeuf, Les éditions du Sonneur, 2013
Avant Herman Melville dans Moby Dick, Jeremiah N. Reynolds, journaliste, conférencier, infatigable voyageur, avait raconté la lutte à mort d’hommes téméraires contre un cachalot blanc aussi résistant que redoutable. Melville avait-il lu cette histoire ? Thierry Gillyboeuf se pose la question dans sa préface, et relève les similitudes entre les deux (un autre récit, celui du naufrage du baleinier l’Essex par Owen Chase, fait partie des sources avérées).
Certes, Mocha Dick est un récit beaucoup plus bref que Moby Dick, moins symbolique aussi. Mais cette relation d’une chasse effrénée à la baleine au large des côtes du Chili relève elle aussi de l’épopée humaine et animale, et la précision avec laquelle sont employés les termes techniques, géographiques, marins atteste une expérience hors du commun.
Descriptions détaillées, style direct des injonctions, dialogues incisifs, rivalités de marins, violence des combats, risques encourus, paroles viriles de la chanson finale… Ce petit livre, d’un coup de rame, nous mêle sans scrupules à la lutte.
Jean-Pierre Longre
18:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, jeremiah n. reynolds, thierry gillyboeuf, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

