27/01/2022
Du poison et des cadavres
 Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021
Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021
Léa Bernard, 23 ans, est découverte morte empoisonnée à son domicile. Visiblement, la jeune femme, dépressive, vivait seule et dans une absolue discrétion, consacrant scrupuleusement son temps à son travail intérimaire d’hôtesse d’accueil et à des ouvrages de broderie. Étonnant pour la commissaire Romano, son adjoint Tellier et accessoirement l’adjudant Clément, qui découvrent, renseignements pris, que Léa était « la jeune miraculée du vol AFI 587 », seule rescapée d’une catastrophe aérienne survenue au-dessus de l’Atlantique. Y aurait-il un lien entre ce crash et l’assassinat ? Les suppositions vont bon train, jusqu’au moment où l’on apprend que la victime a passé du temps à Genève comme hôtesse d’accueil d’une exposition prétendument pédagogique de cadavres plastinés.
La commissaire et son acolyte se rendent donc sur place, et découvrent peu à peu, outre les agréments de Genève et de son lac en été, un certain nombre d’éléments suspects concernant l’origine des cadavres exposés. Léa Bérard aurait-elle fait des découvertes dans le « marché du cadavre » qui se trame entre Chine, Russie, Europe (spécialement Genève et Annecy) ? L’enquête prend des dimensions insoupçonnées auparavant. « D’un côté, une demande qui explose, de l’autre, une offre qui stagne : c’est comme ça que naissent les circuits d’approvisionnement clandestins. ».
Malgré le côté macabre de l’intrigue (un autre assassinat va d’ailleurs avoir lieu), c’est avec un grand plaisir que nous retrouvons les personnages de Sophie Chabanel : Romano, qui, tout en étant harcelée par sa sœur en instance de divorce, ne vit que pour son travail mais ne dédaigne pas quelques plaisirs passagers, et qui est affublée d’un chat supplémentaire tout aussi destructeur que son comparse ; Tellier, ses scrupules, ses enfants et son moralisme rigide qui n’empêche pas son efficacité ; le divisionnaire Bertin, dont Romano moque volontiers le carriérisme forcené… L’emprise du chat est un polar au suspense prenant, à l’humour lucide, tantôt léger tantôt sans concession, aux allusions politiques claires et à l’engagement moral percutant. Une bonne lecture pour les frissons de l’âme, la détente de l’esprit et la moralisation de la conscience.
Jean-Pierre Longre
12:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, sophie chabanel, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/01/2022
Musicothérapie au XVIIIe siècle
 Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021
Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021
Au XVIIIe siècle, on débattait volontiers à propos de la nature de la musique et de ses répercussions sur le corps et le cœur humains. Pour Rameau, par exemple, les sons et leurs vibrations agissent sur l’intellect et le corps, tandis que pour Rousseau c’est le cœur et la sensibilité qui sont touchés par l’harmonie. Entre les deux fameux compositeurs-philosophes, les points de vue paraissent donc antinomiques, mais ils semblent se rejoindre sous la plume d’auteurs méconnus qui se sont intéressés en particulier aux « effets thérapeutiques de la musique », selon la formule que Philippe Sarrasin Robichaud emploie dans sa présentation. Encore une fois, les éditions Manucius ont mis au jour des textes précieux qui, bien qu’ils datent de près de trois siècles, restent d’une fraîche actualité.
Dans Effets de la musique, Jean-Joseph Ménuret de Chambaud reprend d’une manière synthétique, en se fondant sur des exemples puisés dans la mythologie (le chant merveilleux d’Orphée, entre autres) et dans la réalité (de l’antiquité aux temps modernes), les diverses influences que la musique exerce sur le comportement des animaux, mais surtout sur les corps, les esprits et les cœurs des humains, plus particulièrement sur leur santé. « C’est principalement sur les hommes plus susceptibles des différentes impressions, et plus capables de sentir le plaisir qu’excite la musique, qu’elle opère de plus grands prodiges, soit en faisant naître et animant les passions, soit en produisant sur le corps des changements analogues à ceux qu’elle opère sur les corps bruts. » Il rapporte comment certains médecins ont utilisé la musique avec succès comme « remède universel », en l’adaptant aux différentes sortes de maladies. Selon plusieurs observations, on peut prescrire la musique en tenant compte de « la nature de la maladie », du « goût du malade », de « l’effet de quelques sons sur la maladie » - en prenant soin d’ « éviter la musique dans les maux de tête et d’oreilles surtout. » Tout est donc précisément prévu, sachant que les sons musicaux ne sont pas « jetés » au hasard, mais « combinés suivant des règles constantes, unies et variées suivant les principes démontrés de l’harmonie. »
Le second texte porte sur le Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger (synthétisé, donc, pour L’Encyclopédie par Ménuret de Chambaud). Dans cette préface, Étienne Sainte-Marie résume les théories de l’auteur, qui tiennent, on l’aura compris, de ce qu’on appelle de nos jours la musicothérapie. D’après l’auteur, « l’homme renferme en lui trois centres principaux d’activité, qui composent toute son existence, et qui réunis donnent la somme entière des ses forces et de ses moyens : la vie animale, la vie morale et la vie intellectuelle », entre lesquelles il faut trouver un équilibre ; une sensibilité exacerbée, notamment, produit la méchanceté, ce qui explique que des hommes cruels « ont aimé la musique avec passion » (l’auteur évoque Néron, mais nous pourrions maintenant trouver maints autres exemples, chez les bourreaux nazis notamment). Malgré tout, la musique est apte à préserver « l’ordre et l’harmonie », elle est « indispensable à l’homme qui vit dans le tourbillon du monde. »
Si ce n’étaient les références historiques ou morales et, parfois, le style ou le lexique, on oublierait que ces textes, qui ont une même source et se complètent très bien l’un l’autre, ont été écrits au XVIIIe siècle. Toutes les époques, et la nôtre en particulier, peuvent prendre en considération cette assertion : « L’influence de la musique devient chaque jour plus nécessaire dans ce siècle corrompu.»
Jean-Pierre Longre
10:10 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, ménuret de chambaud, Étienne sainte-marie, joseph-louis roger, philippe sarrasin robichaud, éditions manucius, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/01/2022
Questions d’identité
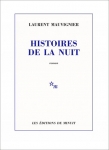 Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021
Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021
La trame de ces Histoires de la nuit a maintes fois été résumée, on ne répétera donc pas ici ce qui a déjà été écrit. Chez Laurent Mauvignier, le souffle de la syntaxe, les circonvolutions du style sont solidaires du récit, et inversement. En l’occurrence, l’intrigue aux apparences simples et aux allures de thriller est soutenue et étoffée par la voix de l’auteur qui laisse volontiers la place, en leur faisant écho, aux points de vue de ses personnages. Patrice le paysan, sa femme Marion au passé énigmatique, Ida leur fillette, Christine leur voisine artiste peintre, tous vivent dans le hameau isolé nommé « L’écart des trois filles seules » (nom mystérieux et légèrement angoissant). On suit chacun dans ses pensées et dans ses occupations d’une journée qui doit s’achever par la fête des quarante ans de Marion, jusqu’à l’irruption de l’inattendu et de l’effrayant, précédée par de mystérieuses lettres anonymes.
 Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »
Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »
D’une manière détournée, voire insidieuse, les terribles aventures vécues par les personnages de Laurent Mauvignier, qui dans les journaux apparaitraient comme un fait divers, voilent et dévoilent l’interrogation que chacun se pose un jour ou l’autre : qui suis-je vraiment ?
Jean-Pierre Longre
09:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/01/2022
Les découvertes de Tintin
 Tintin c’est l’aventure, Le musée imaginaire, Éditions Moulinsart, GEO hors-série, 2021.
Tintin c’est l’aventure, Le musée imaginaire, Éditions Moulinsart, GEO hors-série, 2021.
En 1979, Michel Baudson, concepteur du « Musée imaginaire de Tintin », première exposition consacrée à l’œuvre d’Hergé, écrivait paradoxalement : « Tintin ne s’expose pas. » Il « découvre » et « s’enrichit sans cesse des cultures des mondes qu’il découvre. » Les lecteurs de Tintin savent que les albums contiennent un grand nombre d’objets inspirés de pièces ethnographiques venues d’une multitude de pays. L’exposition de 1979 permettait, dans un « musée imaginaire », de « mettre en relation, album par album, des objets et des reproductions de cases de Tintin », avec d’ailleurs un certain intérêt porté aux voleurs, faussaires, trafiquants d’œuvres d’art – ceux que l’on trouve au fil des aventures du petit reporter.
 Hergé fréquentait volontiers les musées, notamment l’« AfricaMuseum » et le « mudée Art & Histoire » (dans leur appellation actuelle), et les albums s’en ressentent, notamment L’Oreille cassée avec son musée ethnographique et le fameux fétiche arumbaya (dont le modèle est une statuette du Pérou), Tintin au Congo avec « l’homme-léopard », témoignage d’une inspiration colonialiste qui a donné lieu à d’âpres discussions, ou encore Les 7 boules de cristal avec la momie de Rascar Capac…
Hergé fréquentait volontiers les musées, notamment l’« AfricaMuseum » et le « mudée Art & Histoire » (dans leur appellation actuelle), et les albums s’en ressentent, notamment L’Oreille cassée avec son musée ethnographique et le fameux fétiche arumbaya (dont le modèle est une statuette du Pérou), Tintin au Congo avec « l’homme-léopard », témoignage d’une inspiration colonialiste qui a donné lieu à d’âpres discussions, ou encore Les 7 boules de cristal avec la momie de Rascar Capac…
Après un certain nombre de notices et d’interviews (par exemple sur la question des « faux » qui se pose aussi dans Tintin et l'Alph-Art), la deuxième partie du volume est consacrée au « Musée imaginaire d’Hergé », confrontant les albums et les objets réels venus des mudées ou des pays traversés par Tintin – confrontation visuelle pleine d’enseignement sur le sens du détail, le souci de la précision, le génie du dessin chez l’artiste qu’était Hergé. D’ailleurs, en complément, des reproductions rappellent qu’il fut non seulement le père de Tintin (et de quelques autres personnages), mais aussi peintre, illustrateur et affichiste de talent, et grand amateur d’œuvres d’art, qu’il collectionnait volontiers.
Trente ans après l’exposition de 1979, s’ouvrait le musée Hergé de Louvain-la-Neuve, et divers autres lieux (Etterbeek, Angoulême…) témoignent de la popularité pérenne de l’œuvre d’Hergé et de la considération que l’on a maintenant pour la bande dessinée en tant qu’art. Hergé disait qu’en matière artistique, c’est l’émotion qui importe. C’est aussi de l’émotion que les amateurs de toutes générations ressentent en contemplant les nombreuses illustrations de ce « musée imaginaire », ainsi qu’à la relecture des albums de Tintin et à la vue de tous les objets qui les peuplent.
Jean-Pierre Longre
10:26 Publié dans Essai, Exposition, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, hergé, tintin, éditions moulinsart, géo, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/12/2021
Pâques mortelles en pays froid
 Ragnar Jónasson, Sigló, traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Éditions de La Martinière, 2020, Points, 2021
Ragnar Jónasson, Sigló, traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Éditions de La Martinière, 2020, Points, 2021
Dans la tranquille bourgade de Siglufjördur (pour simplifier : Sigló), à l’extrême nord de l’Islande, l’inspecteur Ari Thór doit enquêter sur la mort suspecte (suicide ? accident ? meurtre ?) d’une toute jeune fille, Unnur, visiblement tombée d’un balcon. Nous sommes à la veille du week-end de Pâques, et Ari doit justement accueillir sa femme et son petit garçon venus de Suède pour ces quelques jours de congé – et voilà que les retrouvailles vont être gâchées… Les péripéties de l’enquête vont se mêler aux difficultés familiales.
L’enquête, justement : « Tout portait à croire que la jeune fille s’était jetée dans le vide. Tout portait à croire que son seul objectif avait été de quitter ce monde. Pour lui, c’était la conclusion la plus simple. Mais compte tenu des dires de la mère, une enquête approfondie s’imposait. » Ari, avec l’aide plus ou moins empressée de son second, Ögmundur, et grâce aux conseils de son ancien mentor, suit plusieurs pistes ouvertes par ses soupçons et par quelques personnages qui l’alertent : la mère de la victime, qui justement ne veut pas croire au suicide, un couple âgé et un jeune historien occupants de l’immeuble au pied duquel le corps a été retrouvé, un vieux pensionnaire de maison de retraite et les propriétaires de celle-ci, des camarades de classe de la jeune fille… Dans cette localité dont presque tous les habitants se connaissent, et où les touristes affluent pour les sports d’hiver, les investigations de l’inspecteur ne sont pas simples, les indices minimes, les hypothèses nombreuses.
Il est vrai que le lieu et l’atmosphère sont propices aux mystères : le froid, la neige, les coupures d’électricité, la tempête rebuteraient n’importe qui. Mais Ari supporte stoïquement tout cela, même si ses problèmes conjugaux viennent périodiquement le perturber. Il évolue presque à l’aise entre les écueils et mène scrupuleusement ses recherches, écoutant en particulier avec attention Salvör, la mère d’Unnur, et ne se contentant pas des apparences. « Tandis qu’il affrontait le vent saisissant du nord et les flocons qui tourbillonnaient autour de lui, Ari se demanda si l’enquête avait vraiment été résolue, comme il le croyait. Avait-il commis une erreur ? Tiré de mauvaises conclusions ? Que voulait lui dire Salvör, qu’est-ce qui pouvait bien être aussi urgent ? Tout s’était passé si rapidement. Cela ne faisait que quatre jours que le corps d’Unnur avait été retrouvé. » Ses questionnements laissent le champ libre aux surprises finales – marques d’un vrai polar à suspense.
Jean-Pierre Longre
19:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, ragnar jónasson, jean-christophe salaün, Éditions de la martinière, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/12/2021
La solitude d’une fleur bleue
 Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
« C’est l’histoire d’une fleur bleue qu’on trempe dans de l’acide. Adélaïde Berthel, c’est une femme comme une autre. Qui, à quarante-six ans, entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. » Une femme d’aujourd’hui, féministe et moderne, qui retrouve régulièrement un groupe d’amies partageant entre elles leurs problèmes sentimentaux, professionnels, existentiels – la « sororité » peut être un réconfort, mais ce n’est pas la panacée. Féministe et moderne, donc, mais, après plusieurs déboires amoureux, elle rêve de trouver enfin l’homme avec lequel elle partagera la deuxième partie de sa vie. Les tentatives sont peu concluantes. La « fleur bleue » devient « peur bleue », la « femme comme une autre » devient « faille comme une autre ».
Histoire banale d’une solitude mal assumée ? Cela se pourrait. Mais dans ce domaine, il n’y a pas de banalité. La plume de Chloé Delaume fait du destin d’Adélaïde un cas particulier, et nous suggère qu’en la matière chaque cas est bien particulier, chaque cœur aussi : « C’est le cœur d’Adélaïde, le héros de cette histoire. C’est lui qui cogne et saigne, exige et se déploie. C’est lui qui fait le deuil, englouti par le vide. » Car Adélaïde, elle, la femme de quarante-six ans, a par ailleurs d’autres vies : vie amicale, vie professionnelle : attachée de presse dans une importante maison d’édition, « passeuse », « elle doit aussi gérer les écrivains », ce qui s’accompagne de toute une série de contraintes, de déceptions, de mensonges, et ce qui donne l’occasion à l’autrice de savoureuses pages satiriques sur le monde de l’édition, rivalités et exigences commerciales, batailles d’égos et d’images…
 Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Jean-Pierre Longre
15:00 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, chloé delaume, le cœur synthétique, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/12/2021
Van Gogh l’alchimiste
 Jos Roy, & dedans quantité de soleils; & inside, a great many suns, édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press, 2021
Jos Roy, & dedans quantité de soleils; & inside, a great many suns, édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press, 2021
Souvent, la mise en mots de la peinture tourne court, ou tourne mal : description purement et simplement technique des formes et des couleurs, tendance au rapport biographique, ou suite absconse de phrases indéchiffrables. Rien de tout cela avec Jos Roy. La difficulté de dire la peinture est en partie levée par la pratique d’une autre forme artistique, la poésie. Au lieu de mettre des mots sur la peinture, l’écriture se fait peinture, et en l’occurrence la vérité de Van Gogh se fait jour. Certes, « nous ne pouvons faire parler que nos tableaux », mais « la tâche / est de dire / le vrai / croquer le discours d’ocre&debleu ».
Dans ce long poème en vers plus ou moins réguliers, en strophes plus ou moins décalées, où l’esperluette, nœud musical et figuratif, se fait liant pictural et verbal, tout ce qui peut être dit de l’œuvre est révélé ou suggéré : formes, couleurs, matière, lumière, sens cachés, le chant aussi qui s’échappe de la toile, et même quelques rappels à propos du créateur : « je suis roux maigre à ma bouche il manque des dents qu’un parisien d’un autre temps rafistola ». Mouvements et sensations sont inséparables des gestes et des instruments : « dans les coulées d’ocre tendre / pas de limite entre le corps les tubes les brosses / faits de la même matière qui fait celle-ci ».
Et si les mots tentent de redire les paysages, eau, nuages, terre, village où domine « la haute note jaune », l’ocre puissant que rappelle le Chant de blé qui occupe la belle couverture du livre, c’est à la transformation du réel qu’oeuvrent de concert le matériau pictural et le matériau verbal : « toujours à galoper dans le réel pour saisir l’instant des / métamorphoses ». Transformation par « la jouissance des torsions » et par l’alchimie des couleurs : « depuis la fenêtre je suis dans le jardin de l’asile / de toutes mes chairs. je m’applique à fondre des couleurs / à la manière de l’or. ». « peinture réelle & peintre abstrait / quelle extraordinaire rencontre ! », disent les vers de Jos Roy. Cette extraordinaire rencontre, c’est aussi celle des secrets de la peinture et des mystères de la poésie.
Jean-Pierre Longre
09:45 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, peinture, francophone, jos roy, van gogh, blandine longre, paul stubbs, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Amour-haine en pays abandonné
 Clotilde Escalle, Toute seule, préface de Pierre Jourde, Quidam éditeur, 2021
Clotilde Escalle, Toute seule, préface de Pierre Jourde, Quidam éditeur, 2021
Elle a beaucoup vécu, Françoise, souvent méprisée par les hommes, rejetée d’un peu partout. « Et puis le lézard est arrivé. Cheminot et peintre, s’il vous plaît. Il était arrivé en roulotte tirée par un cheval. Il s’arrêtait dans les bourgs et les villages. Bonjour, je m’appelle Paul Ladier. » Elle s’est laissé séduire, mais les désillusions sont vite venues. La différence d’âge, lui devenu un vieux traîne-savate, elle tâchant sans grand succès de trouver de l’argent en vendant quelques toiles, tous deux installés dans l’ancienne boucherie d’un « bourg sacrifié »… Bref, la misère sociale, amoureuse et psychologique, les angoisses et la haine mutuelle : elle voudrait bien se débarrasser du vieux, mais ne peut se passer de lui, se surprenant parfois à encore partager sa couche.
Pour conjurer ses contradictions et ses peurs (peur pour elle, peur pour le « lézard »), elle marche, marche obstinément dans le bourg et dans la campagne, entendant à peine « les paquets de phrases jetées exprès en vrac sur son passage ». Au cours de ses cheminements, elle rencontre l’écrivain local, qui propose ses livres à la vente et se met à lui parler avec le sourire de Flaubert, de Beckett, de ses conférences, à elle qui ne lit guère que La ménagère française. « Il avait une pointe de mépris dans le regard, mêlé à une certaine indulgence. » Lorsque le vieux sera parti, envoyé par l’assistante sociale à l’hospice, elle reverra l’écrivain, qui lui sortira des mots comme « déterminisme » ou « ontologie », et la poussera à écrire « au lieu de ressasser » : « Tu te débats, tu respires l’ailleurs. Tu as envie de hurler. Alors écris… » Non, elle n’écrira pas. « Ça n’a pas de sens […] Ce n’est pas pour moi. » Et si le mot « ontologie » la travaille à tort et à travers, elle est plutôt rongée par ce que Raymond Queneau appelait l’« ontalgie ». L’existence est pour elle une souffrance sans solution.
Dans sa préface, Pierre Jourde qualifie le roman d’œuvre « sociale », mettant en scène des « sans-dents » (au sens littéral), des « laissés-pour-compte ». Il a raison, et il a raison aussi d’aller plus loin. Les personnages, surtout les deux protagonistes, ont l’épaisseur de ceux qui ne peuvent laisser le lecteur indifférent. Clotilde Escalle a l’art de nous les faire connaître peu à peu, de mieux en mieux, de l’intérieur et de l’extérieur, dans leur complexité, avec leurs paradoxes et leur violence, leur amour-haine. Le style, la structure du récit font de Toute seul un roman qui nous concerne intimement, qui requiert notre émotion profonde. « Qui est-elle, pour qu’on s’y intéresse ? » Ultime question, qui laisse Françoise « toute seule », et qui nous laisse seuls avec elle.
Jean-Pierre Longre
09:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, clotilde escalle, pierre jourde, quidam éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/12/2021
Un été d’apprentissage
 Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, Christian Bourgois éditeur, 2020, Le livre de poche, à paraître en janvier 2022. Prix du Livre Inter 2021
Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, Christian Bourgois éditeur, 2020, Le livre de poche, à paraître en janvier 2022. Prix du Livre Inter 2021
Le narrateur, 10 ans, passe ses vacances en Normandie avec sa grand-mère. « Un garçon de dix ans avec une vieille dame ça n’attire pas vraiment l’attention. » Il serait donc voué à un été anonyme, composant avec ses peurs et ses fantasmes, si n’intervenaient pas quelques personnages qui vont lui faire franchir des étapes : outre sa grand-mère, une tante « monstrueuse » au physique repoussant et à l’odeur nauséabonde, et surtout Baptiste, jeune garçon de son âge qui, contrairement à lui, paraît plein d’assurance et d’audace, vit dans une famille visiblement « idéale », avec une mère dont, secrètement, le narrateur tombe amoureux : « Certains adultes possèdent les clés de mondes plus désirables. Celui que me dévoile la mère de Baptiste a la douceur du velours. Elle a cette façon de me regarder, en penchant la tête, les yeux plissés, la bouche juste assez entrouverte pour que j’aperçoive sa langue pressée contre ses dents, qui me ralentit le cœur. » Il y a aussi le fils de la voisine, jeune homme « cadavérique », « qui se tient debout comme suspendu par des fils invisibles », et quelques autres comparses (ou adversaires) dont la plume aiguë de l’auteur grave définitivement les silhouettes.
 C’est à l’évidence Baptiste qui marque et influence le plus le garçon. Tous deux vont faire connaissance autour d’un cadavre de méduse que l’on triture sans scrupules avec un bâton. Dès lors, « il faut maintenant compter avec Baptiste même quand il n’est pas là », l’imiter, le suivre, honorer les invitations de ses parents, paraître aussi « normal » et courageux que lui, répondre à son amitié, à ses sentiments, à sa complicité, à son désir d’absolu, sans pour autant pouvoir lever les mystères, les ambiguïtés et les troubles que cette amitié recèle. Sans non plus lui révéler ce que la grand-mère raconte du passé de sa famille de Juifs victimes des nazis, la fuite de la Pologne, l’arrivée clandestine à Paris, la mort du frère et de ses proches tombés sous les balles allemandes, ces douleurs que l’on apprend par bribes, au coin des souvenirs.
C’est à l’évidence Baptiste qui marque et influence le plus le garçon. Tous deux vont faire connaissance autour d’un cadavre de méduse que l’on triture sans scrupules avec un bâton. Dès lors, « il faut maintenant compter avec Baptiste même quand il n’est pas là », l’imiter, le suivre, honorer les invitations de ses parents, paraître aussi « normal » et courageux que lui, répondre à son amitié, à ses sentiments, à sa complicité, à son désir d’absolu, sans pour autant pouvoir lever les mystères, les ambiguïtés et les troubles que cette amitié recèle. Sans non plus lui révéler ce que la grand-mère raconte du passé de sa famille de Juifs victimes des nazis, la fuite de la Pologne, l’arrivée clandestine à Paris, la mort du frère et de ses proches tombés sous les balles allemandes, ces douleurs que l’on apprend par bribes, au coin des souvenirs.
Tout le livre, du reste, avance par touches successives : trois parties (Baptiste, Les monstres, Les mondes engloutis), elles-mêmes divisées en brefs chapitres qui tous ont un titre au nom programmatique (« Les Méduses, Le Bain, L’Invitation, La Plage, Le Café, Le Playmobil » etc.), un peu comme dans Poil de Carotte – ne développons pas la comparaison, même si dans les deux cas nous avons affaire à un apprentissage de la vie. Notre narrateur fait son apprentissage comme une plante pousse sur un terreau fertile et humide. D’ailleurs, des « Méduses » au « Pipi Au Lit » en passant par « Le Bain », « La Plage », le shampoing, la purification par l’eau glacée, et bien sûr Baptiste au prénom symbolique s’enfonçant dans la vase, l’élément liquide est partout. Comme si le temps chassait les miasmes de l’enfance et établissait les bases d’une existence consolidée par l’amitié.
Jean-Pierre Longre
10:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hugo lindenberg, christian bourgois éditeur, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2021
« L’aphorisme, cette phrase solitaire »
 Paul Lambda, Le désespoir, avec modération, Cactus Inébranlable éditions, 2021
Paul Lambda, Le désespoir, avec modération, Cactus Inébranlable éditions, 2021
Le titre de l’ouvrage nous l’indique : il faut le consommer à doses raisonnables, comme l’alcool, comme les médicaments, et c’est ainsi que le désespoir peut se muer en plaisir. Et disons-le, la forme encourage ce type de consommation, l’aphorisme étant forcément isolé de ses congénères – ce qui fait que tout résumé de ce genre de livre est impossible.
Tout juste pouvons-nous déceler des retours thématiques ou formels, et les illustrer. La subtilité (« Ils n’ont rien fait de l’après-midi mais apparemment ce n’est pas le même rien. ») n’est pas éloignée de l’absurde (« Ce n’est pas vraiment de leur faute, tu sais : comment auraient-ils pu prévoir qu’en se rencontrant, ils se traverseraient ? »), et la poésie (« Un silence plein de cigales » ou « En attendant la fin du monde, la bruyère est en fleurs. ») voisine avec l’humour (« – Oh vous savez, je ne suis rien ni personne. – Prétentieux. » ou « Le temps fuit et ce plombier qui ne vient pas. ») ; il faut dire que « La poésie ne sert à rien mais elle y contribue. » Et lorsque le fantastique est trop affolant (« Catastrophe ! La montagne a fondu avec la neige. »), c’est la philosophie qui prend le pas (« Le suivant tel un caniche bien dressé, son destin. » ou « J’ai une mauvaise et une bonne nouvelle : j’ai trouvé le sens de la vie, il n’y en a aucun. »)
On surprend çà et là quelques mots qui résument l’enjeu du livre et l’ambition plus ou moins claire de l’auteur : « J’ai le monde au bout de la langue. » Et c’est vrai, mine de rien, le monde entier s’impose dès le début grâce aux mots, puisqu’on commence avec deux événements d’importance (des oiseaux qui s’envolent, d’autres qui se posent) arrivant en même temps à Paris et au Mexique ; il y en a d’autres, qui nous font « enjamber l’horizon », entre Budapest et Gdansk ou entre le Groenland et Berlin… Il paraît que Paul Lambda, qui est aussi l’auteur, entre autres, du Cabinet Lambda, 5014 citations à siroter, croquer, injecter ou infuser, n’est ni belge ni surréaliste. Osons dire que, pourtant, il mériterait de l’être.
Chez le même éditeur : André Stas, Tout est relatif (et tondu) ; Patrick Henin-Miris, Zadigacités
 Tout est relatif (et tondu) est un livre signé par un auteur qui, lui, est à la fois belge et surréaliste, pataphysicien et humoriste, digne disciple de Nougé, Scutenaire, Chavée ou Blavier… Lui nous l’avoue tout crûment, « Les recueils d’aphorismes sont des œuvres de cabinet. » (à comprendre comme on le sent), et relativise l’ambition de la création littéraire : « Les cons signent. Et on devrait les respecter… » C’est tout à sa gloire.
Tout est relatif (et tondu) est un livre signé par un auteur qui, lui, est à la fois belge et surréaliste, pataphysicien et humoriste, digne disciple de Nougé, Scutenaire, Chavée ou Blavier… Lui nous l’avoue tout crûment, « Les recueils d’aphorismes sont des œuvres de cabinet. » (à comprendre comme on le sent), et relativise l’ambition de la création littéraire : « Les cons signent. Et on devrait les respecter… » C’est tout à sa gloire.
 Zadigacités vient aussi d’être publié par le prolifique Cactus Inébranlable. Pas d’aphorismes, cette fois, mais des sortes de contes très courts (une demi page au maximum). Pour terminer cette chronique, voici un encouragement à la lecture, intitulé « Voyage » : « Partout on repeignait les façades en vives couleurs. On plantait des arbres, et surtout des fruitiers pour l’été ou l’automne. On ouvrait des routes qui menaient à de vastes paysages de mer ou de montagne. De nombreux personnages lumineux et désirables se promenaient de tous côtés, comme sur une riche scène de théâtre. Il n’en revenait pas de toutes ces merveilles, la tête lui tournait, et il n’avait encore lu que trois pages. » Poursuivons avec lui.
Zadigacités vient aussi d’être publié par le prolifique Cactus Inébranlable. Pas d’aphorismes, cette fois, mais des sortes de contes très courts (une demi page au maximum). Pour terminer cette chronique, voici un encouragement à la lecture, intitulé « Voyage » : « Partout on repeignait les façades en vives couleurs. On plantait des arbres, et surtout des fruitiers pour l’été ou l’automne. On ouvrait des routes qui menaient à de vastes paysages de mer ou de montagne. De nombreux personnages lumineux et désirables se promenaient de tous côtés, comme sur une riche scène de théâtre. Il n’en revenait pas de toutes ces merveilles, la tête lui tournait, et il n’avait encore lu que trois pages. » Poursuivons avec lui.
Jean-Pierre Longre
16:18 Publié dans Humour, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aphorisme, conte, humour, francophone, paul lambda, andré stas, patrick henin-miris, cactus inébranlable éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/12/2021
Amours virtuelles et mort réelle
 Christian Cogné, Éclats d’Éros sous Covid-19, ETT Borderline, 2021
Christian Cogné, Éclats d’Éros sous Covid-19, ETT Borderline, 2021
Les romanciers à succès utilisent des ingrédients bien connus, qui font toujours recette : Éros et Thanatos en contextes familiers, la séduction et le meurtre, le suspense et le dénouement surprenant… Il y a tout cela dans le livre de Christian Cogné, mais il y a aussi d’autres caractéristiques qui en font l’originalité.
Pour résumer : en novembre 2020, pendant le second confinement « sous Covid-19 », Christophe Picard, retraité de l’enseignement, échange des messages électroniques de plus en plus brûlants avec une jeune femme, Laura, qui l’encourage dans une escalade érotique qu’il ne se prive pas d’accomplir audacieusement – et verbalement bien sûr, puisque l’une est en Normandie, l’autre à Paris, et que les déplacements sont interdits. Mais à la fin du mois, plus de nouvelles de Laura. Que s’est-il passé ? Elle a été retrouvée morte, étranglée, à l’endroit où elle avait l’habitude de faire son jogging, entre Yport et Fécamp. Arrêté par la police qui le confronte à leurs échanges de correspondance et à des sortes d’indices, Christophe Picard nie toute implication dans ce meurtre, et niera constamment, malgré les interrogatoires serrés menés par le commandant de police Steiner, qui d’ailleurs, dans sa vie sentimentale, n’est pas sans se sentir concerné par cette affaire.
Bref, un rapport de force s’établit, mettant au jour les états d’âme de Christophe Picard, qui fait un aveu qui n’est pas celui qu’attend le policier : « Je l’ai tuée en l’oubliant comme j’ai oublié les écrits qu’elle m’a inspirés. Alors oui, je l’ai tuée si c’est un crime de perdre le fil de soi-même et de l’autre. » On ne s’en tient donc pas ici à la simple intrigue policière. L’enjeu est complexe : rapports amoureux et fuite du temps, fantasmes inassouvis et perte des repères, réalité virtuelle et rêves inaccomplis… Tout cela sur fond de pandémie, qui fait redouter le triomphe de Thanatos sur Éros. Et puis, comme l’écrit Christophe Picard au commandant Steiner à la fin d’un « texte poétique » : « Il faut se méfier des très jeunes femmes, comme des barques endormies sur les galets, elles contiennent leurs lots de naufrages innocents. » Christophe Picard, homme ordinaire, à l’image de tout homme, naufragé plus ou moins volontaire, s’est laissé prendre dans une tempête qu’il a provoquée et qu’il n’a pas maîtrisée.
Jean-Pierre Longre
17:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, christian cogné, ett borderline, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/11/2021
Un lourd héritage
 Jean-Paul Dubois, La succession, Éditions de l’Olivier, 2016, Points, 2017, rééd. 2021
Jean-Paul Dubois, La succession, Éditions de l’Olivier, 2016, Points, 2017, rééd. 2021
En lisant ce roman de Jean-Paul Dubois, vous saurez tout sur la pelote basque et la vie des « pelotari » professionnels de Miami, leurs maigres salaires et la « grande grève » qu’ils menèrent en 1988. Vous saurez tout sur la Triumph Vitesse MK2, sur la Karmann Ghia, sur le dernier des quaggas, ces drôles de zèbres, sur le prétendu « complot des blouses blanches » fabriqué par Beria à la mort de Staline, sur la tentative d’assassinat de Roosevelt par le maçon Zangara, sur les hespérophanes et sur bien d’autres choses encore, dont l’art de se suicider.
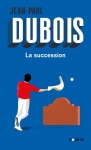 À part le dernier point, ce n’est pas l’essentiel, loin s’en faut, mais cela fait partie du tout romanesque. L’auteur a l’art de raconter des histoires ébouriffées tournant autour d’un axe solide, généralement un personnage prénommé Paul, menant ce qui est pour lui une vie normale, pour d’autres une vie étrange. « Qu’est-ce qui cloche chez toi ? », comme le répète régulièrement son amie Soraya au protagoniste de La succession. Paul Katrakilis, médecin sans patients et surtout joueur de pelote basque, se souvient des quatre années où il fut « un homme profondément heureux, comblé en toutes choses », entre 1983 et 1987. Il exerçait alors le seul métier qui lui plaisait, vivait en parfaite harmonie avec un petit chien qu’il avait sauvé de la noyade, jouissait de la solide amitié d’Epifanio, pelotari comme lui, était tombé sous le charme d’une splendide norvégienne en pleine maturité, menait avec jubilation sa Karmann sur les routes de Floride et son vieux petit bateau le long des côtes…
À part le dernier point, ce n’est pas l’essentiel, loin s’en faut, mais cela fait partie du tout romanesque. L’auteur a l’art de raconter des histoires ébouriffées tournant autour d’un axe solide, généralement un personnage prénommé Paul, menant ce qui est pour lui une vie normale, pour d’autres une vie étrange. « Qu’est-ce qui cloche chez toi ? », comme le répète régulièrement son amie Soraya au protagoniste de La succession. Paul Katrakilis, médecin sans patients et surtout joueur de pelote basque, se souvient des quatre années où il fut « un homme profondément heureux, comblé en toutes choses », entre 1983 et 1987. Il exerçait alors le seul métier qui lui plaisait, vivait en parfaite harmonie avec un petit chien qu’il avait sauvé de la noyade, jouissait de la solide amitié d’Epifanio, pelotari comme lui, était tombé sous le charme d’une splendide norvégienne en pleine maturité, menait avec jubilation sa Karmann sur les routes de Floride et son vieux petit bateau le long des côtes…
 Quatre années qui durent s’interrompre pour un retour à Toulouse, dans la grande maison pleine des fantômes familiaux. Un lourd héritage pèse sur Paul : les suicides de son grand-père, paraît-il ancien médecin de Staline, de sa mère et de son oncle qui ne pouvaient se passer l’un de l’autre, enfin de son père… Ce père médecin qui avait prévu que son fils prenne sa suite. C’est ce que Paul va se risquer à faire : rouvrir le cabinet Katrakilis, recevoir et visiter les malades, en une « succession » qui ira plus loin que ce qu’il avait pensé. « J’avais 44 ans, la vie sociale d’un guéridon, une vie amoureuse frappée du syndrome de Guillain-Barré et je pratiquais avec application et rigueur un métier estimable mais pour lequel je n’étais pas fait. ». Un métier qui le conduira jusqu'au partage des secrets de son père.
Quatre années qui durent s’interrompre pour un retour à Toulouse, dans la grande maison pleine des fantômes familiaux. Un lourd héritage pèse sur Paul : les suicides de son grand-père, paraît-il ancien médecin de Staline, de sa mère et de son oncle qui ne pouvaient se passer l’un de l’autre, enfin de son père… Ce père médecin qui avait prévu que son fils prenne sa suite. C’est ce que Paul va se risquer à faire : rouvrir le cabinet Katrakilis, recevoir et visiter les malades, en une « succession » qui ira plus loin que ce qu’il avait pensé. « J’avais 44 ans, la vie sociale d’un guéridon, une vie amoureuse frappée du syndrome de Guillain-Barré et je pratiquais avec application et rigueur un métier estimable mais pour lequel je n’étais pas fait. ». Un métier qui le conduira jusqu'au partage des secrets de son père.
Jean-Paul Dubois sait réunir dans un même mouvement narratif l’humour et le désespoir, sait superposer le bonheur d’exister et le malheur de vivre, la chaleur humaine et la méchanceté des hommes. La succession le prouve brillamment.
Jean-Pierre Longre
19:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, Éditions de l’olivier, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/11/2021
La parole brute du théâtre
 Eléna Gremina, Mikhaïl Ougarov, Une heure et dix-huit minutes ; Septembre.doc, traduit du russe par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel, éditions L’espace d’un instant, 2021
Eléna Gremina, Mikhaïl Ougarov, Une heure et dix-huit minutes ; Septembre.doc, traduit du russe par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel, éditions L’espace d’un instant, 2021
Eléna Gremina et Mikhaïl Ougarov (tous deux nés en 1956 et morts en 2018) combattaient contre les abus et les violences du pouvoir russe. Un engagement concret, constant, pour lequel ils utilisaient « le moyen qui était le leur, la scène » – et ce d’une manière originale, rompant avec les traditions. Les deux pièces publiées ici manifestent cet engagement et cette originalité, puisqu’elles sont en prise directe avec l’histoire récente, exploitant documents et témoignages. Cécile Vaissié, dans sa préface, explique clairement comment est né le Théâtre.doc de Moscou, « l’un des très rares théâtres financièrement indépendants de Russie », et dit comment les deux pièces « illustrent l’approche artistique » de ce théâtre en s’appuyant « sur des matériaux bruts. »
Une heure et dix-huit minutes, qui utilise entre autres documents les carnets et les lettres de Sergueï Magnitski, relate comment celui-ci, en 2009, est mort en prison à la suite de tortures, de mauvais traitements et d’une agonie d’une heure et dix-huit minutes. La pièce se divise en « rubriques » mettant en scène les monologues de personnes réelles accusées initialement par la mère du défunt : juge d’instruction, procureur, directeur et médecins de la prison, tous responsables des souffrances et de la mort de Magnitski, et montrés dans toute leur lâcheté, leur iniquité, tentant de dégager leur responsabilité, à l’image du médecin qui ne se dit plus soumis au Serment d’Hippocrate, mais au « Serment du médecin russe », ou à celle de la juge Stachina, qui nie être un être humain, mais se dit « l’instrument de la volonté de l’État. »
Septembre.doc est un patchwork d’interventions collectées « sur divers forums internet tchétchènes, ossètes et russes » à la suite des événements sanglants survenus dans une école de Beslan (Ossétie du Nord) en septembre 2004 : plus de trois cents morts provoqués par l’intervention des forces armées russes contre des terroristes tchétchènes ayant pris en otages un millier d’enfants et leurs parents. Toutes les opinions, toutes les émotions, toutes les réactions s’expriment de la part d’un population très diverse, Russes, Ossètes, Tchétchènes, Ingouches, musulmans, orthodoxes, athées, progressistes, fascistes, et tous les types de langage, du plus pensé au plus épidermique, du plus respectueux au plus insultant, du plus correct au plus crû, sont reproduits tels quels. Au public de s’y retrouver, de se faire ses idées, de se construire sa propre vérité face à ce puzzle verbal.
Théâtre document, théâtre de paroles, théâtre témoignage ? Théâtre en tout cas percutant, dont le réalisme à l’état brut, poussé jusqu’au bout de l’odieux et de l’absurde, joue pleinement son rôle. L’œuvre d’art engage non seulement les auteurs et les acteurs, mais aussi les personnages et leurs mots fidèlement représentés, et bien sûr les spectateurs ainsi pleinement sollicités.
Jean-Pierre Longre
Autres parutions aux éditions L’espace d’un instant :
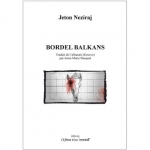 Jeton Neziraj, Bordel Balkans, traduit de l’albanais (Kosovo) par Anne-Marie Bucquet
Jeton Neziraj, Bordel Balkans, traduit de l’albanais (Kosovo) par Anne-Marie Bucquet
« Bordel Balkans est une réécriture de L'Orestie d'Eschyle, traitée de manière très contemporaine. Agamemnon, chef de guerre sanguinaire, est de retour des champs de bataille de l'ex-Yougoslavie. Il retrouve sa femme, Clytemnestre, qui s'est occupée de leur hôtel-bar « Balkan Express » pendant sa longue absence. Ainsi commence l'enchaînement fatal des causalités liées au destin des Atrides. Énergie kaléidoscopique de cette tragédie musicale où alternent imprécations et lamentations, chants populaires, interludes comiques et commentaires du chœur, en une sarabande effrénée dans laquelle tous les personnages sont entraînés jusqu'à l'incendie final purificateur. »
« Jeton Neziraj est né en 1977 au Kosovo. Dramaturge et scénariste, ses œuvres ont été présentées dans une quinzaine de langues en Europe et en Amérique du Nord, du théâtre national d’Istanbul à La MaMa à New York, en passant par le Vidy à Lausanne et le Piccolo à Milan. Il a été directeur du Théâtre national du Kosovo de 2008 à 2011 et dirige actuellement le Qendra Multimedia, principal pôle culturel indépendant de l’espace albanophone, qu’il a fondé en 2002. Censurée en Chine, son œuvre est très impliquée socialement et politiquement. »
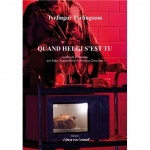 Tyrfingur Tyrfingsson, Quand Helgi s’est tu, traduit de l’islandais par Raka Ásgeirsdóttir et Séverine Deaucourt
Tyrfingur Tyrfingsson, Quand Helgi s’est tu, traduit de l’islandais par Raka Ásgeirsdóttir et Séverine Deaucourt
« L'écriture de Tyrfingur Tyrfingsson détone, elle est immorale, vivifiante et drôle. Ses personnages ne suscitent pas l'empathie, ils sont des figures dévastées d'une société insensée et corrompue. [...] Dans Quand Helgi s'est tu, on joue sans cesse avec la mort, on ne la respecte pas, on s'en moque. À la morgue, chacun, chacune est face à sa condition humaine. Dans l'entreprise familiale de pompes funèbres, tout est fric et corruption, la mort est un marché comme un autre, et le père et le fils, thanatopracteurs, sont de petits escrocs infantiles. L'image courante de l'Islande, celle d'un pays évolué et solidaire, à la démocratie modèle, avec sa nature sauvage et sa magie mystérieuse, est totalement renversée. »
« Tyrfingur Tyrfingsson est né en Islande en 1987. Il a étudié à l'Académie des arts d'Islande et à la Goldsmiths University de Londres. Sa première pièce lui a immédiatement valu la première de ses cinq nominations aux Griman islandais. Depuis 2011, ses textes sont créés au Théâtre de la ville de Reykjavik et au Théâtre national d'Islande. En français, ses textes ont été présentés à partir de 2018 au Festival d'Avignon, au Théâtre 13 à Paris et à la Mousson d'été. Préface de Véronique Bellegarde. Avec le concours de la Maison Antoine-Vitez et du Centre national du livre. »
https://www.sildav.org/editions-lespace-dun-instant/prese...
11:07 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, russie, kosovo, islande, eléna gremina, mikhaïl ougarov, jeton neziraj, anne-marie bucquet, tyrfingur tyrfingsson, raka Ásgeirsdóttir, séverine deaucourt, éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/10/2021
Détective et écrivain
 Lire, relire... Patrick Modiano, Encre sympathique, Gallimard, 2019, Folio, 2021
Lire, relire... Patrick Modiano, Encre sympathique, Gallimard, 2019, Folio, 2021
« J’avais toujours eu le goût de m’introduire dans la vie des autres, par curiosité et aussi par un besoin de mieux les comprendre et de démêler les fils embrouillés de leur vie – ce qu’ils étaient souvent incapables de faire eux-mêmes parce qu’ils vivaient leur vie de trop près alors que j’avais l’avantage d’être un simple spectateur, ou plutôt un témoin ». Cet aveu du narrateur, apprenti détective, est aussi un aveu de l'auteur ; et dans ce nouveau roman, il profite de l’intrigue pour narrer effectivement le passage de l’enquête à l’écriture.
 Cette enquête porte sur une certaine Noëlle Lefebvre, qu’il a eu jadis consigne de retrouver à partir de quelques bribes d’informations – une carte de poste restante, une photo… Peu à peu, quelques pistes se dessinent : des noms supplémentaires, un calepin, mais aussi beaucoup de blancs qui recouvrent peut-être des explications précises, des « mystères éclaircis », comme écrits à l’encre sympathique.
Cette enquête porte sur une certaine Noëlle Lefebvre, qu’il a eu jadis consigne de retrouver à partir de quelques bribes d’informations – une carte de poste restante, une photo… Peu à peu, quelques pistes se dessinent : des noms supplémentaires, un calepin, mais aussi beaucoup de blancs qui recouvrent peut-être des explications précises, des « mystères éclaircis », comme écrits à l’encre sympathique.
Régulièrement et longtemps après, le narrateur, se souvenant de ses tâtonnements anciens, voudrait faire le point, reprendre dans l’ordre chronologique, pousser les recherches grâce aux procédés modernes. Mais ça ne marche pas. « Aujourd’hui, j’entame la soixante-troisième page de ce livre en me disant que l’Internet ne m’est d’aucun secours. […] Tant mieux, car il n’y aurait plus matière à écrire un livre. Il suffirait de recopier des phrases qui apparaissent sur un écran, sans le moindre effort d’imagination. ». Belle vérité de l’écrivain, pour lequel l’enquête est, on l’aura compris, simple matière à littérature.
C’est bien cela : chez Patrick Modiano, on suit des traces, on entend l’écho de faits divers, il y a des explorations urbaines, des voyages même (ici, on passe dans l’’espace et le temps par Paris, Annecy, Rome…). Tous les ingrédients du roman policier. Mais non : Encre sympathique révèle ce que cherche l’écriture : rompre le silence, aller au-delà des mots et des noms (il y en a une belle série au fil des pages), mieux connaître la vie et les êtres, les sortir « du néant » que sont le passé, l’éloignement et l’absence, tout en laissant leur liberté à la fuite et aux secrets : « Ne serait-il pas préférable de laisser autour de soi des terrains vagues où l’on puisse s’échapper ? ».
Jean-Pierre Longre
www.folio-lesite.fr
18:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick modiano, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/10/2021
Souvenirs choisis
 Marius Daniel Popescu, Le Persil n° 187, juin 2021
Marius Daniel Popescu, Le Persil n° 187, juin 2021
Marius Daniel Popescu, dans un élan permanent d’altruisme littéraire, ouvre habituellement les pages de son Persil à toutes sortes d’écrivains, de Suisse romande ou d’ailleurs, confirmés ou débutants, connus ou méconnus. Une fois n’est pas coutume : le numéro 187 est consacré uniquement à des textes inédits de sa propre plume. Et l’on n’est pas déçu. Dans la ligne de La symphonie du loup et de Les couleurs de l’hirondelle, mais aussi de ses Arrêts déplacés, les quatre récits d’inégale longueur qu’il nous offre ici fouillent dans les souvenirs d’un « tu » qui ne dévoile pas son identité, que l’on devine tout de même, des récits dont, la plupart du temps, l’action se déroule dans « le pays du parti unique » ou dans ce qu’il est devenu, et dont on devine aussi le nom…
 « Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret.
« Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret.
Dénouement d’un humour aussi surprenant pour le récit suivant, qui commence pourtant d’une manière dramatique, puisque le « parti unique » a décidé de détruire la maison du grand-père, qui demande à son petit-fils de l’aider à déménager ses meubles – ce qui se fera avec l’aide clandestine d’un oncle et d’un ami chauffeur : « Cet homme faisait souvent des transports illégaux, il était de mèche avec des policiers du parti unique, le pays était devenu un pays au noir. » Mais où entreposer les meubles ? C’est à ce propos que le même « tu » trouve une idée à la fois pratique, drôle et poétique, à l’occasion de Noël. Le lecteur découvrira ce garde-meubles original.
Le troisième texte, dont l’action se déroule après la chute du « parti unique », est paradoxalement le plus triste, puisqu’il relate la mort soudaine d’un ami survenue dans le « Musée d’Art de la Ville » : « Tu le connais depuis tes études universitaires en sylviculture, tu le connaissais depuis trente-six ans. Il n’a pas pu se faire opérer, dans ton pays de là-bas les médecins demandent des pots de vin pour des bricoles et pour des choses importantes ». Mais c’est l’occasion de quelques réflexions sur la mort (« La mort a une faiblesse, elle nous unit, elle est toujours embarrassée par les liens qu’elle crée entre nous »), sur l’amitié et sur la complicité rieuse – car au-delà de l’idée de la mort, le rire bien arrosé ponctue la vie et même la littérature : allusion au « persil » (plante ou journal littéraire) : « Les bières, elles étaient pour ta soif, il fallait que le persil soit arrosé régulièrement. » Malgré cela, malgré les blagues et les facéties, l’ami « est parti dans l’au-delà ».
Dans le quatrième texte, très bref, nous revenons dans « le pays d’ici », celui où vit maintenant l’auteur, avec une belle histoire de solidarité et de générosité. Et c’est une confirmation de ce qui court, en filigrane ou en clair, tout au long de la prose de Marius Daniel Popescu : la générosité, humaine et verbale (les deux vont ensemble). Les descriptions précises, le soin mis à entrer dans le détail des gestes, des objets, des relations humaines, le souci de tout dire, d’emplir la page de mots précis relèvent de l’intérêt pour les autres et du désintéressement fertile qui président aux publications – périodiques ou livresques – de l’auteur, ainsi que de l’ardeur existentielle : « La vie nous offre plein de mauvaises surprises, il faut survivre à tout, il faut toujours être capable de partir de zéro. »
Jean-Pierre Longre
www.facebook.com/journallitterairelepersil
Le persil journal, Marius Daniel Popescu, avenue de Floréal 16, 1008 Prilly, Suisse.
Tél. +41.21.626.18.79.
E-mail : mdpecrivain@yahoo.fr
Association des Amis du journal Le persil : lepersil@hotmail.com
11:42 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, autobiographie, francophone, suisse, roumanie, le persil, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/10/2021
Au-delà du surréalisme
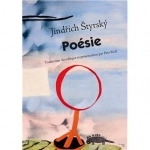 Jindŗich Štyrský, Poésie, édition bilingue, traduction du tchèque par Petr Král, Ab irato éditions, 2021.
Jindŗich Štyrský, Poésie, édition bilingue, traduction du tchèque par Petr Král, Ab irato éditions, 2021.
Jindŗich Štyrský (1899-1942) fut une figure marquante du surréalisme tchèque. Inventeur avec son amie Toyen de l’« artificialisme », il était un artiste multiple (peintre, collagiste, photographe, poète) et un théoricien reconnu. Il faut donc saluer la parution de cet ouvrage bilingue, traduit par Petr Král (1941-2020), écrivain tchèque installé à Paris en 1968, lauréat du grand prix de la Francophonie de l’Académie française en 2019. Poésie est la première édition en français du recueil publié sous le même titre en 1946.
Les textes de Jindŗich Štyrský se situent pour une part dans la lignée du surréalisme défini par André Breton dans ses manifestes. Images insolites (« Cette montagne de sentiments / Couchait sur elle-même comme des crêpes / Paresseuse immobile / Jusqu’à accoucher »), associations aléatoires (« Terre / Ceinture / Galbe » ou « Les feuilles tombaient dans les paniers / De pipes / De lacs / Et de chapeaux »), traces d’écriture automatique et souvenirs de rêves mêlant par exemple des éléphants, de la neige, un trio royal et des chameaux – tous ces signes, d’autres encore, marquent une appartenance, d’ailleurs assumée, puisque l’auteur fut l’un des cofondateurs en 1934 du groupe surréaliste de Prague.
Mais la poésie, la vraie, ne naît pas d’une appartenance, et celle de Jindŗich Štyrský dépasse le surréalisme. Il y a chez lui des marques personnelles qui situent son art dans un territoire inclassable, entre logique et déraison, entre réalisme et onirisme, entre deux eaux : voir par exemple « Dans les marécages », où se cherche « le bonheur tête noire », ou bien « Il s’endort et parle », entre veille et sommeil : « Il vit et on ne saurait le suivre / […] Autour de la vie réglée / Tournent des pensées de vinaigre / Logiques claires ». Dans un autre ordre d’idées, pas tellement éloigné, la poésie et l’énigme résident aussi dans les titres des textes, annonçant à eux seuls un programme qui n’est pas forcément respecté ; qu’attend-on après « Étrange mort de la femme d’un boucher dans le département X », « Entends-tu les clochettes de l’arrivée ? » ou « Jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un cube de margarine douteuse » ? Voilà qui annonce les « Fragments » finaux, sous la fulgurance desquels le lecteur peut se laisser aller à vagabonder, prendre peur, sourire… Avant cela, un long texte au titre paradoxal (« Le monde devient de plus en plus petit ») plante son décor mémoriel (« Quelques fleurs séchées, insérées par une main frêle parmi les feuilles d’un livre et des photos pâlissantes, voici les seuls souvenirs qui me restent. »), et rappelle une double thématique éternelle qui, renouvelée, parcourt tout le recueil : l’amour (l’érotisme) et la mort (la disparition), commencement et fin de tout.
Jean-Pierre Longre
https://abiratoeditions.wordpress.com
En complément, voir: http://jplongre.hautetfort.com/archive/2017/07/27/les-par...
09:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, tchèque, jindŗich Štyrský, petr král, ab irato éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/10/2021
Les affres du voisinage
 Lire, relire... Julia Deck, Propriété privée, Les éditions de minuit, 2019, Minuit "double", 2021
Lire, relire... Julia Deck, Propriété privée, Les éditions de minuit, 2019, Minuit "double", 2021
Dans l’esprit contemporain, c’est un lieu parfait : une allée bordée de huit maisons mitoyennes, quatre de chaque côté, « entièrement autonome en énergie », située dans une banlieue proche du RER et des commodités. Eva et Charles Caradec réalisent leur rêve en emménageant en toute confiance dans cet écoquartier. Ce faisant, ils mettent un doigt dans un engrenage fatal : à côté d’eux vient s’installer un couple avec bébé et gros chat rouquin, les Lecoq ; elle, Annabelle, provocante et sans-gêne ; lui, Arnaud, agent immobilier affairiste et sûr de lui – tous deux envahissants, ignorant tout scrupule, toute vergogne et toute discrétion.
Ainsi résumé, ce début pourrait inaugurer une banale histoire de voisinage comme il y en a beaucoup, tragique et risible à la fois. Mais même si Julia Deck a choisi d’utiliser le registre réaliste (à décrypter tout de même au second degré), ne passant sous silence ni le portrait de tous les résidents, ni les relations fluctuantes qu’ils entretiennent entre eux, ni les déboires qu’ils ont avec le système de chauffage collectif, les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît. Charles, qui souffre de « troubles compulsifs » et voit périodiquement sa psychiatre, ne travaille pratiquement pas et reste le plus souvent replié sur lui-même. Eva, dont la narration s’adresse à son mari, est une architecte d’avant-garde qui travaille sur un projet parisien destiné à « densifier le bâti pour maximiser le rendement foncier », autrement dit à supprimer de la verdure et à chasser les habitants de leur quartier… Couple particulier, donc, qui va devoir se frotter à d’autres couples particuliers, forgés par leurs habitudes et leurs contradictions.
 Tout cela se déroule d’une manière plus ou moins bancale, jusqu’au jour où l’on découvre le chat des Lecoq éventré, à la grande satisfaction de Charles, qui (on l’apprend dès les premières lignes) avait fomenté le projet de ce forfait, sans toutefois passer à l'acte. L’atmosphère devient irrespirable, et le couple Caradec pense à revendre sa maison. Annabelle, qu’on n’a pas revue depuis un certain temps, semble avoir disparu, tandis que son mari vit sa vie quasi normalement. Questions, soupçons dans l’allée, et un jour la police vient arrêter Charles, arguant de faits troublants dans son emploi du temps. Enquête, avocat, examen de coïncidences, révélations de voisins… Eva ne sait plus comment sortir son mari de ce piège et se sortir elle-même du cauchemar. « Je participais à un drame terrifiant, il altérait mes perceptions ». Et jusqu’à la fin, particulièrement explosive, nos perceptions à nous, lecteurs, s’altèrent de plus en plus. Car Propriété privée (titre manifestement ironique), récit aux fausses allures feuilletonesques et policières, tient plutôt du roman parodique dans le ton, le lexique, le style et la teneur, dénonçant les bonheurs factices et les aberrations sociales de notre époque.
Tout cela se déroule d’une manière plus ou moins bancale, jusqu’au jour où l’on découvre le chat des Lecoq éventré, à la grande satisfaction de Charles, qui (on l’apprend dès les premières lignes) avait fomenté le projet de ce forfait, sans toutefois passer à l'acte. L’atmosphère devient irrespirable, et le couple Caradec pense à revendre sa maison. Annabelle, qu’on n’a pas revue depuis un certain temps, semble avoir disparu, tandis que son mari vit sa vie quasi normalement. Questions, soupçons dans l’allée, et un jour la police vient arrêter Charles, arguant de faits troublants dans son emploi du temps. Enquête, avocat, examen de coïncidences, révélations de voisins… Eva ne sait plus comment sortir son mari de ce piège et se sortir elle-même du cauchemar. « Je participais à un drame terrifiant, il altérait mes perceptions ». Et jusqu’à la fin, particulièrement explosive, nos perceptions à nous, lecteurs, s’altèrent de plus en plus. Car Propriété privée (titre manifestement ironique), récit aux fausses allures feuilletonesques et policières, tient plutôt du roman parodique dans le ton, le lexique, le style et la teneur, dénonçant les bonheurs factices et les aberrations sociales de notre époque.
Jean-Pierre Longre
09:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, julia deck, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/09/2021
Ambitions et illusions
 Florian Forestier, Basculer, Belfond, 2021
Florian Forestier, Basculer, Belfond, 2021
Daniel Fresse a disparu dans le massif des Écrins. Mais par la magie de l’artifice romanesque et du changement de point de vue, nous savons qu’il est tombé dans une crevasse, et que du fond de cette crevasse il retrace les péripéties de sa vie de jeune énarque circulant, malgré sa soif d’aventures lointaines, entre les sphères du pouvoir politique et son intérêt pour des groupes alternatifs, sur fond de crise sanitaire. En début de carrière, il avait comme ses amis des espoirs : « Le désir d’infléchir un tant soit peu les choses et les projets de carrière se mêle en un même avenir, que leur nomination comme sous-directeurs commence à esquisser. » De l’énergie, de l’ambition, des illusions sans doute.
Florian Forestier, qui semble bien connaître ce qui se passe dans les cabinets ministériels français, chez les éminences grises, les attachés, les communicants, nous fait pénétrer avec une once d’ironie dans ce microcosme et ses arcanes. Mais il ne s’agit pas que de faire la satire des arrière-boutiques du jeu politique. Il s’agit de montrer comment le « basculement » s’opère, à l’occasion d’une pandémie et du dérèglement climatique, mais aussi à cause de l’envahissement galopant des réseaux sociaux, où se multiplient les commentaires sur le moindre événement. « Il y a ceux qui trouvent qu’on n’en fait pas assez. Ceux qui s’indignent. Et tous les De Gaulle des réseaux sociaux qui lancent leur petit appel du 18 juin. La plupart se contentent de quelques lignes. » D’autres se répandent longuement, lancent des insultes… À côté de Daniel s’agitent maints personnages, femmes et hommes dont les ambitions sont réelles, bien que diverses, et qui jouent parfois leur réputation et leur vie à tenter de les satisfaire. Vies personnelles et vies publiques s’imbriquent, se répondent, s’entrechoquent – et au-delà du foisonnement de détails sur ces vies et les illusions qui les accompagnent, nous sentons que c’est l’existence humaine qui est en jeu, comme l’existence de Daniel dans sa crevasse.
Avec ce premier roman, Florian Forestier, philosophe suisse qui travaille « sur les enjeux des transitions numérique et écologique », ne se contente pas de mettre ses connaissances au service de la fiction et de proposer un récit où se mêlent réalisme et suspense politico-écologique. Il manifeste un vrai talent littéraire, faisant voisiner l’analyse de la fébrilité sociale et médiatique avec les évocations symboliques et poétiques, urbaines ou montagnardes. « Il a coupé droit à travers les roches qui jalonnent le haut du plateau. Ainsi, il a rejoint un col creusé comme un trône de pierre entre deux falaises. Sous lui, très bas, s’étendent des collines et des bois s’abîmant vers le creux de la vallée centrale. » On bascule d’un monde à l’autre, dans le temps comme dans l’espace.
Jean-Pierre Longre
22:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, florian forestier, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/09/2021
L’enfant et l’homme-oiseau
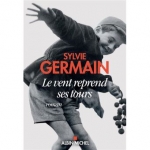 Lire, relire... Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours, Albin Michel, 2019, Le livre de poche, 2021
Lire, relire... Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours, Albin Michel, 2019, Le livre de poche, 2021
Nathan, enfant inattendu, venu au monde comme un intrus, un « fantôme », a été élevé non sans soins, mais sans véritable amour, par sa mère Elda. En grandissant, il se met à fuir les autres, pris d’une sorte de bégaiement qui le laisse « bouche entrouverte, les yeux embués, l’air ahuri », et qui en fait la risée de ses congénères. Or au cours de sa dixième année, sa mère remarque que son « trouble » disparaît. « L’enfant timoré et bredouillant est même devenu plus ouvert, presque bavard et enjoué par moments, utilisant des mots insolites, des tournures biscornues ou inhabituelles, citant des vers dont elle n’était pas sûre qu’il en saisît toujours le sens. ». L’explication de cette renaissance ? Il a rencontré Gavril, « saltimbanque monté sur des échasses », débiteur de syllabes incongrues, tripatouilleur de mots et de poèmes qu’il murmure à travers une espèce de tube qu’il nomme « poèmophone », homme-orchestre, joueur d’ « olifantastique » et autres instruments étranges…
 Une amitié complice naît entre eux, et alors commencent pour Nathan les « années Gavril », homme au passé tourmenté, qui a connu les dictatures, la violence, l’exil, et qui vivote de boulots précaires tout en versant du côté de la joie de vivre et de la fantaisie avec ses spectacles de rue. Sa fréquentation assidue bien qu’irrégulière a permis au garçon d’échapper « à l’ennui, à la routine, et surtout à la solitude et à l’inquiétude », et de développer son imagination, de « dynamiser ses pensées, ses rêves ».
Une amitié complice naît entre eux, et alors commencent pour Nathan les « années Gavril », homme au passé tourmenté, qui a connu les dictatures, la violence, l’exil, et qui vivote de boulots précaires tout en versant du côté de la joie de vivre et de la fantaisie avec ses spectacles de rue. Sa fréquentation assidue bien qu’irrégulière a permis au garçon d’échapper « à l’ennui, à la routine, et surtout à la solitude et à l’inquiétude », et de développer son imagination, de « dynamiser ses pensées, ses rêves ».
De nombreuses années plus tard, en 2015, alors que la morne vie de Nathan ne s’est pas remise de ce qu’il croyait être la mort de son « homme-oiseau » dans un accident de moto dont il se juge responsable, il apprend que Gavril, qui était resté en vie, vient de disparaître de l’hôpital où il végétait, et qu’il est mort noyé dans la Seine. Taraudé par le remords de n’avoir rien su, à cause d’un mensonge, pense-t-il, de sa mère, il entame une longue enquête rétrospective sur son vieil ami, grâce notamment aux enregistrements effectués par l’assistante sociale qui l’avait pris sous son aile. Son ascendance mi allemande mi tsigane, sa vie en Roumanie, l’oppression, le pénitencier, la fuite en France… Et voilà Nathan parti sur les traces de Gavril dans son pays d’origine : Timişoara et les villages du Banat, Bucarest, l’ « enfer carcéral » de Jilava, le Bărăgan, le delta du Danube… Autant de découvertes qui entrent en résonance avec ce que les deux amis avaient vécu ensemble.
La mémoire des événements rapportés ou vécus libère celle des mots et de la poésie. Car c’est elle, la poésie, qui, transcendant les joies et les souffrances de la vie, est le vrai fil conducteur du roman de Sylvie Germain. Depuis le bégaiement involontaire de l’enfant jusqu’au bégaiement « volubile » du poète roumano-français Ghérasim Luca (lui aussi mort, comme son ami Paul Celan, noyé dans la Seine), depuis les désarticulations verbales que Gavril opérait sur les textes de Rimbaud, Apollinaire, Ronsard, Queneau, Prévert, Mallarmé, Hugo (on en passe) jusqu’au souvenir de Benjamin Fondane et aux vers d’Ana Blandiana, c’est, par « les voix des poètes morts », le fond véritable de la vie humaine qui passe à travers la respiration du langage, et c’est « l’espoir oublié » qui renaît.
Jean-Pierre Longre
20:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, sylvie germain, albin michel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/09/2021
Fuir, désespérément
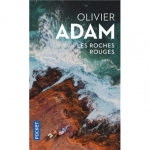 Olivier Adam, Les roches rouges, Robert Laffont, 2020, Pocket, 2021
Olivier Adam, Les roches rouges, Robert Laffont, 2020, Pocket, 2021
Ils se sont rencontrés au Pôle emploi. Il y a des lieux plus exaltants pour commencer une histoire d’amour. C’est pourtant bien de cela qu’il s’agit. Leila, séduite à 14 ans par Alex, son prof de sport, chassée par ses parents, trop jeune mère d’un petit garçon, vit sous la coupe tyrannique de son compagnon devenu violent. Antoine, tout juste sorti de l’adolescence, a arrêté ses études, s’est laissé prendre par la drogue, vit au crochet de ses parents… Il y a des destinées plus heureuses pour poursuivre une histoire d’amour. C’est pourtant toujours de cela qu’il s’agit, puisque malgré leurs différences (d’âge, de tempérament, de passé, de classe sociale), Leila et Antoine, fuyant la fureur d’Alex qui a découvert leur relation, se sauvent en catastrophe avec Gabi, le fils de Leila.
Destination « Les roches rouges », à Agay, où se trouve la maison de famille d’Antoine. La mer, le soleil, le paysage méditerranéen, la tranquillité – apparemment. Mais la maison est déjà occupée par Lise, la sœur d’Antoine ; celui-ci va devoir confier à Leila le secret qui pèse sur ses épaules, qui avait causé le départ de sa sœur et qui va rendre la cohabitation difficile. De son côté, Leila cherche sa sœur disparue – autre secret familial. Le tout sur fond d’angoisse, à la pensée qu’Alex peut surgir à tout moment, car ils savent bien qu’il n’abandonnera pas la partie.
Olivier Adam sait mener une intrigue, ménager le suspense sans laisser de répit au lecteur, camper des personnages d’une grande humanité parce qu’ils ne sont pas tout d’un bloc, que chez eux l’espoir côtoie la détresse, que pour eux les promesses de l’avenir doivent composer avec les tares du passé. « Il ne sert à rien de ressasser tout ça. Les causes. Les conséquences. L’enchaînement des événements. », se dit Leila, alors qu’Antoine s’était dit : « Je sais qu’il est temps. De passer aux aveux. De payer une partie de l’addition. De purger une autre partie de ma peine. » Le procédé qui consiste à faire monologuer tour à tour, chacun selon son point de vue, les deux protagonistes, les rend d’autant plus attachants qu’on les comprend mieux ainsi. Palpitant et profond, un beau récit à deux voix.
Jean-Pierre Longre
12:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, olivier adam, robert laffont, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/09/2021
Le poids des armes
 Nicolas Mathieu, Rose Royal suivi de La retraite du juge Wagner, Actes Sud / Babel, 2021
Nicolas Mathieu, Rose Royal suivi de La retraite du juge Wagner, Actes Sud / Babel, 2021
La nouvelle se distingue du roman par sa brièveté, mais pas seulement. Il y a la densité de la narration, l’unité d’action, le réalisme des personnages, la rapidité du dénouement… Les deux récits réunis dans ce volume répondent à ces critères, et la commune noirceur des sujets justifie leur voisinage, sans parler d’un protagoniste essentiel à chacune des histoires : le révolver, qui dans les deux cas joue un rôle majeur.
Rose, la cinquantaine, divorcée, des enfants qui ne se manifestent guère, a déjà beaucoup vécu et ne croit plus à l’amour. C’est d’ailleurs pour se protéger de ses pièges qu’elle garde sans cesse un révolver sur elle. Elle s’est résignée à mener une vie professionnelle sans ambitions, une vie sexuelle en pointillés, une vie sociale réduite à des fins de journées au Royal, un bistrot où elle boit et bavarde avec les habitués, dont son amie Marie-Jeanne. C’est ici qu’elle va rencontrer Luc, lui aussi désabusé, bon buveur comme elle. « Ils se contentaient de vider leurs verres et apprenaient à se connaitre. […] À force, ils avaient fini par se dire que pour eux, c’était plié, que leur tour était passé, qu’il faudrait désormais se contenter de durer, en profitant à la marge. Et ils se retrouvaient là, le regard dans le regard, preuve que non, il restait à vivre finalement. » Mais l’espoir va être de courte durée. Luc a de l’argent, Rose beaucoup moins ; il va vouloir compenser son manque de vigueur sexuelle par une sorte de chantage à la survie : « Autrefois, Luc lui faisait peur. Il lui faisait mal. Maintenant, c’était pire. Il lui faisait sentir qu’elle ne tenait qu’à un fil. Sa dépendance était telle, elle se trouvait si loin dans la servitude désormais, qu’un mot suffisait pour la renvoyer au néant. » Violence mentale, violence muette, mais violence réelle. Le couple aura beau faire des tentatives pour retrouver un semblant de bonheur (en oubliant, par exemple, le bistrot du « Royal » lors d’un séjour dans un autre « Royal », le grand hôtel d’Évian), c’est la violence ultime qui triomphera.
Quant au juge Wagner, il coule une retraite que l’on croirait paisible, mais qui ne l’est pas. Il a beaucoup jugé, condamné en conséquence – ce qui lui vaut des inimitiés, et même des menaces de mort de la part d’un clan corse qu’il n’a pas ménagé. C’est pour cette raison que lui aussi garde un révolver qui lui vaudra une rencontre avec Johann, un petit jeune un peu paumé qui s’est laissé entraîner dans quelques coups tordus. « Dans le tas, Johann surtout l’avait touché, avec son côté suiveur, cette maladresse dans le zèle, une certaine prudence aussi qui ressemblait presque à du discernement. » Une amitié complice s’instaure entre eux, avec quelques confidences et des silences, jusqu’à un dénouement brusque, sans concessions.
Ce petit livre se lit d’une traite (disons de deux), et Nicolas Mathieu, en un style délicat mais sans fioritures, mène le lecteur dans le dédale d’existences abîmées, sans se départir d’un attachement communicatif pour ses personnages, Cet attachement qu’on avait déjà décelé dans Leurs enfants après eux.
Jean-Pierre Longre
10:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, nicolas mathieu, actes sud, babel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/09/2021
Paradis cannibale
 Marc Villemain, Ceci est ma chair, Éditions Les Pérégrines, 2021
Marc Villemain, Ceci est ma chair, Éditions Les Pérégrines, 2021
Nous sommes à Marlevache, dans le duché de Michão, seul État à « avoir fait sa révolution cannibale ». C’est ainsi que ses habitants, les « Restaurés », se sont mis au ban du monde pour avoir voulu remédier au surpeuplement et au manque de nourriture – et aussi, il faut bien le dire, pour avoir pris goût à la saveur de la chair humaine : au fil des chapitres les scènes de banquets foisonnent, où se dégustent maints morceaux savoureux – steaks, saucisses, boudin, cervelle, andouillettes, brochettes etc. –, le tout accompagné des meilleures bouteilles de vin coupé d’un peu de sang, et dûment préparé dans le « complexe carnologique » (ou « vianderie ») fondé et dirigé par Valère de l’Ondine et employant « mille travailleuses travailleurs : deux cents chercheurs et ingénieurs y préparent l’avenir de la cryogénie, de la thérapophagie, de la prophylaxie de la viande et de ses modes de conditionnement, et pas moins de huit cents ouvriers et techniciens y travaillet d’arrache-pied, nuit et jour et sept jours sur sept. » Bref, tout est organisé pour que les habitants de Marlevache ne manquent pas de chair humaine, prélevée selon une règle précise : « Le deuxième enfant d’une fratrie est constitutionnellement sacrifié lorsqu’il accède à la majorité, soit le jour de ses quatorze ans, âge auquel la chair, en sus de ses qualités gustatives assez remarquables, procure les meilleurs avantages comparatifs. » Grand honneur pour le sacrifié et sa famille !
On l’aura compris, le duché assure le bonheur de ses habitants grâce à une organisation impeccable selon laquelle tout est prévu, même les cas particuliers (femmes stériles, jumeaux, tri des morceaux comestibles ou non, règles de sécurité publique, choix des « Bienheureux » candidats au « dit-don de soi » etc.). Ce qui n’empêche pas que les agapes fassent l’objet de beuveries, voire d’orgies, au cours desquelles le « Spirite » Basile de Blaise, maître religieux, tente vainement de faire entendre ses chants, tel le barde des albums d’Astérix.
Tout semble donc parfaitement huilé (comme la viande embrochée en public), lorsqu’un attentat détruit entièrement le « complexe carnologique », faisant de nombreuses victimes. Terrorisme « anticannibale » ? La population s’affole, et Loïc d’Iphigénie, le « dépariteur », est chargé de mener l’enquête sous la houlette de Gustave de Gonzague, « départiteur judiciaire », et rassurons-nous, l’enquête aboutira.
Ceci est ma chair serait donc un polar bien mené sur fond d’utopie ou de dystopie (question de point de vue) ? Oui, mais c’est bien plus que cela. Marc Villemain, dont la plume acérée, tour à tour gouailleuse et chantournée, joueuse (sur les mots) et méthodique, s’en donne à cœur joie dans différents registres : la satire socio-politique et religieuse, l’érotisme carné (voir la concupiscence ambiguë de certains mâles devant les corps féminins), la parodie (voir quelques paroles de chansons bien senties adaptées aux circonstances). Et ce faisant, il se livre, comme le firent jadis Rabelais, Diderot, Balzac et quelques autres, à une fine description des relations et des comportements humains.
Jean-Pierre Longre
08:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marc villemain, Éditions les pérégrines, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/08/2021
Effrayants mécanismes
 Lire, relire... Éric Vuillard, L’ordre du jour, Actes Sud, 2017, Babel, 2021
Lire, relire... Éric Vuillard, L’ordre du jour, Actes Sud, 2017, Babel, 2021
Prix Goncourt 2017
Il n’est pas fréquent de rencontrer dans ces pages des livres qui figurent en tête des ventes en librairies. Je ferai pourtant une exception pour le Prix Goncourt 2017, qui est lui-même une exception dans sa catégorie, puisqu’il ne s’agit pas d’un roman, mais d’un « récit », qui plus est d’un récit bref (150 pages). Mais si l’on admet que la littérature aide, entre autres, à débusquer la vérité cachée derrière les leurres, les masques, le voile des apparences, alors oui, L’ordre du jour, dans son exploration des bas-fonds de l’Histoire, est une véritable œuvre littéraire. « La vraie pensée est toujours secrète, depuis l’origine du monde. On pense par apocope, en apnée. Dessous, la vie s’écoule comme une sève, lente, souterraine. », écrit l’auteur à propos des jeunes filles qui, à Vienne en 1938, accueillirent Hitler dans l’enthousiasme : « Comment séparer la jeunesse que l’on a vécue, l’odeur de fruit, cette montée de sève à couper le souffle, d’avec l’horreur ? Je ne sais pas. ».
 On l’aura compris, il s’agit ici de l’Anschluss, de ses prémices, de ses secrets, de ses effrayants mécanismes, de ce qui ne se raconte pas habituellement. Le récit commence par la rencontre, en 1933, des grands industriels allemands, Krupp en tête, avec Goering et Hitler venus leur demander de verser leur contribution pour aider le parti nazi à conquérir définitivement le pouvoir – ce qu’ils s’empressent de faire, chacun à sa mesure. Il se termine avec les mêmes industriels qui, à la fin de la guerre, ont largement augmenté leur fortune en utilisant une main-d’œuvre des plus rentables : les déportés de Buchenwald, Auschwitz, Dachau, Dora, Mauthausen (etc.), qui littéralement mouraient à la tâche (l'auteur de ce compte rendu se sent particulièrement concerné, puisque son oncle maternel Pierre Penel, résistant, arrêté sur dénonciation à Lyon, torturé, déporté, est mort d'épuisement et de maladie au camp de Dora).
On l’aura compris, il s’agit ici de l’Anschluss, de ses prémices, de ses secrets, de ses effrayants mécanismes, de ce qui ne se raconte pas habituellement. Le récit commence par la rencontre, en 1933, des grands industriels allemands, Krupp en tête, avec Goering et Hitler venus leur demander de verser leur contribution pour aider le parti nazi à conquérir définitivement le pouvoir – ce qu’ils s’empressent de faire, chacun à sa mesure. Il se termine avec les mêmes industriels qui, à la fin de la guerre, ont largement augmenté leur fortune en utilisant une main-d’œuvre des plus rentables : les déportés de Buchenwald, Auschwitz, Dachau, Dora, Mauthausen (etc.), qui littéralement mouraient à la tâche (l'auteur de ce compte rendu se sent particulièrement concerné, puisque son oncle maternel Pierre Penel, résistant, arrêté sur dénonciation à Lyon, torturé, déporté, est mort d'épuisement et de maladie au camp de Dora).
Entre ces deux évocations, tout le processus de l’Anschluss est démonté. On n’en reprendra pas ici les différents épisodes (les concessions, les manœuvres, les menaces…), épisodes connus mais qui sont minutieusement détaillés, avec des gros plans permettant d’en distinguer les rouages malsains et malfaisants. On apprend aussi que l’armée allemande envahissant l’Autriche était loin d’être opérationnelle (« une armée en panne, c’est le ridicule assuré »), et que si les nations européennes (France et Grande-Bretagne en particulier) n’avaient pas alors pratiqué une « politique d’apaisement » avec l’Allemagne, celle-ci n’aurait peut-être pas fait le poids.
Le livre d’Éric Vuillard, comme les précédents, est un retour sur l’Histoire, avec des épisodes méconnus, des digressions significatives, des ralentis et des arrêts sur image qui révèlent, dans un style saisissant, les réalités que beaucoup ont eu intérêt à dissimuler. « La vérité est cachée dans toute sorte de poussières », les poussières de la violence, de l’impuissance, de l’effroi et de l’horreur. Et c’est toujours à « l’ordre du jour ». À méditer, ici et maintenant.
Jean-Pierre Longre
18:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, histoire, francophone, Éric vuillard, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/08/2021
Illusions tragiques
 Ivana Sajko, Bovary, un cas d’exaltation suivi de Le chant de la ville (ce n’est pas pour toi), traduit du croate par Nicolas Raljevic en collaboration avec Miloš Lazin, Prozor, 2021
Ivana Sajko, Bovary, un cas d’exaltation suivi de Le chant de la ville (ce n’est pas pour toi), traduit du croate par Nicolas Raljevic en collaboration avec Miloš Lazin, Prozor, 2021
Ce volume réunit deux pièces dont les sujets sont apparemment bien différents : Bovary, un cas d’exaltation reprend avec le détachement ironique du langage théâtral et de l’actualisation littéraire le roman de Flaubert, ses personnages et leur tempérament, ses péripéties et ses intrigues. Tout y est : la recherche du bonheur, de l’amour idéal, le mépris pour Charles, les relations avec Rodolphe et Léon, les conflits, les commentaires des témoins (Homais, Justin, Lheureux), Emma qui rêve : « Il y a longtemps, j’ai dansé une valse dans le vrai salon d’un vrai palais avec un vrai homme qu’ils appelaient vicomte, et alors le dos en sueur je suis tombée dans un lit, dans la réalité, dans la vie conjugale, dans la cuisine, devant l’assiette d’un ragoût de bœuf, dans le canapé en face de la télé. Je n’allais pas bien. Mon mari m’a dit : « C’est l’alcool », puis : « C’est la dépression » et alors : « Pourquoi ne fais-tu pas un bon somme ? ». Je n’ai pas pu l’écouter. J’ai fermé les yeux et j’ai continué à danser, piétiner à l’aveugle et tourner autour de moi, ne pas penser, juste danser et danser, même si cela devait me tuer. »
Avec Le chant de la ville, nous changeons de contexte – puisque nous sommes directement plongés dans l’actualité –, de lieu – puisque cela se passe dans une grande ville –, de protagoniste – puisqu’il s’agit d’un immigrant qui cherche à survivre dans les rues d’une cité inconnue marquée par l’indifférence et la violence, une cité où « le premier jour est pour toujours » : « tu as senti une peur qui ne te quitterait plus, / car dans cette parie intérieure d’où proviennent les pensées tu as palpé une place vide, / là où devait se trouver une réponse il n’y avait rien, / tu n’avais rien de judicieux à nous dire. / Tu marchais ainsi, sans savoir ce que tu faisais, roulant au bas du trottoir, / témoignais de scènes quotidiennes sans aucune utilité, / nous t’avons regardé à travers les fentes des rideaux flâner dans le voisinage. »
Au-delà des différences de fond et de forme, les deux personnages d’Ivana Sajko ont un même point d’ancrage : l’illusion. L’illusion théâtrale, certes, qui nous place dans la position du spectateur assistant à un jeu scénique tout en sentant bien que ce jeu est celui du réel. Et les illusions d’Emma et de l’immigrant qui, tous deux, se laissent prendre aux miroirs trompeurs d’une vie rêvée. Illusions tragiques, puisqu’au lieu de la vie rêvée, c’est la mort qui les attend au tournant. Et tout cela est d’autant plus prenant que par le truchement d’une écriture à la fois dense et prenante, c’est l’art dramatique qui nous permet de « reconnaître la tragédie dans la foule ». Comme l’écrit l’autrice à propos de la deuxième pièce : « Tout se tient dans le théâtre. Je ne sais pas dans quelle mesure l’art peut se tromper par une véritable tragédie, une véritable frustration, une véritable blessure, mais dans cet espace dans lequel c’est encore possible, ce texte demeure comme un art. »
Jean-Pierre Longre
18:08 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, croate, ivana sajko, nicolas raljevic, miloš lazin, prozor, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/08/2021
Survivre au malheur
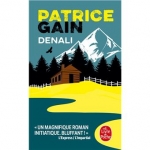 Patrice Gain, Denali, Le mot et le reste, 2017, Le livre de poche, 2021
Patrice Gain, Denali, Le mot et le reste, 2017, Le livre de poche, 2021
Matt Weldon a quasiment tout perdu : son père a disparu dans l’ascension du Denali (anciennement Mont Mc Kinley, plus haut sommet de l’Alaska), après quoi sa mère s’est laissée dépérir. Sa grand-mère, qui l’a recueilli, se tue accidentellement, et son frère Jack se met à mal tourner – drogue, violence et ce qui s’ensuit… Voilà beaucoup de malheurs pour le jeune garçon, qui cherche cependant à retrouver le passé, à percer les mystères qui ont entouré la vie et la mort de son père, et qui malgré tout garde sans cesse le souci de son frère.
 Il n’a que peu de soutien dans sa quête et ses tentatives pour survivre dans le ranch de sa grand-mère au milieu de ses fantômes, perdu au cœur du Montana sauvage, où il s’adonne à la pêche et à la préservation du bien familial : « De temps à autre j’arrivais à me persuader que je pouvais encore être heureux, mais cette illusion ne durait jamais bien longtemps. » Il faut dire que Matt va revenir de loin, et qu’il a un sacré tempérament, toujours lucide sur les événements qui lui tombent dessus : « Quand les choses tournent mal, on pense souvent qu’on ne peut pas vivre pire. Mais quand le pire arrive, on le sait tout de suite. On en prend immédiatement la mesure. »
Il n’a que peu de soutien dans sa quête et ses tentatives pour survivre dans le ranch de sa grand-mère au milieu de ses fantômes, perdu au cœur du Montana sauvage, où il s’adonne à la pêche et à la préservation du bien familial : « De temps à autre j’arrivais à me persuader que je pouvais encore être heureux, mais cette illusion ne durait jamais bien longtemps. » Il faut dire que Matt va revenir de loin, et qu’il a un sacré tempérament, toujours lucide sur les événements qui lui tombent dessus : « Quand les choses tournent mal, on pense souvent qu’on ne peut pas vivre pire. Mais quand le pire arrive, on le sait tout de suite. On en prend immédiatement la mesure. »
Entre évocations sensibles de la nature et accumulation de péripéties dramatiques, le récit file bon train, dans un style alerte, hâtif et efficace, à l’américaine. Roman noir, oui, mais aussi roman de la forêt, de l’eau et de la montagne. La montagne, Patrice Gain en est un fervent connaisseur, et c’est elle qui conduit le fil de l’intrigue. Tout part d’elle (le Denali, et aussi une ascension périlleuse dans l’Himalaya), tout revient à elle. Et Matt, l’ayant retrouvée, va pouvoir rompre avec le passé, conquérir et suivre sa voie, et ainsi survivre au malheur.
Jean-Pierre Longre
21:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrice gain, le mot et le reste, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/08/2021
« Personne n’est à l’abri du succès »
 Paul Fournel, Jeune-Vieille, P.O.L., 2021
Paul Fournel, Jeune-Vieille, P.O.L., 2021
Paul Fournel connaît bien le monde de l’édition, et Jeune-Vieille, comme une suite de La liseuse et de Jason Murphy, toujours dans le registre romanesque, en témoigne avec empathie et humour. Geneviève (qu’un camarade de classe original, Gabert, surnomme « Jeune-Vieille »), passionnée de cinéma et de littérature, rêve d’écrire. Au grand dam de sa mère, elle entame des études de Lettres, fréquente un groupe de jeunes gens intéressés par la littérature, fait les belles découvertes d’une vie estudiantine… Ses premières vraies pages, elle les écrit un matin pour faire passer un mal de ventre, et ça marche. Certes, c’est encore de l’amateurisme : « J’ai écrit une dizaine de pages en poussant devant moi des personnages imaginaires comme des troupeaux d’oies, sans vraiment savoir ce que j’écrivais ou ce que je désirais écrire au moment où je le faisais. » (allusion malicieuse à Raymond Queneau, que Paul Fournel connaît bien aussi…).
Et tout s’enchaîne. « Un matin de juillet 1986 », une simple petite idée lui fait commencer un roman, qu’elle tape en continu sur la machine à écrire Valentine offerte par son père, puis, offert par le même, sur un Macintosh. Rupture avec Marc, le petit ami, changement d’apparence, manuscrit porté chez quatre éditeurs, une lettre de refus, et enfin un rendez-vous donné par Robert Dubois, un éditeur à l’ancienne, un vrai, qui aime la littérature, ses auteurs, la bonne chère et les avertissements en forme de paradoxe, du genre : « N’oublie jamais que tout peut arriver dans ce métier et que personne n’est à l’abri du succès. »
Elle publie donc son premier livre, puis les suivants sous la houlette bienveillante et exigeante de Robert, tout en menant une « double vie » ; sa réalité d’épouse et de mère, et les évasions romanesques guidées par l’imaginaire. Des articles dans la presse générale ou spécialisée, des signatures un peu erratiques dans des salons du livre, un succès d’estime. Comme le lui dit son camarade Gabert, qui donne dans le « polar rural » et qu’elle a retrouvée lors de ces signatures : « Les ventes, c’est plutôt comme le Loto, un coup tu gagnes, mille coups tu perds. C’est le gâteau sous la cerise. […] Le succès, c’est la cerise. » Un jour, elle va se laisser séduire par les promesses du président d’un puissant groupe éditorial, un fort bel homme, d’ailleurs, ce président hyperaffairé, toujours entre deux avions, qui lui annonce des dizaines de milliers de ventes pour son roman, et au bout du compte une adaptation cinématographique. Et c’est l’engrenage.
Elle a bien sûr le sentiment d’avoir trahi Robert Dubois, qui apparemment ne lui en veut pas, ou voit cela d’un œil ironique et désabusé. Mais quand même il y a le succès, le vrai ! « Ayant été adoubée par la télé, Geneviève changea de camp et appartint à la race des seigneurs. Elle se retrouvait de façon systématique dans cette cohorte d’écrivains qu’on promène chaque week-end comme une colo, de fête du livre en fête du livre, pour les asseoir derrière les tables dans la cohue, mais cette fois avec une file de lecteurs qui l’attendaient pour faire signer leur livre et qui l’avaient vue dans le poste. » Et il y a le tournage du film, qui va peut-être lui ouvrir les yeux. On laissera au lecteur le soin de découvrir le dénouement. Disons simplement que l’auteur décrypte finement, en se mettant dans la tête de son héroïne, en prenant son point de vue et sa plume, l’opposition entre deux mondes éditoriaux, l’un traditionnel et solide, qui garantit la qualité sans forcément assurer la fortune (le côté « vieille »), l’autre, moderne et pailleté, qui considère les écrivains comme des producteurs d’objets éphémères (le côté « jeune »). Ce faisant, Paul Fournel nous fait comprendre et aimer « Jeune-Vieille », attachant personnage, tout en pratiquant le détachement ironique qui le caractérise.
Jean-Pierre Longre
17:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, paul fournel, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/08/2021
Descente aux Enfers
 Árpád Schilling, Éva Zabezsinszkij, Jour de colère, traduit du hongrois par Petra Körösi, éditions L’espace d’un instant, 2021
Árpád Schilling, Éva Zabezsinszkij, Jour de colère, traduit du hongrois par Petra Körösi, éditions L’espace d’un instant, 2021
« Lève-toi / Et marche ! / Indigne-toi ! / Manifeste pour tes droits ! » Deux infirmières, Niki et Erzsi, manifestent leur colère – ce qui va leur valoir, dans un mouvement ironique de récupération politique, d’être décorées par le ministre en personne. La fierté ne va pas durer, car on s’aperçoit vite que cette médaille n’est qu’un leurre : pas d’augmentation de salaire, suppression du service de néonatologie où travaillait Erzsi, qui se retrouve au chômage et ne va trouver qu’un travail subalterne.
Á partir de là, c’est pour elle la descente aux Enfers provoquée par les « anges » qui l’entourent sous la forme de personnages bien réels : le directeur de l’hôpital, l’ex-mari, le patron escroc etc. Erzsi va se débattre au milieu des difficultés pour tenter d’assurer une vie décente à sa mère Erzsébet et à sa fille Evelin. Elle ne mesure pas ses efforts, et comme lui dit sa mère : « Tu te crèves le cul au boulot pour deux fois rien, et regarde-toi dans une glace comment tu es à quarante ans ! » Pleine de sollicitude pour les autres, elle va connaître, d’étape en étape, de scène et scène, la déchéance et la solitude, jusqu’à la chute.
Il y a la dénonciation politique d’un régime, certes, mais aussi celle du libéralisme sans pitié, qui n’admet pas qu’on ait des états d’âme et qu’on tente d’aider les autres. Une pièce de théâtre engagée, au sens plein et large du terme, percutante, sans grandiloquence et sans concessions. Les couplets de la fin font écho à ceux du début, par exemple : « Remédiez / À la bonté maudite, / À l’épidémie / Des fausses moeurs ! / Détruisez / L’hypocrisie, / L’idole / De la dévotion ! ».
Jean-Pierre Longre
Autre parution aux éditions L’espace d’un instant :
Sarah Fourage, Affronter les ombres
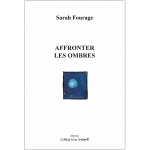 « Dans une petite ville du sud, « aux portes de la Méditerranée », deux femmes se rencontrent sur le parking d’un magasin de bricolage. Quelque chose se tenait là, qui n’y est plus. Une cité tout entière, des logements, des vies, des souvenirs, une mémoire. A-t-on le droit de réveiller un passé hanté par l’horreur de l’Histoire ? Doit-on le taire, tenter de le transmettre ? Librement inspirée de paroles recueillies auprès d’habitants de Lodève, la plupart descendants de harkis, cette fiction théâtrale tente d’évoquer les souvenirs de la Cité de la Gare, où furent logées une soixantaine de familles de harkis en 1962, la création de la Manufacture de la Savonnerie, et l’abandon par la France de ceux qui l’avaient servie. »
« Dans une petite ville du sud, « aux portes de la Méditerranée », deux femmes se rencontrent sur le parking d’un magasin de bricolage. Quelque chose se tenait là, qui n’y est plus. Une cité tout entière, des logements, des vies, des souvenirs, une mémoire. A-t-on le droit de réveiller un passé hanté par l’horreur de l’Histoire ? Doit-on le taire, tenter de le transmettre ? Librement inspirée de paroles recueillies auprès d’habitants de Lodève, la plupart descendants de harkis, cette fiction théâtrale tente d’évoquer les souvenirs de la Cité de la Gare, où furent logées une soixantaine de familles de harkis en 1962, la création de la Manufacture de la Savonnerie, et l’abandon par la France de ceux qui l’avaient servie. »
"Sarah Fourage est née à Nantes en 1975. Comédienne formée à l’Ensatt à Lyon dans les années 2000, elle se met au service d’écritures contemporaines, comme celles d’Emmanuel Darley, Nicoleta Esinencu, Jacques Rebotier… sous la direction de Dag Jeanneret, Véronique Kapoian, Michel Raskine… Dans le même temps elle écrit une quinzaine de pièces dont la plupart ont été commandées et représentées par différentes compagnies, telles que Délit de Façade, La Fédération, Machine Théâtre… Parmi ses thèmes de prédilection, la construction identitaire, l’inégalité sociale, la quête d’émancipation. Elle vit à Montpellier depuis 2005."
21:54 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, hongrie, Árpád schilling, Éva zabezsinszkij, petra körösi, sarah fourage, éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/07/2021
Quand tout se délite
 Karine Tuil, Les choses humaines, Gallimard, 2019, Folio, 2021
Karine Tuil, Les choses humaines, Gallimard, 2019, Folio, 2021
Jean Farel est un homme puissant, qui ne demande qu’à « durer » dans ce qu’il estime être l’essentiel : « Rester avec sa femme ; conserver une bonne santé ; vivre longtemps ; quitter l’antenne le plus tard possible. » Journaliste charismatique et populaire côtoyant le gratin de la politique, il a séduit et épousé Claire, jeune franco-américaine, essayiste féministe reconnue. Leur fils Alexandre, brillant élève, polytechnicien, est promis à un bel avenir aux États-Unis.
Tout semble lisse, malgré une tentative de suicide d’Alexandre en proie à la pression sociale et surtout paternelle. La vie de cette famille médiatique se poursuit sans encombre apparent, jusqu’au jour où Claire s’éprend d’Adam, professeur issu d’une communauté juive traditionnelle, marié et père de famille, qui tombe lui aussi amoureux de Claire. Séparations, couples reformés (Jean, qui a par ailleurs une maîtresse attitrée, va se remarier avec une toute jeune collègue), puis tout va se déliter lorsque Mila, la fille d’Adam, va accuser Alexandre de viol.
 Dès lors, le roman est consacré à cette affaire : l’accusation, l’arrestation du jeune homme, puis le récit détaillé du procès, avec les témoignages à charge et à décharge, les plaidoiries des avocats, le jugement. L’occasion pour l’autrice, qui s’inspire de la réalité, de nous faire entrer dans la vie sentimentale, sexuelle, familiale, amicale, professionnelle de personnages qui ne s’attendaient pas à devoir ainsi dévoiler leur intimité. L’occasion de nous faire pénétrer sur « le territoire de la violence » et de décortiquer les « rapports humains » et leurs ambiguïtés, de montrer combien la vérité est complexe, de pointer les contradictions inhérentes à la psychologie et à l’activité d’hommes et de femmes ambitieux, d’illustrer le passage de la force à l’impuissance.
Dès lors, le roman est consacré à cette affaire : l’accusation, l’arrestation du jeune homme, puis le récit détaillé du procès, avec les témoignages à charge et à décharge, les plaidoiries des avocats, le jugement. L’occasion pour l’autrice, qui s’inspire de la réalité, de nous faire entrer dans la vie sentimentale, sexuelle, familiale, amicale, professionnelle de personnages qui ne s’attendaient pas à devoir ainsi dévoiler leur intimité. L’occasion de nous faire pénétrer sur « le territoire de la violence » et de décortiquer les « rapports humains » et leurs ambiguïtés, de montrer combien la vérité est complexe, de pointer les contradictions inhérentes à la psychologie et à l’activité d’hommes et de femmes ambitieux, d’illustrer le passage de la force à l’impuissance.
D’autant qu’il n’y a pas de réponse définitive aux questionnements. Mais comme le pense Claire à l’issue du procès de son fils : « Vivre, c’était s’habituer à revoir ses prétentions à la baisse. Elle avait cru pouvoir contrôler le cours des choses mais rien ne s’était passé comme prévu. ».
Jean-Pierre Longre
22:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, karine tuil, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2021
Huit siècles de commerce du livre
 Patricia Sorel, Petite histoire de la librairie française, La fabrique éditions, 2021
Patricia Sorel, Petite histoire de la librairie française, La fabrique éditions, 2021
Du Moyen Âge à nos jours, c’est une histoire complète du commerce du livre que nous raconte Patricia Sorel. Dès le treizième siècle, des « stationnaires » et des « libraires » (on découvrira la différence dans les premières pages) sont chargés de fournir les manuscrits nécessaires aux étudiants, tant à Paris qu’en province. Et bien sûr, l’invention de l’imprimerie et sa diffusion en France à partir de 1470 vont « profondément bouleverser » la vente des livres et le métier de libraire, qui va subir des variations au gré des conditions culturelles, sociales et politiques, des réglementations, du succès de tel ou tel type d’ouvrage, des goûts des lecteurs, des choix des éditeurs…
Cinq grandes étapes rythment cette histoire : « La librairie sous l’Ancien Régime », « Le développement de la librairie au XIXe siècle », « Une profession ancrée dans la tradition (fin XIXe siècle – 1945) », « La modernisation à marche forcée » (1945-1981) », « La librairie sous le régime du prix unique », le tout complété par des considérations sur la concurrence actuelle du commerce en ligne, par un index fort utile et par une bibliographie dite « sommaire », mais déjà bien fournie.
On peut bien sûr s’intéresser aux statistiques, aux chiffres détaillés, aux références précises qui jalonnent ces pages semées d’illustrations, devantures ou intérieurs de librairies connues (celles d’Adrienne Monier ou de Sylvia Beach par exemple) ou moins connues. S’intéresser aussi aux fluctuations économiques, aux modes de gestion des stocks, aux relations entre éditeurs, lecteurs, législateur et libraires. Mais les passages les plus prenants sont ceux qui relatent les grandes batailles : contre les différentes formes de censure (ouverte ou insidieuse), entre les grandes surfaces et les véritables librairies, et bien sûr celle du « prix unique » du livre, demandé de longue date par certains, finalement instauré sous la présidence de François Mitterrand et le ministère de Jack Lang le 1er janvier 1982, malgré les vives résistances de forces commerciales comme la Fnac et Édouard Leclerc, qui a cherché par tous les moyens mais finalement sans succès à conserver le statu quo. Des épisodes quasiment épiques qui, comme tout cet ouvrage, nous montrent que la salutaire croissance actuelle du nombre de librairies indépendantes n’est pas due au hasard, mais à une longue lutte pleine de péripéties, de négociations, d’espoirs, de désespoirs, d’abnégation. Cette « petite ( ?) histoire » met les pendules culturelles à l’heure.
Jean-Pierre Longre
19:03 Publié dans Essai, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, patricia sorel, la fabrique éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/06/2021
Le défi de la langue
Lire, relire... Agota Kristof, L’analphabète, récit autobiographique. Éditions Zoé, 2004, rééd. 2021
 Dans Le grand cahier, premier volume de sa trilogie romanesque composée aussi de La preuve et Le troisième mensonge, Agota Kristof fait écrire aux deux jumeaux, narrateurs et protagonistes se donnant à eux-mêmes des leçons de « composition » : « Pour décider si c’est "Bien" ou "Pas bien", nous avons une règle très simple : la composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons ». Et quelques lignes plus loin : « Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues, il vaut mieux éviter leur emploi et s’en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c’est-à-dire à la description fidèle des faits ».
Dans Le grand cahier, premier volume de sa trilogie romanesque composée aussi de La preuve et Le troisième mensonge, Agota Kristof fait écrire aux deux jumeaux, narrateurs et protagonistes se donnant à eux-mêmes des leçons de « composition » : « Pour décider si c’est "Bien" ou "Pas bien", nous avons une règle très simple : la composition doit être vraie. Nous devons décrire ce qui est, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous faisons ». Et quelques lignes plus loin : « Les mots qui définissent les sentiments sont très vagues, il vaut mieux éviter leur emploi et s’en tenir à la description des objets, des êtres humains et de soi-même, c’est-à-dire à la description fidèle des faits ».

Dans L’analphabète, Agota Kristof semble appliquer à son écriture autobiographique les règles qu’elle a imposées à ses personnages fictifs : tout y est « vrai », c’est-à-dire, à coup sûr, conforme à la réalité telle que la mémoire peut la restituer, mais aussi indemne de toutes les déformations que l’expression de la sensibilité personnelle et de l’autoanalyse provoquent généralement dans le jeu des souvenirs. Suivant la structure adoptée dans ses romans – une marqueterie de courts chapitres reproduisant de petites scènes significatives – , l’auteur raconte sans fioritures, sans états d’âme apparents (ce qui n’exclut nullement, au contraire, les non-dits intimes du scripteur et l’émotion secrète du lecteur), les étapes importantes de sa vie, surtout de sa vie en littérature : la découverte de la lecture, de la parole, de l’écriture par la petite fille écoutant les leçons données aux plus grands par son père instituteur, les premiers poèmes, la fuite et l’exil en Suisse, le travail en usine, la maternité, la rivalité des héros (Staline contre Thomas Bernhard), la rivalité des langues (le hongrois contre les « langues ennemies », singulièrement le français – finalement adopté pour la création littéraire), les débuts d’une « carrière » d’écrivain…
Un écrivain « analphabète » ? Le titre paradoxal annonce la fin même du récit, où se pose la question taraudant sans doute tous ceux qui écrivent dans une langue non « maternelle ». Les dernières lignes, avec les mots de l’évidence, l’énoncent clairement :
« Je sais que je n’écrirai jamais le français comme l’écrivent les écrivains français de naissance, mais je l’écrirai comme je le peux, du mieux que je le peux. […]
Écrire en français, j’y suis obligée. C’est un défi.
Le défi d’une analphabète. »
Agota Kristof, avec sa lucidité modeste et l’économie de ses moyens, dans son style implacable, est de ces écrivains venus d’ailleurs, rongés par le doute littéraire, qui donnent inlassablement force et nouveauté à la littérature de langue française.
Jean-Pierre Longre
23:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiograhie, francophone, agota kristof, Éditions zoé, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

