30/10/2017
Une initiation au paradis
 Dany Laferrière, Le goût des jeunes filles, Zulma, 2017
Dany Laferrière, Le goût des jeunes filles, Zulma, 2017
Comme par un processus naturel dont le moteur serait l’éveil des sens, après « l’odeur du café », il y a « le goût des jeunes filles » : après l’enfance à Petit-Goâve, racontée dans le premier volume (L’odeur du café, Zulma, 2016), il y a l’adolescence et ses rites initiatiques à Port-au-Prince, ville de tous les dangers et de tous les plaisirs.
Fanfan, que l’on retrouve sous différents noms (Vieux-Os, Dany) d’un « roman » à l’autre (d’un récit autobiographique à l’autre, ce « mélange de fiction et de réalité », comme le dit le narrateur à l’une de ses tantes qui l’accuse de n’avoir rien dit de vrai dans son livre), le jeune garçon donc a la particularité de franchir le passage à l’âge d’homme en un week-end fort agité. À la suite de ce qu’il croit être un abominable et périlleux crime commis par son ami Gégé, Dany se réfugie en face de chez lui, « du côté ensoleillé de la rue », chez les « jeunes filles » dont, de sa fenêtre, il guettait la vie en constante ébullition. Jeunes filles en fleurs conscientes de leurs charmes, et qui en usent sans vergogne pour pouvoir goûter aux joies de ce monde ; jeunes filles qui, sans le savoir, vont « changer la vie » du garçon. Chez Miki et ses amies, ce « paradis » rêvé, il va non seulement observer une vie à laquelle il n’avait pas accès jusqu’ici, mais aussi assouvir des désirs latents et éclatants, plonger dans le monde méconnu du plaisir des sens, inséparable du plaisir esthétique.
Car l’initiation n’est pas seulement physique, elle est aussi poétique : Fanfan découvre avec avidité le poète Magloire Saint-Aude, dont les vers le nourrissent et rythment ses instants secrets, comme ils rythment en exergue chacune des scènes du récit rétrospectif. Nous ne sommes pas seulement dans un livre de souvenirs – souvenirs certes qui, à eux seuls, mériteraient qu’on s’y intéresse, puisqu’ils situent l’existence intime et sociale du héros à Haïti, l’île natale, entre les dictatures de « Papa » et de « Baby » Doc, cette période où les « Tontons Macoute » faisaient la loi, ne respectant que la caste des privilégiés qui jouaient leur jeu. Le goût des jeunes filles (comme les autres ouvrages de Dany Laferrière) n’est pas non plus un simple document psychologique, sociologique, historique, exotique ; son épaisseur est véritablement littéraire, et c’est sans doute pour donner plus de poids au « réel » narratif que l’auteur a combiné avec la théâtralisation du récit (39 « scènes » cinématographiques et vivantes actualisant l’intrigue) le « Journal de Marie-Michèle », jeune bourgeoise qui, en révolte contre sa mère et son milieu (le « Cercle » fermé qui monopolise argent et pouvoir), se mêle aux « jeunes filles », tout en notant ses observations sur la société haïtienne et ses propres réactions face à la vie. Il y a donc une double narration, un double regard, ceux de Fanfan et de Marie-Michèle, à la fois très différents (le garçon du petit peuple et la fille de la caste dirigeante) et très analogues (tous deux se glissent, se coulent, se fondent, se cachent pour mieux observer) ; deux récits aux tons différents (scènes vivantes et dialoguées, journal intime), encadrés et dominés par un troisième narrateur, l’auteur adulte en visite chez ses tantes à Miami et confronté à sa destinée ; trois récits donc témoignant de la même préoccupation littéraire, du même amour de la poésie et de l’écriture.
Haïtien et Québécois, membre de l’Académie Française depuis 2013, Dany Laferrière est l’un des grands écrivains de l’espace francophone international, et Le goût des jeunes filles, réédité fort à propos par les éditions Zulma après L’odeur du café, Le charme des après-midi sans fin et Le cri des oiseaux fous, confirme s’il en est besoin l’évidente validité esthétique de son œuvre.
Jean-Pierre Longre
18:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, haïti, dany laferrière, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/09/2017
Musique et liberté, passionnément
Fabian Gastellier, Fritz Busch. L’exil : 1933-1951, avec le concours d’Elisabeth Willenz, discographie établie par Georges Zeisel, Notes de Nuit, collection « La beauté du geste », 2017.
Fritz Busch (1890-1951), l’un des plus grands chefs d’orchestre allemands du XXème siècle, eut une carrière et un destin exceptionnels, qui se divisent en deux périodes distinctes : la période allemande, jusqu’en 1933, et celle de l’exil, à partir du moment où le nazisme régna en maître sur son pays. Les éditions Notes de Nuit viennent de contribuer d’une manière décisive à la connaissance d’un musicien aussi important mais sans doute moins notoire, en France en tout cas, que certains de ses compatriotes : par la publication, dans une traduction d’Olivier Mannoni, des Mémoires de Fritz Busch (Une vie de musicien), qui s’arrêtent à l’année 1933 ; et par celle du livre de Fabian Gastellier (créatrice et directrice de Notes de Nuit) sur sa vie d’exilé, de 1933 à sa mort.

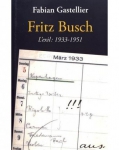
Ce dernier ouvrage est un récit passionné et passionnant en même temps qu’un essai d’une précision scientifique rigoureuse, s’appuyant sur de précieuses archives (Brüder-Busch-Archiv), sur des correspondances, des témoignages et documents divers. Cette dualité correspond parfaitement au personnage : Fritz Busch était à la fois passionné, hyperactif, intransigeant avec lui-même et avec les autres, et d’une rigueur absolue dans son travail. C’est en tout cas le portrait que l’on s’en fait à la lecture d’un livre dont il est, bien sûr, la figure centrale et omniprésente, mais dont la narration se déroule sur un fond historique qui influe fortement sur la vie de l’homme et de ses proches. Le nazisme, auquel il est d’emblée et restera toujours foncièrement hostile, alors que d’autres, comme Wilhelm Furtwängler ou Richard Strauss, eurent une attitude plutôt ambiguë. Pour Fritz Busch (et d’une manière plus radicale pour son frère Adolf, violoniste de renom), la révolte contre Hitler et ses sbires, par-dessus toute ambition et tout désir de gloire, a été permanente, à l'instar de Toscanini s’opposant au fascisme. « Le pouvoir nazi, qui comptait dans ses hauts rangs quelques mélomanes avertis, connaissait l’envergure du personnage. Son nom avait déjà circulé en 1922, quand Arthur Nikisch mourut, laissant la Philharmonie de Berlin orpheline de chef. Wilhelm Furtwängler, Allemand idéal, en héritera la même année. Busch, lui, n’est pas dans les normes. Busch ne transige pas. Le conflit ne pouvait être évité. Busch devra renoncer à l’Allemagne. Paradoxe : dans l’exil, il n’y aura peut-être pas plus allemand que lui. ».
Le livre relate donc, dans le contexte particulièrement tourmenté de ces années, mais sans polémique inutile, les tribulations d’un homme qui ne connaît pas le répit. « S’il se plaint souvent d’avoir un emploi du temps surchargé, ce qui est indéniable, Busch ne sait pas non plus s’arrêter. Il ne peut s’empêcher de caresser sans cesse de nouveaux projets. ». De la création en 1934 du festival de Glyndebourne à la participation active aux « Temporadas alemanas » de Buenos Aires, en passant par les opéras et concerts au Danemark (deuxième pays de prédilection pour lui et sa femme Grete), en Suède, aux USA, son activité vertigineuse, ponctuée d’événements familiaux et amicaux, fait fi de toutes les difficultés, de toutes les embûches, de toutes les inquiétudes, de toutes les souffrances morales et physiques. Jusqu’à son dernier Don Giovanni, dirigé quelques jours avant sa mort, à 61 ans, les espoirs fusent dans son esprit.
Le livre de Fabian Gastellier est d’un intérêt multiple, s’adressant aussi bien à ceux qui sont curieux de la personnalité d’un grand chef d’orchestre qu’à ceux qui s’intéressent à la vie musicale des années 1930 et 1940. Et si l’on veut trouver la date, le lieu, le programme de tel ou tel concert, de telle ou telle représentation lyrique, ou encore une précision discographique ou une critique musicale, on a là une véritable encyclopédie. Quoi qu’il en soit, la lecture de ces pages réveille l’essentiel : le désir de musique, celui d’écouter ou de réécouter Mozart, Beethoven, Verdi, Wagner, bien d’autres encore.
Jean-Pierre Longre
 Vient de paraître : coffret 9 CD : Mozart, Fritz Busch at Glyndebourne (Warner) : http://www.warnerclassics.com/fritz-busch
Vient de paraître : coffret 9 CD : Mozart, Fritz Busch at Glyndebourne (Warner) : http://www.warnerclassics.com/fritz-busch
19:06 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, fabian gastellier, elisabeth willenz, georges zeisel, fritz busch, notes de nuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/09/2017
« Comment les sauver tous ? »
 Emma-Jane Kirby, L’opticien de Lampedusa, traduit de l’anglais par Mathias Mézard, Équateurs, 2016, J'ai lu, 2017
Emma-Jane Kirby, L’opticien de Lampedusa, traduit de l’anglais par Mathias Mézard, Équateurs, 2016, J'ai lu, 2017
« Je ne souhaitais pas raconter cette histoire. Je m’étais promis de ne jamais la raconter. Ce n’est pas un conte de fées. Ils étaient trop nombreux. Je voulais y retourner pour les sauver, tous. Je voulais y retourner. ». Ainsi s’exprime le protagoniste de ce récit, homme ordinaire qui vit sa vie familiale, affective et professionnelle d’opticien sans se soucier outre mesure des réfugiés qui abordent la petite île italienne de Lampedusa, si proche des côtes africaines.
C’est un jour prometteur de joie amicale et de grand air maritime que sa vie bascule. Partis pour une promenade en mer, ses amis, sa femme et lui ne comprennent pas tout de suite d’où proviennent les drôles de cris qu'ils prennent d’abord pour d’étranges "miaulements" de mouettes, et dont ils perçoivent finalement l’horrible vérité : des hurlements d’hommes, de femmes, d’enfants naufragés en train de se noyer. Pas d’hésitations, pas de discussion entre eux : tous se mettent avec acharnement aux tentatives de sauvetage, jusqu’à l’épuisement, jusqu’à la limite du danger pour eux et pour leur bateau, et avec le sentiment de ne pouvoir accomplir complètement leur devoir : « Il apparaît clairement que, pour l’opticien, le sauvetage n’est pas terminé. Il sonde du regard les eaux alentours : il cherche encore, sans relâche. ».
Ce récit sans fioritures romanesques, forcément vrai, qui puise sa force dans une terrible réalité, n’a rien de moralisateur, rien de politique non plus. Il n’est pas question de se demander pourquoi ces gens fuient leur pays : la guerre, les persécutions, la misère, le rêve, l’illusion ? Ils sont là, dénués de tout, au bord de la mort, et il faut les sauver, les accueillir, les héberger. Une histoire humaine, tout simplement, avec tout ce qu’elle implique de courage et d’abnégation. Un héroïsme discret qui ne cherche ni la gloriole ni même la reconnaissance, mais qui est guidé par la puissance de l’émotion, de la révolte et de la colère, et par des sentiments qui ont beaucoup à voir avec la solidarité, l’amitié, l’amour du genre humain. Rien de moralisateur donc, mais L’opticien de Lampedusa est un livre qui devrait donner à penser à tous les tenants de la fermeture des frontières et à tous ceux qui dressent des murs et des barbelés prétendument protecteurs.
Jean-Pierre Longre
11:14 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, anglophone, emma-jane kirby mathias mézard, Équateurs, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/08/2017
Les paradoxes du réel
Egon Bondy, Réalisme total / Totální realismus, traduit du tchèque par Eurydice Antolin, édition bilingue, Black Herald Press, 2017
Kathleen Raine, David Gascoyne et la fonction prophétique / David Gascoyne and the Prophetic Role, traduit de l’anglais par Michèle Duclos, édition bilingue, Black Herald Press, 2017
 Egon Bondy (Zbyněk Fišer), né à Prague en 1930, mort à Bratislava en 2007, est de ces poètes trop méconnus en France, et qui dans leur pays ont eu un impact décisif. Influencé par le dadaïsme et le surréalisme, devenu par la suite prosateur, essayiste, historien de la philosophie, il fut à partir des années 1970 « une figure tutélaire de l’underground tchèque », ainsi qu’un personnage des œuvres de Bohumil Hrabal, qui l’appelait « mon ami le poète Egon Bondy ». Publié pour la première fois en 1951 dans la Collection Minuit, maison d’édition clandestine, Réalisme total réapparut au grand jour en 1992, et la traduction d’Eurydice Antolin est la première en français, contribuant ainsi à la connaissance d’une œuvre qui n’a été publiée dans notre langue que par bribes.
Egon Bondy (Zbyněk Fišer), né à Prague en 1930, mort à Bratislava en 2007, est de ces poètes trop méconnus en France, et qui dans leur pays ont eu un impact décisif. Influencé par le dadaïsme et le surréalisme, devenu par la suite prosateur, essayiste, historien de la philosophie, il fut à partir des années 1970 « une figure tutélaire de l’underground tchèque », ainsi qu’un personnage des œuvres de Bohumil Hrabal, qui l’appelait « mon ami le poète Egon Bondy ». Publié pour la première fois en 1951 dans la Collection Minuit, maison d’édition clandestine, Réalisme total réapparut au grand jour en 1992, et la traduction d’Eurydice Antolin est la première en français, contribuant ainsi à la connaissance d’une œuvre qui n’a été publiée dans notre langue que par bribes.
Le « réalisme total » est une réaction poétique au « réalisme socialiste » qui envahissait la vie pseudo-culturelle de la Tchécoslovaquie et des autres pays tentant de vivre sous la dictature staliniste. La tentative, en l’occurrence, est celle qui consiste à trouver dans toutes les combinaisons verbales (le premier poème en est une démonstration formelle) la dimension nécessaire à la vie : « Et nous devons recommencer / si de fait nous ne voulons pas mourir ». Les scènes de l’existence quotidienne, les tableaux montrant les êtres, les objets et les paysages familiers (le tramway, un vieillard, les rues de Prague, Noël, l’achat d’un livre…) sont soumis à l’ironie mordante, aux confrontations choquantes, telle celle des femmes « bien habillées » des officiers et des détenus « mal vêtus » des commissariats. Les chants d’amour fou pour « Marie » sont aussi les plus implacables des paradoxes : « Elle me hait encore plus que je ne la hais / car moi en même temps je l’aime ».
À l’opposé des promesses de lendemains qui chantent et de grands soirs, l’engagement poétique d’Egon Bondy donne du réel une vision à la fois complexe et transparente, provocatrice et désespérée. Le « tout est vain » qui émane de sa poésie est lié à ses « monstrueux cauchemars », ses « épouvantables lassitudes », et à la révolte contre un régime qui peut faire dire, au comble du cynisme : « Il n’est pas besoin d’attendre longtemps / conseillait la camarade dans la file d’attente du Comité national / Si vous cherchez un appartement d’emprisonné / il vous sera attribué sans délai ». Dix ans après la mort d’Egon Bondy, on n’en a pas fini avec le « réalisme total ».
Jean-Pierre Longre
J
 Juste avant Réalisme total, Black Herald Press a publié David Gascoyne et la fonction prophétique, de Kathleen Raine, traduit par Michèle Duclos. À la suite des précédentes publications de David Gascoyne (La vie de l'homme est cette viande et Pensées nocturnes), cet essai d’une amie du poète, poète elle aussi, permet de mettre en perspective l’œuvre d’un écrivain attiré par « l’aspect messianique du surréalisme », et dont les « poèmes sont parmi les rares poèmes de notre temps à témoigner aussi éloquemment de la vérité de l’imagination au nom de laquelle ils parlent. ».
Juste avant Réalisme total, Black Herald Press a publié David Gascoyne et la fonction prophétique, de Kathleen Raine, traduit par Michèle Duclos. À la suite des précédentes publications de David Gascoyne (La vie de l'homme est cette viande et Pensées nocturnes), cet essai d’une amie du poète, poète elle aussi, permet de mettre en perspective l’œuvre d’un écrivain attiré par « l’aspect messianique du surréalisme », et dont les « poèmes sont parmi les rares poèmes de notre temps à témoigner aussi éloquemment de la vérité de l’imagination au nom de laquelle ils parlent. ».
J.-P. L.
15:30 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, tchèque, anglophone, egon bondy, eurydice antolin, david gascoyne, kathleen raine, michèle duclos, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/08/2017
L’Espace d’un instant, centième
Milena Marković, La forêt qui scintille, traduit du serbe par Mireille Robin, avec la collaboration de Karine Samardžija, éditions L’espace d’un instant, 2017
Dominique Dolmieu, Bleuenn Isambard, Mouradine Olmez, Vivra, traduit du russe par Bleuenn Isambard , éditions L’espace d’un instant, 2017

En Europe orientale, entre Adriatique et Mer Noire, entre Balkans et Russie, la jeune production théâtrale foisonne. Depuis les années 1990, la liberté de créer se manifeste par une effervescence qui traduit l’espoir, la désillusion, les révoltes, la violence, la force poétique accompagnant les changements et les recherches de repères sociaux, politiques, spirituels, artistiques… La connaissance de cette nouvelle création, nous la devons en grande partie, en France, aux éditions L’Espace d’un instant, rattachées à la Maison d’Europe et d’Orient, fondée par Dominique Dolmieu et Céline Barcq. Les nombreuses traductions de textes théâtraux publiées par cette active maison d’édition, accompagnées de présentations et notices biobibliographiques détaillées, enrichissent singulièrement le répertoire dramaturgique contemporain et sont représentatives des écritures issues de cultures qu’on ne peut plus méconnaître.
La diversité des choix de l’Espace d’un instant se manifeste dans les deux derniers ouvrages publiés, bien différents l’un de l’autre.
 Dans La forêt qui scintille, « drame qui commence un soir et se termine au matin », des êtres au passé un peu mystérieux et au présent vacillant (un entraîneur alcoolique, une chanteuse vieillissante, un ancien toxicomane, des jeunes femmes sans doute destinées à la prostitution, leur accompagnateur) se rencontrent dans un cabaret promis à la démolition, aux abords d’une forêt. De leurs dialogues émanent quelques pans de leur passé, des aveux énigmatiques, des non-dits, des querelles anciennes ou récentes… La présence des personnages s’ancre dans une réalité parfois sordide, parfois très humaine, où la laideur des choses peut cacher la beauté : « C’est beau, si beau, la terre, lorsqu’elle donne ses fruits. Quand de la main tu palpes ce qu’elle t’offre sans pouvoir encore y goûter. Tu ressens alors de l’amour, tu as envie de sourire. Elle est là à t’attendre, toi et les tiens, et toutes ces bouches qui se nourrissent de ses bienfaits. ». La pièce entière est parsemée de chansons, de poèmes qui, alternant avec la trivialité ou la violence des paroles échangées, font de La forêt qui scintille (scintillement des âmes de jeunes filles fusillées, dit-on) un texte sensible et fort.
Dans La forêt qui scintille, « drame qui commence un soir et se termine au matin », des êtres au passé un peu mystérieux et au présent vacillant (un entraîneur alcoolique, une chanteuse vieillissante, un ancien toxicomane, des jeunes femmes sans doute destinées à la prostitution, leur accompagnateur) se rencontrent dans un cabaret promis à la démolition, aux abords d’une forêt. De leurs dialogues émanent quelques pans de leur passé, des aveux énigmatiques, des non-dits, des querelles anciennes ou récentes… La présence des personnages s’ancre dans une réalité parfois sordide, parfois très humaine, où la laideur des choses peut cacher la beauté : « C’est beau, si beau, la terre, lorsqu’elle donne ses fruits. Quand de la main tu palpes ce qu’elle t’offre sans pouvoir encore y goûter. Tu ressens alors de l’amour, tu as envie de sourire. Elle est là à t’attendre, toi et les tiens, et toutes ces bouches qui se nourrissent de ses bienfaits. ». La pièce entière est parsemée de chansons, de poèmes qui, alternant avec la trivialité ou la violence des paroles échangées, font de La forêt qui scintille (scintillement des âmes de jeunes filles fusillées, dit-on) un texte sensible et fort.
 « Théâtre documentaire », Vivra (centième volume publié par L’Espace d’un instant, soulignons-le) représente le procès de Koulaev, unique survivant des preneurs d’otages de Beslan : début septembre 2004, des terroristes prennent en otages plus de mille enfants dans une école d’Ossétie-du-Nord. Un cauchemar de trois jours pour les enfants et les adultes qui se trouvent avec eux, et un dénouement terrible : refusant de négocier sur la Tchétchénie, les autorités russes ordonnent l’assaut de l’école à coups d’armes lourdes, un assaut qui se solde par 334 morts, dont 186 enfants. Le procès de Koulaev est un support permettant d’élargir le champ de la réflexion au système qui a permis cette aberration meurtrière, et à la responsabilité des autorités politiques et militaires. La théâtralisation diversifie les points de vue, les répartit entre les différents acteurs du drame (juge, procureure, avocat, fonctionnaires, militaires, « celle qui reste », représentant les victimes). Tout est rigoureusement relaté, précisément analysé et décortiqué, mais c’est du théâtre, avec tout ce que le genre implique de vérité profonde et d’émotion contenue ou manifeste. Si le mot « sanglot » remplace le mot « scène » (il y en a 13 dans la pièce), tout se déroule sans pathos inutile, mais en déclinant la gamme des sentiments et des attitudes : la colère, la souffrance, l’hypocrisie, l’abjection, l’indifférence, le froid calcul – et dans la bouche de l’avocat des victimes, une promesse : « Tant que nous vivrons, cette mémoire vivra en nous, et nous continuerons à nous battre en son nom. ».
« Théâtre documentaire », Vivra (centième volume publié par L’Espace d’un instant, soulignons-le) représente le procès de Koulaev, unique survivant des preneurs d’otages de Beslan : début septembre 2004, des terroristes prennent en otages plus de mille enfants dans une école d’Ossétie-du-Nord. Un cauchemar de trois jours pour les enfants et les adultes qui se trouvent avec eux, et un dénouement terrible : refusant de négocier sur la Tchétchénie, les autorités russes ordonnent l’assaut de l’école à coups d’armes lourdes, un assaut qui se solde par 334 morts, dont 186 enfants. Le procès de Koulaev est un support permettant d’élargir le champ de la réflexion au système qui a permis cette aberration meurtrière, et à la responsabilité des autorités politiques et militaires. La théâtralisation diversifie les points de vue, les répartit entre les différents acteurs du drame (juge, procureure, avocat, fonctionnaires, militaires, « celle qui reste », représentant les victimes). Tout est rigoureusement relaté, précisément analysé et décortiqué, mais c’est du théâtre, avec tout ce que le genre implique de vérité profonde et d’émotion contenue ou manifeste. Si le mot « sanglot » remplace le mot « scène » (il y en a 13 dans la pièce), tout se déroule sans pathos inutile, mais en déclinant la gamme des sentiments et des attitudes : la colère, la souffrance, l’hypocrisie, l’abjection, l’indifférence, le froid calcul – et dans la bouche de l’avocat des victimes, une promesse : « Tant que nous vivrons, cette mémoire vivra en nous, et nous continuerons à nous battre en son nom. ».
Jean-Pierre Longre
11:05 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, serbie, russie, milena marković, mireille robin, karine samardžija, dominique dolmieu, bleuenn isambard, mouradine olmez, l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/08/2017
Ne pas se perdre entre les remparts
Avignon, Festival Off, 2017
1480 spectacles… Comment s’y retrouver ? Le hasard, le bouche à oreille, les parades de présentation, la critique (pour ce qui a déjà été représenté), les auteurs, les comédiens… Avignon en juillet, c’est un grouillement, un bouillonnement urbain et culturel, un mélange inédit des genres et des populations – et c’est un immense choix, un indispensable tri à effectuer. Quelques pépites ? En voici.
 Cour Nord (texte d’Antoine Choplin, adaptation et mise en scène d’Antoine Chalard), met en scène le conflit entre lutte sociale et amour de l’art : le père ouvrier en grève, le fils musicien passionné de jazz. Double combat, double engagement, deux idéaux, un rêve d’avenir pour chacun, deux protagonistes et douze personnages très bien figurés, grâce à de subtils changements a minima, par trois comédiens, Clémentine Yelnik, Antoine Chalard et Florent Malburet.
Cour Nord (texte d’Antoine Choplin, adaptation et mise en scène d’Antoine Chalard), met en scène le conflit entre lutte sociale et amour de l’art : le père ouvrier en grève, le fils musicien passionné de jazz. Double combat, double engagement, deux idéaux, un rêve d’avenir pour chacun, deux protagonistes et douze personnages très bien figurés, grâce à de subtils changements a minima, par trois comédiens, Clémentine Yelnik, Antoine Chalard et Florent Malburet.
Théâtre de l’Alizé, Compagnie du midi. www.compagniedumidi.fr
 La révolte gronde aussi, et différemment, du côté de chez Jean-Luc Lagarce : Noce (mise en scène de Pierre Note, avec Grégory Barco, Bertrand Degrémont, Eve Herszfeld, Amandine Sroussi, et Paola Valentin) est une implacable fable socio-politique : cinq personnages prétendument invités à une noce n’arrivent pas à y trouver leur place, s’y enfonçant comme dans un cauchemar. La "farce noire" tourne à la leçon cruelle lorsque les rôles s’inversent. La violence des situations est accentuée par l’hystérisation et l’humour méchant de certains rôles. Irrésistiblement tragique.
La révolte gronde aussi, et différemment, du côté de chez Jean-Luc Lagarce : Noce (mise en scène de Pierre Note, avec Grégory Barco, Bertrand Degrémont, Eve Herszfeld, Amandine Sroussi, et Paola Valentin) est une implacable fable socio-politique : cinq personnages prétendument invités à une noce n’arrivent pas à y trouver leur place, s’y enfonçant comme dans un cauchemar. La "farce noire" tourne à la leçon cruelle lorsque les rôles s’inversent. La violence des situations est accentuée par l’hystérisation et l’humour méchant de certains rôles. Irrésistiblement tragique.
Théâtre du roi René, Compagnie de la Porte au Trèfle. http://www.porteautrefle.fr
 La tragédie, Marguerite Duras l’a pratiquée à sa manière, en s’inspirant parfois de faits divers. C’est le cas avec L’Amante anglaise (mise en scène de Thierry Harcourt). Par le truchement de deux personnages, le mari et un psy/enquêteur/interrogateur, le texte tente de percer les raisons qui ont poussé une femme à commettre un crime sanglant. Judith Magre joue admirablement la folie (ou pseudo-folie) immobile et dérangeante, et ses deux comparses (Jacques Franz et Jean-Claude Leguay) accomplissent à la perfection la quête d’une vérité impossible
La tragédie, Marguerite Duras l’a pratiquée à sa manière, en s’inspirant parfois de faits divers. C’est le cas avec L’Amante anglaise (mise en scène de Thierry Harcourt). Par le truchement de deux personnages, le mari et un psy/enquêteur/interrogateur, le texte tente de percer les raisons qui ont poussé une femme à commettre un crime sanglant. Judith Magre joue admirablement la folie (ou pseudo-folie) immobile et dérangeante, et ses deux comparses (Jacques Franz et Jean-Claude Leguay) accomplissent à la perfection la quête d’une vérité impossible
Théâtre du Chien qui fume, ID Production. http://www.idproduction.org
 Autre genre de thème et de femme : Palatine (texte, mise en scène et scénographie de Jean-Caude Seguin) reprend et adapte des extraits de la correspondance de Charlotte-Elisabeth de Bavière, dite La Palatine (1652-1722), épouse de Monsieur Frère du Roi, mère du futur régent Philippe d’Orléans… et femme d’une franchise truculente, qui n’hésite pas à montrer les dessous les moins nobles de la Cour. La comédienne Marie Grudzinski la fait vivre avec beaucoup de malice, de drôlerie et de réalisme.
Autre genre de thème et de femme : Palatine (texte, mise en scène et scénographie de Jean-Caude Seguin) reprend et adapte des extraits de la correspondance de Charlotte-Elisabeth de Bavière, dite La Palatine (1652-1722), épouse de Monsieur Frère du Roi, mère du futur régent Philippe d’Orléans… et femme d’une franchise truculente, qui n’hésite pas à montrer les dessous les moins nobles de la Cour. La comédienne Marie Grudzinski la fait vivre avec beaucoup de malice, de drôlerie et de réalisme.
Théâtre des Corps Saints, Compagnie Théâtre du Loup Blanc. http://theatreloupblanc.net
 Pas de bon théâtre sans un bon texte. Les mots, parfois, peuvent devenir personnages, mis en scène avec malice. Le spectacle de et avec Michaël Hirsch, judicieusement intitulé Pourquoi ? (mise en scène d’Ivan Calbérac), pose avec drôlerie les questions qui se succèdent dans la tête des humains, de l’enfance à la vieillesse. Les mots sont triturés, manipulés, déformés, et bien sûr les questions restent en suspens… On est complice, on rit et on réfléchit. L’essentiel.
Pas de bon théâtre sans un bon texte. Les mots, parfois, peuvent devenir personnages, mis en scène avec malice. Le spectacle de et avec Michaël Hirsch, judicieusement intitulé Pourquoi ? (mise en scène d’Ivan Calbérac), pose avec drôlerie les questions qui se succèdent dans la tête des humains, de l’enfance à la vieillesse. Les mots sont triturés, manipulés, déformés, et bien sûr les questions restent en suspens… On est complice, on rit et on réfléchit. L’essentiel.
Théâtre du roi René, http://www.michaelhirsch.fr
 D’autres mots encore, et des trouvailles subtiles et impayables avec Déshabillez mots, nouvelle collection (mise en scène de Marina Tomé). Savez-vous ce qu’est la sérendipité, ou ce que cachent l’oxymore ou le quiproquo ? Saisissez-vous toutes les subtilités du point-virgule, le mal-aimé de la ponctuation ? On en entend, voit et apprend de belles avec ce spectacle où les deux comédiennes et auteures (Léonore Chaix et Flor Lurienne) s’en donnent à cœur et à corps joie, où tout est fignolé (mise en scène, allées et venues, dialogues, inventions verbales, jeux sémantiques, humour…). Beau déshabillage d’une langue française qui ne demande qu’à se laisser faire.
D’autres mots encore, et des trouvailles subtiles et impayables avec Déshabillez mots, nouvelle collection (mise en scène de Marina Tomé). Savez-vous ce qu’est la sérendipité, ou ce que cachent l’oxymore ou le quiproquo ? Saisissez-vous toutes les subtilités du point-virgule, le mal-aimé de la ponctuation ? On en entend, voit et apprend de belles avec ce spectacle où les deux comédiennes et auteures (Léonore Chaix et Flor Lurienne) s’en donnent à cœur et à corps joie, où tout est fignolé (mise en scène, allées et venues, dialogues, inventions verbales, jeux sémantiques, humour…). Beau déshabillage d’une langue française qui ne demande qu’à se laisser faire.
Le Petit Louvre, Templiers, François Volard, Acte 2. http://www.acte2.fr
Jean-Pierre Longre
16:59 Publié dans Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, littérature, festival off avignon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/07/2017
Une « palette bigarrée »
 Brèves n° 110, Nouvelles de Colombie, 2017
Brèves n° 110, Nouvelles de Colombie, 2017
Dans son introduction, Roberto Salazar Morales affirme qu’« il serait impossible de dresser, en quelques lignes, un tableau complet ou exhaustif de la littérature colombienne contemporaine, d’autant plus que celle-ci se caractérise essentiellement par un éclatement généralisé des thèmes et des formes. ». La richesse et la modernité de cette littérature se manifestent en particulier dans la nouvelle, qui est « le lieu privilégié d’une expérimentation formelle », et qui en Colombie semble avoir plus de succès que dans maints autres pays.
Ce numéro de Brèves, qui contribue par son existence aux manifestations de l’année France-Colombie, réunit grâce à Roberto Salazar Morales une « palette bigarrée de textes » d’auteurs contemporains, dont la plupart sont méconnus voire totalement inconnus en France (hormis chez les spécialistes ou les lecteurs avertis, on ne cite guère que Gabríel Garcia Márquez ou Alvaro Mutis). Anthologie salutaire, donc, qui donne un brillant aperçu de styles et de motifs divers. Littérature urbaine, aventures de la vie quotidienne, péripéties inattendues, humour noir, satire, visions poétiques… Toutes les tonalités, tous les registres, tous les sujets – le lecteur y trouve son plaisir, matière à rire ou à sourire, à satisfaire sa colère ou son goût de l’étrange, mais aussi matière à réfléchir : par exemple sur la difficulté à se faire publier ou sur la survie (momentanée) d’un poète (Rimbaud, en l’occurrence), sur la pérennité du tempérament et du sort d’Antigone, sur la vie et la mort… Les textes de Luis Fayad, Diana Ospina Obando, Luis Noriega, Carolina Sanin, Eduardo Garcia Aguilar, Jorge Aristizabal Gáfaro, Margarita Garcia Robayo, José Zuleta, Pablo Montoya, Juan Esteban Constain, Antonio Ungar, Ricardo Silva, Juan Alvarez, traduits par Anne Proenza, Samuel Monsalve, Marie Dadez, Roberto Salazar, Felipe Cammaert, sont complétés par des œuvres foisonnantes, colorées, transgressives de l’artiste Pedro Ruiz, savamment présentées par William Ospina, et par lesquelles on se laisse volontiers embarquer.
Plusieurs numéros de Brèves ont déjà été consacrés, en tout ou en partie, à des nouvelles venues de l’étranger. De la Nouvelle-Zélande à la Norvège, du Mexique à l’Estonie en passant par le Sénégal, l’Algérie ou la Roumanie, la littérature franchit allègrement les frontières géographiques, linguistiques et culturelles. Textes courts, dimensions internationales. Voilà, entre autres, ce qui se concocte à l’Atelier du Gué, rue du Village, à Villelongue d’Aude – et qui rayonne.
Jean-Pierre Longre
22:29 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle, colombie, roberto salazar morales, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/07/2017
Perec, la réapparition
 Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Claude Burgelin, Album Georges Perec, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Une parution en Pléiade, c’est à la fois un moment et un monument. À plus forte raison en ce qui concerne Georges Perec – et Christelle Reggiani commence son introduction, « Un peintre de la vie moderne », en insistant sur la combinaison entre « l’éternel et l’éphémère » qui apparaît, par exemple, dans Les Revenentes, mais aussi un peu partout. L’écrivain lui-même voyait dans son oeuvre « quatre champs différents, quatre modes d’interrogation » : les interrogations « sociologique », « autobiographique », « ludique » et « romanesque ». Ce qui réfère par exemple, pour évoquer les œuvres les plus connues, aux Choses, à W ou le souvenir d’enfance, à La disparition et à l’Oulipo, à La vie mode d’emploi. On pourrait ajouter que toute l’œuvre est traversée par le « rapport à l’histoire » et par « la mise sous contrainte de l’écriture », dont les liens sont étroits. Cela dit, Christelle Reggiani complète ces quatre « champs » par « deux pôles contraires » dans l’écriture : celui de la « blancheur » ou de la « platitude » et celui de « l’hermétisme affiché de la poésie hypercontrainte ».
 Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…
Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…
Et pour parfaire l’ensemble, Claude Burgelin, qui a bien connu l’écrivain, signe un très bel Album Georges Perec. Selon le modèle du genre, la biographie de l’auteur est parsemée de photos, de documents qui ne peuvent laisser indifférent, car ils mettent en avant une autre sorte de dualité de l’homme et de son œuvre, résumée dans ce paragraphe : « Perec a fait s’écrouler de rire des milliers de lecteurs ou d’auditeurs. Sa verve, sa drôlerie, sa façon de rendre sublime l’art du calembour sont étincelantes. En même temps son œuvre est issue d’une des pires barbaries de l’Histoire. Perec ne l’a jamais laissé oublier. Il n’a cessé de réfléchir à ce que fut le crime nazi et aux catastrophes qu’il a provoquées. Sa manière de faire tournoyer la force du comique, de l’ironie, et la violence de la tragédie met en place un ressort d’une rare puissance. ». C’est ainsi que l’écriture absolument maîtrisée de Perec est aussi une écriture de l’émotion absolue.
Jean-Pierre Longre
En complément, une réédition récente :
 Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017
Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017
Un rival de la littérature
Né en Chine, introduit au Japon en l’an 735, le jeu de Go est à la fois « esthétique, polémique et cérébral ». Rival de l’art et de la littérature, il demande un bon entraînement et des facultés intellectuelles avérées, et a parfois remplacé, nous dit-on, la guerre elle-même. En tout cas, il paraît que l’attaque de Pearl Harbor et l’occupation du Pacifique par les Japonais relèvent de ce jeu. Duel mené à coups de pièces noires et blanches sur une sorte de damier (le Go Ban), le Go pourrait faire penser aux Dames ou aux Échecs ; non, nous disent les auteurs, c’est un jeu beaucoup plus subtil, consistant non pas à détruire les adversaires, mais à occuper le plus de terrain possible avec le minimum de pièces (ou pierres).
 Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...
Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...
Évidemment encore, l’ouvrage n’est pas exempt de cet esprit oulipien qui guide les auteurs, dans leur perspective à la fois sérieuse et récréative. Aux définitions, aux éléments de tactique, au traitement des problèmes stratégiques, aux conseils décisifs se mêlent des intermèdes narratifs, des jeux verbaux, des imitations (un beau pastiche de Kipling), des allusions littéraires etc. Voilà qui contribue grandement au plaisir que nous éprouvons à lire ce livre, quel que soit notre passé, notre présent et notre avenir dans la pratique du jeu de Go. Et si celui-ci rivalise avec la littérature, n’hésitons pas à affirmer que ledit livre est autant une œuvre littéraire qu’un « petit traité ».
Jean-Pierre Longre
www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-P...
http://associationgeorgesperec.fr
10:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, poésie, autobiographie, essai, francophone, georges perec, christelle reggiani, dominique bertelli, claude burgelin, florence de chalonge, maxime decout, maryline heck, jean-luc joly, yannick séité, pierre lusson, jacques roubaud, christian bourgois, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/07/2017
L’art de l’entre-deux
 Gaëlle Josse, L’ombre de nos nuits, Les Éditions Noir sur Blanc, 2016, J’ai Lu, 2017
Gaëlle Josse, L’ombre de nos nuits, Les Éditions Noir sur Blanc, 2016, J’ai Lu, 2017
Il y a dans L’ombre de nos nuits deux récits et trois voix. À Lunéville, en 1639, dans cette Lorraine tourmentée par la guerre, le paisible atelier de Georges de La Tour va voir naître, sous les pinceaux du maître, le magnifique Saint Sébastien soigné par Irène, tableau pour lequel il emprunte des traits familiers : ceux de sa fille Claude, de la fille de sa servante, Marthe, et du fils de voisins. Le peintre rapporte lui-même les étapes de son travail, ses difficultés, ses réussites, ses ambitions (celle, notamment, de porter son œuvre au roi de France). De son côté, son apprenti Laurent, orphelin recueilli par la famille, raconte ce qu’il voit, entend, fait – et les deux voix se superposent et se complètent mutuellement, donnant deux visions de l’élaboration du chef-d’œuvre.
En alternance, nous nous retrouvons périodiquement à notre époque. À Rouen, au printemps 2014, une jeune femme, troisième narratrice, découvre entre deux trains le tableau de Georges de La Tour. La vision d’Irène penchée sur le corps blessé de Saint Sébastien lui rappelle l’amour passionné, tourmenté qu’elle a éprouvé pour B, et qu’elle croyait avoir oublié. Occasion pour elle de revivre les enthousiasmes, les attentes déçues, les souffrances de l’amour, de remonter jusqu’à certains épisodes sombres de son enfance.
 Peu de rapports, dira-t-on, entre les deux histoires. En apparence. Bien sûr, du XVIIe siècle au XXIe, le tableau établit un lien concret. Mais au travers et au-delà de l’œuvre peinte, il y a ce que contient, avec subtilité et sensibilité, l’écriture romanesque. Les parallèles s’ouvrent entre la peinture et l’amour : « Comment un peintre aborde-t-il un sujet ? Comme un nouvel amour ? Collision frontale ou lente infusion ? La claque ou la pieuvre ? Le choc ou la capillarité ? Plein soleil ou clair-obscur ? Toi, tu m’avais éblouie. Ensuite, je me suis aveuglée. ». Surtout, se dessinent le jeu des ombres et des lumières, ces entre-deux que l’art et la vie ménagent : « Nous sommes à la lisière de l’ombre et du feu, du souffle et du silence, c’est ce que je tente de montrer sur mes toiles. J’y vois le sens de notre condition humaine, sans cesse oscillant entre la joie et la peine, la bonté et la haine, la main tendue et le poing fermé, les élans les plus généreux et les pensées les plus noires. ». C’est bien de cela qu’il s’agit, comme souvent chez Gaëlle Josse : saisir par le verbe et son agencement mystérieux les sensations cachées sous les gestes de la vie et les rapports humains. Cela passe forcément par l’art. Ici, celui des couleurs et des lumières, celui des sons, celui des mots.
Peu de rapports, dira-t-on, entre les deux histoires. En apparence. Bien sûr, du XVIIe siècle au XXIe, le tableau établit un lien concret. Mais au travers et au-delà de l’œuvre peinte, il y a ce que contient, avec subtilité et sensibilité, l’écriture romanesque. Les parallèles s’ouvrent entre la peinture et l’amour : « Comment un peintre aborde-t-il un sujet ? Comme un nouvel amour ? Collision frontale ou lente infusion ? La claque ou la pieuvre ? Le choc ou la capillarité ? Plein soleil ou clair-obscur ? Toi, tu m’avais éblouie. Ensuite, je me suis aveuglée. ». Surtout, se dessinent le jeu des ombres et des lumières, ces entre-deux que l’art et la vie ménagent : « Nous sommes à la lisière de l’ombre et du feu, du souffle et du silence, c’est ce que je tente de montrer sur mes toiles. J’y vois le sens de notre condition humaine, sans cesse oscillant entre la joie et la peine, la bonté et la haine, la main tendue et le poing fermé, les élans les plus généreux et les pensées les plus noires. ». C’est bien de cela qu’il s’agit, comme souvent chez Gaëlle Josse : saisir par le verbe et son agencement mystérieux les sensations cachées sous les gestes de la vie et les rapports humains. Cela passe forcément par l’art. Ici, celui des couleurs et des lumières, celui des sons, celui des mots.
Jean-Pierre Longre
10:43 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, les Éditions noir sur blanc, j’ai lu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/07/2017
« Devenir autre, devenir moi »
 Auđur Ava Ólafsdóttir, L’Embellie, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2017
Auđur Ava Ólafsdóttir, L’Embellie, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2017
« Là, tout va par trois, dit-elle, trois hommes dans votre vie sur une distance de trois cents kilomètres, trois bêtes mortes, trois accidents mineurs ou plutôt trois incidents malencontreux et il n’est pas certain qu’ils vous affectent directement, des bêtes seront estropiées, hommes et femmes vivront. Il est tout de même clair que trois bêtes mourront avant que vous ne rencontriez l’homme de votre vie. ». La voyante a bizarrement tout anticipé ; sans qu’on s’en doute, sans qu’on y croie vraiment, le roman est contenu dès le début dans ces paroles. Le roman, non : les faits qui en constituent la trame narrative ; le reste (l’essentiel) réside dans l’art inimitable de la conteuse Auđur Ava Ólafsdóttir : son écriture, sa maîtrise de la structure romanesque, son attachement contagieux aux personnages.
Elle aurait de quoi pester ou avoir le cafard, la jeune femme de 33 ans, polyglotte, traductrice et correctrice de son état, qui raconte ici son histoire (son histoire actuelle, et des souvenirs qui lui viennent par bribes en fonction des événements) : elle quitte son amant juste avant que son mari la quitte, des animaux viennent se jeter sous les roues de sa voiture, son amie Auđur, enceinte de jumeaux, lui confie son fils Tumi, mal entendant, mal voyant, alors qu’elle ne s’est jamais occupée d’enfants… En revanche, le pur hasard lui sourit, puisqu’elle gagne coup sur coup un chalet « prêt-à-monter » et une fortune au loto. Tout cela entraîne pour elle un changement radical de vie, qu’elle entérine en décidant de partir vers l’est, en ce mois de novembre islandais particulièrement pluvieux, sur une route littorale pleine d’embûches, pour rejoindre le village de son enfance, en coupant tout lien avec son passé immédiat. « Me voilà en vadrouille dans le noir et la pluie avec un enfant qui ne m’est rien, trois animaux de compagnie dans un bocal, un petit tas de documents qui ne valent pas d’être mentionnés et, last but not least, une boîte à gants bourrée de billets de banque : tout baigne. ».
Situations cocasses, péripéties périlleuses, réactions inattendues, décisions de dernier moment, paroles (et plus) échangées sans hésitations avec des inconnus, communication intense et mystérieuse avec son petit protégé… L’héroïne mène son périple avec une obstination salutaire et une volonté sans faille ; elle y trouve son bonheur : « En réalité, je ne puis guère être plus heureuse, car je commence à savoir qui je suis, je commence à devenir autre, devenir moi. ». Roman de l’aventure extérieure et intérieure, de la transformation de soi, plein d’humour et de tendresse, L’Embellie se lit avec d’autant plus de délectation que sa dernière partie est entièrement consacrée à « quarante-sept recettes de plats ou de boissons ainsi qu’une recette de tricot qui interviennent au fil » du récit. À expérimenter, et à consommer à loisir.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, islande, auđur ava Ólafsdóttir, catherine eyjólfsson, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/06/2017
Laisser dormir le passé
 Francis Dannemark, Martha ou la plus grande joie, Le Castor Astral, 2017
Francis Dannemark, Martha ou la plus grande joie, Le Castor Astral, 2017
Le passé de Martha est douloureux : son mari radiologue « mort d’un cancer foudroyant » en 2011, puis pour elle une grave chute qui a entraîné deux ans d’hospitalisation et de soins divers, ainsi qu’une mémoire défaillante et des réactions parfois déconcertantes. Malgré cela, avec ses gestes et ses mots inattendus et au fond si appropriés, son sourire contagieux et son regard curieux de tout, c’est un vrai bonheur qui émane de toute sa personne.
Avec son frère jumeau Martin (le narrateur), elle rend visite à Jeanne, une dame âgée qui vit dans l’Yonne et a des révélations à leur faire à propos de leur père. Des révélations qui vont plus loin que ce à quoi ils s’attendaient, donnant une dimension nouvelle à la vie et à la personnalité de leur père et de ses relations avec cette vieille femme d’autant plus attachante que son récit est d’une sincérité absolue, nécessaire et vitale : « Jeanne a cessé de parler. Je l’ai vue fermer les yeux, comme s’il s’agissait de se concentrer très fort. Quelques minutes plus tôt, j’avais senti monter en moi une peur sourde, allait-elle s’effondrer, ou s’éteindre comme une bougie ? Non, elle irait jusqu’au terme de son récit. C’est de la force que je sentais en elle maintenant, et j’en étais bouleversé. ».
Autour de l’histoire centrale en tournent quelques autres, en particulier celle de John, écrivain irlandais dont Martin traduit les œuvres, qui est bizarrement accusé de plagiat et qui s’est retiré du monde pour vivre en paix dans un petit village. L’auteur en fait à l’occasion son porte-parole stylistique : « J’ai peur des trop belles phrases. L’important, c’est qu’une phrase soit si juste qu’on en oublie qu’elle est belle. » – et voilà qui se vérifie à la lecture du roman de Francis Dannemark, dont l’écriture comme naturelle ne laisse rien au hasard.
Oublions donc la beauté des phrases pour apprécier celle des personnages et de leur monde. Malgré les accidents de la vie, les incertitudes de la volonté et les caprices du destin, aucun être n’est mauvais ; tous sont profondément humains : Jeanne à coup sûr, et les hommes qu’elle a connus ; Septime le garagiste au grand cœur, qui ravive celui de Martha ; le frère, la sœur et leur famille… Et ces êtres humains, dans leurs gestes, leurs paroles, donnent à l’ensemble une atmosphère apaisante dont l’oubli des fêlures est une condition : « Le passé a bien le droit de dormir maintenant. Moi, en tout cas, je n’ai plus envie de le réveiller. », dit Martha qui préfère contempler les fleurs bleues ; la fleur bleue, cet idéal que, depuis Novalis, beaucoup se sont échinés à chercher, et qui semble ne pouvoir se réaliser que si sa recherche s’accompagne de « la plus grande joie ». Et la vie va s’écouler, paisible comme l’Yonne.
Jean-Pierre Longre
23:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, francis dannemark, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/06/2017
Franz, Caroline et la musique
 Gaëlle Josse, Un été à quatre mains, Ateliers Henry Dougier, 2017
Gaëlle Josse, Un été à quatre mains, Ateliers Henry Dougier, 2017
De mai à octobre 1824, quatre ans avant sa mort prématurée, Franz Schubert séjourna au château de Zseliz, résidence estivale de la famille Esterhazy, en tant que maître de musique des deux filles de la maison. Parenthèse rurale de relatif bonheur mêlé de mélancolie et de quelque regret de la vie animée de Vienne – vie de travail, de rencontres, d’espoir artistique, de misère aussi, sans compter la maladie qui l’a miné durant l’année 1823. Le jeune homme timide et peu familier des rites aristocratiques trouve dans la campagne hongroise, malgré les conventions et barrières sociales, une sorte de paix intérieure, de sérénité baignée de musique, et l’amour de la fille cadette des Esterhazy, Caroline ; amour jamais révélé, sinon par quelques coups d’œil involontaires et quelques gestes à peine esquissés.
Gaëlle Josse relate ici l’histoire romancée de cet amour, qui fait corps avec la musique : « C’est pour elle que tout lui vient, là, toute cette musique qui déferle, qui l’envahit et qu’il reçoit comme elle lui vient, une source vive, un jaillissement ininterrompu. ». Un amour dont on se doute qu’il est secrètement partagé, qui est pourtant voué à l’inaccomplissement et qui précipitera le départ de Franz. Resteront dans leur mémoire les regards échangés, une « main abandonnée » et « toute cette musique partagée ». Autour du récit principal se profilent d’autres épisodes de l’existence du compositeur, des rappels de sa vie viennoise, de ses difficultés, de ses travaux. Gaëlle Josse, dont nous apprenons dès le début du livre que la musique de Schubert l’ « accompagne depuis longtemps, depuis toujours », connaît parfaitement sa vie et son œuvre.
Surtout, ces pages, rythmées par les vers de La belle meunière, sont un hymne à l’amour et à la musique, inséparables l’un de l’autre ; la narration romanesque, l’analyse psychologique et artistique sont menées avec la délicatesse poétique que l’on trouve dans d’autres œuvres de l’auteure. « Schubert parle au cœur, en accompagnant les plus ténus, les plus impalpables de nos états émotionnels intérieurs, sa musique nous atteint avec une désarmante simplicité, comme la main d’un ami posée sur notre épaule. Si peu de choses, bien souvent, pour y parvenir. Si peu de notes, parfois, pour nous réjouir ou nous consoler. ». On pourrait en dire autant de la prose harmonieuse de ce dense et bref roman.
Jean-Pierre Longre
12:02 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, musique, franz schubert, gaëlle josse, ateliers henry dougier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/05/2017
Dynamite financière
 Martin Suter, Montecristo, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Christian Bourgois éditeur, 2015, Points, 2017
Martin Suter, Montecristo, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Christian Bourgois éditeur, 2015, Points, 2017
Jonas Brand, qui tourne des vidéos « people » pour vivre, mais rêve de devenir un vrai cinéaste, est le témoin privilégié de deux événements apparemment indépendants l’un de l’autre : le suicide (ou le meurtre ?) d’un homme se jetant d’un train, et l’acquisition fortuite de deux billets de cent francs suisses portant le même numéro de série et tous deux authentiques. Son métier et son professionnalisme de reporter le poussent à enquêter sur ces deux « incidents » qui, se révélant finalement liés, vont s’avérer bien plus graves qu’il n’y paraissait.
Tenace, persévérant, efficace, Jonas s’enfonce dans les méandres d’une enquête qui menace à chaque instant de l’étouffer ou de lui exploser à la figure. Pour détourner son attention, « on » lui trouve un financement miraculeux pour qu’il puisse réaliser le film dont il rêvait, Montecristo, une fiction narrant elle-même le piège dans lequel un individu est pris, et qui manque de coûter sa liberté et peut-être sa vie au réalisateur en personne. Les investigations qu’il poursuit envers et contre tout lui valent beaucoup de déboires, d’angoisses, de pertes (celle, notamment, de son ami Max dans un incendie faussement accidentel), lui font aussi connaître le grand amour, les doutes, la trahison, et l’introduisent dans les arcanes de la haute finance suisse et mondiale, des spéculations et des manipulations qui la caractérisent.
 Martin Suter sait tenir son lecteur en haleine. Le sujet traité (manœuvres de traders, bulles financières…) aurait pu être aride. Il n’en est rien : le récit avance à coups d’épisodes aussi brefs qu’acérés, se succèdent, s’imbriquent, s’emboîtent comme dans la reconstitution d’un puzzle. Un « thriller », avec les ingrédients nécessaires au suspense, certes, mais un thriller qui met en jeu non seulement la vie de personnages attachants ou repoussants, mais aussi la destinée de toute une société, de tout un pays, jusqu’au fonctionnement de l’économie mondiale. Comme le dit le « directeur de l’administration helvétique des finances » : « Nous continuons tous à planer dans la grande bulle de savon. Et nous allons y évoluer aussi prudemment que possible, car personne ne veut la voir éclater. ». Voilà qui donne à réfléchir…
Martin Suter sait tenir son lecteur en haleine. Le sujet traité (manœuvres de traders, bulles financières…) aurait pu être aride. Il n’en est rien : le récit avance à coups d’épisodes aussi brefs qu’acérés, se succèdent, s’imbriquent, s’emboîtent comme dans la reconstitution d’un puzzle. Un « thriller », avec les ingrédients nécessaires au suspense, certes, mais un thriller qui met en jeu non seulement la vie de personnages attachants ou repoussants, mais aussi la destinée de toute une société, de tout un pays, jusqu’au fonctionnement de l’économie mondiale. Comme le dit le « directeur de l’administration helvétique des finances » : « Nous continuons tous à planer dans la grande bulle de savon. Et nous allons y évoluer aussi prudemment que possible, car personne ne veut la voir éclater. ». Voilà qui donne à réfléchir…
Jean-Pierre Longre
17:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, suisse alémanique, martin suter, olivier mannoni, christian bourgois éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2017
« Le goût des mots »

Dany Laferrière, L’art presque perdu de ne rien faire, Grasset, 2014, Le livre de poche, 2017
Ne nous y trompons pas. Même si, çà et là, y figurent des textes intitulés « L’amateur de sieste », « Éloge de la lenteur » ou « L’art de dormir dans un hamac », même si la nonchalance y est avec bonheur communicative, le livre de Dany Laferrière n’est pas un livre de vrai paresseux. C’est une somme de réflexions, de méditations, de variations, de confidences, d’analyses sur des sujets liés à l’existence humaine en général et à l’expérience de l’écrivain en particulier, et pour lesquels, certes, la tranquillité est de mise.
Vingt-trois chapitres eux-mêmes composés de plusieurs textes autonomes, que l’on peut lire comme les Essais de Montaigne, « à sauts et à gambades », avec la lenteur voulue, que l’on peut savourer, garder en bouche tout en se laissant aller aux rêveries et aux pensées qu’ils suscitent. C’est un choix infini de thèmes et de motifs qui nous est proposé : le temps, les rapports sociaux, l’amour, la mort, les voyages, la culture, le plaisir, la peur, la violence, le pouvoir, la nostalgie, l’art et, bien sûr, les livres et les écrivains préférés – le tout n’étant pas exempt de quelques épisodes autobiographiques, de quelques souvenirs intimes. Cerise sur le gâteau, chaque chapitre est ponctué par un texte en vers libres, qui donne à ce que l’on peut considérer comme une mosaïque d’essais une belle touche poétique.
 Non que la prose de l’académicien Dany Laferrière soit aride, bien au contraire. Comme toujours chez lui, elle se caractérise par son pouvoir d’évocation et d’émotion, d’empathie et d’ironie, par sa sensualité, son humour, son « goût des mots » – pour reprendre le titre d’un texte inclus dans un chapitre ô combien prometteur, « Un orgasme par les mots »…
Non que la prose de l’académicien Dany Laferrière soit aride, bien au contraire. Comme toujours chez lui, elle se caractérise par son pouvoir d’évocation et d’émotion, d’empathie et d’ironie, par sa sensualité, son humour, son « goût des mots » – pour reprendre le titre d’un texte inclus dans un chapitre ô combien prometteur, « Un orgasme par les mots »…
On voudrait tout retenir de ce traité de vie, ou mieux, de ce roman de la vie. Car il s’agit bien de cela : Dany Laferrière se et nous raconte des histoires, des histoires qui donnent à penser, qui nous rendent intelligents, pour peu qu’on puisse l’être, des histoires qui aident à vivre. « J’ai toujours vu un lien entre la librairie et le cimetière », écrit-il. L’art presque perdu de ne rien faire nous fait retrouver l’idée que les livres nous aident à attendre calmement et délicieusement la mort.
Jean-Pierre Longre
22:43 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, francophone, dany laferrière, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/05/2017
"Humour et liberté" en quatre actes
 Didier Convard et Pascal Magnat, L’incroyable histoire du Canard enchaîné, Les arènes BD, 2016
Didier Convard et Pascal Magnat, L’incroyable histoire du Canard enchaîné, Les arènes BD, 2016
Il est né en 1915, en réaction à la grande boucherie qui faisait crever « dans le sang, la boue et les excréments » des millions de jeunes hommes. « Les va-t-en guerre avaient préféré dire aux Poilus qu’ils se battaient pour la France plutôt que pour leur portefeuille ! On meurt plus facilement pour une noble cause, n’est-ce pas ? ». Au printemps 1915, donc, réunion au domicile de Jeanne et Maurice Maréchal : outre les hôtes, il y a là le couple Gassier et Victor Snell – le noyau fondateur du Canard enchaîné, dès le départ « journal humoristique paraissant tous les mercredis », alors largement amputé par Anastasie (la censure).
Pendant les cent années qui ont suivi, et qui ont vu le journal s’étoffer, prendre de l’ampleur, il y a eu les hauts et les bas que toute publication régulière peut connaître, il y a eu des changements – d’équipes bien sûr, d’objectifs parfois – il y a eu les constantes majeures : faire rire à « coups de bec dans le ventre replet des industriels et des banquiers, des pousse-au-crime, des va-t-en guerre et autres ganaches de tout poil… », et rester absolument indépendant : pas d’allégeance, pas d’obligations envers quelque groupe que ce soit, pas de publicité. Et il s’en est toujours sorti, grâce à ses lecteurs de plus en plus nombreux, même si les critiques ont souvent fusé : « Si d’aventure on s’arrête pour faire un brin de causette avec l’instituteur socialiste, voilà le métallo communiste qui vient nous tirer par les basques : “Hé, camarade, attention, vous vous compromettez avec le parti américain.” Et si l’on boit un coup avec le métallo communiste, on vous crie de toutes part : “Alors, quoi, vous êtes du parti russe ?” ». Et l’humour, bien sûr : dessins, textes, jeux de mots, « noix d’honneur » etc. Tout cela pour mieux dénoncer les abus des possédants et des politiques, les violences sociales, l’autoritarisme et, surtout à partir des années 1970, les « affaires ». À la satire s’ajoute l’opposition à la hiérarchie autosatisfaite, à l’hypocrisie, à la mauvaise foi, à la langue de bois, à l’arrogance, à l’enrichissement à tout prix, à la malhonnêteté… Liste à poursuivre ad libitum…
Ce n’est pas une histoire comme les autres. « Incroyable », elle l’est par son protagoniste d’abord, ce canard grâce à qui nombre d’injustices, de coups tordus et de scandales ont pu être révélés, voire déjoués ; par la forme choisie ensuite : un vrai roman graphique, scénario parfaitement construit, texte riche et détaillé, images vivantes et variées – un roman théâtral aussi, en quatre actes assurés par la « Compagnie des Cancaniers », avec ouverture de rideau, défilés des personnages, salut final des nombreux acteurs, un rideau qui se referme sur l’image éternellement rieuse de Cabu, évoquant les pages noires des attentats. Drôles, instructives, émouvantes, ces pages de grande Histoire racontent le premier siècle d’un palmipède qui n’a pas encore fini de faire rire dans les chaumières et pester dans les palais, et auquel on souhaite évidemment longue vie. Qu’il poursuive dans la bonne humeur et le bec toujours bien acéré son œuvre de salubrité morale, politique et sociale.
Jean-Pierre Longre
10:43 Publié dans Essai, Humour, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, le canard enchaîné, didier convard, pascal magnat, Éditions des arènes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/05/2017
Entre Mer et Montagne
 Auđur Ava Ólafsdóttir, Le rouge vif de la rhubarbe, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2016
Auđur Ava Ólafsdóttir, Le rouge vif de la rhubarbe, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2016
Ágústína est née dans la voiture de Vermundur, l’ami de la famille, alors qu’il emmenait la future mère à l’hôpital régional dans le brouillard et la pluie. Les routes islandaises ne sont pas de tout repos, et des complications de cette naissance la jeune fille a gardé de lourdes séquelles : deux jambes paralysées et atrophiées, béquilles obligatoires pour se déplacer. Qui plus est, son père est reparti sur son bateau tout de suite après sa conception, sans rien savoir de ce qu’il laissait derrière lui, et sa mère vit à l’autre bout du monde, poursuivant des recherches sur les oiseaux et lui envoyant de temps à autre quelques nouvelles et de vagues promesses de retour au pays.
C’est avec Nína, vieille femme affectueuse, bienveillante et sage, qu’Ágústína passe son enfance et son adolescence. Une vie d’écolière particulièrement douée et particulièrement originale, qui « commence par les bords », comme dit son professeur, et qui regarde les autres, le monde et les événements en les considérant dans des dimensions et selon des critères bien à elle. « Ce n’est pas seulement ce qui se passe qui a de l’importance, mais aussi ce qui ne se passe pas. ». Rythmée par les plats, confitures et gâteaux confectionnés par Nína, par les visites de Vermundur, celles du jeune Salómon avec qui elle partage des sentiments naissants, par l’école, les séances de cinéma et les quelques activités associatives et culturelles de ce petit village côtier plongé la plupart du temps dans la nuit, la vie de la jeune fille est un mélange de quotidienneté et de rêverie, de réalité et de fiction, de contraintes physiques et de grands projets. « Ágústína a acquis très tôt le sentiment de sa singularité dans l’univers. ». La mer, les oiseaux, la Montagne, le champ de rhubarbe où elle fut conçue et où elle se réfugie – cette rhubarbe qui donne lieu à des concours de confiture chez les ménagères du village –, voilà son monde, avec lequel elle semble souvent ne faire qu’un.
Se confondre avec la plage et l’eau glacée de la mer, ou avec le sommet de la Montagne dont elle projette de gravir, armée de ses béquilles, les huit cent quarante-quatre mètres : Ágústína est une fille de la nature, de cette nature islandaise pleine d’inimitié pour les autres, mais si amicale à ses propres yeux. « Le monde réside dans les yeux de celui qui regarde », dit l’ophtalmo. C’est par le regard particulier du personnage et par la grâce d’une écriture qui présente avec douceur et simplicité les nuances complexes et la dureté de l’existence que le livre d’Auđur Ava Ólafsdóttir est un roman véritablement poétique.
Jean-Pierre Longre
17:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, islande, auđur ava Ólafsdóttir, catherine eyjólfsson, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/04/2017
Les leurres et la vérité de Terezin
 Antoine Choplin, Une forêt d’arbres creux, La fosse aux ours, 2015, Points, 2017
Antoine Choplin, Une forêt d’arbres creux, La fosse aux ours, 2015, Points, 2017
Terezin, trop fameuse localité, dont les nazis firent un ghetto, un camp de concentration, un lieu de transit vers l’extermination. Parmi beaucoup d’autres, y fut détenu Bedrich Fritta, dessinateur et caricaturiste tchèque, ainsi que sa femme et son petit garçon. Les geôliers, connaissant ses talents, le chargèrent, avec une quinzaine d’autres prisonniers, de dessiner les plans du futur crématorium et d’autres éléments de prétendue amélioration du lieu, donc de faire en quelque sorte leur métier malgré eux, ce qui leur valut « une joie presque, secrète et immobile, surplombant les parois du ghetto, réduisant à néant, le temps d’une seconde, les tragédies. ».
De ce dilemme monstrueux, de cette très relative liberté de façade, Antoine Choplin rend compte avec une fine délicatesse et une cruelle vérité. Le récit commence et finit avec des arbres (d’où le titre), des arbres à la fois bien présents et symboliques de la souffrance, des « corps décharnés », de l’enfermement (juste derrière les ormes évoqués au début passe « la clôture de fils de fer barbelés ») et de l’illusion. Car l’apparente douceur que recèlent les quelques instants fugitifs de lumière et de liberté est un leurre, comme ce qui se fabrique dans le ghetto à l’annonce d’une visite de la Croix-Rouge : façades, couleurs, décorations cachant l’angoisse et l’atrocité de la vie quotidienne, la faim, la douleur, les convois, l’épuisement, la mort.
 Or Bedrich et ses compagnons ne veulent pas être uniquement les instruments des bourreaux nazis. Ils comptent témoigner. C’est pourquoi la nuit ils réinvestissent l’atelier où, la journée, ils obéissent aux commandes. En cachette, ils se consacrent à « la représentation de la réalité, sensible et nue. ». Chacun à sa manière dessine « la vérité de Terezin », pour qu’à l’extérieur on sache ce qui s’y passe vraiment.
Or Bedrich et ses compagnons ne veulent pas être uniquement les instruments des bourreaux nazis. Ils comptent témoigner. C’est pourquoi la nuit ils réinvestissent l’atelier où, la journée, ils obéissent aux commandes. En cachette, ils se consacrent à « la représentation de la réalité, sensible et nue. ». Chacun à sa manière dessine « la vérité de Terezin », pour qu’à l’extérieur on sache ce qui s’y passe vraiment.
C’est sur cette vérité que s’appuie l’auteur pour construire son récit. Tout y est conforme à la réalité, dans un style qui fait de cette réalité à la fois une narration romanesque et un questionnement existentiel et artistique, conforme aux réflexions de Bedrich : « Le talent du peintre réside-t-il dans la force et la justesse de sa contribution personnelle, ou, à l’inverse, dans une capacité de retrait afin de mieux se consacrer à la vérité, ses détours, ses irisations ? ». Malgré le drame, et au-delà des mensonges et des souffrances, au-delà de la mort même, subsistent ces « irisations » de la vérité.
Jean-Pierre Longre
17:36 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, antoine choplin, bedrich fritta, la fosse aux ours, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/04/2017
Feuilles à foison
 Journal littéraire Le Persil, 2016-2017
Journal littéraire Le Persil, 2016-2017
Comment se fait-il que quelques revues littéraires – rares, il faut l’avouer – restent actives d’année en année à un rythme soutenu ? Ténacité, pluralité, diversité. Prenons exemple sur Le Persil – pas vraiment « revue », mais « journal », selon l’aveu même inscrit dans l’oreille qui jouxte la manchette (« Journal inédit, Le Persil est à la fois parole et silence ») et le format de la publication.
La ténacité, c’est celle de son initiateur et responsable, Marius Daniel Popescu, poète, romancier, personnalité du monde culturel suisse et roumain, toujours à l’offensive et sur la brèche, soutenu par les « Amis du Journal Le Persil ». La pluralité, la diversité, ce sont celles des auteurs qui emplissent les pages de leurs textes aux tonalités, aux formes, aux sujets d’une variété infinie.
 Considérons les dernières livraisons.
Considérons les dernières livraisons.
Novembre 2016, n° 127-128-129 : « Spécial polar romand », publié sous la responsabilité de Giuseppe Manone (par ailleurs président de l’Association des Amis du journal le Persil), comprenant une bibliographie du polar romand, des entretiens, des présentations d’auteurs et d’ouvrages et, bien sûr, des histoires policières. Avis aux amateurs…
Décembre 2016, n° 130-131-132 : « Atelier d’écriture avec des étudiants du Gymnase de la Cité de Lausanne. Visite de l’Institut littéraire de Bienne. Voyages ». Poèmes, proses, accompagnés d’images de Marie-José Imsand, un dossier sur Matthieu Ruf, Prix Georges-Nicole 2016… Le terme de « diversité » prend ici tout son sens.
Hiver 2016-2017, n° 133-134 : carte blanche à Germano Zuldo et Albertine, « qui ont demandé à vingt auteurs et illustrateurs de s’approprier le thème du territoire ». Textes et illustrations y rivalisent d’originalité, de personnalité – preuve s’il en est besoin qu’une contrainte thématique n’empêche pas et, au contraire, favorise la création.
Janvier 2017, n° 135-136 : « Bonnes feuilles » présentant des extraits de « livres à paraître en 2017 dans treize maisons de Suisse romande », annonçant « le joli printemps des maisons d’édition romandes ». Là encore, il y a de tout, un tout prometteur qui préfigure la qualité des publications à venir.
Cette brève présentation ne permet pas d’entrer dans le détail des feuilles foisonnant d’invention, de connaissances, de talents en germe ou en pleine maturité, d’imagination. Au lecteur de se faire explorateur de ce que Germano Zuldo et Albertine qualifient à juste titre de « formidable espace de création et de liberté ».
Jean-Pierre Longre
https://www.facebook.com/journallitterairelepersil
Le persil journal, Marius Daniel Popescu, avenue de Floréal 16, 1008 Prilly, Suisse.
E-mail : mdpecrivain@yahoo.fr
Association ses Amis du journal Le persil : lepersil@hotmail.com
10:30 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, francophone, suisse, le persil, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/04/2017
« Je viens vivre »
 Patricia Cottron-Daubigné, Ceux du lointain, L’Amourier, 2017
Patricia Cottron-Daubigné, Ceux du lointain, L’Amourier, 2017
Variation sur une question bien connue : peut-on faire de la « bonne poésie » avec de « bons sentiments » ? Oui, si ceux-ci ne sont pas une excuse, et si la poésie en question n’est pas un alibi. Et oui, les poèmes de Patricia Cottron-Daubigné chantent avec force, douleur et vérité la force, la douleur et la vérité de ceux qui cherchent refuge contre la violence, « ceux à qui nous enlevons même / la petitesse d’un pré-fixe comme un bout de terre » : « im-migrants », « é-migrants », « migrants » tout court…
Le poète d’aujourd’hui n’est pas seul à dénoncer « la cruelle désolation », « la guerre, la fuite, l’errance ». C’est sur L’Énéide de Virgile que Patricia Cottron-Daubigné fait reposer toute la première partie de son livre, « Énée de Syrie » rappelant « Énée de Troie », « exilé de tous les siècles de tous les lieux », portant son père et le poids de la guerre sur ses épaules. « C’est chez Virgile que je lis ce que je cherche dans mes mots depuis des mois. Je lis, je regarde, je cherche, je pleure, j’ai honte, j’écris. » (ce « j’écris » deviendra pluriel à la toute fin du recueil : « nous écrirons », manière d’implication collective dans le drame de ceux qui ont à franchir « tant d’écueils et tant d’eau »).
Implication dans l’histoire, implication dans l’écriture de l’actualité : ce peut être le rythme du vers mimant la marche exténuante : « je marche / je ne sais plus / le jour / j’ai compté / au début / puis la peur / a remplacé / les jours / et les nuits… » ; ce peut être un poème infini fait des noms de ceux qui sont morts « en Méditerranée et sur les routes d’Europe ». Cela n’exclut ni les évocations des « camps » délabrés où vivent ceux et celles chez qui l’on voyait « le bel imaginaire de l’enfance lointaine et des livres, des poèmes, du rire et du mouvement, du voyage libre, des jupes et des grands yeux noirs », ni celles du « ban », cette « banlieue de la banlieue » où sont relégués les « bannis », ni le chantant contraste entre la misère et le rire de Brika la Rom.
Ceux du lointain met en poésie les rivages, les naufrages, les images des hommes, des femmes, des enfants que, trop souvent, nous ne voulons pas voir malgré « le flot des mots » et « le mouvement des écrans ». Comme si l’auteure avait décidé que l’expression de notre « honte », de notre « sauvagerie » ne pouvait passer que par la poésie. Elle a raison, avec Virgile et quelques autres, de leur donner au moins le réconfort des mots, de leur donner la parole : « je ne viens rien conquérir / je viens vivre. ».
Jean-Pierre Longre
10:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, patricia cottron-daubigné, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/03/2017
L’écume du malheur
 Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Dans l’avant-propos de L’écume des jours, Boris Vian proclame la primauté, dans la vie comme dans son livre, de l’amour (sans oublier une certaine musique de jazz), et dévoile son principe romanesque : « Les quelques pages de démonstration qui suivent tirent toute leur force du fait que l’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ». À la fin de sa présentation de D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère écrit ceci : « Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d’extrême pauvreté, de justice et surtout d’amour. Tout y est vrai ». Faut-il arrêter ici la comparaison ? Sans doute, mais si elle m’est venue à l’esprit malgré le paradoxe, c’est parce que dans les deux cas les récits sont profondément humains et profondément « vrais », l’humanité et la vérité empruntant des chemins littéraires différents – l’imaginaire fantaisiste et l’humour (noir) dans le premier, la relation précise et sans concessions des faits réels dans le second. L’amour, la tendresse, l’amitié, la maladie, la mort, le malheur sont en tout cas, dans l’un et l’autre roman, le substrat humain qui fonde le besoin d’écriture et le désir de lecture.
 On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
Événements pathétiques s’il en est, racontés sans pathos, avec des détails que l’on sent précisément choisis, dans leur apparente objectivité et à travers quelques exemples individuels, pour montrer la confiance que l’on peut avoir dans l’amour humain (ce sont bien, d’ailleurs, les malheurs dont ils sont témoins qui renforcent les sentiments que se portent l’auteur et sa compagne, et finalement sauvent leur couple). Les personnes réelles deviennent des personnages symboliques de l’humanité, dans tous les sens du terme. Ils sont modestes (petites familles, petits juges), les morts ne sont ni héroïques ni vraiment exceptionnelles (catastrophe naturelle, cancer), mais ce qui est représenté, c’est le pouvoir qu’a chaque être humain, confronté à la fatalité, de changer la vie, de combattre la souffrance, de ressouder les liens, et aussi de peser sur les contraintes sociales, de protéger les pauvres, de braver la puissance des groupes financiers quand on est un « petit juge de province » obstinément épris de justice… Dans l’écume du malheur, il y a toujours de la place pour l’expression poignante de l’amour, et d’une œuvre de « commande », il y a toujours de quoi faire un beau roman.
Jean-Pierre Longre
16:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, emmanuel carrère, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/03/2017
Désespérer, fuir, rêver ?
 Clotilde Escalle, Mangés par la terre, Les éditions du sonneur, 2017
Clotilde Escalle, Mangés par la terre, Les éditions du sonneur, 2017
Enfermement et délabrement ; désespoir ou résignation : avant même l’ouverture du livre, un regard jeté à l’illustration de couverture annonce l’atmosphère, campe le paysage mental des personnages. « Que peut-on faire dans un patelin où la seule direction à prendre est celle de la salle polyvalente ? Panneau cloué sur un poteau, lettres fines et allongées, en italique, noires sur fond blanc, la petite flèche tout de suite après. Envie de vomir, toute la tristesse du monde – les pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi ces jambes, ces seins, etc. – toute cette tristesse prend forme, là, à la lecture de ce panneau. ». Voilà, dans la tête de Jeanne, qui résume ce paysage.
Elle rêve de partir en Amérique avec son copain Éric, qui fait dans la brocante et ne rechigne pas à la bagatelle. Et il y a les autres. Caroline, odieusement repoussée par sa mère, qui la fait passer pour folle et interner dans un asile où elle devient poupée martyre, brutalisée et aimée par deux frères débiles, Patrick et Robert ; Édouard Puiseux, le notaire engoncé dans son univers étriqué, entre les rivalités familiales qui se succèdent dans son étude, le papier peint de sa chambre et la passion jalouse et sans retour que lui voue sa servante Gabrielle. Destins divers, secrets particuliers qui se révèlent tour à tour mais qui se recoupent par leur nature même et par le croisement des chemins. Le notaire couche sans illusions et sans amour avec Agathe, la mère indigne de Caroline, laquelle partage une amitié rêveuse d’adolescente avec Jeanne. L’univers de Copiteau (le village, dont « on ne peut pas dire grand-chose ») se replie sur lui-même, se love dans l’avachissement glauque de ses habitants « mangés par la terre ».
Ce serait désespérant à mourir, s’il n’y avait les rêves de fuite, et surtout ce qui se crée, ou en tout cas ce qui se loge dans les livres et les cahiers. Le notaire Puiseux lit Chateaubriand au hasard, Paul, le frère des deux brutes de l’asile, « récite des poèmes pour se consoler », Jeanne dessine des villes imaginaires, Caroline soliloque, crie, se souvient en écrivant dans ses cahiers… Et Clotilde Escalle raconte tout cela en se coulant dans les voix de ses personnages, sans concessions, crûment parfois, en une poésie brutale et rageuse, en phrases assénées comme des coups, avec juste ce qu’il faut de recul littéraire pour faire de ce réalisme sordide un sujet de roman captivant, d’une beauté cruelle, et qui, pourquoi pas, ménage sa part de rêve par la force des mots.
Jean-Pierre Longre
http://www.marcvillemain.com/archives/2017/03/15/34813884...
10:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, clotilde escalle, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/03/2017
De moderne en classique
 Maxime Decout, Qui a peur de l’imitation ?, Les éditions de minuit, 2017
Maxime Decout, Qui a peur de l’imitation ?, Les éditions de minuit, 2017
Maxime Decout a l’art de soulever les paradoxes auxquels la littérature confronte auteurs et lecteurs. En toute mauvaise foi (2015) avait déjà exploré ce qui se passe sous la surface de l’écriture, et l’auteur récidive avec Qui a peur de l’imitation ?, toujours publié dans la collection clairement nommée « Paradoxes » des éditions de Minuit. Récidive, sans toutefois se répéter. Car l’exploration concerne ici un phénomène inhérent à toute écriture et à toute pensée, et dont les nombreuses catégories peuvent se décliner à l’envi : « Le pastiche, la parodie, le travestissement burlesque, l’allusion, le plagiat », on en passe, sans compter ce qui relève de l’inconscient et des phénomènes « associés » tels que l’influence.
Paradoxes, disions-nous. Cela ne date pas d’aujourd’hui : « J’ai, avant tous les autres, porté de libres pas dans un domaine encore vacant. Mon pied n’a point foulé les traces d’autrui. […] Le premier, j’ai fait connaître au Latium les ïambes de Paros, imitant les rythmes et la vivacité d’Archiloque. ». Voilà ce qu’écrivait Horace dans ses Épîtres, et qui « commande une série de compromis incertains. », provoquant si l’on pousse loin la réflexion (ce qui est le cas) une sorte de vertige, en tout cas une instabilité constante. Tous les écrivains (et Maxime Decout s’appuie sur de multiples exemples, de l’Antiquité à nos jours, en passant bien sûr par Montaigne, La Fontaine, Chateaubriand, Flaubert, Proust, Gide, Joyce, Sartre…) « ont été amenés à confronter leur spontanéité mimétique au démon de l’originalité et aux démangeaisons de l’authenticité. ». Ils ont aussi mis en jeu les origines mêmes de l’acte littéraire ainsi que leur identité propre. « Car imiter, c’est s’engouffrer dans une zone de turbulence qui laboure les notions d’œuvre et d’auteur, puisque ce sont elles qu’on place facilement sous l’égide tyrannique de l’identité, de la singularité et de l’origine. ».
Pour ou contre l’imitation ? La question ne se pose pas vraiment, puisque tout écrivain, quelque original qu’il veuille être, est aussi un lecteur. Mais l’essai de Maxime Decout ne se contente pas du constat, ni de l’analyse des variations sur la question en fonction des périodes, des courants et des mouvements. En deux grandes parties (« Malaises dans l’imitation », « De l’imitation comme défi à l’imitation »), dans un style qui mêle avec bonheur didactisme, précision, objectivité, considérations personnelles, illustration abondante et complicité malicieuse (voir par exemple les titres de l’introduction et de la conclusion), l’auteur trace des itinéraires qui nous permettent de toucher, sur le chemin et au-delà du concept central d’imitation, des notions apparemment secondaires et en réalité importantes telles que celles de « supercherie littéraire », d’altérité (« Je est un autre »), de « plagiat par anticipation », d’« imitation réformatrice », de « communautarisme littéraire » ou encore celle, d’un intérêt majeur, de « mutualisme imitateur », qui, « pensé dans la durée, pourrait bien être aussi à l’origine de la cohésion stylistique et intellectuelle des mouvements littéraires ». Bref, n’ayons pas peur de l’imitation ; elle est là, constamment présente, et loin d’être négative ou honteuse, elle est constructive et constitutive de la chaîne créatrice : l’écrivain imite et est à son tour imité. Quoi de plus enviable pour lui de devenir à son tour un modèle ? C’est ainsi, finalement, que la littérature avance, faisant « d’un texte moderne un classique ».
Jean-Pierre Longre
10:25 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, maxime decout, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/02/2017
Les vertiges de la mémoire
 Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017
Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017
Tout commence avec la mémoire, et se poursuit avec le rêve. Le rêve est d’ailleurs le titre sous lequel les cinq textes du livre parurent dans les années 1980, amputés de certains passages par la censure, puis traduits par Hélène Lenz et publiés en France en 1992 chez Climats (édition maintenant épuisée). La Nostalgie est donc un livre au passé déjà chargé, aussi chargé que les histoires qui s’y trament.
Cinq textes autonomes, donc, mais qui entretiennent entre eux des rapports plus ou moins cachés (retours de personnages, de motifs, de mystères, type de style, progressions parallèles…), rapports qui se tissent à mesure que l’on avance sur la toile narrative – le leitmotiv de l’araignée tissant sa toile et étendant ses longues pattes sur le paysage ou les personnages est l’une des marques saisissantes de l’ouvrage.
Le « Prologue » s’ouvre sur les états d’âme d’un vieil écrivain « pleurant de solitude » et attendant la mort en essayant de « réfléchir ». « Voilà pourquoi j’écris encore ces lignes : parce que je dois réfléchir, comme celui qui a été jeté dans un labyrinthe doit chercher une issue, ne serait-ce qu’un trou de souris, dans les parois souillées d’excréments ; c’est la seule raison. ». Et l’« Épilogue » se ferme sur un autre vieillissement, universel celui-là, anéantissement et renaissance se faisant suite. Entre les deux, les cinq nouvelles cheminent parmi souvenirs et imagination, dans un réalisme fantastique qui ne laisse ni l’auteur, ni ses personnages ni le lecteur en repos.
La « nostalgie » est une pathologie psychique liée au regret du passé, certes, mais aussi à celui d’une situation idéale inatteignable. De fait, ici, chaque récit part d’un point du passé, d’un souvenir qui se tourne vers un univers intérieur échappant à l’entendement ordinaire, voire vers un anéantissement de soi au profit d’une apothéose littéraire ; c’est le cas avec « Le Roulettiste », dont le personnage n’arrive pas à mourir. La seconde nouvelle, « Le Mendébile », tient véritablement du souvenir d’enfance, racontant les jeux plus ou moins violents d’une bande de copains à l’arrière cafardeux d’un immeuble bucarestois des années 1970, avec portraits sans concessions et rivalités sans pitié, jusqu’à la souffrance extrême. Avec « Les Gémeaux », qui ménage un suspense narratif et érotique intrigant, nous suivons une progression vers une double métamorphose, un transfert à la fois intime et terrifiant : « Nous nous sommes longtemps regardés, horrifiés, sans nous parler ni nous attirer. Nous étions trop fatigués, trop abasourdis pour réfléchir encore. […] Nos gestes hésitaient, nos mouvements balbutiaient, nos mains rataient ce qu’elles faisaient. Nous nous regardions comme des êtres venus de deux mondes différents, aux bases chimiques, biologiques et psychologiques totalement autres. ». « REM », le récit le plus long, est aussi le plus complexe, même si lui aussi est un récit d’enfance, celui d’une jeune femme qui déroule en une nuit à l’intention de son amant ses souvenirs de « choses qui se sont passées dans les années 1960, 1961, quand j’étais encore une petite fille. ». Jeux d’enfants chez une tante habitant aux limites de la ville, mystères liés à ces trois lettres, « REM » (la « chose » inexplicable, les Réminiscences de phénomènes dont l’étrangeté est liée à la rencontre entre la poésie de l’enfance et le gigantisme de la mémoire, entre la vie innocente et l’annonce de la mort, entre la quotidienneté du réel et l’étrangeté du songe – confrontations qui ne peuvent se résoudre que dans la création, littéraire en l’occurrence, aboutissement de la quête de ce Graal nouvelle version). « Il existe des livres secrets, écrits à la main, consacrés au REM, et il existe des sectes concurrentes qui reconnaissent le REM, mais qui ont des idées on ne peut plus différentes quant à sa signification. Certains soutiennent que le REM serait un appareil infini, un cerveau colossal qui règle et coordonne, selon un certain plan et en vue d’un certain but, tous les rêves des vivants, depuis les rêves inconcevables de l’amibe et du crocus, jusqu’aux rêves des humains. Le rêve serait, selon eux, la véritable réalité, dans laquelle se révèle la volonté de la Divinité cachée dans le REM. D’autres voient dans le REM une sorte de kaléidoscope dans lequel on peut lire tout l’univers, dans tous les détails de chaque instant de son développement, de sa genèse jusqu’à l’apocalypse. ».
Difficile d’en écrire davantage dans un simple compte rendu. Sinon que le dernier texte est comme une signature apocalyptique, celle de « l’architecte » dont l’influence musicale va s’étendre sur la « mentalité humaine » en transformation, sur le monde entier, sur « l’espace interstellaire » et « des constellations entières ». C’est ainsi que l’artiste complet (l’écrivain, comme l’architecte, le musicien ou tout autre) compose son univers vertigineux et le propose au public, qui a le choix de le suivre ou non sur les flots de son écriture et de son imagination. Avec Cărtărescu, difficile de ne pas se laisser embarquer, même si l’on redoute la tempête, les récifs et les courants.
Jean-Pierre Longre
18:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, mircea cărtărescu, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/02/2017
Lire, relire... L’amitié, la mort, l’amour
 Philippe Claudel, L’arbre du pays Toraja, Stock, 2016, Le livre de poche, 2017
Philippe Claudel, L’arbre du pays Toraja, Stock, 2016, Le livre de poche, 2017
Chez les Toraja, en Indonésie, les dépouilles des défunts sont nichées « à même la roche de certaines falaises sacrées ». Quant à celles des enfants morts au cours de leurs premiers mois, elles sont déposées au creux d’un arbre particulier, qui se referme lentement sur le petit corps. Symbole fort, ouvrant le roman de Philippe Claudel sur son thème majeur, la mort, tout en suggérant le cycle naturel et permanent de la vie, qui inclut l’amour et les perspectives de naissances à venir.
L’histoire est à la fois dramatique et simple. Le narrateur, cinéaste, a pour meilleur ami Eugène, son producteur ; celui-ci lui annonce qu’il est atteint d’un « vilain cancer » qui, après rémissions et rechutes, l’emporte en février 2013. Hymne à l’amitié, le livre est aussi une somme de réflexions, de méditations et d’impressions vagabondes sur l’amour (deux femmes, l’ancienne et la nouvelle, entourent le narrateur comme des garantes aimantes de la mémoire et de l’existence à venir), sur les maladies du corps et de l’esprit, sur les leçons que nous donnent la vie et la disparition d’un être cher, avec les manques qu’elle entraîne : « La mort d’Eugène ne m’a pas seulement privé de mon meilleur et seul ami. Elle m’a aussi ôté toute possibilité de dire, d’exprimer ce qui en moi s’agite et tremble. Elle m’a également fait orphelin d’une parole que j’aimais entendre et qui me nourrissait, qui me donnait, à la façon dont opère un radar, la mesure du monde que, seul désormais, je ne parviens à prendre qu’imparfaitement. ».
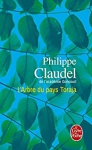 Ce vagabondage entraîne aussi le lecteur dans ce qu’il pourrait prendre pour des digressions, mais qui marque des étapes inhérentes au cheminement de la mémoire : de très belles pages sur l’alpinisme, « leçon rugueuse de philosophie », sur la beauté féminine, sur une rencontre inopinée avec Milan Kundera, au fond d’un café sans grâce, une autre avec Michel Piccoli dans un MacDonald's (où l'acteur est sûr de n'être pas reconnu), sur Venise et sur divers autres paysages. Et surtout sur la création : cinématographique, bien sûr, et littéraire, deux formes d’expression artistique que l’on confronte volontiers : « Je me rends compte que j’écris en mêlant des temps, le passé simple, le présent, le passé composé, l’imparfait dont les règles du récit d’ordinaire n’autorisent pas la cohabitation. Lorsque je filme, je ne me pose pas cette question. Je laisse glisser les plans un à un, sans jamais recourir à des retours en arrière pas plus qu’à des bonds en avant. Très tôt le cinéma m’a paru un art tendu vers le devenir. ». N’empêche, le roman ne cesse de rendre compte de cette tension.
Ce vagabondage entraîne aussi le lecteur dans ce qu’il pourrait prendre pour des digressions, mais qui marque des étapes inhérentes au cheminement de la mémoire : de très belles pages sur l’alpinisme, « leçon rugueuse de philosophie », sur la beauté féminine, sur une rencontre inopinée avec Milan Kundera, au fond d’un café sans grâce, une autre avec Michel Piccoli dans un MacDonald's (où l'acteur est sûr de n'être pas reconnu), sur Venise et sur divers autres paysages. Et surtout sur la création : cinématographique, bien sûr, et littéraire, deux formes d’expression artistique que l’on confronte volontiers : « Je me rends compte que j’écris en mêlant des temps, le passé simple, le présent, le passé composé, l’imparfait dont les règles du récit d’ordinaire n’autorisent pas la cohabitation. Lorsque je filme, je ne me pose pas cette question. Je laisse glisser les plans un à un, sans jamais recourir à des retours en arrière pas plus qu’à des bonds en avant. Très tôt le cinéma m’a paru un art tendu vers le devenir. ». N’empêche, le roman ne cesse de rendre compte de cette tension.
On pourrait chercher à savoir si L’arbre du pays Toraja est un roman à clés. Il y en a, certes. Mais les plus importantes résident dans l’écriture qui permet à un créateur de dévoiler (autant que possible) les méandres de l’âme humaine grâce à la fiction qui, « par une sorte de choc en retour, […] travaille le monde. ».
Jean-Pierre Longre
12:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe claudel, stock, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2017
Lire, relire... L’amour et la barbarie
 Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon, Et tu n’es pas revenu, Grasset, 2015, Le livre de poche, 2016. Suivi d'un dossier d'Annette Wievorka. Grand prix des lectrices de Elle - Document.
Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon, Et tu n’es pas revenu, Grasset, 2015, Le livre de poche, 2016. Suivi d'un dossier d'Annette Wievorka. Grand prix des lectrices de Elle - Document.
Arrêtés en mars 1944 à Bollène, passés par Drancy, Froim Rozenberg et sa fille Marceline ont été déportés à Auschwitz. Séparés dès l’arrivés (lui à Auschwitz, elle à Birkenau), ils ne se sont revus que furtivement, de manière risquée – et lui n’est jamais revenu. Le récit que Marceline fait de cette tragédie bien des années plus tard est une extraordinaire lettre ouverte à son père tant aimé ; comme une amorce épistolaire, cette lettre débute par l’évocation d’un mot que son père avait réussi à lui faire passer là-bas et qui commençait par « ma chère petite fille », et le livre se termine par une terrible question posée par sa belle-sœur : « Maintenant que la vie se termine, tu penses qu’on a bien fait de revenir des camps ? »…
La réponse est contenue par anticipation dans ces cent pages denses, qui racontent l’horreur vécue par une jeune fille de 16 ans, dans le côtoiement quotidien des chambres à gaz et des cadavres, dans la famine et le gel, sous les coups de la cruauté nazie. Elles racontent aussi le retour, l’absence si lourde de celui qui lui avait prédit : « Tu reviendras, Marceline, parce que tu es jeune », un retour auprès d’une mère qui « ne voulait pas comprendre » et d’une famille qui a sa vie, malgré tout, et la tentation du suicide, de l’effacement désespéré.
 Il y aura les mariages – le deuxième avec Joris Ivens, pionnier du cinéma, fameux documentariste, avec qui elle vivra l’engagement, les réussites, les erreurs, les voyages, la création. « Imagine le monde après Auschwitz. Quand la pulsion de vie succède à la pulsion de mort. Quand la liberté retrouvée contamine la planète entière et décrète de nouvelles batailles. ». Chant d’amour filial écrit à l’âge de 86 ans, où on lit entre autres cette phrase bouleversante : « Je t’aimais tellement que je suis contente d’avoir été déportée avec toi. », Et tu n’es pas revenu est aussi une belle leçon d’humanité, de courage et d’intransigeance dans le combat contre la barbarie.
Il y aura les mariages – le deuxième avec Joris Ivens, pionnier du cinéma, fameux documentariste, avec qui elle vivra l’engagement, les réussites, les erreurs, les voyages, la création. « Imagine le monde après Auschwitz. Quand la pulsion de vie succède à la pulsion de mort. Quand la liberté retrouvée contamine la planète entière et décrète de nouvelles batailles. ». Chant d’amour filial écrit à l’âge de 86 ans, où on lit entre autres cette phrase bouleversante : « Je t’aimais tellement que je suis contente d’avoir été déportée avec toi. », Et tu n’es pas revenu est aussi une belle leçon d’humanité, de courage et d’intransigeance dans le combat contre la barbarie.
Jean-Pierre Longre
15:58 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, récit, francophone, marceline loridan-ivens, judith perrignon, grasset, jean-pierre longre, annette wieviorka, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/02/2017
Une traque mouvementée
 Pierre Pouchairet, Mortels trafics, Fayard, 2016. Prix du Quai des Orfèvres 2017
Pierre Pouchairet, Mortels trafics, Fayard, 2016. Prix du Quai des Orfèvres 2017
Qu’attend-on de la lecture d’un roman policier ? Les plaisirs du mystère, du suspense, de l’action, mais aussi celui de faire fonctionner ses méninges et, pourquoi pas, d’acquérir des connaissances. Tous ces ingrédients sont réunis en une savante osmose dans Mortels trafics, qui a bien mérité son Prix du Quai des Orfèvres (décerné sur manuscrit inédit pour un montant de 777 euros et une publication chez Fayard).
Le mystère : le récit commence par le calvaire d’un honorable Marocain torturé à mort, et par le meurtre de deux enfants à l’hôpital Necker. Pour quelles raisons ces crimes odieux ? On ne le saura qu’au fil des pages, bien plus tard. Le suspense : partant de l’assassinat des enfants, l’enquête va se dérouler sur fond de violence et de trafic de drogue, de lieu en lieu, de rebondissement en rebondissement, de danger en danger. L’action : il y a des moments intenses dans les tribulations mortelles des trafiquants, les expéditions périlleuses de la police, entre banlieue parisienne et Maroc, en passant par l’Espagne, les Pyrénées, Nice… La connaissance : celle des hommes, d’abord. Les malfrats plus ou mois engagés dans la violence sans scrupule, sous la coupe de leur avidité et de leur brutalité, et sous celle de puissances internationales malfaisantes et, parfois, de maîtres chanteurs ; les victimes, êtres innocents et braves gens sur qui tombe le hasard du malheur ; et bien sûr les policiers, à commencer par le protagoniste, Patrick Girard, qui mène tout cela de bout en bout avec ses coéquipiers et ses supérieurs, avec ses collègues (dont une forte personnalité, la commandant Léanne Vallauri), et aussi un pittoresque vieillard qui observe scrupuleusement les va-et-vient de la cité où il habite…
Et comme l’auteur est parfaitement au courant du fonctionnement de la police, le lecteur profite largement de ses connaissances sur les différents réseaux d’enquêteurs, les services et les relations qu’ils entretiennent entre eux – le tout précisé par un glossaire qui en fin de volume traduit les sigles correspondants (vous savez, ceux que l’on entend parfois sans bien les comprendre : BRI, DCPJ, DGSI, OCRTIS, RAID etc.). Ainsi actionne-t-il ses méninges, le lecteur ; mais il n’y a rien d’aride dans ces indications. Au contraire : c’est par les points de vue internes et les détails matériels, dans leur agencement impeccable, que le réalisme sans concessions transforme le récit en thriller haletant.
Jean-Pierre Longre
18:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman policier, francophone, pierre pouchairet, fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/01/2017
Hors-normes et dans l’Histoire
 Christophe Boltanski, La cache, éditions Stock, 2015, Folio, 2017
Christophe Boltanski, La cache, éditions Stock, 2015, Folio, 2017
Prix Femina 2015
Certains romans familiaux n’ont d’intérêt que pour leurs protagonistes et ceux qui les connaissent, comme des albums de photos que l’on se passe de mains en mains. Ce n’est pas le cas de La cache. Certes, l’auteur semble se contenter de relater ce qu’il a appris, entendu, éventuellement vu en personne, au sein d’une famille tout en même temps excentrique et autocentrée. Mais le caractère aussi bien hors-normes qu’historique des personnages et des événements, de même que la structure particulière du récit, donne à celui-ci la dimension universelle que l’on attend d’un roman.
 Tout, ou presque, se passe en un seul lieu : la maison familiale de la rue de Grenelle, déclinée en neuf unités formant neuf chapitres (« cuisine, bureau, salon, escalier, appartement, salle de bain, entre-deux, chambre, grenier »), auxquelles s’ajoutent le seul moyen de sortie, la « voiture » (premier chapitre), et une échappée finale de « cet espace clos, plongé dans le silence, rétif à tout rituel, iconoclaste et anachronique ». Lieux à la fois restreints et ouverts sur les perspectives de l’imaginaire et des événements extérieurs, auxquels il est impossible d’échapper – notamment la guerre de 1940 et l’occupation. Le grand-père Boltanski, médecin réputé, redevient aux yeux des autorités et de l’occupant nazi le Juif originaire d’Odessa qu’il était à sa naissance, malgré sa conversion antérieure (et inattendue) au catholicisme. Doit-il fuir ? Persuadé par son épouse, il reste rue de Grenelle, dans un espace minuscule et hermétique qui devient pour ainsi dire le nombril de la maison et le point de focalisation du récit.
Tout, ou presque, se passe en un seul lieu : la maison familiale de la rue de Grenelle, déclinée en neuf unités formant neuf chapitres (« cuisine, bureau, salon, escalier, appartement, salle de bain, entre-deux, chambre, grenier »), auxquelles s’ajoutent le seul moyen de sortie, la « voiture » (premier chapitre), et une échappée finale de « cet espace clos, plongé dans le silence, rétif à tout rituel, iconoclaste et anachronique ». Lieux à la fois restreints et ouverts sur les perspectives de l’imaginaire et des événements extérieurs, auxquels il est impossible d’échapper – notamment la guerre de 1940 et l’occupation. Le grand-père Boltanski, médecin réputé, redevient aux yeux des autorités et de l’occupant nazi le Juif originaire d’Odessa qu’il était à sa naissance, malgré sa conversion antérieure (et inattendue) au catholicisme. Doit-il fuir ? Persuadé par son épouse, il reste rue de Grenelle, dans un espace minuscule et hermétique qui devient pour ainsi dire le nombril de la maison et le point de focalisation du récit.
Autour de ce centre spatial et narratif gravitent les personnages, et d’abord cette « Mère-Grand » si particulière, « tout à la fois petite fille, menteuse, aimante, possessive, mère fouettarde, chef rebelle, agitatrice professionnelle », paralysée et pourtant sans cesse en action, et qui ne peut vivre qu’en gardant tout son monde autour d’elle, « en vase clos », jour et nuit : mari, enfants, petit-fils (Christophe lui-même)… Engagée dans le monde mais voulant en préserver les siens (c’est elle, par exemple, qui se charge de leur faire la classe), elle occupe une large part de leur vie et du roman.
Oui, La cache est bien, comme l’indique la présentation, « le roman-vrai des Boltanski » : la vérité sans fard s’y manifeste, mais elle s’y « cache » aussi. Qui pourrait tout savoir des troubles et des richesses d’une telle famille ? Qui pourrait tout savoir du monde énigmatique et effrayant dont elle tente de se préserver et qui les guette sans cesse ?
Jean-Pierre Longre
10:07 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, christophe boltanski, éditions stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/01/2017
Un regard intense
 Simon Liberati, Eva, éditions Stock, 2015, Le livre de poche, 2016
Simon Liberati, Eva, éditions Stock, 2015, Le livre de poche, 2016
« J’ai su très vite qu’Eva allait me rendre heureux, c’est-à-dire m’affoler, bouleverser ma vie si complètement, qu’il faudrait tout refaire autrement et dans le désarroi, seul symptôme incontestable de la vérité. ». Eva est-il donc un roman d’amour ? Oui, et au-delà. Le roman d’un amour sur lequel pèse tout le poids du passé sulfureux d’une femme qui a commencé sa « carrière » à l’âge de l’innocence sous l’objectif sans concessions de sa mère photographe, et qui a rapidement soumis son existence à l’alcool, à la drogue, aux amours de passage, à l’érotisme – et d’un passé familial placé pour ainsi dire sous le signe maudit de l’inceste.
Simon Liberati, qui a lui aussi beaucoup vécu, et dont le regard fasciné porté sur Eva est à la fois celui de l’abandon passionné et de la recherche maîtrisée, procède par épisodes disparates reliés entre eux par des liens intimes et objectifs, distinguant l’Eva réelle, en chair et en os, de l’Eva fictive, celle des photos, de l’histoire qu’elle s’est elle-même construite dans le monde de la vie nocturne, et du roman que l’auteur mène d’une plume sophistiquée, sur le mode allusif et esthétisant, mais aussi en s’appuyant sur des documents, des témoignages, ses propres souvenirs et les conversations qu’il a avec celle qui partage sa vie depuis 2013, après qu'ils se sont fugitivement croisés des années auparavant.
 Eva, biographie, autobiographie, série de variations sur un thème, est bien un roman d’amour, à la fois tendre et cruel, combinant le naturel et les artifices, nourri de sentiment et de réflexion, de sincérité et de références (littéraires, artistiques, mondaines…). C’est surtout un portrait dont la complexité du personnage, ses ambiguïtés, ses contradictions, ses sautes d’humeur, sa soif de liberté, sa « ferveur naïve » n’occultent pas la lucidité et la tendresse. « Son pouvoir d’imagination est d’autant plus ferme qu’il repose sur des souffrances très anciennes. Ses infortunes ont fait qu’elle a beaucoup observé les autres, beaucoup réfléchi et vu beaucoup de films. Comme tous les martyrs et tous les bourreaux, comme Sade, comme Justine, c’est une grande imaginative. Je discernais en même temps dans ces moments d’urgence que son rapport à soi avait une intensité différente, plus détachée ; l’objet qu’elle voyait dans la glace, Eva, était une fiction, elle l’avait été pour d’autres avant de l’être pour elle-même, ce qui n’était pas sans lien avec cette capacité fantastique de s’abstraire dans une autre dimension. ». Cette « autre dimension », faute d’être complètement identifiable, se laisse deviner comme dans un reflet tout au long de ces pages intenses.
Eva, biographie, autobiographie, série de variations sur un thème, est bien un roman d’amour, à la fois tendre et cruel, combinant le naturel et les artifices, nourri de sentiment et de réflexion, de sincérité et de références (littéraires, artistiques, mondaines…). C’est surtout un portrait dont la complexité du personnage, ses ambiguïtés, ses contradictions, ses sautes d’humeur, sa soif de liberté, sa « ferveur naïve » n’occultent pas la lucidité et la tendresse. « Son pouvoir d’imagination est d’autant plus ferme qu’il repose sur des souffrances très anciennes. Ses infortunes ont fait qu’elle a beaucoup observé les autres, beaucoup réfléchi et vu beaucoup de films. Comme tous les martyrs et tous les bourreaux, comme Sade, comme Justine, c’est une grande imaginative. Je discernais en même temps dans ces moments d’urgence que son rapport à soi avait une intensité différente, plus détachée ; l’objet qu’elle voyait dans la glace, Eva, était une fiction, elle l’avait été pour d’autres avant de l’être pour elle-même, ce qui n’était pas sans lien avec cette capacité fantastique de s’abstraire dans une autre dimension. ». Cette « autre dimension », faute d’être complètement identifiable, se laisse deviner comme dans un reflet tout au long de ces pages intenses.
Jean-Pierre Longre
10:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, simon liberati, eva ionesco, éditions stock, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/01/2017
Après le massacre
 Catherine Meurisse, La légèreté, Dargaud, 2016
Catherine Meurisse, La légèreté, Dargaud, 2016
Catherine Meurisse était depuis dix ans dessinatrice à Charlie-Hebdo. Le 7 janvier 2015, quittée par son amoureux, elle est restée tard au lit, plongée dans les bulles de cette déception sentimentale. Et cela lui a sans doute sauvé la vie, mais ne l’a pas exonérée de la dépression qui a suivi le massacre de ses compagnons de travail par les frères Kouachi.
La légèreté est le récit graphique (et autobiographique) de ce qui a suivi : pannes de dessin, participation au numéro « des survivants », différents modes de psychothérapie, cauchemars, cohabitation avec les gardes du corps et la presse, soirée au théâtre (Oblomov, avec comme des correspondances entre la pièce et la vie), séjours à la campagne, à la mer, à la montagne, retours en arrière, décision d’aller à Rome éprouver le « syndrome de Stendhal » (le vertige dont l’homme peut être pris « face à un déluge de beauté »), donc séjour à la Villa Médicis et confrontation à l’art de toutes les époques…
Le titre de l’album est particulièrement parlant. C’était une sorte de pari : comment retrouver « la légèreté » après une si lourde tragédie ? Comment retrouver la beauté après la laideur de la stupidité sanguinaire ? Par le dessin, l’autoportrait, l’observation de soi et des autres, l’émotion révélée, l’humour renouvelé, l’amitié célébrée, la discrète variété des couleurs, la finesse du trait, l’éveil progressif à la vie réinvestie, à des sensations variées, à l’humanité. « Une fois le chaos éloigné, la raison se ranime et l’équilibre avec la perception est retrouvé. On voit moins intensément, mais on se souvient d’avoir vu… Je compte bien rester éveillée, attentive au moindre signe de beauté… Cette beauté qui me sauve, en me rendant la légèreté. ». Paroles sur fond bleu clair de ciel et de mer, et la frêle silhouette de l’auteure qui regarde passer ses pensées. Un très beau tableau.
Jean-Pierre Longre
18:08 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman graphique, autobiographie, francophone, catherine meurisse, dargaud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/01/2017
Le petit blond en Syrie, suite
 Nous retrouvons le petit blond (voir ICI) âgé de sept ans en 1985. Avec sa famille, il habite toujours en Syrie, dans un village d’où sa mère française ne rêve que de partir – ce qui provoque des tensions parfois bruyantes dans le couple parental. Et voilà, en six chapitres aux vignettes toujours drôles, émouvantes, expressives, la suite des anecdotes ponctuant une enfance peu banale.
Nous retrouvons le petit blond (voir ICI) âgé de sept ans en 1985. Avec sa famille, il habite toujours en Syrie, dans un village d’où sa mère française ne rêve que de partir – ce qui provoque des tensions parfois bruyantes dans le couple parental. Et voilà, en six chapitres aux vignettes toujours drôles, émouvantes, expressives, la suite des anecdotes ponctuant une enfance peu banale.
Riad, « maigrelet à cause des gastros », « air un peu satisfait », « extrêmement propret », encombré de sa « sixième version du cartable en carton », est un élève modèle, obéissant par nature et aussi, disons-le, par crainte des coups du maître, pris entre deux cultures, entre religion et athéisme, entre discipline et amusements collectifs, entre rêves et réalité. Jeux virils avec les cousins, visites à la grand-mère et à la tante, fascination pour Conan le Barbare, manœuvres du père pour grimper dans la société syrienne, voyage et séjour en France pour la naissance du petit troisième, histoire drôlement douloureuse de la circoncision… On frise parfois le drame, mais la comédie retombe sur ses pattes. Chaque épisode a sa saveur particulière, chaque portrait sa précision pittoresque.
Riad Sattouf a l’art de combiner dessins aux allures enfantines mais aux traits parfaitement maîtrisés (entre caricature bienveillante et attendrissement sincère), couleurs (dont les tons et les intensités varient avec les lieux et les situations) et textes (phylactères aux formes adaptées à leur contenu, rapides narrations venant à l’appui du message visuel, et, parfois, petites descriptions souriantes et fléchées pour souligner quelques détails). Un beau récit d’enfance, un beau roman graphique, qui mine de rien donne une véritable leçon d’histoire (par exemple celle, au passage, de la création du Liban et du partage de l’Empire ottoman par les Européens après la Première Guerre Mondiale) et un bel exemple d’ouverture au monde.
Jean-Pierre Longre
23:02 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, riad sattouf, allary Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

