03/11/2019
L’écriture contre la mort
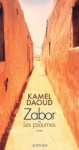 Lire, relire...
Lire, relire...
Kamel Daoud, Zabor ou Les psaumes, Actes Sud, 2017, Babel, 2019
Zabor ou Les psaumes est un livre si dense qu’une fois déverrouillée la lourde porte qui y donne accès on a du mal à en sortir, du mal aussi à en parler, a fortiori à le commenter. Il faudrait en citer des pans entiers pour rendre compte de son style, de sa teneur, de sa portée. Disons ceci : Zabor, presque trente ans, « célibataire et encore vierge » (même s’il porte un amour muet à sa voisine Djemila, répudiée par son mari donc socialement réprouvée), chassé par son père comme un bâtard et recueilli par sa tante Hadjer, compréhensive et aimante, vit en marge de la communauté de son village. Respecté parce que son père est un riche boucher, rejeté par ses demi-frères et moqué par les enfants, il est aussi une figure admirée, parce qu’il sait faire reculer la mort : lorsque quelqu’un en est proche, on fait appel à lui pour écrire au chevet du moribond, remplir un cahier de mots, de phrases, d’histoires dont lui seul a le secret. « Cela dure depuis des années, et j’ai fini par comprendre les règles du jeu, instaurer des rites et des ruses pour aboutir à cette formidable conclusion que ma maîtrise de la langue, cette langue fabriquée par mes soins, est non seulement une aventure mais surtout une obligation éthique. ».
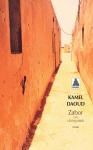 Les trois cents pages du roman tournent autour du récit de l’agonie de son père, Hadj Brahim. Malgré leur animosité, les demi-frères viennent en dernier recours chercher Zabor pour qu’il repousse sa mort. Mission quasiment sacrée : « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l’immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution. ». C’est à la fois sa puissance et son drame.
Les trois cents pages du roman tournent autour du récit de l’agonie de son père, Hadj Brahim. Malgré leur animosité, les demi-frères viennent en dernier recours chercher Zabor pour qu’il repousse sa mort. Mission quasiment sacrée : « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l’immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution. ». C’est à la fois sa puissance et son drame.
Comment ce don lui est-il venu ? Cloîtré dans sa chambre, ne sortant que la nuit, Zabor a déchiffré tous les livres qu’il trouvait dans la langue des anciens colons, le français. « Ce fut toute une aventure que d’apprendre, seul, en cachette, la troisième langue de l’ange, la pièce manquante à la loi de la Nécessité qui allait sauver tant de vies, ajouter mille et un jours à chaque rencontre, dans le secret, humblement, et dans l’art de l’écriture. ». Et plus loin : « Cette langue eut trois effets dans ma vie : elle guérit mes crises, m’initia au sexe et au dévoilement du féminin, et m’offrit le moyen de contourner le village et son étroitesse. C’étaient là les prémices de mon don, qui en fut la conséquence. ». À partir de là, ce sont des centaines de cahiers qu’il emplit de son écriture serrée, qu’il enterre la nuit dans la campagne environnante comme pour en nourrir la terre et les racines des arbres, et qui deviennent une œuvre inépuisable, flot continu faisant une sorte de suite au Coran, à la Bible, aux Mille et une Nuits, et même à Robinson Crusoë, à L'île au trésor ou à La chair de l’orchidée (pour ne citer que les titres les plus importants de son incomparable bagage).
La trame de Zabor propose des cheminements dans le dédale de l’existence, en trois étapes : « Le corps », « La langue », « L’extase ». On pourrait penser aussi : la mort, l’écriture, la vie (ou l’inverse ?). En tout cas, Kamel Daoud offre ici à chaque lecteur une nourriture inépuisable, un chant infini, des « psaumes » aux confins du profane et du sacré.
Jean-Pierre Longre
17:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, kamel daoud, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Fureur et nostalgie
 Lire, relire... Pierre Autin-Grenier, Friterie-bar Brunetti, Gallimard, L’arpenteur, 2005, La Table ronde, Petite vermillon, 2019
Lire, relire... Pierre Autin-Grenier, Friterie-bar Brunetti, Gallimard, L’arpenteur, 2005, La Table ronde, Petite vermillon, 2019
Les souvenirs conduisent Pierre Autin-Grenier dans le quartier de la Guillotière, à Lyon, où dans les années 1960 se côtoient la fine fleur du populaire et de jeunes apprentis poètes préparant la révolution. Il y a là, dans la Friterie-bar « fondée en 1906 au 9 de la rue Moncey et aujourd’hui disparue », Madame Loulou qui réchauffe les cœurs et les corps de son « marin », de son « ancien commis aux Halles » ou de son « banquier » ; le grand Raymond fort en gueule et en muscles ; Domi qui a eu bien des malheurs, dont la vocation policière de son fils n’est pas le moindre ; Ginette qui, ayant passé sa vie en mal d’amour à servir les autres, trouve maintenant refuge aux bons soins de Renée et du père Joseph ; le narrateur, grand lecteur de fond de salle, fourbissant ses armes d’écrivain…
 La Friterie Brunetti, c’est un peu le « vieux bistrot » de Brassens, les zincs de Prévert, ces lieux où l’on ne fabrique pas une convivialité aseptisée, mais où l’amitié bonhomme est naturelle, dans les vapeurs d’anarchie et de gros rouge, dans la brume des fumées de tabac fort. Atmosphère assurée, et quand on en sort on en profite pour parcourir la ville, de la « Fosse-aux-ours » (récemment devenue chantier) à Saint-Paul, en passant par la « passerelle du Palais » et le quai Romain-Rolland. C’est la nostalgie du Lyon de naguère, du temps où l’on ne se perdait pas encore entre les parkings et les tours de verre et de béton (comme celle qui fait maintenant barrière entre la place du Pont et la rue Moncey).
La Friterie Brunetti, c’est un peu le « vieux bistrot » de Brassens, les zincs de Prévert, ces lieux où l’on ne fabrique pas une convivialité aseptisée, mais où l’amitié bonhomme est naturelle, dans les vapeurs d’anarchie et de gros rouge, dans la brume des fumées de tabac fort. Atmosphère assurée, et quand on en sort on en profite pour parcourir la ville, de la « Fosse-aux-ours » (récemment devenue chantier) à Saint-Paul, en passant par la « passerelle du Palais » et le quai Romain-Rolland. C’est la nostalgie du Lyon de naguère, du temps où l’on ne se perdait pas encore entre les parkings et les tours de verre et de béton (comme celle qui fait maintenant barrière entre la place du Pont et la rue Moncey).
Nostalgie, mais aussi révolte radicale et salutaires envolées contre l’ordre établi. Celui d’alors (« On sentait bien qu’aux relents de graillon qui souvent imprégnaient jusqu’à nos chaussures venaient se mêler, à nous étourdir, de forts parfums d’insurrection »), et surtout celui d’aujourd’hui, assuré par « les bourgeois, les beaufs, les banques et les charognards de l’immobilier », celui qui a supprimé les « vrais bistrots » au profit des cafétérias et des Mac Do. L’auteur s’en donne à cœur joie, à rage ouverte, à bile déversée, dans cet adieu désespéré aux « petits Rimbaud » des « bouis-bouis de banlieue », aux « gentils pochards en perpétuel manque de piccolo », à ces « havres de grâce tombés dans les filets d’aigrefins de la finance ».
Du désespoir, vraiment ? Un peu, mâtiné de colère roborative. Il y a surtout un hymne à ces hauts lieux d’humanité que sont les cafés, les vrais, ceux qui, selon George Steiner cité en postface, « caractérisent l’Europe ». Et l’on sait bien que Lyon est une ville européenne.
Jean-Pierre Longre
https://www.editionslatableronde.fr/Catalogue/la-petite-v...
17:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pierre autin-grenier, gallimard, l’arpenteur, la table ronde, petite vermillon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/10/2019
Haletant
 Max Annas, Enfer blanc, traduit de l’allemand par Mathilde Sobottke, Belfond, 2019
Max Annas, Enfer blanc, traduit de l’allemand par Mathilde Sobottke, Belfond, 2019
C’est un banal incident de la vie quotidienne. Moses, jeune étudiant qui vient d’aider son professeur à trier ses livres, s’apprête à rejoindre sa petite amie quand il tombe en panne de voiture. Batterie de téléphone déchargée. Il ne lui reste plus qu’à aller chercher de l’aide derrière de hauts murs qui bordent la route. Il arrive à se faufiler par le portail d’entrée, et commence à parcourir la résidence dans laquelle il se trouve. Mais voilà… Nous sommes en Afrique du Sud, et Moses est noir. Certes, l’apartheid est officiellement aboli depuis de nombreuses années, mais le racisme est toujours présent dans l’esprit et les réactions de certains blancs plus enclins à manier la matraque qu’à utiliser les ressources de la réflexion et de l’empathie. Pour corser le tout, un couple de cambrioleurs a pénétré dans la même résidence et a commencé à visiter des maisons et à y voler des objets précieux.
Tout s’enclenche. Des espèces de miliciens locaux ont repéré Moses, des habitants ont constaté le vol de leurs bijoux – et une folle poursuite commence pour le jeune homme, qui utilise toutes ses ressources physiques et mentales pour échapper à une troupe de plus en plus nombreuse, puis à la police, tandis que les cambrioleurs, qui ont fait une découverte macabre, tentent de se cacher de dangereux malfrats et de la police… Bref, le récit, de plus en plus oppressant, met en scène victimes, bourreaux, coupables, innocents, habitants, employés de maison, dans le contexte d’un quartier réservé à une certaine classe sociale et ultrasécurisé – pas tant que cela tout compte fait, puisqu’au prix d’une grande habileté et d’efforts désespérés on peut s’y cacher… « Moses fonça à travers la haie, l’épaule la première. Son tee-shirt se déchira sur le côté. Il marcha à quatre pattes jusqu’à l’ombre de la maison suivante. Pas le temps de regarder plus attentivement. Derrière la maison, une autre rue. Maintenant, ils allaient patrouiller partout, il ne pourrait plus rester longtemps à découvert. Il se dirigea à l’arrière de la maison. Il ne comptait plus le nombre de maisons derrière lesquelles il s’était faufilé en catimini. ».
Tout cela se passe en quelques heures – unité de temps –, dans un périmètre très circonscrit – unité de lieu –, et l’action progresse vers un tragique sanglant dont on ne dévoilera pas ici le dénouement. Une progression quasiment théâtrale, ou cinématographique, qui fait alterner les focalisations (Moses, les cambrioleurs, les poursuivants…) en brefs chapitres au souffle aussi court que celui du fuyard ; et la noirceur du propos est renforcée par le contexte d’un pays que l’auteur connait bien, dans lequel les relations humaines sont loin d’être apaisées, et où la haine absurde et la violence raciste sont encore monnaie courante. Un roman haletant, à tous points de vue.
Jean-Pierre Longre
18:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, allemagne, max annas, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/10/2019
Retrouver les traces de l'essentiel
Patrick Modiano, Nos débuts dans la vie, Gallimard, 2017
Lire, relire... Souvenirs dormants, Gallimard, 2017, Folio 2019
Malgré les errances urbaines qui sillonnent ses livres, malgré la fugacité des personnages et des événements, Patrick Modiano ne laisse pas au pur hasard le soin de bâtir ses récits en forme de puzzles à trous. « Je tente de mettre de l’ordre dans mes souvenirs. Chacun d’eux est une pièce de puzzle, mais il en manque beaucoup, de sorte que la plupart restent isolées. Parfois, je parviens à en rassembler trois ou quatre, mais pas plus. Alors, je note des bribes qui me reviennent dans le désordre, listes de noms ou de phrases très brèves. Je souhaite que ces noms comme des aimants en attirent de nouveaux à la surface et que ces bouts de phrases finissent par former des paragraphes et des chapitres qui s’enchaînent », écrit-il dans Souvenirs dormants.
 Marque de cette volonté de guider la construction littéraire : la parution simultanée d’une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie, et d’un récit, Souvenirs dormants, qui se complètent mutuellement et se répondent l’un l’autre. Le même protagoniste, Jean, dont les bribes de vies relatées dans les deux ouvrages ressemblent à ce que l’on sait de l’auteur, avec ses « débuts » dans la littérature, des épisodes biographiques qui en rappellent d’autres, le réveil de « souvenirs » qui ont quelque chose à voir avec un passé plus ou moins connu.
Marque de cette volonté de guider la construction littéraire : la parution simultanée d’une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie, et d’un récit, Souvenirs dormants, qui se complètent mutuellement et se répondent l’un l’autre. Le même protagoniste, Jean, dont les bribes de vies relatées dans les deux ouvrages ressemblent à ce que l’on sait de l’auteur, avec ses « débuts » dans la littérature, des épisodes biographiques qui en rappellent d’autres, le réveil de « souvenirs » qui ont quelque chose à voir avec un passé plus ou moins connu.
Nos débuts dans la vie est un livre tout entier occupé par le théâtre : dans sa forme bien sûr, mais aussi dans l’art de mettre le genre en abyme : Jean, écrivain débutant, dialogue avec Dominique, qui joue dans La Mouette de Tchekhov (et dont la présence justifie le « nous » du titre) ; de la loge de Dominique, on peut entendre ce qui se passe sur la scène. Dans le théâtre voisin, la mère de Jean joue une pièce de boulevard. Rivalités, jalousie, surveillance et menaces de l’amant de la mère… On pourrait être en plein mélodrame à suspense. Mais il y a la mémoire, les jeux de lumière, la poésie des dialogues, et ce mélange de rêve et de réalité particulier à la prose de Modiano, et qui ici nous fait sortir du cadre du théâtre pour nous mener vers un « hors-scène » onirique : vers la pièce de Tchekhov (et aussi L’inconnue d’Arras d’Armand Salacrou), et vers des lieux parisiens : « Nous marchons tous les deux dans différents endroits de Paris… Nous ne parlons pas, mais je sais qu’elle m’a reconnu… Nous longeons les lacs du bois de Boulogne, et même nous prenons la barque jusqu’au Chalet des Îles… Nous ne disons pas un mot et, dans mon rêve, cela me semble naturel… ».

 Ces mots pourraient figurer dans Souvenirs dormants, qui relate une série de rencontres féminines que le narrateur, Jean, toujours lui, a faites dans sa jeunesse, et dont il retrouve les traces souvent fugaces dans sa mémoire et dans ses carnets. Rencontres rassurantes, presque maternelles, sur lesquelles plane l’ombre occulte du guide spirituel Gurdjieff, ou rencontres inquiétantes et mystérieuses mêlant Jean à un meurtre. Rencontres récurrentes aussi, réveillant des souvenirs qui, effectivement, dormaient. Tout cela permet quelques constats sur soi-même, frisant l’auto-analyse : « Au cours de cette période de ma vie, et depuis l’âge de onze ans, les fugues ont joué un grand rôle. Fugues des pensionnats, fuite de Paris par un train de nuit le jour où je devais me présenter à la caserne de Reuilly pour mon service militaire, rendez-vous auxquels je ne me rendais pas, ou phrases rituelles pour m’esquiver […]. Aujourd’hui, j’en éprouve du remords. Bien que je ne sois pas très doué pour l’introspection, je voudrais comprendre pourquoi la fugue était, en quelque sorte, mon mode de vie. Et cela a duré assez longtemps, je dirais jusqu’à vingt-deux ans. ». Là encore, aux souvenirs se mêlent les rêves, dont certains sont précisément rapportés.
Ces mots pourraient figurer dans Souvenirs dormants, qui relate une série de rencontres féminines que le narrateur, Jean, toujours lui, a faites dans sa jeunesse, et dont il retrouve les traces souvent fugaces dans sa mémoire et dans ses carnets. Rencontres rassurantes, presque maternelles, sur lesquelles plane l’ombre occulte du guide spirituel Gurdjieff, ou rencontres inquiétantes et mystérieuses mêlant Jean à un meurtre. Rencontres récurrentes aussi, réveillant des souvenirs qui, effectivement, dormaient. Tout cela permet quelques constats sur soi-même, frisant l’auto-analyse : « Au cours de cette période de ma vie, et depuis l’âge de onze ans, les fugues ont joué un grand rôle. Fugues des pensionnats, fuite de Paris par un train de nuit le jour où je devais me présenter à la caserne de Reuilly pour mon service militaire, rendez-vous auxquels je ne me rendais pas, ou phrases rituelles pour m’esquiver […]. Aujourd’hui, j’en éprouve du remords. Bien que je ne sois pas très doué pour l’introspection, je voudrais comprendre pourquoi la fugue était, en quelque sorte, mon mode de vie. Et cela a duré assez longtemps, je dirais jusqu’à vingt-deux ans. ». Là encore, aux souvenirs se mêlent les rêves, dont certains sont précisément rapportés.
Souvenirs réels, souvenirs rêvés… Patrick Modiano continue à fouiller méthodiquement le passé afin de retrouver les traces de l’essentiel.
Jean-Pierre Longre
17:21 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, roman, francophone, patrick modiano, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/10/2019
Une année particulière
 Irina Teodorescu, Ni poète ni animal, Flammarion, 2019
Irina Teodorescu, Ni poète ni animal, Flammarion, 2019
Carmen I., la narratrice, est née en 1979, comme Irina Teodorescu. Comme elle, elle avait dix ans lors de la fameuse « révolution » qui a chassé et liquidé le couple de tyrans qui verrouillait le pays. Maintenant avocate à Paris, Carmen apprend la mort de celui qu’elle appelait le « Grand Poète », ou « Ma Terre », qui l’appelait « Ma Fugue » et jouait un grand rôle non seulement dans sa vie à elle, mais aussi dans celle de la Roumanie, puisque, journaliste et dissident politique, il tenait une place non négligeable dans le pays nouvellement débarrassé des Ceauşescu (surtout de cette « présidente qui avait fait de son mari un homme dépendant. »).
Alors elle se souvient de l’époque où elle était la « Petite Xénoppe » de sa mère, et son récit déroule les événements qui vont de mars 1989 à février 1990, en prenant appui sur trois générations de femmes : Dani, la grand-mère, que l’on connaît par les « notes informatives » de l’hôpital psychiatrique où elle est périodiquement suivie et interrogée ; Ema, ou Em, la mère, qui se confie régulièrement à des K7 qu’elle enregistre à l’intention d’une amie exilée en Amérique ; et Carmen, donc, qui à dix ans vivait la vie d’une écolière roumaine, séjournait parfois à la montagne, et même écrivait des poèmes dans l’esprit politique du temps, dont l’un à la gloire du Parti, qui « avait remplacé Dieu et était, on nous l’avait assez martelé, notre père à tous » - poème qui lui valut les félicitations de « la camarade maîtresse ». Mais on le sait, la fin de l’année 1989 fut d’une tout autre teneur, avec les événements sanglants que connut le pays – coup d’État ou Révolution, ou moitié-moitié ? Les discussions s’animent entre Carmen et le Grand Poète. « Je lui expliquais alors que les événements de 1989 avaient été à la fois une révolution et un coup d’État, que je le savais grâce à mon point de vue distancié ; que les gens comme lui, j’entendais originaires du même pays, ne pouvaient accepter, tant d’années après, que la révolution avait été en même temps un coup d’État, que les gens comme lui – et comme ma mère, ajoutais-je pour le rassurer – se sentaient dépossédés de leur histoire dès qu’on évoquait cette hypothèse double. ».
Ni poète ni animal n’est pas un récit historique ou autobiographique. Ces deux aspects y sont certes contenus. Mais c’est avant tout un roman poétique, ou, disons, qui poétise le passé personnel et collectif, sans recourir à l’illusoire linéarité que l’on attribue aux souvenirs. Construction élaborée qui tient compte de la complexité de la mémoire, de ses allées et venues, de la distance qu’elle entretient avec les événements – distance qui n’occulte pas le tragique, mais qui n’exclut pas l’humour, même morbide. Il faut lire par exemple le récit de cette journée de Noël 1989, où le cochon familial fut tué, « nettoyé et découpé », tandis qu’étaient fusillés « la dictatrice et son mari »… D’où la résolution de la fillette : « Avant de m’endormir, je me promis de manger le plus de cochon possible. ». Les bêtes, d’ailleurs, cochon, renard, éléphant et beaucoup d’autres, tiennent une place prépondérante dans le mécanisme de la narration. Et Carmen/Irina, dans le style plein de surprises qui n’appartient qu’à elles deux, de conclure en évoquant « Ma Terre » qui l’incitait à se « repoétiser » : « Je choisis mon camp : ni poète ni animal, mais les deux réunis. ».
Jean-Pierre Longre
22:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, irina teodorescu, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/09/2019
Comment garder les couleurs du temps ?
 Lionel-Édouard Martin, Tout était devenu trop blanc, le Réalgar, 2019
Lionel-Édouard Martin, Tout était devenu trop blanc, le Réalgar, 2019
Dans le village de M***, le narrateur, qui lorsqu’il était étudiant en lettres avait trouvé un petit emploi de guide au musée municipal, avait par la même occasion appris que les peintres locaux ne manquèrent pas à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et c’est à partir de l’évocation de l’un d’entre eux, Charles Desmassoures, et du récit de Marceline, vieille employée de cuisine née en 1890, que nous connaissons la vie de Charles du Puy du Pin de la Chambue, surnommé Popotame à cause de sa forte corpulence, et dont, sans qu’on le sache à M***, les toiles « s’arrachaient à Drouot, à Sotheby’s, chez Christie’s, pour des centaines de milliers de francs, de livres, de dollars ».
Fils hors normes d’une famille de hobereaux poitevins, dont les particules ne cachent pas complètement l’ascendance paysanne, Charles se révèle très jeune singulièrement doué pour la création artistique, sorte de « Mozart de la peinture ». Sur les conseils de mademoiselle Romanoz, la préceptrice familiale, Desmassoures, marchand de liqueurs et peintre du dimanche déjà cité, par ailleurs assez bien introduit dans les milieux de la bohème artistique parisienne, commence à lui enseigner les rudiments, et voilà notre Popotame parti quotidiennement dans la campagne avec son matériel. « Dès avril prenant la poudre d’escampette, traînant par les prairies tout son barda, chargé comme un baudet, tout sur le dos. La silhouette de profil, c’est la silhouette de l’écureuil debout sur ses pattes, trottinant roux, maladroit, bossu, vers la noisette ; et la noisette, c’est le bout de paysage exploré de l’œil bleu, vaguement expert, l’arbre incliné, pensif, vers le ruisseau, la mare triturée par les grenouilles, le talus gras clouté de ficaires, violettes, pervenches. Il s’arrête, ayant trouvé l’endroit. ». Avec cela, passionné par le Douanier Rousseau, dont il garde toujours avec lui, comme un « nain-nain » de bébé, la reproduction d’une gouache.
Ainsi passe le temps avec ses péripéties et ses bouleversements, le début du siècle, la guerre de 14-18, les années folles, sans que Charles quitte le domaine et son chevalet, vivant « des jours paisibles à la Chambue, sans rien qui rompît la monotonie d’une existence vouée sans partage à la peinture. » Jusqu’à ce qu’une paire de jumeaux dont Charles souffrait mal le voisinage se mettent en tête d’exploiter le sable dont regorge la campagne, dont ils couvrent ainsi les couleurs d’un blanc uniforme et poudreux… Que faire contre le blanc industriel et le noir des corbeaux (les « grolles ») qui infestent les environs et que l’on retrouvera « attablés » dans les entrailles du cadavre de Charles ?
Touchante et terrible, cette histoire de Popotame et de sa famille, que nous propose Lionel-Édouard Martin dans le style à la fois rustique et chantourné qu’il prête à la cuisinière Marceline, à qui le narrateur laisse souvent la parole. Dans un mélange d’élaboration quasiment savante et de simplicité populaire, l’auteur nous offre sa syntaxe bousculée par une poésie tour à tour rocailleuse et fleurie, verdoyante et accidentée, mettant carrément sous nos yeux les toiles de Charles du Puy du Pin de la Chambue et les fragiles couleurs de la campagne.
Jean-Pierre Longre
08:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, éditions le réalgar, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2019
Le fabuleux destin de Laurent Mourguet
 Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
La mère de Paul Fournel, lorsqu’il était enfant, lui enjoignait d’arrêter de « faire Guignol ». Sans connaître le personnage, il se doutait qu’il « incarnait tout ce qui turbule, tout ce qui impertine, tout ce qui pique, tout ce qui ricane en souriant. ». Plus tard, intéressé entre autres par le fonctionnement des langues et du langage, il observa ce personnage de plus près, et fit des recherches poussées sur son histoire et celle de ses comparses, Gnafron, la Madelon et les autres. Il en fit même une thèse. Mais rassurez-vous, Faire Guignol (d’ailleurs qualifié de « roman ») n’est pas un pensum universitaire.
C’est au contraire le récit plein de verve, truffé de mots et d’expressions du parler lyonnais, d’une vie exceptionnelle : celle de l’inventeur de Guignol, Laurent Mourguet (1769-1844). Fils de canut, marié tout jeune à l’amoureuse, compréhensive et soucieuse Jeanne, père de famille nombreuse, il a tâté d’un peu tous les métiers pour faire bouillir la marmite. Crocheteur, marchand ambulant, arracheur de dents, il découvre finalement la manipulation des marionnettes, dont Polichinelle et Colombine sont de fameux représentants. De la manipulation à la fabrication, il n’y a qu’un pas : d’un bloc de bois naît un jour Gnafron, le cordonnier porté sur la bouteille ; puis arrive le personnage central, qui donne de l’air à son créateur, et qui vivra longtemps, très longtemps. « Chance et prix de votre patience, vous êtes les premiers à voir Guignol ! Le voici pour la première fois en son castelet, tout jeune et débutant. Mourguet l’a ganté sur sa main gauche, et de la droite il tient Gnafron. Ces deux lascars vont devenir inséparables. C’est juste un essai pour Mourguet, mais c’est un grand jour pour l’histoire du théâtre, et vous y assistez ! ».
 À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
Oui, cela se confirme à la lecture : la vie de Laurent Mourguet est un véritable roman, et l’œuvre qu’il nous a laissée (dont les textes ont été heureusement recueillis – car leur auteur ne savait pas écrire) est trop universelle pour être oubliée, trop vivante pour mourir. Paul Fournel nous en fournit d’ailleurs, ponctués de photos quasiment parlantes, quelques échantillons colorés, engagés et pétulants, tout en rappelant le contexte historique de son élaboration, et en glissant çà et là quelques anecdotes savoureuses, quelques détails bien utiles, comme la naissances des « mères », ces grandes dames de la cuisine lyonnaise (qui ont maintenant leur « parvis » du côté de la Part-Dieu), comme les révoltes des canuts, ou comme l’ouverture en 1836 de la brasserie Georges, « le plus grand restaurant de France ». Et puis à ce propos, n’hésitons pas à accepter ce que Paul Fournel, en fin connaisseur, nous offre : « Enfin, vous allez être récompensés et réchauffés par un bon repas. Il était temps. C’est le prix de votre patience. Lyon est le moyeu d’une roue gourmande qui n’en finit pas de tourner. Au nord les vins de Bourgogne et du Beaujolais, les viandes du Charolais. Ensuite et en tournant vers la droite, les volailles de Bresse, les poissons, écrevisses et grenouilles de la Dombes, les fromages de la Savoie, les noix de Grenoble, les fruits, les légumes, les fromages et les vins de la vallée du Rhône, les châtaignes de l’Ardèche, les saucissons, les jésus, les fromages et la prune de la Haute-Loire, les céréales de la Loire et les salaisons des monts du Lyonnais. La roue tourne et tout descend vers la ville et ses marchés. ».
Bon appétit, bonne lecture, bons spectacles !
Jean-Pierre Longre
17:10 Publié dans Essai, Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, biographie, francophone, lyon, paul fournel, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/08/2019
Les amours et les livres
 Graham Swift, Le dimanche des mères, traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek, Gallimard, 2017, Folio, 2019
Graham Swift, Le dimanche des mères, traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek, Gallimard, 2017, Folio, 2019
Jane et Paul sont amants. Amants cachés, car elle est une petite servante, et lui un jeune aristocrate destiné à épouser Emma, de même classe sociale que lui. Jane et Paul « avaient fait des tas de choses ensemble, dans des tas de lieux secrets. ». Mais ce 30 mars 1924, leurs ébats sont exceptionnels : c’est le « dimanche des mères », jour de l’année où les domestiques sont en congé pour la journée. Jane n’ayant pas de mère à voir, puisqu’elle a été abandonnée toute petite, les deux jeunes gens ont une matinée entière pour se voir, sans doute pour la dernière fois : Paul doit se marier deux semaines après. Elle le sait, et tous deux vont en profiter le plus intensément possible. Après quoi Paul va partir retrouver sa fiancée, laissant Jane seule dans la grande demeure familiale, qu’elle va explorer minutieusement dans le plus simple appareil, comme pour y laisser la trace indélébile de son corps.
 Des événements imprévus et dramatiques vont marquer ce dimanche, discrètement annoncés au détour de certaines phrases. Le destin de Jane, devenue naturellement servante après avoir été élevée à l’orphelinat, et qui a découvert les livres dans la bibliothèque de ses maîtres, va changer à partir de là. La lecture des grands auteurs (Joseph Conrad en particulier) et l’écriture littéraire vont être son avenir, jusqu’à un âge avancé. « Née en 1901 – l’année, au moins, devait être exacte –, elle grandirait pour devenir domestique, ce que le premier venu aurait pu prédire. Mais qu’elle devînt écrivain, cela, personne ne l’aurait prédit. Y compris les membres bienveillants de la direction de l’orphelinat qui l’avaient fait naître un premier mai sous le nom de Jane Fairchild. Et sa mère encore moins que quiconque. ».
Des événements imprévus et dramatiques vont marquer ce dimanche, discrètement annoncés au détour de certaines phrases. Le destin de Jane, devenue naturellement servante après avoir été élevée à l’orphelinat, et qui a découvert les livres dans la bibliothèque de ses maîtres, va changer à partir de là. La lecture des grands auteurs (Joseph Conrad en particulier) et l’écriture littéraire vont être son avenir, jusqu’à un âge avancé. « Née en 1901 – l’année, au moins, devait être exacte –, elle grandirait pour devenir domestique, ce que le premier venu aurait pu prédire. Mais qu’elle devînt écrivain, cela, personne ne l’aurait prédit. Y compris les membres bienveillants de la direction de l’orphelinat qui l’avaient fait naître un premier mai sous le nom de Jane Fairchild. Et sa mère encore moins que quiconque. ».
Graham Swift a l’art de décrire des événements apparemment simples en allant au fond des choses, en posant les questions justes et en esquissant des réponses laissées à la réflexion des lecteurs : sur l’amour, la mort, la société, la littérature, sur les rapports entre réalité et fiction… Et Le dimanche des mères est certes un roman, mais un roman qui, comme dans le théâtre classique, obéit à la règle des trois unités : unités de temps (un seul jour), de lieu (entre deux maisons de maîtres, Beechwood et Upleigh), d’action (le basculement du destin de Jane). Surtout, cette journée unique dans la vie de la petite servante lui a fait franchir des barrières et lui a ouvert un bel avenir.
Jean-Pierre Longre
23:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, graham swift, marie-odile fortier-masek, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/07/2019
« Tu me trouveras »
 Dario Franceschini, Ailleurs, traduit de l’italien par Chantal Moiroud, Gallimard/L’arpenteur, 2017, Folio, 2019
Dario Franceschini, Ailleurs, traduit de l’italien par Chantal Moiroud, Gallimard/L’arpenteur, 2017, Folio, 2019
Iacopo Dalla Libera, petit notaire des environs de Mantoue, en apprend de belles : son père mourant, auquel il a succédé dans sa respectable étude, lui révèle qu’il a eu cinquante-deux autres enfants de cinquante-deux femmes différentes : « Cinquante-deux putains, Iacopo. Des femmes libres et merveilleuses. Elles avaient besoin d’argent pour vivre et j’avais besoin d’elles pour donner la vie. ». Tout est dans ces deux adjectifs qui vont peu à peu révéler leur force à Iacopo : « Libres » et « merveilleuses ».
Car il décide d’obéir aux injonctions de son père en menant une enquête, au début de laquelle, à Ferrare, il rencontre Mila, « merveilleuse » jeune femme qui ne lui cache pas son métier, mais lui révèle, justement, ce que c’est que d’être « libre ». Cette enquête lui montre aussi que la vie n’est ni aussi simple ni aussi terne que ce qu’il croyait. « Il y a les histoires secrètes et vraies de quantité de pauvres gens qui ont passé leur vie à se cacher : voleurs, ratés, amants, prêtres défroqués, enfants illégitimes, putains, prisonniers. », lui dit un vieil homme qui conserve les secrets de tous ces braves gens. Et Iacopo apprendra bien d’autres choses à propos de son père (son père, vraiment ?), de sa femme (dont la rigidité quotidienne cache un tempérament de feu), de lui-même, de l’humanité ; il apprendra que la vie du peuple, malgré la pauvreté, est bien plus exaltante que l’existence compassée des petits notables…
 Roman au ton alerte et sensible, joyeux et grave, Ailleurs est aussi un roman un peu fou, dira-t-on. Oui, un peu fou sans doute, mais au propos duquel on ne peut que donner raison. Mila la jeune prostituée est bien plus « dans la vie » que Iacopo le petit notaire ne l’était jusqu’à ce qu’il la connaisse. « Mais pourquoi donc, s’était maintes fois demandé Iacopo, racontait-il tous les secrets de sa famille à une putain ? Peut-être parce qu’il faisait confiance à Mila comme à personne d’autre auparavant, avait-il songé. Elle était pure intérieurement et Iacopo savait que tout avait changé dans sa vie depuis qu’il l’avait rencontrée. ». La vie cache bien des choses. Mais une fois qu’on s’en est aperçu, au lieu de succomber à un moralisme mortifère, on peut savoir ce qu’est le véritable amour, et se laisser dire : « Si un jour tu veux me voir, tu me trouveras. ».
Roman au ton alerte et sensible, joyeux et grave, Ailleurs est aussi un roman un peu fou, dira-t-on. Oui, un peu fou sans doute, mais au propos duquel on ne peut que donner raison. Mila la jeune prostituée est bien plus « dans la vie » que Iacopo le petit notaire ne l’était jusqu’à ce qu’il la connaisse. « Mais pourquoi donc, s’était maintes fois demandé Iacopo, racontait-il tous les secrets de sa famille à une putain ? Peut-être parce qu’il faisait confiance à Mila comme à personne d’autre auparavant, avait-il songé. Elle était pure intérieurement et Iacopo savait que tout avait changé dans sa vie depuis qu’il l’avait rencontrée. ». La vie cache bien des choses. Mais une fois qu’on s’en est aperçu, au lieu de succomber à un moralisme mortifère, on peut savoir ce qu’est le véritable amour, et se laisser dire : « Si un jour tu veux me voir, tu me trouveras. ».
Jean-Pierre Longre
17:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, italie, dario franceschini, chantal moiroud, gallimardl’arpenteur, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/07/2019
Amour et disparition
 Philippe Vilain, Un matin d’hiver, Grasset, 2019
Philippe Vilain, Un matin d’hiver, Grasset, 2019
C’est une belle histoire d’amour qui se noue entre deux universitaires, elle (la narratrice) enseignante en littérature française, lui (Dan Peeters) sociologue américain en poste en France, bel homme, simple et bon. « Je ne trouvais pas à Dan de défauts importants, et je n’ai jamais décelé en lui de médiocrité. ». Une histoire d’amour racontée avec délicatesse, qui semble pouvoir se prolonger indéfiniment, dans une sorte de bonheur « consolidé » par le mariage et la naissance d’une petite fille, Mary. « Je songeais à la chance que j’avais d’avoir rencontré Dan et de partager sa vie, à la surprise de voir que notre couple résistait au temps. ».
Pour ses recherches sur la représentation du racisme, Dan doit périodiquement faire des voyages à Atlanta, et sa femme s’en accommode, même s’il ne lui dit rien de ce qu’il y fait. Un jour où il a accepté qu’elle l’accompagne à l’aéroport, il s’envole pour un énième voyage, et contrairement à son habitude ne donne pas de nouvelles. Il n’en donnera plus. Alors commence une longue quête angoissée qui n’aboutit à rien. Sur place, à Atlanta, elle se fait en compagnie et avec l’aide des parents de Dan ; à Paris, en épluchant ses courriers, ses mails, les études qu’il a publiées – et en égrenant toutes les hypothèses : il a pu être assassiné par un gang au cours de ses recherches ; il a peut-être décidé de changer complètement de vie ; aurait-il été un agent de la CIA infiltré dans des bandes criminelles ? Des années et des années d’attente, de suppositions, de tourments… Et comment faire admettre à la petite Mary, qui devient progressivement une adolescente, que son père ne réapparaîtra pas ? Ne pas penser que « sa disparition fût volontaire » : « C’est à cause de Mary que je n’ai pas voulu y penser, parce que je n’imagine pas qu’un père, aimant comme l’était Dan, puisse abandonner son enfant, pourtant cette probabilité existe bel et bien. ».
Ce roman, écrit avec une sobriété tendue par l’émotion, est dédié « à la confidente d’un jour », c’est-à-dire à cette femme qui a « confié son histoire » à l’auteur. Celui-ci s’est livré à un « travail de recomposition », en laissant le lecteur régler à sa manière le « suspens » des phrases, « des mots qui n’arrivent pas à se dire », mais un « suspens » que la narration aide à lever, sans résoudre l’énigme. Car, comme l’écrit Philippe Vilain, les histoires « sont simplement ce que nous faisons d’elles, je dirais même qu’elles sont belles de ce que nous faisons d’elles et de ce qu’elles font de nous : belles des surprises qu’elles nous offrent et des découvertes qu’elles nous font faire, […] belles des peurs qu’elles nous font surmonter, belles de ce qui nous arrive et de ce qu’elles nous font devenir. ».
Jean-Pierre Longre
19:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe vilain, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2019
La maison de l’attente
 Gaëlle Josse, Une longue impatience, Les éditions Noir sur Blanc, Notabilia, 2018, J'ai lu, 2019
Gaëlle Josse, Une longue impatience, Les éditions Noir sur Blanc, Notabilia, 2018, J'ai lu, 2019
« Ma maison à moi, c’est l’attente. C’est l’océan et le bateau de Louis. Quelque part sur une mer du monde. L’incertitude comme seul point fixe. Sous mes gestes de chaque jour, il n’y a que du vide. De la place pour les songes apportés par le vent, pour les mots racontés par les flots. ».
Pendant la guerre, le bateau d’Yvon a été bombardé par la RAF. Dommage collatéral, dirait-on aujourd’hui, qui a bouleversé la vie d’Anne, sa femme, et de Louis, son fils. Remariée après la Libération à Étienne, le pharmacien du village, mère de deux autres enfants, Anne a accepté sans enthousiasme mais avec tendresse pour sa nouvelle famille l’embourgeoisement de sa nouvelle existence. La mésentente progressive, devenant brutale, entre Étienne et Louis fait un jour fuir celui-ci ; sans avertir, il s’engage sur les bateaux de commerce parcourant les mers d’un continent à l’autre.
 Sans nouvelles de son fils, Anne entame une attente d’abord pleine d’espoir, se métamorphosant en déception et en « longue impatience ». Retournant chaque jour dans son « ancienne maison, la bicoque adossée contre le vent, avec ses volets bleus fatigués, sur la lande, à l’entrée du sentier douanier qui surplombe la mer », elle emplit cette attente des souvenirs du passé – ses deux mariages, bien différents l’un de l’autre, les années heureuses, les duretés de la guerre –, et des rêves d’avenir : surtout le banquet qu’elle préparera pour le retour de son fils, et dont elle détaille progressivement le contenu dans les lettres qu’elle lui écrit comme on lance une bouteille à la mer (« Monsieur Louis Le Floch, en mer »). Une infinie promesse, qu’elle tisse de jour en jour, de mois en mois, d’année en année, à l’insu de tous.
Sans nouvelles de son fils, Anne entame une attente d’abord pleine d’espoir, se métamorphosant en déception et en « longue impatience ». Retournant chaque jour dans son « ancienne maison, la bicoque adossée contre le vent, avec ses volets bleus fatigués, sur la lande, à l’entrée du sentier douanier qui surplombe la mer », elle emplit cette attente des souvenirs du passé – ses deux mariages, bien différents l’un de l’autre, les années heureuses, les duretés de la guerre –, et des rêves d’avenir : surtout le banquet qu’elle préparera pour le retour de son fils, et dont elle détaille progressivement le contenu dans les lettres qu’elle lui écrit comme on lance une bouteille à la mer (« Monsieur Louis Le Floch, en mer »). Une infinie promesse, qu’elle tisse de jour en jour, de mois en mois, d’année en année, à l’insu de tous.
D’une grande sensibilité, le récit de Gaëlle Josse, qui renouvelle la thématique de l’attente féminine déclinée sur différents plans depuis celle de Pénélope, nous fait pénétrer dans l’âme complexe, touchante et attachante d’une femme dont la vie est tout entière tendue vers l’amour, celui des vivants et celui des disparus, surtout celui du fils absent, enfoui au plus profond de son cœur, peu à peu débordant tout. De même, débordant le cadre du simple récit à la première personne, la poésie des paysages extérieurs et intérieurs, de l’océan, des saisons, de la mémoire, de l’« immuable cercle » du temps qui passe.
Jean-Pierre Longre
15:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, les Éditions noir sur blanc, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/06/2019
Errance et déchéance
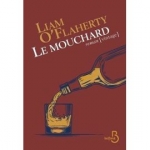 Liam O’Flaherty, Le Mouchard, traduit de l’anglais (Irlande) par Louis Postif, préface de Stève Passeur, Belfond, 2019
Liam O’Flaherty, Le Mouchard, traduit de l’anglais (Irlande) par Louis Postif, préface de Stève Passeur, Belfond, 2019
Gypo Nolan, force de la nature et esprit limité, ancien de l’Organisation révolutionnaire, dont il a été exclu, vit comme beaucoup de ses congénères au jour le jour, souvent sans savoir où il dormira le soir ni comment il pourra manger. En quête du moindre schilling, il décide de dénoncer son ami Mac Phillip, recherché par la police pour avoir tué un fermier. « Je viens réclamer la prime de vingt livres offerte par le Syndicat des fermiers pour des renseignements concernant le nommé Francis-Joseph Mac Phillip ». Ce disant, il donne l’impression de ne pas mesurer la portée de son acte.
Ni ses conséquences, qui vont faire l’objet principal du récit. Première conséquence : la mort de son ami dans l’affrontement avec la police venue l’arrêter. Deuxième conséquence : alors que les choses s’embrouillent dans la tête de Gypo, qui ne sait pas comment gérer les suites de son forfait, il se met à dépenser à tort et à travers et au vu de tous les vingt livres qui gonflent ses poches : tournées générales, visites à des prostituées, cadeaux divers – bagarres et fuites éperdues dans le labyrinthe des ruelles. Nous sommes à Dublin, dans les années 1920, peu après l’insurrection de 1916 ; dans le Dublin des ouvriers, des chômeurs, des miséreux, des parias, des révoltés, des résignés ; un Dublin que Gypo sillonne de « son corps de géant », sa lourde masse arpentant les bas-fonds d’une ville où l’alcool et le dénuement forment un mélange explosif.
L’écriture de Liam O’Flaherty, directe, sans fioritures, d’une poésie violente et brute, rend avec une particulière intensité la complexité de la situation : la condition sociale de ce peuple réduit aux expédients, la psychologie à la fois primaire et voilée de Gypo, qui tour à tour perd et prend conscience de son rôle de délateur et de la culpabilité qui le ronge, la bataille qui se livre au sein de l’Organisation révolutionnaire, guidée par le pur et froid Gallagher, sorte de Robespierre qui a tout deviné de la faute de Gypo, et qui le lui fait sentir : « Une force le poussait à affronter les regards de Gallagher, dont il ne pouvait se détacher sans ressentir une profonde brûlure dans la chair. » On se prend parfois à « souhaiter que [le] mouchard ne soit ni pris ni châtié », comme l’écrit Stève Passeur dans la préface, tant le personnage attire un mélange de dégoût et de compassion, à l’image de ses semblables voués à la déchéance, à l’image aussi de l’insecte pris au piège de son propre destin, comme de nombreux passages le laissent imaginer. « Il allait sans but, poussé vers le nord par la panique et l’impossibilité de réfléchir. Il fonçait dans tous les sens : il descendait une rue, virait à gauche, revenait en ligne parallèle, redescendait la rue qu’il venait de quitter, et contournait plusieurs fois le même coin, dans sa fuite éperdue. Il semblait aux trousses d’un lutin qui prenait un malin plaisir à revenir continuellement sur ses propres pas. Gypo pataugeait dans les mares, tombait sur les mains et les genoux dans des terrains vagues, se cognait violemment aux brèches des murs, grimpait sur des tas de briques, par-dessus des murs, sautait dans des cours et recommençait le même manège dans une autre rue. ». Voilà un exemple de condensé à la fois réaliste et symbolique du roman et de l’état d’un personnage aux abois.
Jean-Pierre Longre
 En 1935, John Ford réalisa un film (Le Mouchard) d’après le roman de Liam O’Flaherty. Outre celui-ci, les éditions Belfond viennent de publier, dans une veine et d’une autre époque, Le Messager de L. P. Hartley (traduit par Denis Morrens et Andrée Martinerie), dont Joseph Losey tira un film fameux, Palme d’Or au Festival de Cannes 1971.
En 1935, John Ford réalisa un film (Le Mouchard) d’après le roman de Liam O’Flaherty. Outre celui-ci, les éditions Belfond viennent de publier, dans une veine et d’une autre époque, Le Messager de L. P. Hartley (traduit par Denis Morrens et Andrée Martinerie), dont Joseph Losey tira un film fameux, Palme d’Or au Festival de Cannes 1971.
23:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglais (irlande), liam o’flaherty, louis postif, stève passeur, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/05/2019
Secrets, aveux et trahisons
 Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 3, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 3, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
Après son retour précipité de Dublin (voir livre 2), Alice se retrouve aux États-Unis, sous le choc de l’attentat au cours duquel Ciaran, son grand amour, a perdu la vie. Retrouvailles avec ses parents pour des relations toujours tumultueuses, poursuite des études, prise de fonctions comme enseignante à la Keene Academy… L’adaptation se fait tant bien que mal dans ce collège de Nouvelle-Angleterre où elle trouve un relatif apaisement de ses traumatismes, jusqu’au moment où elle fait la connaissance d’un père d’élève avec lequel elle noue une relation amoureuse épisodique. Après son retour à New-York, son amitié avec Duncan et Howie, les rapports en dents de scie avec ses parents, ses frères Peter et Adam, si différents l’un de l’autre, peuplent sa solitude. Un poste d’assistante d’édition va lui ouvrir les portes du monde littéraire.
 Les détails de la vie d’Alice nous sont contés sur le fond socio-politique de ces années-là : présidence prometteuse mais décevante de Jimmy Carter, élections successives de Ronald Reagan, perte des illusions, triomphe du capitalisme et des « yuppies », surgissement dramatique du sida, tout cela en résonance avec notre propre époque, jusqu’à des allusions malicieuses comme l’apparition sur la scène publique d’un jeune capitaliste à l’ambition démesurée, Donald Trump… Et nous pénétrons dans les arcanes du commerce éditorial, où Alice évolue à son aise : « Que ce soit au lycée, pendant mes études, ou quand je me terrais dans le Vermont, je ne m’étais jamais vraiment imaginée accéder à une position dirigeante. L’autorité et le management étaient des qualités que j’étais persuadée ne pas posséder, et je n’avais pas pour ambition d’encadrer une équipe, même dans un milieu littéraire. Et pourtant voilà que, à tout juste vingt-neuf ans, j’avais sous ma responsabilité une écurie d’auteurs, un budget, des subalternes – et je devais répondre de tout cela aux services commercial et comptabilité […] ». Bref, sinon le bonheur, du moins une forme de satisfaction personnelle qui, si elle ne résout pas tous les problèmes, réjouit le cœur et l’intellect.
Les détails de la vie d’Alice nous sont contés sur le fond socio-politique de ces années-là : présidence prometteuse mais décevante de Jimmy Carter, élections successives de Ronald Reagan, perte des illusions, triomphe du capitalisme et des « yuppies », surgissement dramatique du sida, tout cela en résonance avec notre propre époque, jusqu’à des allusions malicieuses comme l’apparition sur la scène publique d’un jeune capitaliste à l’ambition démesurée, Donald Trump… Et nous pénétrons dans les arcanes du commerce éditorial, où Alice évolue à son aise : « Que ce soit au lycée, pendant mes études, ou quand je me terrais dans le Vermont, je ne m’étais jamais vraiment imaginée accéder à une position dirigeante. L’autorité et le management étaient des qualités que j’étais persuadée ne pas posséder, et je n’avais pas pour ambition d’encadrer une équipe, même dans un milieu littéraire. Et pourtant voilà que, à tout juste vingt-neuf ans, j’avais sous ma responsabilité une écurie d’auteurs, un budget, des subalternes – et je devais répondre de tout cela aux services commercial et comptabilité […] ». Bref, sinon le bonheur, du moins une forme de satisfaction personnelle qui, si elle ne résout pas tous les problèmes, réjouit le cœur et l’intellect.
C’est un fait : les problèmes ne manquent pas dans l’entourage immédiat d’Alice. Son frère Adam, qui s’est enrichi à coups de manœuvres frauduleuses, va être dénoncé par Peter dans un article au retentissement accablant pour la famille, malgré les tentatives de conciliation de leur sœur, qui en prévoit les conséquences : « La honte salit tout ce qu’elle touche ». Des conséquences, il y en aura, mais aussi, pour Alice, les promesses de l’amour.
Ce troisième livre, qui suscite comme les précédents des réflexions sur l’histoire contemporaine des USA, sur l’écriture littéraire, sur les relations humaines et familiales, sur les secrets, les trahisons et les aveux, boucle en quelque sorte un cycle, puisque l’on retrouve à la fin la situation du début du premier livre : le moment où Alice a décidé de faire, en un récit rétrospectif, le roman de sa famille et de son époque. Mission accomplie pour Douglas Kennedy, qui promet une suite…
Jean-Pierre Longre
19:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), douglas kennedy, chloé royer, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/05/2019
Une Américaine à Dublin
 Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 2, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 2, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
La suite promise de la vie d’Alice Burns (voir le livre 1) a pour cadre l’Irlande. Étudiante au Trinity College de Dublin, elle va connaître les tâtonnements, les tribulations, les émotions d’une jeune américaine transplantée dans un pays dont les mœurs religieuses, familiales, sociales sont restées plutôt traditionnelles (et où par ailleurs la Guiness coule à flot…). Recherche d’un logement, prises de contact universitaires, amicales, sentimentales, tout ce qui compose la vie d’Alice et toutes les interrogations qu’elle suscite reposent non seulement sur le présent, mais aussi sur le lourd passé familial et sur un avenir incertain. « Le désespoir que je ressentais chez mes parents m’avait poussée à me bâtir une certaine indépendance, à un âge où la plupart des gens ne cherchent qu’un moyen de s’amuser sans avoir à grandir. […] Des années plus tard, je tomberais sur un mot qui me plairait immédiatement : conjoncture. La symphonie du hasard. Tout ce qui m’arrivait était-il simplement le fruit des circonstances, ou avais-je, par le biais de mes choix et de mes actions, un certain degré d’incidence sur le cours des choses ? ».
 Au pays de Joyce, Alice trouve à qui parler de littérature, d’art, de religion, de politique… Et tout se déroule sur le fond historique tourmenté des années 1970 : le Chili sanglant de Pinochet, par lequel la famille Burns est spécialement concernée (le père, proche de la junte et de la CIA, le frère Peter, qui a lutté contre la dictature et a dû se sauver en catastrophe après avoir été témoin d’atrocités), les « Troubles » et les attentats en Irlande, UVF contre IRA… Une incursion à Paris, où Alice rend visite à Peter, lui permet de changer d’atmosphère, de découvrir une ville dont elle rêvait, mais la replonge dans des souvenirs qui avaient été aiguisés par le surgissement inattendu à son domicile de Dublin d’une ancienne camarade pétrie de révolte, de désir de vengeance et de violence. Il y a aussi la rencontre de Ciaran, qui semble être le meilleur choix amoureux, et qui lors d’un séjour à Belfast lui fait connaître ses parents, visiblement à l’opposé des parents Burns : « Voilà donc ce qu’il était possible de ressentir dans une famille aimante et équilibrée ? ».
Au pays de Joyce, Alice trouve à qui parler de littérature, d’art, de religion, de politique… Et tout se déroule sur le fond historique tourmenté des années 1970 : le Chili sanglant de Pinochet, par lequel la famille Burns est spécialement concernée (le père, proche de la junte et de la CIA, le frère Peter, qui a lutté contre la dictature et a dû se sauver en catastrophe après avoir été témoin d’atrocités), les « Troubles » et les attentats en Irlande, UVF contre IRA… Une incursion à Paris, où Alice rend visite à Peter, lui permet de changer d’atmosphère, de découvrir une ville dont elle rêvait, mais la replonge dans des souvenirs qui avaient été aiguisés par le surgissement inattendu à son domicile de Dublin d’une ancienne camarade pétrie de révolte, de désir de vengeance et de violence. Il y a aussi la rencontre de Ciaran, qui semble être le meilleur choix amoureux, et qui lors d’un séjour à Belfast lui fait connaître ses parents, visiblement à l’opposé des parents Burns : « Voilà donc ce qu’il était possible de ressentir dans une famille aimante et équilibrée ? ».
En quelques mois, Alice vit des expériences nouvelles, formatrices, émouvantes, surprenantes parfois, aussi bien pour elle que pour le lecteur. Il faut dire qu’il n’y a pas meilleur artisan que Douglas Kennedy pour faire de cette brève tranche de vie vue sous les angles psychologique, social et historique un roman palpitant.
Jean-Pierre Longre
19:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), douglas kennedy, chloé royer, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/05/2019
« Chaque famille est une société secrète »
 Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 1, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2017, Pocket, 2018
Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 1, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2017, Pocket, 2018
Sans conteste, Douglas Kennedy sait écrire des romans, et notre soif narrative ne peut être qu’épanchée à leur lecture. La symphonie du hasard, dans sa construction musicale et sa teneur linéaire, n’a apparemment et malgré son titre rien de hasardeux, et si les péripéties qui en composent la trame laissent supposer que le destin est imprévisible, celui-ci se présente pourtant comme le résultat d’une certaine volonté humaine. En cela – outre le fait que ces péripéties, l’auteur a dû en vivre un certain nombre, ou en tout cas en avoir connaissance, puisque la narratrice Alice est vraisemblablement l’un de ses doubles –, en cela donc, nous avons affaire à un roman réaliste.
Alice Burns, éditrice, rend régulièrement visite à son frère Adam condamné à huit ans de prison. Un jour, il lui fait des révélations inattendues sur un événement de sa jeunesse : « Il fallait que tu le saches. Parce que c’est ce que je suis. Ce que nous sommes. ». Mise malgré elle dans le secret, elle décide de revenir sur le passé. « Si les deux dernières décennies m’ont appris quoi que ce soit, c’est cette vérité essentielle : le malheur est un choix. ».
 Nous voilà plongés dans l’Amérique du début des années 1970. La vie familiale avec ses conflits, ses secrets, ses non-dits, ses éclats : les parents qui ne peuvent se supporter qu’en menant l’un contre l’autre une sorte de guérilla permanente ; Alice et ses deux frères, Peter et Adam, aux tempéraments et aux visées radicalement différentes. La vie étudiante avec ses excès, ses velléités, les amitiés, les amours, l’alcool, la drogue, les regroupements par affinités, les clans, les inimitiés, les brouilles, les dépressions, les relations parfois étroites, parfois étranges, entre professeurs et élèves… Avec cela, le roman aborde de grands thèmes propres à l’époque : les préjugés racistes et homophobes persistants chez les uns, le progressisme et l’humanisme chez d’autres, les idéaux pacifistes (contre la guerre du Vietnam notamment), les manœuvres financières, les élections présidentielles, les déceptions politiques, le coup d’État de Pinochet au Chili (dont les répercussions dans la famille d’Alice ont leur importance)…
Nous voilà plongés dans l’Amérique du début des années 1970. La vie familiale avec ses conflits, ses secrets, ses non-dits, ses éclats : les parents qui ne peuvent se supporter qu’en menant l’un contre l’autre une sorte de guérilla permanente ; Alice et ses deux frères, Peter et Adam, aux tempéraments et aux visées radicalement différentes. La vie étudiante avec ses excès, ses velléités, les amitiés, les amours, l’alcool, la drogue, les regroupements par affinités, les clans, les inimitiés, les brouilles, les dépressions, les relations parfois étroites, parfois étranges, entre professeurs et élèves… Avec cela, le roman aborde de grands thèmes propres à l’époque : les préjugés racistes et homophobes persistants chez les uns, le progressisme et l’humanisme chez d’autres, les idéaux pacifistes (contre la guerre du Vietnam notamment), les manœuvres financières, les élections présidentielles, les déceptions politiques, le coup d’État de Pinochet au Chili (dont les répercussions dans la famille d’Alice ont leur importance)…
Récit rétrospectif foisonnant, dans lequel la littérature, l’écriture, l’histoire, la vie intellectuelle tiennent une place de choix, ce premier volume offre aussi de larges possibilités de réflexion sur l’existence individuelle, sociale, familiale – ce dernier volet étant inséparable de tout le reste et de cette vérité générale prononcée par l’un des personnages : « Nous avons tous une grande part de mystère ». Les volumes 2 et 3 sont annoncés pour les mois à venir. À suivre donc…
Jean-Pierre Longre
18:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), douglas kennedy, chloé royer, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/05/2019
En attendant
 Alain Gerber, La Hache, Ramsay, 2019
Alain Gerber, La Hache, Ramsay, 2019
Dans une contrée anonyme et perdue dont on devine pourtant qu’elle appartient à l’ex-Yougoslavie, à une époque indéfinie dont on se doute pourtant qu’elle se situe, il n’y a pas si longtemps, à l’issue d’une guerre odieuse au cours de laquelle les nationalismes meurtriers s’en sont donné à cœur joie, un jeune sous-lieutenant français, flanqué d’un caporal et de deux hommes de troupe, se retrouve à veiller sur un terrain gelé bordant une ferme isolée. Le terrain cache certainement un charnier, qui ne pourra être mis au jour qu’au printemps, lorsque la terre deviendra suffisamment meuble pour être creusée ; la ferme abrite une famille – père fermé qui a dû participer au massacre (et qui entretient méticuleusement, objet réel et symbolique, la hache annoncée par le titre), mère muette, deux filles, dont l’une s’est exilée, et dont la seconde se cache ou se dévoile d’une manière énigmatiquement perverse.
Notre sous-lieutenant, en attendant le dégel (au sens propre de l’expression), est confronté à l’attitude sournoise de son caporal, à l’apathie de ses hommes, à l’hostilité du voisinage, à la dureté du climat, au vide de ses journées, à sa propre solitude – tout cela sous la férule d’un sens profond du devoir militaire et d’un idéalisme quasiment aristocratique qui lui feront regretter les entorses faites à son honorabilité. Comme le Giovanni Drogo du Désert des Tartares ou le Zangra de Jacques Brel (mais dans le froid et sous la neige), il occupe tant bien que mal son ennui, ne sachant pas si l’ennemi viendra ou s’il est déjà là. Quant au paysan, il cherche à se sortir d’une situation compliquée, face au pope du village qui, afin de sauver sa peau et d’échapper à la faute collective, voudrait lui faire endosser toute la responsabilité du massacre des « Musulmans » qui s’est perpétré sur ses terres, face aussi à ce petit groupe de soldats venu de l’étranger occuper sa propriété et son pays vaincu, face enfin à sa femme mutique et à sa fille au comportement incompréhensible.
Faire un roman de ces journées où, concrètement, il ne se passe pas grand-chose ? Oui. L’art d’Alain Gerber (dont on nous dit qu'il revient, mais qui ne nous a jamais abandonnés...) consiste à suggérer, notamment par l’adoption alternative des points de vue (celui du sous-lieutenant, celui du paysan) et par l’exploration intime des individus les sentiments, les passions, les fantasmes, les espoirs, les frayeurs – tout ce qui bouillonne sous les crânes. À suggérer aussi ce qui mène les cœurs et les âmes – les nationalismes, les haines, les trahisons, le désir d’amour, la peur de la mort, la fascination et le dégoût qu’elle entraîne. Et à montrer que sur tout cela et sur le reste, l’homme peut se tromper. En attendant, la vie continue.
Jean-Pierre Longre
17:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, éditions ramsay, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/04/2019
Le goût des amitiés tourmentées
 Lire, relire... Olivier Bourdeaut, Pactum salis, Finitude, 2017, Folio, 2019
Lire, relire... Olivier Bourdeaut, Pactum salis, Finitude, 2017, Folio, 2019
« Amicitia pactum salis, dit un proverbe médiéval. “L’amitié est un pacte de sel”, c’est-à-dire que l’amitié est durable, voire éternelle, comme le sel. ». Le titre et l’intrigue du livre d’Olivier Bourdeaut sont une illustration et une extension romanesques de ce proverbe. N’oublions pas, en outre, que le sel, à trop forte dose, peut être nocif. L’amitié entre Jean, devenu paludier à Guérande pour fuir les contraintes de Paris et les excès de la modernité, et Michel, agent immobilier aux dents longues et roulant en Porsche, est à la fois imprévisible et tourmentée. Après une rencontre musclée sur fond d’ébriété, de sans-gêne, de fureur et de vengeance, tous deux scellent le fameux pacte, l’un influant sur l’autre et vice-versa : Michel le nouveau riche sans scrupules se met à travailler pour Jean et pour un salaire de misère, et Jean l’ascète solitaire se met à fréquenter avec son compère les lieux branchés et à draguer sur la plage.
 Les péripéties que connaît cette amitié s’assortissent d’une énigme policière, sont jalonnées de suspense, de souvenirs significatifs et de séquences quasiment théâtrales à caractère tragi-comique, voire grand-guignolesque. Le sang et les larmes coulent à flots, provoqués par les rivalités, les coups, l’alcool, le sel et le soleil. L’auteur se plaît aussi à dresser des portraits ironiques et pris sur le vif. Ceux des deux protagonistes, certes, ceux des jeunes filles auxquelles ils s’intéressent, et celui, entre autres, d’Henri, anarchiste de droite, anti-bobo, dandy provocateur sorti tout droit du XIXème siècle, que Jean a naguère assidûment fréquenté.
Les péripéties que connaît cette amitié s’assortissent d’une énigme policière, sont jalonnées de suspense, de souvenirs significatifs et de séquences quasiment théâtrales à caractère tragi-comique, voire grand-guignolesque. Le sang et les larmes coulent à flots, provoqués par les rivalités, les coups, l’alcool, le sel et le soleil. L’auteur se plaît aussi à dresser des portraits ironiques et pris sur le vif. Ceux des deux protagonistes, certes, ceux des jeunes filles auxquelles ils s’intéressent, et celui, entre autres, d’Henri, anarchiste de droite, anti-bobo, dandy provocateur sorti tout droit du XIXème siècle, que Jean a naguère assidûment fréquenté.
Inutile de faire la comparaison avec le premier roman à succès d’Olivier Bourdeaut. Celui-là est bien différent. On sent qu’en racontant cette histoire pleine de remords et de passion, l’auteur s’est amusé (ce qui n’exclut nullement le travail et le talent). Et le lecteur, lui aussi, est pris entre l’amusement et les tourments. La marque d’un bon roman.
Jean-Pierre Longre
10:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, olivier bourdeaut, finitude, jean-pierre longre, folio | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2019
Une nouvelle vie ?
 Éric Arlix & Frédéric Moulin, Agora zéro, éditions JOU, 2019
Éric Arlix & Frédéric Moulin, Agora zéro, éditions JOU, 2019
Voilà un petit livre qui, par sa densité, par ses résonances, par les pistes multiples qu’il ouvre à travers l’imbroglio de la réalité présente et des projections imaginaires, est pour ainsi dire une somme descriptive et narrative dans le domaine de l’anticipation. Mais d’une anticipation qui attache ses ramures à l’Antiquité grecque, voire à la mythologie. Il s’agit, rien de moins, de se lancer, avec le projet « UToPIE », vers « une nouvelle civilisation de liberté éternelle », sous la conduite d’un certain Eon Hayek-Coriolan, libertarien visionnaire issu de quelque Silicon Valley, et dont le nom à lui seul évoque le vertige temporel, la puissance spirituelle ou les velléités populistes.
Alex, autre protagoniste, dont on connaîtra finalement la surprenante nature, et qui est le « père » de l’algorithme Syntagma, capable de juger en toute simplicité et sans ambiguïté n’importe quel délit (« la loi est la loi, les faits sont là »), comme Socrate le fit lors du procès des stratèges grecs des Arginuses (mais maintenant Socrate serait inutile, car Syntagma n’a pas besoin de l’intervention humaine), Alex, donc, va découvrir cette fameuse « UToPIE » – non un « empire virtuel », mais, selon Eon qui le guide, un « monde vrai » : « Nous allons accomplir de grandes choses, et les accomplir dans le monde réel ! ». Écologie parfaite, sécurité absolue, prolongement de la vie jusqu’à l’immortalité, automatisme technique, individualisme sans restriction, liberté de choix… « Aucun malentendu possible, aucune zone grise sur UToPIE, où absolument tout résulte d’un contrat, les droits et les devoirs de chacun, ce qu’on possède ou dont on a la jouissance… Pas un contrat que tu n’as jamais lu ni signé et qui résulterait d’un hypothétique pacte social préhistorique, s’amuse Eon, mais le contrat particulier que toi, individu singulier, aura choisi de conclure. Loi, État, ces fictions bureaucratiques sont pour le créateur d’UToPIE les noms à peine plus honorables qu’emprunte l’extorsion. ».
Ce programme n’est pas bâti sur du vent, mais s’appuie sur les dires et les faits de personnages antiques (Socrate, Alcibiade, les généraux athéniens) et mythologiques (Poséidon, Minos, Thésée…). On serait donc tenté d’être séduit par l’invention d’Eon, d’autant qu’elle se fonde sur des tendances actuelles relevant de l’écologie moderne et des options libertaires. Mais il ne faut pas oublier que « les Athéniens comme les Pères fondateurs de la démocratie américaine possédaient des esclaves » ; de même, le « capitalisme vert » a ses propres victimes, et la prose alerte, variée, concise, luxuriante des deux auteurs ne se prive pas de mettre un accent volontiers satirique sur les dangers d’UToPIE et de ses avatars inhumains. L’humour noir, les évocations mortifères, la mise en évidence des contradictions (« L’innovation, pour changer le monde, se doit d’abord d’être rentable ») nous mettent en garde. Certes. Mais il n’y a pas de vérité unique et absolue : la multiplicité des sujets, l’ambiguïté de la série de tableaux et du « retour vers l’Eden » qui mettent des points de suspension à la fin du livre laissent au lecteur toute liberté de déchiffrement, et tout loisir d’apprécier un ouvrage palpitant, dont l’engagement n’occulte pas la qualité littéraire.
Jean-Pierre Longre
19:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, Éric arlix, frédéric moulin, éditions jou, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/04/2019
Paradoxale émancipation
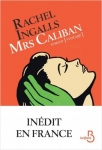 Rachel Ingalls, Mrs Caliban, traduit de l’américain par Céline Leroy, Belfond, 2019
Rachel Ingalls, Mrs Caliban, traduit de l’américain par Céline Leroy, Belfond, 2019
Dorothy, dont la vie s’écoule sur fond de désespoir et de monotonie entre un mari inattentif et volage, le vide laissé par le deuil de son fils Scotty suivi de la perte d’un bébé, les soins du ménage et de la cuisine, les rendez-vous avec son amie Estelle portée sur l’alcool et les hommes, est l’objet de drôles d’hallucinations auditives : elle croit entendre à la radio des phrases qui s’adressent nommément à elle et ne sait pas comment cela évoluera lorsque, un soir, une sorte de monstre investit sa maison : « Une créature pareille à une grenouille géante de presque deux mètres joua des épaules pour entrer dans la maison, puis se planta devant elle, immobile, les jambes légèrement fléchies, et la regarda droit dans les yeux. ». Elle réalise qu’il s’agit de cet « amphibien géant » qui s’est évadé de l’institut où il faisait l’objet d’expériences cruelles, en tuant un gardien et un médecin. Étrangement, Dorothy surmonte sa peur et se laisse vite séduire par le géant.
À partir de là, sa vie de « desperate housewife » prend une tournure toute nouvelle : « Il ne s’était rien passé pendant tant d’années. Elle avait travaillé pour s’occuper, mais c’était tout. Elle n’avait pour ainsi dire pas de passions, plus vraiment de mariage, pas d’enfants. À présent, enfin, elle avait quelque chose. ». En un retournement paradoxal, « Aquarius » (le nom donné publiquement à la créature), que la radio présente comme un monstre sanguinaire, lui fait découvrir l’émancipation, la liberté, la prise de risques même – puisqu’avec lui, elle se met à parcourir de nuit et en secret les rues et les parcs de la ville, courant le danger de croiser des habitants qui l’identifieraient facilement, vu son allure et sa taille. Il lui fait connaître l’amour, le vrai, la « fleur bleue » dont rêve aussi M. Mendoza, le jardinier, qui est peut-être le seul humain « normal » à la comprendre, voire à la deviner.
Ce roman à la fois vif et poétique (et dont la première édition, précisons-le, date de 1982), tient du conte, ou plutôt de la fable. Ses allures fantastiques ne doivent pas faire illusion : Rachel Ingalls explore ici les manifestations et les dessous d’une réalité psycho-sociale pesante et frustrante, que l’irruption de l’irrationnel révèle avec brio et sans optimisme excessif.
Jean-Pierre Longre
Rachel Ingalls vient de décéder (mars 2019) à l’âge de 78 ans.
Née à Boston en 1940, Rachel Ingalls a grandi à Cambridge, dans le Massachusetts. Tour à tour costumière de théâtre, bibliothécaire, lectrice, elle est l’auteure d’une dizaine de livres. Radiophile et cinéphile inconditionnelle, Rachel Ingalls était installée à Londres depuis 1965. (Belfond)
19:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), rachel ingalls, céline leroy, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/03/2019
« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »
 Pascal Quignard, Dans ce jardin qu’on aimait, Grasset, 2017, Folio, 2019
Pascal Quignard, Dans ce jardin qu’on aimait, Grasset, 2017, Folio, 2019
Non seulement le révérend Simeon Pease Cheney entendait tout, comme le recommande Dieu dans Matthieu XIII, 9, mais il notait tout : le chant des oiseaux, et aussi « le seau, où la pluie s’égoutte, qui pleure sous la gouttière de zinc, près de la marche en pierre de la cuisine… ». Cette musique est un psaume, de même que « le vent quand il s’engouffre dans le portemanteau du corridor de la cure » est un Te Deum !
L’histoire racontée par Pascal Quignard est celle, réelle, du pasteur Cheney, dont la femme morte en couches trop jeune fait de sa part l’objet d’une passion exclusive, tellement exclusive qu’il chassera de la maison sa fille Rosemund, cause involontaire du décès de sa mère, lorsqu’elle aura dépassé l’âge de celle-ci… Resté seul dans le jardin conjugal, il transcrit indéfiniment les chants d’oiseaux (bien avant Messiaen), les bruits de la vie quotidienne – et c’est ce qui le rend heureux. « C’est cette maison, mon labyrinthe. C’est ce jardin, mon labyrinthe. Ce n’est pas elle, en personne, Eva, ta mère, bien sûr, je ne suis pas fou. Mais ce jardin, c’est elle qui l’a conçu, c’est son visage. […] Dédale de plus en plus beau dans lequel je me perds. […] Dont je me suis mis à noter tous les chants qui s’ébrouent et vivent sur les branches. ».

Pourtant, sa fille apparemment ne lui en tiendra pas rigueur. Revenue chez son père vieillissant, elle l’encourage à faire publier les vastes partitions issues de ses notations ; refus successifs des éditeurs – mais après la mort de son père en 1890, elle édite à compte d’auteur ces Wood Notes Wild que Dvorak, en particulier, prit tellement au sérieux qu’il en tira son Quatuor à cordes n° 12.
 De « cette double histoire », Pascal Quignard a fait non un roman linéaire, mais un récit théâtralisé, une sorte d’oratorio à trois voix : celles du « récitant » (auteur, metteur en scène, pianiste, narrateur…), de Simeon le pasteur, de Rosemund sa fille. Trois voix auxquelles s’ajoute celle, muette et omniprésente, d’Eva la tant aimée, dont l’alliance, comme un « rayon de lumière », ira finalement au doigt de sa fille. Long poème musical et littéraire, Dans ce jardin qu’on aimait se lit, se dit, se joue et se chante en mineur et se termine dans une lumière intense, avec un arc-en-ciel au fond du jardin. On a assisté à un concert original, émouvant et beau.
De « cette double histoire », Pascal Quignard a fait non un roman linéaire, mais un récit théâtralisé, une sorte d’oratorio à trois voix : celles du « récitant » (auteur, metteur en scène, pianiste, narrateur…), de Simeon le pasteur, de Rosemund sa fille. Trois voix auxquelles s’ajoute celle, muette et omniprésente, d’Eva la tant aimée, dont l’alliance, comme un « rayon de lumière », ira finalement au doigt de sa fille. Long poème musical et littéraire, Dans ce jardin qu’on aimait se lit, se dit, se joue et se chante en mineur et se termine dans une lumière intense, avec un arc-en-ciel au fond du jardin. On a assisté à un concert original, émouvant et beau.
Jean-Pierre Longre
19:31 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, musique, pascal quignard, simeon pease cheney, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2019
L’éveil de la passion
 Marc Villemain, Mado, Éditions Joëlle Losfeld, 2019
Marc Villemain, Mado, Éditions Joëlle Losfeld, 2019
« Mon premier souvenir en tant que femme », dit-elle. Pourtant Virginie était encore une enfant lorsque les deux frères de son amie Mado lui jouèrent un sale tour en emportant tous ses vêtements alors qu’elle prenait un bain de mer. Farce de gosse, et pourtant c’est la peur qui saisit la fillette. « Je crois que derrière leurs grognements j’entendais autre chose que des cris de cow-boys ou d’indiens, de gendarmes ou de voleurs. Je n’entendais plus la gaieté, plus la jubilation, plus la malice ordinaire de nos âges […]. Comme si ce n’était plus eux. Plus des enfants mais des animaux. Qui bondissaient, beuglaient, crachaient, salivaient. Du haut de mes neuf ans, il me semblait voir ce qu’ils s’apprêtaient à être. Leur devenir-homme. Des hommes, voilà. C’est-à-dire, pour la gamine que j’étais, des bêtes sauvages, carnassières. Cannibales. ». Son seul refuge : un « carrelet », pauvre cabane de pêcheurs où elle avait l’habitude de se retrouver seule avec elle-même. Cette fois-ci, elle y aura passé la nuit, nue, « ratatinée sur le plancher », avant de rentrer chez elle en catimini.
Cette aventure l’éloigna un certain temps de Mado. Puis ce fut comme un déclic : les deux filles se retrouvèrent dans une relation plus qu’amicale, s’éveillant mutuellement aux sens, voire à la passion. Séparations, retrouvailles, jeux de la jalousie et du hasard, recherche et découverte du plaisir et de la relation exclusive… Mado est un roman d’amour qui ne verse pas de l’eau de rose. Certes les fleurs bleues y abondent, mais ce sont des chardons, qui envahissent les dunes, griffent les corps et blessent les cœurs.
Le tout est soutenu par le style précis et imagé de Marc Villemain, qui ne mâche ni ses mots ni ses formules, et sait parfaitement marier la délicatesse à la sensualité, l’empathie à la vigueur, la poésie au réalisme, le rêve à la réflexion, l’espoir à l’illusion. L’alternance narrative n’y est pas pour rien : au récit des événements, fait face en une sorte de miroir la mémoire méditative de l’adulte qu’est devenue Virginie, elle-même mère d’une jeune Émilie qui va aussi connaître les « odeurs de fin d’enfance » et la force de la nature. « Qui se souvient de son éveil aux sens ? Qui peut dire : “ Voilà, c’est là, c’est ça, c’est ce jour-là ” ? Moi qui suis chair, et suée, et sang, moi qui suis spasmes et frissons, je peux dire que c’est toute la nature qui est venue à moi. La liste serait infinie des phénomènes qui ont aiguillonné mes sens. Le duvet d’une pêche blanche, son jus clair ruisselant sur mon menton. La supplique inutile d’un poisson frétillant entre mes mains et son regard implorant, visqueux. La violence d’un certain orage de printemps dans l’odeur acidulée de l’herbe chaude, cette échancrure de lumière brutale dans le ciel de suie. […] ». Mado pourrait être une mine pour ceux qui s’adonnent au décorticage psychanalytique des textes littéraires. Heureusement, ni Virginie ni Mado ne sont des objets d’étude. Elles sont des personnages authentiques, sensibles, humains, tels que seul un vrai et beau roman peut en montrer.
Jean-Pierre Longre
23:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marc villemain, Éditions joëlle losfeld, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/12/2018
Exil et rêves à Belfort
 Alain Gerber, Souvenirs d’une invisible, Éditions Marivole, 2018
Alain Gerber, Souvenirs d’une invisible, Éditions Marivole, 2018
Au commencement il y a Samuel Breldzerovsky, sergent dans l’armée impériale russe, obligé, parce que d’origine juive, de quitter son métier, puis son pays. Après diverses tribulations à travers l’Europe, il parvient avec sa femme Helena à Belfort, « ville de garnison au passé mouvementé », pour laquelle il éprouve un « coup de foudre », et où il décide de rester… Lorsqu’il devient veuf, c’est sa fille Sonia qui, du haut de ses cinq ans, se met à tenir le ménage de celui qui, après avoir essayé maints métiers, s’établit comme chiffonnier-brocanteur dans un quartier populaire. Pourtant, « l’extrême docilité de Sonia est trompeuse. Elle déteste, comme son intime ennemie, chacune des besognes qu’elle exécute sans broncher, sans une minute pour souffler dès qu’elle a quitté l’école de la rue des Bons-Enfants. Elle déteste les prodigalités et les débordements de Samuel, qui ne font que lui compliquer la tâche. ». Et lorsqu’elle pénètre dans la famille de son amie Mathilde, elle sait « dans quel cercle elle souhaite s’infiltrer, si on ne l’en empêche pas : celui des radieux et des puissants. ».
Dans cette perspective, elle va faire les choix qu’elle juge les meilleurs (« mauvais », nous dit la présentation… Vraiment ?), à commencer par celui d’un mari : des deux frères Lentz, elle prend comme époux Joseph, le moins séduisant, le plus « lymphatique », le plus « hésitant », le moins « compétent », le plus « gentil », bref celui qu’elle pourra modeler à sa façon, dominer et « inventer ». La naissance de Boris la comble, et elle va mettre en lui toutes ses espérances, beaucoup plus qu’en la petite Mathilde (prénom de sa meilleure amie), qui deviendra ensuite Hélène (prénom de sa mère), dont l’invisibilité laissera toute la place à l’éclat de Boris et à l’observation discrète de l’histoire familiale. À lui la carrière de brillant violoniste programmée, tracée, imposée par Sonia. À lui la gloire musicale qui fera la fierté de sa mère et de son grand-père – mais aussi à lui l’indépendance et l’orgueil du professionnel de la virtuosité. « Au violon, Boris est désormais l’incarnation d’une perfection glacée qui devrait intimider les agents, les directeurs de salle, les chefs d’orchestre et les critiques. Il a tout ce qu’il faut pour s’imposer comme l’interprète idéal aux yeux des avaleurs de parapluie qui, on fait seulement semblant de ne pas le savoir, forment l’essentiel de la clientèle des récitals. Sa mère est aux anges. ».
Il aurait été étonnant que la musique ne soit pas un motif essentiel du roman d’Alain Gerber. Essentiel, mais pas unique. Il y a Belfort, qu’il connaît par cœur, et la vie sociale, politique, laborieuse qui fut celle de la cité dans la première moitié du XXème siècle (n’oublions pas le « Faubourg des coups de trique », qui se glisse au coin d’une page), avec ses autochtones et ses immigrés. Dans son style particulier fait à la fois de détachement pudique, de saine ironie, de compréhension critique et de tendresse discrète, l’auteur nous présente des personnages qui, dans leur diversité, nous apparaissent comme vrais.
Jean-Pierre Longre
08:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, Éditions marivole, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/12/2018
La guerre, l’amour, l’amitié
 Brigitte Giraud, Un loup pour l’homme, Flammarion, 2017, J'ai Lu, 2018
Brigitte Giraud, Un loup pour l’homme, Flammarion, 2017, J'ai Lu, 2018
Ils ne sont pas si nombreux, les livres sur la guerre d’Algérie, ou qui la prennent pour cadre. Un loup pour l’homme répond aux deux critères, ou se situe entre les deux : la guerre en question n’est pas une simple toile de fond, puisqu’elle est au cœur du récit et des préoccupations des personnages qui la vivent à leur niveau, et elle n’est pas un simple sujet de reportage, puisque c’est des corps, des sentiments et des âmes qu’il s’agit ici.
Antoine et Lila s’aiment. Ils vont avoir un enfant, mais Antoine est appelé pour ce que les autorités appellent les opérations de « pacification » en Algérie – et le bébé à venir risque de compliquer les choses. Alors Lila, qui « n’a pas d’autre choix que de garder l’enfant » et qui « veut être l’égale d’Antoine », décide de rejoindre son mari à Sidi-Bel-Abbès, où il soigne les blessés. Refusant de porter une arme, il a été affecté comme infirmier à l’hôpital, où se révèlent à lui, sur les corps et dans les âmes de ses patients, tous les méfaits, toutes les atrocités de ce qui se révèle être une vraie guerre.
 La vie quotidienne d’Antoine prend un élan nouveau grâce à l’arrivée de Lila, puis à la naissance de Lucie, qu’il fête avec ses copains Martin et Jo, et avec laquelle il « prend comme une bouffée d’air, où il puise les forces dont il aura besoin par la suite. ». Une suite qui devient de plus en plus difficile, avec les attentats et les combats dont le nombre et la gravité s’intensifient, les crimes de l’OAS, les dangers qui se rapprochent. Et il y a Oscar, ce jeune soldat amputé de la jambe auquel Antoine s’attache, auquel il arrachera les mots que le blessé traumatisé n’arrive pas à prononcer, jusqu’à ce qu’il se fasse raconter l’histoire qui a valu à Oscar son amputation, et qui vaut au livre son titre à double entente.
La vie quotidienne d’Antoine prend un élan nouveau grâce à l’arrivée de Lila, puis à la naissance de Lucie, qu’il fête avec ses copains Martin et Jo, et avec laquelle il « prend comme une bouffée d’air, où il puise les forces dont il aura besoin par la suite. ». Une suite qui devient de plus en plus difficile, avec les attentats et les combats dont le nombre et la gravité s’intensifient, les crimes de l’OAS, les dangers qui se rapprochent. Et il y a Oscar, ce jeune soldat amputé de la jambe auquel Antoine s’attache, auquel il arrachera les mots que le blessé traumatisé n’arrive pas à prononcer, jusqu’à ce qu’il se fasse raconter l’histoire qui a valu à Oscar son amputation, et qui vaut au livre son titre à double entente.
Dans un style d’une apparente simplicité, sans fioritures, sans pathos excessif, l’auteure révèle les sentiments intimes, les doutes récurrents, les angoisses profondes de personnages qui tentent d’affronter un monde qu’ils n’ont pas voulu. Le loup n’est pas forcément celui qu’on croit, et Brigitte Giraud, qui est née comme Lucie et dans les mêmes conditions qu’elle à Sidi-Bel-Abbès, a l’art de mener, par la narration romanesque, ses personnages et ses lecteurs vers la réalité : Antoine « a compris l’absurdité des choses, soigner ou tenir un fusil, c’est la même frustration, la même aberration. Il a fini par comprendre le rôle que jouait l’armée française, le lourd tribut payé par la population algérienne, et il se sent trahi. Ses yeux se dessillent enfin. ». Heureusement, il y a Lila et Lucie, il y a eu Oscar et quelques autres… Un loup pour l’homme est un beau roman sans concessions, qui, malgré les événements qu’il relate, chante l’amour et l'amitié, et dont l’humanité, dans tous les sens du terme, sort grandie.
Jean-Pierre Longre
15:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, brigitte giraud, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/12/2018
Le « qui » et le « pourquoi »
 E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018
E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018
« Quelqu’un a dit un jour qu’une histoire n’a en réalité ni début ni fin ; ce ne sont que des moments choisis subjectivement par le narrateur pour aider le lecteur à situer un événement dans le temps. ». Cette phrase, par laquelle débute un chapitre de Jeux de miroirs, est une bonne approche de la stratégie narrative de l’auteur, mais n’en dit pas toute la complexité. Car trois voix se relaient pour composer un récit qui tourne autour du même événement, l’assassinat de Joseph Wieder, professeur à Princeton, « dans la nuit du 21 au 22 décembre 1987. ». Assassinat jamais élucidé, mais qui aura fait couler beaucoup d’encre.
La première de ces trois voix est celle de Richard Flynn, alors étudiant à l’université en question, épris de sa colocataire, Laura Baines, elle-même très proche du professeur Wieder, une jeune femme troublante qui deviendra un personnage pivot. Longtemps après les événements, Richard décide d’écrire un livre relatant ceux-ci, mais meurt après n’avoir remis que la première partie de son manuscrit à un agent littéraire, la suite restant introuvable. L’agent confie donc l’enquête à un journaliste (la deuxième voix), qui va suivre des pistes biaisées et se heurter à des obstacles inattendus et à des contradictions nombreuses. « J’étais perdu dans une sorte de dédale sans fin. Je m’étais lancé sur la piste du manuscrit de Richard Flynn, et non seulement je ne l’avais pas trouvé, mais j’étais maintenant enseveli sous une montagne de détails à propos de personnes et de faits qui refusaient de s’assembler pour former une image cohérente. ». La troisième voix est celle du policier maintenant à la retraite qui, à l’époque des faits, n’a pu trouver le meurtrier et qui, pour différentes raisons, reprend l’enquête et fait apparaître d’autres protagonistes. Les trois points de vue, bien sûr, éclairent les événements sous des angles fort différents, suggérant des réponses dans lesquelles le lecteur devra trouver sa part de vérité.
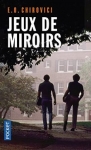 On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié avec succès plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».
On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié avec succès plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».
Jean-Pierre Longre
12:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, usa, roumanie, e. o. chirovici, isabelle maillet, les escales, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/11/2018
Chacun à sa place ?
 François Bégaudeau, En guerre, Verticales/Gallimard, 2018
François Bégaudeau, En guerre, Verticales/Gallimard, 2018
Rien ne prédisposait Romain et Louisa à se rencontrer. Lui, plutôt bobo, donnant dans le socio-culturel, elle, employée en CDD dans un entrepôt d’Amazon, habitent la même ville mais ne vivent pas dans le même monde. Leur rencontre fortuite est pourtant le déclencheur d’un certain nombre d’événements qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’amour. « L’entente de Louisa et Romain tient […] d’abord de la convergence d’intérêts. Elle ne feint pas d’être plus que cela. Elle ne se raconte pas d’histoires d’amour. Sa question n’est pas là. ».
Pour tout dire, En guerre n’est pas un roman sentimental. C’est un roman ironique et pessimiste sur la société d’aujourd’hui. D’une ironie cruelle et d’un pessimisme implacable. On peut être d’accord ou non avec le « rien ne peut changer » dans le système actuel, donc avec l’idée que c’est le système qu’il faut radicalement transformer. Mais on ne peut que se laisser porter par la manière incisive dont François Bégaudeau raconte et décrit le fonctionnement d’une société cloisonnée, en quête de vie ou de survie, une société « en guerre » – pendant que se joue, en fond de scène, une autre guerre, celle des attentats de 2015. La victime emblématique de cette guerre est Cristiano, « fort en gueule mais faible en mots », compagnon de Louisa, dont le destin bascule lorsque l’usine Ecolex, où il était employé, ferme et procède à un licenciement collectif. À partir de là, c’est une déchéance progressive – déprime, addiction au jeu, échec social et sentimental – et l’immolation publique. Qui incriminer ? Les patrons et actionnaires, la société, le capitalisme, la faiblesse des politiques, l’impuissance des syndicats, la compagne délaissée et son amant, le briquet qui a mis le feu, la personne qui a prêté le briquet ?
Il y a bien d’autres péripéties, bien d’autres histoires esquissées ou menées à terme – ce terme étant souvent un cul-de-sac. Dans cette fiction du réel, disons un récit dans lequel, autour de personnages fictifs, tourne, d’une manière parfois vertigineuse, le réel social d’aujourd’hui, l’auteur n’hésite pas, par le jeu d’une écriture où la satire du langage à la mode, des faux engagements et des bonnes consciences fuse vigoureusement, à prendre une sorte de distance humoristique confinant volontiers à l’autodérision, ce qui permet au lecteur de supporter la tragédie. Cette tragédie, c’est celle de la toute-puissance des uns, de l’impuissance des autres – impuissance à laquelle se résignent certains, comme la mère de Louisa : « Les pauvres parfois crient à l’injustice. Ils crient d’autant plus fort qu’au fond d’eux ils estiment leur sort justifié. Au début des temps un verdict juste a été rendu qui les assigne aux soutes. À leur disgrâce il y a une cause réelle et sérieuse. ». La leçon de tout cela, qui laisse peu de place à l’espoir, on pourrait la tirer de la conscience « frétillante » d’Alban, jeune homme de bonne famille qui a voulu devenir avocat spécialisé dans le droit du travail : « Le champ social est une scène d’opérette où les costumes drapent des vides, où les fonctions sont des leurres, où la distribution des places n’est pas plus fondée que l’agencement des bâtons de mikado. »
Jean-Pierre Longre
18:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, françois bégaudeau, verticales, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/11/2018
Misère et rédemption
 William Kennedy, L’herbe de fer, traduction de l’américain et postface de Marie-Claire Pasquier, Belfond, 2018
William Kennedy, L’herbe de fer, traduction de l’américain et postface de Marie-Claire Pasquier, Belfond, 2018
William Kennedy, né en 1928, journaliste et écrivain, est ce que l’on pourrait appeler un romancier « réaliste ». Entendons bien : la démarche « réaliste » en question ne se confond pas avec le récit journalistique, avec le pur reportage ou la simple enquête, même si elle s’attache à la vie quotidienne ; en l’occurrence celle d’un paria, ancien champion de base-ball, père de famille devenu alcoolique et vagabond urbain pendant la Grande Dépression, et celle de ses semblables et compagnons de rue. Le quotidien de ce Francis Phelan, fait d’errances, de rencontres, de la recherche de quelques dollars pour pouvoir manger, boire, trouver un coin où dormir ou tirer d’un mauvais pas sa compagne Helen, est aussi celui de ses souvenirs et de ses fantômes. Les rencontres, ce sont aussi celles des êtres qu’il fait sortir de leur tombe et avec qui il dialogue comme avec des vivants ; parmi eux, le briseur de grève qu’il tua autrefois d’un coup de pierre, ses compagnons de galère disparus avant lui, et surtout son bébé, Gerald, mort par sa faute : « Si je t’ai lâché, ce n’est pas parce que j’étais soûl. Quatre bières, et la quatrième, je ne l’ai même pas finie. […] Ta mère a dit deux mots : « Doux Jésus », et alors nous nous sommes accroupis tous les deux pour te relever. Mais on est tous les deux restés accroupis quand on a vu ton allure. ».
La mort est à l’origine de la fuite et de la clochardisation, mais le désir de vivre et d’aider les autres à vivre fait le reste. Car si la violence physique et sociale est profondément ancrée dans l’existence de Francis, la générosité, la volonté de se racheter, de retrouver les siens (sa femme Annie, ses autres enfants) sont au cœur du roman. « Francis, il l’avait maintenant compris, avait toujours été en guerre avec lui-même, il entretenait en lui des factions dressées les unes contre les autres. Et s’il devait survivre en fin de compte, ce ne serait pas grâce à tel ou tel dieu de la révolution, mais à force de garder la tête claire et un sens exigeant de la vérité. Cette culpabilité qu’il traînait ne méritait pas qu’on se laisse mourir à cause d’elle. Tout ce qu’elle reflétait, c’était les appétits sanguinaires de la nature. Il fallait vivre, au contraire, tenir le coup, tenir bon contre les débordements de la foule, et leur montrer à tous de quoi un homme est capable pour transformer le mal en bien une fois qu’il s’est fixé ce but. ».
Tout se passe à Albany, capitale de l’État de New York, une ville que William Kennedy connaît bien, puisqu’il y a grandi. Une ville dont les quartiers, les avenues, les rues, les arrière-cours, les coins et recoins sont les lieux vivants du récit, une ville qui est un peu ce que Dublin est à James Joyce ou Paris à Raymond Queneau et quelques autres. Les itinéraires tracés par les errances de Francis et de ses comparses forment un trajet poétique, soutenu par un style qui réserve de belles surprises littéraires, qui suggère des images d’une grande intensité, et qui donne, sous l’aspect monologique de la prose, une vision plurielle de l’être humain : au-delà de la misère, dépasser le désespoir pour trouver une forme de rédemption.
Jean-Pierre Longre
23:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), william kennedy, marie-claire pasquier, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/11/2018
Humour trash et satire noire
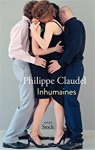 Philippe Claudel, Inhumaines, éditions Stock, 2017, Le livre de poche, 2018.
Philippe Claudel, Inhumaines, éditions Stock, 2017, Le livre de poche, 2018.
La quatrième de couverture annonce : « Nous sommes devenus des monstres. On pourrait s’en affliger. Mieux vaut en rire. ». Oui, on rit, mais plutôt jaune, voire jaune foncé. Dans ce « roman » composé de brefs récits rivalisant d’humour trash et de satire noire, Philippe Claudel s’en donne à cœur joie, jusqu’au défoulement sans bornes, sans ces bornes que nos sociétés apparemment policées se fixent hypocritement.
Des vacanciers insouciants genre Club Med s’amusent chaque soir, depuis leurs jolis bateaux, à voir se noyer des migrants africains. Un mari offre pour Noël à sa femme trois hommes-objets qui finiront au rebut. Un autre (ou le même ? C’est toujours un « je » masculin qui raconte) n’hésite pas à la vendre, sa femme, sur Internet. Lors d’une fête de Noël qui tourne à l’orgie, on assiste au massacre du père Noël ; les enfants sont de la partie, tout contents. La femme d’un suicidaire invite ses collègues de bureau à assister à la pendaison de son mari au cours d’un cocktail qui tourne au Grand Guignol. Par souci d’écologie, chacun doit manger ses morts familiaux (parents, grands-parents, enfants, au hasard des décès). Pour réduire la « fracture sociale », on parque les pauvres dans des camps de travail qui rappellent de terribles souvenirs et que les riches peuvent visiter comme on visite un zoo… On en passe…
 Le lecteur pourrait être écoeuré, s’il ne s’apercevait que ce que décrit l’auteur n’est que la réalité, poussée à l’extrême, de notre vie sociale, professionnelle, familiale, de ses aberrations et de ses absurdités. Le tout sur un rythme effréné, sans pauses, sans concessions. Une caricature ? Une horrible vérité ? Et « pourtant des gestes simples nous contentent : faire la vaisselle. Tondre une pelouse. Peindre une porte. Feindre de respirer. ». C’est ainsi que « la vie devient supportable ». Tentons donc de vivre malgré tout, et rions.
Le lecteur pourrait être écoeuré, s’il ne s’apercevait que ce que décrit l’auteur n’est que la réalité, poussée à l’extrême, de notre vie sociale, professionnelle, familiale, de ses aberrations et de ses absurdités. Le tout sur un rythme effréné, sans pauses, sans concessions. Une caricature ? Une horrible vérité ? Et « pourtant des gestes simples nous contentent : faire la vaisselle. Tondre une pelouse. Peindre une porte. Feindre de respirer. ». C’est ainsi que « la vie devient supportable ». Tentons donc de vivre malgré tout, et rions.
Jean-Pierre Longre
19:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe claudel, éditions stock, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2018
Méconnu et différent
 Erri De Luca, Une tête de nuage, traduit de l’italien par Danièle Valin, Gallimard, 2018
Erri De Luca, Une tête de nuage, traduit de l’italien par Danièle Valin, Gallimard, 2018
Iosèf, descendant de David, « épouse Miriàm enceinte mais pas de lui », et ainsi brave l’inexplicable et « fait front à la loi et à la médisance », anticipant ce que son fils Ièshu dira un jour pour défendre la femme adultère : « Que celui qui est sans erreur jette la première pierre ». La préface de ce court récit en trois étapes (« Une pièce de la cabane », « Une pièce de Jérusalem », « Sur le sommet du Golgotha ») annonce le sujet et donne le ton.
Le sujet : une énième « vie de Jésus » ? Non. Un choix original, tout en finesse et en clairvoyance, d’épisodes autour de la naissance, de la vie privée et publique, de la passion et de la réapparition d’un homme que les Juifs attendaient, en qui ils voyaient le Messie qui allait les libérer du joug de l’occupant, mais dont l’attitude sacrificielle les a déroutés. « Il démissionnait de leur attente. ». « Une tête de nuage est le destin de celui qui est pris pour quelqu’un d’autre. ». Le ton : celui du dialogue intime, tranquille, aimant, souriant entre Iosèf et Miriàm, et avec quelques autres personnages. Voyez par exemple la scène de la visite de « trois seigneurs » qui apportent des cadeaux au nouveau-né. Ou alors, dans un autre registre, lors de la légendaire « Fuite en Égypte » (plutôt, selon le terme grec, le retrait, le « pèlerinage du salut »), le dialogue entre Iosèf et le douanier, barrant le passage à la petite famille de réfugiés, les laissant finalement entrer en apprenant que l’homme est un artisan qualifié. Et le narrateur (l’auteur) d’expliquer ironiquement : « C’était une époque où un pays encourageait les flux migratoires de force de travail, qui augmentaient la production et la prospérité. Il n’existait alors aucun préjugé racial ni aucune discrimination sur la couleur de la peau. Les visages suspects pâles et blonds étaient accueillis eux aussi. ».
Gardons-nous de réduire Une tête de nuage à une actualisation simpliste des évangiles, ou à l’image d’un Christ naïvement contestataire. Erri De Luca, qui s’avoue non croyant, est un lecteur assidu de la Bible ; il en livre ici une vision incisive (retraduisant des mots clés au plus près de leur signification d’origine), poétique (d’une poésie précieuse et précise, annoncée par le titre), une vision qui va au-delà de l’exégèse pour mettre l’accent sur des aspects méconnus et dresser un portrait ineffaçable du fils de Miriàm et Iosèf. « Il était une personne hors du temps, comme c’est le cas des prophètes, des inventeurs, des explorateurs. Il était un résumé de ceux-là et de ce que produit le mieux l’espèce de l’Adàm. Il forçait la frontière du possible et du présent. ».
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, dialogue, essai, erri de luca, danièle valin, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/11/2018
Une trilogie épique d’aujourd’hui (et de demain)
 Virginie Despentes, Vernon Subutex, Grasset, 2015 à 2017, Le livre de poche, 2016 à 2018
Virginie Despentes, Vernon Subutex, Grasset, 2015 à 2017, Le livre de poche, 2016 à 2018
Trois tomes, soit plus de 1200 pages, cela ne se résume pas en quelques lignes. Autant s’en tenir au titre, qui donne d’emblée le fil conducteur : Vernon Subutex (dont le prénom rappelle Boris Vian, et le nom, sans détour, un substitut de la drogue), ancien rocker, ancien disquaire, ancien ami du grand Alexandre Bleach, chanteur à succès mort d’overdose, passe par différentes phases existentielles, psychologiques, morales, sociales. Expulsé de chez lui, accueilli (avec plus ou moins d’empressement) par de « vieilles connaissances », puis clochardisé, il va faire l’objet de recherches assidues de la part de gens en quête d’enregistrements secrets d’Alex Bleach, ainsi que de la part de ses anciens amis, qui vont former autour de lui un groupe solidaire. Cela va donner lieu à l’organisation de « convergences », rassemblements dont Vernon, mixeur génial, est la cheville musicale essentielle, entraînant des danses qui n’ont pas besoin du recours à la drogue pour être sans frein.
La trame, rigoureusement construite et menée sans répit, est primordiale ; mais elle est l’axe autour duquel tourne le plus important, le plus foisonnant, le plus passionnant : une description sans concessions mais toute en finesse, aussi brutale que précise, d’une société multiple qui repousse vers les extrêmes les limites de la cohabitation, une succession de portraits en action de personnages qui ont beaucoup vécu, qui ne sont plus tout jeunes mais qui cherchent plus ou moins consciemment une forme de bonheur collectif ; aussi divers qu’attachants, obsédants parfois, ils naviguent tant bien que mal entre les tempêtes de la société actuelle – drogue, alcool, sexe, argent, violence –, mais font preuve aussi de générosité, de désintéressement, d’amour. Du trader sans scrupules au SDF sans avenir, de la mère de famille attentive au transsexuel enfin bien dans sa peau, de l’ancienne prostituée au producteur véreux, de l’alcoolique invétéré à l’universitaire engagé (on en passe beaucoup d’autres), tous sont, en quelque sorte, les protagonistes successifs du roman. Virginie Despentes maîtrise au plus haut point l’art du portrait (et les rappels succincts et clairs placés en tête des tomes 2 et 3 sont bien utiles), mais un art bien à elle. Elle entre (et fait entrer le lecteur) dans toutes les peaux, dans tous les cerveaux, dans tous les cœurs, se démultiplie en personnages de tous bords, de toutes classes, de tous tempéraments, adaptant sans fards son style, son lexique, son niveau de langue à chacun d’entre eux. Bref, elle est la reine du discours indirect libre : c’est l’auteur qui écrit, mais c’est le personnage qui pense.
C’est ainsi que Vernon Subutex semble avoir les caractéristiques du roman réaliste ; d’ailleurs l’intrigue (surtout celle du tome 3) se déroule sur fond d’actualité (attentats de 2015, Nuit Debout, luttes sociales, guerres du Moyen Orient) ; mais c’est un roman qui, à la manière des épopées, poétise le réel sans l’idéaliser, le montrant dans ce qu’il a de désespérant et de prometteur, de violent et de bienveillant, de dur et de tendre, de repoussant et d’attirant, de tragique et de comique. Toutes les dimensions du réel et de ses avatars, donc, où périodiquement l’humour affleure, éclate parfois, dans la narration objective et dans la tête des personnages ; un humour qui relève de la satire, de la dérision, de l’ironie. Tenant de toutes ces tonalités et les dépassant toutes, le dénouement apocalyptique vire à l’épopée d’anticipation, au centre de laquelle Vernon et les « convergences » sont un point d’ancrage historique. Vernon Subutex est une fresque de grande ampleur, que l’on n’est pas près d’oublier.
Jean-Pierre Longre
12:18 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, virginie despentes, grasset, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/10/2018
Naissance d’une émancipation
 Lamia Berrada-Berca, Kant et la petite robe rouge, La Cheminante, 2016
Lamia Berrada-Berca, Kant et la petite robe rouge, La Cheminante, 2016
Deux découvertes importantes marquent la progression de ce court récit et la vie de celle que nous ne connaissons que sous le nom de « la jeune femme » – un anonymat qui va de pair avec son invisibilité publique, puisqu’elle ne peut sortir que cachée sous son long vêtement noir. Deux découvertes, donc : celle d’une « petite robe rouge » vue dans la vitrine d’une boutique, et qui la séduit tout de suite ; et celle d’un livre de Kant abandonné sur le paillasson du voisin. Le lien entre les deux ? La prise de conscience d’une émancipation possible.
La jeune femme, qui s’est mariée sans amour « au pays », et à qui son mari avait promis une existence heureuse ailleurs, se retrouve à Paris dans la solitude la plus complète, analphabète, sans horizon (ni physique ni moral), vouée aux tâches ménagères, soumise au bon vouloir et au désir intermittent d’un homme qui lui reproche de ne lui avoir donné qu’une fille, alors qu’un garçon serait source d’honneur et de satisfaction… Pour elle, une seule consolation, justement : la présence de sa petite fille qui sera témoin et complice de sa libération progressive, et dont la maîtresse, rencontrée à l’insu du mari, va encourager ses perspectives. Alors, par étapes secrètes, elle surmonte sa crainte, achète la fameuse robe, et se fait lire par sa fille des bribes de Qu’est-ce que les Lumières ?. « Kant est un nom magique. Ne pas comprendre et cependant y croire, voilà ce qui donne à toute chose un caractère magique. ». Et elle apprend « qu’aucun précepte dans le Livre sacré ne dit que vous serez réduite en cendre au Jugement dernier si vous ne portez pas ce vêtement. Aucun précepte religieux ne repose sur un bout de tissu. Aucun précepte du livre n’indique que vous serez maudite. ». Et qu’elle pourra mettre la robe rouge pour emmener sa fille à l’école.
Le livre de Lamia Berrada-Berca n’est ni un pamphlet ni un traité de morale ou de philosophie, mais tout simplement un roman qui, tout en finesse poétique et en discrétion stylistique, laisse entrevoir l’intimité d’une « jeune femme » traçant son chemin vers l’émancipation. Et au-delà du genre romanesque, ou le confortant dans la révélation de la vérité sur la vie humaine, deux appendices de bon aloi donnent des « extraits d’œuvres littéraires évoquant l’émancipation, l’égalité, la liberté des femmes », et des « extraits d’œuvres littéraires évoquant le combat contre les superstitions, le fanatisme religieux et pour la tolérance », avec – excusez du peu – des textes de Molière, Voltaire, Choderlos de Laclos, Kant (bien sûr), Olympe de Gouges, George Sand, Maupassant, Montesquieu. Ainsi les rapports de la jeune femme avec la vraie vie sont-ils étayés par des rencontres avec les écrivains et leurs engagements.
Jean-Pierre Longre
20:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, essai, francophone, lamia berrada-berca, la cheminante, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

