12/12/2012
Secrets de naissance
Hélène Grémillon, Le confident, Plon – JC Lattès, 2010, Folio, 2012
 Après le décès de sa mère, Camille reçoit les traditionnelles lettres de condoléances, pleines de compliments pour la défunte et de compassion pour ceux qui restent. Au milieu, une enveloppe intrigante, contenant une longue missive sans signature, qui inaugure toute une série d’envois de plus en plus étranges, dans lesquels un certain Louis évoque une certaine Annie – prénoms l’un et l’autre étrangers à Camille, qui se laisse prendre de plus en plus passionnément au suspense entretenu par cette mystérieuse correspondance.
Après le décès de sa mère, Camille reçoit les traditionnelles lettres de condoléances, pleines de compliments pour la défunte et de compassion pour ceux qui restent. Au milieu, une enveloppe intrigante, contenant une longue missive sans signature, qui inaugure toute une série d’envois de plus en plus étranges, dans lesquels un certain Louis évoque une certaine Annie – prénoms l’un et l’autre étrangers à Camille, qui se laisse prendre de plus en plus passionnément au suspense entretenu par cette mystérieuse correspondance.
Toutes sortes de soupçons lui viennent à l’esprit, y compris celui du stratagème d’un auteur cherchant à tout prix à se faire publier – puisque Camille est éditrice. Les soupçons, et aussi la peur. Camille est enceinte, et « n’importe quelle femme enceinte aurait été troublée à la lecture de ces lettres ». Au fur et à mesure, l’enfantement et la mort se mêlent étroitement dans le récit morcelé qui s’impose à la destinataire. « Une naissance appelle une mort ».
 Le lecteur, dans un mouvement parallèle, se laisse saisir par les révélations successives dont il ne doute pas, au bout d’un moment, qu’elles impliquent la naissance et l’existence mêmes de Camille, à travers les mystères de ses origines. Les récits épistolaires s’emboîtent les uns dans les autres, selon une structure narrative diversifiant les points de vue et reconstruisant habilement le passé ; un passé familial qui, s’inscrivant sur celui de la guerre de 39-45, prend une dimension à la fois personnelle et historique ; un passé d’autant plus angoissant que les sentiments et les événements intimes fondent leur drame dans le drame collectif.
Le lecteur, dans un mouvement parallèle, se laisse saisir par les révélations successives dont il ne doute pas, au bout d’un moment, qu’elles impliquent la naissance et l’existence mêmes de Camille, à travers les mystères de ses origines. Les récits épistolaires s’emboîtent les uns dans les autres, selon une structure narrative diversifiant les points de vue et reconstruisant habilement le passé ; un passé familial qui, s’inscrivant sur celui de la guerre de 39-45, prend une dimension à la fois personnelle et historique ; un passé d’autant plus angoissant que les sentiments et les événements intimes fondent leur drame dans le drame collectif.
Voilà un roman captivant, au sens premier du terme : captif de l’intrigue, le lecteur, comme l’héroïne, doit aller jusqu’au bout, jusqu’aux tout derniers mots, s’il veut s’en libérer.
Jean-Pierre Longre
18:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hélène grémillon, plon – jc lattès, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Les masques de la vie
 Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
« M. Ali, j’ai parfois l’impression que ce que nous sommes, ce que nous paraissons être, ce que nous prétendons être et ce que nous sommes aux yeux des autres sont quatre choses bien distinctes. Telle est la nature de l’existence, l’une de ses nombreuses imperfections, pourriez-vous ajouter » : le capitaine William Meadows, revenu d’Inde en 1837 avec Amir Ali, semble avoir compris ce qui fait la diversité de l’existence et de ses énigmes, des récits que l’on en fait, aux autres et à soi ; ils sont au cœur du roman de Tabish Khair.
Le protagoniste, donc, s’est installé dans le Londres victorien, sous la protection du capitaine Meadows, qui lui demande de raconter sa vie d’adepte du « thugisme », secte réunissant jadis des musulmans et des hindous pratiquant rituellement le vol et le meurtre. En parallèle, Amir confie à Jenny, la jeune servante qu’il aime, dans des lettres dont il sait qu’elle ne pourra les lire, les vraies vicissitudes de sa vie en Inde et ses doutes actuels, dans la grisaille anglaise.
Une autre intrigue met en scène le fameux phrénologue lord Batterstone, dont la volonté est de montrer à tout prix le bien-fondé de ses théories raciales, et son employé John May qui, à force de chercher pour son patron des crânes difformes dans les tombes, sombrera dans l’acharnement du meurtre, entraînant ses complices avec lui. Le récit tourne au roman noir, avec double enquête, officielle et journalistique d’une part, nourrissant le fantasme du « cannibale décapiteur », officieuse et populaire d’autre part, assurée par quelques représentants efficaces et solidaires de la populace des bas-quartiers.
Tabish Khair, dont l’art des récits alternés se manifestait déjà dans Apaiser la poussière, sait que la vie humaine n’est pas une, et que l’existence n’est pas vouée à la certitude ; surtout, il sait l’écrire, par le truchement d’histoires qui se situent aux confins du réel, aux limites de la possibilité, aux frontières du doute. Et il sait le confier à la plume fictive de ses personnages : « Qu’il est étrange de devenir ce qu’on n’est pas. Quelques histoires, quelques mots suffisent-ils ? Notre emprise sur la réalité est-elle si faible, si précaire ? Les histoires – racontées par nous ou par d’autres – peuvent-elles nous transformer ainsi ? Et pour quelle raison avons-nous besoin de nous en revêtir – quelle que soit notre manière d’avoir prise sur la réalité, et quelle que soit cette réalité ? Est-ce donc ce à quoi nous nous résumons ? Des histoires, des mots, un souffle ? ».
Jean-Pierre Longre
http://blongre.hautetfort.com/archive/2012/04/29/a-propos-d-un-thug.html
15:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, anglophone, inde, tabish khair, blandine longre, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/10/2012
« L’excès de l’absence »
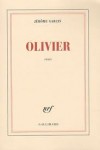 Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Olivier allait avoir six ans lorsqu’il fut tué par un chauffard. Sa mort priva Jérôme, son frère jumeau, d’un autre soi-même, de son double, d’une présence nécessaire. « À chaque anniversaire, le même trouble me saisit : j’ai l’impression que je ne suis pas seul ». Et ce livre, pour la première fois, fait confidence de cet « excès de l’absence » (pour reprendre une formule de L’instant fatal de Queneau), de cette présence en creux qui a modelé ses attitudes face à la vie.
La solitude a donné à l’enfant, à l’adolescent, à l’adulte le goût de l’isolement, du grand air, des randonnées équestres dans la campagne ; les secrets enfouis de la gémellité perdue lui ont donné le goût du silence, de la pudeur muette et nouée. De là, la nécessité d’écrire : « Parmi tout ce que tu m’as appris, il y a d’abord ceci : on écrit pour exprimer ce dont on ne peut pas parler, pour libérer tout ce qui, en nous, était empêché, claquemuré, prisonnier d’une invisible geôle ». L’environnement familial et les choix délibérés aidant, la moitié vide de son existence a vite aspiré Jérôme vers les livres, toutes sortes de livres, parmi lesquels émergent ceux qui relatent l’« expérience du deuil ». Vers les livres à lire, vers les livres à commenter, vers les livres à écrire.
 Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Jean-Pierre Longre
22:37 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, jérôme garcin, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/10/2012
Après la chute
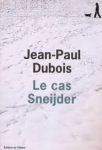 Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Avec les héros de Jean-Paul Dubois, on ne risque pas de s’ennuyer – même si eux-mêmes plongent parfois dans le désespoir et la dépression. Paul Sneijder est, comme les précédents et comme l’annonce le titre, un « cas ». Mais pas tout de suite. Sa vie aurait pu rester dans des normes sociales conventionnelles : une femme du genre « executive woman », des jumeaux qui suivent les traces de leur mère, une fille d’un premier mariage, rejetée par la nouvelle famille, un exil au Québec pour la carrière de l’épouse, un intérêt particulier pour les morts collectives d’animaux (oiseaux, poissons)… Bref, une existence qui, sans être complètement ordinaire, n’est pas encore matière à roman.
 Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Paul Sneijder bascule, pour ainsi dire, vers la face cachée de l’humanité. Son obsession : étudier les divers mécanismes qui commandent les mouvements des ascenseurs, au point d’en devenir un spécialiste. Son occupation : promener les chiens des autres, au point de se prendre d’affection pour eux. Son culte : celui des cendres de Marie, dont il conserve précieusement l’urne sur son bureau. Son amusement : relever, par exemple, les nombres palindromiques trouvés par son patron. Ses souvenirs : précis, sans défauts (« Je me souviens de tout ce que j’ai fait, dit ou entendu » : telle est la première phrase du livre). Ces changements qui, aux yeux de sa femme et de ses  jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
Jean-Paul Dubois a l’art de dénicher des situations inattendues, de les cultiver, de les exploiter dans sa tonalité particulière, où tragédie et comédie se mêlent et se complètent à merveille.
Jean-Pierre Longre
13:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, Éditions de l’olivier, éditions a vue d'oeil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/08/2012
« Les mots de la faim »
 Herta Müller, La bascule du souffle, traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, Gallimard 2010, Folio 2011
Herta Müller, La bascule du souffle, traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, Gallimard 2010, Folio 2011
En 1945, le jeune Léopold, comme tous les Allemands de Roumanie âgés de 17 à 45 ans, est déporté en Union Soviétique. Il restera cinq ans dans un camp, à y subir le travail forcé, les brimades, la faim, à y côtoyer la mort et la souffrance, à y chercher dans le moindre objet, dans le moindre croûton de pain, dans le moindre brin d’herbe une parcelle du bonheur dont ne peuvent se passer les humains.
Herta Müller l’explique en postface : l’histoire de Léopold est largement inspirée de celle d’Oskar Pastior, poète de langue allemande et d’origine roumaine, mort en 2006 après avoir vécu dans sa jeunesse la douloureuse expérience des camps soviétiques, exercé différents métiers, s’être enfin voué, une fois exilé en Autriche puis en Allemagne, à l’écriture littéraire.
Malgré les détails vécus, le livre n’est pas un document de plus sur le goulag. Les choses, les paysages, les gestes quotidiens, intimement incorporés au conscient et à l’inconscient, vivent leur vie, s’imposent au plus profond de l’âme, des rêves, des sensations du narrateur. « L’ange de la faim », leitmotiv qui mine le récit autant que les corps des prisonniers, est l’un de ces fantômes qui hantent leur existence et leurs relations. Les objets usuels (la pelle, le peigne à poux, le charbon, les parpaings, la cuiller…), tout en donnant rythme aux jours et aux nuits, ainsi qu’aux brefs chapitres qui sont comme des tranches de vie, sont les points d’ancrage qui permettent aux êtres de ne pas sombrer.
Et les mots sont les instruments qui non seulement transfigurent le malheur et son souvenir, mais aussi qui pèsent sur le narrateur et son propre récit. Objets poétiques, parfois inutiles et absurdes, ils sont comme le ciment qui, au camp, s’insinuait partout lorsqu’on ne le maîtrisait pas : « Il y a des mots qui font de moi ce qu’ils veulent. Ils sont très différents de moi, et leurs pensées sont différentes d’eux. S’ils me viennent à l’esprit, c’est pour me rappeler qu’il y a de premières choses qui en appellent des deuxièmes, même si je suis loin de le vouloir ».
Jean-Pierre Longre
Herta Müller est Prix Nobel de littérature 2009
12:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, allemagne, roumanie, herta müller, claire de oliveira, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/07/2012
Toute la vérité ?
 François-Guillaume Lorrain, L’homme de Lyon, Grasset, 2011. Le Livre de Poche, 2012.
François-Guillaume Lorrain, L’homme de Lyon, Grasset, 2011. Le Livre de Poche, 2012.
Une « étrenne post-mortem », et la vie d’un homme peut s’en trouver bouleversée. Le père de l’homme en question, Pierre Rolin (un patronyme bien proche de celui de l’auteur…), mort en 2001, a laissé à sa mère un paquet à lui remettre le 1er janvier 2009, ce dont elle s’acquitte scrupuleusement. Pourquoi ce stratagème? Parce que, sans doute, le paquet contient à l’intention du fils une lettre et des photos mystérieuses, message dont l’élucidation ne devra se faire que par étapes successives.
C’est le point de départ, pour le narrateur, d’une quête complexe à travers les années et les lieux : entre France et Allemagne, un retour sur la période de l’occupation et sur des secrets familiaux qui vont peu à peu se laisser percer. Il y a Berlin, il y a surtout  Lyon, ses rues, ses zones d’ombre et de clarté, la place Bellecour et ses environs, la Résistance et la milice, les soldats allemands et les bombardements alliés… Il y a ce que montrent, tout en le cachant, les photos contenues dans l’enveloppe. « Il est facile de ne dire que la vérité. Il est difficile de dire toute la vérité » : le père aimait à répéter certaines phrases, dont celle de Léon Blum, que l’on peut mettre au compte de tout le roman.
Lyon, ses rues, ses zones d’ombre et de clarté, la place Bellecour et ses environs, la Résistance et la milice, les soldats allemands et les bombardements alliés… Il y a ce que montrent, tout en le cachant, les photos contenues dans l’enveloppe. « Il est facile de ne dire que la vérité. Il est difficile de dire toute la vérité » : le père aimait à répéter certaines phrases, dont celle de Léon Blum, que l’on peut mettre au compte de tout le roman.
L’homme de Lyon est une lente remontée du temps à caractère vraisemblablement autobiographique, tâtonnante et angoissante, qui mêle avec art et subtilité les enjeux personnels, familiaux, politiques et historiques, et qui rappelle à juste titre que la vie charrie des vérités qu’il n’est pas si facile de révéler.
Jean-Pierre Longre
19:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, françois-guillaume lorrain, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2012
Un samedi à Belfort
 Alain Gerber, Le Central, Fayard, 2012
Alain Gerber, Le Central, Fayard, 2012
Le Central est un café fréquenté par toutes sortes de clients, qui sont ici pour toutes sortes de raisons (ou pour aucune), composant une galerie de portraits représentative non seulement des Belfortains du début des années 1960, mais encore de la société française, voire humaine, tout bonnement.
Du petit matin au soir tardif, sous la baguette omnisciente d’un narrateur chef d’orchestre qui laisse habilement se développer chaque thème, chaque timbre, chaque harmonique, se croisent, s’entrecroisent, se frôlent, se regardent de temps en temps, se parlent parfois, entre autres : le chauffagiste Albert Spiedler, qui file doux devant sa femme ; Renaud Vinchelmes, le prof d’histoire qui a viré extrême droite aigrie ; Suzette Nandeau, la téléphoniste à l’optimisme indéboulonnable ; le dentiste Waldberg, au passé mystérieux et au présent sulfureux ; les « Américains », cette « tapageuse élite de la jeunesse belfortaine », groupe de garçons dont le comportement tient autant du chahut de la bande de jeunes que de la pose avant-gardiste, et dont le destin immédiat est suspendu aux menaces de la guerre d’Algérie ; Lorraine Mistler, la journaliste vouée à la relation d’anodins événements locaux ; Viviane et Delphine, dont malgré les apparences l’amitié n’est pas parfaitement à double sens ; des inconnus, un malfrat de passage, des promeneurs du samedi, d’autres encore ; le personnel du bistrot, tout aussi divers, qui va et vient sous la houlette imperturbable du consciencieux Serge Castillon, le gérant, et le couple Laigle, les propriétaires, qui arriveront au mauvais moment…
Car cette journée qui paraît coulée dans le moule de toutes les autres sort pourtant de l’ordinaire. D’abord, c’est elle qui a été choisie pour devenir roman (et quasiment pièce de théâtre, avec, excusez du peu, unités de lieu et de temps) ; ensuite, parce qu’elle n’est pas exempte de péripéties qui lui donnent des allures de tragi-comédie. Aucune monotonie dans la succession des arrivées, départs, ruptures, retours, événements plus ou moins mémorables qui rythment les heures de ce long samedi de juin.
Alain Gerber (né à Belfort, rappelons-le) effectue là comme un retour aux sources, en un mouvement par lequel il semble renouer avec un passé que les romans des années 1970 (de La couleur orange à Une sorte de bleu) évoquaient, chacun à sa manière. Certains personnages doivent vraisemblablement beaucoup à l’auteur lui-même – tel Francis Querlier, l’un des jeunes « américains », admirateur secret de Delphine, qui suit différentes pistes studieuses et s’essaie à différents modes de vie culturelle ; le théâtre, le cinéma, la lecture, l’écriture nourrissent chez lui des ambitions qu’il ne voudrait pas illusoires : « S’il consent à se retirer de la lumière des projecteurs, ce sera pour ciseler son premier chef-d’œuvre afin d’y reparaître, plus scintillant que jamais ». Un passé donc relativement lointain, mais aussi proche, puisque la musique, qui a été ces dernières années la grande préoccupation artistique de l’auteur et de son écriture, l’est encore ici : même si le juke-box du Central joue parfois des « scies universelles », le jazz, le vrai, conserve une place de choix dans les pages du roman et sur la scène littéraire d’Alain Gerber.
Jean-Pierre Longre
17:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/06/2012
Truculentes chroniques
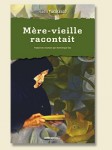 Radu Țuculescu, Mère-vieille racontait, traduit du roumain par Dominique Ilea, Ginkgo éditeur, 2012
Radu Țuculescu, Mère-vieille racontait, traduit du roumain par Dominique Ilea, Ginkgo éditeur, 2012
C’est un hameau perdu de Transylvanie, déserté au fil du temps par la jeunesse, où les anciens, livrés à leurs souvenirs, cohabitent tant bien que mal entre eux et avec les Tziganes qui investissent peu à peu les maisons vides. Le narrateur, Radu, venu de la ville de Cluj rendre visite à Mère-vieille avec « la Dita », sa compagne, se fait le dépositaire et le rapporteur des histoires racontées par l’ancêtre, dont la mémoire est nourrie de tout le passé du village, mais aussi de ses lectures et de son imagination : « Des histoires qui s’ouvrent en éventail, tels les rais du soleil. Dont le centre, le magma d’où elles jaillissent, fut ce hameau au fond d’une vallée, coupé du monde, où j’ai atterri par hasard. Sans Mère-vieille, je n’en aurais rien appris. Je n’aurais pas écrit une seule ligne. Pas le moindre rayon n’aurait jailli… ».
On assiste avec une gourmandise non dénuée d’appréhension aux scènes racontées par bribes où se côtoient des couples rongés par l’existence, le mensonge et le silence, des hommes qui soignent leur nostalgie, leurs fureurs et leurs faiblesses à grandes lampées de ţuica, des femmes dont l’âge n’a pas amoindri la verve railleuse et l’ardeur érotique (parmi lesquelles la Margolili, notamment, qui a fait des ravages chez les mâles, aura bizarrement disparu à l’issue d’une noce héroïque), un pope toujours très, très proche de ses paroissiennes, des êtres fantastiques tel un étrange matou diabolique… On suit les protagonistes dans un voyage épique, une véritable odyssée campagnarde, vers le dispensaire voisin où la grand-mère est censée trouver à se soigner… On vit et on vibre littéralement au son de la musique qui pendant trois nuits entraîna Démitri, époux de Mère-vieille et fameux danseur, au cœur d’un sabbat enragé…
Ces rustiques et truculentes anecdotes, drôles et tragiques, traduites au plus près de la langue et des tournures d’origine, se déroulent sur un rythme enfiévré, en une prose parfois rugueuse, souvent poétique, de cette poésie qui laisse tout juste entrevoir les mystères de la vie, de la mort, du rêve, de l’écriture. « Dès que je me retrouve dans le village de Mère-vieille, sans faute, je glisse derechef sur la piste invisible qui slalome entre la réalité et la fantaisie. […] Dans cette communauté que je flaire ésotérique, les apparences sont souvent trompeuses, ce qui m’arrange ». On s’y laisse prendre, délicieusement.
Jean-Pierre Longre
12:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, radu Țuculescu, dominique ilea, ginkgo éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2012
Les faits et les objets
 Marius Daniel Popescu, Les couleurs de l’hirondelle, José Corti, 2012
Marius Daniel Popescu, Les couleurs de l’hirondelle, José Corti, 2012
Prix de l'Inaperçu 2012
La symphonie du loup, le précédent roman de Marius Daniel Popescu (José Corti, 2007), débutait par la mort du père ; Les couleurs de l’hirondelle commence et finit (presque) par l’enterrement de la mère. Entretemps, le puzzle narratif se met en place, mêlant le passé (l’enfance et la jeunesse au « pays du parti unique », la Roumanie jamais nommée) et le présent (la vie quotidienne dans le pays d’adoption, la Suisse tout aussi anonyme, les jeux avec l’enfant, le travail, le retour dans la famille pour les funérailles, et aussi le livre en train de s’écrire…). Aucune transition entre les épisodes ; placés les uns à côté des autres comme les affiches que colle le narrateur ou comme les cases du jeu de bataille navale qu’évoquent les dernières lignes, chacun d’entre eux est une histoire, un poème, un exercice de style à soi seul.
Exercice et art poétique en même temps. Par exemple : « Tu te dis que tu viens d’écrire un texte avec une fille et une femme, avec de la poésie et de la prose dans ses mots, avant les mots que tu viens d’écrire, avant les mots que tu vas écrire, il y a une sorte d’embryon du texte à venir, du texte publiable-publié et tu places cet embryon avant que les mots commencent à s’inscrire quelque part : toute écriture nécessite des perceptions, des plans ou des spontanéités mentales qui forment dans ton cas le début de chaque texte : une fois que tu commences à transformer en mots l’embryon du texte, tu te soumets à des règles qui bouleversent cet embryon, qui lui proposent de grandir, de devenir texte publiable en suivant des chemins qu’on appelle mots et qui, bizarrement, s’articulent entre eux sans former de carrefours, de places, de trottoirs ». Les mots, mis à rude épreuve, sont là pour exprimer les perceptions, non pour s’imposer, et c’est bien de cela qu’il s’agit : prendre conscience de ce qu’est la vie, dans son unité et sa diversité, dans ses manifestations mentales, affectives, physiques. Elle est faite de ces petites et grandes réalités que l’homme perçoit dans sa conscience et dans son inconscient, dans la mémoire de son esprit et de son corps, et qui voyagent comme un oiseau à qui l’on donne les couleurs du temps. Cela va de l’oppression politique odieuse et bête à la « révolution » vite confisquée par le règne de l’argent, de la misère et de la corruption ; des rideaux de lettres, qui en s’entrouvrant laissent apercevoir quelques mots, aux ensembles d’objets peuplant une existence humaine ; des jeux de l’enfance campagnarde à la confection d’un journal poétique, Le persil…
Les faits et les objets. C’est en eux, par eux, avec eux, apparemment livrés à l’état brut, en réalité répartis avec minutie comme des notes sur une portée musicale, que se crée l’émotion, par l’intercession des mots innombrables peuplant les phrases d’un récit que la mémoire n’en finit pas de prolonger, comme après un beau concert.
Jean-Pierre Longre
13:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu, josé corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/05/2012
En quête des autres, en quête de soi
 Lionel-Édouard Martin, Anaïs ou les Gravières, Les éditions du Sonneur, 2012
Lionel-Édouard Martin, Anaïs ou les Gravières, Les éditions du Sonneur, 2012
Est-il pensable de trouver dans un roman d’aujourd’hui des mots comme « voussure », « fluer », « s’aboucher », « croquemitaine », « floches », des expressions comme « botteler les possibles », « j’hypallageais pas mal sur la bouteille » ou des phrases comme « Il fait sur la rivière un temps de libellule » ? Sachez que oui, au moins sous la plume de Lionel-Édouard Martin, maître en poésie suburbaine et semi-rurale.
Ce n’est pas le tout. Anaïs ou les Gravières est un roman aux multiples facettes. Si d’emblée il prend une tournure policière (le meurtre d’une jeune fille, l’enquête d’un journaliste), on s’aperçoit vite que ce n’est pas vraiment ce qui compte. La rencontre de témoins tourne à la galerie de portraits pittoresques, sensibles, emplis de cette humanité que l’on trouve au fond de tous les yeux, pour peu qu’on le veuille. Il y a Anaïs, la lycéenne morte que l’on finira par connaître grâce aux autres, sa mère, qui confie au narrateur son histoire à la fois commune et unique, Mao, Petit louis, Toto Beauze, le légionnaire… Le lecteur les découvre peu à peu – jamais complètement, car le silence et le non-dit forment une part importante de leurs personnalités –, et devine qui est Nathalie, celle dont le destin reste comme une plaie ouverte dans la trame de l’histoire, comme un reflet pathétique de celui d’Anaïs.
Car les récits enchâssés dans l’intrigue, les souvenirs personnels et collectifs, les évocations de paysages campagnards, minéraux, industriels ou urbains, les portraits, tout cela tient dans l’œil de l’observateur, qui lui-même, dans sa solitude, guette le regard des autres, se voit dans l’autre comme dans un miroir : « Mao. Je dis Mao. Je pourrais aussi bien dire « moi ». Moi, c’est presque dans Mao. Mao, c’est presque moi ». Anaïs elle-même, dès avant sa naissance, a cette puissance du regard silencieux qui perce et reflète son entourage. Sa mère le sent : « À Mao, j’ai dit que j’étais enceinte d’une boule de regards, que j’allais accoucher dans quelques mois d’un gros œil dont il n’était pas responsable ».
Et l’écriture elle-même réfléchit le récit (et vice-versa), puisque le narrateur (l’auteur, aussi bien) ne rechigne pas aux considérations sur son travail, son « droit d’invention » : « Juste inventer ; prendre mon deuil au corps, le travailler de mots ». On y revient toujours : dans ce roman en forme d’enquête, l’important c’est la vie, la mort, les « gens » que l’on interroge par les mots, les silences et le regard, toujours en quête de soi.
Jean-Pierre Longre
A noter ! Rencontre avec Lionel-Édouard Martin le 22 mai à 18h à la Librairie du Tramway, 92 rue Moncey, 69003 LYON
19:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/05/2012
Paris est un roman, la vie est un livre
 Matéi Visniec, Syndrome de panique dans la Ville lumière, roman traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2012
Matéi Visniec, Syndrome de panique dans la Ville lumière, roman traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2012
Comme celles de ses pièces de théâtre, l’intrigue du roman (le premier traduit en français) de Matéi Visniec ne peut être résumée. D’ailleurs il n’y en a pas, d’intrigue ; plutôt, elles sont multiples, cheminant et courant entre réalité et fiction : il y a le « journal réel » d’un écrivain qui, parvenant à sortir de la Roumanie de Ceauşescu, trouve refuge à Paris, et il y a les œuvres potentiellement écrites, sous la houlette d’un éditeur fantasque et tyrannique, par des êtres pouvant être aussi bien auteurs que personnages. Comme le dit l’observateur Georges, derrière son bar : « On dirait que nous nous trouvons ici précisément au point de passage de la frontière entre fiction et réalité ».
Le récit navigue comme un bateau dans une tempête, tantôt grimpant vers les sommets prestigieux des vagues (la gloire mondiale sur laquelle fantasme le narrateur), tantôt plongeant vers l’abîme du néant anonyme – le tout ponctué par un poème qui clôt le livre, « Le Navire », parabole de la lente destruction d’une… (ici, au lecteur de compléter).
Intrigues multiples, personnages multiples : outre l’auteur (qui n’hésite pas à se nommer en tant que personnage), l’éditeur « Monsieur Cambreleng », l’ami d’enfance Gogu Boltanski qui a suivi une autre voie, François, futur auteur malgré lui d’un « chef-d’œuvre », un étrange bossu, un guide aveugle, une jeune femme séduisante et sans cesse éclopée, tout un cheptel d’auteurs-personnages réunis dans un café de la rue Mouffetard… Il faut aussi compter avec les silhouettes d’illustres écrivains et artistes du passé lointain ou proche, de Voltaire à Sartre, d’Hugo à Breton, Beckett ou Queneau, sans oublier le trio roumain Cioran, Eliade, Ionesco…
Personnages multiples, sujets multiples : l’actualité politique, les dictatures d’Europe de l’Est, les bouleversements liés à la chute du Mur, et bien sûr Paris, la ville des lumières et des ombres, des bistrots et des librairies, des touristes et des autochtones aux origines mêlées, des enthousiasmes délirants et des déceptions amères, navire qui « fluctuat nec mergitur » malgré la houle, la ville qui est un livre vivant, plein de souvenirs et de surprises. Paris qui vit des mots, ces êtres traversant les frontières, passant « d’un cerveau à l’autre » : « Toute la ville était habitée par des mots. Je voyais autour de l’église Saint-Médard les mots des passants, d’autres mots qui sortaient des fenêtres ouvertes des immeubles, ou bien des portes des cafés. Partout où deux personnes se rencontraient et se mettaient à discuter, une nébuleuse de mots se formait autour d’eux ».
Chaque chapitre est un déroutement, au plein sens du terme, et le lecteur se laisse mener volontiers où il semble bon à l’auteur de le mener, dans les méandres de la « Ville lumière ». C’est cette instabilité qui paradoxalement fait l’unité du livre, comme dans la vie. Au-delà de la « panique » que peuvent provoquer les tempêtes et les errances, ce qui rassure, c’est le ton de Visniec, le style inimitable qui est le sien, la foi dans l’écriture, la confiance accordée aux mots. La littérature ne sombrera pas.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, matéi visniec, nicolas cavaillès, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/04/2012
Quête clandestine
 Blandine Le Callet, La ballade de Lila K, Stock, 2010, Le livre de poche, 2012
Blandine Le Callet, La ballade de Lila K, Stock, 2010, Le livre de poche, 2012
Lila n’a pas de souvenirs de sa mère, sinon l’image de la « cassure », cette scène de terreur où, toute petite, elle en a été brutalement séparée pour se retrouver dans le « Centre » où elle passera son enfance et sa jeunesse. Pas de souvenirs, mais une quête qui va être son obsession secrète : retrouver cette femme qui, officiellement frappée d’indignité, ne doit plus être sa mère, mais dont elle sait plus ou moins consciemment – et par les mystérieuses résonances de son corps – qu’elle l’aimait malgré la misère et la déchéance.
 Contrainte de s’insérer (ou de feindre l’insertion) dans un monde qui la rebute, mais aidée par quelques êtres qui ont gardé leurs sentiments humains et leur culture livresque, elle mène coûte que coûte sa recherche malgré le programme obligatoire, la surveillance constante, les interdictions multiples, une organisation sociale dans laquelle l’individu ne maîtrise plus rien de son destin, sinon en s’enfermant ou en fuyant « extra muros », dans une « Zone » de tous les dangers… Car, à petites touches, l’auteur évoque un univers qui fait penser à ceux du Meilleur des mondes, de 1984 ou de Farenheit 451, mais dont celui dans lequel nous vivons actuellement porte sans conteste les germes.
Contrainte de s’insérer (ou de feindre l’insertion) dans un monde qui la rebute, mais aidée par quelques êtres qui ont gardé leurs sentiments humains et leur culture livresque, elle mène coûte que coûte sa recherche malgré le programme obligatoire, la surveillance constante, les interdictions multiples, une organisation sociale dans laquelle l’individu ne maîtrise plus rien de son destin, sinon en s’enfermant ou en fuyant « extra muros », dans une « Zone » de tous les dangers… Car, à petites touches, l’auteur évoque un univers qui fait penser à ceux du Meilleur des mondes, de 1984 ou de Farenheit 451, mais dont celui dans lequel nous vivons actuellement porte sans conteste les germes.
Blandine Le Callet, qui dans un registre différent s’est signalée naguère par son roman Une pièce montée (Stock, 2006, Prix des Lecteurs du Livre de Poche 2007), sait ménager un beau suspense tout en suscitant la réflexion. Surtout, elle peint avec délicatesse un être à la fois fragile et déterminé, auquel le lecteur s’attache avec émotion.
Jean-Pierre Longre
19:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, blandine le callet, éditions stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/04/2012
Une leçon de modestie
 Pascal Garnier, Nul n’est à l’abri du succès, Zulma, 2012
Pascal Garnier, Nul n’est à l’abri du succès, Zulma, 2012
Ce bref roman pourrait être vu comme une leçon de modestie délivrée par l’auteur à lui-même d’abord, aux autres écrivains ensuite, et plus généralement à tous ceux qui connaissent un jour ou l’autre le succès. Ce succès qui n’apporte pas le bonheur, mais une rupture existentielle.
Jean-François Colombier reçoit un grand prix littéraire, et se voit comblé d’honneurs, d’amis, d’argent, d’amour… Cédant momentanément à cette vie, il ne la supporte que peu de temps et répond à la rupture que provoqua ce prix par une autre rupture. Parti rejoindre son fils, petit dealer vivant au jour le jour, il se jette tête la première dans des péripéties où il s’empêtre de plus en plus, jusqu’à vouloir en mourir ; victime des escroqueries d’une vamp de bistrot et d’un semblant d’avocat, victime d’une fausse jeunesse qu’à 50 ans il croit retrouver, victime de ses illusions et de ses velléités, victime de son métier d’écrivain qui lui fait prendre les personnes de la vie pour des personnages de roman, à commencer par lui-même, comme le lui rappelle l’un d’entre eux : « Qu’est-ce que vous faites pour eux si ce n’est de les utiliser dans vos romans ? Vous leur versez des droits d’auteur ? […] Vous n’y connaissez rien, mon petit monsieur. C’est moi, là, maintenant qui écris le scénario, vous n’êtes qu’un personnage. »
Livre noir, mais alerte, Nul n’est à l’abri du succès obéit aux lois du roman d’aventures, comporte ce qu’il faut d’amour, de coups de revolver, de trafics divers, de trajets nocturnes en voiture, de déambulations citadines et autres ingrédients traditionnels, mais en décalage et à distance, subvertis par une écriture plaisante et ironique, ainsi que par les actes manqués et souvent ridicules du protagoniste/narrateur, anti-héros qui, ne comprenant pas ce qu’il vit, ne parvient même pas à mourir. Oui, une jolie leçon de modestie pour tous ceux qui se croient utiles aux autres et ne le sont même pas à eux-mêmes.
J.-P. Longre
Après la disparition de Pascal Garnier, en mars 2010, la revue Brèves lui a consacré son numéro 93. Voir: http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/11/29/pour-la-nouvelle-toujours.html
17:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pascal garnier, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/03/2012
La décadence en marche
 Christos Tsiolkas, La gifle, traduit de l’anglais (Australie) par Jean-Luc Piningre, Belfond, 2011. 10-18, 2012
Christos Tsiolkas, La gifle, traduit de l’anglais (Australie) par Jean-Luc Piningre, Belfond, 2011. 10-18, 2012
Au début, on se croirait en pleine saga socio-familiale, entre Desperate housewives et enquête sur les relations humaines dans la société occidentale actuelle. Et peu à peu, à partir d’une gifle donnée à un enfant au cours d’un barbecue entre amis, on s’aperçoit que c’est construit, profond, intéressant en somme, et de plus en plus.
Loin de la lisse superficialité d’une série américaine, nous plongeons dans les rapports complexes, les non-dits troubles, les angoisses secrètes ou involontairement proférées de la société australienne d’aujourd’hui, dans laquelle les mélanges ethniques n’empêchent pas le racisme, le souci de l’harmonie sociale n’empêche pas la violence, les liens familiaux n’empêchent pas le désarroi de la jeunesse, l’amour n’empêche pas la haine.
Même si le récit dans sa globalité revêt une unité, une continuité qui tiennent en haleine, chaque chapitre, consacré à l’un des protagonistes, est à lui seul une sorte de roman autonome, qui permet au lecteur de cheminer à la fois à la surface du temps et dans l’épaisseur psychologique des personnages, de parcourir l’échelle des générations et des origines, de mesurer le délitement d’une société où l’alcool et la drogue, les illusions et la désespérance voisinent avec la chaleur humaine et le réconfort des traditions.
 L’Australie est vue ici à la fois comme un pays particulier, avec ses coutumes, son melting-pot, ses tensions, son isolement, mais aussi comme un symbole de cet Occident qui voudrait avoir tout juste et qui s’aperçoit que, tout compte fait, la décadence est en marche. Christos Tsiolkas a sans doute mis dans son récit de son expérience personnelle et familiale (les immigrés grecs et leurs descendants y tiennent une place de choix) ; mais La gifle est surtout un vrai, bon et gros roman qui, par la fiction, lève le voile sur la réalité. C’est le premier roman de l’auteur traduit en français. Nous attendons les autres.
L’Australie est vue ici à la fois comme un pays particulier, avec ses coutumes, son melting-pot, ses tensions, son isolement, mais aussi comme un symbole de cet Occident qui voudrait avoir tout juste et qui s’aperçoit que, tout compte fait, la décadence est en marche. Christos Tsiolkas a sans doute mis dans son récit de son expérience personnelle et familiale (les immigrés grecs et leurs descendants y tiennent une place de choix) ; mais La gifle est surtout un vrai, bon et gros roman qui, par la fiction, lève le voile sur la réalité. C’est le premier roman de l’auteur traduit en français. Nous attendons les autres.
Jean-Pierre Longre
18:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, australie, christos tsiolkas, jean-luc piningre, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/03/2012
Présente et absente
 Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
PRIX FEMINA 2010
Rééd. Folio, 2012
« Il y a des circonstances où quoi qu’on fasse on va toujours nulle part ». En l’occurrence, dans le dernier roman de Patrick Lapeyre, on va et on vient entre passé et présent, entre ici et ailleurs, entre le réel quotidien et nulle part. Plus précisément, Nora Neville, jeune anglaise farouchement attachée à sa liberté, sans qu’elle éprouve le besoin de s’en justifier, va et vient entre Paris et Londres, entre Louis Blériot (qui n’est pas aviateur) et Murphy (qui est trader).
Et tout tourne autour d’elle, qu’elle soit physiquement présente ou absente, jusqu’à l’obsession, une obsession aux pouvoirs aussi absolus que mystérieux : « C’est à cette heure qu’autrefois Murphy aimait entrer en communication avec Nora. Il la retrouvait sagement assise, un livre à la main, à l’intérieur d’un café de Soho ou bien se promenant dans les allées de Green Park » ; une obsession qui peut suspendre le cours du monde, pour Blériot et pour les autres : « Le temps qu’elle pivote sur elle-même en le cherchant des yeux, il n’y a plus aucun bruit, on ne sent plus le souffle d’air, la rotation de la terre s’interrompt quelques nanosecondes ».
C ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
A l’instar du titre, évocateur et harmonieux, emprunté au poète japonais Issa, le style de Patrick Lapeyre est aéré et allusif, limpide et plein d’échos ; sous un apparent dépouillement, il ne dédaigne pas l’expressivité, la tournure imagée voire surprenante – comme est surprenante l’héroïne fraîche et tragique, présente et absente, attendue et imprévisible, réelle et irréelle – un peu comme si se retrouvaient dans le monde d’aujourd’hui la Manon Lescaut de l’abbé Prévost (dont l’auteur revendique d’ailleurs la paternité), mais aussi la Nadja d’André Breton.
Jean-Pierre Longre
16:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick lapeyre, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/12/2011
Les violences de l’art
 Yves Wellens, Épreuve d’artiste, Grand miroir / Renaissance du livre, 2011
Yves Wellens, Épreuve d’artiste, Grand miroir / Renaissance du livre, 2011
Stéphane Mandelbaum (1961-1986) a connu le destin tragique d’un artiste maudit ; un destin, en quelque sorte, à l’image de sa peinture violente, provocatrice, transgressive, où la mort, le sexe, le sang, la chair sont objets de fascination. Peintre insatisfait, portraitiste tourmenté, il se fit aussi voleur, et en mourut assassiné à 25 ans.
Le personnage a de quoi attirer les écrivains en quête de sujets forts. Certains pourraient en faire une biographie pleine de références ; d’autres un roman aux résonances vigoureuses. C’est le genre qu’a choisi Yves Wellens, mais à sa manière particulière, donnant des allures réalistes à l’invention et des airs romanesques à la réalité – et développant en quelque sorte ce qui se présentait sous forme abrégée ou ramassée dans certains de ses ouvrages précédents, comme Le cas de figure (Didier Devillez, 1995) ou Incisions locales (Luce Wilquin, 2002).
Selon un canevas quasiment immuable et terriblement prenant, entre prologue et épilogue, se succèdent dix chapitres d’« actualités » et sept chapitres de « portraits », qui bâtissent le processus biographique, artistique, mental du personnage devenant sous nos yeux la personne réelle de Stéphane Mandelbaum. Ce qui importe, semble-t-il, c’est moins de raconter une vie, certes hors du commun, que de tenter d’explorer les tréfonds de la création artistique avec ses tâtonnements, ses fulgurances, ses échecs, ses excès, ses risques mortels. Il y a l’enquête journalistique avec son cheminement cahoteux, et la construction esthétique avec ses errements chaotiques. Et à cette construction ne sont pas étrangers les « portraits » d’êtres tout aussi hors normes que Mandelbaum : Rimbaud, Pasolini, Bacon, Pierre Goldman, Goebbels, Himmler… On peut dire que ces portraits, de même qu’ils font partie intégrante du livre, sont au cœur même de l’œuvre du peintre.
Ainsi Wellens donne-t-il une tragédie en forme de puzzle dont chaque ensemble de scènes, chaque acte vise à percer des secrets, à approcher les rapports intimes entre un homme (sa vie, sa mort) et son œuvre. « On atteint, dans cette circonstance, un cas limite de contamination de l’œuvre par la réalité, mais aussi bien de la réalité par l’œuvre, sans qu’on sache parfaitement discerner en quel sens l’influence joue le plus ». ET Stéphane Mandelbaum lui-même de citer cette phrase : « J’ai une certaine faiblesse pour les criminels et les artistes : ni les uns ni les autres ne prennent la vie comme elle est ». Ainsi va la création.
Jean-Pierre Longre
http://www.renaissancedulivre.be/index.php/litterature/grand-miroir
16:17 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, peinture, belgique, francophone, stéphane mandelbaum, yves wellens, grand miroir, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/12/2011
Comment naît la musique
 Alain Gerber
Alain Gerber
Blues, Fayard, 2009, Le livre de poche, 2011
« Une musique immense, qui n’avait en aucun musicien ni commencement ni fin. Une musique à peau sombre, née avec la peau craquelée des vieux cuirs. Par hasard, j’appris un matin, à Clarksdale (Mississippi), dans le comté de Coahoma, qu’elle portait un nom : ces morceaux que nous chantions sans nous connaître, quelqu’un les avait appelés des blues ». Pour en arriver là, que de tribulations, que de vies cassées, que de violences, que d’aspirations à ce que certains appellent la liberté ou le bonheur, dont on sait bien qu’ils n’existent pas ici bas.
Alain Gerber, avec la verve poétique et le pouvoir d’évocation qu’on lui connaît, illustre en quelques destinées le cheminement vers la naissance de cette musique vouée, « comme le silence, à étouffer les soupirs et les cris de joie de ce monde sans queue ni tête ». Nous suivons, depuis la victoire des Nordistes sur les Sudistes et l’« émancipation » des esclaves jusqu’à la mort et l’oubli – mais aussi jusqu’à l’invention de ce langage sublime qui sait exprimer l’indicible -, les vies de Nehemiah, Cassie, Silas, ces vies qui se perdent, se retrouvent, se reperdent, mais qui toutes se rejoignent dans le rêve d’autre chose.
 Musical, ce vaste roman l’est, à coup sûr, puisque, sans qu’il soit explicitement présent à chaque page, tout converge vers le blues, par la grâce progressive et miraculeuse des dons, du travail et du malheur de chaque personnage, de même que par la bonne volonté des instruments (piano, harmonica, banjo, guitare et, bien sûr, voix…) qui se plient aux rythmes, aux souffles, aux doigts de toutes sortes. Musical, le récit l’est aussi dans sa structure polyphonique, puisque chaque personnage, en se racontant, superpose sa voix à celle des autres, tout en se ménageant quelques chorus. Tous font résonner, de la Nouvelle Orléans à Chicago, du Tennessee à la Californie, des chants et des contre-chants de souffrance et de nostalgie qui passent par l’harmonie des phrases et des mots d’un vrai compositeur de romans. Comme le dit à Silas son ami le major : « Je suis convaincu qu’il existe une relation étroite entre la musique et la littérature. Malheureusement, j’ignore laquelle. L’homme qui mettra le doigt dessus méritera qu’on dresse son effigie devant le Capitole, mon cher Silas ! ». Chiche.
Musical, ce vaste roman l’est, à coup sûr, puisque, sans qu’il soit explicitement présent à chaque page, tout converge vers le blues, par la grâce progressive et miraculeuse des dons, du travail et du malheur de chaque personnage, de même que par la bonne volonté des instruments (piano, harmonica, banjo, guitare et, bien sûr, voix…) qui se plient aux rythmes, aux souffles, aux doigts de toutes sortes. Musical, le récit l’est aussi dans sa structure polyphonique, puisque chaque personnage, en se racontant, superpose sa voix à celle des autres, tout en se ménageant quelques chorus. Tous font résonner, de la Nouvelle Orléans à Chicago, du Tennessee à la Californie, des chants et des contre-chants de souffrance et de nostalgie qui passent par l’harmonie des phrases et des mots d’un vrai compositeur de romans. Comme le dit à Silas son ami le major : « Je suis convaincu qu’il existe une relation étroite entre la musique et la littérature. Malheureusement, j’ignore laquelle. L’homme qui mettra le doigt dessus méritera qu’on dresse son effigie devant le Capitole, mon cher Silas ! ». Chiche.
Jean-Pierre Longre
10:05 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, fayard, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2011
Les ruses du roman
 Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Précisément, s’agit-il d’un roman ? Certes, Dumitru Tsepeneag a depuis longtemps (au moins depuis Le mot sablier qui, publié en 1984, représente sous forme narrative le passage d’une langue à l’autre) commencé à dévoiler certains coins de son atelier à l’intention de ses lecteurs, sans leur en laisser découvrir tous les secrets. Mais jamais un de ses livres n’a autant mérité le sous-titre de « Chantier à ciel ouvert ».
À l’image des tranchées que quelques travailleurs s’échinent à creuser dans les rues, certains leitmotive d’œuvres précédentes se retrouvent dans Le camion bulgare, certains personnages aussi : Marianne, l’épouse partie se soigner de son étrange maladie en Amérique, et à qui l’écrivain demande sans cesse des conseils, Alain, l’ami et traducteur à l’agonie, qu’il va falloir remplacer. D’autres apparaissent au fil des pages, fondant une narration épisodique : Tzvetan, le camionneur bulgare qui, en, quelque sorte, succède au fameux « plombier polonais » (et, autre clin d’œil, transporte avec lui un dangereux parapluie) ; Béatrice, dont la route va croiser celle du précédent, après qu’ils auront accompli leur itinéraire érotique ; Milena, romancière originaire de Slovaquie (mais dont le modèle, semble-t-il, vient plutôt de Slovénie), Pastenague, le double de l’auteur/narrateur avec qui il échange parfois des impressions ; quelques autres encore, qui naviguent entre réel et imaginaire.
On ne fera pas ici la liste des thèmes et sujets dont le foisonnement tient à la fois de la marqueterie cubiste, de la musique expérimentale et de l’art consommé de la (fausse) digression, dans un texte qui avance comme un camion cahotant sur les routes européennes. Il est question de Marguerite Duras, de « littérature d’ordinateur » et d’amour par courrier électronique, de mythologie égyptienne, d’animaux divers, de la Bulgarie et de la Roumanie, de maladie et de vieillesse… La récurrence de ce dernier motif pourrait laisser entendre que Le camion bulgare est le roman de la dépossession, voire de la disparition. Mais n’est-ce pas une ruse, pour mieux conserver sa foi en la littérature ? Car c’est essentiellement de littérature qu’il est question ; de celle des autres, parfois (les délicieuses et impitoyables Frappes chirurgicales restent d’actualité), mais surtout de celle qui est en train de s’élaborer ici, maintenant : autocommentaire, autocritique, autobiographie littéraire (que d’« auto » pour un camion…), ou encore métalittérature, poétique du roman, mise en abîme de l’écriture… Patiemment, de livre en livre, bien mieux que dans n’importe quel traité théorique ou manuel universitaire, Dumitru Tsepeneag explore malicieusement l’art du récit et procède aux mises en ordre successives de ses découvertes. Attendons la suite.
« Je reconnais que je n’ai pas eu le courage d’écrire un véritable chantier : rassembler des matériaux de construction, placer côte à côte les briques narratives et les idées structurantes, et laisser le lecteur se faire son roman lui-même. Certes : je l’ai écrit, pour ainsi dire, sous ses yeux, il est témoin des efforts que je fais pour écrire encore un livre – le livre de trop, diront certains… ». Mais non !
Jean-Pierre Longre
14:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/10/2011
Perspectives intimes
 Gaëlle Josse, Les heures silencieuses, Autrement / Littératures, 2011. J'ai lu, 2012
Gaëlle Josse, Les heures silencieuses, Autrement / Littératures, 2011. J'ai lu, 2012
La contemplation d’un tableau requiert par nature le mutisme, et si mots il y a, ils ne peuvent naître que de l’œuvre même. Dans Les heures silencieuses, Gaëlle Josse fait surgir du silence les secrets de l’image, en donnant la parole au personnage que l’on y distingue sans pouvoir en rien le reconnaître.
D’abord l’œuvre picturale, reproduite sur la couverture du livre : un tableau d’Emmanuel De Witte, tout en profondeur, où « l’ombre qui tombe à terre en dévorant les couleurs et en assourdissant les formes » est parsemée des taches de « la lumière du soleil montant ». Dans l’enfilade des pièces de cet intérieur hollandais, la première est occupée par une femme vue de dos, jouant de l’épinette. C’est elle, Magdalena, épouse de Pieter Van Beyeren, qui tient ici son journal, par le truchement de la plume subtile et retenue de Gaëlle Josse.
À Delft, au XVIIe siècle, dans le milieu des riches négociants et des navigateurs audacieux, une épouse et mère, même si elle a la fibre commerçante, doit avant tout tenir sa maison avec la discrétion et l’efficacité requises. Alors Magdalena, qui ne doit rien laisser paraître, apaise les souvenirs cuisants, les accidents de la vie, les aspirations déçues, les tristesses durables, les souffrances passagères en suivant par l’écriture les méandres de son intimité. Il y a aussi de fugitifs moments de joie, des bonheurs artistiques (on croise avec plaisir, à l’occasion, Vermeer ou Sweelinck), et l’amour porté à ses enfants, qui n’occulte pas la perte de ceux qu’elle a perdus.
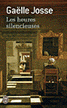 Le dévoilement esquissé des secrets de l’âme et du corps, à l’image de ce que laisse deviner le tableau de De Witte, s’accompagne de détails précis sur la vie quotidienne, les relations familiales et amicales, locales et internationales, la solidarité même : « Nos provinces offrent l’asile à ceux qui ne peuvent vivre en paix dans leur pays. Juifs, catholiques ou réformés demeurent ici en bonne intelligence, et chacun apporte sa pierre à l’édifice commun ». Avec cela, sagesse et lucidité soutiennent la réflexion : « Chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d’une vie n’est en rien semblable à celle d’un stock d’épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elles restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est d’une moindre résistance, je le crains ».
Le dévoilement esquissé des secrets de l’âme et du corps, à l’image de ce que laisse deviner le tableau de De Witte, s’accompagne de détails précis sur la vie quotidienne, les relations familiales et amicales, locales et internationales, la solidarité même : « Nos provinces offrent l’asile à ceux qui ne peuvent vivre en paix dans leur pays. Juifs, catholiques ou réformés demeurent ici en bonne intelligence, et chacun apporte sa pierre à l’édifice commun ». Avec cela, sagesse et lucidité soutiennent la réflexion : « Chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d’une vie n’est en rien semblable à celle d’un stock d’épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elles restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est d’une moindre résistance, je le crains ».
Le silence est bien la condition de la mise au jour de la vie, un silence ponctué par la musique : « C’est une grâce de se laisser toucher par elle. Je crois volontiers qu’elle adoucit nos cœurs et nos humeurs ». Ainsi ce roman, mélancolique journal intime, est-il non seulement un témoignage biographique et historique, la mise en perspective d’une quête morale et sentimentale, mais aussi une somme esthétique : la peinture, l’écriture, la musique s’unissent pour dresser, dans une atmosphère tout en nuances, le portrait d’une femme qui, au-delà de circonstances particulières, (se) pose les questions les plus humaines qui soient.
Jean-Pierre Longre
16:57 Publié dans Littérature et musique, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, musique, peinture, francophone, gaëlle josse, editions autrement, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/09/2011
« Battre le tambour »
 Jacques-Pierre Amée, Le ciel est plein de pierres, Infolio, 2011
Jacques-Pierre Amée, Le ciel est plein de pierres, Infolio, 2011
Le nouveau roman de Jacques-Pierre Amée est certes plein de pierres, mais aussi plein de rythme, et de tant d’autres choses parmi lesquelles la nature tient une place prépondérante (la forêt et les animaux, par exemple), sans compter l’amitié, l’amour, la parole, le silence, le mystère…
Le narrateur, Graham Rouge (un nom qui se détache sur la verdure, la neige, le ciel, la nuit), photographe animalier, observateur du monde lointain et proche, tente de se frayer un chemin entre souvenirs et immédiateté, entre passé et présent. Son récit, qui s’adresse à son ami Emil, hospitalisé au-delà des mers, à cette Ibi qu’il aime mais qu’il n’a pas vue depuis un certain temps, à d’autres encore, Caïm, Lucie, le lecteur, lui-même... son récit, donc, tient autant de la narration que de la poésie, du mouvement que du ressassement, de la fiction que du journal, un journal dans lequel, au fil de la lecture, on assiste à la mise en place de l’écriture.
L’auteur a l’art de (se) raconter sans en avoir l’air, par des détours, par des étapes où l’accessoire narratif parait devenir l’essentiel. « Y a rien de facile », dit périodiquement le boucher du coin : aussi difficile d’étouffer proprement un pigeon que de percer le mystère de l’énigmatique « Toubob », vagabond qui pourrait bien avoir fait disparaître avec lui la vieille dame qui l’avait recueilli, ou de reconstituer le puzzle que représente le titre du magazine NOÉ…
Voilà un livre qui « bat le tambour » (autre leitmotiv, autre rime de la prose), qui bat le rappel (des souvenirs, des amis, des contrées lointaines), qui bat la chamade (émotion à tous les tournants de pages), qui bat les cartes (pour mieux rendre compte du désordre universel). Un livre musical, où le langage des images et des mots s’impose comme une lancinante mélodie, comme une étourdissante symphonie.
Jean-Pierre Longre
15:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, jacques-pierre amée, éditions infolio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/09/2011
Se défaire du monde
 Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
« Nous avons été deux hommes juchés face au mal. J’ai su que vous souffriez comme je souffrais. Nous adressions à des dieux différents des lamentations qui n’empruntaient pas les mêmes mots. Je ne savais pas quelle peine vous avait conduit près de moi. Je ne pensais pas qu’il fût de peine qui valût la mienne. Mais vous étiez venu du bout de la terre. Nous fûmes une seule protestation et l’amour qui ne renonce pas ».
Ces deux hommes, Monsieur de la Tour et Lu Wei, n’étaient pas faits pour se connaître : le premier, noble français plus ou moins mêlé à la Fronde, et le second, dignitaire chinois déchu par les guerres et le renversement de la dynastie des Ming, sont séparés non seulement par les océans, mais aussi par leurs origines et leurs cultures. Pourtant, leur rencontre silencieuse et leur amitié précautionneuse sont le fruit d’une convergence qui les rend inévitables : Monsieur de la Tour, brûlant d’un amour coupable et partagé pour Madame de Clermont, fuit au-delà des mers et se retrouve, au bout d’un périple aussi hasardeux que dangereux, sur un îlot où s’est retiré Lu Wei, souffrant lui-même d’un désespérant mal d’amour pour son épouse disparue. Commencent douze années de condamnation volontaire, de réclusion ascétique, au cours desquelles la soif d’absolu tente de panser la blessure, où la quête du vide le dispute à l’espoir en Dieu, ce dieu que Monsieur de la Tour cherchera encore en France, réfugié à Port-Royal, dans le plus complet dénuement, dans cet « abandonnement » qui l’accompagnera jusqu’à la fin.
Le roman de Laurence Plazenet se déroule comme une longue litanie submergeant les heurts, les atrocités, les décompositions qu’il dévoile. Psalmodiées en un récitatif qui donne autant d’importance à la musique des mots qu’à leur contenu, les phrases, dont la sobriété toute classique s’accommode parfois de circonvolutions baroques, sont prenantes. La stylisation de la forme impose l’évidence des faits et des pensées, donne à la prose une profondeur qui révèle celle des âmes.
Jean-Pierre Longre
Laurence Plazenet vient de publier Disproportion de l'homme, Gallimard, 2011. Lecture et chronique à venir…
09:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurence plazenet, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2011
En allant chez Destouches
 Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010. J'ai lu, 2011
Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010. J'ai lu, 2011
La journée du 6 décembre 1954 aura été pour quelques personnes d’une exceptionnelle densité. C’est d’abord celle où Simone de Beauvoir reçoit le prix Goncourt pour Les Mandarins, ce qui confirme le triomphe de la maison Gallimard sur ses concurrentes. Justement, dans cette maison, il y a un garçon de courses, Gérard Cohen, lui-même fils de l’un des dirigeants, et c’est sa propre journée que raconte le roman : il est chargé d’aller à Meudon, chez Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, porter des papiers que l’écrivain déchu ne voudra même pas regarder, tant il vomit, en même temps que les Juifs et que lui-même, les « sangsues », les « maquereaux », « cette grosse baderne adipeuse de Gaston », ce « gros matou gallimardeux », et « l’univers tout entier ».
 À la fois terrorisé et fasciné par le vieil antisémite, le jeune Cohen accomplira sa mission comme d’habitude, en dépit des chiens, de la crasse et des gémissements. Mais auparavant, il profite du répit que lui donne la remise du Goncourt pour s’adonner au vagabondage, et nous suivons les zigzags spatiaux et mentaux du motocycliste. Cela donne de belles évocations contrastées du Paris des années cinquante : le Milieu (éditorial), ses habitudes et ses célébrations ; les Halles, leurs odeurs et leur grouillement ; les hôtels de passe, les œillades et les caresses professionnelles des putains ; l’île Seguin et ses usines, le village de Meudon et ses grisailles, les hauteurs de la Seine où se terre le « réprouvé »… Cet itinéraire plus ou moins aléatoire est une sorte de préparation de l’entrevue, mais surtout, peut-être, une incitation aux souvenirs. La guerre et l’occupation sont encore toutes proches, que l’enfant juif a vécues en errant « de cachette en cachette » après l’emprisonnement de sa mère et l’arrestation de la femme chez laquelle il s’était réfugié, en errant mais en parcourant la campagne, en étudiant les plantes d’Auvergne, en s’instruisant, en vivant la vie d’un garçon de son âge.
À la fois terrorisé et fasciné par le vieil antisémite, le jeune Cohen accomplira sa mission comme d’habitude, en dépit des chiens, de la crasse et des gémissements. Mais auparavant, il profite du répit que lui donne la remise du Goncourt pour s’adonner au vagabondage, et nous suivons les zigzags spatiaux et mentaux du motocycliste. Cela donne de belles évocations contrastées du Paris des années cinquante : le Milieu (éditorial), ses habitudes et ses célébrations ; les Halles, leurs odeurs et leur grouillement ; les hôtels de passe, les œillades et les caresses professionnelles des putains ; l’île Seguin et ses usines, le village de Meudon et ses grisailles, les hauteurs de la Seine où se terre le « réprouvé »… Cet itinéraire plus ou moins aléatoire est une sorte de préparation de l’entrevue, mais surtout, peut-être, une incitation aux souvenirs. La guerre et l’occupation sont encore toutes proches, que l’enfant juif a vécues en errant « de cachette en cachette » après l’emprisonnement de sa mère et l’arrestation de la femme chez laquelle il s’était réfugié, en errant mais en parcourant la campagne, en étudiant les plantes d’Auvergne, en s’instruisant, en vivant la vie d’un garçon de son âge.
Le réprouvé est un vrai livre de littérature, à tous points de vue. Celle qui s’écrit et se déroule sous nos yeux, en des phrases qui suivent avec bonheur les méandres de la mémoire et de l’autoanalyse ; celle aussi qui s’est construite dans les soubresauts politiques et sociaux (que le père de l’auteur a dû connaître dans des conditions analogues), celle qui a composé avec les abominations, les lâchetés et la mauvaise conscience, avec la souffrance, l’innocence et le courage, celle qui est inséparable de la nature humaine. Et il n’y a pas que Céline ; l’on croise, à l’occasion, Paul Léautaud, Jean Paulhan, Raymond Queneau, et cela fait toujours plaisir. Il ne faut donc pas hésiter à accompagner le jeune Gérard Cohen dans son parcours initiatique.
Jean-Pierre Longre
11:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, mikaël hirsch, l’Éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/08/2011
Brisures et vérités
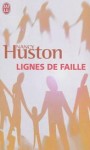 Nancy Huston, Lignes de faille, Actes Sud / Leméac, « Un endroit où aller », 2006. J'ai lu, 2011. Prix Fémina 2006.
Nancy Huston, Lignes de faille, Actes Sud / Leméac, « Un endroit où aller », 2006. J'ai lu, 2011. Prix Fémina 2006.
Quatre récits, quatre enfants de six ans différents et réunis par une ligne dont les brisures s’ouvrent peu à peu aux yeux du lecteur. Avec Sol (« Solly, Solomon »), petit garçon américain à part entière, rêvant sur Internet de puissance et d’éternité, imaginant qu’il « contrôle et possède chaque parcelle du monde », commence le parcours généalogique ascendant d’une famille reliée par quelques points d’ancrage – un grain de beauté, une poupée que se disputent violemment deux femmes âgées redevenues petites, un « vieux nounours tout râpé »…
L’exploration se poursuit avec Randall, le père de Sol, que l’on retrouve à six ans entre un père dramaturge au creux de son inspiration et une mère obsédée par ses recherches sur le Mal et les « fontaines de vie », lieux où les nazis concentraient pour les « germaniser » des enfants volés dans les pays occupés. Celle-ci, Sadie, est passée à l’âge de six ans du « parfum de tristesse » quotidien ressenti entre ses grands-parents à l’agitation réjouissante et désordonnée de la vie d’artiste menée par sa jeune mère. Finalement, c’est cette dernière, Erra (ou Kristina ou AGM), héroïne du quatrième récit, qui imprime sa marque sur tous les épisodes, en pointillés incisifs puis par la découverte de ses propres origines, donc de celles de la famille entière.
Itinéraire temporel sur plus d’un demi-siècle de bouleversements et de conflits entre 2004 et 1944, Lignes de faille est aussi un itinéraire spatial entre l’Amérique moderne et l’ancienne Europe, en passant par Israël. A travers des récits de vie individuels et familiaux, c’est la destinée du monde d’aujourd’hui qui est le véritable enjeu de la narration. C’est l’Histoire vécue de l’intérieur, dans la tension d’un mouvement chronologique inversé, à la recherche d’une authenticité dont seuls les enfants, dans leur lucide naïveté, semblent capables : « En les écoutant je repense à cette idée de théâtre et me demande si au fond le gens ne passent pas leur temps à jouer des rôles, non seulement lors des mariages mais tout au long de leur existence : peut-être qu’en conseillant ses fous grand-papa joue le rôle d’un psychiatre et en me frappant avec la règle Mlle Kelly joue le rôle d’une méchante prof de piano ; peut-être qu’au fond d’eux-mêmes ils sont tous quelqu’un d’autre mais, ayant appris leurs répliques et décroché leurs diplômes, ils traversent la vie en jouant ces rôles et il s’y habituent tellement qu’ils ne peuvent plus s’arrêter ».
Ce que se dit la petite Sadie, c’est souvent ce qu’on se dit non seulement à la lecture d’un roman, mais aussi à l’observation de la société des hommes. Lignes de faille est un roman qui, au-delà de l’habileté de la construction, de l’expressivité des soliloques enfantins, de la cruauté de certains passages, de la tendresse de certains autres, tente de mettre au jour les vérités nichées au plus profond des âmes et des corps.
Jean-Pierre Longre
16:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nancy huston, actes-sud, leméac, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/06/2011
Les parenthèses de l’existence
Alain Gerber, Longueur du temps, Alter ego éditions, 2011 
Alain Gerber et la musique, c’est tout un roman ; une somme de romans. Et malgré les apparences, Longueur du temps ne déroge pas : comme dans les livres précédents, il y a la matière biographique, la narration menée sur fond d’images fortes, l’invention verbale, les thématiques musicales (avec les silhouettes de fameux jazzmen passant à l’arrière-plan, parfois même jusque sur le devant de la scène), l’évocation de pays lointains et de rues toutes proches, Bavilliers et Ouagadougou, Paris et Montréal, Belfort et Corfou, le beau pays d’« Enfrance » et le légendaire Mexique – odyssées dans l’espace et dans le temps.
À part cela, il faut bien distinguer : la matière biographique est tout ce qu’il y a de personnel, même si, mettant à contribution le couple et l’univers environnant, elle ne doit rien à l’égotisme ; et la narration est versifiée – comme Chêne et chien, « roman en vers » dans lequel Raymond Queneau se raconte sans fards. La comparaison n’est pas hasardeuse : chez l’un comme chez l’autre les vers sont la composante nécessaire de la forme romanesque ; ils lui donnent sa ponctuation, son rythme, ses mesures, ses syncopes… Syntagmes sonores, phrases coupées, listes, inventaires, mots martelés, l’écriture au plus fondamental de sa composition est musicale, à la recherche de
« la formule cinglante / le sésame /qui lève l’écrou et brise les scellés / du Temps »,
le temps, incessant leitmotiv, qui donne leur « tempo » aux souvenirs.
Si la musique est partout, n’oublions pas que tout passe par la littérature. Ce sont les mots, combinés entre eux, qui tentent de lever les voiles de la mémoire, « ce lac sourd plein de rumeurs », et de « l’imaginaire incarné ». Et, comme celles des jazzmen, on voit passer tout près les silhouettes des romans de jadis, La couleur orange, Le plaisir des sens, Le faubourg des coups-de-trique, Une sorte de bleu…
Plutôt que de gloser, le commentateur ne rêve que de céder la place au soliste, pour quelques chorus bien sentis :
« Il est faux que l’on naisse mortel / on le devient seulement après quelques années ».
« Il y aura dès lors / un temps pour écrire / un temps pour voir le monde / comme si c’était un roman / qu’on lit en se déchiffrant soi-même ».
« Sur son propre compte / l’existence nous en dit plus dans ses parenthèses / et notes anodines au bas de la page / que dans les périodes les tropes / sourates sorites et tapageurs épichérèmes /qu’elle nous jette au visage ».
« Le but ultime des voyages est / qu’en passant / la vie va vous frôler / au lieu de vous passer à travers ».
Le reste à l’avenant, au rythme des mots, de la lecture et de la vie.
Jean-Pierre Longre
13:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, poésie, musique, francophone, alain gerber, alter ego éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/05/2011
Les mystères de l’art et de la mort
 Denis Labayle, Rouge Majeur,éditions du Panama, 2008, rééd. Editions Dialogues, 2011. Prix des Lecteurs de Brive 2009
Denis Labayle, Rouge Majeur,éditions du Panama, 2008, rééd. Editions Dialogues, 2011. Prix des Lecteurs de Brive 2009
Pourquoi, en mai 1955, Nicolas de Staël, peintre de renom, riche et séduisant, se suicida-t-il en se jetant par la fenêtre de son atelier ? Cette mort prématurée est-elle due à des déboires sentimentaux, aux doutes de l’artiste, à un constat d’impuissance ? De cette énigme, Denis Labayle a fait un roman qui mêle fiction et exactitude historique.
Tout commence avec un concert en hommage à Anton Webern, dont le peintre sort enthousiasmé, quasiment envoûté, à tel point qu’il projette d’en faire une toile hors du commun : « J’ai déjà peint des instruments de musique, mais là je sens naître en moi un projet fantastique : je veux peindre une impression… Oui, c’est cela, une impression musicale. Ce sera beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus difficile ». C’est ainsi qu’il propose au narrateur, un journaliste américain venu tout simplement enquêter sur sa vie et sa relation avec les femmes, de le suivre à Antibes et d’assister à la naissance de sa nouvelle œuvre – tâche à la fois fascinante et rude pour cet ancien combattant, resté handicapé à la suite du débarquement en Normandie. C’est ainsi, encore, qu’à l’existence tourmentée de Nicolas de Staël se mêle celle de son éphémère compagnon, pris par sa propre quête et ses propres réflexions.
La narration romanesque ne cache pas l’essentiel : l’art. Elle tente même de représenter les attitudes et les gestes du peintre en plein travail. Mais comment les mots peuvent-ils traduire « l’alchimie de l’art » ? Comment peuvent-ils « entrer, par effraction, au cœur du mystère » ? Entreprise au moins aussi audacieuse, aussi utopique que celle du peintre voulant matérialiser « l’éclair créateur » produit par la musique : « Je guette sans cesse l’émotion qui m’a saisi lors du concert de Webern, et je me demande si je vais l’éprouver à nouveau. Cette attente me désespère […]. Ah ! je m’en veux de ne pas maîtriser assez mon art ». Du désespoir naît pourtant l’œuvre où domine le rouge, couleur fascinante et terrifiante, la « symphonie majeure » en « rouge immense ».
Jean-Pierre Longre
15:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas de staël, denis labayle, éditions dialogues, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2011
Géraldine Bouvier, le retour
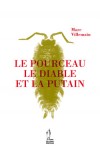 Marc Villemain, Le pourceau, le diable et la putain, Quidam éditeur, 2011
Marc Villemain, Le pourceau, le diable et la putain, Quidam éditeur, 2011
Elle était là dans Et que morts s’ensuivent, elle revient ici, au chevet du narrateur, un octogénaire grabataire qui, à la merci de sa « vipère aux yeux de jade », ne semble se faire d’illusions ni sur cette infirmière « dotée d’un tempérament qui ferait passer l’incendiaire intransigeance de Néron pour une contrariété de mioche privé de chocolatine », ni sur son propre passé de misanthrope sarcastique et invétéré, ni sur le genre humain, ni sur « l’existence profondément débile de son pourceau de fils ».
On l’aura compris, Marc Villemain laisse s’épanouir, dans son nouveau livre, l’humour (noir à souhait) et la satire (cynique à volonté). Les pages sur le monde universitaire, par exemple, que « Monsieur Léandre » a visiblement bien connu, sont un bel échantillon de réalisme critique – et la verve acérée du vieillard (enfin, de l’auteur) n’épargne pas non plus la famille, les enfants, l’école, les femmes, les malades, la société en général, disons l’univers dans son ensemble…
Il n’est pas innocent que le livre s’ouvre et se ferme sur l’image du cloporte, qui elle-même (pré)figure celle de la mort ; et Géraldine Bouvier, silhouette attirante et obsédante à la fois, n’en finit pas d’allonger son ombre diabolique d’un bout à l’autre du récit.
Jean-Pierre Longre
15:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marc villemain, quidam éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/04/2011
Sur les traces d’Emmet Ray
 Alain Gerber, Je te verrai dans mes rêves, Fayard, 2011
Alain Gerber, Je te verrai dans mes rêves, Fayard, 2011
On se souvient du film de Woody Allen Accords et désaccords, dans lequel Sean Penn incarne un jazzman hors du commun, le génial guitariste Emmet Ray, que personne ne peut se targuer d’avoir vu, entendu, rencontré, puisque la réalité ne daigne pas le faire apparaître sous ses propres traits.
Pourtant, Alain Gerber nous raconte comment il s’est acharné à le chercher jusqu’à ce qu’il en retrouve la trace. Après une entrevue vénitienne avec Woody Allen lui-même, il mène l’enquête, au risque de se fourvoyer, à partir d’une mystérieuse cassette et du témoignage d’un étrange personnage, Jean-Charles Gracieux, digne (comme le pavillon où il habite) des meilleurs contes fantastiques. C’est ainsi que l’on parvient à côtoyer cet Emmet Ray, « né Amintore Repeto », à la fois fasciné et effrayé par Django Reinhardt dont il est présenté comme le rival, bien qu’il se soit produit dans des lieux suffisamment discrets pour que le souvenir de sa virtuosité se soit effacé des mémoires les plus fiables… C’est ainsi que l’on voyage avec Alain Gerber entre la France et l’Amérique, entre le passé et le présent, jusqu’à la modeste bourgade de Bottleneck (ce nom désigne, faut-il le préciser, le tube métallique qui permet de jouer en « slide » sur les cordes de la guitare), où nous passons un long moment avec Lorette  racontant son déconcertant compagnon, ses heures flamboyantes et son entrée dans l’ombre, son glissando de fin… C’est ainsi que l’on assiste, aux côtés d’Emmet, à des scènes d’anthologie, telle cette rencontre, au comptoir d’un établissement new-yorkais, entre Marcel Cerdan, Django Reinhardt et Igor Stravinski – excusez du peu !
racontant son déconcertant compagnon, ses heures flamboyantes et son entrée dans l’ombre, son glissando de fin… C’est ainsi que l’on assiste, aux côtés d’Emmet, à des scènes d’anthologie, telle cette rencontre, au comptoir d’un établissement new-yorkais, entre Marcel Cerdan, Django Reinhardt et Igor Stravinski – excusez du peu !
« Longtemps, l’histoire du jazz s’est appuyée sur la tradition orale, ce qui n’a pas toujours permis de distinguer les événements des rumeurs, la réalité et le mythe ». Tandis que certains auteurs ne peuvent écrire qu’en vampirisant l’intimité de personnes réelles, au risque de la mort, Alain Gerber, qui a, lui, redonné l’épaisseur de l’existence à des musiciens devenus légendes (Charlie Parker, Chet Baker, Billie Holiday, Louis Armstrong, Paul Desmond, Frank Sinatra, Miles Davis, Django Reinhardt…), insuffle ici la vie à des êtres de papier ou de pellicule. Je te verrai dans mes rêves est le récit d’une rencontre pleine de vérité : celle d’un écrivain épris de jazz et d’un être essentiellement musical grâce auquel est tenue la promesse du titre.
Jean-Pierre Longre
En bonus, quelques rappels: Le jazz littéraire d'Alain Gerber.pdf
09:00 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, musique, francophone, emmet ray, alain gerber, editions fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/03/2011
Épreuves et variations
 Christian Gailly, K.622, Minuit, 1989, réédition coll. « double », 2011
Christian Gailly, K.622, Minuit, 1989, réédition coll. « double », 2011
Les phrases de Christian Gailly sont tâtonnantes, voire tatillonnantes – comme l’est la quête de son personnage, assidue, obstinée, aléatoire. Un personnage tantôt narrateur et observateur de lui-même, tantôt protagoniste et observé à la loupe, toujours à la recherche de l’émotion suscitée par l’audition radiophonique du Concerto pour clarinette en la majeur de Mozart (K.622). Mais voilà, « les conditions de l’émotion ne sont pas l’émotion, les conditions de l’émotion ne sont que le décor de l’émotion, et s’il est possible, toujours possible de reproduire le décor extérieur, le décor intérieur, lui, n’est pas reproductible, il change à vue, écrit-il ». L’achat de diverses interprétations enregistrées s’avère infructueux, même s’il procure quelques instants de quasi bonheur, jusqu’au jour de l’annonce d’un concert qui va remplir chaque instant de la vie du personnage et créer l’événement.
La lecture burlesque est possible (de ce burlesque irrésistible, agile et subtilement agaçant que peut procurer, parfois, le son de la clarinette dans les traits mozartiens). Mais K.622 est aussi une série de variations sur des thèmes liés à la quête éprouvante, inassouvie, réitérante (d’un choc musical, d’un costume parfait, de la beauté littéraire, sonore, visuelle) : « Reste l’écriture, la musique, la peinture, la beauté en un mot, la BEAUTÉ, mais que vaut-il mieux ? La chercher ? L’ignorer ? La connaître ou ne pas la connaître ? Meurt-on plus heureux auprès d’elle ? Moins désespéré ? ». Et le chapitre 3, qui tente de traduire en mots les trois mouvements du concerto de « WAM », ou en tout cas les impressions subjectives procurées par son audition, témoigne, en une sorte de condensé du roman, d’un art consommé de l’écriture musicale autant que des limites objectives de la superposition des deux esthétiques, sonore et verbale.
La parole et son commentaire, la musique et ses effets : il y a tout cela. En outre, K.622 est paradoxalement et fondamentalement un roman de l’émotion amoureuse : « Ses yeux ne me laissent pas la regarder en paix, il y a un point blanc dans chaque œil, un reflet qui m’indique qu’une source de lumière est entre nous ». C'est à quoi peut mener la musique de Mozart…
Jean-Pierre Longre
16:13 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, christian gailly, mozart, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/02/2011
Marseille-Bruxelles, « espace insulaire »
 Jean-Pierre Martin, Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2010
Jean-Pierre Martin, Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2010
Connaissez-vous le théorème de Montgolfier ? Alors voici : « Plus une rencontre entre deux êtres humains apparaît comme tributaire du hasard, plus elle se délivre par là même de toute contingence ». Et savez-vous qui est ce Montgolfier ? Un « ethnologue du proche », qui – pour faire court – étudie le comportement sexuel des animaux, en particulier des humains, et dans ce but additionne les trajets ferroviaires entre Marseille et Bruxelles. Un personnage observateur, à la fois dans le récit et en dehors, voix in et voix off, tel qu’on en trouve dans certains romans de Queneau (dont on devinerait, si l’on ne le savait déjà, que Jean-Pierre Martin est un fervent lecteur). Un autre se trouve dans une situation similaire : « L’écrivain », qui est « en train d’écrire un roman sur la séduction, […] ou encore, d’une certaine façon, sur l’amour », et qui dévoile volontiers la genèse de ses oeuvres : « J’aime sonder le mystère des êtres qui passent et qui se croisent, s’aperçoivent, s’évitent, se renfrognent ou s’ouvrent les uns aux autres, se racontant leur vie le temps d’un voyage ».
Outre ces deux-là, qui donnent une sorte d’assise comportementaliste et littéraire au récit, il y a dans la voiture 16 du TGV 9864 Nice-Bruxelles beaucoup d’autres personnages dont on ne va pas établir la liste ici. Hommes et femmes, jeunes et vieux, beaux et laids, sûrs d’eux et timides, séducteurs et maussades, ce petit monde représentatif, disons, de la société européenne occidentale de la première décennie du XXIe siècle, échange et détourne des regards, monologue, bredouille des paroles, esquisse et esquive des gestes, ébauche des relations, amorce des aventures, comme dans « un espace insulaire, à l’abri des invasions du monde », dans une parenthèse de liberté qui se refermera à l’ouverture des portes. Plusieurs romans restent ainsi en suspens, tel celui d’Enzo le musicien avec Rachel la prof de fac, ou celui de Laurence Fischer la psychanalyste avec le contrôleur qui ressemble à Lambert Wilson, et cela se tisse au rythme d’Alice, le train en personne, qui n’hésite pas à s’exprimer en mots humains, et dont les vibrations, selon leur intensité, règlent le débit de la parole des passagers, attisent ou atténuent leurs désirs ; au rythme, aussi, des annonces originales et lettrées de Wassim l’employé du wagon-bar… De ce huis clos à grande vitesse, de ces intrigues sans dénouement, de cet enfermement libérateur, on ne sort pas inchangé ; et, paradoxalement, on tente provisoirement de s’en échapper, à l’occasion, par le téléphone (qui dérange les autres), la poésie plus ou moins bien accueillie de Wassim, les souvenirs plus ou moins nostalgiques, les anticipations plus ou moins réalistes, les rêves plus ou moins érotiques… et par l’humour. Car il faut le reconnaître : l’observation du genre humain est, ici, un plaisir ; n’en déplaise à l’écrivain (« Ne riez pas », ordonne-t-il), il nous amuse (et il s’amuse) avec son sujet sérieux ; son style alerte, vibrionnant, n’y est pas pour rien.
Hasard des lectures ? Signes d’une époque ? Air du temps ? Au cours des derniers mois, j’ai lu plusieurs romans récents prenant pour cadre ou pour centre de gravité les transports collectifs, lieux d’observation et d’introspection (sans parler de tout ce que le métro a produit). Certains, comme Apaiser la poussière de Tabish Kair (éditions du Sonneur) ou La croisade des enfants de Florina Ilis (éditions des Syrtes) sont remarquables, chacun dans sa forme et sa portée. J’y ajoute volontiers Les liaisons ferroviaires.
Jean-Pierre Longre
http://www.jeanpierremartin.net
Et un peu de publicité pour des romans ferroviaires ou routiers :
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/01/02/le-train-de-la-memoire.html
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/10/20/nouveaute-aux-editions-du-sonneur.html)
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/05/20/le-pouvoir-de-l-innocence.html
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/02/24/meurtres-sur-la-voie-ferree.html
11:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-pierre martin, Éditions champ vallon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/02/2011
Face à la laideur
 Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Il y a quatre personnages : le narrateur, Luna, Victor et la jeune pianiste. Ajoutons les Niçois et la musique pour parfaire le compte. Pour raconter l’histoire, « on se parle à soi-même. C’est comme ça que ça commence. C’est comme ça qu’on dégénère ».
Et c’est « comme ça » que le lecteur est embarqué dans ce monologue intérieur, pris dans le tourbillon du soliloque, dans les lacets de la mémoire, dans la spirale de la parole intérieure, dans le piège de l’imagination, dans la folie des fantasmes. Ce qui guide le narrateur, et qui en même temps l’enferme, c’est son exigence. Exigence musicale se préservant « des méfaits de la compromission et du renoncement », face à l’ami Victor qui est devenu une « oie » ; exigence morale face à la corruption de la société, en particulier celle de la ville de Nice, qui est « devenue abjecte » ; exigence esthétique qui lui permet d’entendre les sonates inventées par Luna et de les retranscrire purement et simplement…
Tout aurait pu être beau : Nice et « le jardin d’Alsace-Lorraine », la musique enseignée au conservatoire, la visite de « la jeune pianiste », les demoiselles, les relations avec les autres, ceux qui l’appellent Le Dégénéré. Mais tout, dans la tête du narrateur en proie à lui-même et au monde, est dégénérescence. « C’est à se prendre la tête dans les mains et à ne jamais se la lâcher ». Et tout, dans ses phrases, dit qu’il faudra bien que cela finisse un jour, d’une manière ou d’une autre, comme dans les romans de Marguerite Duras ou dans les tragédies de Racine. Le dégénéré met en mots désespérants l’impuissance devant la laideur du monde et de l’âme humaine. Cela donne un roman angoissant, révolté, sombre, beau.
Jean-Pierre Longre
17:34 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jérôme bonnetto, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

