16/04/2021
Les murs du silence
 Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, P.O.L., 2019, Folio, 2021
Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, P.O.L., 2019, Folio, 2021
Dans un entretien accordé à Thierry Guichard (Le Matricule des Anges n° 2016, septembre 2019), Santiago H. Amigorena disait : « Enfance laconique, jeunesse aphone, adolescence taciturne, maturité coite, vieillesse discrète… le silence fait partie de ma vie comme de mon écriture, et je savais, depuis de longues années, qu’il me faudrait un jour écrire sur le silence de Vicente Rosenberg, mon grand-père maternel. Mais ce n’est qu’il y a deux ans, en lisant les lettres que mon arrière-grand-mère lui avait écrites depuis le ghetto de Varsovie et Los Abuelos, un livre écrit par mon cousin, Martin Caparrós, que l’ai compris la forme et le ton que pourrait prendre Le ghetto intérieur. »
C’est en effet l’histoire de ce grand-père qui est ici racontée. Juif polonais arrivé en Argentine en 1928, Vicente Rosenberg se marie avec Rosita, issue d’une famille juive ukrainienne, a des enfants, une belle-famille accueillante, des amis, un magasin de meubles… Bref, la vie semble lui sourire, « mais quelque chose de pire que tout ce qu’il avait imaginé était en train d’arriver – et il ne pouvait rien faire. » L’occupation de la Pologne, Varsovie aux mains des nazis, sa famille restée là-bas, sa mère enfermée dans le ghetto, les lettres de plus en plus déchirantes qui mettent des mois à arriver… Alors Vicente, rongé par la culpabilité de n’avoir pas assez fait pour sauver sa mère, pour la faire sortir du pays, s’enferme lui aussi entre des murs, ceux du silence et de l’absence apparente de toute réaction à l’amour de sa femme et de ses enfants, à la compagnie de ses amis, aux exigences de son travail. Ce sont les fuites nocturnes du domicile familial, le jeu jusqu’à l’aube, acharné à perdre « tout ce que le magasin rapportait », les cauchemars au cours desquels il se voit enserré entre des murailles de plus en plus oppressantes…
L’écriture de Santiago H. Amigorena pénètre jusqu’au fond des choses : les ressassements intérieurs d’un homme qui semble vouloir rester sourd non seulement aux autres, mais à lui-même, à la vérité de l’horreur, à ses propres vérités, sont relatés avec l’émotion et l’empathie d’un écrivain que l’on sent intimement concerné. Et les questions existentielles, les considérations historiques sur le nazisme, sur l’industrie de la mort, sur l’aveuglement des démocraties, sur la Shoah viennent à l’appui des préoccupations personnelles de Vicente et de Santiago, qui a lui aussi quitté son pays, l’Argentine, pour fuir la dictature, et « pour retourner en Europe. » Mais lui, pour tenter d’exorciser la souffrance, a recours aux mots.
Jean-Pierre Longre
18:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, santiago h. amigorena, p.o.l., 2019, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/04/2021
« Tout est réel, toujours »
 Mircea Cărtărescu, Solénoïde, traduit du roumain par Laure Hinckel, les Éditions Noir sur Blanc, 2019, réédition Points, 2021
Mircea Cărtărescu, Solénoïde, traduit du roumain par Laure Hinckel, les Éditions Noir sur Blanc, 2019, réédition Points, 2021
Prix Millepages 2019
Prix Transfuge 2019 du meilleur roman européen
La parution d’un roman de Mircea Cărtărescu est toujours un événement. C’est évidemment le cas ici, et plus encore : Solénoïde est un monument ; pas seulement par les dimensions extérieures du livre, mais aussi et surtout par ce qu’il renferme. Un monument qui, à l’image finale de Bucarest, le lieu de tout, se mettrait en mouvement – et alors les images se précipitent dans la tête du lecteur. Ce pourrait être celle d’un torrent que l’on tente de suivre, dont on tente de scruter les flots, le courant, le fond, les obstacles, et dont on prélève le plus souvent et le mieux possible quelques décilitres d’eau pour les examiner, avant de continuer la poursuite. Ou alors celle du labyrinthe dans lequel on se perd, on se retrouve, on se reperd en tenant un fil d'Ariane dont on espère qu'il mènera vers une issue. Ou encore celle de la spirale que l’on suit en mouvements ascendants et descendants – et dans ce cas on s’approche de l’objet qui sous-tend le roman et qui lui donne son titre. L’objet, ou les objets, puisque le sous-sol de Bucarest est parsemé de plusieurs machines du même type, les solénoïdes, ces grosses bobines en forme de spirale qui créent des vibrations et qui mettent les êtres et les choses (voire une ville entière) en mystérieuse lévitation.
 Mais ce thème central du roman n’en est, justement, qu’un aspect révélateur. Solénoïde est un roman aux multiples facettes, sorte de Recherche du temps perdu qui aurait été modelée par les mains de Lautréamont, de Raymond Roussel, des surréalistes et de Kafka (on en passe, car finalement les mains essentielles sont bien celles de Cărtărescu). Le canevas narratif est simple : un professeur de roumain qui a échoué dans un collège de banlieue et qui aurait voulu être écrivain (le double inversé de l’auteur, en quelque sorte), se raconte, en une superposition des souvenirs d’enfance et de la relation du présent dans une société minée par la dictature, la pauvreté matérielle et morale, mais dont certains membres sont sauvés par la vie mentale et par l’amour. Le rêve, les apparitions nocturnes, le surgissement de l’inconscient, tout cela est inscrit dans la vie. « Tu ne pouvais pas planter le rêve dans le monde, car le monde lui-même était un rêve. ». C’est pourquoi « la chasse au rêve suprême, orama » est l’un des chemins à suivre, sur les traces de Nicolae Vaschide, spécialiste reconnu de la question, et ancêtre d’une belle et inaccessible collègue du narrateur. Tout se tient, vous dit-on : la réalité historique et scientifique, la fiction, le rêve… et tout cela crée le réel.
Mais ce thème central du roman n’en est, justement, qu’un aspect révélateur. Solénoïde est un roman aux multiples facettes, sorte de Recherche du temps perdu qui aurait été modelée par les mains de Lautréamont, de Raymond Roussel, des surréalistes et de Kafka (on en passe, car finalement les mains essentielles sont bien celles de Cărtărescu). Le canevas narratif est simple : un professeur de roumain qui a échoué dans un collège de banlieue et qui aurait voulu être écrivain (le double inversé de l’auteur, en quelque sorte), se raconte, en une superposition des souvenirs d’enfance et de la relation du présent dans une société minée par la dictature, la pauvreté matérielle et morale, mais dont certains membres sont sauvés par la vie mentale et par l’amour. Le rêve, les apparitions nocturnes, le surgissement de l’inconscient, tout cela est inscrit dans la vie. « Tu ne pouvais pas planter le rêve dans le monde, car le monde lui-même était un rêve. ». C’est pourquoi « la chasse au rêve suprême, orama » est l’un des chemins à suivre, sur les traces de Nicolae Vaschide, spécialiste reconnu de la question, et ancêtre d’une belle et inaccessible collègue du narrateur. Tout se tient, vous dit-on : la réalité historique et scientifique, la fiction, le rêve… et tout cela crée le réel.
Outre les récits de rêves, nombre de motifs peuplent ce récit grouillant d’êtres vivants, humains et animaux. Voyez les poux, tiques, sarcoptes de la gale, acariens et autres insectes microscopiques donnant une idée de l’infiniment petit au regard de la vastitude du ciel aux étoiles menaçantes, de la ville fantasmée avec ses avenues, ses dédales de rues, ses souterrains, ses couloirs, ses usines, ses machineries, ses « veines » et ses « artères », sa nudité : « Quand les monceaux de neige ont disparu, Bucarest s’est offerte aux regards comme un squelette aux os dispersés. Qui aurait cru que sa décrépitude de toujours – le baroque sinistre de sa ruine – puisse devenir deux fois plus triste et plus désespérée ? ». Récit grouillant aussi de faits et d’événements plus ou moins étranges : disparitions et réapparitions énigmatiques, manifestations de « piquetistes », secte protestant avec véhémence contre la mort et faisant résonner à l’infini un pathétique « à l’aide », acquisition d’une maison/bateau dont le narrateur n’aura jamais fini d’explorer les prolongements horizontaux et verticaux, anecdotes liées à l’école (celle de l’enfance, celle de l’âge adulte), mariage rapidement interrompu par le changement dramatiquement radical de l’épouse, puis l’amour, le véritable, trouvé avec Irina, et la naissance d’une petite fille, le rappel de livres précédents (par exemple La Nostalgie, avec l’évocation du « REM »)… Le tout passé au crible de l’humour parfois dévastateur d’un Cărtărescu jouant malicieusement avec son propre destin d’écrivain à partir de la lecture publique d’un poème (significativement intitulé La Chute), s’adonnant mine de rien à la ravageuse satire politico-psychosociale d’un régime jamais nommé mais omniprésent, qui gangrène la société, l’école, les familles, les individus dans leur comportement quotidien, et maniant d’une façon impayable et efficace le portrait-charge ; on serait tenté de tout citer en guise de preuve – et il faut lire les descriptions de salle des professeurs, ou le récit de la collecte obligatoire par les élèves des bouteilles, bocaux et vieux papiers tournant à l’épopée absurde et bouffonne…
Roman fantastique dans tous les sens du terme, en vérité roman réaliste, roman humoristique, roman « limpide comme le jour et complètement inintelligible » comme l’est la vie, roman dont les particularités de ton, de style, de lexique sont fidèlement rendues en français grâce à un remarquable travail de traduction, Solénoïde pourrait être une tragédie, celle de la « devinette du monde », celle de la destinée humaine. S’il s’agit bien de celle-ci, elle aboutit, peut-être contre toute attente mais dans une belle perspective, au triomphe de l’amour : « La devinette du monde, enroulée, intriquée, accablante, perdurera, claire comme de l’eau de roche, naturelle comme la respiration, simple comme l’amour et […] elle se versera dans le néant, vierge et non élucidée. ». Finalement, c’est la plongée dans le bonheur, même sous la menace d’une statue géante, sorte de commandeur infernal : « Nous nous sommes enlacés, la petite entre nous deux, soudain incroyablement heureux et ne nous souciant plus d’aucune statue ni d’aucune porte. ».
Jean-Pierre Longre
www.leseditionsnoirsurblanc.fr
…et du même Mircea Cărtărescu vient de paraître :
 Melancolia, traduit par Laure Hinckel, les Éditions Noir sur Blanc, 2021
Melancolia, traduit par Laure Hinckel, les Éditions Noir sur Blanc, 2021
« Ce sont trois longues nouvelles encadrées par deux contes. Melancolia est un livre sur l’expérience de la séparation, sur ce trauma qui a marqué notre naissance et, par la suite, chacune de nos métamorphoses. L’immense écrivain Mircea Cărtărescu en fait ici l’étude à travers trois étapes de la vie : la petite enfance, l’âge de raison, l’adolescence.
Un enfant de cinq ans, dont la mère est sortie, se persuade qu’il a été abandonné : « C’est là le point de départ de la mélancolie, de ce sentiment que personne ne nous tient plus par la main. » Isabel et Marcel, frère et sœur, vivent au sein d’une famille ordinaire comme deux enfants perdus dans la forêt profonde. Lorsque la fillette tombe malade, son frère se jure d’obtenir sa guérison en partant affronter ce qui le terrifie le plus. Un adolescent se questionne sur la différence sexuelle. Il tombe amoureux. Son corps change : mois après mois, il range dans une armoire les peaux devenues trop petites…
Magnifiques variations sur les grands thèmes de l’auteur : le passage du temps, la poésie, le réel et l’irréel, le masculin et le féminin. »
11:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, mircea cărtărescu, laure hinckel, les Éditions noir sur blanc, éditions pointsjean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/04/2021
Quinze ans avant
 Ragnar Jónasson, L’île au secret, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Ombeline Marchon, éditions de la Martinière, Points, 2021
Ragnar Jónasson, L’île au secret, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Ombeline Marchon, éditions de la Martinière, Points, 2021
Outre la littérature policière, Ragnar Jónasson a une spécialité : la remontée du temps. Le premier volet de sa trilogie La Dame de Reykjavik commençait par la dernière enquête de Hulda. Le second, dont l’intrigue se déroule quinze ans auparavant (1997), la conduit même à reconsidérer une enquête pour un meurtre qui est survenu encore dix ans avant (1987), et qui forme la première partie de L’île au secret. De main de maître, l’auteur mène le lecteur, dans le sillage de son héroïne, d’une période à l’autre, d’une région à l’autre, le long les ramifications qui relient les événements entre eux.
Il y a eu la mort suspecte d’une jeune femme, Klara, qui, avec un groupe d’amis d’enfance, était venue faire un bref séjour sur une île déserte au large de la côte Sud de l’Islande. Dix ans avant, il y avait eu le meurtre d’une autre jeune femme, Katla, dont on apprend qu’elle faisait partie du même groupe d’amis. Les deux affaires sont-elles liées ? Les investigations de Hulda vont lui permettre de répondre à la question, et de confondre les manœuvres de Lỷdur, un collègue qui est devenu son supérieur hiérarchique. Cela grâce au revirement d’un policier local qui va revenir sur son témoignage. « Ils avaient peut-être trouvé l’assassin de Klara. Et aussi celui de Katla. Si c’était le cas, réalisa Hulda, le plus grand triomphe de Lỷdur au sein de la police se transformerait d’un coup de baguette magique en échec retentissant. »
Parallèlement, on ne peut que s’intéresser à la vie solitaire de Hulda, qui après la mort de sa fille et de son mari, s’oublie dans le travail, non sans se poser des questions à propos de son père, un soldat américain qui, après une brève mission en Islande, est reparti chez lui sans savoir que la jeune femme qu’il avait séduite était enceinte. Hulda ira même jusqu’aux États-Unis à la recherche de son géniteur. Autre enquête, très personnelle celle-ci… Aboutira-t-elle ? L’île au secret, pour complexe que soit l’écheveau de son intrigue, se lit comme on suit un chemin bordé de paysages mystérieux (ici les falaises maritimes, les sommets enneigées, les volcans…). On a hâte de savoir ce qui s’y cache.
Jean-Pierre Longre
17:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, anglophone, ragnar jónasson, ombeline marchon, éditions de la martinière, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Une ultime enquête
 Ragnar Jónasson, La dame de Reykjavík, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Philippe Reilly, éditions de la Martinière, Points, 2020
Ragnar Jónasson, La dame de Reykjavík, traduit de l’anglais, d’après l’islandais, par Philippe Reilly, éditions de la Martinière, Points, 2020
Hulda, inspectrice hors pair, doit prendre sa retraite, et visiblement son chef est pressé de la voir partir, « comme si toutes ces années de bons et loyaux services n’avaient aucune valeur. » Elle obtient cependant un sursis de quelques jours pour reprendre une affaire ancienne prétendument résolue, mais dont elle découvrira qu’elle a été bâclée par un collègue négligent. Elle se plonge dans son enquête, quitte à s’aventurer aux marges de la légalité et à brûler les étapes, ce qui lui vaut quelques déboires et les foudres de sa hiérarchie.
Elle découvre peu à peu tout ce qui était resté dans l’obscurité, son prédécesseur n’ayant pas jugé bon d’approfondir certains détails. Quelques personnages, louches ou non, vont faire leur apparition, donnant vie à des étapes dans les investigations d’Hulda, dont la vie personnelle nous est livrée peu à peu : l’histoire dramatique de sa fille, la mort de son mari, la rencontre réconfortante d’un homme qui l’apprécie… On s’intéresse autant à elle qu’à son enquête, dans laquelle elle va s’investir de plus en plus, au mépris du danger, de sa propre sécurité, de sa vie personnelle. Et l’on se laisse prendre au jeu du suspense et de l’angoisse, à l’atmosphère particulière et changeante d’une région soumise aux caprices de la météo, entre jours et nuits sans fin, entre soleil pâle et pluie battante, entre lave noire et neige vierge…
L’habileté de l’auteur, outre le style adapté à l’intrigue, est de jouer avec ces alternances, qui correspondent aux focalisations différentes, d’abord énigmatiques, mises sur les personnages, victimes et protagonistes, sur les risques qu’ils courent, sur les péripéties qui guident leurs destinées. Et l’audace suprême et subtile : faire de cette dernière enquête de l’héroïne le premier récit d’une trilogie qui remonte le temps.
Jean-Pierre Longre
16:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, anglophone, ragnar jónasson, philippe reilly, éditions de la martinière, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/04/2021
Les paradoxes du malheur
 Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Éditions de l’Olivier, 2019, Points, 2021
Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Éditions de l’Olivier, 2019, Points, 2021
Prix Goncourt 2019
Une ou deux fois ne sont pas coutume. Il est rare dans ces pages de trouver une chronique sur un livre récompensé par le prix Goncourt. Mais en 2019, ouf ! Nous avons échappé à une intarissable fabricante de best-sellers qui se veut magicienne des Lettres et qui n’a pas besoin d’afficher des prix pour remplir les têtes de gondole. Bref, des deux, c’est bien Jean-Paul Dubois qui méritait la récompense, même si à juste titre on avait déjà beaucoup parlé de son roman.
 Cette notoriété m’évitera de donner un résumé de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Résumé qui d’ailleurs aurait du mal à rendre compte de toutes les aventures qui arrivent à Paul Hansen, et dont il fait lui-même le récit depuis sa cellule d’une prison de Montréal. Pourquoi est-il en prison, lui qui est l’altruisme même, au plein sens du terme ? On ne le saura que sur le tard (stratégie du suspense) ; disons que c’est l’aboutissement (heureusement non définitif) d’un long processus mouvementé : enfant toulousain d’un père danois et pasteur qui perd la foi, d’une mère magnifique, militante et lointaine, Paul va naviguer vers l’âge adulte en suivant son père au Canada, où il deviendra pour de nombreuses années « superintendant » (c’est-à-dire homme à tout faire) de L’Excelsior, une résidence sécurisée à l’américaine pour privilégiés actifs ou retraités – où il aura des amis, mais aussi un ennemi acharné qui le fera sortir de ses gonds. Une compagne idéale, une chienne affectueuse, un métier qui lui plait, qui lui permet de s’adonner à son empathie naturelle et à « son envie de réparer les choses, de bien les traiter, de les soigner, de les surveiller. »... L’auteur combine à merveille l’art du récit à rebondissements, l’art du portrait juste et révélateur, l’art de la surprise et du paradoxe. La cohabitation de Paul, par exemple, avec le détenu Patrick Horton, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos », un passionné de Harley Davidson qui a vraisemblablement assassiné un Hells Angel, pourrait être un enfer ; eh bien non, Patrick, cette force de la nature qui souffre pourtant de phobies inattendues, est d’une bienveillance toute protectrice… Le tout à l’avenant : le père, pasteur en pays catholique, se prend d’une passion fiévreuse et destructrice pour les jeux de hasard, le cinéma d’art et d’essai de la mère est devenu une salle spécialisée dans les films porno, la compagne d’origine algonquine pilote audacieusement un antique aéronef au-dessus des immensités glacées, le seul véritable ami (outre la chienne Nouk) que Paul se fait à l’Excelsior est « casualties adjuster », chargé d’évaluer le prix des morts pour les compagnies d’assurance…
Cette notoriété m’évitera de donner un résumé de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Résumé qui d’ailleurs aurait du mal à rendre compte de toutes les aventures qui arrivent à Paul Hansen, et dont il fait lui-même le récit depuis sa cellule d’une prison de Montréal. Pourquoi est-il en prison, lui qui est l’altruisme même, au plein sens du terme ? On ne le saura que sur le tard (stratégie du suspense) ; disons que c’est l’aboutissement (heureusement non définitif) d’un long processus mouvementé : enfant toulousain d’un père danois et pasteur qui perd la foi, d’une mère magnifique, militante et lointaine, Paul va naviguer vers l’âge adulte en suivant son père au Canada, où il deviendra pour de nombreuses années « superintendant » (c’est-à-dire homme à tout faire) de L’Excelsior, une résidence sécurisée à l’américaine pour privilégiés actifs ou retraités – où il aura des amis, mais aussi un ennemi acharné qui le fera sortir de ses gonds. Une compagne idéale, une chienne affectueuse, un métier qui lui plait, qui lui permet de s’adonner à son empathie naturelle et à « son envie de réparer les choses, de bien les traiter, de les soigner, de les surveiller. »... L’auteur combine à merveille l’art du récit à rebondissements, l’art du portrait juste et révélateur, l’art de la surprise et du paradoxe. La cohabitation de Paul, par exemple, avec le détenu Patrick Horton, « un homme et demi qui s’est fait tatouer l’histoire de sa vie sur la peau du dos », un passionné de Harley Davidson qui a vraisemblablement assassiné un Hells Angel, pourrait être un enfer ; eh bien non, Patrick, cette force de la nature qui souffre pourtant de phobies inattendues, est d’une bienveillance toute protectrice… Le tout à l’avenant : le père, pasteur en pays catholique, se prend d’une passion fiévreuse et destructrice pour les jeux de hasard, le cinéma d’art et d’essai de la mère est devenu une salle spécialisée dans les films porno, la compagne d’origine algonquine pilote audacieusement un antique aéronef au-dessus des immensités glacées, le seul véritable ami (outre la chienne Nouk) que Paul se fait à l’Excelsior est « casualties adjuster », chargé d’évaluer le prix des morts pour les compagnies d’assurance…
Mais les faits, les situations et les personnages ne sont paradoxaux qu’en apparence. Jean-Paul Dubois possède tout à la fois le sens de la construction narrative, l’audace du réalisme, l’ardeur de l’imagination et la richesse de la sensibilité. Certes, pour lui, d’une manière générale, la destinée humaine est vouée à l’échec et au malheur : « À l’intérieur d’un immeuble ou d’une communauté, le malheur s’installe généralement par période. Pendant plusieurs mois, il va rôder dans les étages, oeuvrant de porte en porte, croquant d’abord le faible, ruinant les espérants. Et puis, un jour, changer de rue, de quartier, poursuivant à l’aveugle son travail d’artisan. ». Progression similaire pour tous les individus. Mais l’écriture de Jean-Paul Dubois convoque toutes les ressources de la générosité, de l’amitié, de l’amour, de l’humour. Et la pilule passe à merveille. Chaleureuse et euphorisante.
Jean-Pierre Longre
23:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, éditions de l’olivier, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/03/2021
Une journée de retrouvailles
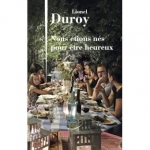 Lire, relire...Lionel Duroy, Nous étions nés pour être heureux, Julliard, 2019, J'ai lu, 2021
Lire, relire...Lionel Duroy, Nous étions nés pour être heureux, Julliard, 2019, J'ai lu, 2021
« On arrive avec trente ans de retard, c’est certain, ça te paraît même peut-être complètement ridicule, mais crois-moi : nous sommes tous désireux de réparer ce qui peut l’être. ». Voilà ce que disent deux des frères de Paul à Claire, l’une de ses filles. Que réparer ? Beaucoup de choses. D’abord l’impéritie et la folie des parents, qui ont fait le malheur de leurs neuf enfants en leur faisant vivre la déchéance matérielle et morale ; ensuite les livres dénonciateurs dans lesquels Paul relate les désastres familiaux ; enfin la brouille de toute la famille avec l’écrivain : « À partir du jour où mon livre a été publié vous ne m’avez plus adressé aucun signe. Ni un mot ni un coup de téléphone. Vous n’avez plus jamais invité mes enfants. ».
 Comment réparer ? Paul a décidé de réunir tout le monde, ses enfants et petits-enfants, ses frères et sœurs, ses deux ex-femmes, pour une journée particulière dans sa maison provençale, au pied du Mont Gardel. À une exception près, chacun se rend à l’invitation, et le livre raconte, en dialogues animés, ces retrouvailles semées de souvenirs, d’aveux sincères et parfois honteux, de bienveillance, de jeux et de mots d’enfants. Retrouvailles émouvantes, qui reconstituent en quelques heures des vies pleines d’embûches, de drames, de hontes, des vies qui se sont plus ou moins bien reconstruites. Et l’on revient sur cette brouille qui, pour beaucoup, est issue de malentendus, d’incompréhensions, à commencer par celle de l’écriture, sans laquelle Paul n’aurait pu survivre : « Comment peut-on exister sans écrire ? songe-t-il. Sans consigner inlassablement le mouvement de la vie ? Écrire est au contraire la plus sûre façon de ne rien rater de la vie, d’en débusquer les ressorts secrets invisibles à l’œil nu, de s’y ancrer ». Certains, comme son frère Nicolas, dont il fut très proche, reviennent sur les pouvoirs de nuisance de la famille : « Au nom de “l’esprit de famille”, cette valeur de merde, je me suis laissé entraîner, et je n’ai plus vu Paul. Notre qualité de frères l’a emporté sur notre amitié, alors que ç’aurait dû être le contraire. Je n’aurais jamais dû lâcher Paul, sous aucun prétexte, et surtout pas au nom d’une quelconque solidarité familiale. Il est là, le vrai scandale ! ».
Comment réparer ? Paul a décidé de réunir tout le monde, ses enfants et petits-enfants, ses frères et sœurs, ses deux ex-femmes, pour une journée particulière dans sa maison provençale, au pied du Mont Gardel. À une exception près, chacun se rend à l’invitation, et le livre raconte, en dialogues animés, ces retrouvailles semées de souvenirs, d’aveux sincères et parfois honteux, de bienveillance, de jeux et de mots d’enfants. Retrouvailles émouvantes, qui reconstituent en quelques heures des vies pleines d’embûches, de drames, de hontes, des vies qui se sont plus ou moins bien reconstruites. Et l’on revient sur cette brouille qui, pour beaucoup, est issue de malentendus, d’incompréhensions, à commencer par celle de l’écriture, sans laquelle Paul n’aurait pu survivre : « Comment peut-on exister sans écrire ? songe-t-il. Sans consigner inlassablement le mouvement de la vie ? Écrire est au contraire la plus sûre façon de ne rien rater de la vie, d’en débusquer les ressorts secrets invisibles à l’œil nu, de s’y ancrer ». Certains, comme son frère Nicolas, dont il fut très proche, reviennent sur les pouvoirs de nuisance de la famille : « Au nom de “l’esprit de famille”, cette valeur de merde, je me suis laissé entraîner, et je n’ai plus vu Paul. Notre qualité de frères l’a emporté sur notre amitié, alors que ç’aurait dû être le contraire. Je n’aurais jamais dû lâcher Paul, sous aucun prétexte, et surtout pas au nom d’une quelconque solidarité familiale. Il est là, le vrai scandale ! ».
Nous étions nés pour être heureux est, si l’on veut, un roman à clés, mais là n’est pas le plus important. Si on reconnaît Lionel Duroy dans le personnage de Paul, si tous les personnages correspondent à des personnes réelles, si les lieux (la région du Ventoux) sont reconnaissables et si les faits évoqués ont bien eu lieu, la condensation fictionnelle et quasiment théâtrale de l’action et des sentiments confère au roman une tension, une authenticité que le pur récit autobiographique ne pourrait pas apporter.
Jean-Pierre Longre
19:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel duroy, julliard, jean-pierre longre, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/03/2021
Un très honorable délateur
 Lire, relire... Romain Slocombe, Monsieur le Commandant, NIL, 2011, Pocket, 2013, Points, 2021, avec une préface inédite de Jérôme Leroy
Lire, relire... Romain Slocombe, Monsieur le Commandant, NIL, 2011, Pocket, 2013, Points, 2021, avec une préface inédite de Jérôme Leroy
Paul-Jean Husson, archétype de l’homme de lettres conscient de son talent, de son entregent et de sa notoriété, respectable académicien et notable respecté dans la sous-préfecture normande où il vit, est aussi le modèle du collaborateur, pétainiste de la première heure, admirateur de l’ordre nazi, antisémite acharné, xénophobe virulent, partisan de la fermeture des frontières, n’hésitant pas à dénoncer « l’immense flot de la crasse napolitaine, de la guenille levantine, des tristes puanteurs slaves, de l’affreuse misère andalouse, de la semence d’Abraham et du bitume de Judée » (ce n’est qu’un exemple).
 L’excès de ces convictions provoque son drame personnel et familial : un fils qui va rallier la France Libre à Londres, une belle-fille d’origine allemande, dont une enquête secrète révèle qu’elle est juive (et que ses petits-enfants, donc, sont juifs aussi…), et dont il ne peut s’empêcher, malgré tout, de tomber passionnément amoureux. Le drame tourne au cauchemar – sans entamer pour autant son antisémitisme viscéral et son pro-nazisme exacerbé. Comment résoudre le dilemme ? Comment sortir de la nasse ? Tout bien pesé, en écrivant, dans le style impeccablement académique que lui prête l’auteur, une longue missive au « Sturmbannführer » de la ville – en trahissant, d’une manière aussi odieuse qu’hypocrite, ses propres sentiments, et en sacrifiant sa famille, ceux qu’il est censé aimer.
L’excès de ces convictions provoque son drame personnel et familial : un fils qui va rallier la France Libre à Londres, une belle-fille d’origine allemande, dont une enquête secrète révèle qu’elle est juive (et que ses petits-enfants, donc, sont juifs aussi…), et dont il ne peut s’empêcher, malgré tout, de tomber passionnément amoureux. Le drame tourne au cauchemar – sans entamer pour autant son antisémitisme viscéral et son pro-nazisme exacerbé. Comment résoudre le dilemme ? Comment sortir de la nasse ? Tout bien pesé, en écrivant, dans le style impeccablement académique que lui prête l’auteur, une longue missive au « Sturmbannführer » de la ville – en trahissant, d’une manière aussi odieuse qu’hypocrite, ses propres sentiments, et en sacrifiant sa famille, ceux qu’il est censé aimer.
 D’aucuns ont vu dans le livre de Romain Slocombe un appel à la compréhension, voire à la bienveillance pour quelqu’un qui s’est rangé du côté des bourreaux. À y regarder de près, il n’en est rien. Les moments d’épanchement et d’apparente sociabilité ne font que mettre en valeur la foncière nocivité du personnage. Sous des dehors sensibles, c’est la brute qui se cache à peine, et qui ne sommeille pas. Derrière l’élégance du style, implosent l’insulte et l’injure. Et soixante-dix ans après ces événements, à l’heure où le fascisme se loge derrière des façades blanchies, où il se targue de compter parmi ses adeptes des notables bien mis et des jeunes gens bon genre – sans pour autant pouvoir passer sous silence sa violence fondamentale et sa haine viscérale de l’étranger –, il est utile de rappeler (qui plus est, comme ici, sous la forme d’un roman aussi complexe que terrifiant), que les pires horreurs, cautionnées par la peur sociale et économique, sont parfois perpétrées par des hommes cultivés et talentueux.
D’aucuns ont vu dans le livre de Romain Slocombe un appel à la compréhension, voire à la bienveillance pour quelqu’un qui s’est rangé du côté des bourreaux. À y regarder de près, il n’en est rien. Les moments d’épanchement et d’apparente sociabilité ne font que mettre en valeur la foncière nocivité du personnage. Sous des dehors sensibles, c’est la brute qui se cache à peine, et qui ne sommeille pas. Derrière l’élégance du style, implosent l’insulte et l’injure. Et soixante-dix ans après ces événements, à l’heure où le fascisme se loge derrière des façades blanchies, où il se targue de compter parmi ses adeptes des notables bien mis et des jeunes gens bon genre – sans pour autant pouvoir passer sous silence sa violence fondamentale et sa haine viscérale de l’étranger –, il est utile de rappeler (qui plus est, comme ici, sous la forme d’un roman aussi complexe que terrifiant), que les pires horreurs, cautionnées par la peur sociale et économique, sont parfois perpétrées par des hommes cultivés et talentueux.
Jean-Pierre Longre
Et à relire encore…
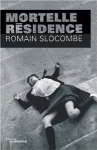 Romain Slocombe, Mortelle Résidence, Le Masque, 2008
Romain Slocombe, Mortelle Résidence, Le Masque, 2008
« Ah, quel drame ! Quel lieu, Lyon… Quelle énergie…Ça m’inspire ! ». Cette réflexion de l’un des personnages résume en quelque sorte la teneur et l’esprit de ce livre foisonnant, qui entrecroise en Rhône et Saône les récits semi-historiques et semi-fictionnels, toujours sanguinaires et terriblement humains. De la Terreur (et même en deçà) à nos jours en passant par l’occupation nazie, du Chili à la France en passant par les camps d’extermination, des pires bains de sang au « performances » du pseudo art contemporain, Mortelle Résidence laisse à peine le temps de souffler. A flux tendu, certains hauts lieux lyonnais du passé et du présent, réels ou à peine déguisés (telle cette « Délivrance » dans laquelle les autochtones reconnaîtront les « Subsistances ») sont le théâtre d’épisodes qui ne laissent pas indifférents. A lire d’un élan, si possible.
JPL
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, romain slocombe, nil, pocket, le masque, jean-pierre longre, points, jérôme leroy | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2021
D’une tempête à l’autre
Lire, relire... Jean-Paul Dubois, Une vie française, Éditions de l’Olivier, 2004, Points 2, 2011, rééd. Points 2021
 Comme en arrière-plan, s’écoule le temps politique, la succession des mandats présidentiels (De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand I, Mitterrand II, Chirac I, Chirac II…). Sur la scène elle-même, se joue la vie personnelle du narrateur, Paul Blick, avec les péripéties qui jalonnent une existence faite d’immobilisme et de tourments, de laisser-faire et de bonds en avant.
Comme en arrière-plan, s’écoule le temps politique, la succession des mandats présidentiels (De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand I, Mitterrand II, Chirac I, Chirac II…). Sur la scène elle-même, se joue la vie personnelle du narrateur, Paul Blick, avec les péripéties qui jalonnent une existence faite d’immobilisme et de tourments, de laisser-faire et de bonds en avant.
Mais les deux plans, le décor et la pièce qui se déploie sous nos yeux ne sont pas aussi distincts qu’il n’y paraît ; ils se rejoignent, se croisent, se superposent : on a bien affaire à une « vie française », celle d’un homme de notre époque et de notre contrée qui cherche sa voie, qui pense parfois l’avoir trouvée, qui la perd ou pense l’avoir perdue ; un homme qui déroule son histoire cahoteuse au milieu d’une Histoire dont le propre déroulement chaotique ne peut être enrayé.
Jean-Paul Dubois, donc, nous plonge directement dans les perturbations de la vie de Paul Blick, depuis la première tempête vécue par l’enfant – la mort de son frère – jusqu’à la dernière – la mort de sa femme dans des circonstances qu’il devra apprendre à maîtriser, puisqu’elle entraînera les désillusions, la ruine financière, la maladie de sa fille, et que l’autre femme de sa vie, sa mère, s’effacera à son tour en toute lucidité politique… Entre temps, il y aura eu mai 68, une jeunesse d’étudiant en sociologie (c’est-à-dire tournée vers beaucoup d’autres préoccupations que les études), les amours et les amitiés, la musique, les changements de cap, le mariage, les enfants et le travail d’homme au foyer, les courts et longs voyages à la recherche d’arbres à photographier, figés dans leur solitude orgueilleuse, une solitude dans laquelle Paul Blick se reconnaît lui-même, repoussant les sollicitations sociales, relationnelles, professionnelles et politiques (une drôle d’intervention de Mitterrand, notamment).
 Chronique du dernier demi-siècle, compte rendu d’une initiation (initiation au vieillissement et au désenchantement, et aussi à une vie qui ne demande qu’à se construire ou au moins à se dessiner), récit d’un naufrage auquel on tâche de réchapper tant bien que mal (et la véritable confrontation avec les éléments déchaînés subie par Paul et son beau-père une nuit d’orage méditerranéen s’impose comme une récapitulation concrète de la situation), tragi-comédie pathétique ou drame socio-familial, incessant questionnement individuel qui demeurera sans réponses, traversée d’un territoire parsemé de viaducs, de tunnels, de paysages lumineux et de sombres pièges… Une vie française est tout cela à la fois : sous un titre dont l’apparente simplicité annonce un programme dense et périlleux, un vrai roman d’aujourd’hui, personnel et universel.
Chronique du dernier demi-siècle, compte rendu d’une initiation (initiation au vieillissement et au désenchantement, et aussi à une vie qui ne demande qu’à se construire ou au moins à se dessiner), récit d’un naufrage auquel on tâche de réchapper tant bien que mal (et la véritable confrontation avec les éléments déchaînés subie par Paul et son beau-père une nuit d’orage méditerranéen s’impose comme une récapitulation concrète de la situation), tragi-comédie pathétique ou drame socio-familial, incessant questionnement individuel qui demeurera sans réponses, traversée d’un territoire parsemé de viaducs, de tunnels, de paysages lumineux et de sombres pièges… Une vie française est tout cela à la fois : sous un titre dont l’apparente simplicité annonce un programme dense et périlleux, un vrai roman d’aujourd’hui, personnel et universel.
Jean-Pierre Longre
http://www.editionsdelolivier.fr
19:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, éditions de l’olivier, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/01/2021
« Pouvoir parler »
 Lire, relire... Brigitte Giraud, Une année étrangère, Stock, 2009, J’ai lu, rééd. 2021
Lire, relire... Brigitte Giraud, Une année étrangère, Stock, 2009, J’ai lu, rééd. 2021
Son jeune frère Léo est mort dans un accident de mobylette, ses parents se renvoient plus ou moins explicitement la responsabilité de leur deuil, et Laura, 17 ans, souffre doublement de ce déchirement familial. Son départ pour l’Allemagne du Nord en tant que jeune fille au pair est comme une fuite.
Là-bas, prise dans le froid et l’humidité de la Baltique, tout près de l’infranchissable frontière avec l’Est (nous sommes avant 1989), elle a du mal à s’intégrer dans un monde inconnu, dans une famille étrange où le mystère et les non-dits semblent tenir une place importante, en un vide existentiel qui, à l’évidence, ne comblera pas le sien. Où trouver refuge ? Dans les occupations ménagères, dans la musique, dans une correspondance réconfortante avec son frère aîné, Simon (qui pourtant trouvera à la longue un autre point d’ancrage sentimental), et, peu à peu, dans une sorte de complicité avec les deux enfants de la famille Bergen, Thomas, 14 ans, et Susanne, 9 ans. Il y a aussi quelques sorties en ville, la bibliothèque, un peu de lecture, Thomas Mann… Pas de quoi contrecarrer la souffrance de la rupture et de l’absence… D’autant que les lacunes linguistiques ne facilitent pas la communication. Trouver les mots, « pouvoir parler », voilà le difficile enjeu, pour elle et pour les autres.
 Bien que certains échos résonnent discrètement et distinctement entre France et Allemagne, entre passé et présent (la mobylette, les relations familiales tendues – ou distendues –), Laura est ailleurs, ou plutôt elle sent les autres ailleurs – Monsieur et Madame Bergen, le grand-père, même les enfants –, et le passé de la famille pèse pour beaucoup dans ce sentiment, même s’il se révèle sur le tard. Elle est certes dans une contrée lointaine, mais ce n’est pas le seul facteur d’isolement. « Voici à quoi ressemble ma vie à quelques mois de mes dix-huit ans : un pays étranger, une langue étrangère, un homme étranger, mes parents étrangers, mon frère Léo dont l’image s’éloigne, mon frère Simon qui m’échappe, et moi, un corps étranger. C’est ce que je me dis le matin au réveil, quand je ne parviens pas à poser un pied par terre alors que la lumière entre depuis longtemps par le vasistas. C’est ce que je ressasse quand je marche près de Susanne le long de la voie ferrée. C’est peut-être cela l’expérience du deuil ? Un vertige d’étrangeté ».
Bien que certains échos résonnent discrètement et distinctement entre France et Allemagne, entre passé et présent (la mobylette, les relations familiales tendues – ou distendues –), Laura est ailleurs, ou plutôt elle sent les autres ailleurs – Monsieur et Madame Bergen, le grand-père, même les enfants –, et le passé de la famille pèse pour beaucoup dans ce sentiment, même s’il se révèle sur le tard. Elle est certes dans une contrée lointaine, mais ce n’est pas le seul facteur d’isolement. « Voici à quoi ressemble ma vie à quelques mois de mes dix-huit ans : un pays étranger, une langue étrangère, un homme étranger, mes parents étrangers, mon frère Léo dont l’image s’éloigne, mon frère Simon qui m’échappe, et moi, un corps étranger. C’est ce que je me dis le matin au réveil, quand je ne parviens pas à poser un pied par terre alors que la lumière entre depuis longtemps par le vasistas. C’est ce que je ressasse quand je marche près de Susanne le long de la voie ferrée. C’est peut-être cela l’expérience du deuil ? Un vertige d’étrangeté ».
Brigitte Giraud, avec profondeur et délicatesse, campe un personnage attachant, tout en nuances, fait de repli sur soi et d’ouverture aux autres, de fermeture et de réceptivité, de désillusion et d’espoir, et dont le nécessaire monologue intérieur laisse alterner plages de lucidité et zones d’ombre. Un personnage que l’on surprend en pleine métamorphose, et qui nous surprend par sa force de résistance aux faiblesses humaines, y compris les siennes.
Jean-Pierre Longre
19:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, brigitte giraud, éditions stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/01/2021
Sanglantes mises en scène
 Antonin Varenne, L’artiste, La Manufacture de livres, 2019, Points, 2020
Antonin Varenne, L’artiste, La Manufacture de livres, 2019, Points, 2020
Ça commence tambour battant. Chapitre 1 : du côté de Ménilmontant, une jeune femme s’est jetée par la fenêtre avec ses deux enfants. Chapitre 2 : dans le centre commercial de Bercy 2, un pompier se fait descendre par un cambrioleur. Fin du chapitre 3 : nous apprenons que nous sommes en septembre 2001, et que les tours du World Trade Center viennent d’être détruites par des avions. Chapitre 4 : Jules Armand, de son vrai nom David Kurjeza, peintre de la place du Tertre, se fait assassiner en rentrant chez lui par un inconnu qui lui a lancé : « Moi aussi je veux être artiste ! Moi aussi je veux peindre ! ». Et il y a vingt-cinq chapitres…
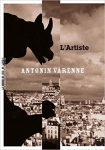 C’est le début d’une série de meurtres visant des artistes, dont on retrouve les cadavres au centre de mises en scène esthétiquement élaborées, impeccablement propres, véritables œuvres d’un « artiste » macabre. C’est Virgile Heckmann, inspecteur hors normes (socialement, professionnellement, individuellement), qui est chargé de ces affaires. Outre quelques adjoints officiels, dont un jeune inspecteur de la police scientifique qui n’a pas fini sa formation mais dont l’efficacité est certaine, il est officieusement secondé par Max Marty, ancien détective privé reconverti dans l’entretien acrobatique de façades et futur père de famille, et par Roland Parques, ancien médecin avorteur en pleine décrépitude crasseuse, mais qui a gardé quelques compétences. Un trio pour le moins pittoresque, dont chaque membre va jouer son rôle à sa façon très personnelle, le plus souvent décontenancé face à la « folie » du tueur.
C’est le début d’une série de meurtres visant des artistes, dont on retrouve les cadavres au centre de mises en scène esthétiquement élaborées, impeccablement propres, véritables œuvres d’un « artiste » macabre. C’est Virgile Heckmann, inspecteur hors normes (socialement, professionnellement, individuellement), qui est chargé de ces affaires. Outre quelques adjoints officiels, dont un jeune inspecteur de la police scientifique qui n’a pas fini sa formation mais dont l’efficacité est certaine, il est officieusement secondé par Max Marty, ancien détective privé reconverti dans l’entretien acrobatique de façades et futur père de famille, et par Roland Parques, ancien médecin avorteur en pleine décrépitude crasseuse, mais qui a gardé quelques compétences. Un trio pour le moins pittoresque, dont chaque membre va jouer son rôle à sa façon très personnelle, le plus souvent décontenancé face à la « folie » du tueur.
Certes, sous la houlette du policier, l’affaire sera résolue, mais ce ne sera pas sans mal ni sans casse. Antonin Varenne mène son lecteur dans un labyrinthe dramatique mais non dénué d’humour (noir, bien sûr), dans un labyrinthe palpitant et pathétique, et il le malmène aussi, son lecteur, comme sont malmenés les personnages – les enquêteurs, les victimes et leur entourage –, dont l’épaisseur psychologique et l’existence problématique donnent un aperçu de la complexité humaine. L’artiste est un vrai polar à suspense, qui n’occulte pas les enjeux socio-politiques, historiques, artistiques et psychologiques, ce qui en fait aussi un roman à part entière.
Jean-Pierre Longre
18:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, antonin varenne, la manufacture de livres, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/12/2020
Passion, liberté, poésie
Michel Peyramaure, La scandaleuse, Calmann-Lévy, 2020
 « Aimer et écrire furent les fils entremêlés dont j’ai tissé ma vie. » Cette phrase placée sous la plume de Louise Labé, et qui synthétise sa vie, est suivie d’une profession de foi singulièrement moderne : « Je revendique aussi pour mes sœurs l’accès au savoir et à la parole, et de vivre selon leur plaisir, comme je l’ai presque toujours fait ». Elle ne l’a sans doute pas formulé réellement de cette manière, mais c’est l’un des points sur lesquels a voulu insister Michel Peyramaure.
« Aimer et écrire furent les fils entremêlés dont j’ai tissé ma vie. » Cette phrase placée sous la plume de Louise Labé, et qui synthétise sa vie, est suivie d’une profession de foi singulièrement moderne : « Je revendique aussi pour mes sœurs l’accès au savoir et à la parole, et de vivre selon leur plaisir, comme je l’ai presque toujours fait ». Elle ne l’a sans doute pas formulé réellement de cette manière, mais c’est l’un des points sur lesquels a voulu insister Michel Peyramaure.
Celui-ci, pour décrire cette « Belle Cordière » qui fut l’une des grandes figures de la vie culturelle lyonnaise, lui invente des mémoires écrits à la fin de sa brève existence (1522-1566) dans sa maison de la Grange-Blanche à Parcieux (ou « Parcieu ») où elle s’est retirée, entre Saône et Dombes. C’est donc une autobiographie fictive qui nous fait découvrir ou redécouvrir un personnage pluriel : fille de cordier, mariée à un autre cordier affectueux et fort indulgent pour son épouse volage, elle fut femme d’action, de lettres et de plaisirs, muse et créatrice, de belle réputation auprès des poètes, mais plutôt de mauvaise auprès du peuple (d’où le titre du livre).
On ne retracera pas ici la destinée mouvementée maintes fois évoquée de Louise, qui a connu (parfois intimement) de grandes personnalités (comme le dauphin Henri, futur Henri II ou le cruel baron des Adrets), des écrivains prestigieux (Maurice Scève, Clément Marot, Pontus de Tyard, Joachim Du Bellay, François Rabelais) et de belles amours souvent brèves ou orageuses… Ce qu’elle narre ici, par la plume de Michel Peyramaure, relève parfois autant de l’imaginaire que du réel, de la légende que du témoignage, du roman que de la biographie, mais on y décèle la vérité d’un personnage ancré à la fois dans son époque tourmentée (les guerres de religion avec leurs massacres et leurs destructions, les épidémies, les manœuvres politiques…) et dans la société lyonnaise. Et même si d’aucuns contestent son talent de poète, voire son existence, on garde en mémoire le portrait d’une jeune femme passionnée, dont le charme, le goût de la liberté et les écrits ont traversé les siècles.
Jean-Pierre Longre
18:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, biographie, histoire, poésie, francophone, michel peyramaure, calmann-lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/12/2020
Une campagne de rêve
 Lionel-Édouard Martin, Roxane, Le bateau ivre, 2020
Lionel-Édouard Martin, Roxane, Le bateau ivre, 2020
Ils sont trois, la soixantaine bien mûre et encore alerte, l’embonpoint assumé, qui après de belles carrières se sont retirés dans leur bourg poitevin d’origine et y forment un « petit cénacle ». Apéritifs quotidiens, copieux repas, conversations interminables, pêche à la ligne, virées dans l’antique AX de l’un d’entre eux… La belle vie, régulière et joyeuse, animée par les récitals de trompe de chasse qu’ils donnent à l’occasion de certaines festivités, revêtus de l’habit rouge traditionnel. Oui, la belle vie, « genre bourgeois-bohèmes des champs, caves profondes, animaux de compagnie », à peine dérangée par quelques Parisiens cherchant à s’installer à la campagne, air pur, « harmonie bucolique » et prix modiques.
Parmi eux, en voilà un qui attire particulièrement leur attention, se renseignant auprès du maire, écumant les agences immobilières, achetant la littérature locale, faisant le trajet à plusieurs reprises et restant même plusieurs jours à examiner ses projets : un moulin au bord de la rivière ? Une grosse propriété ? Un domaine agricole ? Nos trois retraités suivent, espionnent, enquêtent. L’un d’entre eux arrive même à converser avec lui et s’empresse de faire son rapport à ses congénères. Son rêve : s’installer complètement avec sa femme et leur fille Roxane, une enfant fragile, trop sensible à la pollution citadine. Le « zig », avec lequel ils lient une sorte d’amitié malicieuse, commence vraiment à les intriguer, à troubler leur tranquillité. « Qu’est-ce qu’il a, ce zig, de spécial pour à ce point nous obséder ? ». Réponse incertaine : « Sa façon peut-être de s’accrocher à nous, ça fait désespoir de petit baigneur cherchant la perche, comme tombé dans lui-même, dans sa rivière propre, il est là qui panique, mais la perche est une farce, un sucre d’orge, une illusion, ça fond quand on y touche. » Comme si le « petit cénacle » devinait qui est vraiment le « zig ».
Dans son style nourri d’images pittoresques et originales, d’un lexique riche et mêlé, d’une syntaxe rebondissante, avec un sens ravageur de l’humour et du pathétique réunis, Lionel-Édouard Martin mène son roman par étapes successives, faisant alterner les points de vue par le truchement des monologues (ceux du « zig » – y compris les SMS qu’il échange avec Maryelle, sa femme – et ceux du trio), nous laissant savourer quelques morceaux de bravoure (telle la scène affolante d’un molosse déversant son trop-plein, disons… d’affection sur un humain). Peu à peu se mettent en place les ruses du dit trio, le piège qui sera tendu au « Parisien », jusqu’aux surprises finales, au dénouement dévoilant les rêves inaccomplis. Pour le « zig », c’était « rêves à tous les repas, collations comprises, l’imagination flamboyante, le monde lui entre dans la bouche, il le mâche, en fait des mots. » Tout un monde de mots : l’auteur sait de quoi il retourne.
Jean-Pierre Longre
18:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, le bateau ivre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/12/2020
« Une effacée magnifique »
 Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour, Les Éditions Noir sur Blanc, 2019, J’ai Lu, 2020
Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour, Les Éditions Noir sur Blanc, 2019, J’ai Lu, 2020
Vivian Maier était une photographe exceptionnelle, et personne ne le sut jusqu’à sa mort en 2009… Pourtant, la photo était « au cœur de sa vie », c’était « son œil, sa respiration, son toucher, sa façon d’être. ». Et elle n’a « jamais cherché la moindre reconnaissance, alors qu’elle aurait pu publier ses clichés, les exposer, faire montre de son œuvre. Pourquoi ? Toutes les hypothèses sont possibles, mais cette discrétion est sans doute liée à une condition sociale modeste doublée d’une fierté l’incitant à fuir les éventuelles déceptions : « S’épargner le refus, le rejet. »
 C’est en tout cas ce que suggère Gaëlle Josse, dans son récit sensible, émouvant, fouillé qui, à partir de la découverte d’une œuvre aussi abondante que passionnante, compose la rétrospective d’une vie à la fois humble et mouvementée. Née en 1926 aux États-Unis d’une mère originaire du Champsaur, dans les Hautes-Alpes françaises, et d’un père dont la famille venait de l’empire austro-hongrois, Vivian subira les mésententes, les querelles, les mensonges, la dégradation sociale de ses parents. Réfugiée un temps dans le berceau familial français, elle reviendra à New-York, repartira, voyagera, vivra à Chicago, partageant son temps entre son métier de nounou pour des enfants de familles aisées (il faut bien vivre) et sa passion secrète pour la photographie. « Sa vie avance entre ces deux pôles, le plus souvent emmêlés, son métier de gouvernante de jeunes enfants, à domicile, et ses déambulations photographiques. » Sociable, « curieuse de tout », sûre d’elle et de ses opinions, elle reste partout et toujours solitaire, ne cherche pas à plaire – et ses nombreux autoportraits, souvent complexes et savamment élaborés, ne sont pas des entreprises de séduction, mais relèvent plutôt de la recherche visuelle. Photographe de rue, elle fixe sur la pellicule des inconnus pris sur le vif, ceux qu’en général personne ne remarque, « les exclus, les marginaux, les abandonnés, les abîmés, les fracassés… »
C’est en tout cas ce que suggère Gaëlle Josse, dans son récit sensible, émouvant, fouillé qui, à partir de la découverte d’une œuvre aussi abondante que passionnante, compose la rétrospective d’une vie à la fois humble et mouvementée. Née en 1926 aux États-Unis d’une mère originaire du Champsaur, dans les Hautes-Alpes françaises, et d’un père dont la famille venait de l’empire austro-hongrois, Vivian subira les mésententes, les querelles, les mensonges, la dégradation sociale de ses parents. Réfugiée un temps dans le berceau familial français, elle reviendra à New-York, repartira, voyagera, vivra à Chicago, partageant son temps entre son métier de nounou pour des enfants de familles aisées (il faut bien vivre) et sa passion secrète pour la photographie. « Sa vie avance entre ces deux pôles, le plus souvent emmêlés, son métier de gouvernante de jeunes enfants, à domicile, et ses déambulations photographiques. » Sociable, « curieuse de tout », sûre d’elle et de ses opinions, elle reste partout et toujours solitaire, ne cherche pas à plaire – et ses nombreux autoportraits, souvent complexes et savamment élaborés, ne sont pas des entreprises de séduction, mais relèvent plutôt de la recherche visuelle. Photographe de rue, elle fixe sur la pellicule des inconnus pris sur le vif, ceux qu’en général personne ne remarque, « les exclus, les marginaux, les abandonnés, les abîmés, les fracassés… »
Le livre de Gaëlle Josse peut être qualifié de roman, dans la mesure où la vie connue de Vivian Maier est constituée de quelques points de repères et surtout de vides, de silences que seules les déductions et l’imagination peuvent remplir. L’existence en pointillés de cette artiste qui a vécu en domestique est présentée un peu comme une exposition d’instantanés successifs dont la synthèse est laissée à l’appréhension des lecteurs-visiteurs. Dans un ultime chapitre, Gaëlle Josse établit avec justesse un parallèle entre le travail photographique de Vivian Maier et ce que cherche à élaborer le travail littéraire (ou pictural, ou musical). Dans tous les cas, ce qui est en jeu, c’est la création artistique.
Jean-Pierre Longre
16:35 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biographie, roman, francophone, gaëlle josse, les Éditions noir sur blanc, j’ai lu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/12/2020
Affairistes et jeunesse perdue
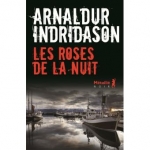 Arnaldur Indridason, Les roses de la nuit, traduit de l’islandais par Éric Boury, éditions Métailié, 2019, Points, 2020
Arnaldur Indridason, Les roses de la nuit, traduit de l’islandais par Éric Boury, éditions Métailié, 2019, Points, 2020
Le cadavre dénudé d’une jeune fille, Birta, est découvert en plein cimetière, sur la tombe du père de l’indépendance islandaise. L’enquête menée par Erlendur et son acolyte Sigurdur Oli va les mener dans le sombre présent d’une jeunesse tourmentée, un milieu où la drogue et la prostitution semblent être les seuls horizons de quelques filles et garçons. Erlendur, d’ailleurs, connaît bien ce monde désespérant et désespéré, fréquenté par sa fille et son fils, qui lui reprochent de les avoir abandonnés. C’est dire que le commissaire (« divorcé, la cinquantaine ») est personnellement impliqué dans cette enquête. La victime étant originaire des fjords de l’Ouest islandais, les deux policiers vont aussi mener leurs investigations dans cette région sinistrée, appauvrie par les manœuvres de spéculateurs sans scrupules, et dont les habitants émigrent vers la capitale, Reykjavik. La jonction va être faite entre les deux pôles, la jeunesse perdue et deux hommes corrompus, un proxénète trafiquant de drogue et un promoteur véreux, qui exploitent ouvertement la fragilité humaine.
 Publié initialement en 1998 mais paru tout récemment en français, ce roman est l’un des premiers à mettre en scène le commissaire Erlendur Sveinsson et ses méthodes originales, et à dévoiler une fiction qui n’est pas seulement policière. Roman d’atmosphère, roman noir (même si, ici, tout se passe sous le soleil d’été qui envahit la nuit), roman psychologique (les personnages – enquêteurs, victimes ou coupables, sont vus sous différentes facettes, voire dans toutes leurs contradictions), roman socio-politique (Erlendur ne cache pas son indignation face aux magouilles et au cynisme des entrepreneurs enrichis qui détiennent le véritable pouvoir)… L’enquête policière, pour palpitante qu’elle soit, est aussi l’occasion pour l’auteur de bâtir un récit complet et complexe, à l’image des réflexions du protagoniste tentant de récapituler les tenants et les aboutissants de son enquête : « Erlendur n’avait pas fermé l’œil de la nuit, gêné par le jour éternel de l’été. Il avait tenté d’établir des liens entre le meurtre de Birta, Herbert, Jon Sigurdsson, Kalmann et ses activités d’entrepreneur, les fjords de l’Ouest, Janus, la boîte métallique, la drogue, le passé et le présent. Il avait peu à peu échafaudé une hypothèse peut-être trop étrange pour correspondre à la réalité, mais c’est la seule qui lui était venue à l’esprit. » Avec Les roses de la nuit, qui se lit avec un plaisir dans lequel l’anxiété tient une belle place, Arnaldur Indridason avait trouvé le style qui lui a valu son succès actuel.
Publié initialement en 1998 mais paru tout récemment en français, ce roman est l’un des premiers à mettre en scène le commissaire Erlendur Sveinsson et ses méthodes originales, et à dévoiler une fiction qui n’est pas seulement policière. Roman d’atmosphère, roman noir (même si, ici, tout se passe sous le soleil d’été qui envahit la nuit), roman psychologique (les personnages – enquêteurs, victimes ou coupables, sont vus sous différentes facettes, voire dans toutes leurs contradictions), roman socio-politique (Erlendur ne cache pas son indignation face aux magouilles et au cynisme des entrepreneurs enrichis qui détiennent le véritable pouvoir)… L’enquête policière, pour palpitante qu’elle soit, est aussi l’occasion pour l’auteur de bâtir un récit complet et complexe, à l’image des réflexions du protagoniste tentant de récapituler les tenants et les aboutissants de son enquête : « Erlendur n’avait pas fermé l’œil de la nuit, gêné par le jour éternel de l’été. Il avait tenté d’établir des liens entre le meurtre de Birta, Herbert, Jon Sigurdsson, Kalmann et ses activités d’entrepreneur, les fjords de l’Ouest, Janus, la boîte métallique, la drogue, le passé et le présent. Il avait peu à peu échafaudé une hypothèse peut-être trop étrange pour correspondre à la réalité, mais c’est la seule qui lui était venue à l’esprit. » Avec Les roses de la nuit, qui se lit avec un plaisir dans lequel l’anxiété tient une belle place, Arnaldur Indridason avait trouvé le style qui lui a valu son succès actuel.
Jean-Pierre Longre
20:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, arnaldur indridason, Éric boury, éditions métailié, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/12/2020
Un Goncourt oulipien
 Le Prix Goncourt 2020 vient d’être attribué à Hervé Le Tellier pour son roman L’Anomalie (Gallimard).
Le Prix Goncourt 2020 vient d’être attribué à Hervé Le Tellier pour son roman L’Anomalie (Gallimard).
Président de l’OuLiPo depuis 2019 (après Paul Fournel), Hervé Le Tellier est l’auteur de nombreux autres livres. Son roman L’anomalie ayant déjà été, à juste titre, abondamment commenté, on trouvera ci-dessous quelques notes sur certains de ses ouvrages antérieurs.
http://jplongre.hautetfort.com/tag/herv%C3%A9+le+tellier&...
22:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hervé le tellier, gallimard | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2020
Réparer les plaies
 Lire, relire...Auđur Ava Ólafsdóttir, Ör, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2017, Zulma Poche, 2020
Lire, relire...Auđur Ava Ólafsdóttir, Ör, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2017, Zulma Poche, 2020
« Je fais tout ce que les trois Guđrun de ma vie me demandent. Je fixe les étagères et les miroirs, je déplace les meubles là où on me dit. […] Je ne suis […] pas un homme qui démolit, plutôt du genre qui arrange et répare ce qui ne fonctionne pas. Si on me demande pourquoi je fais tout ça, je réponds que c’est une femme qui me l’a demandé. ». Jónas Ebeneser, héros et narrateur du nouveau roman d’Auđur Ava Ólafsdóttir, est un habile bricoleur, on l’aura compris. Et bien qu’il n’ait plus de vie sexuelle depuis plusieurs années, il privilégie ses rapports avec les femmes, à commencer par ses « trois Guđrun » : son ex-femme, sa mère (ancienne professeur de mathématiques qui n’a plus toute sa tête mais sait encore calculer) et sa fille (Guđrun Nymphéa), « spécialiste en biologie marine ». À part cela, il se sent bien seul.
 L’histoire que Jónas raconte de lui-même devrait être celle de la fin de sa vie. L’idée du suicide le taraude, et il décide de partir, armé de sa perceuse et de sa caisse à outils, pour un pays en ruines – une contrée anonyme qui synthétise tous les pays détruits par la guerre. Dans la ville où il atterrit, seuls demeurent presque intacts de rares bâtiments, dont l’Hôtel Silence où il s’installe. Il s’y prend d’amitié pour May et Fifi, le frère et la sœur qui gèrent tant bien que mal cet établissement aux rares clients, ainsi que pour le petit garçon de May, Adam, fortement marqué par la guerre, et se met à s’occuper de la plomberie, de l’électricité, bref de toutes les défectuosités qu’un long abandon a entraînées. Et sa renommée de bricoleur va s’étendre…
L’histoire que Jónas raconte de lui-même devrait être celle de la fin de sa vie. L’idée du suicide le taraude, et il décide de partir, armé de sa perceuse et de sa caisse à outils, pour un pays en ruines – une contrée anonyme qui synthétise tous les pays détruits par la guerre. Dans la ville où il atterrit, seuls demeurent presque intacts de rares bâtiments, dont l’Hôtel Silence où il s’installe. Il s’y prend d’amitié pour May et Fifi, le frère et la sœur qui gèrent tant bien que mal cet établissement aux rares clients, ainsi que pour le petit garçon de May, Adam, fortement marqué par la guerre, et se met à s’occuper de la plomberie, de l’électricité, bref de toutes les défectuosités qu’un long abandon a entraînées. Et sa renommée de bricoleur va s’étendre…
Reprenant goût aux choses, aux plaisirs du cœur et du corps, il ne peut évidemment pas réparer les blessures profondes, les tragédies personnelles et familiales, les cicatrices de la vie, mais il voudrait s’y employer. « Ör » signifie « cicatrices », écrit l’auteur, et Jónas « en a sept ». Le titre de l’un des chapitres (les titres son ici, parfois, tout un programme narratif, voire un poème dense et bref) dit ceci : « Les plaies se referment plus ou moins vite et les cicatrices se forment par couches, certaines plus profondes que d’autres ».
Roman poétique et vrai, dramatique et souriant, jonché de signes à déchiffrer, Ör ménage des surprises, en toute simplicité apparente. Une simplicité qui recèle une profonde humanité, comme le reconnaît à demi-mot Jónas : « Je ne peux pas dire à cette jeune femme, qui ne possède rien d’autre que la vie, que je suis perdu ? Ou que la vie a pris un tour différent auquel je ne m’attendais pas ? Mais si je disais : Je suis comme tout le monde, j’aime, je pleure et je souffre, il est probable qu’elle me comprendrait et qu’elle réponde : Je vois ce que vous voulez dire. ».
Jean-Pierre Longre
22:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, islande, auđur ava Ólafsdóttir, catherine eyjólfsson, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/11/2020
L’eau de rose amère de Rosamond
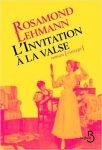 Rosamond Lehmann, L’invitation à la valse, traduit de l’anglais par Jean Talva, Belfond, 2020
Rosamond Lehmann, L’invitation à la valse, traduit de l’anglais par Jean Talva, Belfond, 2020
Dès le premier chapitre, la description progressive de la maison Curtis campe l’atmosphère particulière du roman, faite d’un mélange de romantisme illusoire et d’analyse sociale sans concessions ; atmosphère particulière et légèrement mystérieuse. « Tout est sage, banal, conventionnel, et même un peu guindé. […] Pourtant on n’en peut méconnaître le pouvoir fascinateur, ignorer les suggestions. Quelque chose se passe ici. » De cette famille traditionnelle de la « bonne société » provinciale anglaise, une figure se détache, celle d’Olivia, qui fête ses dix-sept ans et va être invitée, avec sa sœur aînée Kate, à son premier bal.
Une bonne première partie du roman est consacrée à la préparation de ce bal – choix des robes, invitation d’un cousin un peu étrange en guise de cavalier, recommandations maternelles diverses –, le tout au milieu d’une famille attentive mais plus ou moins déclassée socialement. « Il était clair, pour les deux jeunes filles, que leurs parents s’étaient donné beaucoup de peine pour faire de cette soirée en leur honneur un petit événement. » Et commence la réception tant attendue, avec ses espoirs, ses rencontres, les tentatives (plutôt infructueuses) d’Olivia pour remplir son « carnet de bal », les invitations de jeunes (et vieux) hommes… Pour elle, c’est une expérience inédite, et une occasion de s’épanouir, car même si elle est freinée par un complexe d’infériorité (notamment par rapport à sa sœur et à la famille qui reçoit), elle n’est ni naïve ni vraiment timide, et en se frottant au monde elle affermit son caractère.
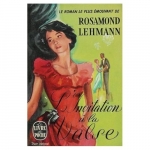 C’est dire que, malgré ce que pourrait laisser croire le sujet, L’invitation à la valse n’est pas un roman à l’eau de rose, ou alors une eau de rose amère et vitaminée ; c’est plutôt un roman initiatique dans lequel Rosamond Lehmann s’adonne aussi à la fine critique d’une certaine société anglaise de l’entre-deux-guerres (nous sommes en 1920). « Dans un petit pays comme Little Compton, on avait à tenir son rang ; il fallait se montrer circonspect, ombrageux, prompt à s’offenser des manques d’égards imaginaires ou des familiarités déplacées. » En outre elle installe une belle galerie de portraits en action, à commencer par celui d’Olivia, et en continuant par ceux de sa sœur, de ses parents, d’un vieil oncle un peu lunatique et, bien sûr, d’un certain nombre d’invités au bal : des jeunes gens de toutes sortes, distingués ou vulgaires, affables ou mufles, sobres ou alcoolisés, séduisants ou laids, parmi lesquels on remarque un attachant jeune père de famille aveugle, un anarchiste légèrement caractériel, un vieillard amateur de jeunes filles… Dans ce monde, Olivia évolue entre admiration et déception. « Il m’est arrivé beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Qu’est-ce donc qui en fait presque de la richesse ? Fragments étranges, méli-mélo de regards, de paroles… En réalité rien, pour moi. Rollo qui me quitte pour Nicole. Rollo et son père qui me sourient. Peter qui pleure et me dit : « Vous êtes mon amie… » Kate qui a l’air si heureuse… Une valse avec Timmy. Marigold dégringolant l’escalier pour courir vers lui. Oui, je peux dire que j’ai passé une bonne soirée. Bien que ma robe… Elle se mit à désirer de toutes ses forces l’obscurité de sa petite chambre, son lit qui l’attendait à la maison. » Par sa complexité, par ses enjeux psychologiques et sociaux, par sa subtilité, par son style enlevé, L’invitation à la valse, dont la première publication date de 1932, est un roman manifestement moderne.
C’est dire que, malgré ce que pourrait laisser croire le sujet, L’invitation à la valse n’est pas un roman à l’eau de rose, ou alors une eau de rose amère et vitaminée ; c’est plutôt un roman initiatique dans lequel Rosamond Lehmann s’adonne aussi à la fine critique d’une certaine société anglaise de l’entre-deux-guerres (nous sommes en 1920). « Dans un petit pays comme Little Compton, on avait à tenir son rang ; il fallait se montrer circonspect, ombrageux, prompt à s’offenser des manques d’égards imaginaires ou des familiarités déplacées. » En outre elle installe une belle galerie de portraits en action, à commencer par celui d’Olivia, et en continuant par ceux de sa sœur, de ses parents, d’un vieil oncle un peu lunatique et, bien sûr, d’un certain nombre d’invités au bal : des jeunes gens de toutes sortes, distingués ou vulgaires, affables ou mufles, sobres ou alcoolisés, séduisants ou laids, parmi lesquels on remarque un attachant jeune père de famille aveugle, un anarchiste légèrement caractériel, un vieillard amateur de jeunes filles… Dans ce monde, Olivia évolue entre admiration et déception. « Il m’est arrivé beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Qu’est-ce donc qui en fait presque de la richesse ? Fragments étranges, méli-mélo de regards, de paroles… En réalité rien, pour moi. Rollo qui me quitte pour Nicole. Rollo et son père qui me sourient. Peter qui pleure et me dit : « Vous êtes mon amie… » Kate qui a l’air si heureuse… Une valse avec Timmy. Marigold dégringolant l’escalier pour courir vers lui. Oui, je peux dire que j’ai passé une bonne soirée. Bien que ma robe… Elle se mit à désirer de toutes ses forces l’obscurité de sa petite chambre, son lit qui l’attendait à la maison. » Par sa complexité, par ses enjeux psychologiques et sociaux, par sa subtilité, par son style enlevé, L’invitation à la valse, dont la première publication date de 1932, est un roman manifestement moderne.
Jean-Pierre Longre
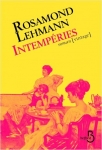 Les éditions Belfond publient en même temps Intempéries, publié pour la première fois en 1936.
Les éditions Belfond publient en même temps Intempéries, publié pour la première fois en 1936.
« Dix ans après L’Invitation à la valse, Olivia a divorcé, mûri, quand son chemin recroise celui de son premier amour. Cèderont-ils à leur passion commune ? Dans ce second volet des aventures d’Olivia Curtis, l’émotion, l’invitation à l’amour, les vertiges de la liberté sont toujours là, mais avec une tonalité plus grave, plus profonde.
Londres, 1930. Dans le train qui la ramène chez ses parents, Olivia Curtis reconnaît immédiatement Rollo Spencer, frère de sa camarade d’enfance Marigold, mais elle hésite à lui adresser la parole. Le riche fils de Lord Spencer a épousé la 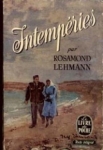 brillante Nicole, elle-même s’est mariée avec Ivor puis l’a quitté en dépit de la réprobation muette des siens et vit maintenant seule à Londres dans une situation financière précaire.
brillante Nicole, elle-même s’est mariée avec Ivor puis l’a quitté en dépit de la réprobation muette des siens et vit maintenant seule à Londres dans une situation financière précaire.
C’est Rollo qui fait les premiers pas, qui renoue avec entrain les liens d’autrefois — et Olivia se laisse reprendre par la fascination qu’exerçait naguère sur elle la famille Spencer. Alors que Rollo souhaite la revoir, alors qu’il dit l’aimer, comment pourrait-elle résister ? Elle sait bien pourtant que rien d’autre n’est possible entre eux que la clandestinité, les coups de téléphone en cachette, les chambres d’hôtels anonymes…
Malgré tout ça, elle se lance. Avec lucidité mais avec aussi cet espoir fou de voir ses rêves de jeunesse se réaliser et l’amour s’offrir à elle ».
18:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, rosamond lehmann, jean talva, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/10/2020
Les merveilles de la décadence
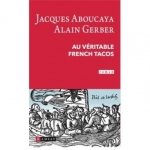 Jacques Aboucaya, Alain Gerber, Au véritable french tacos, Ramsay, 2020
Jacques Aboucaya, Alain Gerber, Au véritable french tacos, Ramsay, 2020
Ganymède et Calixte, deux amis apparemment assez proches pour se répandre en confidences mutuelles, visitent, chacun de son côté, deux pays qui, pour peu qu’on les observe un peu en profondeur, révèlent des mœurs devant lesquelles nos deux « naïfs » ne laissent pas de s’étonner. Un étonnement qui ne va pas, parfois, sans frayeur, et le plus souvent sans émerveillement, à tel point qu’ils se laisseraient volontiers gagner par les coutumes locales. Ganymède (prénom emprunté au jeune mortel qui découvrit le royaume des dieux), donc, explore la Zapockie, et Calixte (le même qui, jadis, fut introduit dans la vie lyonnaise ?), prospecte la Phéraizie, deux contrées qui se ressemblent quelque peu, se complètent même l’une l’autre, tout en laissant prévoir, par les progrès qui s’y manifestent, ceux qui attendent le pays d’origine de nos deux beaux héros, la France.
Quels progrès ? Eh bien, les lettres qu’ils échangent nous en donnent un aperçu sinon exhaustif, du moins aussi abondant qu’éclairant. Disons-le carrément, presque tout y passe en des salves satiriques qui n’épargnent aucun des signes d’une décadence qui « porte le masque du progrès » (George Bernard Shaw, cité en exergue). Les deux compères s’en donnent à cœur joie, tirant à vue sur toutes les tares, tous les abus, toutes les stupidités qui marquent la civilisation moderne. Des exemples ? L’individualisme galopant qui n’empêche pas le grégarisme, le laxisme social et scolaire, l’encouragement à la fainéantise, la délation, le harcèlement, le lynchage public, l’omniprésence des écrans (qui explique, rendez-vous compte, que les bébés naissent avec un pouce démesuré, tant leurs parents ont balayé leurs téléphones portables), la fumisterie des arts contemporains, qu’ils soient plastique, théâtral, musical, gastronomique, télévisuel, le cirque politique qui assimile violence publique et complicité privée, le vain nombrilisme médiatique, on en passe…
Et que dire de la langue utilisée par les autochtones (on n’en attendait pas moins de deux auteurs qui manient avec grande dextérité l’art subtil de l’écriture littéraire) ? Ils dénoncent les mots tronqués devenus « moignons, trognons, quignons, brimborions, déchiquetures verbales » (aphérèses en Phéraizie, apocopes en Zapockie, est-on amené à deviner), les bouillies et borborygmes qui caractérisent les propos mêmes des acteurs de cinéma, comme si « parler trop vite » était « une preuve de dynamisme, d’esprit d’entreprise, de liberté orale et de fécondité intellectuelle. »
Nos deux observateurs ne se lassent pas d’admirer la vie des habitants qu’ils côtoient. Ironie, antiphrase, car sous l’admiration que l’on devine un peu forcée, se glissent les serpents d’une impitoyable critique qui ne va pas sans un humour ravageur. On rit à en pleurer, à la lecture de ces lettres. On rit, car les excès décrits touchent au ridicule. On pleure, car les dits excès mènent les Zapocks et les Phéraizes (et donc à terme, nous, Français et autres Européens) à la ruine de toute civilisation, de toute culture dignes de ces noms. Le « roman » de Jacques Aboucaya et Alain Gerber (dont le mystère du titre peut être levé si l’on va à la page 157), placé sous l’égide de trois humoristes (George Bernard Shaw déjà cité, Pierre Dac et Pierre Desproges), mais aussi, in absentia, de Voltaire, Montesquieu et autres philosophes des Lumières, ce « roman », donc, prête à rire, mais surtout donne à penser. Et puis, si l’on se sent impuissant à corriger les mœurs contemporaines, au moins voilà une prose qui nous fait du bien.
Jean-Pierre Longre
18:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jacques aboucaya, alain gerber, ramsay, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/10/2020
« Qu’étions-nous en train de vivre ? »
 Lire, relire... Lionel Duroy, Eugenia, Julliard, 2018, J'ai lu, 2019
Lire, relire... Lionel Duroy, Eugenia, Julliard, 2018, J'ai lu, 2019
Jeune fille vivant à Jassy (Iaşi en roumain) dans les années 1930, Eugenia a été élevée dans une famille apparemment sans histoires. Mais alors que l’un de ses frères, Stefan, adhère aux idées et aux actions de la Garde de fer, elle découvre grâce à l’un de ses professeurs l’écrivain juif Mihail Sebastian, qu’elle va contribuer à sauver des brutalités d’une bande de jeunes fascistes. Ainsi, au fil du temps et des rencontres, va se nouer avec lui une liaison amoureuse épisodique dans la Bucarest de l’époque, où les épisodes dramatiques n’empêchent pas les récits de festivités mondaines et culturelles.
Autour des relations sentimentales et intellectuelles entre la personne réelle de l’écrivain qui, après avoir échappé aux crimes antisémites, mourra accidentellement en 1945, et le personnage fictif d’une jeune femme qui, devenue journaliste et assistant à la montée du fascisme et du nazisme, va s’impliquer de plus en plus dans la lutte et la Résistance, se déroule l’histoire de la Roumanie entre 1935 et 1945 : les atermoiements du roi Carol II devant les exactions du fascisme dans son pays et l’extension du nazisme en Europe, la prise du pouvoir par Antonescu, l’antisémitisme récurrent, la guerre aux côtés de l’Allemagne contre l’URSS, le retournement des alliances par le jeune roi Michel et les partis antinazis, le sommet de cette rétrospective étant le pogrom de Jassy, auquel Eugenia assiste épouvantée : « Je n’avais plus ma tête en quittant la questure, j’étais abasourdie et chancelante. Qu’étions-nous en train de vivre ? Était-cela qu’on appelait un pogrom ? J’avais beaucoup lu sur celui de Chişinau, en 1903, sans imaginer qu’un tel déchaînement puisse se renouveler un jour. Puisque la chose avait eu lieu, qu’elle avait horrifié le monde entier, elle ne se reproduirait plus. Ainsi pensons-nous, nous figurant que l’expérience d’une atrocité nous prémunit contre sa répétition. ». Avec, comme un refrain désespéré, la question plusieurs fois posée de savoir comment on pouvait « appeler la moitié de la population à tuer l’autre moitié » « dans le pays d’Eminescu, de Creangă et d’Istrati. ».
 Car si Eugenia est un roman historique particulièrement documenté (on sent que Lionel Duroy s’est renseigné aux bonnes sources, qu’il a scrupuleusement enquêté sur place), il s’agit aussi d’un roman psychologique, dans lequel les sentiments, les réactions et les résolutions d’une jeune femme évoluent et mûrissent. Face à l’aberration meurtrière, Eugenia passe de l’indignation naturellement spontanée à la réflexion, à l’engagement et à la stratégie, en essayant par exemple, sous l’influence ambiguë de Malaparte (encore une figure d’écrivain connu que l’on croise à plusieurs reprises), de se mettre dans la peau et dans la tête des bourreaux pour mieux percevoir d’où vient le mal et pour mieux le combattre. Et comme souvent, mais d’une manière particulièrement vive ici, l’Histoire met en garde contre ses redondances, notamment, en filigrane, contre la montée actuelle des nationalismes et le rejet de l’étranger devenu bouc émissaire. Les qualités littéraires d’Eugenia n’occultent en rien, servent même les leçons historiques et humaines que sous-tend l’intrigue.
Car si Eugenia est un roman historique particulièrement documenté (on sent que Lionel Duroy s’est renseigné aux bonnes sources, qu’il a scrupuleusement enquêté sur place), il s’agit aussi d’un roman psychologique, dans lequel les sentiments, les réactions et les résolutions d’une jeune femme évoluent et mûrissent. Face à l’aberration meurtrière, Eugenia passe de l’indignation naturellement spontanée à la réflexion, à l’engagement et à la stratégie, en essayant par exemple, sous l’influence ambiguë de Malaparte (encore une figure d’écrivain connu que l’on croise à plusieurs reprises), de se mettre dans la peau et dans la tête des bourreaux pour mieux percevoir d’où vient le mal et pour mieux le combattre. Et comme souvent, mais d’une manière particulièrement vive ici, l’Histoire met en garde contre ses redondances, notamment, en filigrane, contre la montée actuelle des nationalismes et le rejet de l’étranger devenu bouc émissaire. Les qualités littéraires d’Eugenia n’occultent en rien, servent même les leçons historiques et humaines que sous-tend l’intrigue.
Jean-Pierre Longre
23:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, lionel duroy, julliard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/09/2020
Une Europe sens dessus dessous
 Laurent Binet, Civilizations, Grasset, 2019, Le livre de poche, 2020
Laurent Binet, Civilizations, Grasset, 2019, Le livre de poche, 2020
Quatre fictions d’inégale longueur mais d’égale intensité jubilatoire composent le livre. « La saga de Freydis Eriksdottir » relate l’expédition que celle-ci (fille d’Erik le Rouge, comme son nom l’indique) fit au Xème siècle depuis le Groenland jusque vers le sud américain, devançant Christophe Colomb, auquel le deuxième épisode est consacré, nous livrant des fragments de son journal, selon lequel on devine que l’explorateur mourut, seul européen rescapé au milieu des indigènes, sur l’île de Cuba : « L’heure approche où mon âme va être rappelée à Dieu, et si je suis sans doute déjà oublié de l’autre côté de la mer Océane, je sais qu’il est au moins une personne qui se soucie encore de l’amiral déchu, et que la petite Higuénamota, qui sera reine un jour, ma dernière consolation ici-bas, sera auprès de moi pour me fermer les yeux. »
 Justement, la petite Higuénamota, on la retrouve adulte dans la troisième partie – le plus gros morceau de cette uchronie épique. À l’inverse de ce que nous ont appris les manuels, les Incas, après une guerre intestine, débarquent en Europe sous la direction d’Atahualpa qui montera sur le trône de Charles Quint, se frottera aux rivalités politiques et religieuses, apportera une forme de sérénité tolérante dans les relations humaines, bref imposera sa vision civilisatrice à un monde de violence et de cruauté tout en assurant un commerce prospère avec son continent d’origine. Un nombre incalculable de péripéties – dont la moindre n’est pas l’arrivée en Europe des « Mexicains » qui investissent le royaume de France – émaillent un récit aux ramifications politiques et internationales complexes, où les unions entre familles européennes et américaines offrent de nobles et fructueux métissages. Un exemple parmi d’autres : Quizquiz, général inca, à qui est dévolu le pouvoir sur une bonne partie de l’Italie, « épousa Catherine de Médicis, qui était la veuve d’Henri, fils de François Ier, laquelle lui donna neuf enfants. »
Justement, la petite Higuénamota, on la retrouve adulte dans la troisième partie – le plus gros morceau de cette uchronie épique. À l’inverse de ce que nous ont appris les manuels, les Incas, après une guerre intestine, débarquent en Europe sous la direction d’Atahualpa qui montera sur le trône de Charles Quint, se frottera aux rivalités politiques et religieuses, apportera une forme de sérénité tolérante dans les relations humaines, bref imposera sa vision civilisatrice à un monde de violence et de cruauté tout en assurant un commerce prospère avec son continent d’origine. Un nombre incalculable de péripéties – dont la moindre n’est pas l’arrivée en Europe des « Mexicains » qui investissent le royaume de France – émaillent un récit aux ramifications politiques et internationales complexes, où les unions entre familles européennes et américaines offrent de nobles et fructueux métissages. Un exemple parmi d’autres : Quizquiz, général inca, à qui est dévolu le pouvoir sur une bonne partie de l’Italie, « épousa Catherine de Médicis, qui était la veuve d’Henri, fils de François Ier, laquelle lui donna neuf enfants. »
Moins complexes mais bien mouvementées aussi, « Les aventures de Cervantès » (quatrième partie) s’insinuent dans l’histoire collective, et l’auteur n’hésite pas à fomenter une belle rencontre, à Bordeaux, entre le futur auteur de Don Quichotte et « Monsieur de Montaigne », qui lui offre l’hospitalité dans sa tour, où les discussions vont bon train et où la femme du Français ne laisse pas l’Espagnol indifférent…
À lire ces résumés, on pourrait croire que l’imagination de Laurent Binet tourne au débridé, voire au farfelu. Il n’en est rien. Tout est maîtrisé, fondé sur une connaissance érudite de l’Histoire et des personnages qui l’ont faite. Allusions, citations, références accrochent la narration à un réel dont on se dit qu’il peut être facilement transformé, renversé par telle péripétie, tel changement de détail. Malicieuse leçon historico-philosophique donc, mais aussi belle leçon littéraire : la succession des genres (récit, correspondance, journal, poésie…) et des tonalités souvent parodiques donne une coloration séduisante à une œuvre à la lecture de laquelle on se prend à penser (outre Cervantès et Montaigne) à Voltaire, à Montesquieu et à bien d’autres plumes du passé. Mais c’est bien du Laurent Binet.
Jean-Pierre Longre
19:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent binet, grasset, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/09/2020
L’enfer de Rose
 Franck Bouysse, Né d’aucune femme, La manufacture de livres, 2019, Le livre de poche, 2020
Franck Bouysse, Né d’aucune femme, La manufacture de livres, 2019, Le livre de poche, 2020
Aînée des quatre filles d’un couple de paysans miséreux, Rose, 14 ans, a été vendue par son père aux abois à un « maître de forges » qui, avec sa mère, règne en despote cynique sur son domaine, ses chiens, ses chevaux et son rare personnel, et qui cache sa femme, prétendument malade, dans une chambre close de sa vaste maison. Rose s’habituerait tant bien que mal à sa nouvelle vie de servante, s’il n’y avait le regard cruel et sournois de la vieille femme, et la brutalité sans scrupules du maître, qui va se mettre à violer régulièrement la jeune fille.
 On comprend rapidement que ce qui guide l’homme et sa mère est la volonté d'assurer une descendance à la famille, de perpétuer le nom et la propriété. Alors les drames vont s’accumuler : les remords et l’assassinat sordide du père de Rose, les découvertes de celle-ci, qui trouve un fugace répit auprès du palefrenier Edmond (personnage dont l’importance va peu à peu se révéler), les incursions dans la vie de la mère privée de sa fille aînée et de son mari, et qui va tenter de survivre avec ses trois autres filles, l’acte désespéré qui va mener la jeune fille, sous la houlette d’un médecin corrompu, à l’asile où on lui enlève de force l’enfant qu’elle met au monde et où elle va rester enfermée des années… Pathétique des événements, pathétique de la narration : « Six jours. On m’a laissé mon bébé pendant six jours. Six jours, lui et moi. Mon bébé, rien qu’à moi. C’était loin de faire la vie que je voulais avec lui. Rien que six petits jours. Le septième après la naissance, ils sont tous entrés dans le silence. Il y avait le docteur, deux infirmiers, et la vieille. […] Le docteur s’est approché de la vieille. Il s’est penché sur le berceau et il a attrapé mon petit qui dormait. J’ai senti mon cœur qui cherchait à sortir de ma poitrine. J’ai voulu sauter sur le docteur, mais l’infirmier m’a plaquée sur le lit, et le deuxième a commencé à m’attacher avec les sangles, sans que je puisse rien faire contre eux ».
On comprend rapidement que ce qui guide l’homme et sa mère est la volonté d'assurer une descendance à la famille, de perpétuer le nom et la propriété. Alors les drames vont s’accumuler : les remords et l’assassinat sordide du père de Rose, les découvertes de celle-ci, qui trouve un fugace répit auprès du palefrenier Edmond (personnage dont l’importance va peu à peu se révéler), les incursions dans la vie de la mère privée de sa fille aînée et de son mari, et qui va tenter de survivre avec ses trois autres filles, l’acte désespéré qui va mener la jeune fille, sous la houlette d’un médecin corrompu, à l’asile où on lui enlève de force l’enfant qu’elle met au monde et où elle va rester enfermée des années… Pathétique des événements, pathétique de la narration : « Six jours. On m’a laissé mon bébé pendant six jours. Six jours, lui et moi. Mon bébé, rien qu’à moi. C’était loin de faire la vie que je voulais avec lui. Rien que six petits jours. Le septième après la naissance, ils sont tous entrés dans le silence. Il y avait le docteur, deux infirmiers, et la vieille. […] Le docteur s’est approché de la vieille. Il s’est penché sur le berceau et il a attrapé mon petit qui dormait. J’ai senti mon cœur qui cherchait à sortir de ma poitrine. J’ai voulu sauter sur le docteur, mais l’infirmier m’a plaquée sur le lit, et le deuxième a commencé à m’attacher avec les sangles, sans que je puisse rien faire contre eux ».
Toutes les péripéties de la vie de Rose, tous les retournements de situation, toutes les surprises du récit sont relatés par l’intermédiaire d’un prêtre qui a retranscrit le journal de la jeune femme, trouvé à la suite d’un concours de circonstances, et qui s’est pris d’affection pour elle, « cette femme que je n’ai jamais rencontrée de ma vie, mais dont il me semble pourtant tout connaître, cette femme avec qui je n’ai pas fini de cheminer, avec qui je n’en aurai jamais fini ». À ce journal s’ajoutent les points de vue et les histoires d’autres personnages (le père, la mère, l’enfant, le prêtre, Edmond…), ce qui donne à l’ensemble une dimension chorale, parfaitement maîtrisée par l’habileté narrative de l’auteur. Et le lecteur, accroché à cette description d’un enfer à la fois inhumain et réaliste, d’un enfer qui, toutes différences faites, est comparable à ceux que Zola a peints, le lecteur, donc, qui ne peut qu’aller jusqu’au bout de l’histoire de Rose, n’en sort pas indemne.
Jean-Pierre Longre
Rencontre avec l'auteur le 30 septembre 2020 à la Librairie du Tramway, Lyon. Voir ici
10:16 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, franck bouysse, la manufacture de livres, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/09/2020
Édicule tous azimuts

Jean Rouaud, Kiosque, Grasset, 2019, Points, 2020
En 1990, le Prix Goncourt fut attribué à Jean Rouaud pour son premier roman, Les champs d’honneur. Mais pendant la gestation de l’œuvre, et en attendant que s’accomplisse le destin littéraire, il fallait bien vivre. C’est ainsi que l’auteur tint pendant sept ans un kiosque de presse dans le quartier populaire de la rue de Flandre, sous la houlette d’un certain P., anarchiste reconverti dans le commerce, grand buveur à la méticulosité de comptable, altruiste aux colères mémorables.
Des personnages hauts en couleurs, il y en en abondance, autour du kiosque, qui viennent acheter leur journal préféré, ou simplement s’occuper à des discussions animées. L’occasion pour l’auteur de dresser des portraits pittoresques (ceux d’un certain Norbert, d’un certain Chirac – qui attend vainement un logement de la ville de Paris – et de beaucoup d’autres) issus d’une observation acérée, amusée, pleine de sympathie, et pour le futur écrivain d’exercer sa plume en évoquant des scènes de la vie quotidienne, en des « instantanés » en forme de haïkus. « Un lecteur de La Croix / Se devrait /De dire merci. » ; « Avec son accent parigot / Tatave salue / Le doigt sur sa casquette. » « Il était à la première / De la jeune Maria Callas / Dans les arènes de Vérone. ». Etc.
 De quoi s’entraîner à la rigueur, combattre le « cancer du lyrisme » pour privilégier le « réalisme » (invocations à Flaubert), appliquer « les préceptes d’ordonnancement de P. à mes phrases qui avaient aussi tendance à zigzaguer ». Le kiosque n’est pas seulement un lieu de vente, de rencontres et d’observation, mais le point de départ de la création, s’épanouissant au milieu des pages imprimées. L’habitacle serré, confiné, donne à voir tout un monde : celui, infini, que les journaux décrivent, celui du quartier, de Paris, de l’humanité tout entière contenue dans les silhouettes qui gravitent autour. Rien n’est fini : le livre lui-même figure l’édicule ouvert sur des sujets tous azimuts, à propos par exemple des constructions du Paris contemporain (Beaubourg, la Pyramide du Louvre), du concept de modernité, des guerres nouvelles et anciennes (celle de 1914, notamment, qui fit mourir Joseph Rouaud et naître Les champs d’honneur, Prix Goncourt), de la littérature, bien sûr, avec ses exigences et ses mystères.
De quoi s’entraîner à la rigueur, combattre le « cancer du lyrisme » pour privilégier le « réalisme » (invocations à Flaubert), appliquer « les préceptes d’ordonnancement de P. à mes phrases qui avaient aussi tendance à zigzaguer ». Le kiosque n’est pas seulement un lieu de vente, de rencontres et d’observation, mais le point de départ de la création, s’épanouissant au milieu des pages imprimées. L’habitacle serré, confiné, donne à voir tout un monde : celui, infini, que les journaux décrivent, celui du quartier, de Paris, de l’humanité tout entière contenue dans les silhouettes qui gravitent autour. Rien n’est fini : le livre lui-même figure l’édicule ouvert sur des sujets tous azimuts, à propos par exemple des constructions du Paris contemporain (Beaubourg, la Pyramide du Louvre), du concept de modernité, des guerres nouvelles et anciennes (celle de 1914, notamment, qui fit mourir Joseph Rouaud et naître Les champs d’honneur, Prix Goncourt), de la littérature, bien sûr, avec ses exigences et ses mystères.
Jean-Pierre Longre
www.editionspoints.com
20:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, jean rouaud, kiosque, grasset, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/08/2020
Avec les « corps errants »
 Jean-Pierre Martin, Mes fous, Éditions de l’Olivier, 2020
Jean-Pierre Martin, Mes fous, Éditions de l’Olivier, 2020
La famille de Sandor, vue de loin, ne sort pas des normes sociales actuelles. Une femme dont il est séparé mais avec laquelle les relations restent solidairement stables, quatre enfants harmonieusement échelonnés. Sauf que… Sa fille Constance souffre d’une folie qui le ronge perpétuellement ; quant à ses fils, l’un est addict aux écrans, un autre s’est mis en tête de « sauver la planète », et le dernier « est tellement adapté au monde qu’il s’est préservé de la profondeur comme de l’angoisse. » Bref, « nos enfants se sont mis sérieusement à dérailler les uns après les autres autour de la vingtaine, enfin au moins trois des quatre. » Quant à Sandor lui-même, qui a sans doute hérité de la mélancolie de son père, il est comme un aimant pour les fous, qui l’abordent dans les lieux publics comme s’il était l’un des leurs, et pour qui il ressent une sincère affection (« Mes fous », clame le titre).
Son récit est rythmé par ces rencontres dans les rues de Lyon, par les conversations parfois déroutantes qu’il a avec ceux qu’il appelle les « corps errants », et par l’épreuve que représentent pour lui l’état et les délires de Constance. Une « étrange coïncidence » lui permet de revoir avec plaisir Rachel, qui avait été étudiante avec lui, et dont le frère est lui aussi plongé dans la folie. « Avec Rachel, on s’est dit d’un commun accord : il y a deux catégories de personnes, celles qui ont eu affaire à la folie de près, et les autres. Je me suis trouvé une sœur de détresse. »
La folie est-elle un sujet de littérature ? Sans doute. Sandor assiste à un colloque universitaire intitulé « Littérature et folie » (l’occasion de légères pointes humoristiques) ; et les pages de son récit sont pleines d’allusions et de références à des personnages et à des écrivains qui ont eu à voir avec « le désordre mental ». Les surréalistes bien sûr (avec Nadja de Breton au premier plan), et aussi Artaud, Hölderlin, Flaubert, Balzac, Romain Gary etc. Il y a aussi la musique (il écoute et joue du Schumann, « rien que du Schumann », comme par hasard). On pourrait penser que, de même que Queneau a farci son roman Les enfants du limon d’extraits substantiels de son étude sur les « fous littéraires », de même Jean-Pierre Martin (fin connaisseur et adepte lucide du dit Queneau) a bâti une belle fiction qui lui permet de s’exprimer ouvertement sur la folie, en évitant les circonvolutions langagières de la philosophie et de la psychiatrie. Et il n’y a pas que cela. Il y a la vie, dont le retrait du monde (retrait mental ou physique) permet d’appréhender la vraie substance. « Notre vie est à la fois précaire et infinie. Il y a quelque chose d’enivrant dans cette histoire de fin du monde. C’est une occasion à saisir pour les âmes blessées. Pendant tous ces mois, j’ai de fait survécu. Je vais continuer à survivre, mais dans un autre sens. Je ne me soucie plus seulement de mes proches, de la folie dévastatrice ou des humains en général. Mon empathie s’étend à l’univers. ».
Jean-Pierre Longre
12:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-pierre martin, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/08/2020
Les rôles et les quêtes de Jamal
 Christian Cogné, Vaisseau Humanité 2.0, Kyklos Éditions, 2020
Christian Cogné, Vaisseau Humanité 2.0, Kyklos Éditions, 2020
« Nour doit être une belle jeune fille à présent, songeait-il, ma douce, ma tendre, ma petite branche en fleurs d’amandier… ». Jamal, metteur en scène renommé, engagé dans les manifestations de l’opposition syrienne, a été emprisonné et torturé dans les geôles du pouvoir, puis libéré par l’Armée syrienne libre. Il va alors parcourir la Syrie en quête de sa fille disparue, peut-être réfugiée à l’étranger, et faire diverses rencontres au milieu des ruines du pays.
Parmi ces rencontres, il y a Tala, reporter pour The Guardian, qui va l’encourager et tenter de l’aider dans sa recherche. Il y a son frère Tarek, qui l’entraîne dans des missions anti-sniper et qui considère la quête de Jamal avec étonnement. Il y a Majd, ancien codétenu, astrophysicien et professeur à l’Université, dont la silhouette bizarre apparaît périodiquement dans le récit, dont on disait aussi qu’il avait été « enlevé à bord d’un vaisseau spatial », et qui passe son temps à lancer en l’air des boîtes métalliques… Il y a beaucoup d’autres rencontres de personnages plus ou moins honorables, plus ou moins scrupuleux, plus ou moins violents, dont la guerre et la misère révèlent le vrai visage, les vraies valeurs et les vraies bassesses.
La personnalité et la culture de Jamal permettent à l’auteur et au lecteur de dépasser le seul récit de guerre, de destruction et de quête familiale, et d’évoquer les leçons du théâtre shakespearien, entre autres : « Et s’il avait rejoint lui aussi le monde nocturne des personnages de Shakespeare ? Le songe d’une nuit d’été suggérait aux spectateurs syriens qu’il y a quelque chose de merveilleux dans le réel, que l’homme n’est pas sauvé par une religion abrutissante mais par l’émerveillement d’être simplement au monde. Sans Dieu, avec seulement l’amour de l’Autre dans son cœur. Cette leçon-là, il la devait principalement à sa mère ». Et si le livre nous éclaire sur l’enfer syrien, sur un pays et une population pris dans les brutalités de la dictature et de ses alliés, minés par les cruautés de Daech et les destructions des cultures anciennes, il nous donne à voir la complexité de la destinée humaine grâce à un protagoniste, homme de théâtre qui se cherche lui-même à travers les rôles qu’il a l’impression de jouer : « À cet instant il ne sut à quoi il pouvait ressembler. À un Syrien égaré ? Un fugitif ? Un metteur en scène au chômage ? Un intellectuel, un artiste incapable de comprendre le peuple […] ? Un type qui avait perdu la mémoire et peut-être l’esprit ? Ou encore un « enlevé » selon la définition de Majd ? Aucun moyen de le savoir. Aucun moyen de connaître ce que les gens assis dans le bus pouvaient penser de lui. ». Dans le bus, et dans le « Vaisseau Humanité ».
Jean-Pierre Longre
Précision: Les droits d'auteur seront versés au bénéfice d'une association de secours au peuple syrien.
16:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, christian cogné, kyklos Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/07/2020
Périple tous azimuts
 Pierre Jourde, Le voyage du canapé-lit, Gallimard, 2019, Folio, 2020
Pierre Jourde, Le voyage du canapé-lit, Gallimard, 2019, Folio, 2020
« On n’allait pas le laisser perdre », ce « canapé-lit » hérité de la grand-mère aussi pingre que méchante, mais dont la fille, dans un geste de « piété filiale », veut garder ce vétuste témoignage mobilier. La fille en question – la mère de l’auteur – charge donc ses deux fils de transporter l’encombrant objet de Créteil à Lussaud, « pays perdu » en pleine Auvergne, que les lecteurs de Pierre Jourde connaissent déjà (voir ici), et où le dernier étage de la maison familiale attend d’être meublé.
Pierre, Bernard et Martine, la femme de celui-ci, embarquent donc le canapé (plus deux fauteuils assortis) dans une camionnette, et alors commence un voyage de quelques heures, qui en réalité va s’étaler, par la magie des conversations, des souvenirs et même des anticipations, sur un grand nombre d’années. Aux paysages et localités traversés vont se superposer les espaces lointains, les aventures inattendues, les coups du sort désopilants, les péripéties inénarrables (et pourtant narrées) vécues par deux hommes qui, dans leur jeunesse, étaient plutôt incontrôlables et faisaient le désespoir (indulgent, disons-le) de leurs parents. Sous une autre plume, c’eût été un road-movie franchouillard doublé d’une autoanalyse égocentrée (le canapé aidant, bien sûr). Sous celle de Jourde, cela devient une épopée burlesque, un festival d’anecdotes tragicomiques et de considérations satiriques, placés sous les signes variés de Rabelais (pour la scatologie, par exemple), de Diderot et Sterne (pour la complicité entre l’auteur et le lecteur), de Jerome K Jerome (pour l’humour absurde), sans parler de la vigueur stylistique d’un écrivain qui ne recule pas devant les confidences personnelles et familiales, tout en gardant, à la différence de ses cibles favorites, assez de recul pour les mettre à une bonne distance littéraire et critique et pour cultiver l’autodérison raisonnable.
 Les péripéties, aventures et anecdotes ne seront pas reprises ici, elles perdraient toute leur saveur. Voyons tout de même quelques titres de chapitres mystérieusement prometteurs : « La boule Quies qui tue, la sacoche piégée, la bouteille de Coca ravageuse, le bidon tentaculaire, la marinière équivoque… ». De quoi mettre en bonne condition le lecteur, qui se perdra avec délices dans « ce foutoir narratif ». Et qui, pour finir, s’apercevra que le périple du canapé, après maints détours, converge vers un beau chant d’amour pour la mère, « Mme Jourde ».
Les péripéties, aventures et anecdotes ne seront pas reprises ici, elles perdraient toute leur saveur. Voyons tout de même quelques titres de chapitres mystérieusement prometteurs : « La boule Quies qui tue, la sacoche piégée, la bouteille de Coca ravageuse, le bidon tentaculaire, la marinière équivoque… ». De quoi mettre en bonne condition le lecteur, qui se perdra avec délices dans « ce foutoir narratif ». Et qui, pour finir, s’apercevra que le périple du canapé, après maints détours, converge vers un beau chant d’amour pour la mère, « Mme Jourde ».
Jean-Pierre Longre
16:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, pierre jourde, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/06/2020
"La vie mode d’emploi" sous le Second Empire
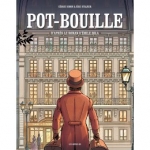 Cédric Simon & Éric Stalner, Pot-Bouille, d’après le roman d’Émile Zola, Les Arènes BD, 2020
Cédric Simon & Éric Stalner, Pot-Bouille, d’après le roman d’Émile Zola, Les Arènes BD, 2020
Dixième roman de la série des Rougon-Macquart, Pot-Bouille, publié en 1883, décrit la vie d’un immeuble parisien dont la belle façade haussmanienne ne cache pas longtemps un « envers du décor » peu reluisant : rivalités, arrivisme, mesquineries, intrigues financières et amoureuses… C’est ce que découvre Octave Mouret en emménageant dans une chambre du quatrième étage (la montée d’étage en étage correspond à une descente dans la hiérarchie sociale). Le jeune homme a justement pour ambition de s’élever dans cette hiérarchie, si possible en séduisant une femme de la « bonne société ». Ce faisant, il s’insinue dans la bourgeoisie commerçante, dont le récit analyse sans concessions les faits, gestes, préoccupations et intentions.
 De ce roman, Cédric Simon et Éric Stalner ont tiré une bande dessinée qui traduit pleinement le « naturalisme » dont se réclamait l’écrivain. Les plaisirs, les turpitudes, les élans, les tromperies, les colères, la violence même se manifestent en images où s’épanouit la satire. Octave Mouret, au centre du ballet, fait figure de héros charmeur et sans scrupules, et il tirera bien son épingle du jeu, un jeu dont la suite sera décrite dans Au Bonheur des Dames… Certes, la morale en prend un coup, et ce sont les servantes, devisant d’une fenêtre à l’autre dans la cour, qui la tirent : « Comme j’aimerais quitter cette baraque ! On y devient malhonnête malgré soi ! » / « Celle-ci ou une autre, toutes les baraques se ressemblent ! » / « C’est vrai… » / « C’est toujours pareil… C’est cochon et compagnie !... ».
De ce roman, Cédric Simon et Éric Stalner ont tiré une bande dessinée qui traduit pleinement le « naturalisme » dont se réclamait l’écrivain. Les plaisirs, les turpitudes, les élans, les tromperies, les colères, la violence même se manifestent en images où s’épanouit la satire. Octave Mouret, au centre du ballet, fait figure de héros charmeur et sans scrupules, et il tirera bien son épingle du jeu, un jeu dont la suite sera décrite dans Au Bonheur des Dames… Certes, la morale en prend un coup, et ce sont les servantes, devisant d’une fenêtre à l’autre dans la cour, qui la tirent : « Comme j’aimerais quitter cette baraque ! On y devient malhonnête malgré soi ! » / « Celle-ci ou une autre, toutes les baraques se ressemblent ! » / « C’est vrai… » / « C’est toujours pareil… C’est cochon et compagnie !... ».
La fin de l’album est consacrée à un dossier de Philippe Mellot, très documenté et richement illustré, sur la transformation de Paris par les « grands travaux d’Haussmann » (non dénués bien sûr d’intentions politiques), sur le « quartier des déshérités et ouvriers », et sur « un immeuble des quartiers populaires au temps de Pot-Bouille ». Dessins et photos d’époque livrent des scènes vivantes, réalistes et cocasses de la vie d’« une maison à Paris ». De quoi imaginer, dans un souci d’exhaustivité, des existences méconnues, comme le fera Georges Perec dans La vie mode d’emploi.
Jean-Pierre Longre
18:54 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, roman, francophone, cédric simon, Éric stalner, philippe mellot, Émile zola, les arènes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/06/2020
« Nous sommes simplement de passage »
 Laurine Roux, Une immense sensation de calme, Les éditions du Sonneur, 2018, Folio, 2020. Prix SGDL Révélation 2018
Laurine Roux, Une immense sensation de calme, Les éditions du Sonneur, 2018, Folio, 2020. Prix SGDL Révélation 2018
Sur une terre à la sauvagerie sibérienne vivent tant bien que mal les descendants des rescapés d'une guerre qui n'a laissé que des femmes et quelques enfants devenus des "Invisibles", aveuglés par les gaz toxiques et élevés parmi les ours. Depuis, le "Grand Oubli" avait tenté d'effacer les souvenirs, pourtant restés gravés dans la mémoire des vieilles femmes. C'est dans ce monde que vit la narratrice, jeune fille errante qui, réfugiée chez des pêcheurs, rencontre un jour Igor : « Lorsqu'il descend de la falaise, Igor s'approche de moi. Tout près. Il me regarde sans un mot. Le bleu délavé de ses yeux a l'acuité du métal, mais il est surtout immense, comme si un bout du ciel s'était détaché pour tomber là en deux petites taches rondes et azurées. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, si cet homme me regarde ou voit au-delà, je sens juste mon pouls battre à tout rompre et ma tête se remplir d'un liquide bleuté noyant, au-delà de mes pensées, toute ma personne. ».
 C'est avec lui qu'elle va parcourir le pays jusqu'à ses confins, jusqu'à la mer, jusqu'à comprendre que « le temps n’est qu’une succession d’effondrements à l’infini » et que les humains, passagers de l’histoire ou de la légende, ne font qu’un avec les éléments. À l’intérieur du trajet narratif principal se glissent une série d’aventures qui le soutiennent, qui le nourrissent, histoires vécues ou légendes transmises. Malgré les promesses du « Grand Oubli », le passé ressurgit : la mort de la grand-mère Baba, les épisodes de la guerre qui a créé les « Invisibles », l’histoire de la vieille Grisha et du Dresseur d’ours qu’elle a connu dans sa jeunesse, liée à celle des Tsiganes, de la Tochka et de Tochko… Tout se rejoint dans la tradition des contes merveilleux et cruels, dans lesquels le bonheur et le malheur, la bonté et la méchanceté ne vont pas les uns sans les autres.
C'est avec lui qu'elle va parcourir le pays jusqu'à ses confins, jusqu'à la mer, jusqu'à comprendre que « le temps n’est qu’une succession d’effondrements à l’infini » et que les humains, passagers de l’histoire ou de la légende, ne font qu’un avec les éléments. À l’intérieur du trajet narratif principal se glissent une série d’aventures qui le soutiennent, qui le nourrissent, histoires vécues ou légendes transmises. Malgré les promesses du « Grand Oubli », le passé ressurgit : la mort de la grand-mère Baba, les épisodes de la guerre qui a créé les « Invisibles », l’histoire de la vieille Grisha et du Dresseur d’ours qu’elle a connu dans sa jeunesse, liée à celle des Tsiganes, de la Tochka et de Tochko… Tout se rejoint dans la tradition des contes merveilleux et cruels, dans lesquels le bonheur et le malheur, la bonté et la méchanceté ne vont pas les uns sans les autres.
Inséparable des personnages et de la narration, la présence de la nature, sans laquelle rien ni personne ne vivrait, une nature sublimée par le style âpre, sensuel et poétique de l’auteure : « Un rai de lune perce à travers les volets. Le feu s’est éteint. Tochko ronfle. Dans son sommeil, Igor semble moins agité. […] Nous parcourons la campagne, traversons les forêts, suivons les crêtes marneuses, longeons les rives du lac, et pendant tout ce temps notre vigueur reste en son enfance. Je suis une enfant qui fait l’amour avec Igor, mais aussi avec la forêt, le lac, les hirondelles du printemps, les grives de l’automne, qui se laisse choisir par la jouissance, les bras ouverts et la bouche continûment humide. Je crois pouvoir dire que nous sommes beaux. Chaque seconde explose en fruit gorgé, chaque jour est l’orée d’un commencement. ». Ainsi se construit un monde où se rejoignent le passé et le présent, le réel et le mythe, les tourments et cette « sensation de calme » annoncée par le titre et incarnée par Grisha : « Un instant sa beauté d’antan irradie le masque plissé de la vieillesse. Derrière le cuir et les rides, par-delà l’affaissement, on entraperçoit le visage clair comme l’eau de source, chantant et limpide, de la jeune fille qui s’éveille au désir. ».
Jean-Pierre Longre
18:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurine roux, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/05/2020
« Toucher une autre étoile »
 Auður Ava Ólafsdóttir, Miss Islande, traduit de l’islandais par Éric Boury, Zulma, 2019. Prix Médicis étranger 2019.
Auður Ava Ólafsdóttir, Miss Islande, traduit de l’islandais par Éric Boury, Zulma, 2019. Prix Médicis étranger 2019.
Hekla, 21 ans en 1963, jeune islandaise à qui son père a donné le nom d’un volcan, a décidé de mener à bien sa vocation d’écrivain et dans cette perspective de quitter la ferme familiale pour s’installer à Reykjavík, où en dépit (ou à cause) de l’isolement du pays à cette époque fleurissent les librairies, les bibliothèques, les cercles littéraires… Elle y retrouve sa grande amie Ísey, mariée et mère d’une petite fille, dont l’avenir assumé est celui d’une femme installée dans le mariage et la maternité, mais qui écrit son journal en cachette et qui sait bien ce qui attend son amie : « J’ai toujours su que tu deviendrais écrivain, Hekla. Tu te souviens, quand on avait six ans et que tu as noté dans un cahier, de ton écriture enfantine, que la rivière avançait comme le temps ? Et que l’eau était froide et profonde ». Hekla va s’installer avec Jón John, autre ami très cher, mal vu et maltraité par ses collègues pêcheurs parce qu’il est homosexuel. « Je ne rentre dans aucune catégorie, Hekla. Je suis un accident qui n’aurait jamais dû voir le jour. Je n’arrive pas à trouver ma place. Je ne sais pas d’où je viens. Cette terre n’est pas la mienne. Je ne la connais pas sauf quand on m’y enfonce le visage. Je sais le goût de la poussière ».
La beauté d’Hekla lui vaut d’être harcelée par un organisateur du concours de Miss Islande – ce qui n’intéresse pas du tout la jeune fille. Sa vie se partage entre un emploi de serveuse pour vivre, la lecture, l’écriture, l’amitié, et bientôt l’amour de celui qu’elle appelle « le poète », employé de bibliothèque et très assidu à la fréquentation des cafés où se retrouvent plusieurs de ses semblables prompts à se donner le titre de poète sans produire un seul recueil… Il se rend compte tout de même que c’est sa petite amie qui est la vraie plume du couple, et elle ne le détrompe pas, revendiquant le droit pour les femmes de s’adonner à l’écriture littéraire : « C’est moi qui ai la baguette de chef d’orchestre. J’ai le pouvoir d’allumer une étoile sur le noir de la voûte céleste. Et celui de l’éteindre. Le monde est mon invention ». Elle rejoindra finalement son ami Jón John au Danemark pour prendre avec lui son élan artistique, s’éloigner de l’hiver insulaire, partir « vers le sud », « si loin du champ de bataille du monde ».
Décrivant le destin littéraire d’une jeune femme qui veut élargir son horizon, Miss Islande (titre porteur non seulement d’ironie, mais aussi de promesses de beauté autres que la simple beauté physique), écrit à la première personne, met en scène romanesque son propre sujet. L’œuvre projetée par Hekla se déroule sous nos yeux, et ainsi s’accomplit son projet, sous la forme d’un roman poétique (une poésie qui s’affirme dans les intitulés mêmes des courts chapitres dont il est composé), un roman où les soucis de la vie quotidienne, les vues de la nature, l’amitié, l’amour, l’attention aux autres se combinent esthétiquement avec l’émotion artistique, et où s’accomplit le « rêve d’un autre lieu, pour toucher une autre étoile ».
Jean-Pierre Longre
19:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, islande, auður ava Ólafsdóttir, Éric boury, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/04/2020
« Composer avec le réel »
 Clarisse Gorokhoff, Les Fillettes, Équateurs, 2019
Clarisse Gorokhoff, Les Fillettes, Équateurs, 2019
Rebecca est une jeune femme vive, originale, cultivée, généreuse, qui vit dans l’amour de son mari Anton et de leurs trois filles encore petites : Justine, l’aînée, qui « a réponse à tout », Laurette et ses « grands yeux qui s’ouvrent sur le monde avec indolence », et Ninon, qui est encore un bébé. « Ses fillettes sont des bombes à retardement mais Rebecca les aime par-dessus tout ». Tout pour être heureuse ? Les apparences sont trompeuses : Rebecca se drogue depuis son jeune âge, et l’alcool est venu aggraver les choses. Malgré le dévouement indéfectible de son mari, la présence épisodique mais affectueuse de sa belle-mère ou de sa sœur, et la joie que lui procurent ses enfants, elle a du mal à « composer avec le réel », à être levée pour emmener ses filles à l’école, à être à l’heure pour aller les chercher, à trouver un travail…
Fondée sur les souvenirs de l’une de ses filles, l’histoire de Rebecca et de sa famille est structurée en courts épisodes adoptant tour à tour les points de vue de chaque personnage, adultes et enfants. Cette alternance narrative donne un récit tantôt gai tantôt tragique, plein de douceur ou d’amertume – car la vie, on le sait, est complexe. D’ailleurs les allusions à Queneau (la famille habite impasse Raymond Queneau, et une vieille femme pittoresque se fait appeler Zazie) ont sans doute quelque chose à voir avec le « pleurire » du Dimanche de la vie… Les fillettes se doutent bien parfois que « Maman est bizarre », et cette bizarrerie leur vaut des déboires à l’école et ailleurs, mais la vie avec elle est si joyeuse, malgré ses périodes d’absence aux autres, de regard étrange et de « manque ».
Les Fillettes est un roman attachant, solidement soutenu par la sincérité de l’amour et de l’émotion. Un roman « vrai », au plein sens du terme, d’une vérité que la mère, au-delà de ses difficultés, porte en elle : « Mes filles sont des incantations. Elles ne pourront pas me sauver, c’est certain – elles ne sont pas là pour ça. Mais je compris à cet instant qu’aucune des trois n’était venue sur terre par hasard : je les ai toutes désirées, une par une convoquées, afin de les aimer éternellement… Et pour qu’elles m’attachent au monde ». Lourde responsabilité, que « les fillettes » assument en assurant la continuité de la vie.
Jean-Pierre Longre
16:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, clarisse gorokhoff, Équateurs, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/04/2020
L'enlèvement de Constance
 Lire, relire... Jean Échenoz, Envoyée spéciale, Les éditions de minuit, 2016, Minuit "double", 2020
Lire, relire... Jean Échenoz, Envoyée spéciale, Les éditions de minuit, 2016, Minuit "double", 2020
Un matin d’avril, sortant du cimetière de Passy où elle a fait une promenade de jeune femme désoeuvrée, Constance est enlevée – sans brutalité, presque avec politesse. Son mari, censément riche puisqu’il fut sous le pseudonyme de Lou Tausk un auteur-compositeur de chansons à succès, reçoit une demande de rançon à laquelle il ne donnera finalement pas suite, oubliant même progressivement Constance au profit d’une nouvelle aventure amoureuse. C’était là le but de la manœuvre fomentée par un certain général Bourgeaud, ancien du « Service Action », et par son adjoint Objat : trouver une jeune femme disponible, créer chez elle « un petit état de choc », l’isoler, la faire oublier puis la faire intervenir. C’est ainsi que Constance va devoir jouer les Mata-Hari, chargée de déstabiliser le régime de la Corée du Nord – rien que ça –, terrible dictature comme on le sait, mais pays où elle est restée « une idole dans les milieux dirigeants » en tant qu’interprète d’Excessif, le grand tube de son oublieux de mari.
 Voilà la trame. Un roman d’espionnage, certes, avec tous les ingrédients du genre : de la violence, du mystère, des voyages, de l’exotisme, de l’érotisme… Mais surtout un roman de Jean Échenoz, dans la lignée de ses précédents ouvrages, dans la filiation de Sterne ou Stendhal, et plus près de nous des Queneau, Perec et Roubaud (auteur entre autres d’un Enlèvement d’Hortense un peu différent de celui de Constance, mais tout de même…), et avec l’originalité d’un écrivain qui sait combiner comme pas un l’élégance et l’audace. Qui d’autre qu’Échenoz peut glisser en plein épisode à suspense une assertion telle que « À de nombreux égards le rêve est une arnaque » ? Qui d’autre peut se permettre sans dommage (au contraire) les digressions les plus érudites sur, par exemple, les travaux du docteur L. Elizabeth L. Rasmussen concernant la femelle de l’Elephas maximus, sur le nombre d’accidents domestiques en France, sur Pierre Michon ou sur le taekwondo? Tout cela sans perdre ni le fil de l’intrigue, ni un humour complice, donnant à l’ensemble toutes les allures de la parodie.
Voilà la trame. Un roman d’espionnage, certes, avec tous les ingrédients du genre : de la violence, du mystère, des voyages, de l’exotisme, de l’érotisme… Mais surtout un roman de Jean Échenoz, dans la lignée de ses précédents ouvrages, dans la filiation de Sterne ou Stendhal, et plus près de nous des Queneau, Perec et Roubaud (auteur entre autres d’un Enlèvement d’Hortense un peu différent de celui de Constance, mais tout de même…), et avec l’originalité d’un écrivain qui sait combiner comme pas un l’élégance et l’audace. Qui d’autre qu’Échenoz peut glisser en plein épisode à suspense une assertion telle que « À de nombreux égards le rêve est une arnaque » ? Qui d’autre peut se permettre sans dommage (au contraire) les digressions les plus érudites sur, par exemple, les travaux du docteur L. Elizabeth L. Rasmussen concernant la femelle de l’Elephas maximus, sur le nombre d’accidents domestiques en France, sur Pierre Michon ou sur le taekwondo? Tout cela sans perdre ni le fil de l’intrigue, ni un humour complice, donnant à l’ensemble toutes les allures de la parodie.
Oui, nous avons affaire à de la parodie. Mais pas seulement, et ce n’est pas le principal. La mise à distance du récit romanesque recèle un savant travail de construction. Si les personnages (nous ne les avons pas tous nommés, loin s’en faut) paraissent se rencontrer sous la poussée du hasard, c’est en réalité à un ballet très étudié, minutieusement et plaisamment agencé, que nous assistons. Et si l’auteur paraît bien s’amuser (n’hésitant pas à intervenir en personne, faisant mine de dévoiler les arcanes de son travail d’écriture, jouant avec la construction romanesque et le scénario cinématographique), Envoyée spéciale est un beau morceau de littérature – nous parlons là de la littérature qui, sans rien sacrifier à l’art, se lit avec jubilation.
Jean-Pierre Longre
17:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean Échenoz, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

