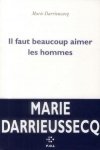03/12/2015
Kafka à l’Université
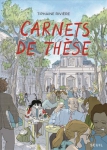 Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Tiphaine Rivière, Carnets de thèse, Le Seuil, 2015
Voulant d’urgence échapper (au moins quelques années) aux turbulences de l’enseignement en collège, Jeanne décide de s’inscrire en thèse. Après l’euphorie des débuts (bien qu’elle n’ait pu obtenir de financement), commence le parcours du combattant universitaire.
Combattant, ou soutier, comme on voudra. Franchie l’étape du dossier d’inscription, entravée par l’inertie dissuasive de la secrétaire ; celle de l’entretien avec le directeur de recherches, aussi charmant que silencieux, laissant passer six mois avant de répondre au moindre mail ; celle des cours à donner, dont la préparation mange tout le temps que l’on croyait réserver à la recherche, et qui finalement se révéleront aussi peu lucratifs qu’inutiles ; celles, successives, de la documentation bibliographique envahissante, de l’établissement d’un plan aussi labyrinthique que changeant, de la rédaction sans cesse repoussée mais à laquelle il faudra bien se mettre un jour… Sans compter l’incompréhension de l’entourage (le petit ami, la famille) qui ne s’explique pas pourquoi Jeanne se lance dans un travail qui ne rapporte rien, qui paraît totalement vain, voire irresponsable, et qui exacerbe son égocentrisme ; pas comme le cousin Alexandre qui, lui, va faire une thèse scientifique, utile au progrès de l’humanité, n’est-ce pas ; mais à quoi peut bien servir un travail sur la parabole de la loi dans Le Procès de Kafka ? Cela dit, lorsque Jeanne parviendra à sa soutenance, l’entourage en question sera aussi fier qu’il aura été sceptique et critique les années précédentes…
Tiphaine Rivière aurait pu écrire un roman autobiographique. Cela nous aurait privés du charme de ses dessins, qui tient au trait à la fois précis et nuancé, au mélange d’apparente candeur et d’ironie vraie, de réalisme et d’onirisme. Vignettes muettes ou dialogues vifs, couleurs contrastées ou teintes pastel, arrière-plans grisâtres ou animés, scènes de la vie quotidienne ou rêves éveillés, tout concourt à plonger le lecteur dans les affres intimes et cycliques de notre héroïne. Tout est bien vu, à l’image de cet édifice monstrueux (kafkaïen) aux coupoles interchangeables et aux murs instables qui représente le plan (de 64 pages) que Jeanne n’en finit pas de déconstruire et de reconstruire. Drôles et réalistes, vivants et oniriques, ces Carnets de thèse permettront à certains de s’y retrouver, à d’autres de se préparer, à tous de pendre plaisir à une histoire à la fois cauchemardesque et pleine d’humour.
Jean-Pierre Longre
10:14 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, dessin, autobiographie, tiphaine rivière, jean-pierre longre, le seuil | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/11/2015
Un polar bien renseigné
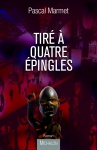 Pascal Marmet, Tiré à quatre épingles, Michalon, 2015
Pascal Marmet, Tiré à quatre épingles, Michalon, 2015
Les ingrédients y sont : un meurtre, suivi (ou précédé) de quelques autres, un policier au tempérament particulier – à la fois solitaire, discret et sensible –, des jeunes gens paumés et sympathiques, des trafiquants, de vrai(e)s méchant(e)s, des secrets venus d’ailleurs, de l’exotisme… Cela donne une bonne intrigue policière : on suit les méandres, les hauts et les bas de l’enquête du commandant Chanel assisté du capitaine Devaux, on s’insinue dans la vie mystérieuse d’une certaine Madame Saint-Germain de Ray, veuve peu nette d’un ex-préfet assassiné il y a quelque temps, on compatit aux errances d’un certain Laurent tout habillé de vert, on assiste aux affaires louches d’un expert en arts primitifs…
Roman policier donc, qui vaut surtout par le suspense entretenu, mais aussi par sa riche documentation: le fameux 36 quai des Orfèvres est décrit comme si nous y étions, et son auteur en connaît visiblement bien le fonctionnement. Autres exemples : les quais de la gare de Lyon, ou le musée des Arts Premiers, que l’on visite avec intérêt. Ainsi de suite.
Pascal Marmet, qui n’en est pas à sa première publication (deux romans aux éditions du Rocher : le Roman du parfum et le Roman du café, respectivement en 2013 et 2014), sait camper des décors, créer des atmosphères où cauchemar et réalité se côtoient volontiers, et tenir le lecteur en haleine.
Jean-Pierre Longre
13:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, pascal marmet, michalon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/11/2015
Passeur de littérature
 Journal Le Persil n° 100, puis 101-102-103, automne 2015
Journal Le Persil n° 100, puis 101-102-103, automne 2015
Marius Daniel Popescu aime la vie quotidienne, il aime les gens qui la traversent et la peuplent, et des moindres gestes, des moindres objets, des moindres mots s’échappent sous sa plume des paysages nouveaux – par la parole, le souvenir, l’imagination. Le banal, chez lui, ne l’est jamais; de l’ordinaire naît l’extraordinaire. S’il est besoin de le prouver encore, le numéro 100 du Persil, « journal qui cultive le goût de la cuisine des mots de chaque jour », le fait à merveille. Des poèmes nouveaux, et deux extraits d’un roman à venir (et attendu), Le Cri du barbeau : l’un puisé dans un épisode de la vie actuelle – petits incidents et conversations paisibles –, l’autre dans les souvenirs des « travaux patriotiques » organisés par le « parti unique » – ramassage obligatoire de pommes de terre par les étudiants, sous la surveillance des professeurs d’université, à l’époque de la dictature en Roumanie.
 Cette centième parution, donc, qui dresse aussi la liste des 99 précédentes, avec tous les détails sur leur sommaire, contient « des textes d’un seul auteur ». Mais le numéro triple qui suit dans la foulée (101-102-103) est, comme la plupart des précédents, laissé à la disposition d’autres auteurs de la Suisse romande (Ivan Farron, Serge Cantero, Bertrand Schmid, Janine Massard, Silvia Härri, Ferenc Rákóczy, Lucas Moreno, Lolvé Tillmans, Dominique Brand, Heike Liedler, Michel Layaz) et de Sanaz Safari, écrivaine iranienne qui, grâce à David André et Marius Daniel Popescu, publie ici ses deux premiers textes écrits en français, « à l’attention d’un lectorat dont elle ignore tout ».
Cette centième parution, donc, qui dresse aussi la liste des 99 précédentes, avec tous les détails sur leur sommaire, contient « des textes d’un seul auteur ». Mais le numéro triple qui suit dans la foulée (101-102-103) est, comme la plupart des précédents, laissé à la disposition d’autres auteurs de la Suisse romande (Ivan Farron, Serge Cantero, Bertrand Schmid, Janine Massard, Silvia Härri, Ferenc Rákóczy, Lucas Moreno, Lolvé Tillmans, Dominique Brand, Heike Liedler, Michel Layaz) et de Sanaz Safari, écrivaine iranienne qui, grâce à David André et Marius Daniel Popescu, publie ici ses deux premiers textes écrits en français, « à l’attention d’un lectorat dont elle ignore tout ».
 Roumanie, Suisse romande, Iran, et tous les espaces que l’écriture laisse entrevoir : Le Persil, « parole et silence », est un généreux passeur de littérature, au plein sens de l’expression.
Roumanie, Suisse romande, Iran, et tous les espaces que l’écriture laisse entrevoir : Le Persil, « parole et silence », est un généreux passeur de littérature, au plein sens de l’expression.
Jean-Pierre Longre
12:44 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, roman, nouvelle, suisse, roumanie, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/05/2015
Le roman de Nadia

Lola Lafon, La petite communiste qui ne souriait jamais, Actes Sud, 2014, Babel/Poche, mai 2015
Prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs 2014
Montréal, 1976, Jeux olympiques. Une petite Roumaine de 14 ans détraque le panneau électronique d’affichage des résultats : les ordinateurs n’avaient pas prévu que la note 10 puisse être attribuée à une gymnaste – et ce fut pourtant le cas avec Nadia Comaneci… C’est avec ce fameux épisode que naît la légende et que débute le livre, qui n’est cependant ni un éloge dithyrambique, ni un reportage sportif ni un récit biographique. C’est un roman, qui s’appuie certes sur la vie de la protagoniste, jalonnée de fameux épisodes, mais qui, en comblant « les silences de l’histoire et ceux de l’héroïne », en fait une destinée à la fois hors normes et représentative d’une époque tourmentée.
Un roman vrai, dramatique, vivant, mortel, dont le centre est une petite fille prodige et tenace, imperturbable dans son acharnement à réussir, éduquée à être la meilleure, à incarner la perfection du corps et d’une nation totalitaire où tout n’est qu’apparat et apparence. Car Lola Lafon, qui connaît bien la Roumanie, donne une image précise de la dictature de Ceauşescu, avec la surveillance incessante, les pénuries et les artifices grotesques qui la caractérisaient, mais aussi de la situation actuelle, avec la soumission au libéralisme effréné et les injustices qui en résultent. L’histoire du pays induit celle de « la petite communiste » au visage énigmatique et au corps virtuose, ce corps qui va être comme les autres soumis à l’évolution naturelle jusqu’à devenir comme les autres celui d’une femme : fin du miracle, et fuite vers autre chose ? Que n’aura-t-on dit, écrit, susurré, proclamé sur le passage de Nadia Comaneci à l’Ouest, sur sa vie en Amérique…
Sans fioritures, sans excès rhétoriques ou lyriques, mais avec la vivacité de la parole et de l’échange direct, l’auteure trace le portrait complexe d’un personnage qui malgré les images que l’on en a universellement diffusé garde son mystère et ses contradictions. Visage impassible et corps tout en mouvements. Le roman, en va-et-vient tournoyants, en saltos arrière et avant, en rebondissements inattendus, équilibres précaires ou magiques, circule entre réalité et fiction, entre histoire et mythe, entre points de vue subjectifs et reconstitutions objectives. Ce faisant, il tente de percer les mystères de « la beauté absolue » du mouvement physique, sans occulter la question essentielle et éternelle de la liberté humaine, que ce soit celle d’un peuple ou celle d’un individu : « Je rêvais de liberté, j’arrive aux États-Unis et je me dis : c’est ça la liberté ? Je suis dans un pays libre et je ne suis pas libre ? Mais où, alors, pourrai-je être libre ? ».
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, francophone, roumanie, lola lafon, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/04/2015
Les méandres d’une existence
 Joseph Danan, La Vie obscure, lettrines et encres d’Eva Wellesz, Les éditions du Paquebot, 2015
Joseph Danan, La Vie obscure, lettrines et encres d’Eva Wellesz, Les éditions du Paquebot, 2015
Soixante et onze chapitres, soixante et onze phrases (annoncées de manière claironnante et oulipienne par les « Septante phrases en guise de préface » de Jacques Jouet – qui a eu l’élégance modeste de laisser la primauté du nombre à Joseph Danan). Soixante et onze phrases, donc, qui pour la plupart font une bonne page, si ce n’est deux : c’est dire combien elles sont sinueuses, rebondies, pleines de recoins et de plis qui laissent entrevoir des détails insoupçonnés, des confidences inattendues, des évocations poétiques. Une seule d’entre elles s’impose en un mouvement irrésistible et lapidaire : « Comme une lame de fond montait la Vie obscure. ».
Quelle est-elle, cette « Vie obscure » dont chaque début de chapitre donne une image sous la forme des lettrines sombres sur fond tacheté de gris d’Eva Wellesz ? Elle est la vie (fondée au moins en partie sur l’expérience personnelle) d’un homme qui, envers et contre tout, se voue à l’écriture : théâtre, poésie, narration, « Journal rêvé » devenant poèmes en prose puis « Nouvelles de l’intérieur ». La quête d’éditeurs et de metteurs en scène, les amours de passage, les désirs de notoriété, le refus des compromissions, l’emploi de bureau à la MATMUT (parce qu’il faut bien vivre), les « idées de voyages », les illusions et désillusions que réserve le monde de la littérature, tout y passe, jusqu’au « livre qui n’existait pas » et qu’il voudrait tant écrire, « lancé à pleine vitesse, le cheveu fou, tapant sur son ordinateur beaucoup plus fort qu’il n’est nécessaire »…
L’essentiel se passe aux confins de l’ironie et aux détours des chapitres-phrases labyrinthiques, dans le dédale de ces proses poétiques dont le cheminement suit les méandres d’une existence dans laquelle le réel est un complexe mélange de vie quotidienne et de rêve (diurne ou nocturne), des méandres qui aboutissent à la ligne droite d’un dénouement brusque et surprenant. Proclamons-le avec Jacques Jouet : « C’est la fin qui est le plus drôle. – C’est la fin qui finit mal. – C’est la fin qui est happy end du point de vue du plaisir de la lecture. – Toujours vivant ? – L’auteur ! l’auteur ! – Longue vie à l’auteur ! »
Jean-Pierre Longre
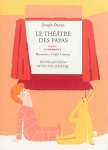 En même temps ou à peu près, Joseph Danan a publié Le théâtre des papas, pièce à trois personnages (Papa, Maman et Bébé), qui rappelle qu’il est d’abord un auteur de théâtre, et qu’il écrit volontiers pour les enfants (ce qui évidemment n’exclut pas les adultes).
En même temps ou à peu près, Joseph Danan a publié Le théâtre des papas, pièce à trois personnages (Papa, Maman et Bébé), qui rappelle qu’il est d’abord un auteur de théâtre, et qu’il écrit volontiers pour les enfants (ce qui évidemment n’exclut pas les adultes).
Le théâtre des papas, illustrations d’Adèle Garceau, Heyoka Jeunesse, Actes Sud-Papiers, 2015.
15:15 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, théâtre, francophone, joseph danan, eva wellesz, jacques jouet, les éditions du paquebot, heyoka jeunesse, actes sud-papiers, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/04/2015
Le « meilleur des mondes » ?
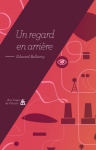 Edward Bellamy, Un regard en arrière, traduit de l’anglais par Francis Guévremont, préface de Manuel Cervera-Marzal, Aux forges de Vulcain, 2014
Edward Bellamy, Un regard en arrière, traduit de l’anglais par Francis Guévremont, préface de Manuel Cervera-Marzal, Aux forges de Vulcain, 2014
30 mai 1887, Boston : Julian West, 30 ans, riche et très joliment fiancé, s’endort dans la chambre souterraine que, par souci de tranquillité, il s’est fait aménager chez lui. 10 septembre 2000, Boston : le même Julian West est découvert, en un parfait état de conservation, endormi mais toujours vivant, dans la même chambre oubliée à la suite de l’incendie de sa maison. Il se retrouve au sein d’une charmante famille (le père, la mère, la fille), chaleureusement accueillante et respirant le bonheur, comme d’ailleurs le reste de la société bostonienne et américaine.
Rêve merveilleux ou fantastique bond en avant ? La fin du XXème siècle apparaît comme un âge d’or, dans un monde radicalement transformé par un assemblage parfait (trop parfait ?) des divers rouages de la société. Sous la houlette bienveillante du docteur Leete, son hôte, et de sa fille Edith (qui porte étrangement le même prénom que sa fiancée d’autrefois), Julian apprend à connaître avec un étonnement grandissant ce qui fait fonctionner à merveille l’industrie, le commerce, les relations humaines, la condition féminine, le travail, la finance (en tout cas ce qui en tient lieu), la vie intellectuelle et culturelle, les loisirs, la politique, la justice, la religion… Tout y passe, d’une manière systématique, jusqu’aux sentiments et serments amoureux qui viennent couronner cette revue intégrale.
C’est à un voyage complexe dans le temps que nous invite l’auteur : lecteurs de 2015, nous découvrons ce qu’un auteur de la fin du XIXème siècle prévoyait comme un monde parfait à la fin du XXème siècle : une organisation irréprochable au service d’hommes et de femmes coulés dans le moule d’un bonheur uniforme et indéfectible. Une utopie, une uchronie (comme le précise à juste titre Manuel Cervera-Marzal), dont on se doute qu’elle est et restera du domaine de la spéculation. Mais comment ne pas remarquer combien, hormis les progrès techniques et les améliorations du confort quotidien, le fonctionnement de la société n’a pas changé en presque 130 ans ? On en juge aux comparaisons triomphantes faites par le docteur Leete entre les XIXème et XXème siècles. Par exemple : « Votre système subissait des convulsions périodiques, qui s’emparaient aussi bien des sages que des imbéciles, des égorgeurs que de leurs victimes. Je veux parler de ces crises économiques, qui se produisaient tous les cinq ou dix ans ; elles détruisaient les industries de la nation, accablaient les compagnies qui étaient faibles et mutilaient les plus fortes. Après, il fallait traverser de longues périodes de léthargie, qui pouvaient durer plusieurs années ; les capitalistes en profitaient pour regagner les forces qu’ils avaient perdues ; les classes ouvrières crevaient de faim ou se déchaînaient en émeutes. Alors enfin arrivait une brève période de prospérité, suivie d’une nouvelle crise et d’une nouvelle léthargie. Au fur et à mesure que le commerce se développait, les nations devenaient interdépendantes, les crises s’étendaient au globe tout entier… ». Rien de plus actuel que cette condamnation du libéralisme économique et du règne de la finance ; cette première traduction intégrale et cette réédition d’un livre qui en son temps connut un succès comparable à celui de La case de l’oncle Tom sont salutaires.
Voilà donc un « regard en arrière » plein d’enseignements sur l’évolution (plutôt la stagnation) de l’humanité, de même que sur ses aspirations … À ce titre, il relève de l’essai. Mais c’est aussi un beau récit, avec des personnages auxquels on s’attache – même si certains tendent vers une vision manichéiste de l’Histoire. Un beau récit qui réserve des surprises, d’étranges liens entre le passé et le présent, entre le rêve et la réalité.
Jean-Pierre Longre
23:28 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, essai, anglophone, edward bellamy, francis guévremont, manuel cervera-marzal, aux forges de vulcain, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/03/2015
Hollywood, Afrique
Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes, P.O.L., 2013, Folio, 2015
Prix Médicis 2013
Dans le monde à la fois excentrique et fermé du cinéma hollywoodien, Solange, la jeune française de Clèves devenue actrice américaine, et Kouhouesso, second rôle dont la figure est cependant notoire, se rencontrent au cours d’une soirée. Cela aurait pu être « Coup de foudre chez George Clooney » – car c’est bien lors d’une réception chez la star que cela se passe. Cela aurait pu être aussi un drôle de roman à clés (outre Clooney, on y rencontre Matt Damon, Steven Soderbergh, Vincent Cassel et quelques autres), ou encore un roman de mœurs, un roman exotique, un roman psychologique…
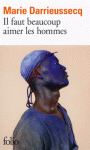 Bien sûr, ces lectures sont possibles, mais il y en d’autres, plus prégnantes. On pourrait parler de roman d’atmosphères (au pluriel), de roman parodique aussi, jouant avec les stéréotypes auxquels est confrontée l’héroïne : le cinéma, bien sûr, comme un miroir déformant et onirique ; la passion amoureuse, au premier plan, liée à l’attente – celle de l’homme qu’elle aime, qui n’a pas son pareil pour se faire désirer longuement et pour débarquer au moment inattendu ; le couple mixte (femme blanche, homme noir) et les clichés que, nonobstant l’évolution des mœurs et les apparences progressistes, cette alliance véhicule ; l’Afrique, sa chaleur, ses paysages et ses coutumes – où Kouhouesso va tourner Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
Bien sûr, ces lectures sont possibles, mais il y en d’autres, plus prégnantes. On pourrait parler de roman d’atmosphères (au pluriel), de roman parodique aussi, jouant avec les stéréotypes auxquels est confrontée l’héroïne : le cinéma, bien sûr, comme un miroir déformant et onirique ; la passion amoureuse, au premier plan, liée à l’attente – celle de l’homme qu’elle aime, qui n’a pas son pareil pour se faire désirer longuement et pour débarquer au moment inattendu ; le couple mixte (femme blanche, homme noir) et les clichés que, nonobstant l’évolution des mœurs et les apparences progressistes, cette alliance véhicule ; l’Afrique, sa chaleur, ses paysages et ses coutumes – où Kouhouesso va tourner Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
Dans un style où perce, entre autres, la « petite musique » de Marguerite Duras (à qui l’auteure a emprunté son titre), Marie Darrieussecq construit un récit très personnel, aux allures à la fois théâtrales et cinématographiques, tragédie en cinq actes ou film en cinq grandes séquences précédées d’un « générique » et complétées par un « bonus » (dix ans après…). Mais la différence entre un film ou une pièce de théâtre et un roman, c’est que celui-ci peut diversifier les points de vue, accéder directement à l’intériorité des personnages, mettre des mots sur les comportements et les attitudes, approcher par le verbe les mystères de la vie, les rêves des humains, le sens des silences et la poésie du monde. Tout cela, Il faut beaucoup aimer les hommes y parvient dans une prose à la fois retenue et fiévreuse, sensible et sensuelle, pleine d’images et d’échos, une prose qui laisse de belles traces dans la mémoire du lecteur.
Jean-Pierre Longre
12:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marie darrieussecq, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2015
« Où allez-vous, monsieur Eminescu ? »
 Florina Ilis, Les vies parallèles, traduit du roumain par Marily Le Nir, précédé d’une préface par Ghislain Ripault, Éditions des Syrtes, 2014
Florina Ilis, Les vies parallèles, traduit du roumain par Marily Le Nir, précédé d’une préface par Ghislain Ripault, Éditions des Syrtes, 2014
« Où trouveras-tu le mot / Qui exprime la vérité ? ». Ces deux vers du « poète national » roumain, cités dans les dernières pages du livre, posent la question cruciale : existe-t-il une « vérité » concernant Mihai Eminescu, et dans l’affirmative comment l’exprimer ? Il semble que Florina Ilis se soit approché de la solution : « le mot », en l’occurrence, fait presque 650 pages.
Il y est donc question d’Eminescu, l’accent étant mis sur la fin de sa brève vie (« Eminescu est mort jeune. C’était une chose nécessaire à son génie » – affirmation professorale), sur son amour complexe et tempétueux pour Veronica (Madame Micle), sur sa folie lui valant soins et enfermement – mais aussi sur la personnalité, l’érudition, l’inspiration, la sensibilité et la créativité qui firent de lui à la fois le poète de grande envergure que les Roumains portent aux nues et l’artiste incompris, confronté à la matérialité de l’existence, aux mesquineries de la société, aux différents métiers ou aux différentes aides auxquels il dut avoir recours pour subsister. Suprême figure romantique…
Si le roman (oui, il s’agit bien d’un roman) de Florina Ilis était une simple narration biographique, il ne ferait que confirmer, voire renforcer l’image statufiée du poète. Mais on a affaire à des « vies parallèles », dans une perspective autre que celle de Plutarque. On pourrait y voir les vies d’un homme et de ses contemporains célèbres, que l’on rencontre au fil des pages (Maiorescu, Macedonski, Creangă, Caragiale…), ce qui permet de contempler une fresque de la vie politico-culturelle de la fin du XIXème siècle. Il s’agit plutôt des diverses vies vécues par le protagoniste : son existence réelle, mais aussi ses rêves, son imaginaire, son destin littéraire et historique – disons le mythe Eminescu, cultivé dans toutes les dimensions possibles, récupéré par toutes les factions (fascisme, communisme, antisémitisme, repli sur soi ou propagande internationale…), avec un point commun : le poète « national » devenu emblème « nationaliste », pour ainsi dire victime de son succès, de ses excès, de l’image qu’il s’est donnée et qu’on lui a construite.
Cela étant, l’auteure fait de ces « vies parallèles » des romans concomitants et imbriqués, en quelque sorte. Les va-et-vient dans le temps et l’espace, le choc et la fusion des époques (avec passages subits du XIXème siècle aux années 1950 ou 1970) s’accommodent avec une grande réussite du choc et de la fusion des styles. La rigueur de fidèles témoignages et de froids rapports de police (cités intégralement ou résumés) n’exclut ni le lyrisme (sincère ou parodique, avec de belles et plaisantes invocations à la muse), ni l’ironie, ni l’humour (voir le procès épique au cours duquel Eminescu, mort depuis longtemps, ne peut paraître que sous la forme d’une statue qui fait scandale…) ; l’originalité de l’écriture, avec les étonnements qu’elle ménage et les sauts d’obstacles dont elle nous gratifie, facilite la déambulation « dans ce stimulant dédale » (formule du préfacier). Florina Ilis, qui avait déjà créé une belle et vraie surprise littéraire en publiant La croisade des enfants (éditions des Syrtes, 2010), propose un roman aux ramifications multiples, dont l’excès même, dans sa forme et dans son contenu, est celui du personnage multiple qui la peuple.
Jean-Pierre Longre
16:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, florina ilis, mihai eminescu, marily le nir, ghislain ripault, éditions des syrtes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/02/2015
Marius Daniel Popescu à Lyon
Mardi 03 mars 2015 à partir de 14h
14h-17h
Dans le cadre du séminaire 2014/2015 Concepts et créations : état des lieux des littératures francophones (Universités Lyon 2 et Lyon 3, ENS de Lyon):
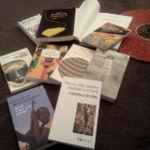
Lieu : ENS-Site R. Descartes, 15 Parvis R. Descartes, Lyon7, salle F008
- Conférence de Jean-Pierre Longre : « Retour sur la littérature française d’origine roumaine»
- Rencontre avec Marius Daniel Popescu. Modératrice : Marie Bouchereau
18h30
L’association Rhône Roumanie propose une soirée lecture avec Marius Daniel Popescu.

Événement organisé en partenariat avec le Consulat Général de Roumanie à Lyon et la Librairie Passages.
Lieu : Consulat Général de Roumanie à Lyon, 1, rue le Royer, 69003 Lyon
Marius Daniel Popescu, écrivain roumain d’expression française, réside en Suisse. Il est l’auteur, notamment, de deux recueils de poèmes, 4x4 poèmes tout-terrains (1995) et Arrêts déplacés (2004), publiés chez Antipodes (Suisse), et de deux romans publiés chez José Corti : La Symphonie du loup (2007) et Les Couleurs de l'hirondelle (2012). Il est d’autre part le créateur et l’animateur du journal littéraire Le Persil. Ses écrits ont reçu diverses récompenses, dont le Prix Robert Walser.
Plus de précisions :
http://jplongre.hautetfort.com/tag/marius+daniel+popescu
Pour les deux manifestations : entrée libre et ouverte à tous.
10:44 Publié dans Conférence, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, poésie, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/02/2015
« Bienvenue dans mon épopée »
 Mircea Cărtărescu, Le Levant, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2014
Mircea Cărtărescu, Le Levant, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2014
Faut-il définir le genre de l’ouvrage ? On parlera d’épopée. Douze chants, invocations aux Muses et à d’autres entités divinisées, exploits guerriers de courageux navigateurs, intrigues amoureuses, amitiés et inimitiés viriles, héros à la fois modernes et intemporels dont le but est de libérer leur patrie de l’occupant étranger, fond historique sur lequel se détachent des événements transfigurés en mythes, lyrisme tantôt échevelé tantôt intimiste, en prose ou en vers… La tonalité épique est bien une caractéristique fondamentale du récit, dont le protagoniste, Manoïl, n’a de cesse que de renverser la tyrannie levantine qui opprime la Valachie – et qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler, ici, la sombre dictature dont était victime le peuple roumain dans les années 1980, celles durant lesquelles l’auteur écrivait son livre.
Épopée, donc, mais travestie et burlesque, parodique et humoristique, aux inventions inattendues, que ce soit dans les descriptions, les situations ou l’écriture. Chaque page est une surprise nouvelle, chaque phrase recèle une trouvaille stylistique ou verbale. L’histoire du monde devient une fable pleine de paysages étonnants, de machines complexes, de péripéties fantaisistes, d’anachronismes audacieux, de rêves merveilleux ou terribles, d’illusions politiques, de voyages infinis, de tirades grandioses. Avec ses personnages en quête (plus ou moins consciente) d’un Graal oriental ou de ce que les surréalistes appelaient le « point suprême », la narration s’envole au-delà des « limites du monde », là où « le bien et le mal, les ténèbres et la lumière s’annihilent, petit et grand, infini et limité deviennent une même chose ». Comme ce sera le cas dans les romans à venir, notamment dans la trilogie Orbitor, Cărtărescu le magicien n’hésite pas à naviguer entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, donnant par exemple à Bucarest toutes ses dimensions dans une larme, et envisageant le monde depuis une nacelle de ballon dirigeable…
À l’instar de ce qui se produit dans les romans picaresques, Mircea l’écrivain intervient à tout moment en tant que tel dans son œuvre, la contemple, l’examine, ironise, s’efforce de la modifier, s’en éloigne pour mieux la commenter, s’adresse directement à ses personnages, se regarde travailler dans sa cuisine, accueille le lecteur à l’intérieur de ses pages en lui souhaitant la bienvenue. Non seulement le lecteur, mais nombre d’écrivains sur lesquels il s’appuie, qu’il prend à témoin avec un respect non dénué de familiarité. Il y a là Homère, bien sûr, et quelques autres antiques, mais aussi Shakespeare, Byron, Borges et quantité de modernes, roumains de préférence. Cărtărescu a beaucoup lu, cultive une imagination débordante, et pratique une écriture effervescente. Le Levant est une somme grouillante, un univers foisonnant, et surtout un hymne à la vie sous tous ses aspects, la vie réelle, la vie rêvée :
"Je lève ce verre lourd à la sainte Liberté,
À la douce Poésie, et à la Rêverie ailée."
Jean-Pierre Longre
15:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : épopée, roman, poésie, roumanie, mircea cartarescu, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/02/2015
Opérette en forêt
 Frédéric Verger, Arden, Gallimard, 2013, Folio, 2015
Frédéric Verger, Arden, Gallimard, 2013, Folio, 2015
Prix Goncourt du premier roman 2014
Entre la Hongrie, la Roumanie et l’Ukraine, se trouve le Grand-Duché de Marsovie, « Monaco (ou Suisse) des Carpates », qui, avec sa petite capitale S., son souverain populaire et autoritaire, ses forêts et ses mystères, tient de la Marsovie de Franz Lehar (voir La veuve joyeuse), de la Syldavie d’Hergé et de la Roumanie elle-même, qui dans son histoire récente a vu son roi prendre ses distances avec le fascisme, changer d’alliance en 1945, participer ainsi à la victoire des Alliés, ce qui a malgré lui et malgré son peuple favorisé la prise du pouvoir par les communistes en 1947 – mais ceci est d’un autre domaine.
 Car ce qui importe, dans Arden, c’est l’amitié entre deux hommes bien différents, Alexandre de Rocoule (grand-oncle du narrateur), propriétaire volage d’un hôtel de luxe niché au cœur de la forêt, et Salomon Lengyel, mélancolique tailleur juif à la clientèle clairsemée ; cette amitié est nourrie, en particulier, par une passion commune pour l’opérette. Que de scénarios et de partitions ils ont composé ensemble ! Œuvres jamais jouées car toujours inachevées, l’impossibilité de se mettre d’accord sur un dénouement étant pour eux comme une tradition, comme une marque d’attachement mutuel. Jusqu’à ce jour de 1945 où, la « Garde noire » et les SS sévissant de plus en plus violemment, Alexandre et Salomon ont l’idée d’enregistrer, avec l’aide de la séduisante Esther, fille de Salomon, et de musiciens juifs réfugiés dans la cave de l’hôtel, une opérette en plusieurs épisodes destinée à passer en feuilleton sur les ondes de la radio nationale. Se produire publiquement à la radio, le meilleur moyen de se cacher, pensent-ils. « Et c’est ainsi que naquit ce qui devint plus tard la légende de l’orchestre juif d’Alex. ».
Car ce qui importe, dans Arden, c’est l’amitié entre deux hommes bien différents, Alexandre de Rocoule (grand-oncle du narrateur), propriétaire volage d’un hôtel de luxe niché au cœur de la forêt, et Salomon Lengyel, mélancolique tailleur juif à la clientèle clairsemée ; cette amitié est nourrie, en particulier, par une passion commune pour l’opérette. Que de scénarios et de partitions ils ont composé ensemble ! Œuvres jamais jouées car toujours inachevées, l’impossibilité de se mettre d’accord sur un dénouement étant pour eux comme une tradition, comme une marque d’attachement mutuel. Jusqu’à ce jour de 1945 où, la « Garde noire » et les SS sévissant de plus en plus violemment, Alexandre et Salomon ont l’idée d’enregistrer, avec l’aide de la séduisante Esther, fille de Salomon, et de musiciens juifs réfugiés dans la cave de l’hôtel, une opérette en plusieurs épisodes destinée à passer en feuilleton sur les ondes de la radio nationale. Se produire publiquement à la radio, le meilleur moyen de se cacher, pensent-ils. « Et c’est ainsi que naquit ce qui devint plus tard la légende de l’orchestre juif d’Alex. ».
L’œuvre ainsi composée par les deux compères, énorme pot-pourri plein de réminiscences et d’improvisations, est aussi labyrinthique que le roman, lui-même aussi touffu que la forêt d’Arden. Dans les unes et dans l’autre, on se perd avec inquiétude, on se retrouve avec soulagement, on erre avec délices, guidés par les déambulations du narrateur et par la prose imagée, foisonnante, truculente de l’auteur. L’intrigue principale croise des péripéties secondaires – secondaires mais primordiales, car elles font le sel du récit, parfois son fil conducteur. Ce sont des rêves ou des souvenirs, c’est l’histoire d’une petite bague plusieurs fois perdue et retrouvée, celle aussi d’une lettre d’amour qui se transforme au fil des aventures, jusqu’à devenir une sorte de message codé, voire de clé narrative : « Ceux qui aiment finissent par se retrouver dans des forêts si obscurs que des souvenirs » (orthographe et graphie respectées).
Dans Arden voisinent l’imagination débridée et la minutieuse description de la vie quotidienne, l’Histoire de l’Europe dans la première moitié du XXème siècle et l’intemporalité, la tendresse et la cruauté, la violence et la sensibilité, l’angoisse et la joie. On pense parfois, devant les intrusions semi-ironiques de l’auteur, aux romans du XVIIIème siècle et à ceux de Stendhal ; on pense à la comédie de mœurs et à la farce tragique ; on pense à une certaine littérature d’Europe orientale, mélange de réalisme social et de fantastique légendaire. On pense que Frédéric Verger est un écrivain complet, et que son premier roman est un ouvrage accompli.
Jean-Pierre Longre
www.folio-lesite.fr
23:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, frédéric verger, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/01/2015
Inséparables
 Mikhaïl Elizarov, Les ongles, traduit du russe par Stéphane A. Dudoignon, Serge Safran éditeur, 2014
Mikhaïl Elizarov, Les ongles, traduit du russe par Stéphane A. Dudoignon, Serge Safran éditeur, 2014
À l’époque de la transition entre la chute de l’empire soviétique et l’avènement du capitalisme débridé, abandonnés ou orphelins, handicapés de surcroît, deux garçons au sort similaire se sont pris d’une amitié indéfectible. Difficile, voire impossible pour eux de rester séparés plus d’une journée, et l’on peut supposer que quand l’un des deux mourra, l’autre le suivra de près. Élevés (pour ainsi dire) dans les mêmes institutions, où le mépris, la maltraitance et la mort sont monnaies courantes, ils suivent des itinéraires parallèles, compte tenu de leurs tares et de leurs dons respectifs.
Gloucester (un surnom qui n’a rien de russe, mais qui le suivra constamment), le narrateur, paraît posséder dans sa bosse, pour le meilleur et pour le pire, deux atouts qui lui sauvent la vie et qui vont faire ses éphémères fortune et célébrité : une force herculéenne et un génie mozartien de la musique. Bakatov (surnom sonnant bien russe mais lui aussi fruit du hasard) a visiblement un pouvoir occulte qui se manifeste lorsqu’il se ronge les ongles, à intervalles réguliers – et, par ailleurs, il devient un habile plombier. Devenus jeunes adultes émancipés, livrés à eux-mêmes, Gloucester et Bakatov vont devoir se débrouiller dans la grande ville, jungle inconnue, dévorante, où ils sont pris en main par des hommes qui apparemment leur veulent du bien, mais dont on peut mettre en doute la sincérité et la probité. L’essentiel, pour les deux garçons, est leur lumineuse intimité réciproque. « La vie suivait son cours. Nous n’étions jamais séparés plus de vingt-quatre heures de suite. J’allais lui rendre visite et il venait me voir. Je lui racontais mes événements musicaux, il m’initiait aux mystères percés par lui des lavabos finnois. Pour une raison que j’ignore, cela me rappelait tout de suite les contes d’Andersen ou le Nord scandinave cristallin et glacé et Bakatov m’apparaissait comme le Finnois de Pouchkine, en mage d’opéra. ».
Né en Ukraine en 1973, Mikhaïl Ezarov (dont Les Ongles est le deuxième ouvrage traduit en français) a l’art des descriptions grouillantes, de la narration aux péripéties surprenantes. Son roman, dans lequel le réalisme du quotidien sordide et le sens aigu de la psychologie voisinent avec le fantastique, l’humour noir et l’onirisme, se situe à la fois dans une certaine tradition russe et dans la lignée de certains récits poétiques contemporains.
Jean-Pierre Longre
23:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, russie, ukraine, mikhaïl elizarov, stéphane a. dudoignon, serge safran éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/12/2014
À l’Est quoi de nouveau ?
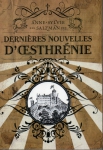 Anne-Sylvie Salzman, Dernières nouvelles d’Œsthrénie, Dystopia, 2014
Anne-Sylvie Salzman, Dernières nouvelles d’Œsthrénie, Dystopia, 2014
Dans une Europe orientale qui a vu passer au fil des siècles des occupants de tous horizons (Turcs, Russes, Autrichiens, Allemands…), il est de petits pays, royaumes, principautés, duchés, nés de l’imagination de quelques auteurs bien inspirés, qui regroupent et condensent les réelles caractéristiques de cette région fluctuante et troublée. L’Œsthrénie en fait partie. Comme dans la Syldavie et la Bordurie d’Hergé, comme dans la Marsovie de Frédéric Verger, on y trouve des montagnes escarpées au profil carpatique, des forêts peuplées de bêtes sauvages et semées d’étangs mystérieux, des rivières apaisantes, des villages heureux ou miséreux, des châteaux seigneuriaux, un bord de mer séduisant, une capitale peu engageante…
En six chapitres (ou « nouvelles » – prenons le terme dans ses deux acceptions principales) logés sous une couverture délicieusement baroque et rudement incitative (Laurent Rivelaygue), Anne-Sylvie Salzman conte l’histoire de ce royaume devenu dictature. Par la voix de six protagonistes différents mais ayant tous quelque chose à voir entre eux – liens familiaux, historiques ou narratifs – nous assistons aux péripéties qui vont entraîner la ruine du pays. Sa prospérité relative, minée par la mégalomanie d’un despote paranoïaque faisant construire un immense palais à la manière de Ceauşescu, mais aussi par les complots et les velléités de soulèvement, par les persécutions et la soumission, par l’expansionnisme des peuples voisins, sera mortellement menacée.
Dernières nouvelles d’Œsthrénie relève à la fois du réalisme historique et du fantastique suggéré. Un réalisme qui ne colle pas aux événements relatés dans les manuels scolaires et dans les encyclopédies, mais qui, par le truchement d’un microcosme précisément décrit, forme une synthèse romanesque de l’histoire de toute une partie de l’Europe ; et un fantastique qui ne fait pas basculer dans des mondes éloignés, mais qui, par touches discrètes, s’appuie sur les mythes et légendes populaires. Surtout, l’auteure, adaptant subtilement son écriture aux situations et aux tempéraments des protagonistes narrateurs, campe des êtres qui, au-delà des circonstances particulières au récit et aux dialogues, au-delà de leurs vies respectives, représentent une humanité en proie à ses peurs, à ses espoirs, à ses interrogations, à ses contradictions, à ses admirations, à ses violences, en proie à la mort.
Jean-Pierre Longre
17:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, anne-sylvie salzman, dystopia, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/12/2014
« Le lieu de l’exil »
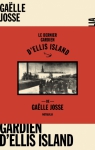 Gaëlle Josse, Le dernier gardien d’Ellis Island, Notabilia / Les Éditions Noir sur Blanc, 2014
Gaëlle Josse, Le dernier gardien d’Ellis Island, Notabilia / Les Éditions Noir sur Blanc, 2014
Entre 1978 et 1980, Robert Bober et Georges Perec réalisèrent un film issu de la visite du site où transitèrent les aspirants à l’immigration américaine : Récits d’Ellis Island, histoires d’errance et d’espoir. En 1994 et 1995, en fut tiré Ellis Island (P.O.L.), le texte de Georges Perec, pour qui ce lieu « est le lieu même de l’exil, / c’est-à-dire / le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. ».
Est-ce à dire que le livre de Gaëlle Josse fait double emploi ? Certes, comme pour Perec, il fait suite à une visite de l’île, « aujourd’hui transformée en musée de l’Immigration, à quelques brasses de la statue de la Liberté. », et il est une tentative de réponse à la question qui s’est immédiatement posée à elle : « Comment expliquer la fulgurante émotion dont j’ai été saisie dans ce lieu chargé du souvenir de tous les exils ? ». Mais en dehors de cette communauté de réactions humaines, Le dernier gardien d’Ellis Island adopte un point de vue radicalement différent de celui de Perec, puisqu’il s’agit là des souvenirs, sous forme de journal, d’un personnage fictif mais représentatif d’une vérité, John Mitchell, directeur du centre d’immigration, qui sera le dernier à quitter « cet environnement à la fois lugubre et familier », comme un capitaine est le dernier à quitter son navire en péril. Car en 1954, le centre ferme, et John doit rejoindre la terre ferme, la cité, le monde qu’il évitait le plus possible.
Si Ellis Island est « le lieu de l’exil », c’est bien sûr pour ces étrangers venus du monde entier, fuyant la misère et l’oppression (il y a dans les premières pages un émouvant rappel du psaume de l’exil « Sur les bords des fleuves de Babylone ») ; mais ce lieu est celui de l’exil aussi pour cet homme qui raconte en quelques journées un long passé tourmenté. Tourmenté par son travail, par le tri des êtres humains fondé sur vingt-neuf questions auxquelles ils doivent répondre avant d’être admis dans ce qu’ils imaginaient comme une terre promise, ou rejetés. Tourmenté aussi par son propre destin – son mariage et la mort prématurée de la femme aimée, la passion irrépressible et dramatique éprouvée pour une jeune italienne et la crise de conscience qui a suivi, la transgression de son devoir, les relations difficiles entretenues avec certains de ses subordonnés…
Plus que l’histoire d’Ellis Island, cette « Porte d’or rêvée », c’est donc celle de son « dernier gardien » que relate Gaëlle Josse, l’histoire d’un homme solitaire, dont la sensibilité et la générosité naturelles se sont heurtées à la nature humaine et aux lois collectives du devoir. « Seuls quelques visages émergent, fugitivement, comme sortis d’une brume, avant de retourner s’y fondre. Les visages de ceux dont j’aurais peut-être, dans une autre vie, aimé devenir l’ami, ou du moins échanger avec eux sans crainte de jugement, et sans position hiérarchique à tenir. ». Un « dernier gardien » d’une grande humanité.
Jean-Pierre Longre
10:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, notabilia, les Éditions noir sur blanc, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/11/2014
Retour sur Panaït Istrati
Monique Jutrin, Panaït Istrati, Un chardon déraciné, Éditions L’Échappée, 2014
Panaït Istrati, Présentation des Haïdoucs, Éditions L’Échappée, 2014

Longtemps méconnu, souvent ignoré, parfois méprisé, Panaït Istrati est pourtant l’un des grands écrivains européens des années 1920. Il revient en force, et c’est justice. L’association des Amis de Panaït Istrati, qui a récemment repris ses activités éditoriales, témoigne en particulier de cette réhabilitation, et y contribue avec bonheur, de même que plusieurs publications récentes.
Monique Jutrin (qui a par ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur Benjamin Fondane) a publié en 1970 la première grande biographie de l’auteur des Chardons du Baragan et de maints autres romans, un auteur qui était alors « oublié en Occident ». Ce livre, réédité avec retouches et actualisations de rigueur, se lit aujourd’hui avec autant d’intérêt qu’il y a quarante ans, faisant redécouvrir à la fois le « conteur » et « l’homme passionné », qui a connu « tous les degrés du bonheur et de la misère ». La première partie est un récit de vie intimement lié à l’œuvre, et aussi passionné que le fut l’homme – ce qui, dans le cas d’Istrati, est de très bon aloi, très naturel aussi. Les voyages, le « déracinement », les déboires, les joies, les illusions et désillusions politiques, l’entrée en écriture – tout fait l’objet de recherches précises, de témoignages directs, sans que soient occultées les questions (par exemple à propos de la tentative de suicide de 1921), ni « les détours et les contradictions dont est faite cette vie ».
La seconde partie de Panaït Istrati, Un chardon déraciné est spécifiquement consacrée à l’œuvre : les racines, les « sources populaires et historiques », « l’art du conteur », la réception… Une analyse fouillée, s’appuyant sur des citations nombreuses et convaincantes. Le livre de Monique Jutrin, documenté, vivant, relève à la fois du sérieux universitaire et de la lecture engagée auprès d’un auteur qui proclamait volontiers qu’il n’était « pas un écrivain comme les autres ».
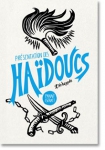 Le lecteur qui voudra (re)prendre contact concrètement avec l’œuvre (re)lira avec bonheur un autre ouvrage réédité par L’échappée, Présentation des Haïdoucs, que Panaït Istrati publia en 1925, après Oncle Anghel et avant Domnitza de Snagov. Entre une préface discrètement personnelle de Sidonie Mézaize et une étude littéraire circonstanciée de Carmen Oszi, les récits de Floarea, d’Élie, de Spilca et des autres comparses disent avec vigueur qui sont ces bandits au grand cœur, ces hommes (et femmes, oui !) d’honneur, ce que sont leurs sentiments et leurs exploits dont l’écho résonne avec puissance et originalité dans la rugueuse musique de l’écriture istratienne.
Le lecteur qui voudra (re)prendre contact concrètement avec l’œuvre (re)lira avec bonheur un autre ouvrage réédité par L’échappée, Présentation des Haïdoucs, que Panaït Istrati publia en 1925, après Oncle Anghel et avant Domnitza de Snagov. Entre une préface discrètement personnelle de Sidonie Mézaize et une étude littéraire circonstanciée de Carmen Oszi, les récits de Floarea, d’Élie, de Spilca et des autres comparses disent avec vigueur qui sont ces bandits au grand cœur, ces hommes (et femmes, oui !) d’honneur, ce que sont leurs sentiments et leurs exploits dont l’écho résonne avec puissance et originalité dans la rugueuse musique de l’écriture istratienne.
Jean-Pierre Longre
http://rhone.roumanie.free.fr/rhone-roumanie/index.php?op...
10:48 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, francophone, roumanie, monique jutrin, sidonie mézaize, carmen oszi, panaït istrati, éditions l’échappée, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/11/2014
L’histoire mouvementée de la famille Marinescu
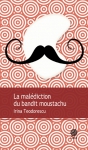 Irina Teodorescu, La malédiction du bandit moustachu, Gaïa, 2014
Irina Teodorescu, La malédiction du bandit moustachu, Gaïa, 2014
« L’homme à la longue moustache », bandit au grand cœur et trop confiant, meurt un jour « en maudissant Gheorghe Marinescu et toute sa descendance jusqu’en l’an deux mille ». Pourquoi ? Parce que le Marinescu en question, « petit-bourgeois qui a envie de s’enrichir », l’a laissé mourir de faim et de soif enfermé dans sa cave, tandis que, chassant ses derniers scrupules, il s’emparait du trésor destiné à être distribué aux pauvres. Et c’est le début d’une saga familiale semée de morts brutales et de deuils multiples.
Voilà qui aurait pu donner lieu à une longue suite tragique, à un vaste drame pathétique ou à un conte moral fondé sur une légende d’allure populaire dont la Roumanie a le secret. Il y a de tout cela, mais l’histoire racontée par Irina Teodorescu, par la grâce d’un style alerte et cocasse, par l’originalité du ton et du verbe, par la variété de l’imagination, va au-delà ; c’est un roman à la fois truculent et sensible, où le réalisme et le merveilleux se côtoient et se mélangent allègrement.
Les personnages, caractérisés par des surnoms pittoresques (Maria la Cadette, Maria la Cochonne, Ana la belle masochiste, Ion-Aussi, Margot la Vipère, Maria la Laide) ou par des portraits hauts en couleurs, tentent par tous les moyens d’enrayer la malédiction : pèlerinages, séjours au monastère, recours à la Tzigane diseuse de bonne aventure, enrichissement, carrière politique, générosité, méchanceté… Peine perdue. Au fil du siècle, de génération en génération, la mort guette et assaille la famille Marinescu, sans crier gare, aux moments où l’on s’y attend le moins – comme survint, par exemple, le tremblement de terre meurtrier de 1977. Car « dans cette vie imaginaire, des choses vraies se glissent malgré tout et se mélangent aux autres, les imaginées. ». C’est là l’un des mérites du roman : mêler les réalités de l’Histoire collective à celles du vécu individuel, de l’imagination et du fantasmatique. Les références à un passé vérifiable (la guerre, le communisme etc.) ne sont pas incompatibles avec les mystères qu’interrogent les âmes. Et sous la fable de « la malédiction du bandit moustachu », se tapit sans vraiment se cacher l’idée que la mort frappe n’importe quand, n’importe où, n’importe qui, que cela fait très mal à tout le monde, et d’abord aux proches.
Tout un roman pour aboutir à ce constat ? Oui, car il y a dans ce roman ce qu’il faut pour une lecture bondissante, émouvante, joyeuse même, et un goût des mots, de la phrase, de la langue qui avec délices se nourrit à la fois de la rigueur et de l’élasticité du français.
Jean-Pierre Longre
10:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, irina teodorescu, gaïa-éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/10/2014
Vive Modiano, merci Queneau !
 Patrick Modiano Prix Nobel de littérature 2014
Patrick Modiano Prix Nobel de littérature 2014
Les médias n’ont pas fini d’en parler… Laissons faire, et ne soyons pas plus bavards que le lauréat, pas plus, de même, que Raymond Queneau qui, lorsque Patrick était adolescent, lui donnait des cours de mathématiques (utiles ?), puis qui un peu plus tard l’introduisit dans le monde éditorial et lui permit de publier son premier roman. Il fut même témoin de son mariage, avec André Malraux (ce qui valut une dispute mémorable entre les deux écrivains à propos de Dubuffet…). L’essentiel, c’est l’œuvre. Voilà donc l’occasion de lire et de relire Modiano, de lire et de relire Queneau, de constater que les personnages romanesques de l’un et de l’autre ne sont pas étrangers les uns aux autres. Êtres au passé flou, en quête d’une identité qu’ils ont laissé échapper, suivant des itinéraires urbains aussi fluctuants que leur existence… Et de goûter bien d’autres choses encore…
Jean-Pierre Longre
Pour mémoire ou consultation :
http://jplongre.hautetfort.com/tag/patrick+modiano
http://jplongre.hautetfort.com/tag/raymond+queneau
http://lereseaumodiano.blogspot.fr/2012/01/raymond-quenea...
http://www.huffingtonpost.fr/jeannine-hayat/le-rire-de-qu...
16:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick modiano, raymond queneau, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/09/2014
« Une histoire rude »
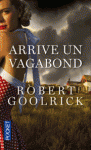 Robert Goolrick, Arrive un vagabond, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de Prémonville, Éditions Anne Carrière, 2012, Pocket, 2014
Robert Goolrick, Arrive un vagabond, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de Prémonville, Éditions Anne Carrière, 2012, Pocket, 2014
Pendant la première moitié du roman, on se sent bien. Blotties dans l’atmosphère sereine d’un petit bourg de Virginie, peu après la deuxième guerre mondiale, quelques familles vivent en harmonie dans des maisons bien rangées autour de boutiques où l’on trouve tout le nécessaire. Cette tranquillité tient certes à la bienveillance de chacun, mais aussi à l’autorité des pasteurs dans la bouche desquels l’enfer est une menace permanente, à un repli instinctif sur soi et à une ségrégation caractéristique des États-Unis d’Amérique de cette époque : chacun chez soi, les Blancs en ville, les Noirs en périphérie.
 Quand « arrive un vagabond », ce Charlie Beale épris de liberté, de la nature et des grands espaces, il est accueilli avec une curiosité un peu méfiante, mais sans animosité. Il est même pris en amitié par Will le boucher, sa femme Alma et surtout leur fils Sam, un petit garçon de cinq ans auquel il fait découvrir des tas de choses que recèle la campagne environnante et que ses parents n’ont pas le temps de lui montrer. Tout se passe d’une manière lisse, jusqu’au jour où Charlie s’éprend de Sylvan, jeune femme à peine tirée de l’enfance et de sa campagne reculée par un homme brutal qui l’a carrément achetée à ses parents afin de l’épouser. Sylvan, qui par films et magazines interposés ne rêve que de Hollywood et de robes de stars, voit le beau Charlie à travers le prisme du cinéma et de ses rêves. Elle n’a donc pas de mal à se laisser aimer passionnément par le nouveau venu. À partir de là commence la descente ; le mal s’insinue d’abord sournoisement, puis les destins vont basculer de plus en plus tragiquement, sous les yeux du petit garçon lié à Charlie par une promesse tenace.
Quand « arrive un vagabond », ce Charlie Beale épris de liberté, de la nature et des grands espaces, il est accueilli avec une curiosité un peu méfiante, mais sans animosité. Il est même pris en amitié par Will le boucher, sa femme Alma et surtout leur fils Sam, un petit garçon de cinq ans auquel il fait découvrir des tas de choses que recèle la campagne environnante et que ses parents n’ont pas le temps de lui montrer. Tout se passe d’une manière lisse, jusqu’au jour où Charlie s’éprend de Sylvan, jeune femme à peine tirée de l’enfance et de sa campagne reculée par un homme brutal qui l’a carrément achetée à ses parents afin de l’épouser. Sylvan, qui par films et magazines interposés ne rêve que de Hollywood et de robes de stars, voit le beau Charlie à travers le prisme du cinéma et de ses rêves. Elle n’a donc pas de mal à se laisser aimer passionnément par le nouveau venu. À partir de là commence la descente ; le mal s’insinue d’abord sournoisement, puis les destins vont basculer de plus en plus tragiquement, sous les yeux du petit garçon lié à Charlie par une promesse tenace.
L’art de Robert Goolrick tient du piège et de l’accélération. D’abord la mise en confiance, qui confine à la monotonie rassurante, puis des péripéties apparemment sans conséquences et restant dans les normes du comportement humain (l’amitié solide, l’amour joyeusement fou), enfin le drame, qui arrive presque sans crier gare et qui laissera des traces indélébiles. Comme l’explique le narrateur final, cinquante ans après, à de nouveaux venus dans le pays : « C’est une histoire rude. Aussi accueillant qu’il paraisse, ce n’est pas un pays facile. Mais on ne peut vivre de la terre sans la connaître, on ne peut la fouler sans se rappeler que nos pas ne sont pas les premiers ». Oui, une histoire rude, d’amour, de terre et de sang.
Jean-Pierre Longre
11:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, états-unis, robert goolrick, marie de prémonville, éditions anne carrière, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/09/2014
Paradoxes et vérité
Russell Banks, Lointain souvenir de la peau. Traduit de l’américain par Pierre Furlan, Actes Sud, 2012, Babel, 2013
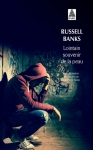
Premier paradoxe : aux États-Unis d’Amérique, les délinquants sexuels condamnés puis libérés ne doivent pas sortir des limites de leur comté, et ont interdiction de résider à moins de 800 mètres d’un lieu susceptible d’être fréquenté par des enfants (école, bibliothèque, centre de loisirs etc.). En Floride, dans le comté de Calusa (nom sous lequel ne se cache pas vraiment celui de Miami), quelles solutions leur reste-t-il ? L’aéroport, les marais ou le viaduc qui relie la ville à la mer, et sous lequel vit effectivement une colonie de parias.
Second paradoxe : le Kid, 21 ans, bracelet électronique à la cheville, fait partie de ces parias, et a planté sa tente sous ce viaduc. Pourtant, il est vierge. Son addiction au sexe, qui le tient depuis l’enfance, est purement virtuelle, passant par des sites internet qui n’ont aucun secret pour lui ; la seule incursion qu’il a faite dans le monde réel n’a été qu’une tentative minable, un lamentable piège, et lui a valu sa condamnation. Vierge sexuellement, il l’est aussi socialement ; sans attache parentale, ses seuls amis sont un iguane, puis une chienne et un perroquet ; ses compagnons d’infortune ne sont que des voisins plus ou moins clochardisés, puis ou moins sympathiques, obéissant au « chacun pour soi » des exclus. Frotté à la dure réalité, le Kid perdra sa naïveté, aura l’occasion de mettre son intelligence à l’épreuve, de toucher du doigt la complexité de l’existence : « À présent, lentement, il commence à se rendre compte qu’il pourrait ne pas être quelqu’un d’exceptionnel mais qu’au moins il a une importance par le simple fait d’être qui il est, qu’en réalité il n’est pas comme la masse de l’humanité telle qu’elle était à ses débuts, comme ces gens dont la vie entière, tout ce qu’ils décidaient de faire ou de ne pas faire, était déterminée par des facteurs extérieurs, par les conditions et les circonstances de leur naissance et par les gens qu’ils trouvaient là pour les accompagner dans leur vie ».
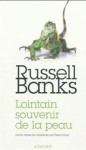
Cette démarche et cette transformation sont déclenchées par l’arrivée dans la vie du Kid d’un étrange personnage, le « Professeur », qui dans le cadre de ses recherches sociologiques s’intéresse particulièrement au jeune homme. Sans dévoiler les mystères de son propre passé ni les secrets de son présent, le « Professeur » parvient à faire parler son protégé, à lui faire prendre conscience de la vie, des sentiments, des relations humaines, mais aussi de la difficulté, voire de l’impossibilité de connaître la vérité, comme il est impossible de savoir si le trésor des pirates de jadis est vraiment caché quelque part.
Voilà une des questions centrales de ce grand roman : peut-on croire sans savoir ? « Ouais, bon, moi, il faut que je sache si cette histoire est vraie ou pas. Parce que s’il s’agit juste de croire, je peux aller d’un côté comme de l’autre. Et si je vais d’un côté, mon « comportement humain » sera pas le même que si je vais de l’autre et vice versa. Quel que soit le côté où je vais, j’aurai peur que ce soit pas le bon côté, et mon comportement humain sera pas bon non plus. On est pas dans un roman ou un film, tu comprends, où des conneries de ce genre n’ont aucune importance puisqu’à la fin on sait ce qui s’est réellement passé ». Dernier enchaînement de paradoxes : Lointain souvenir de la peau est bien un roman, mais un roman qui interroge la réalité sans forcément trouver de réponse, une fiction que l’on peut ranger dans la catégorie du réalisme social, mais qui met en avant les mensonges d’une société disparaissant sous les illusions du monde virtuel des écrans d’ordinateurs. « Ce qu’il sait pourtant, c’est que si rien n’est vrai, alors rien n’est réel. La logique le lui dit. Et si rien n’est réel, alors rien n’a d’importance ».
Jean-Pierre Longre
18:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, états-unis, russel banks, pierre furlan, actes sud, leméac, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/09/2014
La perfection, jusqu’à la perte.
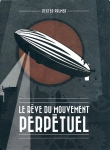 Dexter Palmer, Le rêve du mouvement perpétuel, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel et Blandine Longre, Passage du Nord-Ouest, 2014
Dexter Palmer, Le rêve du mouvement perpétuel, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel et Blandine Longre, Passage du Nord-Ouest, 2014
Enfermé dans le « vaillant navire Chrysalide », vaste zeppelin censé fonctionner pour l’éternité, Harold Winslow, jeune homme ordinaire, héros malgré lui d’aventures extraordinaires, narrateur scrupuleux et acteur étonné, couche par écrit ses souvenirs – c’est-à-dire tout ce qui l’a mené à s’embarquer dans le monstrueux véhicule aérien.
Récit touffu, plein de péripéties inattendues et de personnages étranges, Le rêve du mouvement perpétuel met en scène Prospero Taligent, « le plus prodigieux et le plus doué des inventeurs du XXème siècle », qui règne sur Xéroville dominée par l’immense tour où, pour la protéger des ravages du monde et du temps, il a enfermé sa trop aimée fille Miranda, et où l’on découvrira aussi son « fils » Caliban, créature difforme et complexe. Il y a aussi Astrid, la sœur de Harold, artiste au cheminement absolu et suicidaire. Il y a encore les robots (vrais ou faux, c’est selon) fabriqués par Prospero, qui de plus en plus envahissants s’adonnent aux tâches nécessaires à la vie collective, et dont on ne sait s’ils vont atteindre le niveau d’intelligence et d’initiative des humains… Voilà, entre autres phénomènes, qui suscite des réflexions poussées sur l’âme, l’esprit, le progrès, les rapports des hommes entre eux…
Comment qualifier le genre de ce rebondissant roman ? Science-fiction ou anticipation ? Dans ce cas, c’est de la rétro-anticipation (rétrofuturisme, dira-t-on), puisque tout se passe dans un XXe siècle tel qu’aurait pu l’imaginer le XIXème. Fantastique ? Merveilleux ? Il est vrai que les actes terribles et hors normes auxquels conduit l’amour fou de Prospero pour sa fille n’occultent pas par exemple les aspects merveilleux de l’enfance qu’elle a vécue, auxquels Harold n'est pas étranger. De même, la relation dramatique des événements n’exclut pas la distance humoristique et satirique de certains chapitres. Il faut aussi évoquer le démarquage littéraire, évident, revendiqué, puisque les protagonistes de La Tempête de Shakespeare sont là : Prospero, Miranda, Caliban… Un Prospero qui ne vieillit pas : « Je n’ai pas de passé. Vous pouvez toujours imaginer que je fus un jour petit, jeune et sans sagesse, comme vous autrefois, mais j’ai toujours été tel que je vous apparais aujourd’hui. Un vieux magicien en exil, depuis toujours ». Un magicien vieux sans doute, mais moderne, et dont la quête de perfection ne peut mener qu’à la mort figée ou à l’enfermement onirique. Souvenons-nous de La Tempête, acte IV, scène 1 : « Nous sommes faits de la même étoffe que les songes, et notre petite vie, un songe la parachève ».
Jean-Pierre Longre
http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/-Passage-du-Nord-O...
18:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, dexter palmer, anne-sylvie homassel, blandine longre, passage du nord-ouest, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/09/2014
Rêves d’azur
 Jérôme Garcin, Bleus Horizons, Gallimard, 2013, Folio, 2014
Jérôme Garcin, Bleus Horizons, Gallimard, 2013, Folio, 2014
Né à Bordeaux en 1886, Jean de la Ville de Mirmont est mort sur le front en novembre 1914, laissant une œuvre forcément interrompue : un bref roman, Les dimanches de Jean Dézert, quelques contes et, surtout, un recueil poétique, L’horizon chimérique. Qui s’en souvient ? Quelques amateurs éclairés, quelques lecteurs obstinés, quelques auditeurs attentifs aussi, puisque les beaux vers du poète ont été mis en musique par Gabriel Fauré. Les autres ne savent pas ce qu’ils perdent.
Jérôme Garcin, qui a l’art de ressusciter de grandes silhouettes enfouies sous des années d’oubli (pensons, par exemple, à ce qu’il a écrit sur Jean Prévost, mort dans le Vercors, lui aussi les armes à la main, trente ans après Jean de la Ville de Mirmont), le fait cette fois par le truchement d’un personnage imaginaire, Louis Gémon, frère d’armes du poète, blessé au Chemin des Dames, qui va consacrer sa vie à la mémoire de Jean. La consacrer sans relâche, jusqu’à sacrifier son existence sociale, jusqu’à en mourir seul dans une obscure maison des bords de l’Yonne. Avant cela, écrit-il, « m’occuper de Jean fut ma seule raison de vivre. Il donnait un sens à ce qui n’avait plus de sens. Si je n’avais décidé, un matin, de faire connaître ses poèmes et son roman, de lui tendre la main comme s’il me glissait le témoin dans la tranchée où il fut enterré vivant, peut-être aurais-je mis fin à mes jours. Il m’a distrait de mon chagrin, il m’a sauvé de la dépression ». Et la seule œuvre que laissera Louis est Bleus Horizons, ce manuscrit abandonné sur son bureau.
 La fiction est un moyen de rendre le réel plus prégnant, et le roman de Jérôme Garcin l’atteste magistralement. Le réel collectif, comme ce début de l’été 1914, où l’ambiance est à l’enthousiasme patriotique avec lequel tout le monde pense que la guerre ne sera qu’une « formalité », voire une « belle expérience »… « Nous étions invincibles. Dieu que nous étions bêtes ». Et, bien sûr, le réel individuel, le destin tragique du jeune héros, l’amour exclusif et réciproque qu’il éprouvait pour sa mère, ses rêves de voyages lointains, son « courage incroyable », son « goût pour l’exceptionnel »… Et il y a l’intangible, suggéré par les mots et les vers de Jean de la Ville de Mirmont qui rythment la narration, qui lui donnent sa couleur poétique et pathétique. Au-delà des hommes, au-delà des faits, L’horizon chimérique est, en quelque sorte, le personnage principal et omniprésent de ce livre émouvant et ardent.
La fiction est un moyen de rendre le réel plus prégnant, et le roman de Jérôme Garcin l’atteste magistralement. Le réel collectif, comme ce début de l’été 1914, où l’ambiance est à l’enthousiasme patriotique avec lequel tout le monde pense que la guerre ne sera qu’une « formalité », voire une « belle expérience »… « Nous étions invincibles. Dieu que nous étions bêtes ». Et, bien sûr, le réel individuel, le destin tragique du jeune héros, l’amour exclusif et réciproque qu’il éprouvait pour sa mère, ses rêves de voyages lointains, son « courage incroyable », son « goût pour l’exceptionnel »… Et il y a l’intangible, suggéré par les mots et les vers de Jean de la Ville de Mirmont qui rythment la narration, qui lui donnent sa couleur poétique et pathétique. Au-delà des hommes, au-delà des faits, L’horizon chimérique est, en quelque sorte, le personnage principal et omniprésent de ce livre émouvant et ardent.
« À vivre parmi vous, hélas ! avais-je une âme ?
Mes frères, j’ai souffert sur tous vos continents.
Je ne veux que la mer, je ne veux que le vent
Pour me bercer, comme un enfant, au creux des lames. »
Jean-Pierre Longre
16:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, poésie, francophone, jean de la ville de mirmont, jérôme garcin, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Le puzzle des destins croisés
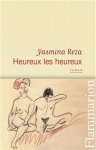 Yasmina Reza, Heureux les heureux, Flammarion, 2013, Folio, 2014
Yasmina Reza, Heureux les heureux, Flammarion, 2013, Folio, 2014
Yasmina Reza, on le sait, est une femme de théâtre. Et Heureux les heureux, roman aux multiples personnages, pourrait l’attester si c’était nécessaire. Comme sur une scène aux profondeurs insondables, passent des êtres, des couples, des groupes sur lesquels, tour à tour, se fait la lumière et se focalise l’attention, tandis que les autres restent dans l’ombre, silhouettes mystérieusement concernées.
De même que vont et viennent les personnages, avec leurs aventures intimes et leurs relations sociales, se succèdent dans l’esprit du lecteur des questions qui tournent autour de l’amour, de la souffrance, de la violence, de la mort – celles que la littérature pose inlassablement. Dans La vie mode d’emploi de Perec, l’unité de l’ensemble se construit sur les multiples ouvertures de l’immeuble où se croisent les destins. Dans Heureux les heureux, elle se compose différemment, mais elle est bien là, dans la vivante convergence de tous les monologues, dans l’ironie pessimiste du ton, dans l’incessante interrogation des humains.
La réputation de Yasmina Reza n’est plus à faire, il est donc inutile d’en dire davantage. Il faut lire Heureux les heureux, texte foisonnant, aux potentialités innombrables, aux ramifications infinies.
Jean-Pierre Longre
15:45 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, yasmina reza, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Roman d’errances
 Julia Deck, Viviane Élisabeth Fauville, Éditions de Minuit, 2012, Minuit "Double", 2014
Julia Deck, Viviane Élisabeth Fauville, Éditions de Minuit, 2012, Minuit "Double", 2014
Dès les premières pages, on croit tout savoir : Viviane Élisabeth Fauville est une femme d’aujourd’hui ; la quarantaine, une enfant de douze semaines, un mari qui vient de la quitter pour une autre, elle travaille comme responsable de la communication dans une grosse entreprise. Une bourgeoise moderne, en quelque sorte. Puis l’information nous arrive sans ambages : « Vous avez déménagé le 15 octobre, trouvé une nourrice, prolongé votre congé maternité pour raisons de santé et, le lundi 16 novembre, c’est-à-dire hier, vous avez tué votre psychanalyste ».
On croit tout savoir, et l’on ne sait rien. « Heureusement, je suis là pour reprendre la situation en main », annonce la quatrième de couverture. Si le « vous », le « elle » et le « je » alternent dans la désignation de la protagoniste, en une navigation entre les points de vue, entre prise en charge empathique, rapport objectif et tentatives d’introspection, il y a un autre « je » invisible mais omniprésent, un « je » narrateur qui cache son jeu mais qui mène le récit à sa guise.
 Et qui guide les pas, les gestes, les réactions, les relations de Viviane ; les pas qui la font circuler dans le Paris des rues, des boulevards et des squares, dans le Paris souterrain du métro ; les gestes bizarres et apparemment fous ; les réactions incohérentes ; les relations étranges avec le bébé, le mari, la mère absente-présente, la police, les personnes mêlées à l’assassinat… « Je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, mais je le fais. Qu’on n’aille pas croire que je pense que c’est une bonne idée ou que j’en suis fière, c’est juste que cela s’impose : mes pieds avancent et je les suis ». Les errances urbaines sont les mises en espace des errances mentales d’une femme dont l’existence prévisibles et les souvenirs bien rangés ont été bouleversés par les grains de sable glissés dans les rouages. La psychanalyste est-elle un recours ? Mortelle, la psychanalyse ! Alors quoi ? La vie ?
Et qui guide les pas, les gestes, les réactions, les relations de Viviane ; les pas qui la font circuler dans le Paris des rues, des boulevards et des squares, dans le Paris souterrain du métro ; les gestes bizarres et apparemment fous ; les réactions incohérentes ; les relations étranges avec le bébé, le mari, la mère absente-présente, la police, les personnes mêlées à l’assassinat… « Je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, mais je le fais. Qu’on n’aille pas croire que je pense que c’est une bonne idée ou que j’en suis fière, c’est juste que cela s’impose : mes pieds avancent et je les suis ». Les errances urbaines sont les mises en espace des errances mentales d’une femme dont l’existence prévisibles et les souvenirs bien rangés ont été bouleversés par les grains de sable glissés dans les rouages. La psychanalyste est-elle un recours ? Mortelle, la psychanalyse ! Alors quoi ? La vie ?
Jean-Pierre Longre
15:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, julia deck, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2014
L’errance et la conscience
 Alexis David-Marie, Prométhée vagabond, Aux forges de Vulcain, 2014
Alexis David-Marie, Prométhée vagabond, Aux forges de Vulcain, 2014
Paul, étudiant sorbonnard, pour avoir commis une faute dont le mystère ne sera livré qu’en cours de route, est envoyé par son recteur à la recherche de l’un de ses condisciples, Jean-Baptiste Larpenteur (nom clairement symbolique), impie notoire, auteur de pamphlets qui l’ont contraint à l’exil. Un premier obstacle franchi (la guerre sur le Rhin), Paul pénètre en Allemagne : Weimar, Iéna… et trouve son blasphémateur au milieu d’une compagnie d’étudiants dépravés. À partir de là, il ne le lâchera plus, et tous deux vont parcourir, sur terre et sur mer, l’Europe des années 1670, de Iéna à Lübeck, de Lübeck à Bordeaux, et de Bordeaux vers Paris à travers les campagnes les plus reculées de France, d’infortunes en vicissitudes, miséreux parmi les miséreux. Parfois, une heureuse rencontre leur fournit de quoi survivre, parfois, ils échappent de peu à la mort. On fait même la connaissance de quelques autres protagonistes hauts en couleurs, parmi lesquels le narrateur en personne, compréhensif et accueillant.
Comme Prométhée, les deux jeunes gens devenus compères cherchent dans leurs tribulations à capter le feu de la vie, sur des chemins identiques mais chacun à sa manière. Car leurs aventures physiques, géographiques, sociales, si elles leur permettent de mieux connaître le genre humain, relèvent aussi de la quête intérieure. Entre eux, qui ne sont au départ d’accord sur rien, les discussions vont bon train : foi chrétienne contre athéisme, Dieu contre constellations, certitudes contre angoisse de l’ignorance… Peu à peu, ils apprennent à se comprendre, à s’apprécier, à se libérer de leurs contraintes spirituelles et intellectuelles. Larpenteur, à la recherche d’une trinité sans divinité, n’est plus prisonnier de lui-même, et Paul se détache des croyances toutes faites pour se mettre au service des hommes, pour faire rimer « errance » et « vérité ». Chacun, dans ses vagabondages, trouve sa conscience et sa lumière.
Roman picaresque, roman initiatique, Prométhée vagabond est aussi la chronique d’une conversion à la révolte teintée de libertinage. Le roman comique de Scarron et le Dom Juan de Molière sont passés par là.
Jean-Pierre Longre
15:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alexis david-marie, aux forges de vulcain, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/07/2014
Verdun, l’autre bord
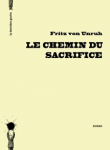 Fritz von Unruh, Le chemin du sacrifice. Traduit de l’allemand par Martine Rémon, préface de Nicolas Beaupré, illustrations de Vincent Vanoli. La dernière goutte, 2014
Fritz von Unruh, Le chemin du sacrifice. Traduit de l’allemand par Martine Rémon, préface de Nicolas Beaupré, illustrations de Vincent Vanoli. La dernière goutte, 2014
Fritz von Unruh fait partie de ceux que Nicolas Beaupré appelle les « écrivains combattants ». Dans Le chemin du sacrifice (titre original : Opfergang), qui fut censuré en 1918 et qui fut peut-être à l’origine de son pacifisme et plus tard de ses courageuses positions antinazies, il fait certes preuve de son expérience de soldat de la « grande guerre », mais il va bien au-delà. À travers la fiction, en quatre actes tragiques (« L’approche », « La tranchée », « L’assaut », « Le sacrifice »), la réalité morbide de la bataille de Verdun devient une autre expérience, celle de la littérature.
Après la première traduction (plus ou moins fidèle, plus ou moins édulcorée) de Jacques Benoist-Méchin, celle de Martine Rémon restitue la force expressionniste du style de l’auteur. Les dialogues et monologues des personnages, archétypes humains traumatisés par la violence folle de la bataille, l’évocation de leurs souffrances physiques et morales, de leurs résistances et de leurs faiblesses, les descriptions hallucinées des combats sanguinaires, tout concourt à faire du récit une mosaïque de tableaux pathétiques. Un exemple ? « Chaque homme était à son poste. La mèche rougeoyait en bordure du grand champ de mines. Les abris flamboyaient de mille yeux. Un battement de cœur rempli d’espoir martelait les pelotes serrées de fantassins et un vacarme à détruire les mondes inondait de ses ondes incandescentes les oreilles des combattants. Les cerveaux subissaient un pilonnage en règle ».
Parfois, une incursion au sein de l’état-major donne la mesure du cynisme de la hiérarchie militaire – à l’image de cette réponse du général en chef à l’un de ses subordonnés se plaignant de l’épuisement des hommes et du nombre des pertes : « C’est normal que nous ayons des pertes ! s’exaspéra-t-il en jetant la liste dans un coin de la pièce. J’attends les Anglais à Arras. Pas question de gaspiller tout mon matériel ici ! Nous devons y arriver avec ce corps ! 400 000 pertes ? Ça rejoint mes calculs ». Preuve, du côté allemand comme du côté français, de l’infini écart entre les délires patriotiques et les vérités de la boucherie. Deux bords cruellement opposés, qui ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Et puisque nous en sommes aux écarts, le livre pose aussi la question de ce qui en l’homme oppose et unit le rêve lumineux et la sombre réalité. « L’atmosphère commençait à resplendir à l’arrière des rafales. Dans un rêve né de la surexcitation, la guerre se détacha de la terre, jusqu’à ce que celle-ci se soulevât, libre de respirer, et que le rire des enfants vînt couvrir toute destruction. Quels yeux, quelles larmes ! Partout cette lumière ! La planète Terre la saluait avec des cris de joie comme une alouette lance ses trilles au matin, elle fondait et se perdait dans les délices du soleil. Clemens tendait ses bras vers l’astre. Mais des milliers d’atrocités surgies d’abîmes où le sang se glace et la raison se perd s’accrochaient encore à ses jambes et le tiraillaient. Alors, d’un geste résolu, il desserra l’étreinte et déchira son rêve ».
Saturé de violence et d’humanité, d’illusion et de désespoir, d’humour noir et de pathos, de satire et de compassion, Le chemin du sacrifice est un grand roman, qu’on ne lit pas sans angoisse, ni sans empathie. Dans cette nouvelle et belle édition, les gravures en noir et blanc de Vincent Vanoli sont en phase directe avec l’expressivité de l’écriture.
Jean-Pierre Longre
15:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, allemagne, guerre de 14-18, fritz von unruh, martine rémon, nicolas beaupré, vincent vanoli, la dernière goutte, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/07/2014
« Je ne sais plus pourquoi je meurs »
Sorj Chalandon, Le quatrième mur, Grasset, 2013, Le Livre de Poche, 2014
Prix Goncourt des lycéens 2013
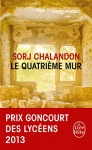 Le récit commence sur un rythme essoufflé, violent, dans le sang et la souffrance, et toute la suite du roman est un long retour en arrière haletant – mieux qu’un reportage sur la guerre du Liban, un roman à la fois personnel et collectif, où la réalité se laisse déborder par la fiction narrative.
Le récit commence sur un rythme essoufflé, violent, dans le sang et la souffrance, et toute la suite du roman est un long retour en arrière haletant – mieux qu’un reportage sur la guerre du Liban, un roman à la fois personnel et collectif, où la réalité se laisse déborder par la fiction narrative.
Georges, un peu étudiant, un peu théâtreux, un peu pion, a participé à toutes les luttes gauchistes et pro-palestiniennes des années 1970, mais vit aussi l’amour et les joies de la paternité. En 1982, il se laisse persuader par son ami et mentor mourant, Sam, Grec et Juif, qui fut victime de la dictature des Colonels et militant de la justice et de la liberté, de partir pour le Liban en guerre prendre la relève de son utopie. Il s’agit de mettre en scène Antigone d’Anouilh et de faire jouer la pièce par des comédiens issus de toutes les religions, de toutes les factions qui se combattent les unes les autres, Druzes, Chiites, Palestiniens, Chrétiens, et ainsi de donner au théâtre l’occasion de mettre un instant entre parenthèses les tirs, les bombardements, les attentats, les embuscades et les contrôles meurtriers, laissant aux acteurs la liberté de tirer au profit de leur cause l’interprétation de leur rôle.

Tout cela est une histoire de combats. Pas seulement ceux qui se déroulent à Beyrouth, mais aussi celui de Sam contre la mort (de son corps et de son projet), celui de Georges en proie à sa lutte intérieure (choisir entre le bonheur simple de la vie familiale et le malheur irrésistible, confinant à la folie, de la guerre fratricide), celui du lecteur contre l’émotion et la rage qui l’étreignent devant le récit des massacres, devant la description du camp de Chatila dévasté par la barbarie aveugle, et celui de la petite Antigone contre le pouvoir de Créon, du devoir fraternel et mortel contre la tentation de la vie ; le choix d’Antigone sera-t-il aussi celui de Georges ?
Sorj Chanlandon, vrai journaliste et vrai romancier, montre ici combien la réalité peut fournir une matière romanesque prenante et terrible, et combien la fiction peut permettre de saisir la réalité et de poser les questions essentielles. De quoi faire résonner la fameuse réplique d’Antigone : « Je ne sais plus pourquoi je meurs ».
Jean-Pierre Longre
15:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, sorj chalandon, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
L’ombre de l’essentiel
Patrick Modiano, L’herbe des nuits, Gallimard, 2012, Folio, 2014
 On le sait depuis longtemps, Patrick Modiano a l’art de suggérer, de laisser entrevoir l’ombre de l’essentiel, tout en faisant savoir à mots couverts que jamais celui-ci ne pourra être dévoilé. Bien sûr, ici, il y a le « carnet noir » dans lequel sont notés des noms de lieux, des dates, des détails concrets, des repères dont on se demande souvent quoi faire. Bien sûr, les personnages ont des noms, des semblants d’identités dont on ne sait jamais si la forme correspond au fond. Identité ? Nom, origine, profession, nationalité… Oui, il y a dans le roman une sorte d’enquête policière, et il y a « la bande de Montparnasse », celle qui apparaît – tableau récurrent – dans le hall de l’Unic Hôtel, et qui a quelque chose à voir avec le Maroc, un enlèvement, un assassinat (l’affaire Ben Barka, puisque c’est apparemment l’époque)… Aghamouri, le faux étudiant attardé, l’inquiétant « Georges », et puis Paul Chastagnier, Duwelz, Gérard Marciano – ces quelques hommes que semble fréquenter et aussi fuir Dannie.
On le sait depuis longtemps, Patrick Modiano a l’art de suggérer, de laisser entrevoir l’ombre de l’essentiel, tout en faisant savoir à mots couverts que jamais celui-ci ne pourra être dévoilé. Bien sûr, ici, il y a le « carnet noir » dans lequel sont notés des noms de lieux, des dates, des détails concrets, des repères dont on se demande souvent quoi faire. Bien sûr, les personnages ont des noms, des semblants d’identités dont on ne sait jamais si la forme correspond au fond. Identité ? Nom, origine, profession, nationalité… Oui, il y a dans le roman une sorte d’enquête policière, et il y a « la bande de Montparnasse », celle qui apparaît – tableau récurrent – dans le hall de l’Unic Hôtel, et qui a quelque chose à voir avec le Maroc, un enlèvement, un assassinat (l’affaire Ben Barka, puisque c’est apparemment l’époque)… Aghamouri, le faux étudiant attardé, l’inquiétant « Georges », et puis Paul Chastagnier, Duwelz, Gérard Marciano – ces quelques hommes que semble fréquenter et aussi fuir Dannie.
Dannie a sûrement d’autres noms, d’autres identités, mais peu importe au tout jeune homme qu’était alors Jean, le narrateur. « Elle a fait quelque chose d’assez grave… ». Quoi ? Est-ce primordial ? Comme la Nadja d’André Breton, comme, dans un autre registre, l’Odile de Raymond Queneau, elle est de ces jeunes femmes qu’entourent des mystères dans lesquels l’amour a quelque chose à voir, sans que cela soit jamais clairement proclamé ; de ces êtres qui dévoilent une facette de leur personnalité pour mieux occulter les autres, qui cachent leur histoire sans avoir l’air de le vouloir.
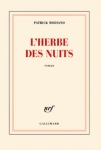
La narration, tout en zigzags et allers-retours, est une quête sans fin que symbolisent les itinéraires parisiens et nocturnes, dans le labyrinthe quasi végétal des rues, des boulevards, d’où émergent quelques lieux de rendez-vous, bouches de métro, cafés, carrefours… Quête du passé de Dannie, quête de soi, quête d’un temps révolu qui se superpose au présent : « Derrière la vitre, la chambre est vide, mais quelqu’un a laissé la chambre allumée. Il n’y a jamais eu pour moi ni présent ni passé. Tout se confond, comme dans cette chambre vide où brille une lampe, toutes les nuits. ». Quête qui doit beaucoup à l’errance et à l’attente d’on ne sait quoi : « Je plaignais ceux qui devaient inscrire sur leur agenda de multiples rendez-vous, dont certains deux mois à l’avance. Tout était réglé pour eux et ils n’attendraient jamais personne. Ils ne sauraient jamais que le temps palpite, se dilate, puis redevient étale, et peu à peu vous donne cette sensation de vacances et d’infini que d’autres cherchent dans la drogue, mais que moi je trouvais tout simplement dans l’attente. ». Paradoxalement, chez Patrick Modiano, c’est la ténuité des liens entre le temps et l’espace, entre la surface des personnages et l’insondable des êtres, entre la légèreté du réel et le poids des interrogations qui constitue la force de l’écriture romanesque.
Jean-Pierre Longre
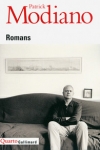 La collection « Quarto » de Gallimard réunit dix romans de Patrick Modiano : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures, Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder, Accident nocturne, Un pedigree, Dans le café de la jeunesse perdue, L’horizon.
La collection « Quarto » de Gallimard réunit dix romans de Patrick Modiano : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures, Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder, Accident nocturne, Un pedigree, Dans le café de la jeunesse perdue, L’horizon.
Présentation de l’auteur : «Ces "romans" réunis pour la première fois forment un seul ouvrage et ils sont l'épine dorsale des autres, qui ne figurent pas dans ce volume. Je croyais les avoir écrits de manière discontinue, à coups d'oublis successifs, mais souvent les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes lieux, les mêmes phrases reviennent de l'un à l'autre, comme les motifs d'une tapisserie que l'on aurait tissée dans un demi-sommeil. Les quelques photos et documents reproduits au début de ce recueil pourraient suggérer que tous ces "romans" sont une sorte d'autobiographie, mais une autobiographie rêvée ou imaginaire. Les photos mêmes de mes parents sont devenues des photos de personnages imaginaires. Seuls mon frère, ma femme et mes filles sont réels. Et que dire des quelques comparses et fantômes qui apparaissent sur l'album, en noir et blanc? J'utilisais leurs ombres et surtout leurs noms à cause de leur sonorité et ils n'étaient plus pour moi que des notes de musique.»
Patrick Modiano
Un rappel
 Patrick Modiano, La petite Bijou, Gallimard, 2001, Folio, 2002.
Patrick Modiano, La petite Bijou, Gallimard, 2001, Folio, 2002.
Dans De si braves garçons, il y a plus de vingt ans, était évoquée l’histoire de la Petite Bijou ; Patrick Modiano, qui avoue lui-même avoir « l’impression depuis plus de trente ans d’écrire le même livre », l’a reprise et développée dans un roman paru en 2001, et publié à bon escient dans la collection Folio en novembre 2002.
La Petite Bijou, c’est le surnom (le « nom d’artiste ») d’une fillette qui, devenue adulte (disons, une jeune adulte de 19 ans prénommée Thérèse), se met en quête de son passé, une quête fébrile, qui lui procure les images obscures d’une mère distante, d’un oncle (resté en tout cas comme tel dans la mémoire) qui lui prodigue une affection en pointillés, d’un chien perdu, d’une grande maison vide près du Bois de Boulogne... Le déclic de cette quête, c’est une femme en manteau jaune entrevue à la station Châtelet, et en qui Thérèse croit reconnaître cette mère dont on lui a pourtant dit qu’elle est morte au Maroc. S’ensuivent des filatures en direction de Vincennes, vers un grand immeuble désolé, des déambulations dans Paris, la rencontre d’un gentil traducteur d’émissions radiophoniques étrangères, d’une pharmacienne à l’affection toute maternelle, d’un couple étrange qui lui confie la garde de sa petite fille, - et ce couple, comme par hasard, habite une grande maison vide en bordure du Bois de Boulogne et, comme par hasard, ne se soucie guère de la fillette livrée à elle-même...
L’écriture est précise, le monde est flou. Mondes du passé et du présent qui se mêlent, se superposent en couches parallèles, se brouillent comme les voix de la radio et du téléphone ; monde urbain, parcouru en lignes brisées selon des itinéraires complexes et récurrents, parsemé de lieux-repères entre Vincennes et Neuilly (stations de métro, café du Néant, hôtel...), dans un Paris de rêve et de cauchemar, où la foule fantomatique vaque comme dans un théâtre d’ombres. Evidemment, les parcours de la Petite Bijou dans le temps et dans l’espace sont les images de son parcours intérieur, d’une recherche d’elle-même qui risque de lui être fatale, mais qui peut aussi lui permettre de renouer avec la vie.
Si certains affirment que Modiano écrit toujours le même livre, le lecteur trouve toujours son plaisir (le même et un autre) au contact de personnages qui, dans leurs zones secrètes, recèlent les mystères de tout être doué d’humanité.
Jean-Pierre Longre
15:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick modiano, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Croisements ferroviaires, bifurcations personnelles
Gaëlle Josse, Noces de neige, Autrement / Littérature, 2013, J'ai lu, 2014
 Anna Alexandrovna Oulianova, jeune aristocrate russe, laide et mal aimée de sa mère la « somptueusement belle » Maria Petrovna, passe chaque année avec sa famille un hiver de fêtes et de mondanités sur la Côte d’Azur. En mars 1881, tout le monde prend le train de retour vers Saint-Petersbourg. En compagnie de Mathilde, sa jeune gouvernante française, Anna Alexandrovna voyage au rythme de ses souvenirs et de ses projets, dans la hâte de retrouver les chevaux, qui sont sa passion, et Dimitri Sokolov, cadet du tsar, qui un jour lui a dit cette phrase qui ne sort pas de sa mémoire : « Comme vous êtes radieuse, Anna Alexandrovna, tellement radieuse ! ».
Anna Alexandrovna Oulianova, jeune aristocrate russe, laide et mal aimée de sa mère la « somptueusement belle » Maria Petrovna, passe chaque année avec sa famille un hiver de fêtes et de mondanités sur la Côte d’Azur. En mars 1881, tout le monde prend le train de retour vers Saint-Petersbourg. En compagnie de Mathilde, sa jeune gouvernante française, Anna Alexandrovna voyage au rythme de ses souvenirs et de ses projets, dans la hâte de retrouver les chevaux, qui sont sa passion, et Dimitri Sokolov, cadet du tsar, qui un jour lui a dit cette phrase qui ne sort pas de sa mémoire : « Comme vous êtes radieuse, Anna Alexandrovna, tellement radieuse ! ».

Irina Tanaiev, jeune fille d’aujourd’hui dont on apprend peu à peu quels drames elle a vécus, prend à Moscou, en mars 2012, le Riviera Express qui doit la mener à Nice en deux jours. Sous la houlette de son amie Oksana, elle a fréquenté des sites de rencontre et échangé pendant plus de six mois une correspondance électronique avec Enzo, qui lui a dit travailler dans une banque niçoise. « Il est très amoureux de moi, il m’écrit tous les jours, il m’envoie des photos. Il est beau, en plus. Je vais rester un mois, on va se découvrir, se connaître. Il voudrait qu’on se marie vite », dit-elle à Sergueï, le chef de bord du train.
Noces de neige raconte en quatorze chapitres croisés le trajet de ces deux jeunes filles, dont le destin – pour ne pas en dire plus – va basculer, d’une manière ou d’une autre. Car il ne s’agit pas seulement de voyages en train, mais d’itinéraires intérieurs et passionnels, que toutes deux tracent dans leur vie sentimentale – ou que l’on trace pour elles. Gaëlle Josse, dans sa prose suggestive et musicale, a l’art de rendre les subtilités de l’esprit et du cœur, de traduire les impressions furtives et les émotions envahissantes, de créer la surprise, de faire éclater la tragédie, et de tracer des chemins de vie qui, à plus d’un siècle de distance, se croisent sans se confondre.
Jean-Pierre Longre
15:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, autrement, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Traitres, héros, victimes
Dan Franck, Les champs de bataille, Grasset, 2012, Le Livre de Poche, 2014
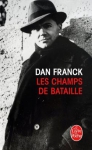 « L’affaire de Caluire » est bien connue de ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’histoire de l’occupation nazie et de la Résistance. Jean Moulin et ses compagnons, réunis le 21 juin 1943 dans la maison du Docteur Dugoujon pour procéder à la nomination du chef de l’Armée secrète, sont arrêtés par Klaus Barbie et ses sbires. Qui a trahi ? René Hardy, qui s’était invité à cette réunion après avoir été arrêté puis relâché par la Gestapo ? Deux fois de suite pourtant, après la Libération, il fut jugé puis acquitté.
« L’affaire de Caluire » est bien connue de ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’histoire de l’occupation nazie et de la Résistance. Jean Moulin et ses compagnons, réunis le 21 juin 1943 dans la maison du Docteur Dugoujon pour procéder à la nomination du chef de l’Armée secrète, sont arrêtés par Klaus Barbie et ses sbires. Qui a trahi ? René Hardy, qui s’était invité à cette réunion après avoir été arrêté puis relâché par la Gestapo ? Deux fois de suite pourtant, après la Libération, il fut jugé puis acquitté.
C’est à partir de là que se construit le roman. Dan Franck ne raconte pas les faits une énième fois ; il ne les réinvente pas non plus : il imagine qu’un juge à la retraite « instruit un troisième procès, totalement imaginaire ». Ce faisant, il pénètre dans le labyrinthe des relations complexes entre Résistance et collaboration, entre les Résistants eux-mêmes, des calculs politiques et des ambiguïtés idéologiques. Entrent en jeu notamment les rapports de force entre Gaullistes, communistes, ex-cagoulards… Parmi ceux-ci, par exemple, Pierre de Bénouville, alias Barrès, qui aurait cherché à neutraliser Jean Moulin, dit Max, homme de gauche… Sur ces points, le juge, qui a participé à bien des combats pour la liberté, a ses propres convictions, voire ses colères, qui peuvent aller loin : « Barrès ! Encore Barrès ! Toujours Barrès ! Lui aussi, cagoulard fasciste ! Et pourquoi tout cela ? Pour que la droite de la Résistance s’unisse à Vichy contre les communistes ! Et la suite doit se faire sans Max ! ».

La fiction brouille et confond habilement les époques (les années 1940 et la période actuelle), les lieux (le Palais de Justice, l’appartement du juge, Paris, Lyon), les personnages (Jean Moulin et le juge lui-même). Celui-ci a d’ailleurs sa propre histoire, qui nous est périodiquement contée. Les deux intrigues imbriquées, celle qui relève de l’Histoire collective et celle qui relève de la biographie individuelle, ne nous donnent pas de certitudes sur la culpabilité de Hardy ou de certains autres personnages impliqués dans le « complot » contre Jean Moulin. Mais le dénouement romanesque, avec le fin mot sur l’identité du juge, nous apporte une autre vérité : face au malheur, à la trahison, à la cruauté, l’être humain peut encore réagir comme tel, choisir son attitude et son destin.
Jean-Pierre Longre
15:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, histoire, francophone, dan franck, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/06/2014
« Rien ne remplace le vivant »
 Jeanne Benameur, Profanes, Actes Sud, 2013, Babel, 2014
Jeanne Benameur, Profanes, Actes Sud, 2013, Babel, 2014
Octave Lassalle, 90 ans, vit seul dans sa grande maison depuis la mort de sa fille Claire et le départ de sa femme Anna pour le Canada. Ancien chirurgien, il ressent le besoin de rassembler de nouveau une équipe autour de lui, une équipe bien choisie qui fasse corps avec lui, qui lutte avec lui dans la dernière phase de sa vie, au moment où il se donne « droit au doute ». Une équipe de « profanes » pour « la lutte sacrée ».
« Chez chacun des quatre, il a flairé le terreau d’une histoire. Quelque chose qui pourrait l’éclairer ». La vie s’organise, chacun accomplissant la tâche qui lui est dévolue, selon un emploi du temps précisément défini. Rien de mécanique ni de contraignant ; l’humain dans ses diverses dimensions prend peu à peu toute sa place, et peu à peu le passé revient ; non seulement celui d’Octave et de ce qu’il a manqué de l’amour d’Anna et de l’existence de Claire, de son enfance et de ses passions, des secrets qu’elle a confiés au journal qu’il découvre comme par effraction, mais aussi celui des trois femmes et de l’homme qui maintenant partagent son quotidien. Car tous les quatre, aussi, recèlent des mystères, des souffrances, des espérances dont les voiles se lèvent progressivement, partiellement.
Dans le style tout en finesse et en sensibilité qui lui est propre, Jeanne Benameur construit le roman de ces destinées qui accompagnent celle d’Octave. « Entre eux et moi, au fil des jours, quelque chose s’est bien tissé. Un drôle de fil de vie à vie. Ma vie, elle ne vaut pas plus que la leur ». Pas plus, mais pas moins, dirait-on. À mesure qu’avance le temps, les liens se resserrent non seulement entre eux et le vieil homme, mais entre chacun d’entre eux, « de vivant à vivant ». Et au seuil de la mort de son occupant, la grande maison se met à respirer d’un souffle nouveau, humain, tellement humain.
Jean-Pierre Longre
06:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jeanne benameur, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |