07/10/2022
S’évader vers les chefs d’œuvre.
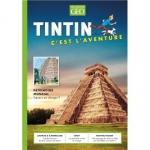 Tintin c’est l’aventure n° 12, Patrimoine mondial. Trésors en danger ? Geo, éditions Moulinsart, juin-août 2022
Tintin c’est l’aventure n° 12, Patrimoine mondial. Trésors en danger ? Geo, éditions Moulinsart, juin-août 2022
Commençons par la fin : avant une interview de François Schuiten et Benoît Peeters à propos de leur album Bruxelles, Un rêve capital, « ode au patrimoine de la capitale millénaire de l’Europe », une question récurrente parce qu’importante est posée : « Mais où est donc la Syldavie ? » La Syldavie, « pays mosaïque », celui du Sceptre d’Ottokar, où l’on passe aussi en lisant Objectif lune, On a marché sur la lune, que l’on côtoie (en Bordurie) dans L’affaire Tournesol… Tenter de répondre à cette question, c’est faire le tour de pays européens au riche patrimoine, à commencer par la Roumanie, illustrée ici par une magnifique photo de la cité médiévale de Sighişoara. Les autres hypothèses ne sont pas à rejeter, loin s’en faut : Monténégro, Albanie, Serbie, Croatire, République tchèque, Pologne, Autriche, Hongrie, et même Angleterre et Belgique – ou un mélange de toutes ces régions. Bref, on n’a pas fini d’en discuter, et le magazine Géo a dressé une carte précise du pays…
 Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey.
Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey.
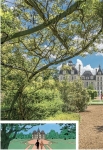 Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. »
Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. »
Jean-Pierre Longre
23:29 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : bande dessinée, francophone, hergé, tintin, éditions moulinsart, géo, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/09/2022
Symphonie des persécutés
 Michael Haas, Musique interdite. Les compositeurs juifs persécutés par les nazis. Traduit de l’anglais par Blandine Longre, avec le concours d’Elisabeth Willenz pour les citations en allemand, Notes de nuit, 2022
Michael Haas, Musique interdite. Les compositeurs juifs persécutés par les nazis. Traduit de l’anglais par Blandine Longre, avec le concours d’Elisabeth Willenz pour les citations en allemand, Notes de nuit, 2022
« Cet ouvrage est une épopée qui débute en 1815 avec le congrès de Vienne et s’achève sur les définitions nouvelles de la musique et de la société dans les années 1960. » Cette annonce faite à la fin de l’introduction reflète exactement la suite : si le sujet central du livre est bien la persécution des musiciens juifs par les nazis, Michael Haas, spécialiste de la question et musicologue érudit, cofondateur du centre « Exilarte » de Vienne consacré à la musique de l’exil, celle de l’extérieur et celle du « retour intérieur », s’adonne plus globalement à une étude historique complète permettant de comprendre les tenants et les aboutissants de cette persécution.
Les premiers chapitres sont consacrés à un tableau historique des nations qui, bien plus largement que l’Allemagne seule, ont en commun la langue allemande, ou ont donné naissance à des artistes et des intellectuels s’exprimant en allemand. On apprend aussi, entre autres informations de premier plan, que l’Autriche vit, entre 1857 et 1920, sa population juive se multiplier par presque cent, ce qui « s’accompagna d’un élan libérateur d’assimilation qui vit artistes et musiciens devenir des citoyens à part entière participant à la vie intellectuelle autrichienne, ainsi que des protagonistes dans le domaine plus vaste de la culture allemande. » Et dans une autre perspective on mesure à quel point Wagner est « le père de l’antisémitisme allemand », et fut considéré par les nazis « comme la national-socialiste » par excellence, sur lequel furent fondées « les politiques musicales dans l’Allemagne hitlérienne. »
On suit dans cette monumentale étude les épisodes qui, aux XIXe et XXe siècles, ont marqué la vie politique et artistique – particulièrement la vie musicale bien sûr – des pays concernés, avec les grands compositeurs qui ont ponctué cette vie : outre Wagner, on rencontre Mendelssohn, Brahms, Mahler, Schoenberg, Schrecker, Zemlinsky, Berg, Webern, Kurt Weill, bien d’autres, sans compter les interprètes et chefs d’orchestre, tels Fritz Busch ou Bruno Walter (qui ont fait précédemment l’objet de publications chez Notes de nuit)… Michael Hass donne en outre de nécessaires précisions sur les mouvements caractéristiques ou les états d’esprit des différentes périodes concernées (« fin de siècle », « modernisme », « nihilisme thérapeutique », « renouveau romantique » etc.). Tout cela permet à l’auteur de faire une analyse poussée de l’attitude des nazis face aux musiciens juifs, persécutions, déportations, exils vers les États-Unis, l’Angleterre, la France (avant qu’elle soit elle-même occupée, mais où certains comme le Hongrois Joseph Kosma ont pu rester) et quelques autres pays. Ce qui a permis à des compositeurs exilé, malgré l’accueil mitigé qui leur fut réservé, de reprendre, parfois différemment, leur carrière, voire de renouer, par exemple, avec des formes anciennes comme la symphonie, d’où la « symphonie de l’exil » austro-allemand. N’oublions pas non plus les compositions écrites dans les camps de concentration, notamment à Theresienstadt, comme Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann. Le dernier chapitre est consacré, après la victoire sur le nazisme, aux débuts de la guerre froide et à ce qu’il en résulte sur le plan musical.
Ouvrage de grande envergure, savant, exhaustif, complété par une bibliographie fournie et un index très utile, Musique interdite est une mine de renseignements historiques et une large base de réflexion sur ce que peut provoquer une politique dévoyée dans le domaine de la création musicale et plus généralement artistique. Pour n’en pas finir, en résonance avec notre époque, citons quelques lignes d’un éditorial anonyme paru en 1933 dans Neue Freie Press et cité dans le livre : « La déshumanisation de l’humanité a progressé comme jamais auparavant, l’indifférence au sort d’autrui, le désir de domination sans limites, la déification du préjugé, tout cela s’est propagé comme une épidémie psychique telle qu’on en avait connu seulement durant les heures les plus sombres du mysticisme médiéval. […] La notion de civilisation européenne est détruite, aujourd’hui toutes ses traditions intellectuelles sont en miettes. »
Jean-Pierre Longre
10:41 Publié dans Essai, Histoire, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, musique, michael haas, blandine longre, elisabeth willenz, notes de nuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/07/2022
Mystérieux champion
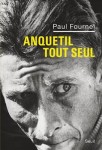 Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Le jeune Paul a eu beau, tout au long de son enfance et des routes parcourues sur deux roues, se prendre pour son champion préféré (souvenons-nous, il y avait deux clans bien marqués, celui, plus populaire, des Poulidor et celui, plus élitiste, des Anquetil), jamais il n’a réussi jusqu’à présent à percer les mystères de celui pour qui « l’essentiel se joue dans la solitude ».

« Petit cycliste, j’avais des idées claires sur ce que devait être un champion. Elles étaient si claires que je les consignais dans un cahier d’écolier parmi les photos que je découpais dans les journaux et collais dans un ordre qui n’appartenait qu’à moi. Ce cahier était à la fois mon Panthéon et mes Commandements ». Devenu grand, Paul doit pourtant se poser les questions essentielles, résumées par le titre du chapitre central, « À quoi marche Anquetil ? » : à l’exploit, à l’amour du vélo, à l’argent, à la douleur, à la drogue, à la générosité ? À tout cela sans doute, ce qui le rend d’autant plus « énervant » qu’il reste très secret.
Paul Fournel, qui s’y connaît en vélo, sportivement, pratiquement, théoriquement et littérairement (voir Besoin de vélo, Méli-vélo etc.), livre dans Anquetil tout seul des réflexions qui ne doivent rien à l’hagiographie (même si Anquetil est devenu, comme d’autres et plus que d’autres, une légende, celle-ci n’occulte en rien les défauts humains qui ne lui ont pas été épargnés), rien à la complaisance, rien au moralisme, beaucoup tout de même à l’admiration inséparable de l’autobiographie. Des réflexions, et des variations : ce livre est la partition d’une cantate qui suit les rythmes variés d’une combinaison instrumentale élégante et indicible : l’homme et la bicyclette.
Jean-Pierre Longre
23:12 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, cyclisme, francophone, paul fournel, le seuil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/07/2022
“Mépriser son être essentiel”
 Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Médecin de marine, écrivain, grand voyageur, Victor Segalen (1878-1919) a peu publié de son vivant, mais son œuvre est abondante (deux volumes dans la Pléiade). Le double Rimbaud, publié pour la première fois dans Le Mercure de France le 15 avril 1906, n’en est qu’un échantillon fort bref, mais très représentatif des préoccupations de l’auteur : peut-on être à la fois un immense poète et un négociant aventureux ? À la fois, non. Successivement, oui, apparemment, et Segalen s’interroge sur les deux Rimbaud : « Quel fut, des deux, le vrai ? Quoi de commun entre eux ? »
On le sait, Rimbaud s’arrêta brusquement d’écrire, et après avoir erré pendant au moins quatre ans, passa les dix dernières années de sa vie entre l’Abyssinie et Aden. Segalen utilise divers documents (lettres, souvenirs écrits ou oraux) pour retracer cette aventure, non sans citer et analyser auparavant un certain nombre d’extraits poétiques parvenant à « d’insoupçonnables horizons » et proclamant des désirs d’ailleurs : « Et cela fut, en vérité, prophétique des désirs constants de l’autre Rimbaud, qui même avant ses souffrances, avant ses échecs, en pleine fièvre de vie et d’action, entrevoyait, comme but seul désirable, le repos. »
Comment expliquer ce « cas singulier, d’un poète récusant son œuvre entière de poète […] par son mutisme définitif » ? Segalen avance alors « le Bovarysme », fameuse théorie conçue d’après l’héroïne de Flaubert par Jules de Gautier comme « le pouvoir départi à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est. » Et de donner les exemples d’Ingres et son violon, de Chateaubriand et ses velléités politiques, de Goethe et ses ambitions scientifiques etc. Voilà qui expliquerait aussi « les deux essors divergents » et l’étouffement de l’inspiration poétique chez Rimbaud, « persistant à mépriser son être essentiel. » Rien n’est définitivement éclairci, et Arthur Rimbaud restera toujours un cas mystérieux et fascinant dans l’histoire de la poésie. Mais Victor Segalen, dans ce petit ouvrage que les éditions Black Herald Press ont eu l’excellente idée de rééditer – en version bilingue qui plus est – fait avancer la réflexion non seulement sur le poète de Charleville, mais plus généralement sur la destinée des artistes.
22:13 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, anglophone, victor segalen, arthur rimbaud, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/06/2022
« Elle avait toujours raison »
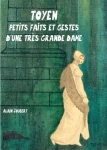 Alain Joubert, Toyen. Petits faits et gestes d’une très grande dame, Ab irato, 2022
Alain Joubert, Toyen. Petits faits et gestes d’une très grande dame, Ab irato, 2022
Comptée au nombre des surréalistes, née à Prague et figure majeure de l’avant-garde tchèque, Toyen (Maria Čerminová, 1902-1980) dépasse largement les limites des classifications. Créatrice avec Jindřich Štyrský de l’artificialisme et fondatrice du mouvement surréaliste tchèque, elle rejoint après la guerre le groupe français, liée d’une forte amitié avec certains de ses membres. L’exposition de ses œuvres (peintures, collages, dessins etc.) au Musée d’Art Moderne de Paris (jusqu’au 24 juillet 2022) témoigne de l’originalité de son œuvre.
Cette originalité, Alain Joubert (1936-2021) en témoigne à sa manière, celle de quelqu’un qui, lui-même partie prenante dans les activités surréalistes des années 1950-1960, a connu Toyen dans sa vie quotidienne, dont il évoque ici « quelques moments », montrant combien sa « vie réelle » a pu influer sur sa « vraie vie », celle de l’art. Alors nous voici embarqués avec elle au café où elle retrouvait André Breton et son groupe, ainsi que ses « complices » Benjamin Péret, Charles Estienne et quelques autres. Nous voici confrontés à un langage que l’auteur appelle « le toyen », fort en accent et en images nouvelles, du genre : « Ti sais, moi, j’y bouffe du cinéma ! » ; ou partageant avec elle des tâches ménagères qu’elle considérait comme secondaires, et un goût inattendu pour le Rock de Vince Taylor ; ou séjournant avec elle à Saint-Cirq-Lapopie, s’adonnant à la natation ou à des mimes endiablés devant ses compagnons ; ou encore à l’hôpital, où elle manifestait ouvertement sa détestation de la religion et son éloignement de toutes « racines », se caractérisant par deux mots : surréaliste et APATRIDE.
Relatés sur le mode personnel, émaillés d’anecdotes savoureuses et d’illustrations photographiques, ponctués par le tableau « L’échiquier » (1963), ces « petits faits et gestes d’une très grande dame » révèlent une personnalité hors du commun, dynamique, robuste physiquement, intellectuellement, esthétiquement. Et comme l’écrit Alain Joubert : « Soyons clairs : elle avait toujours raison… ».
Jean-Pierre Longre
09:39 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, illustrations, francophone, alain joubert, jean-pierre longre, toyen, ab irato | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/05/2022
« Musique interdite »
 Michael Haas, Musique interdite. Les compositeurs juifs persécutés par les nazis. Traduit de l’anglais par Blandine Longre, avec le concours d’Elisabeth Willenz pour les citations en allemand, Notes de nuit, 2022
Michael Haas, Musique interdite. Les compositeurs juifs persécutés par les nazis. Traduit de l’anglais par Blandine Longre, avec le concours d’Elisabeth Willenz pour les citations en allemand, Notes de nuit, 2022
Présentation :
« En 1933, quand Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, le monde musical, davantage que tout autre, compte d’innombrables Juifs qui deviennent aussitôt une cible pour le régime national-socialiste. Dans Musique interdite. Les compositeurs juifs persécutés par les nazis, Michael Haas commence par dresser un panorama politico-historique de la situation paradoxale des Juifs, dans les États germanophones, depuis le XIXe siècle, replaçant la progression de l’antisémitisme austro-allemand dans un contexte musical où l’assimilation juive se trouve rapidement confrontée à des attaques virulentes, notamment de la part de Richard Wagner. Après une période de créativité intense jusqu’aux années 1930, les compositeurs juifs, mais aussi les interprètes, les chefs d’orchestre, les critiques ou les éditeurs de musique, sont impitoyablement persécutés par les nazis, et ceux qui ne trouvent pas refuge dans l’exil connaîtront un sort tragique. Dans cet ouvrage foisonnant, l’auteur s’efforce de réhabiliter des musiciens et des œuvres trop longtemps abandonnés à l’oubli. »
11:44 Publié dans Essai, Histoire, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, musique, anglophone, michael haas, blandine longre, elisabeth willenz, notes de nuit | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/01/2022
Musicothérapie au XVIIIe siècle
 Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021
Ménuret de Chambaud, Effets de la musique, suivi de : Étienne Sainte-Marie, Préface du Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger. Édition et présentation de Philippe Sarrasin Robichaud, éditions Manucius, 2021
Au XVIIIe siècle, on débattait volontiers à propos de la nature de la musique et de ses répercussions sur le corps et le cœur humains. Pour Rameau, par exemple, les sons et leurs vibrations agissent sur l’intellect et le corps, tandis que pour Rousseau c’est le cœur et la sensibilité qui sont touchés par l’harmonie. Entre les deux fameux compositeurs-philosophes, les points de vue paraissent donc antinomiques, mais ils semblent se rejoindre sous la plume d’auteurs méconnus qui se sont intéressés en particulier aux « effets thérapeutiques de la musique », selon la formule que Philippe Sarrasin Robichaud emploie dans sa présentation. Encore une fois, les éditions Manucius ont mis au jour des textes précieux qui, bien qu’ils datent de près de trois siècles, restent d’une fraîche actualité.
Dans Effets de la musique, Jean-Joseph Ménuret de Chambaud reprend d’une manière synthétique, en se fondant sur des exemples puisés dans la mythologie (le chant merveilleux d’Orphée, entre autres) et dans la réalité (de l’antiquité aux temps modernes), les diverses influences que la musique exerce sur le comportement des animaux, mais surtout sur les corps, les esprits et les cœurs des humains, plus particulièrement sur leur santé. « C’est principalement sur les hommes plus susceptibles des différentes impressions, et plus capables de sentir le plaisir qu’excite la musique, qu’elle opère de plus grands prodiges, soit en faisant naître et animant les passions, soit en produisant sur le corps des changements analogues à ceux qu’elle opère sur les corps bruts. » Il rapporte comment certains médecins ont utilisé la musique avec succès comme « remède universel », en l’adaptant aux différentes sortes de maladies. Selon plusieurs observations, on peut prescrire la musique en tenant compte de « la nature de la maladie », du « goût du malade », de « l’effet de quelques sons sur la maladie » - en prenant soin d’ « éviter la musique dans les maux de tête et d’oreilles surtout. » Tout est donc précisément prévu, sachant que les sons musicaux ne sont pas « jetés » au hasard, mais « combinés suivant des règles constantes, unies et variées suivant les principes démontrés de l’harmonie. »
Le second texte porte sur le Traité des effets de la musique sur le corps humain de Joseph-Louis Roger (synthétisé, donc, pour L’Encyclopédie par Ménuret de Chambaud). Dans cette préface, Étienne Sainte-Marie résume les théories de l’auteur, qui tiennent, on l’aura compris, de ce qu’on appelle de nos jours la musicothérapie. D’après l’auteur, « l’homme renferme en lui trois centres principaux d’activité, qui composent toute son existence, et qui réunis donnent la somme entière des ses forces et de ses moyens : la vie animale, la vie morale et la vie intellectuelle », entre lesquelles il faut trouver un équilibre ; une sensibilité exacerbée, notamment, produit la méchanceté, ce qui explique que des hommes cruels « ont aimé la musique avec passion » (l’auteur évoque Néron, mais nous pourrions maintenant trouver maints autres exemples, chez les bourreaux nazis notamment). Malgré tout, la musique est apte à préserver « l’ordre et l’harmonie », elle est « indispensable à l’homme qui vit dans le tourbillon du monde. »
Si ce n’étaient les références historiques ou morales et, parfois, le style ou le lexique, on oublierait que ces textes, qui ont une même source et se complètent très bien l’un l’autre, ont été écrits au XVIIIe siècle. Toutes les époques, et la nôtre en particulier, peuvent prendre en considération cette assertion : « L’influence de la musique devient chaque jour plus nécessaire dans ce siècle corrompu.»
Jean-Pierre Longre
10:10 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, ménuret de chambaud, Étienne sainte-marie, joseph-louis roger, philippe sarrasin robichaud, éditions manucius, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/01/2022
Les découvertes de Tintin
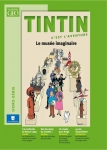 Tintin c’est l’aventure, Le musée imaginaire, Éditions Moulinsart, GEO hors-série, 2021.
Tintin c’est l’aventure, Le musée imaginaire, Éditions Moulinsart, GEO hors-série, 2021.
En 1979, Michel Baudson, concepteur du « Musée imaginaire de Tintin », première exposition consacrée à l’œuvre d’Hergé, écrivait paradoxalement : « Tintin ne s’expose pas. » Il « découvre » et « s’enrichit sans cesse des cultures des mondes qu’il découvre. » Les lecteurs de Tintin savent que les albums contiennent un grand nombre d’objets inspirés de pièces ethnographiques venues d’une multitude de pays. L’exposition de 1979 permettait, dans un « musée imaginaire », de « mettre en relation, album par album, des objets et des reproductions de cases de Tintin », avec d’ailleurs un certain intérêt porté aux voleurs, faussaires, trafiquants d’œuvres d’art – ceux que l’on trouve au fil des aventures du petit reporter.
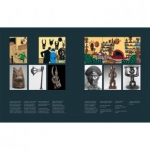 Hergé fréquentait volontiers les musées, notamment l’« AfricaMuseum » et le « mudée Art & Histoire » (dans leur appellation actuelle), et les albums s’en ressentent, notamment L’Oreille cassée avec son musée ethnographique et le fameux fétiche arumbaya (dont le modèle est une statuette du Pérou), Tintin au Congo avec « l’homme-léopard », témoignage d’une inspiration colonialiste qui a donné lieu à d’âpres discussions, ou encore Les 7 boules de cristal avec la momie de Rascar Capac…
Hergé fréquentait volontiers les musées, notamment l’« AfricaMuseum » et le « mudée Art & Histoire » (dans leur appellation actuelle), et les albums s’en ressentent, notamment L’Oreille cassée avec son musée ethnographique et le fameux fétiche arumbaya (dont le modèle est une statuette du Pérou), Tintin au Congo avec « l’homme-léopard », témoignage d’une inspiration colonialiste qui a donné lieu à d’âpres discussions, ou encore Les 7 boules de cristal avec la momie de Rascar Capac…
Après un certain nombre de notices et d’interviews (par exemple sur la question des « faux » qui se pose aussi dans Tintin et l'Alph-Art), la deuxième partie du volume est consacrée au « Musée imaginaire d’Hergé », confrontant les albums et les objets réels venus des mudées ou des pays traversés par Tintin – confrontation visuelle pleine d’enseignement sur le sens du détail, le souci de la précision, le génie du dessin chez l’artiste qu’était Hergé. D’ailleurs, en complément, des reproductions rappellent qu’il fut non seulement le père de Tintin (et de quelques autres personnages), mais aussi peintre, illustrateur et affichiste de talent, et grand amateur d’œuvres d’art, qu’il collectionnait volontiers.
Trente ans après l’exposition de 1979, s’ouvrait le musée Hergé de Louvain-la-Neuve, et divers autres lieux (Etterbeek, Angoulême…) témoignent de la popularité pérenne de l’œuvre d’Hergé et de la considération que l’on a maintenant pour la bande dessinée en tant qu’art. Hergé disait qu’en matière artistique, c’est l’émotion qui importe. C’est aussi de l’émotion que les amateurs de toutes générations ressentent en contemplant les nombreuses illustrations de ce « musée imaginaire », ainsi qu’à la relecture des albums de Tintin et à la vue de tous les objets qui les peuplent.
Jean-Pierre Longre
10:26 Publié dans Essai, Exposition, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, hergé, tintin, éditions moulinsart, géo, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2021
Huit siècles de commerce du livre
 Patricia Sorel, Petite histoire de la librairie française, La fabrique éditions, 2021
Patricia Sorel, Petite histoire de la librairie française, La fabrique éditions, 2021
Du Moyen Âge à nos jours, c’est une histoire complète du commerce du livre que nous raconte Patricia Sorel. Dès le treizième siècle, des « stationnaires » et des « libraires » (on découvrira la différence dans les premières pages) sont chargés de fournir les manuscrits nécessaires aux étudiants, tant à Paris qu’en province. Et bien sûr, l’invention de l’imprimerie et sa diffusion en France à partir de 1470 vont « profondément bouleverser » la vente des livres et le métier de libraire, qui va subir des variations au gré des conditions culturelles, sociales et politiques, des réglementations, du succès de tel ou tel type d’ouvrage, des goûts des lecteurs, des choix des éditeurs…
Cinq grandes étapes rythment cette histoire : « La librairie sous l’Ancien Régime », « Le développement de la librairie au XIXe siècle », « Une profession ancrée dans la tradition (fin XIXe siècle – 1945) », « La modernisation à marche forcée » (1945-1981) », « La librairie sous le régime du prix unique », le tout complété par des considérations sur la concurrence actuelle du commerce en ligne, par un index fort utile et par une bibliographie dite « sommaire », mais déjà bien fournie.
On peut bien sûr s’intéresser aux statistiques, aux chiffres détaillés, aux références précises qui jalonnent ces pages semées d’illustrations, devantures ou intérieurs de librairies connues (celles d’Adrienne Monier ou de Sylvia Beach par exemple) ou moins connues. S’intéresser aussi aux fluctuations économiques, aux modes de gestion des stocks, aux relations entre éditeurs, lecteurs, législateur et libraires. Mais les passages les plus prenants sont ceux qui relatent les grandes batailles : contre les différentes formes de censure (ouverte ou insidieuse), entre les grandes surfaces et les véritables librairies, et bien sûr celle du « prix unique » du livre, demandé de longue date par certains, finalement instauré sous la présidence de François Mitterrand et le ministère de Jack Lang le 1er janvier 1982, malgré les vives résistances de forces commerciales comme la Fnac et Édouard Leclerc, qui a cherché par tous les moyens mais finalement sans succès à conserver le statu quo. Des épisodes quasiment épiques qui, comme tout cet ouvrage, nous montrent que la salutaire croissance actuelle du nombre de librairies indépendantes n’est pas due au hasard, mais à une longue lutte pleine de péripéties, de négociations, d’espoirs, de désespoirs, d’abnégation. Cette « petite ( ?) histoire » met les pendules culturelles à l’heure.
Jean-Pierre Longre
19:03 Publié dans Essai, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, patricia sorel, la fabrique éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/06/2021
Un astronome original
 Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021
Nicolas Cavaillès, Le Temps de Tycho, Éditions Corti, 2021
Nicolas Cavaillès a l’art de dénicher des sujets et des personnages à la fois méconnus et porteurs de questionnements sans précédents, ouvrant de nouveaux horizons. Il y a eu la vie aventureuse de Monsieur Leguat, les destins particuliers des enfants Schumann, le tour de l’île Maurice par un âne portant un cadavre sur le dos, les sauts mystérieux des baleines (On trouvera sur http://jplongre.hautetfort.com/tag/nicolas+cavaill%C3%A8s des chroniques sur les ouvrages et les traductions de Nicolas Cavaillès)… Cette fois, c’est Tycho Brahe, astronome danois du XVIe siècle, qui occupe la centaine de pages d’un ouvrage tenant de la biographie et de la réflexion sur le rythme du temps.
 Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».
Impressionné tout jeune par une éclipse solaire, Tycho se passionna pour les mathématiques et l’astronomie, délaissant les études de droit auxquelles il était voué, et publia un petit livre qui lui valut « l’attention de ses pairs » et du roi du Danemark. Celui-ci lui octroya l’île de Hven, près d’Elseneur, sur laquelle, installé avec femme et enfants, Tycho construisit des observatoires et passa vingt ans à mener ses études astronomiques et « s’échina en effet, le premier dans l’histoire de l’humanité, à faire retentir le balancier d’une trotteuse ; d’abord, tic, dans la silencieuse salle des cadrans d’Uraniborg, tac, puis dans tout l’observatoire, tic, et sur l’ensemble de l’île, tac, depuis les eaux glaciales de la Scandinavie, tic, jusques aux confins de l’univers, tac, une trotteuse prodromique enclenchée au printemps de l’année mil cinq cent soixante-dix-sept et qui ne s’arrêta plus ensuite, indestructible et exponentielle ».
L’auteur ne s’en tient pas à l’histoire. Du récit de la vie et des trouvailles de son héros, il tire des anecdotes où il est question de Giordano Bruno, de Copernic, de Johannes Kepler (qui fut « l’un de ses proches collaborateurs »), et même de Shakespeare, puisque se pose la question de savoir si la Tragédie du prince Hamlet n’aurait pas quelque rapport avec le destin de Tycho… Bref, voilà un ouvrage à la fois savant et savoureux qui, dépassant le sujet d’une biographie déjà intéressante en soi et même d’une méditation sur le découpage temporel, nous mène vers des sphères insoupçonnées.
Jean-Pierre Longre
à paraître le 26 août 2021
17:11 Publié dans Essai, Littérature, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, francophone, tycho brahe, nicolas cavaillès, Éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/06/2021
Paysages illimités avec pianos
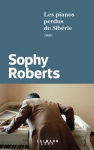 Sophy Roberts, Les pianos perdus de Sibérie, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2021
Sophy Roberts, Les pianos perdus de Sibérie, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2021
« Le fait que des instruments majestueux puissent encore exister dans un endroit aussi profondément énigmatique est tout à fait remarquable, sans que je parvienne à me l’expliquer », écrit Sophy Roberts au début de son livre. Et dans toute la suite, elle plonge le lecteur dans ce mystère, non pour le percer complètement, mais pour narrer des aventures aussi diverses que lointaines, pour faire part de rencontres aussi chaleureuses qu’inattendues, pour décrire des contrées aussi froides que pittoresques. Disons-le : si l’on apprend beaucoup de choses sur les pianos (bien ou mal conservés, difficilement découverts ou trouvés en nombre surprenant, prestigieux ou modestes, ayant appartenu à des grands de Russie ou à des anonymes, joués par de grands interprètes ou par des inconnus…), l’ouvrage est à la fois relation de voyage et d’exploration, roman à caractère autobiographique truffé d’anecdotes savoureuses, somme érudite pleine de références historiques, géographiques, musicales, et semée de documents photographiques et de reproductions de gravures (on peut contempler maints portraits et paysages, faire connaissance, par exemple, avec un impayable Liszt en pop star acclamée par ses groupies, apercevoir la famille impériale prenant l’air sur le toit d’une maison à Tobolsk, ou voir un intéressant dessin musical de Kandinsky, bien d’autres illustrations encore).
Si l’on se fie à la structure d’ensemble, on suit une chronologie historique : une première partie (« Pianomanie ») qui court de 1762 à 1917, une deuxième (« Accords brisés »), de 1917 à 1991, et une troisième (« Dieu seul sait où »), de 1992 à aujourd’hui. Le motif du piano est donc décliné depuis le régime des Tsars jusqu’à la Russie d’aujourd’hui, en passant bien sûr par les grands bouleversements politiques (1917, la guerre de 1940-1945, 1991 etc.), et, cartes à l’appui, de l’Oural au Kamtchatka, en passant par le lac Baïkal, l’Altaï, la Kolyma, l’île de Sakhaline, les grandes et petites villes, les vastes étendues et les coins les plus reculés (généralement en hiver, afin d’éviter les boues et les moustiques). Et en faisant la connaissance de toutes sortes de personnes, souvent accueillantes, parfois fort originales, qui « ont ouvert non seulement leurs pianos, mais aussi leur maison et leur cœur à une inconnue. », et l’ont guidée dans sa quête inlassable d’instruments que recèlent ces contrées méconnues.
Contrées méconnues, certes, à vue de première lecture, mais contrées qui, à mesure qu’on avance dans le livre, deviennent familières, tant l’autrice nous présente avec chaleur ces régions glaciales où, comme l’écrivit Tchekhov, « les émotions et expériences sont nombreuses ». « Tandis que je passe en revue mes découvertes, j’ai conscience de toutes les choses inattendues que mes recherches ont produites, et je constate que chaque piano a réduit la taille illimitée de la Russie, qui m’apparaît désormais à échelle humaine. ». Et l’on sent bien que malgré tout ce qu’elle a vécu au cours de ses aventures sibériennes, Sophy Roberts n’en a pas fini avec les explorations, puisqu’elle avoue « savoir qu’il existe toujours un lieu plus lointain encore où se rendre. »
Jean-Pierre Longre
09:09 Publié dans Essai, Littérature et musique, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, voyages, musique, autobiographie, sophy roberts, blandine longre, calmann lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/04/2021
Comique existentiel
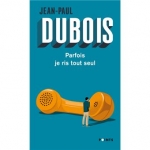 Jean-Paul Dubois, Parfois je ris tout seul, Points, 2021
Jean-Paul Dubois, Parfois je ris tout seul, Points, 2021
Le titre l’atteste : Jean-Paul Dubois a dû bien s’amuser en écrivant ces mini-textes (une page chacun au maximum) parus initialement en 1992 chez Robert Laffont, puis en 2007 aux éditions de l’Olivier. C’est un fait : on rit franchement à la réponse que font les parents (la mère surtout) à la question sur les raisons qui font que les chiens se montent dessus et restent collés l’un à l’autre, au dialogue de deux mécanos évoquant Picasso en se disputant sur la couleur d’un manche de tournevis, à des souvenirs culinaires et bien écœurants de cantine d’école religieuse, ou à des propos de comptoir du genre : « T’es vraiment le cousin du pape ? » Et on apprécie à juste titre certaines surprises finales, par exemple dans la confrontation d’un rêve ou d’un fantasme à la réalité, ou dans la réponse acerbe à une question : « Tu me demandes ce que je voudrais ? Ce que j’attends de toi ? Qu’au moins une fois dans notre vie, tu te comportes comme un être humain. »
Mais comme souvent chez l’auteur, la plaisanterie cache des réflexions et des états d’âme plus profonds qu’il n’y paraît. Le tragique n’est pas toujours loin, lorsqu’il s’agit de dire que « la vérité c’est une chose avec laquelle il ne faut pas rigoler. » Et surtout, les questions existentielles forment une trame régulière, en rapport avec les sensations physiques et la maladie : « Je suis toujours tendu, anxieux. […] J’ai l’impression que quelque chose grésille en moi, la sensation d’avoir la poitrine remplie de hannetons. » Et lorsqu’on s’interroge sur la santé des mouches, on se doute qu’il s’agit de celle des humains. En rapport aussi avec le sentiment amoureux, souvent déçu. Peut-on être heureux ? Oui, si l’on en croit le destin de cet homme (« mon père ») qui se transforme en gitan (sur une remarque de sa femme) en achetant une « Chevrolet Bel Air Power Glide 1957, noire, pavillon blanc », ou si l’on apprécie avec le narrateur de rouler tranquillement au volant de sa voiture et de s’allumer une cigarette…
Il y a donc le choix. Chacun peut se promener à sa guise et à sa façon dans cette forêt livresque, glaner çà et là telle ou telle bribe, y voir de l’humour, de l’inquiétude, de l’insolite, des problèmes irrésolus, des réponses improbables, du plaisir, du bonheur, du malheur… Avec toujours dans un coin de la tête cette question qui clôt une page commençant par « T’as aucune morale » : « Le problème avec toi, c’est qu’on sait jamais quand tu déconnes. »
Jean-Pierre Longre
19:56 Publié dans Essai, Humour, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chroniques, récit, humour, francophone, jean-paul dubois, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/03/2021
Paris-Bucarest-Paris. Journal d’un écrivain
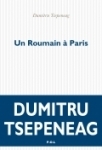 Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021
Dumitru Tsepeneag, Un Roumain à Paris, traduit du roumain, avant-propos et notes par Virgil Tanase, P.O.L., 2021
« Au moment même où je suis sur le point de devenir un écrivain professionnel (horribile dictu !), j’ai décidé, par un choix délibéré, de me prêter à cet exhibitionnisme autorisé (et inoffensif) qui est de tenir un journal. C’est pour cette raison que je suis à Paris ! » En 1970, au moment où il écrivait cela, Dumitru Tsepeneag ne savait pas qu’à partir de 1975, déchu de sa nationalité roumaine, il ne pourrait retourner dans son pays qu’après la chute de Ceauşescu. Ce journal, entrecoupé de « notes à la va-vite » datées de 1972, de notes sur un « voyage en Amérique » accompli en 1974, suivi d’un entretien avec Monica Lovinescu intitulé « La condition des intellectuels en Roumanie. Entre censure et corruption » (Radio Free Europe, 30 septembre 1973) et précédé d’une solide préface historico-biographique de Virgil Tanase, court de 1970 à 1978, avec quelques interruptions plus ou moins longues, et il est un vrai journal d’écrivain qui, la trentaine bien sonnée, s’est lancé dans la littérature de fiction.
Car si l’auteur s’adonne çà et là à quelques confidences personnelles (ses relations avec ses parents, son mariage…), c’est le monde intellectuel et artistique qu’il décrit avec beaucoup de précision et de diversité, notamment celui qui concerne les écrivains roumains, exilés ou restés au pays, dissidents ou s’accommodant du régime, notoires ou méconnus. Alors on croise à plusieurs reprises Cioran et Ionesco, Paul Goma (souvent) et Vintilă Horia (un peu), Virgil Tanase et Leonid Dimov, bien d’autres encore. Et aussi les Français Robbe-Grillet et Michel Deguy, le traducteur Alain Paruit, les éditeurs, dont Paul Otchakovsky (qui, devenu P.O.L., publiera les ouvrages de Tsepeneag, dont celui-ci), et encore Roland Barthes, sous la direction duquel il commença une thèse sur Gérard de Nerval. On en passe une multitude, tant ces 600 pages regorgent de rencontres et d’événements qui suscitent récits et réflexions.
Il y a bien sûr ce qui a trait à la situation en Roumanie et à sa dégradation vers plus de censure, d’hypocrisie, d’intimidations, de répression ; ce qui concerne, par extension, la situation internationale et les questions idéologiques (« Confusion des termes ! Quel rapport entre l’Union soviétique et le communisme ? Confusion qu’entretiennent aussi, cela va de soi, et par tous les moyens, les adversaires du communisme. ») ; et les mouvements littéraires, dont l’onirisme, bien sûr (que l’auteur, qui en fut le chef de file avec Dimov, distingue précisément du surréalisme), le nouveau roman et ses théories… Dans tous les cas, Dumitru Tsepeneag affirme nettement sa personnalité et ne mâche pas ses mots, conformément à son habitude (souvenons-nous de ses Frappes chirurgicales) : « Lorsque quelqu’un m’est antipathique, j’ai du mal à changer d’avis. » Même les gens qu’il apprécie sont parfois passés au crible, et cela concerne aussi ses propres écrits, dont ce journal, qui parfois lui pose problème : « À quoi bon ce journal ? Je ne le publierai jamais. Je ne suis même pas sûr de ne pas le détruire un jour ou l’autre. L’idée de me regarder plus tard dans un miroir (déformant) est stupide et je doute que l’envie m’en vienne un jour. D’autant plus que je note des impressions très superficielles, occasionnées par des événements extérieurs. »
Sévère voire injuste avec lui-même, l’auteur a beau dire, son journal est du plus haut intérêt pour toute une série de raisons, dont les conditions et le déroulement de la vie littéraire, collective et individuelle, n’est pas la moindre. Il n’est pas indifférent, loin s’en faut, de savoir par exemple comment sont nés, non sans difficultés, Les Cahiers de l’Est, ou comment se sont élaborés certains romans comme Les Noces nécessaires, Arpièges ou, surtout, Le Mot sablier, où « la langue roumaine s’écoulera dans la langue française comme à travers l’orifice d’un sablier. » Une belle image, qui résume la riche destinée linguistique et littéraire d’un écrivain qui, sans fausse pudeur ni étalage complaisant, montre comment l’exil a été un frein et un moteur de la création littéraire.
Jean-Pierre Longre
18:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, roumanie, dumitru tsepeneag, virgil tanase, jean-pierre longre, p.o.l. | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/03/2021
Manuel de rébellion littéraire
 Maxime Decout, Éloge du mauvais lecteur, Les éditions de minuit, 2021
Maxime Decout, Éloge du mauvais lecteur, Les éditions de minuit, 2021
Le titre, paradoxal, pourrait sonner comme une provocation de la part d’un universitaire censé enseigner la « bonne lecture ». Mais justement : si l’adjectif « mauvais » « signale un écart par rapport à une norme intellectuelle », il annonce aussi et surtout une activité productrice de sens et esthétiquement créatrice. De manière réjouissante et familière, dans le style enlevé qu’on lui connaît et qui n’empêche pas la rigueur intellectuelle et le sens de la pédagogie, Maxime Decout s’adresse directement à nous (bons ou mauvais lecteurs ?) pour faire un tour exhaustif des types de « mauvaise lecture ».
On connaît les « dangers de l’identification » symbolisés fictivement par Don Quichotte, Emma Bovary et quelques autres, ou réellement, entre autres, par les suicides qui ont suivi le succès des Souffrances du jeune Werther de Goethe. En rester là serait stérile, et ne permettrait de garder des théories de la lecture que ce qu’Umberto Eco appelle « Lecteur Modèle ». Heureusement, l’ouvrage fait renaître (ou naître) le vrai « mauvais lecteur », qui est en réalité multiple, puisque l’on va de l’identification positive à la réécriture littéraire, en passant par maintes étapes précises au long des quatre larges chapitres du livre. Comment « redevenir un mauvais lecteur » ? En s’adonnant à l’interprétation, entre « immersion » et « intellection », comme cela se passe par exemple avec le roman policier et certaines œuvres de Georges Perec, ou à la « lecture contrefactuelle », c’est-à-dire en lisant un texte « en dépit de ses paramètres visibles », voire en allant jusqu’à la « lecture aberrante ». La « mauvaise lecture » peut pencher du côté du fétichisme, de la monomanie, jusqu’à l’envie pressante d’écrire en imitant telle œuvre ou tel auteur idolâtrés. Tout est fertile, rien n’est interdit : ni la « lecture haineuse », ni la « lecture névrotique », ni les fantasmes qu’elle peut induire. Le dernier chapitre répertorie « les pratiques du mauvais lecteur », qui ressortissent à deux attitudes principales : « lire le nez en l’air » (se promener dans un livre, par exemple, en sautant des passages ou en pensant à autre chose) et « lire en tous sens » (lecture puzzle ou labyrinthe, notamment). Déconstruire, donc, mais pour reconstruire, recomposer, réécrire…
La rébellion plus ou moins consciente que représente la « mauvaise lecture » aboutit donc à la création. Ce que nous dit ici Maxime Decout, et que grâce à lui nous prenons conscience de pratiquer régulièrement, passe par de nombreux exemples, des références variées (des grands classiques aux contemporains, des œuvres méconnues à la littérature policière). Un ensemble à la fois précis, documenté, richement illustré, d’où l’humour n’est pas exclu, loin de là. Voyez : quelle est « la plus grande marque de respect qu’un auteur peut recevoir » ? Eh bien : « Être kidnappé ou assassiné par son propre lecteur ». Et pour celui-ci, en tout cas, le livre de Maxime Decout est un bel encouragement à la lecture libre et fructueuse.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, maxime decout, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/03/2021
« L’authentique philosophie existentielle »
 David Gascoyne, Après dix années de silence, Léon Chestov / After Ten Year’s Silence, Lev Shestov, traduit de l’anglais par Michèle Duclos, édition bilingue, Black Herald Press, 2020
David Gascoyne, Après dix années de silence, Léon Chestov / After Ten Year’s Silence, Lev Shestov, traduit de l’anglais par Michèle Duclos, édition bilingue, Black Herald Press, 2020
Dix ans après la mort du philosophe russe Léon Chestov (1886-1938), David Gascoyne (1916-2001), qui l’avait découvert grâce à Benjamin Fondane, lui consacra cet essai destiné à faire connaître en Grande-Bretagne celui qui y restait alors « tout à fait inconnu. » Grâce à cette édition et à cette traduction, les fondements de l’existentialisme chrétien dont se revendiquait le philosophe nous sont présentés d’une manière à la fois claire et précise.
En « quête de la vérité absolue et totale », Chestov était préoccupé par la mort, sans morbidité mais surtout sans l’oublier, comme ont tendance à vouloir le faire les « modernes ». Lui qui ne voulait pas enseigner, afin de garder l’attitude d’un chercheur exigeant, s’efforçait de « lancer des individus dans une existence réelle » et, en un apparent paradoxe, de lutter « contre les idées » ou, plus précisément, contre l’idéalisme et le rationalisme, contre la « Raison Pure », guidant sa pensée du côté de Pascal plutôt que de Descartes.
David Gascoyne, dont le parcours, ici, va de Benjamin Fondane à Léon Chestov (dont Fondane fut en 1939 « l’unique disciple »), accompagne le lecteur sur le chemin de « l’authentique philosophie existentielle » et sur les traces d’un penseur qui ne prétendait pas atteindre la « sagesse », mais exprimer ses vérités.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, philosophie, anglophone, david gascoyne, léon chestov, michèle duclos, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/01/2021
L’ogre et l’adolescente
 Lire, relire... Vanessa Springora, Le consentement, Grasset, 2020, Le livre de poche, 2021
Lire, relire... Vanessa Springora, Le consentement, Grasset, 2020, Le livre de poche, 2021
Depuis longtemps Vanessa Springora n’est plus une adolescente, mais il lui a fallu de nombreuses années pour pouvoir revenir par écrit sur sa dramatique relation avec Gabriel Matzneff (G. dans le livre). « Jusqu’ici, je n’étais pas prête. Les obstacles me paraissaient infranchissables. » Mais « si je voulais étancher une bonne fois pour toutes ma colère et me réapproprier ce chapitre de mon existence, écrire était sans doute le meilleur des remèdes ». Finalement, grâce à certaines personnes, notamment à celui qu’elle appelle « l’homme que j’aime », le livre s’est accompli. Un récit précis, sans concessions, dont la progression lucide est implacable, en six sections aux titres révélateurs: « L’enfant, La proie, L’emprise, La déprise, L’empreinte, Écrire ».
 Père absent, mère plus intéressée par son propre plaisir que par l’attention portée à sa fille – V. se réfugie dans les livres qu’elle dévore avec passion avant d’être elle-même dévorée par un « homme de lettres ». Oui, « toutes les conditions sont réunies ». Chaque chapitre, chaque épisode rapporté décrit et analyse le piège dans lequel elle s’est laissé enfermer, fascinée par un homme qui savait exactement ce qu’il faisait, maîtrisant parfaitement le mécanisme du « consentement ». « En jetant son dévolu sur des jeunes filles solitaires, vulnérables, aux parents dépassés ou démissionnaires, G. savait pertinemment qu’elles ne menaceraient jamais sa réputation. Et qui ne dit mot consent ». Dans l’atmosphère de permissivité aveugle qui caractérise le monde intellectuel de l’époque, G., « stratège exceptionnel », est guidé par deux motivations : « Jouir et écrire ».
Père absent, mère plus intéressée par son propre plaisir que par l’attention portée à sa fille – V. se réfugie dans les livres qu’elle dévore avec passion avant d’être elle-même dévorée par un « homme de lettres ». Oui, « toutes les conditions sont réunies ». Chaque chapitre, chaque épisode rapporté décrit et analyse le piège dans lequel elle s’est laissé enfermer, fascinée par un homme qui savait exactement ce qu’il faisait, maîtrisant parfaitement le mécanisme du « consentement ». « En jetant son dévolu sur des jeunes filles solitaires, vulnérables, aux parents dépassés ou démissionnaires, G. savait pertinemment qu’elles ne menaceraient jamais sa réputation. Et qui ne dit mot consent ». Dans l’atmosphère de permissivité aveugle qui caractérise le monde intellectuel de l’époque, G., « stratège exceptionnel », est guidé par deux motivations : « Jouir et écrire ».
Car les deux sont inséparables. Double jouissance : celle, immédiate, qui satisfait ses sens, et celle qui, pour longtemps, va satisfaire son goût du scandale littéraire par le récit de ses turpitudes. Pas besoin de bien écrire : il suffit d’écrire glauque. « Avec G., je découvre à mes dépens que les livres peuvent être un piège dans lequel on enferme ceux qu’on prétend aimer, devenir l’instrument le plus contondant de la trahison. Comme si son passage dans mon existence ne m’avait pas suffisamment dévastée, il faut maintenant qu’il documente, qu’il falsifie, qu’il enregistre et qu’il grave pour toujours ses méfaits ».
Si le succès du livre de Vanessa Springora est dû en partie à la juste et bouleversante dénonciation qu’il développe, il ne faut pas cacher qu’il suscite une vraie réflexion sur les rapports entre la littérature, l’honnêteté intellectuelle, la morale et la loi, ainsi que sur la distinction à faire (ou non) entre la personne et l’œuvre. « Les écrivains sont des gens qui ne gagnent pas toujours à être connus. On aurait tort de croire qu’ils sont comme tout le monde. Ils sont bien pires. Ce sont des vampires ». Ce cri du cœur et la généralisation qu’il contient donnent matière à réflexion.
Jean-Pierre Longre
17:49 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, vanessa springora, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/01/2021
« À l’école de l’enfance »
 Jean Miniac, Béquille d’école, éditions Conférence, 2020
Jean Miniac, Béquille d’école, éditions Conférence, 2020
Ils sont quelques élèves de cours préparatoire à être « accompagnés », après la classe, au sein d’un atelier de lecture et d’écriture, dans le but de lever leurs difficultés. Dans cette école parisienne située en REP (réseau d’éducation prioritaire), nous faisons la connaissance d’Audrey, Jade, Yacine, Mathis, Adama, Ismaël, Alinaya, et nous rencontrons aussi Madame la Directrice et les enseignants, pleins de bonne volonté et, s’ils sont gagnés par la fatigue, portés par l’espoir, des parents parfois démunis, parfois méfiants, ainsi que le REV (ne nous méprenons pas, le « Responsable éducatif ville », qui veille sur la sécurité et gère les problèmes matériels…). Et il y a l’auteur, qui n’en est pas à son premier livre, loin s’en faut, mais qui en l’occurrence raconte son expérience d’accompagnateur (j’allais dire de « simple » accompagnateur, mais non ; c’est au contraire une expérience fort complexe !), l’auteur, donc, qui décrit ses activités quotidiennes avec des enfants dont l’apprentissage de la lecture et de l’écriture les aidera à franchir les barrières que la vie a dressées devant eux.
Ce pourrait être un compte rendu à caractère socio-psychologique, voire un traité de pédagogie. Si ces motifs sont présents dans ces pages, en clair ou en filigrane, ils n’en sont pas les éléments premiers. Tous ces textes brefs, formés de courts paragraphes s’apparentant à des versets, donnent un ensemble de variations (plus « coda ») tenant autant de la poésie en prose que de la narration. La poésie s’insinue même dans la tâche effectuée, « au carrefour de nos interactions » : « Le propre d’une activité de service, c’est que celui qui l’accomplit s’y oublie complètement. / La poésie devrait être ainsi. C’est sa vocation. »
Le travail quotidien de l’« accompagnateur », comme celui du personnel enseignant et administratif, peut paraître ingrat, comme en un éternel recommencement qui abolirait le courage. Décourageant, oui, parfois. « Mais l’espoir est plus fort que tout savoir, que toute conviction d’échec. » C’est ce que met en avant l’ouvrage de Jean Miniac : rien n’est définitif, et ces enfants qui paraissent en perdition forment une communauté dont chaque membre, soudé aux autres, forge son apprentissage et bâtit son destin, aidé en cela par l’adulte bienveillant et lucide qui, lui-même, se sent en retour « à l’école de l’enfance ». Et c’est poétiquement que celui-ci rend compte des transformations auxquelles il assiste, dont il se sent partie prenante. « Ces enfants qui ne partaient jamais ; ces enfants qui restaient ancrés dans le port circonscrit de leur entourage, de leur quartier, dans le havre de quelques rues… ils étaient en voyage, à présent… / Avaient-ils jamais cessé de l’être, pour peu que l’on écoute, en sourdine, leurs routes fuyantes, tapies sous chacun de leurs pas ? Les sillons qui s’y dessinent, leurs brusques inflexions de cap, non voulues, non réfléchies, simplement existantes. / Simplement nécessaires. / Comme l’élément qui les porte. »
Jean-Pierre Longre
22:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, jean miniac, éditions conférence, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/12/2020
Immigration et « nouvelles patries »
 Boris Adjemian, Les Petites Arménies, Éditions Lieux Dits, 2020
Boris Adjemian, Les Petites Arménies, Éditions Lieux Dits, 2020
L’histoire des Arméniens, depuis plus de cent ans, est semée de malheurs, de massacres, de migrations, mais aussi de résilience, et les derniers événements (nouvelle guerre du Haut-Karabagh, exactions des « loups gris » contre des communautés arméniennes en France…) font ressurgir les tribulations passées. La France, et particulièrement la région Rhône-Alpes, comprennent de nombreux foyers de fixation provisoire ou définitive des exilés arméniens ayant fui le génocide de 1915 et ses suites, qui se sont prolongées tout au long des années 1920-1930. L’ouvrage de Boris Adjemian rend compte avec beaucoup de précision de l’installation de ces exilés dans les villes de la vallée du Rhône et de ses alentours, Lyon et Villeurbanne, Saint-Étienne, Grenoble, Roanne, Vienne, Privas, Valence (ville privilégiée), et aussi des localités moins peuplées telles que Décines, Pont-de-Chéruy, Meyzieu, Romans, Largentière…
Trois grandes parties fixent la chronologie : « Groung » (la grue, emblème de l’oiseau migrateur), « les temps de l’exil », section qui étudie les origines et le déroulement de l’émigration, et montre que l’installation des individus, des familles et des communautés s’est heurtée à l’hostilité et aux préjugés raciaux de l’administration française (tracasseries, rejet, menaces d’expulsion etc.), et s’est faite le plus souvent dans le dénuement, mais qu’à force de volonté l’adaptation s’est effectuée par le travail, les regroupements par affinités, la préservation des traditions culturelles restant compatible avec l’intégration. La deuxième partie, « Haynots » (petites patries), analyse justement la « stabilisation » par la création d’associations ou unions, de « partis et chapelles »… « Dans les années 1920-1940, en dépit des mouvements croisés induits par l’arrivée de nouveaux immigrants et les départs répétés pour l’Arménie soviétique, les colonies arméniennes de la vallée du Rhône se stabilisent progressivement. Les hauts lieux de la présence arménienne (rues, quartiers, immeubles collectifs) s’affirment. La mise en place de structures communautaires favorise l’ancrage social des Arméniens, l’épanouissement d’une vie associative et culturelle, ainsi que l’appropriation et l’identification de nouveaux terroirs. » Les naturalisations se réalisent peu à peu, les « apatrides » devenant français, surtout à partir de 1939 et de la mobilisation. La troisième partie, « Houshamadyan, de la mémoire au patrimoine », décrit l’enracinement d’une communauté qui, tout en gardant son identité, a « pris ses marques » dans le tissu régional (et national). Actuellement, la mémoire se fixe sur les grands événements de l’histoire du peuple arménien tels que le génocide et les exils, le groupe de résistants dont Missak Manouchian était le chef, bien d’autres encore, cela grâce aux lieux culturels et cultuels, aux noms donnés à des rues et des places, aux jumelages, aux monuments (le Mémorial de Lyon, le « Centre du patrimoine arménien » de Valence etc.), aux commémorations régulières…
Ce volume présente plusieurs facettes : il est le fruit d’une recherche documentaire rigoureuse et approfondie, d’une quête de témoignages probants, d’une analyse historique et sociologique serrée ; il présente concrètement l’histoire de ces « petites Arménies » avec beaucoup de clarté et d’empathie, partant souvent d’exemples particuliers pour parvenir à une vision générale ; enfin, l’iconographie est à la fois riche, parlante et émouvante : photos de familles, de groupes, d’individus, reproductions de documents officiels, de passeports, de lettres… Voilà qui en fait à la fois ce qu’on appelle un « beau livre » et un essai historique, un ouvrage qui peut se lire de plusieurs manières et qui, s’il concerne au premier chef les Arméniens de la région, peut être mis entre toutes les mains.
Jean-Pierre Longre
17 rue René Leynaud
69 001 LYON
Tél : +33 (0) 4 72 00 94 20
Fondée en 2000, Lieux Dits est une maison d’édition spécialisée dans le Beau livre illustré dont le catalogue s’articule autour de trois thèmes principaux, le patrimoine, la photographie et récemment une collection sur le monde du travail plus particulièrement destinée à l’orientation professionnelle.
Issue du monde de la photographie, Lieux Dits attache une attention particulière à la reproduction de l’image imprimée dans des ouvrages de belle facture.
Le catalogue de Lieux Dits possède plus de 700 titres auxquels viennent s’ajouter une vingtaine de nouveautés par an.
19:22 Publié dans Essai, Histoire, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, beau livre, francophone, arméniens, boris adjemian, Éditions lieux dits, jean-pierre longre, arménie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/12/2020
Découvertes, souvenirs et coups de cœur
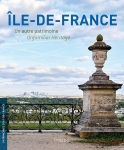 Île-de-France, Un autre patrimoine, réalisé par la Région Île-de-France, direction de la Culture, service Patrimoines et Inventaire, direction de la publication Julie Corteville, Éditions Lieux Dits, 2020
Île-de-France, Un autre patrimoine, réalisé par la Région Île-de-France, direction de la Culture, service Patrimoines et Inventaire, direction de la publication Julie Corteville, Éditions Lieux Dits, 2020
« Île-de-France »… D’où vient ce nom ? Il date du XVe siècle, désignant « un territoire compris entre trois cours d’eau : la Marne, la Seine et l’Oise. » Et selon Charles Estienne en 1552 : « L’isle de France contient ce qui est depuis sainct Denys dict en France, jusques a Roissy et Montmorency : et generalement le contenu entre les revolutions et sinuositez de la riviere de Seine, vers la Normandie d’un costé, et la Picardie de l’autre. » Province à part, puisqu’elle est « région-capitale », elle est particulièrement riche en témoignages du passé mais aussi en innovations diverses. Cet ouvrage met en relief l’héritage « pluriséculaire », le patrimoine « remarquable » dont jouit cette région.
 Les trois grandes sections (« Partir au vert », « Là où souffle l’esprit », « Au cœur de la modernité ») sont rythmées par des chapitres spécifiques illustrés par de magnifiques photographies, au contenu parfois inattendu. Nous découvrons par exemple dans le chapitre « Une ruralité méconnue » des fermes, dont certaines fort anciennes, parsemant la campagne agricole, et complémentairement l’originalité de la gastronomie « populaire et princière ». Découverte aussi des « villégiatures » construites par les familles aisées entre les XVIIIe et XXe siècles. Plus connus, les jardins des châteaux mettent en mémoire de majestueux points de vue.
Les trois grandes sections (« Partir au vert », « Là où souffle l’esprit », « Au cœur de la modernité ») sont rythmées par des chapitres spécifiques illustrés par de magnifiques photographies, au contenu parfois inattendu. Nous découvrons par exemple dans le chapitre « Une ruralité méconnue » des fermes, dont certaines fort anciennes, parsemant la campagne agricole, et complémentairement l’originalité de la gastronomie « populaire et princière ». Découverte aussi des « villégiatures » construites par les familles aisées entre les XVIIIe et XXe siècles. Plus connus, les jardins des châteaux mettent en mémoire de majestueux points de vue.
Le « souffle » de « l’esprit » est d’abord illustré par les grands édifices religieux, l’accent étant mis sur l’architecture gothique (bien sûr Notre-Dame de Paris et la basilique Saint-Denis, sans oublier Provins ou Étampes, entre autres), mais aussi par le « patrimoine religieux » du XXe siècle, églises, temples, synagogues, mosquées etc. Ce sont encore les lieux de pouvoir comme Le Louvre, Versailles, le château de Vincennes… De même les lieux artistiques : musées, ateliers, œuvres plus ou moins expérimentales telles que celles de Calder, Dubuffet ou Buren. Des points de vue sur certains théâtres donnent des images, au-delà des bâtiments renommés, d’« une constellation de salles » de style art déco, et c’est une jolie surprise. La section consacrée à « l’esprit » se termine, et c’est justice, par les lieux d’études : lycées, universités, centres de recherche, avec des photos d’une grande originalité (voyez celles de l’École nationale supérieure des télécommunications ou du lycée Camille Sée).
Preuve que l’Île-de-France est bien une terre d’innovations, le chapitre « Au cœur de la modernité » est consacré aux « cathédrales de l’industrie », manufactures et usines mises en valeur par l’archéologie industrielle ; puis à l’architecture des banlieues, des pavillons aux grands ensembles, avec ses réussites et ses échecs. Les transports terrestres et aériens et, pour finir, les équipements sportifs concluent ce tour d’horizon sinon exhaustif, du moins remarquablement représentatif de la diversité d’un patrimoine inépuisable. Si les textes décrivent et explicitent clairement chaque facette de ce patrimoine, les photographies pleine page pour la plupart relèvent de l’art, aussi bien du point de vue thématique que du point de vue esthétique. Complété par la localisation précise des sites photographiés et par la « liste des publications du service de l’inventaire d’Île-de-France », cet ouvrage permet à chacun de trouver des souvenirs, des pistes de visites et des coups de cœur… et une belle idée de cadeau.
Jean-Pierre Longre
17 rue René Leynaud
69 001 LYON
Tél : +33 (0) 4 72 00 94 20
Fondée en 2000, Lieux Dits est une maison d’édition spécialisée dans le Beau livre illustré dont le catalogue s’articule autour de trois thèmes principaux, le patrimoine, la photographie et récemment une collection sur le monde du travail plus particulièrement destinée à l’orientation professionnelle.
Issue du monde de la photographie, Lieux Dits attache une attention particulière à la reproduction de l’image imprimée dans des ouvrages de belle facture.
Le catalogue de Lieux Dits possède plus de 700 titres auxquels viennent s’ajouter une vingtaine de nouveautés par an.
16:39 Publié dans Essai, Mots et images, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beau livre, essai, photographie, francophone, anglophone, région Île-de-france, Éditions lieux dits, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/12/2020
Le droit de s’emparer de tout
Lire, relire... Hervé Le Tellier, Esthétique de l'Oulipo, Le Castor Astral, 2006.
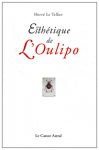
« Existe-t-il une approche oulipienne de l’esthétique ? Une esthétique oulipienne ? Quitte à décevoir, affirmons-le : sous cette formulation brutale, certainement pas. Le groupe est lié par un refus commun, celui du hasard, et non par une quelconque théorie du beau ». Qu’est-ce à dire ? Hervé Le Tellier cultiverait-il le paradoxe gratuit ? La provocation ? Pas vraiment. Il n’y a pas de « beau » oulipien, mais il y a une « création » et une « réception » oulipiennes, qui peuvent être étudiées, et c’est à cette étude que se consacre l’un des piliers actuels de l’Ouvroir de Littérature Potentielle, dans une perspective à la fois vulgarisatrice, scientifique, et tout de même un peu ludique, forcément.
Cinq chapitres qui se succèdent dans un ordre logique (« Fondation et influences », « Univers (et niveaux) « naturels » de complicité », « Immédiatetés culturelles », « Lecteur, encore un effort », « La forme, la contrainte et le monde » (ou « Desseins et dessins », on ne sait pas bien)) convergent vers l’idée d’un oulipisme humaniste : le groupe que fondèrent légitimement Raymond Queneau et François Le Lionnais (avec quelques autres) et qui fonde sa légitimité sur les contraintes formelles serait l’un des ultimes lieux où l’homme trouverait une place, « parce que la potentialité de la littérature est une forme de revanche dérisoire sur celle de l’existence » ; lieu de complicité, « choix de création, ironique et désenchanté ».
Oui. Et comme « l’Oulipo revendique, avec d’autres, le droit des poètes à s’emparer de tout », Le Tellier poète laisse parler Le Tellier poéticien, analyste et théoricien. S’il recense les principaux procédés contraignants de la création oulipienne – des poèmes à forme fixe à l’homophonie (« l’homme aux faux nids ») en passant par le pastiche, la parodie, le contrepet, l’acrostiche, le palindrome, le lipogramme, le « S+7 » et quelques autres manipulations –, il les place dans le contexte général de la création. Et s’il étudie les rapports de l’Oulipo avec le surréalisme, avec les mathématiques, avec l’art, il rappelle que tout cela se situe dans un vaste cadre : celui de la littérature.
Alors, il ne paraît pas inutile qu’il participe aux tentatives de définition et d’évaluation de la littérature ; qu’il rappelle le rôle des mots et de la langue dans la poésie (« il y a chez tout poète cette utopie cratylienne de la langue »), ainsi que la richesse de la multiplicité linguistique (jeux lexicaux et orthographiques à l’appui) ; qu’il développe le concept d’intertextualité afin de montrer comment les textes oulipiens s’inscrivent dans la « généalogie de la littérature »… Et il ne paraît pas hors de propos d’affirmer que cette Esthétique de la littérature, destinée à la fois à faire le point sur 45 ans de vie commune, à replacer cette vie dans le champ littéraire général et à ouvrir des horizons nouveaux, est un ouvrage nécessaire.
Jean-Pierre Longre
21:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/11/2020
Une mine de bribes
 Le cabinet Lambda, 5014 citations à siroter, croquer, injecter ou infuser, compilées par Paul Lambda, Cactus Inébranlable éditions, 2020
Le cabinet Lambda, 5014 citations à siroter, croquer, injecter ou infuser, compilées par Paul Lambda, Cactus Inébranlable éditions, 2020
« Ça fait très longtemps que je ne lis pas de livre : je lis dans les livres. ». Cette citation d’Éloïse Lièvre résume l’attitude que nous avons face au Cabinet Lambda : on ne va pas s’amuser (s’astreindre ?) à lire le livre in extenso, de la page 7 à la page 700. Non. Pour explorer cette mine, pour en goûter les délices, nous pouvons en user de plusieurs manières, l’aborder sous différentes faces. Feuilleter l'ouvrage, et ainsi se fier au hasard des rencontres séduisantes; chercher un mot qui nous intéresse (ils sont déclinés dans l’ordre alphabétique), le trouver (il y a de grandes chances) et en épuiser le contenu ; utiliser l’ « index des auteurs et autres sources » afin de chercher un écrivain (ou autre) et se reporter aux numéros des citations qui le concernent (à considérer cet index, on devine les préférences de Paul Lambda).
Avec modestie, celui qui dit avoir « compilé » ces citations (« tirées de livres, de films et de deux trois passants, de beaucoup de morts et de quelques vivants ») écrit en avant-propos : « C’est mon meilleur livre car il n’est pas de moi. » Certes. Il y a tout de même un énorme travail, visant à « attiser la curiosité », à stimuler l’intellect, la mémoire, la lecture. Car le souvenir de telle œuvre lue jadis ou naguère n’empêche pas la relecture, et la méconnaissance de telle autre pousse à s’y plonger. Sans oublier le plaisir esthétique qu’il y a à superposer des phrases ou de brefs paragraphes, à les faire résonner ensemble, à les remâcher même.
L’inconvénient, avec ce genre d’ouvrage, c’est que le chroniqueur ne peut pas le résumer. S’il veut encourager le futur lecteur (et il le veut), il en est réduit à en citer quelques bribes. Alors, puisque « la législation sur le droit d’auteur » le tolère, en voici quelques-unes, qui pourraient faire naître quelques échos dans notre monde intérieur et extérieur. « Au réveil : malade ; oreilles bouchées, nez qui coule, mal de tête. Mort prochaine ? » (Francis Frog) ; « Je lave chaque matin je ne sais combien de paires de mains qui, toutes, m’appartiennent. » (Vincent La Soudière) ; « À vous votre religion, et à moi ma religion. » (Le Coran) ; « Le terrorisme n’est pas l’expression d’une rage. Le terrorisme, c’est une arme politique. Retirez à un gouvernement sa façade d’infaillibilité et vous retirez la confiance que le peuple peut lui porter. » (Dan Brown) ; « À force de silence, ils ont fini par s’entendre. » (Katherine Mansfield et son mari) ; « Quelle merveilleuse invention que l’homme ! Il peut souffler dans ses mains pour les réchauffer et souffler sur sa soupe pour la refroidir. » (Georges Perec). Pour finir, du côté des auteurs : « Je voudrais arriver un jour à tout faire comprendre en une simple ligne. » (Hugo Pratt) ; et des éditeurs : « Un écrivain est innocent, un éditeur coupable. […] Ne regardez pas seulement ce que je publie, regardez ce que je ne publie pas. ».
Jean-Pierre Longre
16:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : citations, compilation, francophone, paul lambda, cactus inébranlable éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2020
« Toute vie a sa part de mystère »
 Lire, relire...Dominique Bona, Mes vies secrètes, Gallimard, 2019, Folio, 2020
Lire, relire...Dominique Bona, Mes vies secrètes, Gallimard, 2019, Folio, 2020
Dominique Bona est connue pour avoir raconté d’autres vies que la sienne. Outre ses romans, elle a écrit les biographies de Romain Gary, Stefan Zweig, Berthe Morisot, Camille Claudel, Clara Malraux, Paul Valéry, Colette, Gala Dalí, André Maurois, des sœurs Heredia, des sœurs Rouart… Personnes déjà plus ou moins notoires et bien réelles, qui sont ainsi devenues des personnages, non de fiction, non de roman, mais de récits en quête de vérité humaine. Cette quête, elle passe par la construction des « vies secrètes » dont on ne sait si elles sont celles des protagonistes, celles de l’auteure, ou les deux à la fois.
 Le livre, qui a les caractéristiques de l’autobiographie sans en être vraiment une, est peuplé d’une myriade de personnages tournant autour des grandes figures qui ont occupé les recherches, le travail, l’existence de la biographe : Pierre Louÿs, Manet, Mallarmé, Degas, Debussy, Paul Claudel, Rodin, Michel Mohrt, Simone Gallimard, Salvador Dalí, Michel Déon, François Nourissier, d’autres encore… À vrai dire, les fréquentations de Dominique Bona ne sont pas seulement littéraires, et elle leur reconnaît une influence profonde : « Les personnages ont tout pouvoir sur leur biographe, qui en ressent leurs ondes et en accuse les effets. Gary, avec ses masques, me désorientait et j’ai fini par le perdre. Zweig m’a entraînée dans sa descente vers l’abîme et conduite aux portes de la dépression qui l’a finalement emporté. Berthe Morisot voulait que je sois droite et claire, comme elle tenace et appliquée. Clara Malraux m’a communiqué sa joie, sa malice, et fait pleurer aussi avec elle, dans les moments de tendresse vaincue. Mais aucun ne m’a procuré comme Gala tant d’ondes dynamiques : l’énergie, la force qui va, tels sont ses dons de muse. ».
Le livre, qui a les caractéristiques de l’autobiographie sans en être vraiment une, est peuplé d’une myriade de personnages tournant autour des grandes figures qui ont occupé les recherches, le travail, l’existence de la biographe : Pierre Louÿs, Manet, Mallarmé, Degas, Debussy, Paul Claudel, Rodin, Michel Mohrt, Simone Gallimard, Salvador Dalí, Michel Déon, François Nourissier, d’autres encore… À vrai dire, les fréquentations de Dominique Bona ne sont pas seulement littéraires, et elle leur reconnaît une influence profonde : « Les personnages ont tout pouvoir sur leur biographe, qui en ressent leurs ondes et en accuse les effets. Gary, avec ses masques, me désorientait et j’ai fini par le perdre. Zweig m’a entraînée dans sa descente vers l’abîme et conduite aux portes de la dépression qui l’a finalement emporté. Berthe Morisot voulait que je sois droite et claire, comme elle tenace et appliquée. Clara Malraux m’a communiqué sa joie, sa malice, et fait pleurer aussi avec elle, dans les moments de tendresse vaincue. Mais aucun ne m’a procuré comme Gala tant d’ondes dynamiques : l’énergie, la force qui va, tels sont ses dons de muse. ».
Certes, les biographies, sans expliquer ce que sont vraiment l’art ou la littérature (voir le Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust), permettent d’aller au-delà des apparences, de montrer quelques-unes des faces cachées d’êtres trop connus pour échapper aux clichés. Mais il faut reconnaître que « toute vie a son mystère ». « Le biographe se donne pour mission d’aller aussi loin que possible dans la découverte du personnage, dans son intimité profonde, cachée. Mais il demeure et demeurera toujours en deçà de l’inaccessible secret de chacun. ». Si dans Mes vies secrètes Dominique Bona évoque les aspects pluriels de sa vie personnelle en même temps qu’elle rappelle les vies auxquelles elle s’est consacrée, elle ne dévoile pas ce que le titre de son livre a d’ambigu et de dense.
Jean-Pierre Longre
www.folio-lesite.fr
20:22 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, francophone, dominique bona, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/10/2020
Pierres maternelles
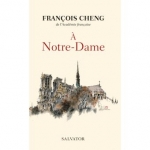 François Cheng, À Notre-Dame, Éditions Salvator, 2019
François Cheng, À Notre-Dame, Éditions Salvator, 2019
Les paroles s’envolent, les écrits restent. De même les images traumatisantes, telles celles de l’incendie, en avril 2019, de Notre-Dame de Paris. Le surlendemain de la catastrophe, François Cheng, participant à l’émission « La grande librairie », y parle de « l’émotion » collective, mais aussi de la « mémorable communion universelle qu’aucun artifice humain n’aurait réussi à créer. » Il évoque la cathédrale comme monument unique, incarnant « notre âme commune », au caractère vivant, « chargé de spiritualité ». Un monument véritablement maternel dont, par sa destruction, l’amour nous échappe. Mais non, dit-il, « Notre-Dame est sauvée ».
Ce sont ces paroles qui sont publiées dans ce mince et précieux volume, suivies de lettres émues et émouvantes de téléspectateurs, admirant la « voix de vérité », le « rayonnement spirituel » de François Cheng qui, dans un « ajout » de quelques pages, avoue qu’il a habituellement des réticences à s’exprimer à la télévision, mais qu’en l’occurrence il a su décrire « ce qui [l]’habitait », et que lui « qui venait de l’autre bout du monde » « a pu trouver enfin les mots pour dire, à sa manière, sa gratitude envers la terre qui l’a accueilli, ainsi que sa rencontre en profondeur avec son peuple et son histoire. ». Et il a su chanter en Notre-Dame de Paris « un vaisseau portant toujours plus loin, toujours plus haut, les rêves humains. ».
Jean-Pierre Longre
23:12 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, françois cheng, Éditions salvator, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/07/2020
Choisir et ranger, ou « penser / classer »
 Albert Cim, Une bibliothèque, éditions Manucius, Littéra, 2020
Albert Cim, Une bibliothèque, éditions Manucius, Littéra, 2020
George Perec avait-il lu Albert Cim avant d’écrire ses « Notes brèves sur l’art et la manière de ranger ses livres » ? En tout cas, c’est un sujet qui préoccupe non seulement les bibliophiles, mais tous les possesseurs de (plusieurs) livres. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. Une bibliothèque a été publié en 1902, et cette réédition, même partielle, est un témoignage à la fois fort érudit, très abordable et bien émouvant de cette préoccupation récurrente.
L’ouvrage commence par un chapitre substantiel sur « l’amour des livres et de la lecture », où, après une distinction faite entre les types de lectures (notamment celle du livre et celle du journal), l’auteur développe dans un style d’époque sa passion pour les livres en s’appuyant sur de nombreuses citations, de l’antiquité au XIXème siècle – ce qui nous permet, à côté de noms connus, de découvrir des auteurs oubliés tels qu’Édouard Laboulaye, Ferdinand Fabre, Hippolyte Rigault, Jules Richard ou Gustave Mouravit… sans omettre Albert Cim lui-même. Et les questions de se précipiter : quel papier, quel aspect, quel format privilégier ? Notons que Cim, dans le chapitre suivant (« De l’achat des livres »), anticipe sur les éditions de poche actuelles en appelant de ses vœux des « éditions portatives » « à la portée des petites bourses », et s’attarde aussi sur les livres d’occasion et la fréquentation des bouquinistes. Quoi qu’il en soit, de la passion, mais aussi de la raison, et pas de boulimie : « Est-il raisonnable […] d’acheter plus de livres qu’on n’en peut lire, et n’est-ce pas une excellente habitude de n’effectuer de nouveaux achats qu’après avoir terminé la lecture des acquisitions précédentes ? ».
Le dernier chapitre est le point de convergence des précédents : « De l’aménagement d’une bibliothèque et du rangement des livres ». « De la bonne disposition et du bon ordre de notre bibliothèque dépendent, en très grande partie, le plaisir et les services que nous tirerons d’elle ». Les conseils donnés sont des plus pratiques, des plus concrets : mettre les livres à l’abri de l’humidité, préférer les rayonnages ouverts aux meubles fermés (il y a même des conseils de menuiserie), combiner le rangement par formats avec l’ordre alphabétique des noms d’auteurs, voire avec les thèmes… Et retenons ceci : « Le point capital pour vous, ou même le seul point à retenir, c’est que votre classement vous plaise, et que vous le possédiez jusqu’au bout des doigts, de façon à aller quérir sans lumière ou les yeux fermés n’importe lequel de vos volumes. » Et bien sûr, après cela, de faire la lumière et d’ouvrir les yeux en même temps que le livre…
Jean-Pierre Longre
21:25 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, albert cim, éditions manucius, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2020
Queneau et Cioran
 Jean-Pierre Longre, Richesses de l'incertitude. Queneau et Cioran / The Riches of Uncertainty. Queneau and Cioran. Bilingual book - ouvrage bilingue, translated from the French by Rosemary Lloyd. Black Herald Press, 2020.
Jean-Pierre Longre, Richesses de l'incertitude. Queneau et Cioran / The Riches of Uncertainty. Queneau and Cioran. Bilingual book - ouvrage bilingue, translated from the French by Rosemary Lloyd. Black Herald Press, 2020.
Bizarre. Lorsque je lis Cioran, je pense souvent à Queneau, et lorsque je lis Queneau, je pense parfois à Cioran. Il s’agit peut-être là d’un phénomène tout simple : pour un familier de Queneau, le risque est de laisser son esprit en être occupé même lorsqu’il lit d’autres auteurs ; pour un familier aussi de la littérature d’origine roumaine, préoccupé entre autres par Cioran, le risque est de laisser à celui-ci le champ un peu trop libre dans des lectures diverses, notamment queniennes… Bref, il me fallait tenter d’élucider la question pour mieux m’en débarrasser, en naviguant entre Exercices de style et Exercices d’admiration.
How strange. Reading Cioran often puts me in mind of Queneau, and reading Queneau sometimes puts me in mind of Cioran. Perhaps this is really quite a simple phenomenon: for anyone who is familiar with Queneau, there is a risk of letting your mind be taken over by him even when you read other authors, and for anyone familiar with literature from Romania, and preoccupied with such writers as Cioran, the risk is that you will give him too much leeway in your various readings, especially the works of Queneau… In a word, I felt I needed to clarify the question the better to clear my mind of it, as I navigated between Exercises in Style and Exercises in Admiration.
https://www.blackheraldpress.com/boutique-shop
Voir:
Article de Mircea Anghelescu: J.P.Longre.jpg (Observator Cultural)
Article de Dominique et Daniel Ilea:
https://revue-traversees.com/2020/06/20/deux-ecrivains-a-...
https://www.litero-mania.com/deux-ecrivains-a-la-loupe/
https://www.viataromaneasca.eu/revista/2021/03/doi-scriitori-sub-lupa/
Une analyse d'Aurélien Demars:
22:46 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, littérature, francophone, anglophone, raymond queneau, cioran, jean-pierre longre, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/03/2020
L’amitié, la littérature, l’histoire
 Panaït Istrati – Romain Rolland, Correspondance 1919-1935, édition établie, présentée et annotée par Daniel Lérault et Jean Rière, Gallimard, 2019
Panaït Istrati – Romain Rolland, Correspondance 1919-1935, édition établie, présentée et annotée par Daniel Lérault et Jean Rière, Gallimard, 2019
Les publications de correspondances d’écrivains ont-elles un intérêt ? Non, si elles sont uniquement l’occasion de donner lieu à des anecdotes biographiques, voire à de vaines indiscrétions. Oui, si elles donnent à lire des lettres qui reflètent de fortes personnalités, qui portent témoignage de l’Histoire et qui relèvent de la vraie littérature.
Cette édition de la Correspondance 1919-1935 entre Panaït Istrati et Romain Rolland, qui « fera date », comme l’écrit Christian Delrue dans Le Haïdouc de l’été 2019, répond à tous ces critères. D’autant plus que nous avons affaire à un ouvrage très élaboré, une véritable édition scientifique, dans laquelle on peut puiser à satiété. Les notes, références, explications concernant le contexte, comme les annexes (extraits divers, lettres complémentaires, analyse graphologique etc.), renforcent l’authenticité d’un ensemble qui ne comporte « aucune suppression, aucun ajout, aucune modification », reprenant « les autographes originaux ».
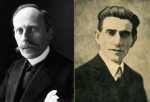
Les éditeurs précisent en outre : « Vocabulaire, orthographe, syntaxe ont été conservés en gardant un souci de lisibilité et d’homogénéité. ». C’est là un aspect primordial de ce volume, pour ce qui concerne Panaït Istrati : on peut relever, de moins en moins nombreuses au fil du temps, les erreurs, les maladresses, les « fautes » d’un homme né en Roumanie, qui a beaucoup voyagé et qui a appris le français sur le tard, seul avec ses modèles ; et les conseils encourageants de Romain Rolland, qui n’hésite pas à lui envoyer de petits tableaux de fautes à éviter (« Ne pas dire… mais…), tout en s’enthousiasmant pour le « don de style », le « flot de vie » de son correspondant. Pour qui veut étudier l’évolution linguistique et littéraire d’un écrivain qui s’évertue (et qui parvient admirablement) à passer de sa langue maternelle à une langue d’adoption, c’est une mine. « On ne saura jamais combien de fois par jour je hurle de rage, et m’ensanglante la gueule et brise mes dents en mordant furieusement dans cet outil qui rebelle à ma volonté », écrit-il à son « maître » (les ratures sont d’origine, attestant la fidélité au texte initial). Mais la volonté servira la « Nécessité » d’écrire, et on mesure à la lecture combien Istrati a progressé, et combien cette progression a servi la vigueur de son expression.
Autre aspect primordial : l’Histoire, dont les troubles et les soubresauts provoquèrent une querelle politique et une brouille d’envergure entre deux personnalités de fort tempérament. Pour le rappeler d’une manière schématique, les voyages qu’Istrati fit en URSS lui révélèrent une réalité bien différente de celle qu’il imaginait, lui dont l’idéal social et politique le portait pourtant vers le communisme. Sa réaction « consterne » un Romain Rolland resté fidèle à son admiration pour le régime soviétique. « Rien de ce qui a été écrit depuis dix ans contre la Russie par ses pires ennemis ne lui a fait tant de mal que ne lui en feront vos pages. ». Le temps a montré qui avait raison… Certes, tout n’est pas aussi simple, et l’un des avantages de cette correspondance est de montrer que, sous les dehors d’un affrontement rude et apparemment irrémédiable, certaines nuances sont à prendre en compte. Il y aura d’ailleurs une réconciliation en 1933, même si chacun campe sur ses positions à propos de l’URSS (pour Romain Rolland « le seul bastion qui défend le monde contre plusieurs siècles de la plus abjecte, de la plus écrasante Réaction », pour Panaït Istrati « lieu des collectivités nulles, aveugles, égoïstes » et du « soi-disant communisme »). Malgré cela donc, le pardon et l’amitié l’emportent, peu avant la mort d’Istrati.
Évidemment, il n’y a pas que cela. Il y a les enthousiasmes et l’idéalisme du scripteur en formation devenu auteur accompli, qui contrastent souvent avec la lassitude d’une gloire des Lettres accablée par le travail, les visites, les sollicitations. Il y a, racontées avec la vivacité d’un écrivain passionné, des anecdotes semées de savoureux dialogues et de descriptions pittoresques. Il y a les échanges sur la vie quotidienne, la santé, les rencontres, les complicités, les amitiés, les amours… Et les projets littéraires, les péripéties liées à la publication des œuvres, les relations avec d’autres artistes – tout ce qui fait la vie de deux êtres qui ont en commun la passion généreuse de la littérature. Chacun peut y trouver son compte.
En 1989, parut chez Canevas éditeur une Correspondance intégrale Panaït Istrati – Romain Rolland, 1919-1935, établie et annotée par Alexandre Talex, préfacée par Roger Dadoun. Une belle entreprise, qui cependant se voulait trop « lisible », effaçant les maladresses de l’auteur débutant, les scories, repentirs, ratures… Fallait-il s’en tenir à cette version fort louable, mais partielle et édulcorée ? Non. Daniel Lérault et Jean Rière ont eu raison de s’atteler à une tâche difficile, pleine d’embûches, mais qui a donné un résultat d’une fidélité scrupuleuse et d’une grande envergure historique et littéraire.
Jean-Pierre Longre
En complément :
Le Haïdouc n° 21-22 (été 2019), « bulletin d’information et de liaison de l’Association des amis de Panaït Istrati » est consacré à cette Correspondance. Et l’un des numéros précédents (n° 14-15, automne 2017 – hiver 2018) contient un texte éclairant de Daniel Lérault et Jean Rière sur leur publication. Voir www.panait-istrati.com
17:57 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : correspondance, francophone, roumanie, panaït istrati, romain rolland, daniel lérault, jean rière, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/01/2020
Les Caractères, miroir toujours fidèle
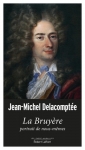 Jean-Michel Delacomptée, La Bruyère, portrait de nous-mêmes, Robert Laffont
Jean-Michel Delacomptée, La Bruyère, portrait de nous-mêmes, Robert Laffont
Certes, Jean de La Bruyère est un classique, et chacun se rappelle avoir lu, apprécié, étudié l’un ou l’autre des portraits dans lesquels il croque les humains de ses traits de plume ravageurs et savoureux. Mais un classique à part, dont l’œuvre est unique, dans tous les sens du terme : elle est sa seule production littéraire, et la seule dans son genre, même s’il se réclame d’abord du Grec Théophraste.
Jean-Michel Delacomptée nous rappelle cela, dévoilant par la même occasion certains aspects du personnage que faute de témoignages convergents on connaît mal : discret, « fort honnête homme », « maltraité » par la nature… Surtout, l’auteur analyse sans pédanterie, sans susciter l’ennui, bien au contraire, le contenu et la forme des Caractères, en insistant (le titre l’annonce) sur leur intemporalité. Bien sûr, La Bruyère peint toutes sortes de personnages inspirés par ceux qu’il a croisés à la ville et à la cour : le riche qui « s’étale » et le pauvre qui « ne prend aucune place », le bourgeois, le courtisan, le distrait, le glouton, l’égocentrique, l’hypocrite, l’intrigant, les femmes de toutes sortes, le misogyne… Et l’on s’aperçoit vite que, au-delà des aspects circonstanciels, c’est bien le genre humain de toute époque qui est visé, avec une impitoyable lucidité et une ferme volonté morale : « Écrire, pour lui, consistait à dénoncer les iniquités abusives afin de ramener dans la bergerie le troupeau égaré. Douteux succès, il en avait conscience. Mais il se fiait assez à la force des mots pour croire en leur capacité de convaincre les récalcitrants et même les obtus. ».
Corriger les vices, telle était la cause qu’il annonçait en mettant en forme les portraits qu’il composait. Non les vices de tel ou tel en particulier, mais ceux qui rongent la société. Moraliste sévère et conservateur, se situant du côté des Anciens dans la fameuse « Querelle des Anciens et des Modernes », La Bruyère est aussi un remarquable styliste à la plume subtile et acérée : « Les Caractères réalisent la synthèse entre la gravité de la pensée et l’excellence du style naturel, et c’est cette fusion de la forme élégante, foncièrement aristocratique, et du fond sérieux, qui, pour La Bruyère, faisait un écrivain. Et qui continue à le faire. ». Et Jean-Michel Delacomptée, avec la vivacité de son propre style, nous le présente, effectivement, comme un écrivain toujours vivant.
Jean-Pierre Longre
18:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, jean-michel delacomptée, la bruyère, robert laffont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/01/2020
Journal d’une reconstruction
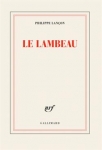 Lire, relire, 5 ans après... Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, Folio 2019.
Lire, relire, 5 ans après... Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, Folio 2019.
Prix Femina 2018. Prix spécial du jury Renaudot 2018
À l’hôpital de la Salpêtrière, quelques jours après l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie-Hebdo qui lui a emporté la mâchoire, Philippe Lançon, pensant à l’infirmière de nuit qui « avait le prénom d’un personnage de Raymond Queneau », se prend à évoquer deux vers de l’écrivain : « Je crains pas ça tellment la mort de mes entrailles / et la mort de mon nez et celle de mes os ». Quelques strophes plus loin, Queneau écrit ceci, qui pourrait s’appliquer à ce que Lançon tente de dépasser : « Je crains bien le malheur le deuil et la souffrance / et l’angoisse et la guigne et l’excès de l’absence / Je crains l’abîme obèse où gît la maladie / et le temps et l’espace et les torts de l’esprit ».
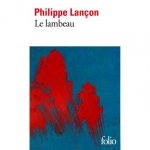 Rescapé de la tuerie dont il fait un récit à la fois terrifiant et subjectif, le récit d’une « abjection » vue du point de vue particulier d’une victime qui attend « simultanément l’invisibilité et le coup de grâce – deux formes de la disparition », l’auteur, journaliste à Charlie-Hebdo et à Libération, consacre le reste des 500 pages de son livre à la reconstruction : celle de sa mâchoire, qui va nécessiter de nombreuses opérations, et celle de sa personne tout entière, corps et esprit. Aucun détail ne nous est caché de ces mois de soins, de greffes, de suintements, de silences, d’interrogations, d’espoirs, de souffrances, d’attente au long desquels Chloé, sa chirurgienne, prend une importance médicale et humaine de plus en plus grande. L’entourage aussi tient une place prépondérante dans l’accompagnement du « patient » : son frère, ses parents, son ex-femme Marilyn, sa compagne Gabriela, ses nombreux et chaleureux amis ; et la lente progression du récit de la réparation, avec ses hauts et ses bas, est si prégnante, les précisions sanitaires et psychologiques si circonstanciées que nous, lecteurs, sommes complètement pris dans la nasse, au point de nous confondre avec l’auteur adressant ses plaintes au corps médical : « Docteur, vous m’écoutez ? La jambe et le pied droit me font mal, la cuisse droite aussi, plus encore la nuit que le jour. Le simple contact du drap m’irrite le pied entier et m’empêche de dormir. Les nerfs semblent à vif. La malléole me fait particulièrement souffrir. […] Le menton, de plus en plus envahi par les fourmis, est vivant. J’en suis venu à croire que je pense par le menton. Heureusement, je pense peu. ». Nous sommes avec lui, pleinement.
Rescapé de la tuerie dont il fait un récit à la fois terrifiant et subjectif, le récit d’une « abjection » vue du point de vue particulier d’une victime qui attend « simultanément l’invisibilité et le coup de grâce – deux formes de la disparition », l’auteur, journaliste à Charlie-Hebdo et à Libération, consacre le reste des 500 pages de son livre à la reconstruction : celle de sa mâchoire, qui va nécessiter de nombreuses opérations, et celle de sa personne tout entière, corps et esprit. Aucun détail ne nous est caché de ces mois de soins, de greffes, de suintements, de silences, d’interrogations, d’espoirs, de souffrances, d’attente au long desquels Chloé, sa chirurgienne, prend une importance médicale et humaine de plus en plus grande. L’entourage aussi tient une place prépondérante dans l’accompagnement du « patient » : son frère, ses parents, son ex-femme Marilyn, sa compagne Gabriela, ses nombreux et chaleureux amis ; et la lente progression du récit de la réparation, avec ses hauts et ses bas, est si prégnante, les précisions sanitaires et psychologiques si circonstanciées que nous, lecteurs, sommes complètement pris dans la nasse, au point de nous confondre avec l’auteur adressant ses plaintes au corps médical : « Docteur, vous m’écoutez ? La jambe et le pied droit me font mal, la cuisse droite aussi, plus encore la nuit que le jour. Le simple contact du drap m’irrite le pied entier et m’empêche de dormir. Les nerfs semblent à vif. La malléole me fait particulièrement souffrir. […] Le menton, de plus en plus envahi par les fourmis, est vivant. J’en suis venu à croire que je pense par le menton. Heureusement, je pense peu. ». Nous sommes avec lui, pleinement.
Le récit n’est pas pour autant égocentré. Outre la leçon de courage et l’éloge du personnel hospitalier, nous avons affaire à une émouvante et pittoresque galerie de portraits : ceux des familiers, mais aussi ceux de pas mal d’inconnus, soignants et soignés, hommes et femmes croisés en chemin, policiers chargés de la protection de celui qui reste une cible potentielle, policiers pour qui il se prend d’une amitié reconnaissante, quand ce n’est pas d’une complicité souriante, silhouettes entrevues, toute une humanité bien campée dans son environnement ou perdue dans l’incertain. Et l’écriture acérée, poétique, chargée de sens ou pétrie de questions de Philippe Lançon est à bonne école. On ne le trouve jamais sans son Proust, son Kafka ou son Thomas Mann, qu’il emporte jusqu’au bloc pour lire et relire ses passages favoris ; sans oublier la musique : Bach le plus souvent possible (Les Variations Goldberg, Le Clavier bien tempéré, L’Art de la Fugue), le jazz aussi… Le lambeau n’est pas une simple « hostobiographie » (pour reprendre le mot-valise d’Alphonse Boudard), mais le roman d’une tranche de vie personnelle qui vaut toutes les destinées (comme l’a écrit Sartre cité par Lançon : « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. »), toutes les destinées donc, avec leurs inévitables paradoxes : alors que l’auteur, jouissant de ses premiers instants de vraie liberté, peut enfin rejoindre sa compagne à New-York, éclate l’attentat du 13 novembre 2015 à Paris. Même de loin, c’est un nouveau « décollement de conscience ».
Jean-Pierre Longre
09:09 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, philippe lançon, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2019
« Il n’est de solution à rien »
 Cioran, Divagations, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Arcades Gallimard, 2019
Cioran, Divagations, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Arcades Gallimard, 2019
Débusqué à Paris (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet), cet ensemble d’écrits, qui « date vraisemblablement de 1945 », selon Nicolas Cavaillès, est l’une des dernières œuvres rédigées par Cioran dans sa langue maternelle, avec d’autres « Divagations », publiées en 1949, ainsi que Fenêtre sur le Rien (voir ci-dessous). Ensuite, ce sera Précis de décomposition puis les autres grands textes écrits en français et publiés dans les Œuvres (Gallimard /Pléiade).
Cioran est adepte du fragment, et ce volume resté à l’état de brouillon lui permet, en pratiquant la brièveté, de s’exprimer en toute liberté, quitte à se contredire parfois – mais le paradoxe est l’une de ses figures favorites (voir : « Entre une affirmation et une négation, il n’y a qu’une différence d’honorabilité. Sur le plan logique comme sur le plan affectif, elles sont interchangeables. »). La brièveté va de pair avec le sens aigu de la formule tendant vers la perfection : « Les pensées devraient avoir la perfection impassible des eaux mortes ou la concision fatale de la foudre. » ; et quoi qu’il en soit, « il n’est de solution à rien ». Ce qui n’empêche pas qu’on surprenne ce sceptique absolu à explorer le versant poétique (bien que sombre) du monde en prenant part « aux funérailles indéfinies de la lumière » et à « la cérémonie finale du soleil », ou en découvrant « un sonnet indéchiffrable » dans « l’harmonie de l’univers ».
Bref (c’est le cas de l’écrire), les grands thèmes de la philosophie et de la morale cioraniennes se succèdent en ordre aléatoire au fil des pages : la vie (qui n’a « aucun sens », mais « nous vivons comme si elle en avait un »), la mort, Dieu (qui reste à « réaliser »), la révolte (« vaine », mais « la rébellion est un signe de vitalité »), la douleur, la solitude, la tristesse (engendrée notamment par « la pourriture secrète des organes »), cette tristesse inséparable du « dor » roumain, langueur, nostalgie, « ennui profond » de l’inoccupation – tout cela, que l’on pourrait énumérer en maintes citations, est à peine, parfois, adouci par l’idée d’un sursis : celui, par exemple, de l’amour, « notre suprême effort pour ne pas franchir le seuil de l’inanité », ou de la musique, capable de « nous consoler d’une terre impossible et d’un ciel désert », « la musique – mensonge sublime de toutes les impossibilités de vivre ».
Gardons donc l’espoir – en particulier celui de continuer à lire Cioran : il a beau être « en proie au vieux démon philosophique », gardons-le précieusement, brouillon ou pas, inachèvement ou non, roumain ou français, comme un inimitable écrivain.
Jean-Pierre Longre
 Simultanément, paraît chez le même éditeur un autre ouvrage de Cioran :
Simultanément, paraît chez le même éditeur un autre ouvrage de Cioran :
Fenêtre sur le rien, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Gallimard Arcades, 2019
Présentation de l’éditeur :
Avec Divagations, ce recueil exceptionnel constitue la dernière œuvre de Cioran écrite en roumain. Vaste ensemble de fragments probablement composés entre 1941 et 1945, ce recueil inachevé et inédit commence par une sentence programmatique : « L'imbécile fonde son existence seulement sur ce qui est. Il n'a pas découvert le possible, cette fenêtre sur le Rien... » Voilà sept ans que Cioran « [moisit] glorieusement dans le Quartier latin », la guerre a emporté avec elle ses opinions politiques et sa propre destinée a toutes les apparences d'un échec : le jeune intellectuel prodigieux de Bucarest a beaucoup vieilli en peu de temps, passé sa trentième année ; il erre dans l'anonymat des boulevards de Paris et noircit des centaines de pages dans de petites chambres d'hôtel éphémères. Fenêtre sur le Rien constitue un formidable foyer de textes à l'état brut, le long exutoire d'un écrivain de l'instant prodigieusement fécond. Dès les premières pages, un thème s'impose : La femme, l'amour et la sexualité - terme rare sous la plume de Cioran -, qui surprend d'autant plus qu'il est l'occasion de confessions exceptionnelles : « Je n'ai aimé avec de persistants regrets que le néant et les femmes », écrit-il. On lit aussi, tour à tour, des passages sur la solitude, la maladie, l'insomnie, la musique, le temps, la poésie, la tristesse. Chaque fragment se referme sur lui-même, et l'on note un souci croissant du bien-dire, du style. Peu de figures culturelles, réelles ou non, apparaissent ici, mais dessinent un univers contrasté et puissant : Niobé et Hécube, Adam et Ève, Bach (pour Cioran le seul être qui rende crédible l'existence de l'âme), Beethoven, Don Quichotte, Ruysbroeck, Mozart, Achille, Judas, Chopin, et les romantiques anglais. Errance métaphysique d'une âme hantée par le vide mais visitée par d'étonnantes tentations voulant la ramener du néant à l'existence, ce cheminement solitaire et amer trouve encore un compagnon de déroute en la figure du Diable, régulièrement invoqué, quand l'auteur n'adresse pas ses blasphèmes directement à Dieu...
11:23 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, cioran, divagations, nicolas cavaillès, arcades gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/11/2019
L’ardeur et la sensibilité
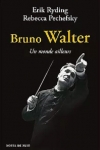 Erik Ryding, Rebecca Pechefsky, Bruno Walter. Un monde ailleurs, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Notes de nuit, 2019.
Erik Ryding, Rebecca Pechefsky, Bruno Walter. Un monde ailleurs, traduit de l’anglais (États-Unis) par Blandine Longre, Notes de nuit, 2019.
« Selon Walter, la propriété essentielle de la musique était sa capacité à tirer hommes et femmes hors de leur vie quotidienne et à les transporter vers un niveau supérieur d’existence. Tout en accomplissant sa mission première, celle d’exister en tant qu’art pur, la musique faisait aussi du monde un endroit meilleur. ». Ou « un monde ailleurs », selon le sous-titre du livre, emprunté à Shakespeare. Un livre qui, s’il est bien une biographie détaillée du fameux chef d’orchestre, se tisse autour du fil conducteur de « la force morale » de la musique et du « message d’espoir » qu’elle porte.
Une biographie détaillée, donc ; c’est le moins que l’on puisse dire. La vie et la carrière de Bruno Walter (1876-1962) sont décrites en détail, « presque jour par jour », jusqu’à la fin. Soutenu par une documentation fournie (comme les notes abondantes l’attestent), faite de références précises, de nombreuses lettres citées en tout ou en partie, d’articles de presse, de textes critiques, l’ouvrage d’Erik Ryding et Rebecca Pechefsky est une mine de renseignements. Nous y suivons l’apprentissage de l’enfant qui pensait avoir un avenir de pianiste, tant il faisait preuve de dons et d’originalité, avant de vouloir se consacrer à la direction d’orchestre en découvrant le chef Hans von Bülow et la musique de Wagner ; puis sa rencontre avec Mahler fut décisive, marquant « le début d’une amitié et d’une collaboration artistiques étroites », et lui valant son premier poste officiel de chef d’orchestre à Breslau (ce qui l’obligea de changer son nom de Bruno Schlesinger en Bruno Walter).
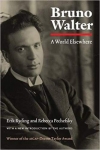 C’est ensuite une longue succession de prestations brillantes souvent accueillies avec succès, de tournées internationales, de nominations à des postes de plus en plus prestigieux, de bonheurs et de malheurs personnels, le tout dans différents pays. La montée du nazisme en Allemagne obligea Bruno Walter et sa famille à s’exiler, d’abord en Autriche, ensuite en France, enfin aux États-Unis – ce qui fait que né allemand, il prit les nationalités française et américaine. On ne détaillera pas ici les péripéties d’une vie particulièrement remplie, celle d’un musicien complet (chef d’orchestre, mais aussi pianiste, compositeur, directeur de chœur, conseiller musical) qui s’intéressait en outre à la littérature et à l’écriture (qu’il pratiquait), qui traversa une période historique particulièrement troublée et violente, lui-même victime de l’antisémitisme et des manœuvres angoissantes du pouvoir hitlérien.
C’est ensuite une longue succession de prestations brillantes souvent accueillies avec succès, de tournées internationales, de nominations à des postes de plus en plus prestigieux, de bonheurs et de malheurs personnels, le tout dans différents pays. La montée du nazisme en Allemagne obligea Bruno Walter et sa famille à s’exiler, d’abord en Autriche, ensuite en France, enfin aux États-Unis – ce qui fait que né allemand, il prit les nationalités française et américaine. On ne détaillera pas ici les péripéties d’une vie particulièrement remplie, celle d’un musicien complet (chef d’orchestre, mais aussi pianiste, compositeur, directeur de chœur, conseiller musical) qui s’intéressait en outre à la littérature et à l’écriture (qu’il pratiquait), qui traversa une période historique particulièrement troublée et violente, lui-même victime de l’antisémitisme et des manœuvres angoissantes du pouvoir hitlérien.
Au fil des pages, les auteurs nous renseignent sur les faits relatés d’une manière scrupuleuse, mais aussi sur les goûts musicaux de Bruno Walter, dont la nature le portait plutôt vers le XIXème siècle et le tournant du XXème (Beethoven, les Romantiques, Schubert, Brahms, Bruckner, Wagner, Mahler bien sûr, Richard Strauss, Enesco…), mais aussi vers la musique nouvelle (Schoenberg, Chostakovitch), sans négliger Mozart, dont il dirigea entre autres le Requiem et de nombreux opéras, ni Bach, dont il considérait l’œuvre comme « un pilier de notre culture ». Pour faire bref, il faudrait plutôt recenser les compositeurs qui n’ont pas figuré à son répertoire.
Nous faisons aussi connaissance avec le tempérament d’un chef aux idées généreuses, ouvertes et avancées (par exemple sur la mixité dans les orchestres), un chef qui dirigeait non en « despote », mais en communiquant à l’orchestre une ardeur et une sensibilité fondées sur la liberté et la persuasion, à en croire notamment le critique Adolf Aber : « Il n’a pas à imposer ses pensées à l’orchestre à chaque noire et à chaque croche ; il s’autorise même à se laisser porter un instant par les vagues puis, le point culminant approchant, il reprend la barre avec une plus grande fermeté encore et tire le maximum de ses musiciens. Une telle interprétation exige de l’orchestre une joie prodigieusement mûrie à jouer de la musique et qui lui soit propre, une ardeur qui lui soit tout aussi propre. », ou encore Olin Downes : « Quand une phrase musicale est réellement ressentie par le chef d’orchestre, et quand les musiciens la ressentent avec lui, l’orchestre respire, et cette respiration rythmique naturelle, profonde, des instruments est l’une des qualités inaliénables d’une bonne interprétation. ». La souplesse et la sensibilité de Bruno Walter dans l’exercice de son métier ne sont pas sans rapport avec sa spiritualité ; si selon lui la musique doit apporter à l’humanité « un message d’espoir », elle ne doit toutefois pas être « descriptive », mais dans sa pureté conserver un « pouvoir émotionnel […] illimité. ». Cette spiritualité le fit d’ailleurs adhérer, à partir des années 1950, aux théories de l’anthroposophie développées par Rudolf Steiner ; insistant sur « l’importance spirituelle de la musique et les dangers du matérialisme », il fut attiré par le domaine de la « thérapie musicale, une discipline alors en développement et qui recoupait l’un de ses centres d’intérêt, l’anthroposophie, et ses écrits plus anciens sur les forces morales de la musique. ».
Le livre d’Erik Ryding et Rebecca Pechefsky est, disions-nous, une mine. Les nombreux enregistrements que Walter a laissés (répertoriés dans les « discographies recommandées » en fin de volume) et la filmographie établie par Charles Barber complètent parfaitement ce qui est, en soi, une somme biographique et musicale montrant que Bruno Walter fut non seulement l’un des plus grands chefs du XXème siècle, mais aussi une personnalité hors du commun, ouvrant le chemin d’« un monde ailleurs ».
Jean-Pierre Longre
20:44 Publié dans Essai, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, anglophone, bruno walter, eryk ryding, rebecca pechefsky, blandine longre, notes de nuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

