13/02/2013
Papiers millimétrés
 Jean-Jacques Nuel, Courts métrages, Le Pont du Change, 2013
Jean-Jacques Nuel, Courts métrages, Le Pont du Change, 2013
Le texte bref, malgré les apparences, n’est pas un genre facile. Il n’est pas donné à tout le monde de réussir à dire (ou, le plus souvent, à suggérer) en quelques lignes ce que d’autres développent en plusieurs centaines de pages. Il faut pour cela non seulement le sens de la concision, la maîtrise du mot et de l’expression justes, l’art de la chute, mais aussi de l’imagination, beaucoup d’esprit et beaucoup de travail.
Ces qualités, Jean-Jacques Nuel les réunit dans ses Courts métrages, qui donnent un avant-goût déjà fort savoureux de ses Contresens à venir. Ces ensembles, taillés au millimètre (de trois lignes à une page), se succèdent sur les modes humoristique, étrange, désespérant, poétique… De l’épigramme classique au conte absurde, de la leçon morale à l’anecdote terrifiante, de la fable sociale au récit d’anticipation, il y en a pour tous les goûts, et chacun peut cueillir parmi ces quatre-vingts œuvres en puissance ce qui lui convient au moment voulu, dans un contexte donné.
On aurait envie de faire profiter tout le monde de sa cueillette personnelle, et de citer ce qui tombe, même au hasard, sous le regard. On se contentera d’un exemple, « Le bureau des admissions » : « Les candidats attendaient toute la nuit dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture, pour être certains d’obtenir dès l’ouverture du bureau ce précieux ticket, délivré en nombre limité, qui leur donnait le droit d’attendre, la nuit suivante, dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture ».
Jean-Pierre Longre
Et relire J.-J. Nuel…
 Le nom, éditions A Contrario, 2005
Le nom, éditions A Contrario, 2005
La littérature est d'abord une affaire de mots, et le tout est de pouvoir utiliser ce matériau artistiquement, le fin du fin consistant en une combinaison harmonieuse du plus petit nombre de mots possible avec la plus grande longueur de texte (voir par exemple Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau).
Jean-Jacques Nuel - ou, en tout cas - le protagoniste-narrateur (l'unique personnage) qui, dans le livre, s'appelle Jean-Jacques Nuel, a tenté de battre tous les records : bâtir une œuvre d'ampleur infinie, universellement reconnue comme telle, conférant à son auteur l'aura des idoles, en n'utilisant qu'un petit mot de quatre lettres, qui passe par le truchement de l'écriture réitérée à l'envi du statut de nom propre à celui de nom commun décliné sous toutes ses faces, dans toutes ses dimensions, selon toutes les formes esthétiques. Ce petit mot est tout bonnement le nom du narrateur (qui est aussi celui de l'auteur), lieu commun ainsi renouvelé (ce par quoi Cocteau définit la poésie), nom trop usé résonnant de son étrangeté fictionnelle, "comme si c'était appeler les choses / Justement de ce bizarre nom qui est le leur " (Aragon).
L'obsession du nom s'empare du souci de perfection définitive, et alors survient la folie des nombres, l'utopie de la machine littéraire donnant toutes facilités au scripteur, dans une tentative d'épuisement (toute perecquienne) de la vie littéraire : déambulations quotidiennes dans l'appartement, dans le quartier (une Part-Dieu lyonnaise qui n'a en soi rien pour inspirer l'artiste…), courriers aux éditeurs (réponses négatives ou inexistantes), reniement des œuvres antérieures, vains espoirs de notoriété… tout cela pour s'apercevoir au bout du compte que l'écrivain est un homme, avec des souvenirs, le sentiment de la vie et de la mort, qu'il doit faire ce qu'il a à faire, se reposer de temps en temps (disons chaque septième jour), et que la création n'est pas seulement une questions de mécanique et d'arithmétique.
Le nom est un roman de la création, et aussi - prénom oblige - une véritable confession d'écrivain.
http://lepontduchange.hautetfort.com
09:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : récit, essai, roman, jean-jacques nuel, le pont du change, a contrario, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/02/2013
Fruits défendus
 Geoffrey Lachassagne, Et je me suis caché, Aux Forges de Vulcain, 2012
Geoffrey Lachassagne, Et je me suis caché, Aux Forges de Vulcain, 2012
Il est des histoires d’enfants et d’adolescents qui ne disent pas grand-chose aux adultes, ni même aux premiers intéressés. Celle de Titi et Jérémie « parle » au sens plein du terme, et en tout cas ne peut laisser le lecteur indifférent, quel que soit son âge. Ce sont leurs voix mêmes que l’on entend, avec leurs mots, leurs phrases, leurs cris, leurs rires, leurs pleurs, leurs prières, leur lyrisme, les voix d’enfants plutôt perdus dans un monde dont, sur le mode brutal ou sur le mode affectueux, ils se sentent rejetés, et qu’ils cherchent à fuir, d’une manière ou d’une autre.
Ils vivent avec une grand-mère à la fois intraitable et possessive, adepte d’une secte dans laquelle elle les a introduits tout naturellement. Titi, 14 ans, attend le retour du grand frère Jules (qui deviendra vers la fin le troisième protagoniste, prenant à son tour la parole) ; Jérémie, 7 ans, fait cohabiter dans ses rêves les prophètes, les Indiens, les Infidèles, Yahweh… Désorientés, sevrés d’amour, ils errent, rêvent, font des projets fous et flous. « J’avais tout qui me bouillonnait dans la tête, en désordre ». Ils rencontrent d’autres êtres aussi perdus qu’eux, et vivent en leur compagnie des aventures inattendues, exaltantes et frustrantes, des aventures qui leur font toucher du doigt les vérités de la vie.
Car, sans en être conscients, c’est une quête qu’ils mènent, une quête de vérités que les adultes ne peuvent ni concevoir ni transmettre. « Et si les adultes étaient un peu moins cons, ils l’écouteraient, et alors ils comprendraient peut-être un peu de ce qu’ils répètent comme des perroquets en réunion ». Sur fond biblique, semi-rural, semi-urbain, Et je me suis caché mêle narration et poésie, veille et rêve, réalisme et imaginaire, et les héros recréent pour ainsi dire la Création, retrouvant mine de rien les origines mythiques de l’humanité – qui a osé toucher au fruit de l’arbre interdit.
Jean-Pierre Longre
17:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, geoffrey lachassagne, aux forges de vulcain, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/02/2013
« Psychose mystique »
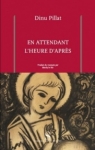 Dinu Pillat, En attendant l’heure d’après. Traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2013
Dinu Pillat, En attendant l’heure d’après. Traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2013
Peu de livres ont eu un destin aussi aventureux que ce roman – destin que relatent, dans leurs postfaces respectives, Gabriel Liiceanu et Monica Pillat. Achevé en 1948, En attendant l’heure d’après n’a pas pu être publié, et les deux exemplaires dactylographiés ont été confisqués dès l’arrestation de l’auteur, en 1959. Condamné pour apologie du mouvement légionnaire (mouvement d’extrême-droite créé en Roumanie entre les deux guerres) et pour « crime de trahison de la patrie », amnistié en 1964, Dinu Pillat (1921-1975) cherchera en vain à retrouver son texte, qui ne reverra le jour, d’une manière quasiment miraculeuse, qu’en 2010.
Sa publication en roumain et sa traduction en français sont salutaires, non seulement parce que le roman a suivi un cheminement hors du commun, mais aussi parce qu’il rend compte, sous la forme d’une fiction littéraire longuement mûrie et finement élaborée, de l’exaltation de jeunes gens qui, dans les années 1930, se laissèrent séduire par les délires apocalyptiques et parfois meurtriers d’une révolution nationale. Ainsi, sans que cela relève de l’essai, se démontent les mécanismes du fanatisme, de tous les fanatismes.
Roman à clefs, En attendant l’heure d'après n’est pas une fresque historique, mais s’attache à l’évolution psychologique et morale d’individus représentant des figures typiques du mouvement, qui devient ici celui des « Messagers ». Sans les approuver (loin s’en faut), l’auteur, adoptant différents angles d’approche, cherche à comprendre comment certains en arrivent à la violence, d’autres à la trahison, d’autres encore à la prise de conscience de l’illusion mystico-politique dans laquelle ils se fourvoient. Divers personnages gravitent autour des protagonistes – politiciens, étudiants, parents, parmi lesquels Raluca Holban, mère pitoyable et tragique voyant ses enfants lui échapper –, peuplant ce récit à la fois rigoureusement construit et foisonnant, qui vaut d’abord par la facture littéraire dans laquelle se coulent les désespérances individuelles et les errances collectives.
Jean-Pierre Longre
14:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, dinu pillat, marily le nir, éditions des syrtes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/01/2013
Entre deux
 Willa Cather, Le pont d’Alexander, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel, Les éditions du Sonneur, 2012
Willa Cather, Le pont d’Alexander, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel, Les éditions du Sonneur, 2012
Bartley Alexander a bâti sa réputation en construisant des ponts, et il a tout pour être un homme heureux : un métier qu’il aime et qui lui permet de largement gagner sa vie, la renommée, une épouse parfaite et vigilante, des occasions de voyager entre les États-Unis, où il réside, et l’Angleterre, où il se rend fréquemment pour son travail, au prix de longues traversées en bateau (nous sommes au début du XXe siècle).
Mais parallèlement aux difficultés qu’il rencontre dans la construction du pont Moorlock, au Canada, une faille va s’ouvrir dans sa vie sentimentale. À Londres, il retrouve Hilda Burgoyne, fameuse actrice de théâtre, qu’il a autrefois connue et aimée, et qu’il redoute d’aimer de nouveau. Le roman est la relation de sa passion (au sens premier et plein du terme) qui le mine intérieurement, pris entre la fidélité à son épouse Winifred qui a « modelé sa vie » et la tentation de tout recommencer avec Hilda, qui lui donne une « force nouvelle ». Comment combler cet écart, comment échapper à « la fissure dans le mur, [à] l’écroulement, [au] nuage de poussière » ?
Le pont d’Alexander, dont le titre est à la fois reflet d’une réalité matérielle et symbole des émotions et incertitudes plus ou moins voilées du protagoniste, est un récit à la fois tout en délicatesse et tout en puissance, tout en fragilité et tout en force, comme le sont les personnages et comme l’est la destinée d’un homme qui ne peut échapper à sa dualité fondamentale. Publié en 1912, ce premier roman de Willa Cather (dont les éditions du Sonneur ont déjà publié La nièce de Flaubert) témoigne déjà d’une maîtrise parfaite de la faculté d’évocation des troubles de l’âme humaine.
Jean-Pierre Longre
15:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, états-unis, willa cather, anne-sylvie homassel, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/01/2013
Homo politicus et « collectisme »
 Fernand Bloch-Ladurie, Georges-Guy Lamotte. Le dernier des socialistes, Aux Forges de Vulcain, 2012
Fernand Bloch-Ladurie, Georges-Guy Lamotte. Le dernier des socialistes, Aux Forges de Vulcain, 2012
Homme de tous les combats, de la Résistance aux joutes électorales, et théoricien inégalé du « collectisme », Georges-Guy Lamotte (1929-2007) est l’une des grandes figures françaises de la période contemporaine. Injustement oublié aujourd’hui, il est enfin réhabilité par un chercheur hors-pair, un fin politologue et un écrivain chevronné, Fernand Bloch-Ladurie – trois personnes en une, trinité laïque qui offre au lecteur une biographie à la fois objective et pleine d’empathie, claire et labyrinthique, limpide et complexe, légère et pathétique de ce personnage qui sut avoir l’oreille de Guy Mollet et de François Mitterrand, et qui traversa toutes les tempêtes des IVème et Vème républiques sans dévier de son objectif : être Georges-Guy Lamotte, « synthèse entre Karl Marx et Margaret Thatcher »… Du moins, tout cela, c’est l’auteur qui nous le rapporte.
À une époque où nombre de « romans » ne sont que des biographies (ou autobiographies) relatant les moindres détails triviaux de vies plus ou moins sordides, plus ou moins sulfureuses, plus ou moins dramatiques, la publication d’une vraie fiction biographique, où le grotesque et la satire, l’ironie et l’autodérision voisinent avec un sens acéré de l’histoire, relève de la salubrité publique. Car il faut l’avouer : Georges-Guy Lamotte n’a jamais existé en tant que tel. Le grand burlesque repose sur ce décalage que l’on trouve entre les faits relatés et la tonalité de l’écriture, entre la boursouflure du héros et l’apparent sérieux des références, entre la caricature et la rhétorique, entre le ridicule de l’homme et la grandiloquence du discours. Ici, en outre, les allusions, les non-dits, les regards obliques, les aveux voilés sont aussi bien des sources de réflexion que des déclencheurs du rire (souvent intérieur, parfois jaune – car le lecteur quelque peu lucide sent bien que des hommes comme Georges-Guy Lamotte, il en a connu, parfois admiré, et qu’il s’est laissé prendre à leurs pièges).
Tous les hommes politiques, mais aussi tous les électeurs devraient lire Georges-Guy Lamotte. Le dernier des socialistes. Miroir déformant, vitre dépolie, lunette grossissante (on en passe), ce livre a aussi le grand mérite de dévoiler une doctrine dont chaque idéologie, chaque programme électoral passés, présents et à venir s’inspirent consciemment ou inconsciemment, puisque son Manifeste contient la réponse aux trois questions qui fondent toutes les grandes ambitions politiques :
1° Qu’est-ce que le collectisme ? Tout.
2° Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien.
3° Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose.
Jean-Pierre Longre
10:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, histoire, humour, francophone, fernand bloch-ladurie, aux forges de vulcain, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/01/2013
Relire Philippe Besson…
 Un mort et ses secrets
Un mort et ses secrets
Un garçon d’Italie, Julliard, 2003 et 2011, Pocket 2008
Le cadavre de Luca vient d’être retrouvé sur une rive de l’Arno. Accident ? Suicide ? Meurtre ? Voilà qui aurait pu fournir matière à un roman policier traditionnel, avec enquête, interrogations, confrontations… Il y a de tout cela dans le roman, mais ce n’est pas le plus important.
Ce qui compte, c’est la levée progressive des secrets plus ou moins lourds qui lestent les personnages, selon une structure apparemment simple (monologues alternés des trois protagonistes), mais qui laisse s’épanouir la prose incisive de Philippe Besson, mélange de sensibilité et de violence. Luca laisse entendre à la fois son état cadavérique, son passé mystérieux, son indépendance, les ambiguïtés de ses amours et de ses rapports aux autres ; Anna, sa compagne aimante et aimée, dévoile peu à peu son désarroi devant les découvertes que lui permettent de faire les parents de Luca et la police ; Leo, le jeune prostitué de la gare, apparaît comme un observateur secret et un amant désintéressé, lointain mais de plus en plus proche, de plus en plus impliqué…
Outre celle du roman policier, la matière aurait pu être celle du vaudeville, avec le traditionnel trio amoureux et les chassés-croisés qui s’ensuivent. Ce n’est pas non plus le propos. Il s’agit pour l’auteur – et pour le lecteur – d’affronter le tumulte des cœurs, des corps et des âmes, d’aller le plus loin possible à la rencontre de ce qu’ils cachent, de déchiffrer ce que dévoilent d’eux les actes et les pensées des personnages. Il s’agit, plus profondément encore, d’en chercher l’émotion et la beauté. Car ils sont émouvants et beaux, ces personnages, extérieurement et intérieurement, de même qu’est émouvante et belle la tragédie florentine que leur fait jouer Philippe Besson.
 Risques épistolaires
Risques épistolaires
Se résoudre aux adieux, Julliard, 2007, 10/18, 2008
Abandonnée par l’homme qu’elle aimait, Louise parcourt le monde (Cuba, New York, Venise, Paris), en quête d’on ne sait quoi : l’oubli (de soi, de l’autre) ? le renouveau ? la certitude ? Mais elle sait bien qu’aimer, « c’est prendre des risques ». Apparemment, elle tente de les reprendre, ces risques, par correspondance. Le livre entier est composé des lettres que depuis ses résidences lointaines elle adresse à Clément.
 Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.
Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.
Jean-Pierre Longre
18:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe besson, julliard, pocket, 1018, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/01/2013
Un conte modernisé
 Gilles Granouillet, Poucet, pour les grands, Lansman éditeur, 2012
Gilles Granouillet, Poucet, pour les grands, Lansman éditeur, 2012
« Tu vois, on peut tromper les histoires. Si on le veut vraiment, si on est très intelligent ! ». Visiblement, Poucet, qui s’adresse ici à une des filles de l’ogre, l’est, très intelligent, et volontaire, puisque par la magie du théâtre (et du dramaturge), le conte traditionnel va, un beau moment, changer de cap.
Grâce à deux jeunes gens qui se rencontrent au bord d’une mare, les caractères peuvent se transformer, la laideur devenir beauté, la méchanceté bonté, la cruauté douceur, la haine amour. Rien à voir, pourtant, avec un spectacle à l’eau de rose. Il ne s’agit pas d’une pièce moralisante, ni même simplement bien intentionnée. C’est du théâtre, mêlant la peur et le courage, le rire et les larmes, le poids de la tragédie et la légèreté de la comédie. Et s’il fallait en tirer une leçon, ce serait celle-ci : l’esprit de liberté a toutes les chances de l’emporter sur la résignation.
Jean-Pierre Longre
Outre Poucet, pour les grands, Lansman éditeur a récemment mis trois pièces à la disposition des lecteurs et des gens de théâtre :
Vipérine de Pascal Brullemans, « comédie fantastique sur la difficulté de traverser un deuil ».
Monstres du même Pascal Brullemans, « l’histoire d’une minute », « monologue polyphonique » d’une adolescente attendant le résultat de son test de grossesse.
Vivarium S01E02 de Thierry Simon, « polar scénique » dans lequel trois enquêteurs cherchent à « percer le mystère » d’une quadruple meurtrière.
À lire aussi, chez le même éditeur : Rêves d’air et de lumière ou comment créer le désir de théâtre, de Roger Deldime, et Humour et identité, La matière et l’esprit n° 24, novembre 2012.
18:14 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, francophone, gilles granouillet, lansman éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Un guide littéraire pour tous
 Bernard Camboulives, Sur les pas des écrivains roumains, éditions Vaillant, 2012
Bernard Camboulives, Sur les pas des écrivains roumains, éditions Vaillant, 2012
La Roumanie et la France entretiennent depuis longtemps des liens privilégiés, notamment dans le domaine culturel, et tout particulièrement littéraire. On le sait, mais il est bon que, périodiquement, quelques « passeurs » le rappellent et s’emploient à resserrer ces liens. Bernard Camboulives, fin connaisseur de la littérature roumaine, fait partie de ces « passeurs ».
Son dernier ouvrage, modestement sous-titré « Aperçu à l’usage des lecteurs francophones », dresse d’abord un tableau général de l’histoire littéraire de la Roumanie, depuis les textes médiévaux jusqu’à notre époque (en anticipant même sur les traductions à paraître d’ici au Salon du Livre de Paris, où en 2013 les écrivains roumains seront à l’honneur). La deuxième partie donne des précisions sur les œuvres en langue roumaine de certains auteurs représentant des points d’ancrage décisifs, tels que Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Eugène Ionesco, Gherasim Luca, Herta Müller, Florina Ilis (à noter qu’une liste très utile des « auteurs roumains traduits en France » figure à la fin de l’ouvrage).
Bernard Camboulives ne se contente pas de recenser et de décrire. Ses analyses sont circonstanciées et détaillées, les éclairages diversifiés (voir par exemple le chapitre sur la ballade Mioritsa et ses interprétations divergentes, ou celui qui porte sur le « cas » Eminescu). Il y a donc là matière à intéresser tous les lecteurs – ceux qui désirent s’initier à l’histoire de la littérature roumaine aussi bien que ceux qui veulent approfondir la connaissance qu’ils en ont déjà.
Jean-Pierre Longre
18:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, bernard camboulives, éditions vaillant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/12/2012
La voix de la nature et le sens de la vie
 N. D. Cocea, Le vin de longue vie, traduit du roumain par Jean de Palacio, Cambourakis, 2012
N. D. Cocea, Le vin de longue vie, traduit du roumain par Jean de Palacio, Cambourakis, 2012
Dans le district de Cotnar, où la vigne produit un vin particulièrement fameux, vient d’être nommé un jeune juge auxiliaire qui observe la vie quotidienne du lieu, d’abord avec un certain recul humoristique, et entend avec intérêt les conversations des notables. Celles-ci tournent souvent autour d’un certain Maître Manole, propriétaire du « manoir » et de sa vigne, âgé d’environ quatre-vingt-dix ans, et sur lequel courent des bruits mystérieux relevant autant de la légende que de l’histoire locale.
Notre jeune magistrat, de rencontre en rencontre, va faire la connaissance du vieux boyard qui a conservé une étonnante santé pour son âge, et avec qui les promenades dans la campagne environnante prennent l’allure de déambulations philosophiques. Maître Manole dévoile peu à peu sa sagesse, sa culture, son goût pour la nature, pour les livres, pour la beauté, pour l’intelligence, pour la vie ; et finalement il révèle les secrets de sa jeunesse et l’histoire tragique de son amour passé pour une jeune Tzigane.
Le vin de longue vie, dont la première publication date de 1931, fait partie de ces romans épiques et intemporels qui mêlent le réalisme et l’étrange, l’humour et le tragique, le mystère et la vérité, la simplicité de la vie et la complexité de l’existence, la force et la fragilité des êtres, la satire et la morale, l’amour et la mort… « C’est folie et vaine ambition littéraire, que de décrire la beauté ». Et pourtant le style narratif de N. D. Cocea, à la fois alerte et poétique, recèle une inimitable beauté, celle que suggèrent la nature et la vie.
Jean-Pierre Longre
19:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, n. d. cocea, jean de palacio, cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/12/2012
Secrets de naissance
Hélène Grémillon, Le confident, Plon – JC Lattès, 2010, Folio, 2012
 Après le décès de sa mère, Camille reçoit les traditionnelles lettres de condoléances, pleines de compliments pour la défunte et de compassion pour ceux qui restent. Au milieu, une enveloppe intrigante, contenant une longue missive sans signature, qui inaugure toute une série d’envois de plus en plus étranges, dans lesquels un certain Louis évoque une certaine Annie – prénoms l’un et l’autre étrangers à Camille, qui se laisse prendre de plus en plus passionnément au suspense entretenu par cette mystérieuse correspondance.
Après le décès de sa mère, Camille reçoit les traditionnelles lettres de condoléances, pleines de compliments pour la défunte et de compassion pour ceux qui restent. Au milieu, une enveloppe intrigante, contenant une longue missive sans signature, qui inaugure toute une série d’envois de plus en plus étranges, dans lesquels un certain Louis évoque une certaine Annie – prénoms l’un et l’autre étrangers à Camille, qui se laisse prendre de plus en plus passionnément au suspense entretenu par cette mystérieuse correspondance.
Toutes sortes de soupçons lui viennent à l’esprit, y compris celui du stratagème d’un auteur cherchant à tout prix à se faire publier – puisque Camille est éditrice. Les soupçons, et aussi la peur. Camille est enceinte, et « n’importe quelle femme enceinte aurait été troublée à la lecture de ces lettres ». Au fur et à mesure, l’enfantement et la mort se mêlent étroitement dans le récit morcelé qui s’impose à la destinataire. « Une naissance appelle une mort ».
 Le lecteur, dans un mouvement parallèle, se laisse saisir par les révélations successives dont il ne doute pas, au bout d’un moment, qu’elles impliquent la naissance et l’existence mêmes de Camille, à travers les mystères de ses origines. Les récits épistolaires s’emboîtent les uns dans les autres, selon une structure narrative diversifiant les points de vue et reconstruisant habilement le passé ; un passé familial qui, s’inscrivant sur celui de la guerre de 39-45, prend une dimension à la fois personnelle et historique ; un passé d’autant plus angoissant que les sentiments et les événements intimes fondent leur drame dans le drame collectif.
Le lecteur, dans un mouvement parallèle, se laisse saisir par les révélations successives dont il ne doute pas, au bout d’un moment, qu’elles impliquent la naissance et l’existence mêmes de Camille, à travers les mystères de ses origines. Les récits épistolaires s’emboîtent les uns dans les autres, selon une structure narrative diversifiant les points de vue et reconstruisant habilement le passé ; un passé familial qui, s’inscrivant sur celui de la guerre de 39-45, prend une dimension à la fois personnelle et historique ; un passé d’autant plus angoissant que les sentiments et les événements intimes fondent leur drame dans le drame collectif.
Voilà un roman captivant, au sens premier du terme : captif de l’intrigue, le lecteur, comme l’héroïne, doit aller jusqu’au bout, jusqu’aux tout derniers mots, s’il veut s’en libérer.
Jean-Pierre Longre
18:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hélène grémillon, plon – jc lattès, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Les masques de la vie
 Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
« M. Ali, j’ai parfois l’impression que ce que nous sommes, ce que nous paraissons être, ce que nous prétendons être et ce que nous sommes aux yeux des autres sont quatre choses bien distinctes. Telle est la nature de l’existence, l’une de ses nombreuses imperfections, pourriez-vous ajouter » : le capitaine William Meadows, revenu d’Inde en 1837 avec Amir Ali, semble avoir compris ce qui fait la diversité de l’existence et de ses énigmes, des récits que l’on en fait, aux autres et à soi ; ils sont au cœur du roman de Tabish Khair.
Le protagoniste, donc, s’est installé dans le Londres victorien, sous la protection du capitaine Meadows, qui lui demande de raconter sa vie d’adepte du « thugisme », secte réunissant jadis des musulmans et des hindous pratiquant rituellement le vol et le meurtre. En parallèle, Amir confie à Jenny, la jeune servante qu’il aime, dans des lettres dont il sait qu’elle ne pourra les lire, les vraies vicissitudes de sa vie en Inde et ses doutes actuels, dans la grisaille anglaise.
Une autre intrigue met en scène le fameux phrénologue lord Batterstone, dont la volonté est de montrer à tout prix le bien-fondé de ses théories raciales, et son employé John May qui, à force de chercher pour son patron des crânes difformes dans les tombes, sombrera dans l’acharnement du meurtre, entraînant ses complices avec lui. Le récit tourne au roman noir, avec double enquête, officielle et journalistique d’une part, nourrissant le fantasme du « cannibale décapiteur », officieuse et populaire d’autre part, assurée par quelques représentants efficaces et solidaires de la populace des bas-quartiers.
Tabish Khair, dont l’art des récits alternés se manifestait déjà dans Apaiser la poussière, sait que la vie humaine n’est pas une, et que l’existence n’est pas vouée à la certitude ; surtout, il sait l’écrire, par le truchement d’histoires qui se situent aux confins du réel, aux limites de la possibilité, aux frontières du doute. Et il sait le confier à la plume fictive de ses personnages : « Qu’il est étrange de devenir ce qu’on n’est pas. Quelques histoires, quelques mots suffisent-ils ? Notre emprise sur la réalité est-elle si faible, si précaire ? Les histoires – racontées par nous ou par d’autres – peuvent-elles nous transformer ainsi ? Et pour quelle raison avons-nous besoin de nous en revêtir – quelle que soit notre manière d’avoir prise sur la réalité, et quelle que soit cette réalité ? Est-ce donc ce à quoi nous nous résumons ? Des histoires, des mots, un souffle ? ».
Jean-Pierre Longre
http://blongre.hautetfort.com/archive/2012/04/29/a-propos-d-un-thug.html
15:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, anglophone, inde, tabish khair, blandine longre, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2012
Au-delà des apparences
 Philippe Georget, L’été tous les chats sont gris, éditions Jigal, 2009, Pocket, 2012
Philippe Georget, L’été tous les chats sont gris, éditions Jigal, 2009, Pocket, 2012
Dans la région de Perpignan, cet été là, de jeunes hollandaises qui n’ont pas froid aux yeux semblent être victimes d’un tueur en série : agression, enlèvement, meurtre… Mais Gilles Sebag, policier aux allures ordinaires de père de famille soucieux et de mari aimant, et pourtant doué d’une subtilité qui ne fait pas fi des intuitions, sait aller au-delà des apparences.
Voilà un roman policier (un thriller, si l’on veut) qui, tout en répondant aux normes du  genre (intrigue à la fois localisée et complexe, suspense, rebondissements, traits psychologiques marqués, affrontements directs ou indirects, un zeste de violence et de sensualité…), émerge du lot des productions saisonnières (le Prix SNCF du polar français l'a d'ailleurs justement récompensé). Cela tient à une écriture qui marie habilement la narration implacable, les traits humoristiques et les évocations poétiques, et au caractère très humain des protagonistes. Si les chats s’ennuient, ce n’est pas le cas du lecteur.
genre (intrigue à la fois localisée et complexe, suspense, rebondissements, traits psychologiques marqués, affrontements directs ou indirects, un zeste de violence et de sensualité…), émerge du lot des productions saisonnières (le Prix SNCF du polar français l'a d'ailleurs justement récompensé). Cela tient à une écriture qui marie habilement la narration implacable, les traits humoristiques et les évocations poétiques, et au caractère très humain des protagonistes. Si les chats s’ennuient, ce n’est pas le cas du lecteur.
Jean-Pierre Longre
15:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman policier, francophone, philippe georget, éditions jigal, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/11/2012
Une nouvelle librairie à Lyon
 La librairie POINT D’ENCRAGE vient d’ouvrir dans le 9e arrondissement (Vaise). Accueil chaleureux, conseils éclairés : avis aux amateurs de bonne littérature, qui ne figure pas forcément dans les listes des best-sellers… Et un bel espace pour les enfants et la bande dessinée.
La librairie POINT D’ENCRAGE vient d’ouvrir dans le 9e arrondissement (Vaise). Accueil chaleureux, conseils éclairés : avis aux amateurs de bonne littérature, qui ne figure pas forcément dans les listes des best-sellers… Et un bel espace pour les enfants et la bande dessinée.
Une fête d'inauguration aura lieu le samedi 10 novembre à partir de 18h. A 18h30 Romain Verger lira des extraits de ses trois romans publiés. A 20 heures, Fred Griot dira sa poésie. La soirée se terminera quand tout le monde sera fatigué...
Coordonnées de la librairie :
Point d'Encrage
73, rue Marietton
69009 Lyon
04.78.47.84.16
06.61.92.76.39
En attendant la construction du site, on peut consulter :
http://www.facebook.com/PointDencrage
et le blog d’Anne-Françoise Kavauvea, l’une des deux libraires : http://annefrancoisekavauvea.blogspot.fr/
19:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : librairie, lyon, point d'encrage | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/11/2012
Le numéro trois est arrivé !
 The Black Herald – 3
The Black Herald – 3
Literary magazine – Revue de littérature
Issue #3 – September 2012 - Septembre 2012
190 pages – 15€ / £13 / $19 – ISBN 978-2-919582-04-4
Poetry, short fiction, prose, essays, translations.
Poésie, fiction courte, prose, essais, traductions.
With / avec W.S. Graham, Gregory Corso, Andrew Fentham, Louis Calaferte, Iain Britton, Jos Roy, Tristan Corbière, Michael Lee Rattigan, Clayton Eshleman, Denis Buican, John Taylor, César Vallejo, Anne-Sylvie Homassel, Cécile Lombard, Gary J. Shipley, Rosemary Lloyd, Bernard Bourrit, Mylène Catel, Nicolas Cavaillès, Ernest Delahaye, Sébastien Doubinsky, Gerburg Garmann, Michel Gerbal, Allan Graubard, Sadie Hoagland, James Joyce, João Melo, Andrew O’Donnell, Kirby Olson, Devin Horan, Dominique Quélen, Nathalie Riera, Paul B. Roth, Alexandra Sashe, Will Stone, Anthony Seidman, Ingrid Soren, August Stramm, Pierre Troullier, Romain Verger, Anthony Vivis, Elisabeth Willenz, Mark Wilson, Paul Stubbs, Blandine Longre et des essais sur / and essays about Charles Baudelaire, Francis Bacon. Images: Ágnes Cserháti, Olivier Longre, Will Stone, Devin Horan. Design: Sandrine Duvillier.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de Rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
17:34 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, anglophone, francophone, poésie, nouvelle, essai, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/10/2012
« L’excès de l’absence »
 Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Olivier allait avoir six ans lorsqu’il fut tué par un chauffard. Sa mort priva Jérôme, son frère jumeau, d’un autre soi-même, de son double, d’une présence nécessaire. « À chaque anniversaire, le même trouble me saisit : j’ai l’impression que je ne suis pas seul ». Et ce livre, pour la première fois, fait confidence de cet « excès de l’absence » (pour reprendre une formule de L’instant fatal de Queneau), de cette présence en creux qui a modelé ses attitudes face à la vie.
La solitude a donné à l’enfant, à l’adolescent, à l’adulte le goût de l’isolement, du grand air, des randonnées équestres dans la campagne ; les secrets enfouis de la gémellité perdue lui ont donné le goût du silence, de la pudeur muette et nouée. De là, la nécessité d’écrire : « Parmi tout ce que tu m’as appris, il y a d’abord ceci : on écrit pour exprimer ce dont on ne peut pas parler, pour libérer tout ce qui, en nous, était empêché, claquemuré, prisonnier d’une invisible geôle ». L’environnement familial et les choix délibérés aidant, la moitié vide de son existence a vite aspiré Jérôme vers les livres, toutes sortes de livres, parmi lesquels émergent ceux qui relatent l’« expérience du deuil ». Vers les livres à lire, vers les livres à commenter, vers les livres à écrire.
 Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Jean-Pierre Longre
22:37 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, jérôme garcin, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/10/2012
Distillerie littéraire au Pont du Change
Les éditions Le Pont du Change continuent à distiller des textes narratifs et poétiques. En voici deux, qu’il convient de déguster délicieusement à gorgées mesurées.
 Drôle d’animaux
Drôle d’animaux
Christian Cottet-Emard, Dragon, ange et pou, trois burlesques, Le Pont du Change, 2012
Est-il possible qu’un diacre un peu encombrant se métamorphose malgré lui en pou géant accroché à des tuyaux d’orgue ? Existe-t-il des bébés dragons cachés sous les bâches des tas de bois ? Un ange peut-il nous aider à sortir et rentrer les poubelles ?
De fait, tout cela se produit bel et bien dans les nouvelles de Christian Cottet-Emard. Pas simplement pour le plaisir de l’étrange et du fantastique. Ceux-ci, au-delà de leur charme propre, sont des chemins vers le « burlesque » et le comique de situation, mais aussi des moyens d’accès à une sorte d’observatoire. Observatoire du genre humain, de ses réactions face à l’inattendu – réactions qui n’en sont pas, puisque rien semble-t-il ne peut transformer les habitudes des hommes, incorrigibles curieux. L’auteur l’avoue poétiquement : « Les personnages principaux se contentent d’observer, comme les anges curieux de Conques qui enroulent le firmament, légèrement en retrait de ce qui s’annonce ».
Au rire déclenché par l’écriture (jeux sur les noms propres, dialogues alertes, formules répétitives, farce…) répond, plus profondément, la possibilité d’une méditation sur ces drôles d’animaux que sont les humains et sur l’évolution générale de l’espèce.
 Récit au compte-gouttes
Récit au compte-gouttes
Roland Counard, Le laitier de Noël, Le Pont du Change, 2012
De tout petits textes, à la mesure du garçonnet qui en est le héros. De tout petits textes qui, même s’ils restent aussi distincts les uns des autres que des poèmes en prose ou des saynètes comiques, forment une trame narrative aussi cohérente qu’énigmatique. De tout petits textes qui s’adressent à lui, Robin Dubuisson (deviendrait-il un jour Robin des Bois ?), tout en laissant planer sur ses faits et gestes, sur ses intentions mêmes, de lourds soupçons…
Car si la famille et le voisinage de Robin forment de prime abord un entourage rassurant, une cellule confortable, les morts violentes se succèdent – accidents ou meurtres. Celles du grand-père, de la voisine… et ce n’est certainement pas fini… Peu à peu, au compte-gouttes, les éléments s’emboîtent, sans donner de réponse claire. Vus à hauteur d’enfant, les événements se succèdent, laissant planer des hypothèses peu rassurantes sur la prétendue innocence et l’apparente naïveté des humains de cinq ans.
Jean-Pierre Longre
16:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, christian cottet-emard, roland counard, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/10/2012
Tableaux de la fa(m)ille humaine
 Matéi Visniec, Lettres d’amour à une princesse chinoise, Actes Sud-Papiers, 2012
Matéi Visniec, Lettres d’amour à une princesse chinoise, Actes Sud-Papiers, 2012
Tout est possible au théâtre, et dans son œuvre entière Matéi Visniec le prouve, qui sait à merveille mettre en scène les relations sociales, sentimentales, familiales, les idées, l’érotisme, la politique, la morale, la violence, la mort… Mettre en scène, c’est-à-dire faire en sorte qu’à travers les paroles, les gestes, les silences des personnages, les questions restent posées, avec leur évidence cruciale et leur complète incertitude.
Il ne s’agit évidemment pas d’asséner des réponses. Dans les huit brèves pièces de ce nouveau volume, dont le titre poétique est emprunté à celui de la première, beaucoup de tirades, quelques monologues et dialogues, montrent à mots couverts et en d’énigmatiques paraboles la complexité du monde et des êtres. Comment deux « Maisons florales », l’une plutôt nationaliste, l’autre plutôt internationaliste (dirons-nous pour schématiser) alternent rivalités sans concessions et tentatives de concertation pour servir leur gouvernement. Comment le cœur et le corps, le sentiment et le désir, la honte et l’impudeur sont à la fois moteurs et obstacles dans la vie d’un couple. Comment révolutions, contre-révolutions et fermes résolutions se noient dans la brutalité. Comment la mort, aux yeux des enfants, n’est pas aussi tragique qu’on le croit (« Mourir, chez nous, il paraît que c’est vraiment inoubliable ») !
Pas de réponses donc, pas de démonstrations non plus. Chaque pièce est un véhicule qui nous transporte vers des espaces étranges et révélateurs. Nous voici dans un empire chinois où seules les fleurs semblent avoir de l’importance ; dans une gare perdue où ne passe aucun train ; en promenade prometteuse et lente sur un corps féminin ; dans une « baignoire révolutionnaire » ; sur un littoral aux falaises vivantes ; dans un magasin de chaussures où les femmes se laissent prendre au piège… Et, comme toujours chez Visniec, la peinture de la famille humaine et de ses failles, la poésie et la musique des mots, l’humour plus ou moins voilé, la magie narrative, le jeu de l’imaginaire.
Jean-Pierre Longre
18:14 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, francophone, roumanie, matéi visniec, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/10/2012
Après la chute
 Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Avec les héros de Jean-Paul Dubois, on ne risque pas de s’ennuyer – même si eux-mêmes plongent parfois dans le désespoir et la dépression. Paul Sneijder est, comme les précédents et comme l’annonce le titre, un « cas ». Mais pas tout de suite. Sa vie aurait pu rester dans des normes sociales conventionnelles : une femme du genre « executive woman », des jumeaux qui suivent les traces de leur mère, une fille d’un premier mariage, rejetée par la nouvelle famille, un exil au Québec pour la carrière de l’épouse, un intérêt particulier pour les morts collectives d’animaux (oiseaux, poissons)… Bref, une existence qui, sans être complètement ordinaire, n’est pas encore matière à roman.
 Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Paul Sneijder bascule, pour ainsi dire, vers la face cachée de l’humanité. Son obsession : étudier les divers mécanismes qui commandent les mouvements des ascenseurs, au point d’en devenir un spécialiste. Son occupation : promener les chiens des autres, au point de se prendre d’affection pour eux. Son culte : celui des cendres de Marie, dont il conserve précieusement l’urne sur son bureau. Son amusement : relever, par exemple, les nombres palindromiques trouvés par son patron. Ses souvenirs : précis, sans défauts (« Je me souviens de tout ce que j’ai fait, dit ou entendu » : telle est la première phrase du livre). Ces changements qui, aux yeux de sa femme et de ses  jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
Jean-Paul Dubois a l’art de dénicher des situations inattendues, de les cultiver, de les exploiter dans sa tonalité particulière, où tragédie et comédie se mêlent et se complètent à merveille.
Jean-Pierre Longre
13:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, Éditions de l’olivier, éditions a vue d'oeil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/10/2012
L’humain sous toutes les latitudes
 Jean-Christophe Rufin, Sept histoires qui reviennent de loin, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Jean-Christophe Rufin, Sept histoires qui reviennent de loin, Gallimard, 2011, Folio, 2012
D’une expérience multiple (la médecine, les missions humanitaires, la diplomatie) et d’un talent littéraire officiellement reconnu (prix Goncourt, Académie française…) et néanmoins réel, Jean-Christophe Rufin a su tirer parti avec brio dans ces nouvelles.
Sept récits, sept voyages immobiles, de Paris au Luxembourg en passant par la Kirghizie, l’île Maurice, les Dolomites, le Mozambique, le Sri Lanka, sans compter l’évocation hors scène d’autres périodes historiques et d’autres contrées lointaines. Mais l’exotisme, s’il donne du piquant et du relief aux événements et aux personnages, n’est pas le principal. L’important, ce qui fait l’unité de ces textes dont on pourrait croire à première vue qu’ils sont disparates, c’est l’humain. Narrateurs et protagonistes, sous toutes les latitudes, à toutes les époques,  dans toutes les langues, sont empreints de cette intelligence et de cette sensibilité qui donnent confiance en l’humanité, jusqu’au milieu des conflits et du malheur, de l’intolérance et de la cruauté.
dans toutes les langues, sont empreints de cette intelligence et de cette sensibilité qui donnent confiance en l’humanité, jusqu’au milieu des conflits et du malheur, de l’intolérance et de la cruauté.
Et ce qui ne gâte rien, l’auteur sait construire ses histoires, avec la ferveur de l’acteur et le détachement de l’observateur. Entre mystère et clarté, le tragique et l’humour se côtoient et se combinent, les péripéties dramatiques et les situations burlesques convergent vers un dénouement souvent inattendu. Sourires ou frissons garantis, et toujours le plaisir de lire de vraies « histoires ».
Jean-Pierre Longre
18:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, jean-christophe rufin, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/08/2012
« Les mots de la faim »
 Herta Müller, La bascule du souffle, traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, Gallimard 2010, Folio 2011
Herta Müller, La bascule du souffle, traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, Gallimard 2010, Folio 2011
En 1945, le jeune Léopold, comme tous les Allemands de Roumanie âgés de 17 à 45 ans, est déporté en Union Soviétique. Il restera cinq ans dans un camp, à y subir le travail forcé, les brimades, la faim, à y côtoyer la mort et la souffrance, à y chercher dans le moindre objet, dans le moindre croûton de pain, dans le moindre brin d’herbe une parcelle du bonheur dont ne peuvent se passer les humains.
Herta Müller l’explique en postface : l’histoire de Léopold est largement inspirée de celle d’Oskar Pastior, poète de langue allemande et d’origine roumaine, mort en 2006 après avoir vécu dans sa jeunesse la douloureuse expérience des camps soviétiques, exercé différents métiers, s’être enfin voué, une fois exilé en Autriche puis en Allemagne, à l’écriture littéraire.
Malgré les détails vécus, le livre n’est pas un document de plus sur le goulag. Les choses, les paysages, les gestes quotidiens, intimement incorporés au conscient et à l’inconscient, vivent leur vie, s’imposent au plus profond de l’âme, des rêves, des sensations du narrateur. « L’ange de la faim », leitmotiv qui mine le récit autant que les corps des prisonniers, est l’un de ces fantômes qui hantent leur existence et leurs relations. Les objets usuels (la pelle, le peigne à poux, le charbon, les parpaings, la cuiller…), tout en donnant rythme aux jours et aux nuits, ainsi qu’aux brefs chapitres qui sont comme des tranches de vie, sont les points d’ancrage qui permettent aux êtres de ne pas sombrer.
Et les mots sont les instruments qui non seulement transfigurent le malheur et son souvenir, mais aussi qui pèsent sur le narrateur et son propre récit. Objets poétiques, parfois inutiles et absurdes, ils sont comme le ciment qui, au camp, s’insinuait partout lorsqu’on ne le maîtrisait pas : « Il y a des mots qui font de moi ce qu’ils veulent. Ils sont très différents de moi, et leurs pensées sont différentes d’eux. S’ils me viennent à l’esprit, c’est pour me rappeler qu’il y a de premières choses qui en appellent des deuxièmes, même si je suis loin de le vouloir ».
Jean-Pierre Longre
Herta Müller est Prix Nobel de littérature 2009
12:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, allemagne, roumanie, herta müller, claire de oliveira, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/07/2012
Toute la vérité ?
 François-Guillaume Lorrain, L’homme de Lyon, Grasset, 2011. Le Livre de Poche, 2012.
François-Guillaume Lorrain, L’homme de Lyon, Grasset, 2011. Le Livre de Poche, 2012.
Une « étrenne post-mortem », et la vie d’un homme peut s’en trouver bouleversée. Le père de l’homme en question, Pierre Rolin (un patronyme bien proche de celui de l’auteur…), mort en 2001, a laissé à sa mère un paquet à lui remettre le 1er janvier 2009, ce dont elle s’acquitte scrupuleusement. Pourquoi ce stratagème? Parce que, sans doute, le paquet contient à l’intention du fils une lettre et des photos mystérieuses, message dont l’élucidation ne devra se faire que par étapes successives.
C’est le point de départ, pour le narrateur, d’une quête complexe à travers les années et les lieux : entre France et Allemagne, un retour sur la période de l’occupation et sur des secrets familiaux qui vont peu à peu se laisser percer. Il y a Berlin, il y a surtout  Lyon, ses rues, ses zones d’ombre et de clarté, la place Bellecour et ses environs, la Résistance et la milice, les soldats allemands et les bombardements alliés… Il y a ce que montrent, tout en le cachant, les photos contenues dans l’enveloppe. « Il est facile de ne dire que la vérité. Il est difficile de dire toute la vérité » : le père aimait à répéter certaines phrases, dont celle de Léon Blum, que l’on peut mettre au compte de tout le roman.
Lyon, ses rues, ses zones d’ombre et de clarté, la place Bellecour et ses environs, la Résistance et la milice, les soldats allemands et les bombardements alliés… Il y a ce que montrent, tout en le cachant, les photos contenues dans l’enveloppe. « Il est facile de ne dire que la vérité. Il est difficile de dire toute la vérité » : le père aimait à répéter certaines phrases, dont celle de Léon Blum, que l’on peut mettre au compte de tout le roman.
L’homme de Lyon est une lente remontée du temps à caractère vraisemblablement autobiographique, tâtonnante et angoissante, qui mêle avec art et subtilité les enjeux personnels, familiaux, politiques et historiques, et qui rappelle à juste titre que la vie charrie des vérités qu’il n’est pas si facile de révéler.
Jean-Pierre Longre
19:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, françois-guillaume lorrain, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Pas de cris »
 Xavier Carrar, La bande, Lansman éditeur, 2012. Prix de l’inédiThéâtre, prix lycéen des pièces inédites.
Xavier Carrar, La bande, Lansman éditeur, 2012. Prix de l’inédiThéâtre, prix lycéen des pièces inédites.
C’est l’histoire de Tom, un jeune homme mal dans sa peau et dans sa chair, de sa rencontre avec Lilas et la bande de JB, de ce qu’il advient de leurs relations. Dans les journaux, cela donne un fait divers ; au théâtre, un drame. Dans tous les cas, c’est la tragédie d’une humanité qui n’arrive pas à maîtriser sa violence.
Car c’est aussi l’histoire d’une jeune fille vouée au « bonheur-à-venir dans un monde de merde », d’une mère trop inquiète, de personnages qui, poussés dans leurs retranchements par « l’interrogateur », pivot de la pièce, révèlent peu à peu leurs douleurs enfouies et leur personnalité cachée.
L’art du dramaturge est de faire entrevoir sans les montrer à nu les secrets des êtres dont il s’est emparé ; il y parvient en laissant s’entrechoquer le présent et le passé, l’ici et le là-bas, en laissant surgir par la fiction dialoguée les vérités qui font mal et la complexité des sentiments, entre amour et haine. « Pas de cris. Pas de souvenirs de cris. Pourtant, il était costaud, Tommy. Il aurait pu les mettre ko, tous, avec un seul bras… Mais non. Il fait rien. Il dit rien. Ça met les mecs en rage. Encore plus. Pas possible de se laisser faire à ce point ». Chez Tom, tout est dans le regard, mystérieusement, comme chez d’autres tout est dans la rage. Rien de tel que le théâtre pour mettre en évidence les contradictions humaines.
Jean-Pierre Longre
N.B. : Les éditions Lansman, toujours aussi productives, ont publié en mai et juin 2012, outre La bande : L’enfant, Drame rural de Carole Thibault, Et des poussières… de Michel Bellier, Oubliés de Jean-Rock Gaudreault, SStockholm et Humains de Solenn Denis, Le sable dans les yeux de Bénédicte Couka (Prix Annick Lansman). Une mine de bons et vrais textes pour la scène. Avis aux gens de théâtre !
15:51 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, francophone, xavier carar, lansman éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/07/2012
Déroutantes et immuables dislocations
 Jean Burgos, Anamorphoses, Éditions Calliopées, 2012
Jean Burgos, Anamorphoses, Éditions Calliopées, 2012
Jean Burgos, spécialiste de l’imaginaire en littérature, aurait pu se contenter (si l'on peut dire) de ses brillantes publications universitaires. Avec ce recueil, il va au-delà, puisque c’est sa propre imagination qu’il sollicite, laissant de côté sans les renier les éléments théoriques qu’il a développés dans ses recherches.
Anamorphose : « Transformation, par un procédé optique ou géométrique, d’un objet que l’on rend méconnaissable, mais dont la figure initiale est restituée par un miroir courbe ou par un examen hors du plan de la transformation. – Image résultant d’une telle transformation. » (Dictionnaire Le Robert). Les mondes que l’auteur donne à explorer sont peuplés d’êtres mouvants dont les transformations et les dislocations, effrayantes ou pitoyables, détestables ou déroutantes, ne peuvent laisser indifférent, puisqu’elles concernent l’homme dans sa propre apparence et dans sa propre chair, ainsi que le monde grouillant et bestial qui peuple la réalité invisible. Une réalité qui tient du rêve, de l’hallucination, du cauchemar, mais aussi de la création universelle et de la vie quotidienne, qui projettent leurs ombres et leurs reflets déformés sur la perception qu’en a le genre humain.
La pénétration dans ces mondes, au cours des sept nouvelles du recueil, ne peut se faire qu’en suivant avec de perverses délices et une fidélité à toute épreuve les méandres d’une prose savamment élaborée, parsemée de termes rares et d’images insolites, une prose qui suit elle-même l’itinéraire labyrinthique que lui imposent des destins inattendus, inoubliables et définitifs. Cela dit, le grouillement descriptif, le fourmillement narratif et les surprises qu’ils ménagent n’occultent pas la sagesse résignée : « On n’a plus rien à espérer. On n’a plus de prestige à sauver ni de mode à défendre, plus de rang à tenir, plus de rôle à remplir ni de pudeur à vaincre ; on n’a plus rien à comparer et les saisons pourront se suivre. Le temps est là, il faut l’user, il faut danser la même danse pour ne plus jamais s’arrêter : ce sont partout mêmes visages qui n’ont plus de morts à masquer ».
Jean-Pierre Longre
16:38 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, jean burgos, éditions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/07/2012
Jeunesse et affirmation d’un genre
 Brèves n° 99, Nouvelles de Roumanie, 2012
Brèves n° 99, Nouvelles de Roumanie, 2012
« Anthologie permanente de la nouvelle ». Tel est le sous-titre de la revue Brèves, qui depuis ses débuts répond fidèlement à cette forme d’engagement : publier des textes littéraires courts. Le n° 99 n’y déroge pas : des textes, uniquement des textes (narratifs et brefs, bien sûr), consacrés ici à une littérature en pleine expansion, qui n’a pas fini de faire parler d’elle : la littérature roumaine.
Fanny Chartres, qui a traduit et qui présente ces nouvelles, signale au passage que la Roumanie « est le pays de l’ambivalence, des extrêmes, des passions, de l’endurance ». La vie culturelle du pays et de sa capitale est foisonnante, et la publication de ces nouvelles est une heureuse initiative, mettant en avant un genre qui n’ y a pas un passé aussi riche qu’en France, par exemple, mais qui se constitue et s’affirme durablement à notre époque. Le critique Marius Chivu rappelle d’ailleurs, dans un entretien initial, que « la moyenne d’âge des écrivains actifs a beaucoup baissé ces dernières années » ; il paraît donc normal que les formes et les genres se renouvellent, même si le roman et, surtout, la poésie restent les fondements de la création.
Dix textes, dix écrivains dont certains bénéficient déjà d’une notoriété nationale et internationale, tels Gabriela Adameşteanu et Mircea Nedelciu, qui ouvrent et ferment le recueil. Des découvertes, aussi, qui donnent une idée de la richesse et de la diversité des tons et des styles, mais aussi des points communs : l’art du raccourci et de la condensation, le goût des déplacements (on voyage beaucoup, dans l’espace et dans le temps, de différentes manières : en imagination ou par quelque moyen de transport bien réel), la force des sentiments et des émotions, l’humour… Et les photographies d’Ileana Partenie donnent de Bucarest, en particulier, une vision à la fois personnelle et en adéquation avec les points de vue suggérés par l’écriture.
On met souvent en avant, à juste titre, les relations privilégiées qu’entretiennent depuis longtemps les cultures roumaine et française ; il est aussi important de prendre en compte ce que la Roumanie apporte de nouveau, dans ce domaine, à la culture européenne. Ce volume en donne des échantillons de choix.
Jean-Pierre Longre
17:18 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle, roumanie, fanny chartres, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Un samedi à Belfort
 Alain Gerber, Le Central, Fayard, 2012
Alain Gerber, Le Central, Fayard, 2012
Le Central est un café fréquenté par toutes sortes de clients, qui sont ici pour toutes sortes de raisons (ou pour aucune), composant une galerie de portraits représentative non seulement des Belfortains du début des années 1960, mais encore de la société française, voire humaine, tout bonnement.
Du petit matin au soir tardif, sous la baguette omnisciente d’un narrateur chef d’orchestre qui laisse habilement se développer chaque thème, chaque timbre, chaque harmonique, se croisent, s’entrecroisent, se frôlent, se regardent de temps en temps, se parlent parfois, entre autres : le chauffagiste Albert Spiedler, qui file doux devant sa femme ; Renaud Vinchelmes, le prof d’histoire qui a viré extrême droite aigrie ; Suzette Nandeau, la téléphoniste à l’optimisme indéboulonnable ; le dentiste Waldberg, au passé mystérieux et au présent sulfureux ; les « Américains », cette « tapageuse élite de la jeunesse belfortaine », groupe de garçons dont le comportement tient autant du chahut de la bande de jeunes que de la pose avant-gardiste, et dont le destin immédiat est suspendu aux menaces de la guerre d’Algérie ; Lorraine Mistler, la journaliste vouée à la relation d’anodins événements locaux ; Viviane et Delphine, dont malgré les apparences l’amitié n’est pas parfaitement à double sens ; des inconnus, un malfrat de passage, des promeneurs du samedi, d’autres encore ; le personnel du bistrot, tout aussi divers, qui va et vient sous la houlette imperturbable du consciencieux Serge Castillon, le gérant, et le couple Laigle, les propriétaires, qui arriveront au mauvais moment…
Car cette journée qui paraît coulée dans le moule de toutes les autres sort pourtant de l’ordinaire. D’abord, c’est elle qui a été choisie pour devenir roman (et quasiment pièce de théâtre, avec, excusez du peu, unités de lieu et de temps) ; ensuite, parce qu’elle n’est pas exempte de péripéties qui lui donnent des allures de tragi-comédie. Aucune monotonie dans la succession des arrivées, départs, ruptures, retours, événements plus ou moins mémorables qui rythment les heures de ce long samedi de juin.
Alain Gerber (né à Belfort, rappelons-le) effectue là comme un retour aux sources, en un mouvement par lequel il semble renouer avec un passé que les romans des années 1970 (de La couleur orange à Une sorte de bleu) évoquaient, chacun à sa manière. Certains personnages doivent vraisemblablement beaucoup à l’auteur lui-même – tel Francis Querlier, l’un des jeunes « américains », admirateur secret de Delphine, qui suit différentes pistes studieuses et s’essaie à différents modes de vie culturelle ; le théâtre, le cinéma, la lecture, l’écriture nourrissent chez lui des ambitions qu’il ne voudrait pas illusoires : « S’il consent à se retirer de la lumière des projecteurs, ce sera pour ciseler son premier chef-d’œuvre afin d’y reparaître, plus scintillant que jamais ». Un passé donc relativement lointain, mais aussi proche, puisque la musique, qui a été ces dernières années la grande préoccupation artistique de l’auteur et de son écriture, l’est encore ici : même si le juke-box du Central joue parfois des « scies universelles », le jazz, le vrai, conserve une place de choix dans les pages du roman et sur la scène littéraire d’Alain Gerber.
Jean-Pierre Longre
17:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/07/2012
Gueux et nomades
 Jean Richepin, Truandailles, Le Vampire Actif, 2012
Jean Richepin, Truandailles, Le Vampire Actif, 2012
Jean Richepin ? C’est La Chanson des gueux qui vient à la mémoire, guère plus. Pourtant, l’œuvre de cet écrivain à la carrière atypique (ancien élève de l’École Normale Supérieure, professeur, poète, linguiste, académicien, sans compter les métiers de toutes sortes auxquels il a touché, et avec cela passionné par la langue populaire et l’argot, condamné par la censure pour certains de ses écrits…), son œuvre, donc, est abondante, truculente et variée.
Alors, quelle bonne idée d’avoir exhumé cet ensemble de récits dans lesquels les « gens du voyage », les saltimbanques, les brigands et les miséreux occupent les premières places, dans une succession de bons et mauvais coups, de malheurs, de générosités et de violences, avec leur langage direct et imagé ! « Être libre, et vivre, et créer, et sans savoir pourquoi ni comment, telle me semble devoir être la fonction du poète, et sa joie. ». Telle est la profession de foi de l’écrivain, qui la met en pratique dans ces textes où les mots, les phrases, les différents registres de langue s’épanouissent effectivement en toute liberté. Au fil de la lecture, on découvre un styliste hors pair, dont la prose s’adapte parfaitement à des situations et à des personnages aussi divers que pittoresques.
Bonne idée, aussi, d’avoir complété ce passionnant volume par un substantiel chapitre intitulé « De l’argot et des gueux… ». On y trouve des considérations circonstanciées sur « la multiplicité des formes que [l’argot] a pu prendre au cours des siècles », puis des pages illustratives de Victor Hugo (Les Misérables) et d’Eugène Sue (Les Mystères de Paris), enfin les « pièces supprimées » de La Chanson des gueux de Richepin. Un « glossaire argotique » bien utile clôt cet ensemble qui allie avec bonheur les plaisirs de la lecture et les satisfactions de la connaissance.
Jean-Pierre Longre
16:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelles, poésie, essai, francophone, jean richepin, le vampire actif, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/06/2012
Roi de la satire
I on Luca Caragiale, L’effroyable suicide de la rue de la Fidélité, éditions Héros-Limite, 2012
on Luca Caragiale, L’effroyable suicide de la rue de la Fidélité, éditions Héros-Limite, 2012
Ion Luca Caragiale (1852-1912), le plus fameux des dramaturges roumains, est souvent comparé à Gogol ou à Courteline. On pourrait dire aussi, en changeant d’époques, qu’il y a chez lui du Molière (pour la verve comique) et du Voltaire (pour l’ironie mordante). Tout compte fait, Caragiale est incomparable, car les rapprochements sont dépassés à la fois par l’écriture personnelle de l’auteur et par les particularités de l’âme roumaine.
Il est en général question de l’œuvre théâtrale, avec des pièces comme Monsieur Leonida aux prises avec la réaction ou Une lettre perdue*. On évoque moins souvent les textes narratifs – nouvelles, récits ou « moments » – dont ce volume exhume un choix judicieux. Caragiale y apparaît comme le roi de la satire qu’il est dans toute son œuvre : satire de la société, des relations familiales, amoureuses et amicales, de la bureaucratie administrative, des manœuvres politiques, de la corruption des élites, du nationalisme xénophobe, de la délation, de l’hypocrisie… Nul n’est épargné, si ce n’est le petit peuple des victimes et des paysans besogneux. D’ailleurs les prises de position de l’auteur (que développent et précisent bien les pages intitulées « 1907, du printemps à l’automne » reproduites en fin de volume) l’ont conduit à l’exil : il passa les huit dernières années de sa vie à Berlin.
Textes engagés, donc ; textes circonstanciels, certes, puisque l’esprit roumain (un mélange d’humour et d’humeur, de simplicité et d’ostentation) imprègne ces pages ; textes universels, aussi, écrits par un moraliste qui met en avant les défauts inhérents à la nature humaine et à la vie en groupe. Surtout, textes comiques, d’une drôlerie qui résulte de tout ce qui précède, de l’expérience et de l’imagination d’un homme qui invente à partir de la vie, et de la plume particulièrement acérée d’un écrivain qui a le génie de la mise en scène (théâtrale ou narrative, c’est tout un). « Le monde ne change jamais que de forme », écrit-il dans « Scribes et bouffons ». Il faut lire L’effroyable suicide de la rue de la Fidélité (titre emprunté à celui de l’une des nouvelles du recueil), pour rire de bon cœur, et pour méditer sur les vices d’une société humaine qui, effectivement, ne change qu’en apparence.
Jean-Pierre Longre
*Les Œuvres de Caragiale, traduites en français sous la direction de Simone Roland et Valentin Lipatti et comprenant les pièces, les récits et les articles, ont été publiées aux éditions Méridiens (Bucarest, 1962). Plus récemment, le Théâtre, traduit par Paola Benz-Fauci, est paru en 2002 aux éditions de l’UNESCO. Eugène Ionesco est aussi l’auteur d’adaptations françaises de plusieurs textes (L’Arche, 1994, Fata Morgana, 1998).
18:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, essai, roumanie, ion luca caragiale, éditions héros-limite, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/06/2012
Truculentes chroniques
 Radu Țuculescu, Mère-vieille racontait, traduit du roumain par Dominique Ilea, Ginkgo éditeur, 2012
Radu Țuculescu, Mère-vieille racontait, traduit du roumain par Dominique Ilea, Ginkgo éditeur, 2012
C’est un hameau perdu de Transylvanie, déserté au fil du temps par la jeunesse, où les anciens, livrés à leurs souvenirs, cohabitent tant bien que mal entre eux et avec les Tziganes qui investissent peu à peu les maisons vides. Le narrateur, Radu, venu de la ville de Cluj rendre visite à Mère-vieille avec « la Dita », sa compagne, se fait le dépositaire et le rapporteur des histoires racontées par l’ancêtre, dont la mémoire est nourrie de tout le passé du village, mais aussi de ses lectures et de son imagination : « Des histoires qui s’ouvrent en éventail, tels les rais du soleil. Dont le centre, le magma d’où elles jaillissent, fut ce hameau au fond d’une vallée, coupé du monde, où j’ai atterri par hasard. Sans Mère-vieille, je n’en aurais rien appris. Je n’aurais pas écrit une seule ligne. Pas le moindre rayon n’aurait jailli… ».
On assiste avec une gourmandise non dénuée d’appréhension aux scènes racontées par bribes où se côtoient des couples rongés par l’existence, le mensonge et le silence, des hommes qui soignent leur nostalgie, leurs fureurs et leurs faiblesses à grandes lampées de ţuica, des femmes dont l’âge n’a pas amoindri la verve railleuse et l’ardeur érotique (parmi lesquelles la Margolili, notamment, qui a fait des ravages chez les mâles, aura bizarrement disparu à l’issue d’une noce héroïque), un pope toujours très, très proche de ses paroissiennes, des êtres fantastiques tel un étrange matou diabolique… On suit les protagonistes dans un voyage épique, une véritable odyssée campagnarde, vers le dispensaire voisin où la grand-mère est censée trouver à se soigner… On vit et on vibre littéralement au son de la musique qui pendant trois nuits entraîna Démitri, époux de Mère-vieille et fameux danseur, au cœur d’un sabbat enragé…
Ces rustiques et truculentes anecdotes, drôles et tragiques, traduites au plus près de la langue et des tournures d’origine, se déroulent sur un rythme enfiévré, en une prose parfois rugueuse, souvent poétique, de cette poésie qui laisse tout juste entrevoir les mystères de la vie, de la mort, du rêve, de l’écriture. « Dès que je me retrouve dans le village de Mère-vieille, sans faute, je glisse derechef sur la piste invisible qui slalome entre la réalité et la fantaisie. […] Dans cette communauté que je flaire ésotérique, les apparences sont souvent trompeuses, ce qui m’arrange ». On s’y laisse prendre, délicieusement.
Jean-Pierre Longre
12:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, radu Țuculescu, dominique ilea, ginkgo éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2012
Les faits et les objets
 Marius Daniel Popescu, Les couleurs de l’hirondelle, José Corti, 2012
Marius Daniel Popescu, Les couleurs de l’hirondelle, José Corti, 2012
Prix de l'Inaperçu 2012
La symphonie du loup, le précédent roman de Marius Daniel Popescu (José Corti, 2007), débutait par la mort du père ; Les couleurs de l’hirondelle commence et finit (presque) par l’enterrement de la mère. Entretemps, le puzzle narratif se met en place, mêlant le passé (l’enfance et la jeunesse au « pays du parti unique », la Roumanie jamais nommée) et le présent (la vie quotidienne dans le pays d’adoption, la Suisse tout aussi anonyme, les jeux avec l’enfant, le travail, le retour dans la famille pour les funérailles, et aussi le livre en train de s’écrire…). Aucune transition entre les épisodes ; placés les uns à côté des autres comme les affiches que colle le narrateur ou comme les cases du jeu de bataille navale qu’évoquent les dernières lignes, chacun d’entre eux est une histoire, un poème, un exercice de style à soi seul.
Exercice et art poétique en même temps. Par exemple : « Tu te dis que tu viens d’écrire un texte avec une fille et une femme, avec de la poésie et de la prose dans ses mots, avant les mots que tu viens d’écrire, avant les mots que tu vas écrire, il y a une sorte d’embryon du texte à venir, du texte publiable-publié et tu places cet embryon avant que les mots commencent à s’inscrire quelque part : toute écriture nécessite des perceptions, des plans ou des spontanéités mentales qui forment dans ton cas le début de chaque texte : une fois que tu commences à transformer en mots l’embryon du texte, tu te soumets à des règles qui bouleversent cet embryon, qui lui proposent de grandir, de devenir texte publiable en suivant des chemins qu’on appelle mots et qui, bizarrement, s’articulent entre eux sans former de carrefours, de places, de trottoirs ». Les mots, mis à rude épreuve, sont là pour exprimer les perceptions, non pour s’imposer, et c’est bien de cela qu’il s’agit : prendre conscience de ce qu’est la vie, dans son unité et sa diversité, dans ses manifestations mentales, affectives, physiques. Elle est faite de ces petites et grandes réalités que l’homme perçoit dans sa conscience et dans son inconscient, dans la mémoire de son esprit et de son corps, et qui voyagent comme un oiseau à qui l’on donne les couleurs du temps. Cela va de l’oppression politique odieuse et bête à la « révolution » vite confisquée par le règne de l’argent, de la misère et de la corruption ; des rideaux de lettres, qui en s’entrouvrant laissent apercevoir quelques mots, aux ensembles d’objets peuplant une existence humaine ; des jeux de l’enfance campagnarde à la confection d’un journal poétique, Le persil…
Les faits et les objets. C’est en eux, par eux, avec eux, apparemment livrés à l’état brut, en réalité répartis avec minutie comme des notes sur une portée musicale, que se crée l’émotion, par l’intercession des mots innombrables peuplant les phrases d’un récit que la mémoire n’en finit pas de prolonger, comme après un beau concert.
Jean-Pierre Longre
13:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, suisse, marius daniel popescu, josé corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/05/2012
En quête des autres, en quête de soi
 Lionel-Édouard Martin, Anaïs ou les Gravières, Les éditions du Sonneur, 2012
Lionel-Édouard Martin, Anaïs ou les Gravières, Les éditions du Sonneur, 2012
Est-il pensable de trouver dans un roman d’aujourd’hui des mots comme « voussure », « fluer », « s’aboucher », « croquemitaine », « floches », des expressions comme « botteler les possibles », « j’hypallageais pas mal sur la bouteille » ou des phrases comme « Il fait sur la rivière un temps de libellule » ? Sachez que oui, au moins sous la plume de Lionel-Édouard Martin, maître en poésie suburbaine et semi-rurale.
Ce n’est pas le tout. Anaïs ou les Gravières est un roman aux multiples facettes. Si d’emblée il prend une tournure policière (le meurtre d’une jeune fille, l’enquête d’un journaliste), on s’aperçoit vite que ce n’est pas vraiment ce qui compte. La rencontre de témoins tourne à la galerie de portraits pittoresques, sensibles, emplis de cette humanité que l’on trouve au fond de tous les yeux, pour peu qu’on le veuille. Il y a Anaïs, la lycéenne morte que l’on finira par connaître grâce aux autres, sa mère, qui confie au narrateur son histoire à la fois commune et unique, Mao, Petit louis, Toto Beauze, le légionnaire… Le lecteur les découvre peu à peu – jamais complètement, car le silence et le non-dit forment une part importante de leurs personnalités –, et devine qui est Nathalie, celle dont le destin reste comme une plaie ouverte dans la trame de l’histoire, comme un reflet pathétique de celui d’Anaïs.
Car les récits enchâssés dans l’intrigue, les souvenirs personnels et collectifs, les évocations de paysages campagnards, minéraux, industriels ou urbains, les portraits, tout cela tient dans l’œil de l’observateur, qui lui-même, dans sa solitude, guette le regard des autres, se voit dans l’autre comme dans un miroir : « Mao. Je dis Mao. Je pourrais aussi bien dire « moi ». Moi, c’est presque dans Mao. Mao, c’est presque moi ». Anaïs elle-même, dès avant sa naissance, a cette puissance du regard silencieux qui perce et reflète son entourage. Sa mère le sent : « À Mao, j’ai dit que j’étais enceinte d’une boule de regards, que j’allais accoucher dans quelques mois d’un gros œil dont il n’était pas responsable ».
Et l’écriture elle-même réfléchit le récit (et vice-versa), puisque le narrateur (l’auteur, aussi bien) ne rechigne pas aux considérations sur son travail, son « droit d’invention » : « Juste inventer ; prendre mon deuil au corps, le travailler de mots ». On y revient toujours : dans ce roman en forme d’enquête, l’important c’est la vie, la mort, les « gens » que l’on interroge par les mots, les silences et le regard, toujours en quête de soi.
Jean-Pierre Longre
A noter ! Rencontre avec Lionel-Édouard Martin le 22 mai à 18h à la Librairie du Tramway, 92 rue Moncey, 69003 LYON
19:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

