04/05/2012
Le rien et Flaubert
William Wilkie Collins, En quête du rien, traduction de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel, Les éditions du Sonneur, 2011
Willa Cather, La nièce de Flaubert, traduction de l’anglais et préface par Anne-Sylvie Homassel, Les éditions du Sonneur, 2012
 Comme si cela procédait d’une démarche volontaire, les éditions du Sonneur ont récemment publié dans leur « petite collection », à quelques mois de distance, deux livres aux contenus apparemment bien différents, mais dont le rapprochement, pour fortuit qu’il soit, laisse à penser.
Comme si cela procédait d’une démarche volontaire, les éditions du Sonneur ont récemment publié dans leur « petite collection », à quelques mois de distance, deux livres aux contenus apparemment bien différents, mais dont le rapprochement, pour fortuit qu’il soit, laisse à penser.
Dans En quête du rien, témoignage d’un voyageur anonyme, un écrivain se voit prescrire par son médecin une cure de repos total, d’inoccupation complète, de tranquillité absolue, ce qui ne va pas sans difficultés, tant le néant est proche de l’oisiveté. Cela donne lieu à un savoureux morceau d’humour. Dans La nièce de Flaubert, on assiste, en 1930 à Aix-les-Bains, à la rencontre de l’auteur avec Caroline Franklin-Grout, nièce du grand écrivain, élevée par  lui, évoluant dans le souvenir vivant et créateur de son monde. Discussions émouvantes et nourries sur Flaubert, ses amis, l’écriture, la lecture, la musique, l’art, et beau portrait de vieille femme cultivée, active, qui fut dans son enfance et sa jeunesse une « oreille attentive » pour le romancier : « Pendant les meilleures années de sa vie d’écrivain, il avait eu dans sa maison, à son côté, ou du moins à portée de correspondance, un être de son sang, plus jeune et plus ardent que lui, qui comprenait la moindre de ses intentions, et qui, plus encore, percevait la qualité de ses échecs. Peut-on rêver situation plus heureuse pour un homme de lettres ? ».
lui, évoluant dans le souvenir vivant et créateur de son monde. Discussions émouvantes et nourries sur Flaubert, ses amis, l’écriture, la lecture, la musique, l’art, et beau portrait de vieille femme cultivée, active, qui fut dans son enfance et sa jeunesse une « oreille attentive » pour le romancier : « Pendant les meilleures années de sa vie d’écrivain, il avait eu dans sa maison, à son côté, ou du moins à portée de correspondance, un être de son sang, plus jeune et plus ardent que lui, qui comprenait la moindre de ses intentions, et qui, plus encore, percevait la qualité de ses échecs. Peut-on rêver situation plus heureuse pour un homme de lettres ? ».
Quels rapports entre les deux livres, objectera-t-on ? L’attention à la forme de ces deux objets à l’esthétique soignée, la précieuse minceur du propos, la rigoureuse limpidité de l’écriture. Surtout, ici, les deux mots clés sont « rien » et « Flaubert » : voilà qui rappelle ce que celui-ci écrivait à Louise Collet le 16 janvier 1852 : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. ».
Nous y sommes, quasiment.
Jean-Pierre Longre
16:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, anglophone, william wilkie collins, willa cather, anne-sylvie homassel, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/05/2012
Paris est un roman, la vie est un livre
 Matéi Visniec, Syndrome de panique dans la Ville lumière, roman traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2012
Matéi Visniec, Syndrome de panique dans la Ville lumière, roman traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2012
Comme celles de ses pièces de théâtre, l’intrigue du roman (le premier traduit en français) de Matéi Visniec ne peut être résumée. D’ailleurs il n’y en a pas, d’intrigue ; plutôt, elles sont multiples, cheminant et courant entre réalité et fiction : il y a le « journal réel » d’un écrivain qui, parvenant à sortir de la Roumanie de Ceauşescu, trouve refuge à Paris, et il y a les œuvres potentiellement écrites, sous la houlette d’un éditeur fantasque et tyrannique, par des êtres pouvant être aussi bien auteurs que personnages. Comme le dit l’observateur Georges, derrière son bar : « On dirait que nous nous trouvons ici précisément au point de passage de la frontière entre fiction et réalité ».
Le récit navigue comme un bateau dans une tempête, tantôt grimpant vers les sommets prestigieux des vagues (la gloire mondiale sur laquelle fantasme le narrateur), tantôt plongeant vers l’abîme du néant anonyme – le tout ponctué par un poème qui clôt le livre, « Le Navire », parabole de la lente destruction d’une… (ici, au lecteur de compléter).
Intrigues multiples, personnages multiples : outre l’auteur (qui n’hésite pas à se nommer en tant que personnage), l’éditeur « Monsieur Cambreleng », l’ami d’enfance Gogu Boltanski qui a suivi une autre voie, François, futur auteur malgré lui d’un « chef-d’œuvre », un étrange bossu, un guide aveugle, une jeune femme séduisante et sans cesse éclopée, tout un cheptel d’auteurs-personnages réunis dans un café de la rue Mouffetard… Il faut aussi compter avec les silhouettes d’illustres écrivains et artistes du passé lointain ou proche, de Voltaire à Sartre, d’Hugo à Breton, Beckett ou Queneau, sans oublier le trio roumain Cioran, Eliade, Ionesco…
Personnages multiples, sujets multiples : l’actualité politique, les dictatures d’Europe de l’Est, les bouleversements liés à la chute du Mur, et bien sûr Paris, la ville des lumières et des ombres, des bistrots et des librairies, des touristes et des autochtones aux origines mêlées, des enthousiasmes délirants et des déceptions amères, navire qui « fluctuat nec mergitur » malgré la houle, la ville qui est un livre vivant, plein de souvenirs et de surprises. Paris qui vit des mots, ces êtres traversant les frontières, passant « d’un cerveau à l’autre » : « Toute la ville était habitée par des mots. Je voyais autour de l’église Saint-Médard les mots des passants, d’autres mots qui sortaient des fenêtres ouvertes des immeubles, ou bien des portes des cafés. Partout où deux personnes se rencontraient et se mettaient à discuter, une nébuleuse de mots se formait autour d’eux ».
Chaque chapitre est un déroutement, au plein sens du terme, et le lecteur se laisse mener volontiers où il semble bon à l’auteur de le mener, dans les méandres de la « Ville lumière ». C’est cette instabilité qui paradoxalement fait l’unité du livre, comme dans la vie. Au-delà de la « panique » que peuvent provoquer les tempêtes et les errances, ce qui rassure, c’est le ton de Visniec, le style inimitable qui est le sien, la foi dans l’écriture, la confiance accordée aux mots. La littérature ne sombrera pas.
Jean-Pierre Longre
17:43 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, matéi visniec, nicolas cavaillès, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/04/2012
Quête clandestine
 Blandine Le Callet, La ballade de Lila K, Stock, 2010, Le livre de poche, 2012
Blandine Le Callet, La ballade de Lila K, Stock, 2010, Le livre de poche, 2012
Lila n’a pas de souvenirs de sa mère, sinon l’image de la « cassure », cette scène de terreur où, toute petite, elle en a été brutalement séparée pour se retrouver dans le « Centre » où elle passera son enfance et sa jeunesse. Pas de souvenirs, mais une quête qui va être son obsession secrète : retrouver cette femme qui, officiellement frappée d’indignité, ne doit plus être sa mère, mais dont elle sait plus ou moins consciemment – et par les mystérieuses résonances de son corps – qu’elle l’aimait malgré la misère et la déchéance.
 Contrainte de s’insérer (ou de feindre l’insertion) dans un monde qui la rebute, mais aidée par quelques êtres qui ont gardé leurs sentiments humains et leur culture livresque, elle mène coûte que coûte sa recherche malgré le programme obligatoire, la surveillance constante, les interdictions multiples, une organisation sociale dans laquelle l’individu ne maîtrise plus rien de son destin, sinon en s’enfermant ou en fuyant « extra muros », dans une « Zone » de tous les dangers… Car, à petites touches, l’auteur évoque un univers qui fait penser à ceux du Meilleur des mondes, de 1984 ou de Farenheit 451, mais dont celui dans lequel nous vivons actuellement porte sans conteste les germes.
Contrainte de s’insérer (ou de feindre l’insertion) dans un monde qui la rebute, mais aidée par quelques êtres qui ont gardé leurs sentiments humains et leur culture livresque, elle mène coûte que coûte sa recherche malgré le programme obligatoire, la surveillance constante, les interdictions multiples, une organisation sociale dans laquelle l’individu ne maîtrise plus rien de son destin, sinon en s’enfermant ou en fuyant « extra muros », dans une « Zone » de tous les dangers… Car, à petites touches, l’auteur évoque un univers qui fait penser à ceux du Meilleur des mondes, de 1984 ou de Farenheit 451, mais dont celui dans lequel nous vivons actuellement porte sans conteste les germes.
Blandine Le Callet, qui dans un registre différent s’est signalée naguère par son roman Une pièce montée (Stock, 2006, Prix des Lecteurs du Livre de Poche 2007), sait ménager un beau suspense tout en suscitant la réflexion. Surtout, elle peint avec délicatesse un être à la fois fragile et déterminé, auquel le lecteur s’attache avec émotion.
Jean-Pierre Longre
19:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, blandine le callet, éditions stock, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/04/2012
« À la moitié du chemin »
 Letitia Ilea, Blues pour chevaux verts, traduit du roumain par Fanny Chartres, Le corridor bleu, 2012
Letitia Ilea, Blues pour chevaux verts, traduit du roumain par Fanny Chartres, Le corridor bleu, 2012
La poésie est un combat obstiné contre l’épuisement, contre le désespoir, contre la mort ; de ce combat, elle ne sort pas toujours victorieuse ; les poètes aussi meurent :
« que d’amis poètes partis
comme ça tout simplement
vivant encore un moment
dans la mémoire de quelques connaissances
dans des rayons retirés et des commentaires ingrats »
Mais sous la plume de Letitia Ilea, la poésie prend vigueur (chaque titre est un élan initial qui lance ses mots dans le texte), même si la modestie souriante du doute l’emporte périodiquement :
« je suis préoccupée
dites-moi monsieur le lecteur
le ciel est-il plus haut ?
les profondeurs plus profondes ?
avez-vous ri avez-vous pleuré ?
êtes-vous toujours en vie ?
Si les grands thèmes (la mort du père et de la mère, l’enfance, la vieillesse, la solitude, l’attachement aux objets de la vie, le vide de l’existence et de la mémoire…) se répandent de page en page comme des questions sans réponses (« à quand la fin ? / à quand le début ? »), tout se situe dans un entre-deux que seule la poésie peut suggérer, dans une oscillation entre « brise » et « ouragan », entre « rosée et soleil du désert », entre « nord » et « sud », à mi-chemin de la lumière et de l’ombre, de la vie et du néant.
Il y a des images fortes (« cette chemise en barbelé / que je ne parviens pas à retirer »), des couleurs chantantes (annoncées par le titre), une musique suggestive, des rythmes marqués, aussi bien dans les vers libres que dans une parenthèse de prose ramassée rappelant la manière du recueil Terrasses (publié en 2005 au centre international de poésie Marseille – voir ci-dessous). Ainsi, on ne parcourt pas Blues pour chevaux verts d’un œil distrait. L’itinéraire verbal et existentiel de Letitia Ilea, ponctué de douleurs et d’espérances, ne peut laisser indifférent ; le lecteur chemine avec elle, forcément.
Jean-Pierre Longre
Un rappel :
 Letitia Ilea, Terrasses, « Le Refuge », cipM / Spectres Familiers, 2005 (textes écrits lors d’une résidence effectuée en 2004 au centre international de poésie de Marseille)
Letitia Ilea, Terrasses, « Le Refuge », cipM / Spectres Familiers, 2005 (textes écrits lors d’une résidence effectuée en 2004 au centre international de poésie de Marseille)
Au cours de trois mois de résidence au centre international de poésie Marseille, Laetitia Ilea, qui est née en 1967 à Cluj (Roumanie) et qui publie, en roumain ou en français, des poèmes depuis 1984, a composé 45 textes dont les titres sont les noms des bars où ils furent écrits. Bars à « terrasses », comme il se doit dans le sud, lieux à la fois ouverts et fermés, lieux d’agitation et de promiscuité, de repos de solitude, « où j’attends terrassée », dit-elle dès les premières lignes.
Prose brève et compacte, chaque texte est une sorte d’instantané télégraphique, au souffle souvent court marqué par des points permettant à peine un bref soupir, sur un rythme qui tient autant de l’étouffement que de la respiration. Dans ce journal haletant, la détresse humaine (« mes meilleurs amis sont morts », « je suis sans amis », « j’ai passé toute ma vie à attendre »…), confinant à celle des animaux (« je me dis "bon appétit" puis jette quelques miettes à cette chienne que l’on a pris l’habitude d’appeler "solitude" »), est aussi la solitude linguistique (« j’ai enfermé ma langue dans une armoire et j’ai commencé à vivre ma nouvelle solitude »). Le combat entre vide de la mémoire et trop-plein des souvenirs n’exclut pas le sens de l’humour qui, par exemple, empêche d’entrer au bistrot nommé « Tout va bien » : « ça, non.j’y entre pas.je ne me ferai pas avoir. »
Certes, il y a les gestes banals de l’existence ordinaire, les courses, les cigarettes, le café, les petites scènes visuelles, les quelques rencontres, éphémères ou durables, les déplacements dans la ville, ou hors de la ville vers d’autres lieux plus ou moins lointains, Cassis, Aigues-Mortes, Narbonne, Perpignan, et aussi l’Espagne, Paris… Tout cela ne suffit pas à remplir la vie quotidienne, à éviter les appels à l’aide voilés ou clamés aux êtres aimés, aux gens de passage, à la Maison d’Édition elle-même (« tu ne m’as pas du tout aimée.je compte sur toi »).
À qui donc faire confiance ? À l’écriture, aux mots (« donnez-moi une autre langue pour crier ma douleur »), à un mode d’expression universel qui offre la possibilité d’oublier, de s’oublier « comme un lest inutile » et de ne conserver que l’essentiel, la poésie.
Jean-Pierre Longre
18:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, letitia ilea, fanny chartres, le corridor bleu, cip marseille, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/04/2012
L’art de l’illusionniste
 Jean-Marie Blas de Roblès, La mémoire de riz, Zulma, 2011
Jean-Marie Blas de Roblès, La mémoire de riz, Zulma, 2011
Prix de la Nouvelle de l'Académie Française 1982
L’illusionniste est la première des dix-huit nouvelles qui composent La mémoire de riz. Il est vrai que l’illusion, sous ses formes les plus achevées, mène le recueil : la construction des récits, le mystère qui plane sur leur dénouement même, les différentes visions du réel comme autant d’angles de prise de vue aboutissant au fantastique, tout cela réussit à perdre le lecteur à travers un labyrinthe de significations dans lequel il doit s’enfoncer pour tenter de résoudre les énigmes.
On oublie vite le caractère un peu fabriqué de certains de ces textes pour se laisser prendre à leurs toiles. Chaque page pourrait être une case de « L’échiquier de Saint-Louis » ou un des grains de riz à agencer avec les autres pour garder la mémoire de récits multiples (le titre du recueil est celui de la quatrième nouvelle). Jean-Marie Blas de Roblès (prix Médicis 2008 pour Là où les tigres sont chez eux, Zulma) prolonge et enrichit la tradition du genre : les personnages qui devisent confortablement et se lancent dans des récits au milieu desquels s’enchâssent d’autres récits nous font remonter à Boccace et à Marguerite de Navarre ; mais les visions fantastiques, nées d’une réalité soutenue par des descriptions souvent riches et baroques, de portraits bizarres et quotidiens, nous mènent à l’atmosphère des contes de Buzzati, Borgès, Garcia Marquez ou Cortazar… Tradition encore (la grande, celle qui fait la vraie littérature) dans les thèmes favoris de l’auteur : La Méditerranée, avec son Orient de rêve, sa sensualité, son merveilleux mythologique et psychologique ; l’amour et la mort, qui se combinent diaboliquement avec la peinture et la musique ; et parfois, rançon de sa formation, un petit bout de philosophie qui échappe à l’auteur au coin d’une phrase.
C’est porté par cette force, soutenue par elle, que l’auteur trouve son originalité : latine, orientale, méditerranéenne, sa prose a la logique sereine des belles architectures, la sensualité lourde des parfums entêtants, la complexité obscure des fonds sous-marins, la violence convulsive des passions mortelles. Mélange prometteur et séduisant, opérant la jonction entre rêve et réalité dans une vérité qui doit une bonne part d’elle-même à l’art de l’illusionniste.
Jean-Pierre Longre
Trente ans ! Cette chronique a paru pour la première fois dans la revue Brèves n° 6 (juin 1982), à l’occasion de la publication de La mémoire de riz aux éditions du Seuil. Quelques petits remaniements l’actualisent.
Jean-Marie Blas de Roblès, sera le jeudi 26 avril à 19h à la Librairie du Tramway (Lyon) pour parler de La Mémoire de riz. Cette rencontre sera enrichie par la présence du comédien professionnel Christian Taponard qui lira à voix haute des extraits choisis de ces nouvelles.
11:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, jean-marie blas de roblès, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/04/2012
Une leçon de modestie
 Pascal Garnier, Nul n’est à l’abri du succès, Zulma, 2012
Pascal Garnier, Nul n’est à l’abri du succès, Zulma, 2012
Ce bref roman pourrait être vu comme une leçon de modestie délivrée par l’auteur à lui-même d’abord, aux autres écrivains ensuite, et plus généralement à tous ceux qui connaissent un jour ou l’autre le succès. Ce succès qui n’apporte pas le bonheur, mais une rupture existentielle.
Jean-François Colombier reçoit un grand prix littéraire, et se voit comblé d’honneurs, d’amis, d’argent, d’amour… Cédant momentanément à cette vie, il ne la supporte que peu de temps et répond à la rupture que provoqua ce prix par une autre rupture. Parti rejoindre son fils, petit dealer vivant au jour le jour, il se jette tête la première dans des péripéties où il s’empêtre de plus en plus, jusqu’à vouloir en mourir ; victime des escroqueries d’une vamp de bistrot et d’un semblant d’avocat, victime d’une fausse jeunesse qu’à 50 ans il croit retrouver, victime de ses illusions et de ses velléités, victime de son métier d’écrivain qui lui fait prendre les personnes de la vie pour des personnages de roman, à commencer par lui-même, comme le lui rappelle l’un d’entre eux : « Qu’est-ce que vous faites pour eux si ce n’est de les utiliser dans vos romans ? Vous leur versez des droits d’auteur ? […] Vous n’y connaissez rien, mon petit monsieur. C’est moi, là, maintenant qui écris le scénario, vous n’êtes qu’un personnage. »
Livre noir, mais alerte, Nul n’est à l’abri du succès obéit aux lois du roman d’aventures, comporte ce qu’il faut d’amour, de coups de revolver, de trafics divers, de trajets nocturnes en voiture, de déambulations citadines et autres ingrédients traditionnels, mais en décalage et à distance, subvertis par une écriture plaisante et ironique, ainsi que par les actes manqués et souvent ridicules du protagoniste/narrateur, anti-héros qui, ne comprenant pas ce qu’il vit, ne parvient même pas à mourir. Oui, une jolie leçon de modestie pour tous ceux qui se croient utiles aux autres et ne le sont même pas à eux-mêmes.
J.-P. Longre
Après la disparition de Pascal Garnier, en mars 2010, la revue Brèves lui a consacré son numéro 93. Voir: http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/11/29/pour-la-nouvelle-toujours.html
17:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pascal garnier, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Dans la modernité européenne
 Andreia Roman, Literatura româna / Littérature roumaine, tome III, L’entre-deux-guerres, éditions Non Lieu, 2012
Andreia Roman, Literatura româna / Littérature roumaine, tome III, L’entre-deux-guerres, éditions Non Lieu, 2012
Il y a deux ans, Andreia Roman publiait les deux premiers volumes de sa Littérature roumaine, qui nous menaient des origines à la première guerre mondiale. Ce tome trois, toujours bilingue (consultante pour la version française : Lorène Vanini), est consacré tout entier à une période relativement brève (celle de la « Grande Roumanie ») qui, dans sa richesse et son foisonnement, assoit le patrimoine roumain dans la modernité européenne.
Comme l’explique l’auteur dans son introduction, c’est un renouvellement décisif dans les domaines culturel, historique, idéologique qui marque ces années : « La littérature de l’époque se situe plus que jamais au cœur de la société ». Une société dont l’expression se fait de plus en plus urbaine, passant par de nombreux périodiques publiés dans la capitale et les grandes villes.
Dans les livres, des figures romanesques nouvelles surgissent (l’arriviste, l’intellectuel, le citadin), et le réalisme s’assortit d’une dimension sociale et philosophique qui prend ses sources dans la littérature occidentale, sans renier les traditions orientales. La poésie, à l’évidence, est le lieu d’un éclatement, d’une « révolution » qui donnent naissance à l’avant-gardisme que de jeunes Roumains exportent largement vers l’Europe occidentale, en particulier vers la France. En outre, l’un des grands mérites de cet ouvrage est de rappeler que la production théâtrale, durant cette période, « est de loin la plus riche de l’histoire littéraire de la Roumanie », et qu’ainsi elle doit être « reconsidérée ».
Selon le principe bien établi des deux premiers tomes, ce sont ici les exemples textuels qui priment, suivant un choix judicieux, représentatif de la diversité des genres et des styles. Depuis Hortensia Papadat-Bengescu, « grande dame de la littérature roumaine », jusqu’à Mircea Eliade, dont l’œuvre proprement roumaine est surtout romanesque, nous parcourons un itinéraire donnant une idée précise des auteurs et des œuvres. Se succèdent les poètes Tristan Tzara, Ion Vinea, Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Benjamin Fundoianu, Tudor Arghezi, Ion Pillat, Lucian Blaga, Ion Barbu, les prosateurs Mihail Sadoveanu, Urmuz, Mateu I. Caragiale (fils du célèbre dramaturge Ion Luca Caragiale), Liviu Rebreanu, Gib Mihăescu, Camil Petrescu, George Călinescu, Anton Holban, les dramaturges George Mihail Zamfirescu, Tudor Muşatescu, Mihail Sebastian (dont le fameux Journal a un peu occulté les œuvres romanesques et théâtrales)… Il y en a beaucoup d’autres, mais le choix était inévitable. En tout cas, les notices biobibliographiques et les extraits d’œuvres nous incitent à considérer l’importance, la diversité, la complexité de cette période, à aller plus loin et à attendre, bien sûr, la suite de cette belle anthologie.
Jean-Pierre Longre
15:14 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire littéraire, anthologie, roumanie, andreia roman, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/03/2012
La décadence en marche
 Christos Tsiolkas, La gifle, traduit de l’anglais (Australie) par Jean-Luc Piningre, Belfond, 2011. 10-18, 2012
Christos Tsiolkas, La gifle, traduit de l’anglais (Australie) par Jean-Luc Piningre, Belfond, 2011. 10-18, 2012
Au début, on se croirait en pleine saga socio-familiale, entre Desperate housewives et enquête sur les relations humaines dans la société occidentale actuelle. Et peu à peu, à partir d’une gifle donnée à un enfant au cours d’un barbecue entre amis, on s’aperçoit que c’est construit, profond, intéressant en somme, et de plus en plus.
Loin de la lisse superficialité d’une série américaine, nous plongeons dans les rapports complexes, les non-dits troubles, les angoisses secrètes ou involontairement proférées de la société australienne d’aujourd’hui, dans laquelle les mélanges ethniques n’empêchent pas le racisme, le souci de l’harmonie sociale n’empêche pas la violence, les liens familiaux n’empêchent pas le désarroi de la jeunesse, l’amour n’empêche pas la haine.
Même si le récit dans sa globalité revêt une unité, une continuité qui tiennent en haleine, chaque chapitre, consacré à l’un des protagonistes, est à lui seul une sorte de roman autonome, qui permet au lecteur de cheminer à la fois à la surface du temps et dans l’épaisseur psychologique des personnages, de parcourir l’échelle des générations et des origines, de mesurer le délitement d’une société où l’alcool et la drogue, les illusions et la désespérance voisinent avec la chaleur humaine et le réconfort des traditions.
 L’Australie est vue ici à la fois comme un pays particulier, avec ses coutumes, son melting-pot, ses tensions, son isolement, mais aussi comme un symbole de cet Occident qui voudrait avoir tout juste et qui s’aperçoit que, tout compte fait, la décadence est en marche. Christos Tsiolkas a sans doute mis dans son récit de son expérience personnelle et familiale (les immigrés grecs et leurs descendants y tiennent une place de choix) ; mais La gifle est surtout un vrai, bon et gros roman qui, par la fiction, lève le voile sur la réalité. C’est le premier roman de l’auteur traduit en français. Nous attendons les autres.
L’Australie est vue ici à la fois comme un pays particulier, avec ses coutumes, son melting-pot, ses tensions, son isolement, mais aussi comme un symbole de cet Occident qui voudrait avoir tout juste et qui s’aperçoit que, tout compte fait, la décadence est en marche. Christos Tsiolkas a sans doute mis dans son récit de son expérience personnelle et familiale (les immigrés grecs et leurs descendants y tiennent une place de choix) ; mais La gifle est surtout un vrai, bon et gros roman qui, par la fiction, lève le voile sur la réalité. C’est le premier roman de l’auteur traduit en français. Nous attendons les autres.
Jean-Pierre Longre
18:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, australie, christos tsiolkas, jean-luc piningre, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/03/2012
Les aboiements de la littérature
 Jean-François Louette, Chiens de plume. Du cynisme dans la littérature française du XXe siècle, La Baconnière, 2011
Jean-François Louette, Chiens de plume. Du cynisme dans la littérature française du XXe siècle, La Baconnière, 2011
Il y a le Cynisme, mouvement philosophique venu de l’antiquité et dont Diogène est la figure la plus fameuse, il y a le cynisme, attitude sociale de l’amertume, qualifié ici de « mondain », et il y a le « canisme », qui donne à l’expression littéraire le point de vue du chien (ou l’inverse ?) ; l’auteur rappelle à juste titre que le mot « cynisme » vient du grec « kuôn », chien.
Voilà ce que Jean-François Louette, professeur à la Sorbonne, entreprend d’étudier à travers cinq écrivains du XXe siècle, Michaux, Queneau, Bataille, Drieu la Rochelle, Nimier, plus quelques autres qui parcourent en zigzag les dix chapitres du livre (parmi lesquels se font repérer par leurs jappements réitérés Maupassant, Gide, Céline, Sartre, Genet, d’autres encore, en meutes ou solitaires).
Les soubassements philosophiques de l’analyse servent la cause littéraire, et c’est ce qu’on attend : il s’agit bien du « cynisme dans la littérature », et non du cynisme littéraire dans la philosophie, ni du cynisme des écrivains en tant qu’individus. Prenons l’exemple du chapitre consacré à Raymond Queneau, balayant les rapports du chien et du cynisme avec un écrivain qui ne s’est pas privé de faire remarquer que son nom même évoque à la fois le chêne et le chien (le haut et le bas) et qui cultive un « mythe personnel du chien » ; rapports avec l’écrivain, donc, mais aussi et surtout avec les personnages de certains de ses romans comme Le chiendent (titre en soi significatif), avec l’écriture même, cette écriture dont l’attitude distanciée par rapport à la langue et aux conventions romanesques relève aussi du cynisme.
Exemple probant, mais très partiel. Les autres chapitres font des « chiens de plume » cités plus haut des objets d’études fouillées, de découvertes judicieuses. En même temps, la portée de la réflexion se fait volontiers générale, par exemple sur le cynisme comme « révélateur de la modernité », sur les attitudes contradictoires et complémentaires du chien (l’écriture peut aboyer chaleureusement ou agressivement, l’animal littéraire peut être gai ou triste, nonchalant ou en colère…), et sur les va-et-vient entre cynisme et littérature : « La littérature aiguise notre connaissance du cynisme. En sens inverse, il se peut que la connaissance du cynisme aiguise notre savoir des mécanismes du champ littéraire ».
Jean-Pierre Longre
10:57 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, francophone, jan-françois louette, la baconnière., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
L’animal humain
 Serge Scotto, Qui veut tuer Astrid la truie ?, Les éditions du littéraire, 2011
Serge Scotto, Qui veut tuer Astrid la truie ?, Les éditions du littéraire, 2011
Drôles de personnages que ceux qui circulent dans les nouvelles de Serge Scotto : une truie qui, délaissant la ferme d’origine, décide de monter à Paris (comme on le dit des ambitieux) pour y mener une vie que, finalement, elle ne pourra pas maîtriser ; une girafe inspecteur des impôts qui n’apprendra ce qu’est l’indulgence que par le truchement d’un passage au purgatoire…
Des animaux très humains – ou du moins représentatifs de certaines catégories d’humains, tel aussi ce jeune homme si démonstratif de son malheur que les autres le feront roi, voire tyran sanguinaire comme par inadvertance… Mais le plus réussi des quatre textes met en scène une statue de Jeanne d’Arc qui, prenant vie comme la Vénus d’Ille, s’emploiera, beaucoup plus violemment que cette dernière, à passer au fil de son épée tout ce qu’elle rencontrera de vivant.
Récits aux allures de fables socio-morales, ces « quatre nouvelles qui font une satire » tiennent un peu de Marcel Aymé, et aussi de la bande dessinée (y compris les quelques coquilles et négligences orthographiques qui parfois caractérisent le genre…). C’est alerte, étrange, vivifiant, et les aquarelles de l’auteur donnent au volume une coloration de bon aloi.
Jean-Pierre Longre
10:53 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, illustration, francophone, serge scotto, les éditions du littéraire, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/03/2012
Présente et absente
 Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
PRIX FEMINA 2010
Rééd. Folio, 2012
« Il y a des circonstances où quoi qu’on fasse on va toujours nulle part ». En l’occurrence, dans le dernier roman de Patrick Lapeyre, on va et on vient entre passé et présent, entre ici et ailleurs, entre le réel quotidien et nulle part. Plus précisément, Nora Neville, jeune anglaise farouchement attachée à sa liberté, sans qu’elle éprouve le besoin de s’en justifier, va et vient entre Paris et Londres, entre Louis Blériot (qui n’est pas aviateur) et Murphy (qui est trader).
Et tout tourne autour d’elle, qu’elle soit physiquement présente ou absente, jusqu’à l’obsession, une obsession aux pouvoirs aussi absolus que mystérieux : « C’est à cette heure qu’autrefois Murphy aimait entrer en communication avec Nora. Il la retrouvait sagement assise, un livre à la main, à l’intérieur d’un café de Soho ou bien se promenant dans les allées de Green Park » ; une obsession qui peut suspendre le cours du monde, pour Blériot et pour les autres : « Le temps qu’elle pivote sur elle-même en le cherchant des yeux, il n’y a plus aucun bruit, on ne sent plus le souffle d’air, la rotation de la terre s’interrompt quelques nanosecondes ».
C ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
A l’instar du titre, évocateur et harmonieux, emprunté au poète japonais Issa, le style de Patrick Lapeyre est aéré et allusif, limpide et plein d’échos ; sous un apparent dépouillement, il ne dédaigne pas l’expressivité, la tournure imagée voire surprenante – comme est surprenante l’héroïne fraîche et tragique, présente et absente, attendue et imprévisible, réelle et irréelle – un peu comme si se retrouvaient dans le monde d’aujourd’hui la Manon Lescaut de l’abbé Prévost (dont l’auteur revendique d’ailleurs la paternité), mais aussi la Nadja d’André Breton.
Jean-Pierre Longre
16:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick lapeyre, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/02/2012
Match livresque
 Pierre Autin-Grenier et Christian Garcin, Quand j’étais écrivain, Finitude, 2011
Pierre Autin-Grenier et Christian Garcin, Quand j’étais écrivain, Finitude, 2011
Face à face, dos à dos, tour à tour ? En tout cas, deux écrivains, fort marris de la maigreur de leurs ventes, se retrouvent autour de bonnes bouteilles et se lancent un défi susceptible de leur remonter le moral, sait-on jamais. Pour l’un, Christian Garcin (alias Christophe Garçon), c’est « le concours de la plus maigre assistance en librairie » ; pour l’autre, Pierre Autin-Grenier (alias Paul Autant-Grognard), le gagnant serait celui « qui collectionnerait le plus d’invitations » dans les lieux culturels les plus divers.
Ce double défi donne lieu à un délicieux double petit livre, « côté pile et côté face », une double « fantaisie » pleine de rebondissements saugrenus et d’humour irrésistible, parsemée de citations et de proverbes chinois qui laissent perplexe.
À chacun ses voyages, à chacun son récit, à chacun son style, alerte et sans chichis, le style des vrais écrivains qui ne se prennent pas pour des institutions littéraires. Tout se déroule dans le fumet engageant de « casseroles frémissantes » et le bouquet enivrant de fameux bourgognes, puis se résout d’une manière un peu inattendue, mais toujours avec les livres. Les livres auxquels – auteur ou lecteur – on n’échappera pas.
Jean-Pierre Longre
Dans le même esprit, mais dans un contexte bien différent, on lira avec un plaisir non dénué d'arrière-pensées les mésaventures d'écrivains anglo-saxons racontées par eux-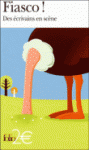 mêmes: lectures publiques sans public, signatures qui tournent court, rencontres inattendues.
mêmes: lectures publiques sans public, signatures qui tournent court, rencontres inattendues.
Ces souvenirs, extraits de Hontes, confessions impudiques mises en scène par les auteurs (éditions Joëlle Losfeld) sont d'autant plus délicieux que, tout en étant pleins d'humour et d'autodérision, ils renseignent sans faux-fuyants sur la réelle condition de l'écrivain débutant ou confirmé, méconnu ou célèbre, et sur l'ignorance, voire le mépris dans lesquels la société occidentale actuelle tient la littérature...
Fiasco! Des écrivains en scène. D'après une anthologie de Robin Robertson, traduit de l'anglais par Catherine Richard, Gallimard, Folio, 2011.
15:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, pierre autin-grenier, christian garcin, finitude, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/02/2012
« Pouvoir rire de tout, ce n’est pas rien »
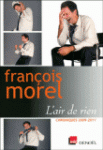 François Morel, L’air de rien, chroniques 2009-2011, France Inter/Denoël, 2011
François Morel, L’air de rien, chroniques 2009-2011, France Inter/Denoël, 2011
Le vendredi matin, un peu avant le journal de neuf heures, France Inter donne la parole à un drôle de bonhomme qui s’est fait connaître jadis avec les Deschiens (ce dont on doit lui rebattre les oreilles, d’ailleurs) et qui, depuis, a fait son chemin, notamment sur les planches théâtrales et à la radio, dans ses « billets » d’humeur et d’humour.
Chroniques de circonstance qui ont pourtant une portée plus générale que les simples (ou complexes) événements auxquels elles se réfèrent, elles donnent, sans forcer la note, matière à un livre savoureux. Elles courent sur deux saisons, du 4 septembre 2009 au 30 juin 2011, et nous replongent dans l’histoire immédiate, nous rappelant des faits petits et grands qui ont ponctué l’actualité ; le tout sur le mode délicatement railleur, finement burlesque, faussement naïf caractérisant la manière de François Morel, qui ne se prive pas, parfois, de laisser s’épancher une sensibilité sincère, voire une colère à peine contenue.
On ne rappellera pas toutes les affaires, toutes les aberrations politiques et sociales, toutes les injustices, tous les scandales auxquels s’attaque l’humoriste : un par semaine en presque deux ans, le choix est trop difficile. On dira simplement que le fait de lire ces chroniques confirme l’auditeur dans ses impressions fugitives : voilà un auteur qui manie avec une belle dextérité les mots, la syntaxe, les tonalités diverses (toute la gamme qui va du style enfantin à la fausse grandiloquence), sans se départir de sa personnalité, et sans se prendre au sérieux. « J’ai envie de parler de tout. […] C’est tout. C’est rien ». C’est salutaire.
Jean-Pierre Longre
11:34 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, francophone, françois morel, france inter, denoël, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/02/2012
« Le plus triste et le plus heureux des hommes »
É ric Durnez, Le voyage intraordinaire, Lansman, 2011
ric Durnez, Le voyage intraordinaire, Lansman, 2011
Un homme seul, dans la vie et sur la scène, raconte. Il se raconte, il raconte le voyage de sa vie, son « épreuve de force intérieure », sorte d’odyssée à la fois mentale et physique, aux étapes tour à tour vécues et rêvées.
« C’est arrivé comme ça et ça n’a plus fait l’ombre d’un pli ». Il décide d’un coup de quitter sa famille, ses camarades, et d’entamer ce qui se révélera comme un voyage initiatique. Ses souvenirs, présentés dans le désordre de la mémoire, évoquent des rencontres inopinées : « Le doyen de l’humanité, la fille la plus bête du monde, le pilote de la Grande Ourse, la jeune femme à l’orange, l’aubergiste des jours heureux, le véritable Monsieur Moyen, le manieur de paradoxes, le garçon aux trois yeux » (efficaces pour la mémoire, ces récapitulations périodiques…). Chacune de ces rencontres est une étape révélatrice, entre autres, de la relativité du temps et de la vie.
Le récit se referme sur lui-même, semble-t-il (avant de nouvelles aventures ?). Retour à la case départ, comme Ulysse à Ithaque, avec les changements inhérents au défilement du temps… Cette pièce narrative fait aussi réfléchir sur le statut même du genre théâtral : qu’est-ce que la scène, sinon une production de l’esprit, de l’imaginaire et du langage ?
Jean-Pierre Longre
16:54 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, belgique, francophone, eric durnez, lansman éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/01/2012
« La rue m’étonne toujours »
 Roland Tixier, Le passant de Vaulx-en-Velin, Le Pont du Change, 2011
Roland Tixier, Le passant de Vaulx-en-Velin, Le Pont du Change, 2011
Si l’on veut sortir des clichés que les médias affichent invariablement lorsqu’ils évoquent les banlieues des grandes villes, il faut lire les textes de Roland Tixier sur Vaulx-en-Velin. Loin du misérabilisme de rigueur et des rumeurs violentes qui y sont liées, le poète chante, dans de brèves strophes en forme de haïkus, les joies simples et naturelles d’une ville qu’il connaît bien, mais dont chaque exploration est pour lui une nouvelle source de découvertes.
Lumières, poussières et promesses du printemps, oiseaux dans le vent, feuillages mobiles des arbres, la nature tient une place de choix le long des rues, des avenues et des trottoirs, d’où ne sont nullement exclus les « visages singuliers », les « acteurs extraordinaires », les « files d’attente à Casino ».
« La rue m’étonne toujours
Tant de panoplies
Tant de gens différents »
C’est bien une ville, avec ses bus et ses chantiers, ses quartiers et ses marchés, avec ses passants (parmi lesquels se glisse, tiens donc, Georges Perec), et aussi avec tout ce qui fait la vie : les souvenirs, la musique, les sensations, la légèreté ou la lourdeur de l’air, le temps qui passe, le cycle des saisons, « l’impression que tout recommence » ; bref, la discrète et immuable beauté d’un monde qu’il convient de voir d’un regard neuf, par-delà les apparences. Pour cela, rien ne vaut la poésie.
Jean-Pierre Longre
http://lepontduchange.hautetfort.com
Au Pont du Change, d'autres recueils de Roland Tixier:
- Simples choses (2009), "haïkus urbains", "regard posé sur le monde".
- Chaque fois l’éternité (2011): voir http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/09/07/des-tro...
22:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roland tixier, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/12/2011
Les violences de l’art
 Yves Wellens, Épreuve d’artiste, Grand miroir / Renaissance du livre, 2011
Yves Wellens, Épreuve d’artiste, Grand miroir / Renaissance du livre, 2011
Stéphane Mandelbaum (1961-1986) a connu le destin tragique d’un artiste maudit ; un destin, en quelque sorte, à l’image de sa peinture violente, provocatrice, transgressive, où la mort, le sexe, le sang, la chair sont objets de fascination. Peintre insatisfait, portraitiste tourmenté, il se fit aussi voleur, et en mourut assassiné à 25 ans.
Le personnage a de quoi attirer les écrivains en quête de sujets forts. Certains pourraient en faire une biographie pleine de références ; d’autres un roman aux résonances vigoureuses. C’est le genre qu’a choisi Yves Wellens, mais à sa manière particulière, donnant des allures réalistes à l’invention et des airs romanesques à la réalité – et développant en quelque sorte ce qui se présentait sous forme abrégée ou ramassée dans certains de ses ouvrages précédents, comme Le cas de figure (Didier Devillez, 1995) ou Incisions locales (Luce Wilquin, 2002).
Selon un canevas quasiment immuable et terriblement prenant, entre prologue et épilogue, se succèdent dix chapitres d’« actualités » et sept chapitres de « portraits », qui bâtissent le processus biographique, artistique, mental du personnage devenant sous nos yeux la personne réelle de Stéphane Mandelbaum. Ce qui importe, semble-t-il, c’est moins de raconter une vie, certes hors du commun, que de tenter d’explorer les tréfonds de la création artistique avec ses tâtonnements, ses fulgurances, ses échecs, ses excès, ses risques mortels. Il y a l’enquête journalistique avec son cheminement cahoteux, et la construction esthétique avec ses errements chaotiques. Et à cette construction ne sont pas étrangers les « portraits » d’êtres tout aussi hors normes que Mandelbaum : Rimbaud, Pasolini, Bacon, Pierre Goldman, Goebbels, Himmler… On peut dire que ces portraits, de même qu’ils font partie intégrante du livre, sont au cœur même de l’œuvre du peintre.
Ainsi Wellens donne-t-il une tragédie en forme de puzzle dont chaque ensemble de scènes, chaque acte vise à percer des secrets, à approcher les rapports intimes entre un homme (sa vie, sa mort) et son œuvre. « On atteint, dans cette circonstance, un cas limite de contamination de l’œuvre par la réalité, mais aussi bien de la réalité par l’œuvre, sans qu’on sache parfaitement discerner en quel sens l’influence joue le plus ». ET Stéphane Mandelbaum lui-même de citer cette phrase : « J’ai une certaine faiblesse pour les criminels et les artistes : ni les uns ni les autres ne prennent la vie comme elle est ». Ainsi va la création.
Jean-Pierre Longre
http://www.renaissancedulivre.be/index.php/litterature/grand-miroir
16:17 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, peinture, belgique, francophone, stéphane mandelbaum, yves wellens, grand miroir, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/12/2011
Dans le silence des profondeurs
 Valérie Canat de Chizy, Pieuvre, Jacques André éditeur, 2011
Valérie Canat de Chizy, Pieuvre, Jacques André éditeur, 2011
« Dans l’antre du poème, accueillir sa solitude, sa vérité. Se taire une bonne fois pour toutes, laisser couler la source claire ».
Les textes qui composent Pieuvre tiennent autant de la poésie que de la narration. C’est en tout cas poétiquement que l’auteur y déroule ses souvenirs en racontant son expérience et les épreuves de la surdité, du silence, de la solitude, de l’anormalité, des transformations physiologiques, mentales, relationnelles qu’entraîne cette sorte de mise à l’écart. Une « harmonie », une « logique » particulières marquent cet enfermement dans les profondeurs de soi.
Car ce n’est pas seulement l’ouïe qui est en jeu. L’atrophie de l’un des sens entraîne la quête d’un nouvel équilibre dans le rapport à l’environnement. Les mots sont ceux des sensations qui traversent le corps : odorat, goût, toucher, et surtout vue (scintillements légers et ombres lourdes, noirceur et clarté) sont ici sollicités, faisant résonner la présence du monde et des autres.
Pas de miracle. Singulièrement, le recours à l’écriture n’est pas considéré comme la panacée, mais comme une des composantes de la survie : « Tiraillée entre le désir de vivre et l’exigence de l’écriture, j’oscille entre ouverture et repli. Il me faut trouver l’équilibre juste entre ces deux pôles. L’extériorisation me fait perdre de la profondeur. Tandis que la solitude me rapproche de ce qui en moi est humain. Forcément douloureuse, elle me mène à creuser dans l’obscurité pour trouver la lumière ». Cette lumière, malgré tout, Valérie Canat de Chizy, qui n’en est pas à sa première expérience poétique, nous la fait entrevoir dans ce récit poétique en demi-teintes.
Jean-Pierre Longre
22:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, poésie, francophone, valérie canat de chizy, jacques andré éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2011
Le sacre du métèque
 Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Venu des Carpates et des « cimes du désespoir », exilé à Paris, prisonnier volontaire d’une langue nouvelle et d’un pessimisme provocateur, Cioran est l’un des grands écrivains français du XXe siècle. Lui consacrer un volume de la Pléiade était justice, et la publication de ses Œuvres est un modèle du genre.
Les éditeurs ont choisi à bon escient de se limiter (si l’on peut dire) aux textes rédigés en langue française. Ce choix est dû à des raisons non seulement linguistiques et chronologiques, mais aussi philosophiques et littéraires. Les dix œuvres « françaises » publiées, présentées et annotées ici, même si elles n’échappent pas – et c’est heureux – à l’héritage roumain, forment un ensemble cohérent dans sa succession interne, tant du point de vue de la pensée que de celui du style.
On lira (ou relira) donc avec un bonheur non dénué d’une angoisse communicative Précis de décomposition, Syllogismes de l’amertume, La tentation d’exister, Histoire et utopie, La chute dans le temps, Le mauvais démiurge, De l’inconvénient d’être né, Écartèlement, Aveux et anathèmes, Exercices d’admiration, le tout complété, comme il se doit dans la Pléiade, par une préface, une biographie, une bibliographie, des notices, des notes, des appendices… Comme il se doit, et plus qu’il ne se doit : la préface, entre autres, offre, certes, une synthèse impeccable de l’œuvre de Cioran, une analyse limpide de son écriture, des ouvertures séduisantes sur les origines et les enjeux des textes, mais elle est aussi en elle-même un morceau de littérature ; à la fois enthousiaste et distanciée, construite et foisonnante, elle offre un bel exemple de « style comme aventure ».
Avec ce volume, le plaisir d’entendre une « voix [qui] accède à une pluralité de formes et de tons – de l’essai lyrique au lambeau delphique, de l’aphorisme ravageur à l’épître complice, de l’effigie destructrice à l’oraison non-violente… » est relevé par celui d’en apprendre beaucoup sur cette « voix », sur ce qui l’a construite et sapée, nourrie et affamée, encouragée et découragée, composée et décomposée. Au-delà de l’amertume ou des anathèmes, ce sont bien des « exercices d’admiration » que nous sommes amenés à pratiquer en l’écoutant, et en écoutant celles qui l’accompagnent.
Jean-Pierre Longre
19:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, francophone, roumanie, cioran, nicolas cavaillès, aurélien demars, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Pas maintenant, pas comme ça »
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, Les éditions de Minuit, 2011
Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, Les éditions de Minuit, 2011
En décembre 2009, des vigiles du supermarché Carrefour de Lyon La Part-Dieu, ayant surpris un jeune homme à voler une canette de bière, se défoulent sur lui jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ces quatre hommes n’en étaient sans doute pas à leurs premières brutalités, mais il n’étaient pas encore allés jusqu’à l’assassinat.
Ce dramatique fait divers a été librement adapté par Laurent Mauvignier, en soixante pages d’un seul élan – une seule phrase suspendue entre un non début et une non fin, entre inspiration et expiration, comme le dernier souffle de l’être qui ne veut pas vraiment y croire et se dit jusqu’au bout : « Pas maintenant, pas comme ça ».
La syntaxe audacieuse, tourmentée, précise, comme toujours chez Mauvignier, forge et nourrit les personnages et les événements, les sensations et la trame narrative. Adressé au frère de la victime, le récit incantatoire dévoile peu à peu ce qu’était la vie (réinventée, transposée) du jeune homme qui ne se doutait pas que, accomplissant l’acte anodin de pénétrer dans un grand magasin, il n’en ressortirait pas vivant ; sa modeste famille, ses piètres amours, ses petits boulots, tout le mène sans en avoir l’air vers la tragédie, qui est aussi celle, en quelque sorte, des quatre bourreaux dont le narrateur se demande « de quelle humiliation ils veulent se venger ».
Tragédie en un acte, en un souffle, Ce que j’appelle oubli prouve que la littérature est apte à mettre en scène la souffrance humaine, honteuse, révoltante, que l’art peut faire vivre intensément la parole toute simple d’un homme de loi : « et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière ».
Jean-Pierre Longre
09:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/12/2011
Une culture en mouvement
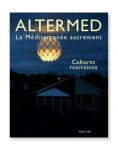 Revue Altermed n° 4, « Cultures roumaines », éditions Non Lieu, 2011
Revue Altermed n° 4, « Cultures roumaines », éditions Non Lieu, 2011
La revue Altermed a consacré trois numéros à la culture de différents pays méditerranéens, en mettant l’accent sur la création contemporaine et ce qui fait ses spécificités. La Roumanie est-elle un pays méditerranéen ? Michel Carassou, dans sa présentation, justifie le choix du numéro 4 en rappelant l’histoire et la tradition latines du pays, ainsi que l’influence ottomane à laquelle s’est heurtée « l’hégémonie slave ».
Quoi qu’il en soit, un volume consacré aux « cultures roumaines », qui ont tant de liens avec celles de divers pays d’Europe, notamment la France, autre pays méditerranéen, se justifie pleinement. Les bouleversements intervenus depuis la fin des années 1980 ne sont pas seulement politiques ou économiques. Le champ culturel a lui aussi connu des changements radicaux, ne serait-ce que par la liberté retrouvée, avec les tentatives, les tâtonnements, les expériences, les échecs et les réussites qu’elle a suscités.
La littérature occupe ici une place importante : la prose narrative, dont Andreia Roman rappelle l’histoire récente, depuis les contraintes du totalitarisme jusqu’à la « mise en question du monde » par les romanciers de la dernière génération comme Florina Ilis ; la poésie, elle aussi florissante, dont l’anthologie contenue dans ces pages complète celle qui a été publiée en 2008 dans Confluences poétiques ; le théâtre, lieu expérimental par excellence, qui oscille entre fidélité aux « racines » et « désir violent de réel ». Deux chapitres sont en outre consacrés aux arts visuels : le cinéma, dont les films d’auteurs internationalement reconnus manient à l’envi l’absurde, la satire et le « minimalisme » ; les arts plastiques – photographie, graphisme – qui tendent eux aussi vers un renouvellement complet et un engagement socio-politique marqué.
Malgré sa relative jeunesse, la Roumanie est riche d’un patrimoine culturel exceptionnel, qui a souvent nourri les avant-gardes européennes. Les artistes d’aujourd’hui ne dérogent pas à cette tradition, et on est heureux de lire ici des textes d’auteurs notoires ou encore peu connus, ainsi que des analyses précises et engageantes de certaines formes d’art contemporain.
Jean-Pierre Longre
 Les éditions Non Lieu viennent de publier une très intéressants correspondance de la poétesse et philosophe Catherine Pozzi (1882-1934) avec Raïssa et Jacques Maritain, Hélène Kiener et Audrey Deacon. Ces lettres inédites sont longuement présentées, précisément annotées par Nicolas Cavaillès, qui les a pour la plupart retrouvées à la Bibliothèque Nationale de France.
Les éditions Non Lieu viennent de publier une très intéressants correspondance de la poétesse et philosophe Catherine Pozzi (1882-1934) avec Raïssa et Jacques Maritain, Hélène Kiener et Audrey Deacon. Ces lettres inédites sont longuement présentées, précisément annotées par Nicolas Cavaillès, qui les a pour la plupart retrouvées à la Bibliothèque Nationale de France.
Nicolas Cavaillès, L’élégance et le chaos, éditions Non Lieu, 2011
17:36 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, essai, francophone, roumanie, altermed, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2011
Les ruses du roman
 Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Dumitru Tsepeneag, Le camion bulgare, « Chantier à ciel ouvert ». Traduction du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2011
Précisément, s’agit-il d’un roman ? Certes, Dumitru Tsepeneag a depuis longtemps (au moins depuis Le mot sablier qui, publié en 1984, représente sous forme narrative le passage d’une langue à l’autre) commencé à dévoiler certains coins de son atelier à l’intention de ses lecteurs, sans leur en laisser découvrir tous les secrets. Mais jamais un de ses livres n’a autant mérité le sous-titre de « Chantier à ciel ouvert ».
À l’image des tranchées que quelques travailleurs s’échinent à creuser dans les rues, certains leitmotive d’œuvres précédentes se retrouvent dans Le camion bulgare, certains personnages aussi : Marianne, l’épouse partie se soigner de son étrange maladie en Amérique, et à qui l’écrivain demande sans cesse des conseils, Alain, l’ami et traducteur à l’agonie, qu’il va falloir remplacer. D’autres apparaissent au fil des pages, fondant une narration épisodique : Tzvetan, le camionneur bulgare qui, en, quelque sorte, succède au fameux « plombier polonais » (et, autre clin d’œil, transporte avec lui un dangereux parapluie) ; Béatrice, dont la route va croiser celle du précédent, après qu’ils auront accompli leur itinéraire érotique ; Milena, romancière originaire de Slovaquie (mais dont le modèle, semble-t-il, vient plutôt de Slovénie), Pastenague, le double de l’auteur/narrateur avec qui il échange parfois des impressions ; quelques autres encore, qui naviguent entre réel et imaginaire.
On ne fera pas ici la liste des thèmes et sujets dont le foisonnement tient à la fois de la marqueterie cubiste, de la musique expérimentale et de l’art consommé de la (fausse) digression, dans un texte qui avance comme un camion cahotant sur les routes européennes. Il est question de Marguerite Duras, de « littérature d’ordinateur » et d’amour par courrier électronique, de mythologie égyptienne, d’animaux divers, de la Bulgarie et de la Roumanie, de maladie et de vieillesse… La récurrence de ce dernier motif pourrait laisser entendre que Le camion bulgare est le roman de la dépossession, voire de la disparition. Mais n’est-ce pas une ruse, pour mieux conserver sa foi en la littérature ? Car c’est essentiellement de littérature qu’il est question ; de celle des autres, parfois (les délicieuses et impitoyables Frappes chirurgicales restent d’actualité), mais surtout de celle qui est en train de s’élaborer ici, maintenant : autocommentaire, autocritique, autobiographie littéraire (que d’« auto » pour un camion…), ou encore métalittérature, poétique du roman, mise en abîme de l’écriture… Patiemment, de livre en livre, bien mieux que dans n’importe quel traité théorique ou manuel universitaire, Dumitru Tsepeneag explore malicieusement l’art du récit et procède aux mises en ordre successives de ses découvertes. Attendons la suite.
« Je reconnais que je n’ai pas eu le courage d’écrire un véritable chantier : rassembler des matériaux de construction, placer côte à côte les briques narratives et les idées structurantes, et laisser le lecteur se faire son roman lui-même. Certes : je l’ai écrit, pour ainsi dire, sous ses yeux, il est témoin des efforts que je fais pour écrire encore un livre – le livre de trop, diront certains… ». Mais non !
Jean-Pierre Longre
14:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, dumitru tsepeneag, nicolas cavaillès, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/10/2011
Les révélations de la musique
 Kazuo Ishiguro, Nocturnes. Traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch, Éditions des 2 terres, 2010, rééd. Folio, 2011
Kazuo Ishiguro, Nocturnes. Traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch, Éditions des 2 terres, 2010, rééd. Folio, 2011
De même que la belle interprétation d’un morceau donne envie de le réécouter, de même la lecture des « Cinq nouvelles de musique au crépuscule » de Kazuo Ishiguro (auteur, entre autres, des Vestiges du jour) invite à la relecture. Car dans chaque récit, le thème principal est soutenu par des thèmes secondaires, contrepoints et basses continues, qui lui donnent une profondeur harmonique inépuisable.
Le « crooner » vieillissant, idole d’un jeune guitariste, ne peut prouver son amour à sa femme qu’en l’amenant à Venise pour une ultime sérénade. L’ami de jeunesse, amateur de jazz, resté à près de cinquante ans une sorte d’adolescent que l’on prend en pitié, sera-t-il d’un quelconque secours pour Emily et son mari ? Que vient faire cet étrange couple de voyageurs suisses allemands dans les douces collines de Malvern, sous le regard étonné d’un jeune auteur-compositeur-interprète ? Il faut ensuite assister aux folles expéditions nocturnes, dans un hôtel de luxe, d’un jeune saxophoniste en mal de notoriété et d’une vedette de la télévision, tous deux la tête enfouie sous des bandages après une opération de chirurgie esthétique. Enfin, retour en Italie pour une série de tête à tête entre un violoncelliste plein de « potentialités » et une « virtuose » à l’attitude bizarre…
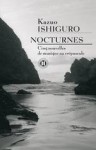 La musique est partout, susceptible de révéler les sentiments, les émotions et les secrets que tout être humain cache au fond de lui, les questions qu’il se pose, les rêves qu’il voudrait réaliser. Et l’écriture est telle, dans son apparente simplicité, dans la sobriété des moyens utilisés, dans les changements de tempo, dans les mystères qu’elle recèle, dans l’humour des situations et des gestes, que le lecteur se prend d’affection pour les personnages – témoins ou acteurs –, devinant plus ou moins spontanément que, sous des aspects très divers, chacun d’entre eux lui ressemble, en toute humanité.
La musique est partout, susceptible de révéler les sentiments, les émotions et les secrets que tout être humain cache au fond de lui, les questions qu’il se pose, les rêves qu’il voudrait réaliser. Et l’écriture est telle, dans son apparente simplicité, dans la sobriété des moyens utilisés, dans les changements de tempo, dans les mystères qu’elle recèle, dans l’humour des situations et des gestes, que le lecteur se prend d’affection pour les personnages – témoins ou acteurs –, devinant plus ou moins spontanément que, sous des aspects très divers, chacun d’entre eux lui ressemble, en toute humanité.
Jean-Pierre Longre
- 2 mars 2011 : Sortie du film Never let me go d’après le roman de Kazuo Ishiguro.
- Nocturnes fait partie de la sélection par le magazine Lire des « 20 meilleurs livres de l’année ».
18:13 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, anglophone, kasuo ishiguro, anne rabinovitch, Éditions des 2 terres, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/10/2011
Chaos bien ordonné
 Patrick Ledent, À vos caddies !, Éditions Calliopées, 2011
Patrick Ledent, À vos caddies !, Éditions Calliopées, 2011
Dans son précédent recueil (Joli coup), Patrick Ledent avait révélé un vrai talent de conteur. Voilà qui se confirme sans conteste dans À vos caddies !. Et le mot « recueil » n’est pas anodin : les vingt nouvelles, encadrées par des « Prolégomènes » et un « Envoi », bouclent un itinéraire plein de surprises, qui mène le lecteur d’une envolée satirique (le monde de la consommation) à l’autre (le monde du travail), d’un cimetière au même cimetière, à Nice où sévissent des vampires très humains. La vie, mort comprise…
Les surprises ? Elles sont multiples et variées : un drôle de restaurant où se cache une drôle de lolita, l’étrange rencontre d’une tulipe et d’un enfant, les illusions d’un tueur en série, les découragements d’un employé de bureau, les ruses d’une élégante de casino… des accidents bizarres, des hasards suspects, des rencontres inattendues…
Pour réaliste que soit le monde dans lequel évoluent les personnages et surgissent les événements, le lecteur se laisse volontiers transporter vers l’imprévu, et la verve de l’auteur y est pour beaucoup. Car le suspense s’assortit d’une écriture alerte, d’une prose séduisante où se profilent parfois quelques silhouettes familières, telle celle de Queneau qui passe comme une discrète figure tutélaire. On se laisse mener avec délices par le bout du nez pour s’évader à loisir, poussant devant soi une provision de références rassurantes et d’inventions délicieuses, dans un chaos bien ordonné. « Mais c’est dur, le chaos. Alors, pardon, je compense. Je mets de l’ordre, me réinvente, vous réinvente. Invente tout court, puisqu’on est frères. Des petites histoires. Je fais comme tout le monde, je fais comme vous : je creuse. Une évasion, ça commence par là ».
Jean-Pierre Longre
18:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, patrick ledent, éditions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/09/2011
« Battre le tambour »
 Jacques-Pierre Amée, Le ciel est plein de pierres, Infolio, 2011
Jacques-Pierre Amée, Le ciel est plein de pierres, Infolio, 2011
Le nouveau roman de Jacques-Pierre Amée est certes plein de pierres, mais aussi plein de rythme, et de tant d’autres choses parmi lesquelles la nature tient une place prépondérante (la forêt et les animaux, par exemple), sans compter l’amitié, l’amour, la parole, le silence, le mystère…
Le narrateur, Graham Rouge (un nom qui se détache sur la verdure, la neige, le ciel, la nuit), photographe animalier, observateur du monde lointain et proche, tente de se frayer un chemin entre souvenirs et immédiateté, entre passé et présent. Son récit, qui s’adresse à son ami Emil, hospitalisé au-delà des mers, à cette Ibi qu’il aime mais qu’il n’a pas vue depuis un certain temps, à d’autres encore, Caïm, Lucie, le lecteur, lui-même... son récit, donc, tient autant de la narration que de la poésie, du mouvement que du ressassement, de la fiction que du journal, un journal dans lequel, au fil de la lecture, on assiste à la mise en place de l’écriture.
L’auteur a l’art de (se) raconter sans en avoir l’air, par des détours, par des étapes où l’accessoire narratif parait devenir l’essentiel. « Y a rien de facile », dit périodiquement le boucher du coin : aussi difficile d’étouffer proprement un pigeon que de percer le mystère de l’énigmatique « Toubob », vagabond qui pourrait bien avoir fait disparaître avec lui la vieille dame qui l’avait recueilli, ou de reconstituer le puzzle que représente le titre du magazine NOÉ…
Voilà un livre qui « bat le tambour » (autre leitmotiv, autre rime de la prose), qui bat le rappel (des souvenirs, des amis, des contrées lointaines), qui bat la chamade (émotion à tous les tournants de pages), qui bat les cartes (pour mieux rendre compte du désordre universel). Un livre musical, où le langage des images et des mots s’impose comme une lancinante mélodie, comme une étourdissante symphonie.
Jean-Pierre Longre
15:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, jacques-pierre amée, éditions infolio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/09/2011
Se défaire du monde
 Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
« Nous avons été deux hommes juchés face au mal. J’ai su que vous souffriez comme je souffrais. Nous adressions à des dieux différents des lamentations qui n’empruntaient pas les mêmes mots. Je ne savais pas quelle peine vous avait conduit près de moi. Je ne pensais pas qu’il fût de peine qui valût la mienne. Mais vous étiez venu du bout de la terre. Nous fûmes une seule protestation et l’amour qui ne renonce pas ».
Ces deux hommes, Monsieur de la Tour et Lu Wei, n’étaient pas faits pour se connaître : le premier, noble français plus ou moins mêlé à la Fronde, et le second, dignitaire chinois déchu par les guerres et le renversement de la dynastie des Ming, sont séparés non seulement par les océans, mais aussi par leurs origines et leurs cultures. Pourtant, leur rencontre silencieuse et leur amitié précautionneuse sont le fruit d’une convergence qui les rend inévitables : Monsieur de la Tour, brûlant d’un amour coupable et partagé pour Madame de Clermont, fuit au-delà des mers et se retrouve, au bout d’un périple aussi hasardeux que dangereux, sur un îlot où s’est retiré Lu Wei, souffrant lui-même d’un désespérant mal d’amour pour son épouse disparue. Commencent douze années de condamnation volontaire, de réclusion ascétique, au cours desquelles la soif d’absolu tente de panser la blessure, où la quête du vide le dispute à l’espoir en Dieu, ce dieu que Monsieur de la Tour cherchera encore en France, réfugié à Port-Royal, dans le plus complet dénuement, dans cet « abandonnement » qui l’accompagnera jusqu’à la fin.
Le roman de Laurence Plazenet se déroule comme une longue litanie submergeant les heurts, les atrocités, les décompositions qu’il dévoile. Psalmodiées en un récitatif qui donne autant d’importance à la musique des mots qu’à leur contenu, les phrases, dont la sobriété toute classique s’accommode parfois de circonvolutions baroques, sont prenantes. La stylisation de la forme impose l’évidence des faits et des pensées, donne à la prose une profondeur qui révèle celle des âmes.
Jean-Pierre Longre
Laurence Plazenet vient de publier Disproportion de l'homme, Gallimard, 2011. Lecture et chronique à venir…
09:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurence plazenet, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2011
Poète du mouvement
 Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral, Rafael de Surtis / Éditinter, 2011
Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral, Rafael de Surtis / Éditinter, 2011
De tous les écrivains venus de Roumanie qui, au cours du XXe siècle, ont enrichi la littérature de langue française, Ilarie Voronca est l’un des plus importants et des plus méconnus. Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Eugène Ionesco, Cioran et quelques autres font l’objet de nombreuses études ; pour les compléter, la parution de l’ouvrage de Christophe Dauphin est salutaire.
« Poète intégral », Voronca l’est à des titres divers. Théoricien de l’« intégralisme », il fut l’un des rédacteurs de la revue Integral, ainsi que d’autres revues de de cette avant-garde qui caractérisa la vie intellectuelle roumaine de l’entre-deux-guerres. En outre, toute son œuvre, en vers et en prose, relève d’une volonté d’unification « intégrale » des éléments naturels et humains. La biographie d’Eduard Marcus, alias Ilarie Voronca (1903-1946), très précisément rapportée, s’insère ici dans un environnement lui aussi parfaitement détaillé. Les années roumaines, l’installation en France, l’exil et ses difficultés, les brouilles littéraires momentanées, les amitiés, les amours, les rencontres (avec la plupart de ceux qui forment le monde artistique), les ruptures, la période de l’occupation et de la résistance, la quête désespérée du bonheur, jusqu’au suicide au domicile parisien – tout cela est solidement inscrit dans le contexte historique, social, politique, culturel, roumain, français, européen dont la destinée individuelle est indissociable.
Cette biographie est aussi un portrait moral (« Combattre les prisons, la haine, l’angoisse et l’oppression ») et surtout poétique, dans cet espace franco-roumain qu’Ilarie Voronca incarne totalement : symbolisme, avant-garde, intégralisme, lyrisme personnel… il est le poète du « mouvement », de l’« inquiétude », de l’« insatisfaction », de ces états qui ne laissent jamais en repos et d’où émane une incessante évolution.
Voilà un livre indispensable à la connaissance d’un poète majeur, qui plus est écrit par quelqu’un pour qui l’écriture est une matière vivante, puisque Christophe Dauphin, outre ses essais, a publié nombre de recueils poétiques. Son étude, qui s’appuie beaucoup sur les textes, forme un ensemble très documenté (citations, anthologie significative, riche iconographie…) : Ilarie Voronca, le poète intégral est un ouvrage nourri d’authenticité.
Jean-Pierre Longre
18:04 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, roumanie, ilarie voronca, christophe dauphin, rafael de surtis, Éditinter, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/09/2011
Des trouvailles au Pont du Change
Roland Tixier, Chaque fois l’éternité, préface de Geneviève Metge, Le Pont du Change, 2011
Alphonse Allais, L’agonie du papier et autres textes d’une parfaite actualité, introduction de Jean-Jacques Nuel, Le Pont du Change, 2011
Le Pont du Change, maison d’édition lyonnaise, enrichit sa production de deux livres à déguster lentement, avec délectation.
 L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
 L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
Le Pont du Change passe par-dessus les années en deux démarches différentes. Empruntez-le sans hésiter, le trajet ne vous décevra pas.
Jean-Pierre Longre
18:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, humour, francophone, roland tixier, alphonse allais, geneviève metge, jean-jacques nuel, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2011
En allant chez Destouches
 Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010. J'ai lu, 2011
Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010. J'ai lu, 2011
La journée du 6 décembre 1954 aura été pour quelques personnes d’une exceptionnelle densité. C’est d’abord celle où Simone de Beauvoir reçoit le prix Goncourt pour Les Mandarins, ce qui confirme le triomphe de la maison Gallimard sur ses concurrentes. Justement, dans cette maison, il y a un garçon de courses, Gérard Cohen, lui-même fils de l’un des dirigeants, et c’est sa propre journée que raconte le roman : il est chargé d’aller à Meudon, chez Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, porter des papiers que l’écrivain déchu ne voudra même pas regarder, tant il vomit, en même temps que les Juifs et que lui-même, les « sangsues », les « maquereaux », « cette grosse baderne adipeuse de Gaston », ce « gros matou gallimardeux », et « l’univers tout entier ».
 À la fois terrorisé et fasciné par le vieil antisémite, le jeune Cohen accomplira sa mission comme d’habitude, en dépit des chiens, de la crasse et des gémissements. Mais auparavant, il profite du répit que lui donne la remise du Goncourt pour s’adonner au vagabondage, et nous suivons les zigzags spatiaux et mentaux du motocycliste. Cela donne de belles évocations contrastées du Paris des années cinquante : le Milieu (éditorial), ses habitudes et ses célébrations ; les Halles, leurs odeurs et leur grouillement ; les hôtels de passe, les œillades et les caresses professionnelles des putains ; l’île Seguin et ses usines, le village de Meudon et ses grisailles, les hauteurs de la Seine où se terre le « réprouvé »… Cet itinéraire plus ou moins aléatoire est une sorte de préparation de l’entrevue, mais surtout, peut-être, une incitation aux souvenirs. La guerre et l’occupation sont encore toutes proches, que l’enfant juif a vécues en errant « de cachette en cachette » après l’emprisonnement de sa mère et l’arrestation de la femme chez laquelle il s’était réfugié, en errant mais en parcourant la campagne, en étudiant les plantes d’Auvergne, en s’instruisant, en vivant la vie d’un garçon de son âge.
À la fois terrorisé et fasciné par le vieil antisémite, le jeune Cohen accomplira sa mission comme d’habitude, en dépit des chiens, de la crasse et des gémissements. Mais auparavant, il profite du répit que lui donne la remise du Goncourt pour s’adonner au vagabondage, et nous suivons les zigzags spatiaux et mentaux du motocycliste. Cela donne de belles évocations contrastées du Paris des années cinquante : le Milieu (éditorial), ses habitudes et ses célébrations ; les Halles, leurs odeurs et leur grouillement ; les hôtels de passe, les œillades et les caresses professionnelles des putains ; l’île Seguin et ses usines, le village de Meudon et ses grisailles, les hauteurs de la Seine où se terre le « réprouvé »… Cet itinéraire plus ou moins aléatoire est une sorte de préparation de l’entrevue, mais surtout, peut-être, une incitation aux souvenirs. La guerre et l’occupation sont encore toutes proches, que l’enfant juif a vécues en errant « de cachette en cachette » après l’emprisonnement de sa mère et l’arrestation de la femme chez laquelle il s’était réfugié, en errant mais en parcourant la campagne, en étudiant les plantes d’Auvergne, en s’instruisant, en vivant la vie d’un garçon de son âge.
Le réprouvé est un vrai livre de littérature, à tous points de vue. Celle qui s’écrit et se déroule sous nos yeux, en des phrases qui suivent avec bonheur les méandres de la mémoire et de l’autoanalyse ; celle aussi qui s’est construite dans les soubresauts politiques et sociaux (que le père de l’auteur a dû connaître dans des conditions analogues), celle qui a composé avec les abominations, les lâchetés et la mauvaise conscience, avec la souffrance, l’innocence et le courage, celle qui est inséparable de la nature humaine. Et il n’y a pas que Céline ; l’on croise, à l’occasion, Paul Léautaud, Jean Paulhan, Raymond Queneau, et cela fait toujours plaisir. Il ne faut donc pas hésiter à accompagner le jeune Gérard Cohen dans son parcours initiatique.
Jean-Pierre Longre
11:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, mikaël hirsch, l’Éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Vous vous souvenez ? »
 Gianina Carbunariu, Avant-hier, après demain, Nouvelles du futur. Traduit du roumain par Mirella Patureau, éditions L’espace d’un instant, 2011
Gianina Carbunariu, Avant-hier, après demain, Nouvelles du futur. Traduit du roumain par Mirella Patureau, éditions L’espace d’un instant, 2011
Dans ces quatre scènes, ponctuées de « micro-séquences » laissées à l’initiative du réel et des acteurs, Gianina Carbunariu anticipe. Beaucoup l’ont fait avant elle, beaucoup le feront après, dira-t-on. C’est un fait. Comme on le voit chez d’autres auteurs, les défauts, les excès, les tabous, les interdits, les vides du monde actuel sont ici poussés à un tel degré qu’ils deviennent à la fois absurdes, odieux et destructeurs. Ne le sont-ils pas déjà ? Les fumeurs deviennent des criminels, les animaux des compagnons adulés, les gadgets électroniques disparaissent sous la montée des eaux, la misère pousse à chercher tous les moyens de survie : finalement, peu de différence entre les XXIe et XXIIe siècles.
Mais il ne s’agit pas seulement de dénoncer les abus de nos sociétés, d’exercer son esprit critique, de s’adonner à la satire (souvent savoureuse, salutaire et parfaitement ciblée, au demeurant) des mœurs d’aujourd’hui. Nous avons affaire à du théâtre, un théâtre polyphonique à souhait, permettant à l’auteur, aux personnages, aux comédiens, aux spectateurs / lecteurs de (se) rendre compte, d’une manière concrète et stylisée, de ce qu’est la réalité. Le langage théâtral, à la fois maîtrisé et libéré, assure la mise en perspective burlesque, morbide, tragique de l’Histoire, et ce langage, s’il est multiple, est d’abord celui des mots. Mots accumulés, mots perdus et recherchés, mots ambigus, mots crus, mots à la mode, mots de toujours (saluons au passage le travail de la traductrice)… Ces « nouvelles du futur » sont aussi – pour reprendre une formule de Ghérasim Luca dans Levée d’écrou – « des nouvelles inquiétantes sur le langage ».
Avant-hier, après demain, à travers les va-et-vient de la mémoire, montre, suggère et pose des questions qui concernent non seulement notre actualité, mais aussi les moyens que nous avons de dire cette actualité, de suivre la marche du monde passé, présent et à venir. Donner à voir et à entendre le réel, dans les interstices et les harmoniques de la fiction verbale et scénique : c’est bien ce que l’on attend du théâtre.
Jean-Pierre Longre
10:58 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, roumanie, gianina carbunariu, mirella patureau, l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/08/2011
The Black Herald n°2 arrive
 Literary magazine –Revue de littérature
Literary magazine –Revue de littérature
The Black Herald issue #2 – September 2011 - Septembre 2011
162 pages - 13.90 € – ISBN 978-2-919582-03-7
Poetry, short fiction, prose, essays, translations.
Poésie, fiction courte, prose, essais, traductions.
With / avec W.S Graham, Danielle Winterton, Dumitru Tsepeneag, Clayton Eshleman, Pierre Cendors, Onno Kosters, Alistair Noon, Anne-Sylvie Salzman, Róbert Gál, Andrew Fentham, Hart Crane, Delphine Grass, Jacques Sicard, Iain Britton, Jos Roy, Michael Lee Rattigan, Georges Perros, Laurence Werner David, John Taylor, Sudeep Sen, César Vallejo, Cécile Lombard, Michaela Freeman, Gary J. Shipley, Lisa Thatcher, Dimíter Ánguelov, Robert McGowan, Jean-Baptiste Monat, Khun San, André Rougier, Rosemary Lloyd, Hugh Rayment-Pickard, Sherry Macdonald, Will Stone, Patrick Camiller, Paul Stubbs, Blandine Longre. and essays about / et des essais sur Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Jacques Derrida. Images : Romain Verger, Jean-François Mariotti. Design: Sandrine Duvillier.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
http://blackheraldpress.wordpress.com/magazine/the-black-herald-issue-2/
Where to find the magazine and our books / Où trouver la revue et nos publications :
http://blackheraldpressbookshop.blogspot.com/p/add-to-cart-ajouter-au-panier.html
And soon in bookshops listed here / et bientôt dans les librairies suivantes:http://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles/
Black Herald Press : http://blackheraldpress.wordpress.com/
Blog : http://blackheraldpress.tumblr.com
To follow us on Facebook / nous suivre sur Facebook : http://www.facebook.com/BlackHeraldPress
& Twitter : http://twitter.com/Blackheraldpres
Co-edited by Blandine Longre and Paul Stubbs, the magazine’s only aim is to publish original world writers, not necessarily linked in any way by ‘theme’ or ‘style’. Writing that we deem can withstand the test of time and might resist popularization – the dangers of instant literature for instant consumption. Writing that seems capable of escaping the vacuum of the epoch. Where the rupture of alternative mindscapes and nationalities exists, so too will The Black Herald.
L’objectif premier de la revue, coéditée par Blandine Longre et Paul Stubbs, est de publier des textes originaux d’auteurs du monde entier, sans qu’un « thème » ou un « style » les unissent nécessairement. Des textes et des écritures capables, selon nous, de résister à l’épreuve du temps, à la vulgarisation et aux dangers d’une littérature écrite et lue comme un produit de consommation immédiate. Des textes et des écritures refusant de composer avec la vacuité de l’époque, quelle qu’elle soit. Éclatement des codes, des frontières nationales et textuelles, exploration de paysages mentaux en rupture avec le temps : c’est sur ces failles que l’on trouvera le Black Herald.
“Black Herald Press is an outstanding new imprint – physically and stylistically their books are a delight.” — Paul Sutton, Stride magazine, 10/2010.
« La ligne éditoriale de la revue s’attache avant tout à établir un horizon élargi et diversifié de genres, de langues et de styles. Aucun thème ni mouvement commun, simplement (et c’est là que se trouve tout le sel de ces pages) l’articulation d’hémisphères, quelques terres inconnues reliées les unes aux autres pour que le style, justement, de la revue, ce soit ce point de convergence des textes entre eux. » – Guillaume Vissac, 04/2011
“Its publication feels like an event, in terms of quality and scope (it’s bi-lingual and has its sights, like Blast long before it, on the more visionary and European aspects of poetry).” – Darran Anderson, 02/2011
« Aux commandes de ce navire de pirates, Paul Stubbs et Blandine Longre, dont on avait déjà loué ici la sauvage poésie d’expression anglaise. Tous deux ont eu l’audace d’offrir à leurs contributeurs cette étrange arène où la langue, par le système d’échos qu’ils ont construit, ne peut être que remise en cause. Lecture jamais confortable, jamais contentée, donc, que celle du Black Herald, où chaque page, chaque texte, dans sa version originale et / ou dans sa traduction est source d’inquiétude. On attend avec une impatience certaine la deuxième livraison (automne 2011, nous dit-on) de ce super-héraut. » – Le Visage Vert, 01/2011
15:31 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, anglophone, francophone, poésie, nouvelle, essai, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

