23/08/2011
Brisures et vérités
 Nancy Huston, Lignes de faille, Actes Sud / Leméac, « Un endroit où aller », 2006. J'ai lu, 2011. Prix Fémina 2006.
Nancy Huston, Lignes de faille, Actes Sud / Leméac, « Un endroit où aller », 2006. J'ai lu, 2011. Prix Fémina 2006.
Quatre récits, quatre enfants de six ans différents et réunis par une ligne dont les brisures s’ouvrent peu à peu aux yeux du lecteur. Avec Sol (« Solly, Solomon »), petit garçon américain à part entière, rêvant sur Internet de puissance et d’éternité, imaginant qu’il « contrôle et possède chaque parcelle du monde », commence le parcours généalogique ascendant d’une famille reliée par quelques points d’ancrage – un grain de beauté, une poupée que se disputent violemment deux femmes âgées redevenues petites, un « vieux nounours tout râpé »…
L’exploration se poursuit avec Randall, le père de Sol, que l’on retrouve à six ans entre un père dramaturge au creux de son inspiration et une mère obsédée par ses recherches sur le Mal et les « fontaines de vie », lieux où les nazis concentraient pour les « germaniser » des enfants volés dans les pays occupés. Celle-ci, Sadie, est passée à l’âge de six ans du « parfum de tristesse » quotidien ressenti entre ses grands-parents à l’agitation réjouissante et désordonnée de la vie d’artiste menée par sa jeune mère. Finalement, c’est cette dernière, Erra (ou Kristina ou AGM), héroïne du quatrième récit, qui imprime sa marque sur tous les épisodes, en pointillés incisifs puis par la découverte de ses propres origines, donc de celles de la famille entière.
Itinéraire temporel sur plus d’un demi-siècle de bouleversements et de conflits entre 2004 et 1944, Lignes de faille est aussi un itinéraire spatial entre l’Amérique moderne et l’ancienne Europe, en passant par Israël. A travers des récits de vie individuels et familiaux, c’est la destinée du monde d’aujourd’hui qui est le véritable enjeu de la narration. C’est l’Histoire vécue de l’intérieur, dans la tension d’un mouvement chronologique inversé, à la recherche d’une authenticité dont seuls les enfants, dans leur lucide naïveté, semblent capables : « En les écoutant je repense à cette idée de théâtre et me demande si au fond le gens ne passent pas leur temps à jouer des rôles, non seulement lors des mariages mais tout au long de leur existence : peut-être qu’en conseillant ses fous grand-papa joue le rôle d’un psychiatre et en me frappant avec la règle Mlle Kelly joue le rôle d’une méchante prof de piano ; peut-être qu’au fond d’eux-mêmes ils sont tous quelqu’un d’autre mais, ayant appris leurs répliques et décroché leurs diplômes, ils traversent la vie en jouant ces rôles et il s’y habituent tellement qu’ils ne peuvent plus s’arrêter ».
Ce que se dit la petite Sadie, c’est souvent ce qu’on se dit non seulement à la lecture d’un roman, mais aussi à l’observation de la société des hommes. Lignes de faille est un roman qui, au-delà de l’habileté de la construction, de l’expressivité des soliloques enfantins, de la cruauté de certains passages, de la tendresse de certains autres, tente de mettre au jour les vérités nichées au plus profond des âmes et des corps.
Jean-Pierre Longre
16:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nancy huston, actes-sud, leméac, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/07/2011
« Machine mentale »
 Mark Twain, L’homme, c’est quoi ?, traduit de l’américain par Freddy Michalski, L’œil d’or, 2011
Mark Twain, L’homme, c’est quoi ?, traduit de l’américain par Freddy Michalski, L’œil d’or, 2011
L’auteur des Aventures de Tom Sawyer et de celles de Huckleberry Finn (entre autres) publia aussi, à partir de 1896, des textes philosophiques à forte teneur pessimiste, voire nihiliste, au nombre de trois : Lettres de la terre, L’étranger mystérieux et L’homme, c’est quoi ? (tous trois réédités récemment aux éditions de L’œil d'or).
L’homme, c’est quoi ? est un dialogue philosophique empruntant sa forme à la tradition platonicienne : comme Socrate avec ses disciples, un Vieil Homme soumet un Jeune Homme à sa maïeutique ; le va-et-vient des questions-réponses, parsemé non seulement de sentences et d’exemples persuasifs, mais aussi de rappels historiques, de paraboles, de fables, donne à l’enseignement une allure vive et théâtrale.
Comme l’indique le titre, c’est la question fondamentale de l’homme, de sa nature et de ses actions qui est au cœur du débat, et surtout celle de son libre-arbitre (ou plutôt de l’absence de celui-ci). Les six parties du livre orientent le Jeune Homme (et le lecteur) vers l’idée que l’homme, comme une machine, est mû de l’extérieur, que tout ce qu’il pense, émet, fait est de « seconde main » et n’a « pour autre finalité que de lui assurer ponctuellement, d’abord et avant tout, paix de l’esprit et confort spirituel » en lui donnant bonne conscience. À ce compte, l’homme est-il supérieur à la fourmi et aux autres animaux réputés intelligents ? Écoutons encore le vieux philosophe : « Le fait que l’homme sache distinguer le bien du mal prouve sa supériorité INTELLECTUELLE sur les autres créatures mais le fait qu’il soit capable de FAIRE le mal est la preuve même de son infériorité MORALE à toute créature qui ne le peut pas. »
La leçon est rude et ce texte, pour le moins, donne à penser. La réflexion, fortement sollicitée, voire poussée dans ses retranchements (c’est évidemment le but du dialogue), est égayée avec bonheur par les plaisants dessins de Sarah d’Haeyer ponctuant chaque chapitre. Un peu de sourire au milieu de ces déprimants constats.
Jean-Pierre Longre
22:19 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, usa, mark twain, freddy michalski, sarah d’haeyer, éditions l’œil d'or, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/07/2011
Drôle ou morbide ?
 Patrick Rambaud, Comment se tuer sans en avoir l’air, La Table Ronde, 1986, rééd. Folio, 2011
Patrick Rambaud, Comment se tuer sans en avoir l’air, La Table Ronde, 1986, rééd. Folio, 2011
L’un des propres de l’homme est « le suicide individuel » : les animaux, à part quelques exceptions circonstancielles et généralement collectives, ne prennent pas ce genre d’initiative. C’est en tout cas ce qu’explique Patrick Rambaud en introduisant son « Manuel d’élégance à l’usage des mal partis avec des ruses, des méthodes et des principes expliqués par l’exemple ». Comme un autre propre de l’homme est, selon Rabelais, le rire, il semble que Rambaud ait décidé de développer l’un en s’aidant de l’autre (et inversement).
Cela nous vaut quatorze moyens d’en finir sans honte et en préservant son amour-propre. Il n’est pas question de les énumérer ici, mais on saura que les quatorze chapitres qui les abordent ne sont ni vulgairement pédagogiques ni abstraitement théoriques. Tout passe par des anecdotes aussi tragi-comiques que convaincantes. Les personnages dont l’auteur nous narre le trépas volontaire, nous les connaissons, nous les côtoyons, c’est nous, en plus malheureux, en plus désespérés, en plus obstinés. Les circonstances de la vie les ont poussés à interrompre celle-ci « sans en avoir l’air » : il leur faut trouver un moyen de maquiller leur suicide en accident, en meurtre, en geste héroïque (et « con »), en infarctus, en maladie mortelle… et ils le trouvent.
Tout cela est fort drôle, même s’il nous arrive de rire jaune, tant le genre humain dans son entier est mis à rude épreuve et tend à la morbidité. Le style allant, allusif, expéditif parfois, imagé souvent n’est pas pour rien dans le plaisir que l’on prend à lire dans les pensées des personnages, à les accompagner dans leur cheminement souvent complexe, toujours fatal. Et il faut aller jusqu’au bout : dans sa conclusion, Patrick Rambaud rappelle que le suicide ne date pas d’aujourd’hui, loin s’en faut, et termine tout de même par un bel hymne à la vie.
Jean-Pierre Longre
18:07 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, récits, humour, francophone, patrick rambaud, la table ronde, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/06/2011
"Mots nomades"
 Sylvie Germain, Le monde sans vous, Albin Michel, 2011
Sylvie Germain, Le monde sans vous, Albin Michel, 2011
En juin 2010, quatorze écrivains, réunis par « Culturesfrance », ont effectué le trajet Moscou-Vladivostok à bord du Transsibérien. Beau parcours de 19 jours semé d’étapes littéraires et de rencontres diverses, belle ouverture sur le monde extérieur et intérieur.
Sylvie Germain a rapporté de ce périple le premier texte de son livre Le monde sans vous. Ni relation de voyage, ni guide touristique, ni accumulation de notes, « Variations transsibériennes » tient la promesse de son titre : le double déplacement dans l’espace et dans le temps se fait au gré de la musique des mots, du rythme des phrases : « Le train va son chemin. Il va, calme et docile, obstinément ». La musicalité, c’est aussi celle de l’alternance entre la prose narrative ou descriptive et les poèmes empruntés à Ossip Mandelstam, à la Bible, à Boris Pasternak, à Anna Akhmatova, à Arseni Tarkovski, à Paul Celan, à Jules Supervielle, à Blaise Cendrars… C’est bien sûr celle de l’évocation des paysages : la Sibérie, « Nord magnétique » ; la taïga, où « tout est échange, et tout est solitude » ; le lac Baïkal, « œil-ombilic », « visage entier », « paume large ouverte », « oreille tendue », « bouche cobalt », « vulve bleu satin » ; Vladivostok, « drapé dans les plis de son nom qui claque en saccades grises »… Surtout, c’est l’harmonie des va-et-vient entre présent et passé, soutenue par l’évocation de la mère et de sa mort, « douceur et violence intensément unies ».
On saisit alors l’unité du livre en son entier, même si les proses qui le composent datent d’époques différentes. Le Transsibérien est comme un déclencheur de poésie, de souvenirs, d’images. « Kaléidoscope ou notules en marge du père », le deuxième texte, est soutenu, après celle de la mère, par « l’une des deux images premières, fondatrices. Celle du père », ce père porteur et suscitateur de mémoire, et dont la disparition n’a pas effacé le « regard d’enfant simple et confiant ». Suite et variations : la relation entre le père et l’enfant est au cœur des deux derniers textes, « Il n’y a plus d’images » et « Cependant », où le « mystère de la mort », qui ne revendique pas le « dernier mot » (puisqu’il n’y en a pas), se laisse effleurer sans imposer la lourdeur du désespoir.
Car si les grands thèmes (mort et mémoire, entre autres) forment la trame de ce livre polyphonique, dense et profond, ils sont transfigurés par l’art – peinture, poésie, musique – et par l’écriture, « lent travail de détours », dont les « mots nomades » suivent la « marche sinueuse » du train, « point de tangence entre l’espace et le temps ».
Jean-Pierre Longre
19:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récits, poésie, francophone, sylvie germain, albin michel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/06/2011
Des moutons et des hommes
 Blaise Hofmann, Estive, éditions Zoé, 2007, rééd. 2011
Blaise Hofmann, Estive, éditions Zoé, 2007, rééd. 2011
L’estive, une large saison d’été à garder les moutons sur les pentes des montagnes suisses, entre la vallée des hommes et les sommets des dieux, ce peut-être pour le berger l’occasion de contempler, de méditer, de réfléchir, voire d’écrire, mais c’est aussi le temps du labeur ingrat, répétitif, dur au corps et à l’esprit. En brèves et multiples notations qui combinent comme naturellement le vécu et le travail littéraire, Blaise Hofmann campe sa propre silhouette sur fond de montagne à la fois immuable et changeante, où passent avec le mouvement des saisons celui des troupeaux et des chiens.
La prose fragmentaire saisit le réel des hommes, des bêtes, de la nature dans des évocations poétiques, tantôt transparentes tantôt énigmatiques. Et les hommes, les bêtes, la nature s’en portent d’autant mieux dans les rêves du lecteur.
Jean-Pierre Longre
17:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, suisse, blaise hofmann, éditions zoé, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/06/2011
Les parenthèses de l’existence
Alain Gerber, Longueur du temps, Alter ego éditions, 2011 
Alain Gerber et la musique, c’est tout un roman ; une somme de romans. Et malgré les apparences, Longueur du temps ne déroge pas : comme dans les livres précédents, il y a la matière biographique, la narration menée sur fond d’images fortes, l’invention verbale, les thématiques musicales (avec les silhouettes de fameux jazzmen passant à l’arrière-plan, parfois même jusque sur le devant de la scène), l’évocation de pays lointains et de rues toutes proches, Bavilliers et Ouagadougou, Paris et Montréal, Belfort et Corfou, le beau pays d’« Enfrance » et le légendaire Mexique – odyssées dans l’espace et dans le temps.
À part cela, il faut bien distinguer : la matière biographique est tout ce qu’il y a de personnel, même si, mettant à contribution le couple et l’univers environnant, elle ne doit rien à l’égotisme ; et la narration est versifiée – comme Chêne et chien, « roman en vers » dans lequel Raymond Queneau se raconte sans fards. La comparaison n’est pas hasardeuse : chez l’un comme chez l’autre les vers sont la composante nécessaire de la forme romanesque ; ils lui donnent sa ponctuation, son rythme, ses mesures, ses syncopes… Syntagmes sonores, phrases coupées, listes, inventaires, mots martelés, l’écriture au plus fondamental de sa composition est musicale, à la recherche de
« la formule cinglante / le sésame /qui lève l’écrou et brise les scellés / du Temps »,
le temps, incessant leitmotiv, qui donne leur « tempo » aux souvenirs.
Si la musique est partout, n’oublions pas que tout passe par la littérature. Ce sont les mots, combinés entre eux, qui tentent de lever les voiles de la mémoire, « ce lac sourd plein de rumeurs », et de « l’imaginaire incarné ». Et, comme celles des jazzmen, on voit passer tout près les silhouettes des romans de jadis, La couleur orange, Le plaisir des sens, Le faubourg des coups-de-trique, Une sorte de bleu…
Plutôt que de gloser, le commentateur ne rêve que de céder la place au soliste, pour quelques chorus bien sentis :
« Il est faux que l’on naisse mortel / on le devient seulement après quelques années ».
« Il y aura dès lors / un temps pour écrire / un temps pour voir le monde / comme si c’était un roman / qu’on lit en se déchiffrant soi-même ».
« Sur son propre compte / l’existence nous en dit plus dans ses parenthèses / et notes anodines au bas de la page / que dans les périodes les tropes / sourates sorites et tapageurs épichérèmes /qu’elle nous jette au visage ».
« Le but ultime des voyages est / qu’en passant / la vie va vous frôler / au lieu de vous passer à travers ».
Le reste à l’avenant, au rythme des mots, de la lecture et de la vie.
Jean-Pierre Longre
13:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, poésie, musique, francophone, alain gerber, alter ego éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/05/2011
Les mystères de l’art et de la mort
 Denis Labayle, Rouge Majeur,éditions du Panama, 2008, rééd. Editions Dialogues, 2011. Prix des Lecteurs de Brive 2009
Denis Labayle, Rouge Majeur,éditions du Panama, 2008, rééd. Editions Dialogues, 2011. Prix des Lecteurs de Brive 2009
Pourquoi, en mai 1955, Nicolas de Staël, peintre de renom, riche et séduisant, se suicida-t-il en se jetant par la fenêtre de son atelier ? Cette mort prématurée est-elle due à des déboires sentimentaux, aux doutes de l’artiste, à un constat d’impuissance ? De cette énigme, Denis Labayle a fait un roman qui mêle fiction et exactitude historique.
Tout commence avec un concert en hommage à Anton Webern, dont le peintre sort enthousiasmé, quasiment envoûté, à tel point qu’il projette d’en faire une toile hors du commun : « J’ai déjà peint des instruments de musique, mais là je sens naître en moi un projet fantastique : je veux peindre une impression… Oui, c’est cela, une impression musicale. Ce sera beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus difficile ». C’est ainsi qu’il propose au narrateur, un journaliste américain venu tout simplement enquêter sur sa vie et sa relation avec les femmes, de le suivre à Antibes et d’assister à la naissance de sa nouvelle œuvre – tâche à la fois fascinante et rude pour cet ancien combattant, resté handicapé à la suite du débarquement en Normandie. C’est ainsi, encore, qu’à l’existence tourmentée de Nicolas de Staël se mêle celle de son éphémère compagnon, pris par sa propre quête et ses propres réflexions.
La narration romanesque ne cache pas l’essentiel : l’art. Elle tente même de représenter les attitudes et les gestes du peintre en plein travail. Mais comment les mots peuvent-ils traduire « l’alchimie de l’art » ? Comment peuvent-ils « entrer, par effraction, au cœur du mystère » ? Entreprise au moins aussi audacieuse, aussi utopique que celle du peintre voulant matérialiser « l’éclair créateur » produit par la musique : « Je guette sans cesse l’émotion qui m’a saisi lors du concert de Webern, et je me demande si je vais l’éprouver à nouveau. Cette attente me désespère […]. Ah ! je m’en veux de ne pas maîtriser assez mon art ». Du désespoir naît pourtant l’œuvre où domine le rouge, couleur fascinante et terrifiante, la « symphonie majeure » en « rouge immense ».
Jean-Pierre Longre
15:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas de staël, denis labayle, éditions dialogues, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2011
Odyssées urbaines
 Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
« Ma chronique eut, je dois le dire en toute modestie, un certain succès. Elle dura plus de deux ans ; à raison de trois questions pas jour, cela en fit plus de deux mille que je posai au lecteur bénévole », écrit Queneau dans un article daté de 1955 et reproduit en tête de volume. Cette chronique, donc, parut quotidiennement dans L’Intransigeant du 23 novembre 1936 au 26 octobre 1938. Le livre publié par Odile Cortinovis et Emmanuël Souchier ne reproduit pas les 2102 questions–réponses, mais 456, selon un choix raisonné (c’est-à-dire en fonction des réponses qu’on peut leur apporter encore actuellement).
Quelques exemples ? « Qui était le Père Lachaise ? » ; « Quel est le plus ancien square de Paris ? » ; « Combien y a-t-il d’arcs de triomphe à Paris ? » ; « Quelle est la première voie parisienne qui fut pourvue de trottoirs ? » ; « Quel rapport existe-t-il entre l’église Saint-Séverin et la république d’Haïti ? » ; « Depuis quelle époque les bouquinistes sont-ils établis sur les quais ? » ; « De quand datent les premiers tramways à Paris ? » ; « Combien y avait-il d’édifices religieux à Paris en 1789 ? »… On trouvera les 448 autres questions et toutes les réponses en lisant Connaissez-vous Paris ?
Au-delà de l’encyclopédisme, il y a une vraie philosophie de la promenade urbaine (des « antiopées, ou déambulations citadines », comme le rappelle et l’explique Emmanuël Souchier) et un sens aigu de l’histoire, marques indélébiles de la vie et de la pensée de Queneau. Et, sans en avoir l’air, le goût des voyages : « Je me disais : comme c’est curieux, il me semble que j’ai fait un long… très long… voyage. J’avais visité Paris ». Nous aussi.
Jean-Pierre Longre
18:41 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, francophone, raymond queneau, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2011
Aux jeunes écrivains, définitivement
 Jean Prévost, Traité du débutant, préface de Jérôme Garcin, Joseph K., « métamorphoses », 2011
Jean Prévost, Traité du débutant, préface de Jérôme Garcin, Joseph K., « métamorphoses », 2011
En douze brefs chapitres, Jean Prévost développe, à l’intention des jeunes gens qui s’apprêtent à écrire, tout, absolument tout ce qui leur est nécessaire, méthodiquement, vigoureusement. En 1929, à 28 ans, il se pose en maître qui, s’appuyant sur une expérience déjà riche (Jérôme Garcin, qui le connaît parfaitement, le rappelle dans sa préface), parle de la « vocation », de la « carrière », des « milieux » et du « travail » littéraires, de la parution du premier livre avec ce qui s’ensuit, du public et du succès éventuel, des attentes matérielles (« avancement », droits d’auteur)… De toutes les préoccupations, donc, de l’écrivain débutant.
Ces conseils, d’ordre pratique au moins autant qu’intellectuel, s’assortissent de jugements bien sentis, sans concessions, sur le monde littéraire – ce qui, de la part de Jean Prévost, n’est pas pour étonner. Les critiques (dont il était) : « À part deux ou trois exceptions dont vous connaissez les noms aussi bien que moi, les critiques n’ont aucune espèce d’influence : on les soupçonne toujours de camaraderie quand ils sont favorables ou défavorables, car le reste du temps, de peur de se tromper, ils n’ont même pas d’avis » ; le public (dont nous sommes tous) : « Je fixe donc le public des vrais lettrés à cinq ou six cents, […] et à cinq ou six mille le nombre des êtres falots et utiles qui agissent comme s’ils étaient lettrés, et acceptent le bon goût en confection » ; les auteurs (dont il reconnaissait volontiers, en connaissance de cause, qu’ils ne peuvent vivre de leurs droits) : « La plus vive des passions des littérateurs n’est ni la jalousie ni même la vanité : c’est la paresse » ; mais aussi : « La plupart des gens de lettres, en dehors de leurs œuvres, sont assez apathiques – ou bien bons critiques d’eux-mêmes – oui bien assez sages pour rire de qui les déteste » ; le travail d’écriture : « [Notre écrivain] ajoutera ce qui se peut ajouter : de la concision, et c’est bien ; des épithètes, et c’est mal. Le plus souvent des métaphores, où l’on semble croire, depuis cinquante ans, que consiste l’essentiel du style. Cela donne des Salammbô » (impitoyablement, Jean Prévost, c’est Stendhal contre Flaubert).
Jugements bien sentis, disais-je, jamais gratuits cependant. En un style impeccable (en guise de travaux pratiques), ils servent la cause de la littérature, sans vanité, sans illusions. Le « portrait imaginaire » qui clôt l’ouvrage met en avant la modestie du métier d’écrivain, son côté artisanal, se développant au cours d’une vie ordinaire où se cultive le plaisir plutôt que l’ambition. Ce traité, vieux de plus de quatre-vingts ans, est d’une étonnante modernité, d’un didactisme toujours actuel, d’une jeunesse définitive.
Jean-Pierre Longre
En savoir un peu plus sur Jean Prévost :
http://www.gallimard.fr/Folio/livre.action?codeProd=A41017
http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/jean-prevost-aux-avant-postes
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/04/23/la-noblesse-des-parvenus.html
09:54 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, jean prévost, jérôme garcin, éditions joseph k., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/05/2011
Les éditions Galimatias
Une nouvelle maison d’édition franco-roumaine, indépendante et généraliste : GALIMATIAS (www.editions-galimatias.fr)
"Les livres que nous accompagnons ne sont pas configurés selon les standards du marché. Notre projet est en décalage, conformément à notre devise « le galimatias est voisin de la pompe ». Le plaisir de lecture, la fraîcheur et l’amour des formes nouvelles sont, entre autres, des critères qui nous guident dans nos choix éditoriaux. Alternative, notre offre croit dans la qualité de l’écriture et l’intelligence des lecteurs".
Deux collections :
 Galimatias noir. Premier ouvrage publié : La fièvre des corps célestes, de Carmen Duca. Ami est secrétaire dans une agence de détectives privés…Une enquête « longue distance » parsemée d’épices et de retournements, avec des incursions dans Bologne et Miami, dont la morale est quelque peu cosmogonique : les planètes n’abandonnent jamais la partie.
Galimatias noir. Premier ouvrage publié : La fièvre des corps célestes, de Carmen Duca. Ami est secrétaire dans une agence de détectives privés…Une enquête « longue distance » parsemée d’épices et de retournements, avec des incursions dans Bologne et Miami, dont la morale est quelque peu cosmogonique : les planètes n’abandonnent jamais la partie.
Galimatias gris. Premier ouvrage : voir ici
15:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éditions galimatias | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Du fond des insomnies
 Radu Bata, Mines de petits riens sur un lit à baldaquin, Éditions Galimatias, 2011.
Radu Bata, Mines de petits riens sur un lit à baldaquin, Éditions Galimatias, 2011.
À paraître en mai 2011
Voilà de « petits riens » qui disent beaucoup, venus comme par la grâce du rêve, comme saisis en plein sommeil, en réalité vus, revus, travaillés, retravaillés dans un style qui ne doit rien au hasard. Le nom de l’éditeur, d’ailleurs, s’il cède au plaisir de la parodie, évoque par antiphrase l’amour d’une langue acquise tendrement et obstinément, avec laquelle on peut se permettre de jouer sans lui manquer de respect – comme en témoignent la dédicace et plusieurs mentions contenues dans le recueil.
Le recueil ? Comment nommer autrement un ouvrage aux genres aussi divers que les sujets abordés – même si tous sont attachés par les liens du sommeil et des images qui le peuplent, ce sommeil qui fait l’objet d’autant de définitions que, devine-t-on, de nuits passées à l’élucider, comme on passe sa vie à tenter de percer le mystère de la mort. Genres divers : journal nocturne, souvenirs fantasmés, essai cioranesque, conte merveilleux, nouvelle fantastique, fable morale, récit de rêve, jeu verbal, poésie versifiée, prose introspective, traduction… Le tout assorti d’un goût avéré pour les définitions, les inventaires, les listes, dans une tentative d’épuisement des significations : non seulement celles du grand sommeil noir et de ses accessoires, mais aussi celles de l’insomnie, d’où tout provient.
La diversité générique s’assortit, comme on peut s’y attendre, d’une pluralité thématique. Surgissant des profondeurs de la vie nocturne, viennent nous faire signe, çà et là, un ange gardien, le vin vivant sa vie multiple, de beaux hommages (à Ben Corlaciu, écrivain, ami de la famille, à Enrique Vila-Matas…), des bribes d’existence quotidienne, et bien sûr de nombreuses résonances autobiographiques, où l’enfance, la Roumanie, « l’exil permanent » prennent une place discrète et émouvante. Résonances autobiographiques et, dirons-nous, autolinguistiques. Car le changement de langue, le « troc linguistique » est au cœur des textes. « Hormis quelques moments d’enchantement, le passage dans une autre langue est un exercice douloureux ».
Ce « journal de bord judicieusement déraisonnable » met en scène un « amour immodéré pour les mots » que Radu Bata fait abondamment partager à son lecteur. Vu de l’entre-deux-langues, le français se prête à la redécouverte, à la mise en perspective, aux effets d’assonances et d’allitérations, à l’« orage lexical », aux détournements, aux variations sémantiques et typographiques, dans une jubilation qu’entache à peine la désagrégation finale. Et le renouvellement de la langue s’assortit d’une intertextualité tout azimut : l’écriture est celle d’un grand lecteur, qui ne se prive pas de glisser la littérature universelle entre les lignes de son invention : allusions, citations, références, démarquage, parodie voire satire, tout y passe et beaucoup, sûrement, nous échappe.
Radu Bata, dont les publications précédentes (Fausse couche d’ozone, Le rêve d’étain) avaient déjà réjoui un public choisi, propose ici une réflexion en forme de puzzle, dans laquelle se livrent combat le pessimisme et la joie de vivre, la résignation et l’espoir, le cauchemar et l’utopie, le sommeil et la veille. Au bout du compte, le gagnant est le langage, cet « idiome intérieur » que l’auteur, généreusement, laisse à notre disposition.
Jean-Pierre Longre
15:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, récit, poésie, aphorisme, francophone, roumanie, radu bata, éditions galimatias, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/05/2011
Trois "Queneau" en quelques semaines...
Trois livres, rien de moins, sur (ou autour de) Queneau. Qu’on en juge ci-dessous… Et il y en a encore, tel Connaissez-vous Paris? (Folio / Gallimard), choix de question que l'auteur a posées, entre novembre 1936 et octobre 1938, aux lecteurs du quotidien L’Intransigeant...
15:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
La contagion Queneau
 Jean-Pierre Martin, Queneau losophe, Gallimard, « L’un et l’autre », 2011
Jean-Pierre Martin, Queneau losophe, Gallimard, « L’un et l’autre », 2011
Quel présomptueux, ce Jean-Pierre Martin ! se dit-on. Le voilà qui, non content de publier trois livres quasiment en même temps*, se targue d’avoir été élu « meilleur lecteur de son œuvre » par Queneau lui-même, d’avoir entretenu avec lui une correspondance anthume et posthume aussi abondante qu’intime, d’être en quelque sorte le filleul du maître – que dis-je, le filleul : son égal, son conseiller, « sa chance » même ! Autant dire que sans Martin, Queneau n’existerait pas… Bon, tout ça, c’est pour de rire. Un peu. C’est en tout cas pour dire combien le lecteur se sent en phase avec un auteur qu’il admire depuis belle lurette.
Qu’il admire et qu’il comprend, autant qu’on puisse comprendre ce qui se trame derrière l’apparente fantaisie et la multiplicité des facettes qu’avec la discrétion qui le caractérise l’ami Raymond présente à ses observateurs. De même que Jean-Pierre Martin cache sous un ton plaisant une rigoureuse analyse de la « pensée » quenienne, de même Raymond Queneau cache sous le rire communicatif, la myopie sympathique et l’ironique légèreté de ses personnages une gravité tenant à la fois à la réalité de la souffrance et à la profondeur de la réflexion. Il y a bien une « correspondance » entre les deux auteurs, mais une correspondance qui dépasse la fiction des lettres échangées pour atteindre les secrets que recèle le travail littéraire.
Là, il faut bien en venir à la « losophie », qui est, disons, « la philosophie corrigée par le rire, le burlesque, le quotidien et le principe de relativité », ou encore ce qui « emprunte les formes de la littérature pour donner voix à une nébuleuse de pensées et de méditations qui n’ont place dans aucun système » (car, tout de même, « ça ne rigole pas toujours, la losophie »). Bref, pour plus de précisions sur ce concept, on lira avec profit le chapitre intitulé « Morceaux de losophie », sorte de petite anthologie mettant en bonne place quelques œuvres choisies comme Gueule de Pierre, Le Chiendent ou Les Derniers Jours. C’est cela : revenons-en toujours à l’écriture, à la langue, aux textes ; il nous est donné là une belle occasion de relire ceux-ci avec un regard renouvelé.
En mettant l’accent sur les relations intimes qu’il entretient avec Raymond Queneau, Jean-Pierre Martin procure un plaisir contagieux, tout en définissant mine de rien mais sérieusement les tendances (phi)losophiques de l’écrivain, et en livrant une vraie biographie littéraire et orientée de celui avec qui il rêve de faire du tandem sur la côte normande et à qui il n’hésite pas à dire : « Vous avez joué vos tripes tout en laissant tomber la musique guimauve, ce pourquoi on ne vous a pas toujours compris ».
Jean-Pierre Longre
* Outre Queneau losophe : Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2011 (voir ici) ; Les écrivains face à la doxa, essai sur le génie hérétique de la littérature, Éditions José Corti, 2011 (voir là).
15:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, raymond queneau, jean-pierre martin, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Accueillir la désillusion
 Dominique Charnay, Cher Monsieur Queneau. Dans l’antichambre des recalés de l’écriture. Préface de Pierre Bergounioux, Denoël, 2011
Dominique Charnay, Cher Monsieur Queneau. Dans l’antichambre des recalés de l’écriture. Préface de Pierre Bergounioux, Denoël, 2011
De 1938 à 1974, Raymond Queneau écrivit abondamment, publia beaucoup, exerça maintes activités liées en général à la littérature, et lut pour les éditions Gallimard une quantité phénoménale de manuscrits, en tant que « chef du comité de lecture ». Énorme travail, qui impliquait de rédiger des fiches, de prendre des décisions, donc – opération délicate – de « recaler » la plupart des candidats au métier d’écrivain tout en laissant leur chance à ceux qui paraissaient appartenir « à la communauté des autres écrivains », comme Marguerite Duras, Hélène Bessette, Boris Vian, J.-M. G. Le Clézio, Claude Simon… Au long de ces années, Queneau s’acquitta avec conscience, scrupules, lucidité et humanité de sa tâche ardue.
Le recueil présenté par Dominique Charnay et subtilement préfacé par un Pierre Bergounioux mettant en avant, particulièrement, l’aptitude de Queneau à susciter « les confidences de ceux qui, à tort ou à raison, se sentent habilités à écrire », ce recueil, donc, est un florilège des lettres de ces derniers, soigneusement conservées par leur destinataire. En les lisant, on comprend pourquoi : pittoresques, attendrissantes, naïves, provocantes, ironiques, désespérées, humoristiques, furieuses, poétiques, modestes, orgueilleuses, incompréhensibles, flagorneuses, menaçantes, elles sont le reflet de tous les tempéraments, elles témoignent de toutes les réactions imaginables et inimaginables des déçus de la création, ou de leurs porte-parole – car certains écrivent même en lieu et place de leurs père, fils, neveu, épouse… Il y a ceux qui s’humilient honteusement, ceux qui exercent le chantage affectif, ceux qui, pathétiquement, tentent de plaire en imitant la manière de leur destinataire, ceux qui, non moins pathétiquement, de la jouent stylistes détachés ou poètes maudits… Mais constamment, dans ces adresses au « maître », à « Monsieur Queneau », à « Monsieur », on devine une confiance accordée à la « franchise » du lecteur qui prend ses responsabilités, et dont la réputation de sérieux et de « bonté » provoque parfois de véritables confessions ; il n’est pas indifférent non plus que Queneau soit un écrivain reconnu, apprécié, comme le sont les autres lecteurs de la maison Gallimard, la distance humoristique en plus : le ton de ces missives s’en ressent, parfois avec une certaine réussite.
Ce livre n’est pas du Queneau, mais il n’aurait évidemment pas existé sans Queneau – le lecteur professionnel, et aussi l’écrivain, l’artisan qui sait reconnaître ses pairs et accueillir la désillusion avec un sourire compréhensif.
Jean-Pierre Longre
P.S. : Un sommet humoristique est gravi par la société Picon, dont une lettre reproduite en annexe commence ainsi :
« Monsieur,
Nous avons appris avec grand plaisir que pour l’Apéritif vous donniez volontiers votre préférence à l’AMER PICON (Cf/ CANDIDE du 16 NOVEMBRE).
Dès lors, voulez-vous nous permettre de vous offrir gracieusement 6 Bouteilles, que nous ferons déposer, à votre nom, aux Editions GALLIMARD, pour vous remercier du témoignage de fidélité que vous donnez à notre Marque ».
15:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : correspondance, francophone, raymond queneau, dominique charnay, pierre bergounioux, éditions denoël, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Mieux vaut rire ?
 François Naudin, Les terreurs de Raymond Queneau, Essai sur les 12 travaux d’Hercule, Calliopées, 2011
François Naudin, Les terreurs de Raymond Queneau, Essai sur les 12 travaux d’Hercule, Calliopées, 2011
« Plus Queneau entend rire et faire rire, plus redoutables sont les éléments que ce rire entreprend d’escamoter ». Voilà le théorème qui conduit François Naudin à s’interroger, en prenant principalement comme points d’appui le poème « Je crains pas ça tellment » et le texte « Une trouille verte », mais aussi en observant plus généralement et très précisément l’œuvre entière.
Les terreurs de Raymond Queneau est un livre à la fois savant et personnel, parfois désespéré – forcément, vu le sujet – mais pas toujours. Dans sa teneur et dans sa forme, il dénote une parfaite connaissance des écrits, et même de ce que l’on peut savoir de l’homme Queneau, de sa vie, de ses préoccupations, de ses lectures. En même temps, il témoigne d’une relation intime, voire secrète, avec le monde quenien.
François Naudin veut être clair, mettant en œuvre une sorte de didactisme qui conduit le développement. Mais il n’oublie pas le sourire, par exemple dans les titres du genre « Le pot de fleurs et le manque de pot » ou « Notre père qui êtes absent ». Ce qui ne l’empêche pas d’examiner, très sérieusement, le rôle joué par la lecture dans la lutte contre la culpabilité et, en regard, la transposition de l’anxiété dans la création artistique, d’émettre l’idée d’une écriture comme art de la duplicité, de la dissimulation ou de prendre position sur ce que certains appellent les « crises mystiques » de l’auteur, en parlant plutôt de « crises spirituelles, à la rigueur »…
Terreurs de l’homme Queneau, terreurs de l’auteur Queneau, terreurs de ses personnages, tout cela à la fois ? Les questions ont le mérite d’apparaître au grand jour, montrant que rien n’est simple chez lui, même si tout se lit avec plaisir. Il faut aller voir au fond des choses, sans arrière pensée, sans a priori, et c’est ce que fait avec beaucoup d’à-propos et de finesse François Naudin.
Jean-Pierre Longre
15:37 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, raymond queneau, françois naudin, editions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2011
Géraldine Bouvier, le retour
 Marc Villemain, Le pourceau, le diable et la putain, Quidam éditeur, 2011
Marc Villemain, Le pourceau, le diable et la putain, Quidam éditeur, 2011
Elle était là dans Et que morts s’ensuivent, elle revient ici, au chevet du narrateur, un octogénaire grabataire qui, à la merci de sa « vipère aux yeux de jade », ne semble se faire d’illusions ni sur cette infirmière « dotée d’un tempérament qui ferait passer l’incendiaire intransigeance de Néron pour une contrariété de mioche privé de chocolatine », ni sur son propre passé de misanthrope sarcastique et invétéré, ni sur le genre humain, ni sur « l’existence profondément débile de son pourceau de fils ».
On l’aura compris, Marc Villemain laisse s’épanouir, dans son nouveau livre, l’humour (noir à souhait) et la satire (cynique à volonté). Les pages sur le monde universitaire, par exemple, que « Monsieur Léandre » a visiblement bien connu, sont un bel échantillon de réalisme critique – et la verve acérée du vieillard (enfin, de l’auteur) n’épargne pas non plus la famille, les enfants, l’école, les femmes, les malades, la société en général, disons l’univers dans son ensemble…
Il n’est pas innocent que le livre s’ouvre et se ferme sur l’image du cloporte, qui elle-même (pré)figure celle de la mort ; et Géraldine Bouvier, silhouette attirante et obsédante à la fois, n’en finit pas d’allonger son ombre diabolique d’un bout à l’autre du récit.
Jean-Pierre Longre
15:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marc villemain, quidam éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/04/2011
« Tout n’est pas perdu »
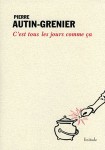 Pierre Autin-Grenier, C’est tous les jours comme ça, Finitude, 2010. Grand prix de l'humour noir 2011
Pierre Autin-Grenier, C’est tous les jours comme ça, Finitude, 2010. Grand prix de l'humour noir 2011
Le temps, laissé à lui-même, s’écoule à son propre rythme, parfois plus lentement que prévu, ce qui permet à Anthelme Bonnard, observateur familier, étonné, révolté de la vie quotidienne, de se dire : « Je continuerai donc à étourdir mes vieux jours à la fabrication de ma dentelle à la main […] pour la beauté du geste, aussi pour m’occuper l’esprit et tenter de me soustraire, autant que faire se peut, à la turbulente inquiétude du lendemain ». Et cela pour « une petite poignée de fidèles ».
Soyons heureux d’en faire partie, tels les « happy few » de Stendhal ! Et ainsi de pouvoir lire C’est tous les jours comme ça, un livre plein de petites chroniques comme il y en a dans Une histoire (Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée, L’éternité est inutile), trilogie parue entre 1996 et 2002 chez Gallimard (L’Arpenteur) – faut-il le rappeler ? Les brefs récits de Pierre Autin-Grenier (ou Anthelme Bonnard), donc, se situent dans la continuité, mais tout est relatif : le ton est parfois plus acerbe, le contexte souvent plus mouvementé, l’engagement plus marqué. Le décor est un beau pastel de la vie quotidienne locale (lyonnaise, en l’occurrence), entre Croix-Rousse et Guillotière, une vie de voisinage, où les bistrots et les petits commerces sont des repères familiers, une vie de solitude où, parfois, il ne se passe rien d’exceptionnel… Mais une vie sans cesse menacée par les excès de la répression policière, par les soupçons pesants dignes de la Stasi ou de la Securitate, par la violence qu’engendre une situation politique portant, tapis au fond d’elle, les signes de la dictature et du totalitarisme.
Nous assistons, dans ce qu’il faut tout de même appeler des fictions, à un incessant combat entre la tranquille vie de quartier et la brutalité de la société, entre la chaleur des relations humaines et l’aveuglement glacial des institutions nationales. Cela nous vaut des fables morales et sociales, des relations sanglantes et des versions fantastiques de faits divers, des passages kafkaïens, des pages épiques (comme celle qui décrit un pauvre cortège funèbre devenant « considérable rassemblement » et presque « grand chambardement »).
Ce pourrait être noir, déprimant, désespérant… Ce serait sans compter avec l’écriture jubilatoire de Pierre Autin-Grenier, son goût pour l’humour bien entendu, son art de la phrase ciselée, son sens du mot juste et de l’image marquante, la musique de sa prose. Il n’est d’ailleurs pas anodin de remarquer que les deux derniers textes s’intitulent respectivement « Jazzman » et « Musique ». Tant que l’on peut encore écrire, lire, jouer, chanter, écouter, savourer, il y a de l’espoir. « Tout n’est donc pas perdu, je me dis, et d’une certaine façon, avec cette envolée de notes dans la rue, c’est le combat vers la légèreté et la lumière qui continue ».
Jean-Pierre Longre
16:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelle, francophone, anthelme bonnard, pierre autin-grenier, finitude, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2011
Littérature en vert
 Le persil journal, Lausanne
Le persil journal, Lausanne
Marius Daniel Popescu, poète du quotidien réel et imaginaire, de l’évidence et du non-dit, du passé roumain, du présent suisse, chauffeur de bus (mais « on n’a pas besoin d’être chauffeur de bus pour aimer les gens qui prennent le bus »), auteur du recueil Arrêts déplacés (Antipodes, Lausanne, 2004) et du roman La symphonie du loup (José Corti, 2007), publie depuis plusieurs années ce journal au drôle de titre, édité en Suisse, où réside son créateur.
Poèmes et autres textes s’y glissent discrètement, s’y étalent orgueilleusement, s’y côtoient, s’y répondent avec, depuis un certain temps, une nouveauté de taille : le rédacteur en chef n’en est plus l’unique signataire ; ses pages sont généreusement prêtées à d’autres, Suisses ou Français, jeunes ou vieux, célèbres ou méconnus, qui les ouvrent sur des paysages multiples et divers. Le numéro 38 de février 2011, par exemple, donne carte blanche à Olivier Sillig, romancier, peintre, réalisateur, qui lui-même offre une bonne place à des textes de Daisy Nachevez et Daisy Neddi… Dans un terreau fertile, Le persil prospère en branches multiples, en bouquets serrés, « à la fois parole et silence ».
Jean-Pierre Longre
Le persil journal, Marius Daniel Popescu, avenue de Floréal 16, 1008 Prilly, Suisse.
Tél. 0041.21.626.18.79. E-mail : mdpecrivain@yahoo.fr
Association ses Amis du journal Le persil : lepersil@hotmail.com
Pour rappel :
La symphonie du loup : http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/08/04/hurlement-de-la-vie-epuisement-du-langage.html
Arrêts déplacés : http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/03/16/transports-en-commun-poetiques.html
15:13 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, poésie, suisse, roumanie, marius daniel popescu, olivier stillig, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/03/2011
« Traces écrites de poésie »
 Jean-Michel Espitallier, Pièces détachées, Une anthologie de la poésie française aujourd’hui, édition revue et corrigée par l’auteur, Pocket, collection Agora, 2011
Jean-Michel Espitallier, Pièces détachées, Une anthologie de la poésie française aujourd’hui, édition revue et corrigée par l’auteur, Pocket, collection Agora, 2011
« En déplacement » : tel est le titre que Jean-Michel Espitallier donne à la préface de cette nouvelle édition de son anthologie, inchangée dans son contenu depuis 2000. Déplacement temporel, culturel (comment parler de « poésie contemporaine » à l’époque de « l’avachissement des consciences », du « génie de la bêtise » ?), définitionnel même. Peut-on, faut-il classifier ? Qu’est-ce que la poésie, a fortiori la « poésiecontemporaine » … ? Ces textes gardent une « force intacte », déstabilisatrice, ils nous permettent de « respirer hors de l’étouffement médiocratique », et l’auteur préfère maintenant parler à leur propos de « poésie écrite, ou de traces écrites de poésie ». Suivons-le derechef, et pour ce faire réitérons (en partie) ce que nous en disions il y a dix ans.
Une heureuse initiative, dans un contexte qui donne à réfléchir : la poésie, après la disparition des « grands » du siècle et la déprime qui a suivi, fait aujourd’hui l’objet d’un renouveau, de manifestations publiques bien fréquentées (« Le printemps des poètes », si menacé maintenant (note de 2011)), de représentations sonores et collectives … Il fallait faire une sorte de point, et Jean-Michel Espitallier s’y est employé avec beaucoup de soin, en traçant un chemin personnel mais suffisamment large dans le maquis des textes et des auteurs.
Voilà un bon livre, qui a de nombreux mérites, à commencer par celui de son existence. Publié pour tous, dans une collection de poche, maniable et abordable, il témoigne de la diversité et de la richesse de la poésie récente. De Bernard Heidsieck, emblème de la poésie « action », au langage poétique-théâtral de Valère Novarina, 33 auteurs, auxquels J.-M. Espitallier laisse le plus possible le soin de se présenter, déclinent des échantillons de leurs textes, et leur liste à elle seule est tout un poème, comme le rappellent les « lettres d’effigie » de Jude Stéfan. On rencontre dans cette liste, avec un plaisir renouvelé, les figures de Ghérasim Luca, Jean-Luc Parant, Jacques Roubaud, Jean-Marie Gleize, et l’on fait des connaissances, ou des reconnaissances dans la jungle d’une mémoire encombrée de fatras médiatique et de patrimoine officiel.
Jean-Michel Espitallier a couru le risque d’une entreprise forcément partielle et subjective, et son itinéraire poétique est à la fois séduisant et didactique ; il est à mettre entre les mains, sous les pas de tous ceux qui, connaisseurs ou non, se posent la question : où en suis-je avec la lecture poétique?, et qui veulent poursuivre le chemin entamé par cette « cartographie d’un coin de ciel », ce « Meccano multicolore en construction ». Disons aussi, crions-le : poètes, ne décevez pas le lecteur qui veut poursuivre ce chemin, ne le laissez pas dépérir, ravitaillez-le en cours de route !
Jean-Pierre Longre
19:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anthologie, francophone, jean-michel espitallier, pockett, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/02/2011
Marseille-Bruxelles, « espace insulaire »
 Jean-Pierre Martin, Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2010
Jean-Pierre Martin, Les liaisons ferroviaires, Éditions Champ Vallon, 2010
Connaissez-vous le théorème de Montgolfier ? Alors voici : « Plus une rencontre entre deux êtres humains apparaît comme tributaire du hasard, plus elle se délivre par là même de toute contingence ». Et savez-vous qui est ce Montgolfier ? Un « ethnologue du proche », qui – pour faire court – étudie le comportement sexuel des animaux, en particulier des humains, et dans ce but additionne les trajets ferroviaires entre Marseille et Bruxelles. Un personnage observateur, à la fois dans le récit et en dehors, voix in et voix off, tel qu’on en trouve dans certains romans de Queneau (dont on devinerait, si l’on ne le savait déjà, que Jean-Pierre Martin est un fervent lecteur). Un autre se trouve dans une situation similaire : « L’écrivain », qui est « en train d’écrire un roman sur la séduction, […] ou encore, d’une certaine façon, sur l’amour », et qui dévoile volontiers la genèse de ses oeuvres : « J’aime sonder le mystère des êtres qui passent et qui se croisent, s’aperçoivent, s’évitent, se renfrognent ou s’ouvrent les uns aux autres, se racontant leur vie le temps d’un voyage ».
Outre ces deux-là, qui donnent une sorte d’assise comportementaliste et littéraire au récit, il y a dans la voiture 16 du TGV 9864 Nice-Bruxelles beaucoup d’autres personnages dont on ne va pas établir la liste ici. Hommes et femmes, jeunes et vieux, beaux et laids, sûrs d’eux et timides, séducteurs et maussades, ce petit monde représentatif, disons, de la société européenne occidentale de la première décennie du XXIe siècle, échange et détourne des regards, monologue, bredouille des paroles, esquisse et esquive des gestes, ébauche des relations, amorce des aventures, comme dans « un espace insulaire, à l’abri des invasions du monde », dans une parenthèse de liberté qui se refermera à l’ouverture des portes. Plusieurs romans restent ainsi en suspens, tel celui d’Enzo le musicien avec Rachel la prof de fac, ou celui de Laurence Fischer la psychanalyste avec le contrôleur qui ressemble à Lambert Wilson, et cela se tisse au rythme d’Alice, le train en personne, qui n’hésite pas à s’exprimer en mots humains, et dont les vibrations, selon leur intensité, règlent le débit de la parole des passagers, attisent ou atténuent leurs désirs ; au rythme, aussi, des annonces originales et lettrées de Wassim l’employé du wagon-bar… De ce huis clos à grande vitesse, de ces intrigues sans dénouement, de cet enfermement libérateur, on ne sort pas inchangé ; et, paradoxalement, on tente provisoirement de s’en échapper, à l’occasion, par le téléphone (qui dérange les autres), la poésie plus ou moins bien accueillie de Wassim, les souvenirs plus ou moins nostalgiques, les anticipations plus ou moins réalistes, les rêves plus ou moins érotiques… et par l’humour. Car il faut le reconnaître : l’observation du genre humain est, ici, un plaisir ; n’en déplaise à l’écrivain (« Ne riez pas », ordonne-t-il), il nous amuse (et il s’amuse) avec son sujet sérieux ; son style alerte, vibrionnant, n’y est pas pour rien.
Hasard des lectures ? Signes d’une époque ? Air du temps ? Au cours des derniers mois, j’ai lu plusieurs romans récents prenant pour cadre ou pour centre de gravité les transports collectifs, lieux d’observation et d’introspection (sans parler de tout ce que le métro a produit). Certains, comme Apaiser la poussière de Tabish Kair (éditions du Sonneur) ou La croisade des enfants de Florina Ilis (éditions des Syrtes) sont remarquables, chacun dans sa forme et sa portée. J’y ajoute volontiers Les liaisons ferroviaires.
Jean-Pierre Longre
http://www.jeanpierremartin.net
Et un peu de publicité pour des romans ferroviaires ou routiers :
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/01/02/le-train-de-la-memoire.html
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/10/20/nouveaute-aux-editions-du-sonneur.html)
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/05/20/le-pouvoir-de-l-innocence.html
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/02/24/meurtres-sur-la-voie-ferree.html
11:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-pierre martin, Éditions champ vallon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/02/2011
Émotions à demi traits
 Myriam Gallot, Les cœurs suspendus, dessins de Jean-Philippe Bretin, Éditions Noviny44, 2010
Myriam Gallot, Les cœurs suspendus, dessins de Jean-Philippe Bretin, Éditions Noviny44, 2010
Qu’ont-ils d’exceptionnel, les personnages qui parcourent les quinze récits de Myriam Gallot ? Au premier abord, pas grand-chose : trois copines courant les lotos de village, des agriculteurs en faillite, un jeune chauffard emprisonné, un clochard embauché comme Père Noël, un vendeur ambulant, une jeune femme en quête de logement, un professeur de maths en rupture, un conducteur de limousine… Des gens ordinaires, de condition plutôt modeste – mis à part l’épouse d’un homme d’État avide de pouvoir et de richesse et un chien de luxe… En vérité, tous, y compris la femme privilégiée, ont en commun la solitude, une solitude qu’ils contiennent en eux-mêmes ou que le monde et les aléas de la vie leur imposent.
Les petits et grands malheurs, communs et particuliers, se dévoilent sans pathos, avec tendresse et cruauté, dans un entre-deux qui attache intimement le lecteur aux personnages. Ceux-ci représentent la collectivité humaine, saisie ici et maintenant, et chacun d’entre eux est un être saisi dans son individualité, sa spécificité.
La prose est moderne, composée de mots et d’expressions d’aujourd’hui, de la parole même des protagonistes, et sa tournure précise, incisive, laisse toutefois de la marge pour un je-ne-sais-quoi d’évanescent qui laisse planer un mystère sur les émotions, les événements, les caractères, les destinées. La société n’est pas épargnée, la satire affleure, le cynisme se laisse deviner ; mais il y a toujours une sorte de pudeur, un délicat suspens des sentiments (voir le titre) qui n’empêchent pas l’exploration des profondeurs plus ou moins secrètes de l’âme humaine, chacune à sa mesure. Une exploration sans limites, puisque les dénouements, chute ou absence de chute, ne sont jamais des fins.
La réussite d’une nouvelle tient à l’art de l’unité, de la concision et de la mise en situation, une situation qui, relevant du réel (social, actuel, quotidien), passe par le tamis de la fiction. Les cœurs suspendus est, en l’occurrence, un vrai et beau recueil de nouvelles. Le style, l’esthétique littéraire y servent le social et l’humain, et inversement, selon le point de vue que l’on adopte. Ajoutons que les dessins de Jean-Philippe Bretin, noir et blanc ou couleurs vives, accompagnent les récits, en se gardant de les illustrer directement, de leurs éclats, de leurs méandres, de leurs taches, de leurs formes suggérées. Comme dans le texte, suggestions à demi traits dont le lecteur peut prolonger les effets à sa guise.
Jean-Pierre Longre
17:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, illustration, francophone, myriam gallot, jean-philippe bretin, noviny44, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Face à la laideur
 Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Il y a quatre personnages : le narrateur, Luna, Victor et la jeune pianiste. Ajoutons les Niçois et la musique pour parfaire le compte. Pour raconter l’histoire, « on se parle à soi-même. C’est comme ça que ça commence. C’est comme ça qu’on dégénère ».
Et c’est « comme ça » que le lecteur est embarqué dans ce monologue intérieur, pris dans le tourbillon du soliloque, dans les lacets de la mémoire, dans la spirale de la parole intérieure, dans le piège de l’imagination, dans la folie des fantasmes. Ce qui guide le narrateur, et qui en même temps l’enferme, c’est son exigence. Exigence musicale se préservant « des méfaits de la compromission et du renoncement », face à l’ami Victor qui est devenu une « oie » ; exigence morale face à la corruption de la société, en particulier celle de la ville de Nice, qui est « devenue abjecte » ; exigence esthétique qui lui permet d’entendre les sonates inventées par Luna et de les retranscrire purement et simplement…
Tout aurait pu être beau : Nice et « le jardin d’Alsace-Lorraine », la musique enseignée au conservatoire, la visite de « la jeune pianiste », les demoiselles, les relations avec les autres, ceux qui l’appellent Le Dégénéré. Mais tout, dans la tête du narrateur en proie à lui-même et au monde, est dégénérescence. « C’est à se prendre la tête dans les mains et à ne jamais se la lâcher ». Et tout, dans ses phrases, dit qu’il faudra bien que cela finisse un jour, d’une manière ou d’une autre, comme dans les romans de Marguerite Duras ou dans les tragédies de Racine. Le dégénéré met en mots désespérants l’impuissance devant la laideur du monde et de l’âme humaine. Cela donne un roman angoissant, révolté, sombre, beau.
Jean-Pierre Longre
17:34 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jérôme bonnetto, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Mortelle réalité
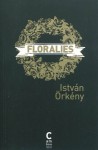 István Örkény, Floralies, traduit du hongrois par Jean-Michel Kalmbach, Cambourakis, 2010
István Örkény, Floralies, traduit du hongrois par Jean-Michel Kalmbach, Cambourakis, 2010
Les (a)mateurs des Loft story, Koh-Lanta et Îles de la tentation diverses supporteraient-ils de voir mourir sur leur écran des volontaires pour ce genre de télé-réalité ? Peut-être, puisque ça passerait à la télévision… C’est en tout cas ce que propose, bien avant l’invention de ce genre d’émission, et sous couvert d’une argumentation philosophico-humaniste un peu spécieuse, le héros du roman d’István Örkény (1912-1979), dont les livres méritent vraiment d’être connus.
Áron Korom, jeune réalisateur, frappe à différentes portes pour mener à bien son projet : montrer aux téléspectateurs « les dernières heures de trois malades incurables », dans la vérité de leur agonie. Il a trouvé trois personnes qui, contre rétribution (à leurs héritiers, bien sûr), acceptent de laisser filmer leurs derniers instants ; et au bout de ses démarches, ses supérieurs lui donnent l’autorisation de créer le documentaire Notre mort (titre qui, suprême ironie, sera changé en Floralies…). On s’en doute, tout ne va pas pour le mieux lors du tournage. En particulier, comment prévoir le moment précis du décès de chaque « acteur » ? Le premier a devancé l’appel, et c’est sa veuve qui raconte les derniers instants du personnage. Pour les deux autres, le film pourra se faire, mais au prix de compromis, d’anticipations, d’artifices, bref de l’hypocrisie télévisuelle que l’on connaît bien, mais qui, lorsque c’est la mort d’un humain qui est en jeu, paraît d’autant plus odieuse. Même s’« il suffit de vouloir fortement pour réussir », peut-on « pondre un infarctus conforme aux desideratas de la télévision » ?
Ce pourrait être morbide et dramatique, c’est plutôt vivace et cruel, satirique et drôle. Le traitement du sujet par l’absurde, le ton du récit, le découpage théâtral des scènes, l’allant des descriptions, le naturel des dialogues, tout cela fait de Floralies un exemple achevé de savoureux humour noir.
Jean-Pierre Longre
13:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, hongrie, istván Örkény, jean-michel kalmbach, cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« L’impromptu de Neuilly »
 Patrick Rambaud, Quatrième chronique du règne de Nicolas Ier, Grasset, 2011
Patrick Rambaud, Quatrième chronique du règne de Nicolas Ier, Grasset, 2011
Patrick Rambaud, romancier de talent (Prix Goncourt pour La bataille en 1997), s’y connaît aussi en Histoire récente et contemporaine, et a fait ses preuves en matière de parodie (rappelons, entre autres, ses pastiches de Roland Barthes ou de Marguerite Duras, et un savoureux Bernard Pivot reçoit… qui réunit et fait parler, chacun dans son style personnel, quelques grands écrivains du XXème siècle).
Tout cela pour dire qu’il n’est pas le premier venu, et qu’il était tout désigné pour être, à la manière de Saint-Simon, le chroniqueur de « Notre Nerveux Souverain », qui prête si bien le flanc à la moquerie et à la protestation, et qui toutefois en est à sa quatrième année de règne – ce qui nous vaut, pour nous divertir et nous remonter le moral le temps d’une lecture, le quatrième tome (été 2009 – été 2010) des aventures de celui qui est « désormais pour l’Histoire Nicolas le Névrosé », « à cause de son obsession inassouvie de la bougeotte ». Histoire individuelle, mais aussi histoire collective, comprenant le grouillement de ceux qui gravitent autour de « Notre Vibrionnant Monarque ». Voilà donc des portraits hauts en couleur, tels ceux du « comte Chatel, qui s’occupait des écoles de Sa Majesté », de M. le duc de Villepin, l’ennemi juré, de « Monsieur Fredo », nommé « marquis de Valois » pour régner sur la Culture, du « lieutenant criminel Besson », transfuge par excellence, du « chevalier d’Ouillet », sorte de colosse « fermement ancré dans la balourdise », de M. Raoult, « lieutenant général du Raincy », qui « servait deux maîtres, notre Phosphorescent Monarque et le tyran de Tunis, M. Ben Ali », et qui pensait que les écrivains obtenant le prix Goncourt ne devaient pas exprimer leurs opinions, de M. Woerth, « duc de Chantilly », de « la Grande Duchesse de Bettencourt »…
Il serait vain de rappeler tous les exploits accumulés en une année par Sa Majesté et ses courtisans, et relatés ici sur le mode satirique et néanmoins réaliste. L'art de Patrick Rambaud est de décrire les faits sans cacher ce qu’il en pense, de dénoncer les excès, les vanités, les incompétences, les mensonges et les ratages, le tout dans le style fleuri, métaphorique, ironique, pince-sans-rire et pour tout dire fort plaisant des prosateurs classiques. Il ne mâche pas ses mots, ne manque pas de dire leurs vérités aux puissants et aux riches qui nous gouvernent et de mettre au jour les injustices et les abus, mais il le fait toujours avec une élégance qui tranche furieusement sur les ânonnements de « Notre Bravache Souverain », avec un lexique choisi (les journaux sont les « gazettes », la télévision les « fenestrons », la Parti socialiste le « Parti Social » et l’UMP le « Parti Impérial », les autobus des « diligences » conduites par des « postillons » etc.) et un sens inégalable de la formule qui fait mouche (« Madame rentra tardivement du Bénin, où elle était allée regarder le sida »… Impayable et implacable « regarder »…).
Cette Quatrième chronique est dédiée, entre autres, « à M. Molière qui aurait écrit puis joué L’Impromptu de Neuilly, c’est-à-dire l’envers du décor ». Molière, La Bruyère, Saint-Simon, Voltaire… Patrick Rambaud a d’illustres maîtres, et sans conteste il en est digne.
Jean-Pierre Longre
10:15 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, francophone, patrick rambaud, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/02/2011
« Les taupes de Dieu »
 Horia Badescu, Parler silence, L’Arbre à paroles, 2010
Horia Badescu, Parler silence, L’Arbre à paroles, 2010
Parler silence comprend deux parties distinctes, « Les apocryphes du roi Salomon » et « Journal de souterrain ». Distinctes, mais pas si éloignées l’une de l’autre, ne serait-ce que par l’unité formelle des brefs textes en vers libre souvent sous-tendus par une dualité profonde. Ainsi, le recueil en un seul volume de ces deux ensembles poétiques n’est pas le fruit du hasard.
La dualité, c’est en fait celle de couples prenant leurs racines dans la thématique fondamentale de la vie et de la mort. Dès lors, ce peut être, dans la première partie, la complémentarité ou l’antagonisme corps/nature – le corps se nourrissant, tirant sa substance de la nature, ou celle-ci mettant en évidence l’impuissance de l’homme ; dans la deuxième partie la complémentarité ou l’antagonisme entre le haut et le bas, entre le monde des taupes et le jour céleste, entre la cécité du néant et l’attente d’un horizon. Et partout, çà et là, l’impossibilité de la mesure humaine :
« Ici, le temps n’existe pas,
l’espace non plus
[…]
un désert d’attente s’étend
entre la naissance et la mort ».
L’humanité est vouée au vieillissement, au silence des origines, à la mort s’approchant jour après jour. Existerait-il un espoir, une lumière éventuelle,
« quand la rosée des morts
allume sous nos paupières
l’œil de Dieu » ?
Il y a effectivement l’amour, l’osmose des êtres, les rêves de lumière ; mais la paix ne peut être que celle du néant :
« Entre rien et rien
se déroule notre vie ».
Les images de la nature et de la vie, les sonorités, la sobriété du style, le pouvoir d’évocation des résonances lexicales, tout tend à développer l’oxymore du titre, « parler silence », qui induit la dualité constante de ces poèmes (vie/mort, corps/nature, espoir/désespoir, guerre/paix, haut/bas, ombre/lumière, tout/rien…). Pour Horia Badescu, qui a déjà publié chez L’Arbre à paroles Un jour entier (2006) et Miradors de l’abîme (2007), la langue française est devenue un matériau dont il sait tirer, sans effets oratoires superflus, l’essence poétique.
Jean-Pierre Longre
www.maisondelapoesie.com/index.php?page=editions-arbre-a-paroles
11:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roumanie, horia badescu, l’arbre à paroles, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/02/2011
Animaux littéraires
 Pascal Herlem, Les chiens d’Echenoz, précédé d’un Avertissement de Jean Echenoz, Calliopées, 2010
Pascal Herlem, Les chiens d’Echenoz, précédé d’un Avertissement de Jean Echenoz, Calliopées, 2010
« Le chien littéraire constitue une race à part entière ». Voilà qui est clairement énoncé. Fort de cette vérité, Pascal Herlem trace sa route, explore, hume, flaire, s’arrête, écoute, repart, examine les écrits d’Echenoz jusque dans leurs moindres recoins, à travers le « maillage serré » d’une œuvre dans laquelle « le sens peut circuler dans toutes les dimensions possibles ». Auparavant, il aura pris soin d’étayer son point de départ : le chien est partout dans la littérature, aussi bien chez Alphonse Allais que chez Maupassant ou Tchekhov – et pas seulement chez La Fontaine, Buffon ou Jules Renard… Une mention spéciale pour Queneau, à la fois « chêne » et « chien »… Le chien est donc bien « littéraire », mais aussi « locutif », et le rappel de quelques expressions courantes intégrant l’animal métaphorique nous rafraîchit plaisamment la mémoire.
Alors se déroule, avec un sérieux humour pince-sans-rire, suivant une méthode imperturbable et infaillible, une « echenozographie canine » qui nous apprend beaucoup sur les chiens, sur l’écrivain, son oeuvre et ses personnages, mais aussi sur le monde et la condition humaine. En psychanalyste chevronné, en critique averti, en lecteur avisé (épithètes interchangeables ad libitum), Pascal Herlem parcourt les romans d’Echenoz selon une progression qui ne laisse rien au hasard. Après les « chiens de langue » (mentions allusives, comparatives, indirectes, fragmentaires) viennent les chiens « culturels », auxquels on se réfère pour retrouver « un certain équilibre du monde », puis les « chiens-objets », métaphores des choses de la vie, et l’on arrive au plat de résistance avec les chiens-personnages : les « petits seconds rôles » et « rôles de figurants » suscitant le sentiment d’abandon ou imposant leur utilité dans la garde des habitations et des fermes ; les chiens identifiables à leur race et/ou à leur nom – ce qui nous vaut des considérations animalières très documentées sur, par exemple, l’histoire des molosses ou l’origine des danois ; enfin, les chiens reconnaissables non seulement à leur race et à leur nom, mais aussi à l’identité de leur maître – faveur qui leur confère, à eux surtout, des fonctions précises : percer les secrets de l’âme humaine, assurer « une critique sociologique de première grandeur ».
Si l’auteur nous dévoile « l’art si particulier d’écrire en chien » d’un Echenoz qui, de son propre aveu, ne savait pas qu’il connaissait cette langue, s’il nous embarque dans certaines des « énigmes de l’univers romanesque d’Echenoz » (celle de Titov, entre autres, dans Nous trois), c’est à l’évidence pour mieux nous faire connaître les hommes, et pour nous faire deviner différents cheminements possibles à travers l’œuvre de l’un des meilleurs romanciers de notre époque. La route canine ouvre d’autres routes, à partir desquelles s’en entrouvrent d’autres encore, et ainsi de suite. Grâce à Pascal Herlem, nous avons plus de chances de nous rapprocher du « lecteur complet » qu’imagine Jean Rousset dans Forme et signification, ce lecteur qui, « tout en antennes et en regards, lira l’œuvre en tous sens, adoptera des perspectives variables mais toujours liées entre elles, discernera des parcours formels et spirituels, des tracés privilégiés, des trames de motifs ou de thèmes qu’il suivra dans leurs reprises et leurs métamorphoses, explorant les surfaces et creusant les dessous jusqu’à ce que lui apparaissent le centre ou les centres de convergence, le foyer d’où rayonnent toutes les structures et toutes les significations ».
Jean-Pierre Longre
22:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roman, francophone, pascal herlem, jean echenoz, editions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/02/2011
Une identité culturelle ?
 François Provenzano, Vies et mort de la francophonie, « Une politique française de la langue et de la littérature », Les Impressions Nouvelles, 2011
François Provenzano, Vies et mort de la francophonie, « Une politique française de la langue et de la littérature », Les Impressions Nouvelles, 2011
Le titre définit brutalement l’enjeu : la francophonie est-elle morte ? Si c’est le cas, il est bon de savoir pour quelles raisons, en examinant les « vies » (important pluriel) qu’elle a vécues. C’est ce que propose François Provenzano, selon un parcours historique qui permet « d’analyser les discours sur la « francophonie » en tant qu’ils dessinent toute une politique de la littérature, en permanente évolution ». En six chapitres et en un examen attentif, sont étudiés les « histoires en jeu », les contextes de la naissance et de l’évolution du phénomène francophone (la colonisation et la décolonisation, l’invention du concept et ce qu’il en reste), ses dimensions politique, économique, idéologique, culturelle, littéraire…
Surtout, l’ouvrage introduit un nouveau terme permettant de mettre en perspective celui de « francophonie » : la « francodoxie », qui désigne « l’ensemble des […] procédés rhétoriques auxquels puise le discours » sur la francophonie. Autrement dit, il y a ici une volonté d’étudier comment et pourquoi la francophonie désigne à la fois une institution et une production littéraire, aussi diverse soit-elle. Depuis la conceptualisation, au XIXe siècle, par le géographe Onésime Reclus, lui-même héritier d’auteurs précédents, de l’idée d’une utilisation du français à l’extérieur de la France, jusqu’aux discours modernes non exempts de condescendance et de paternalisme à l’égard des anciens colonisés (tel le fameux « discours de Dakar » prononcé par Nicolas Sarkozy en 2007), en passant par les premiers congrès du XXe siècle, l’institutionnalisation de la « Francophonie », l’instauration des « Sommets », l’idéologie de la « négritude » dans le contexte post-colonial, la satire du « franglais » par Étiemble, le débat engagé par la revue Esprit, la tendance critique illustrée par Les voleurs de langue de Jean-Louis Joubert, les vies de la francophonie sont passées au crible, sans indulgence et sans parti pris, dans un ensemble richement documenté et solidement charpenté.
La démarche est universitaire, mais le profane averti trouvera là matière à réflexion, en s’appuyant sur les « cinq ensembles de représentation » que l’auteur récapitule dans sa conclusion : représentation de la « langue », de la « France », de la « valeur littéraire », de la « société », de l’« histoire ». Ainsi la « mort » ou la « dissolution » de la francophonie peut donner lieu, dans un renouvellement des enjeux, à une « redéfinition » et à une « renaissance ».
Jean-Pierre Longre
15:34 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, françois provenzano, les impressions nouvelles, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/02/2011
Qui sommes-nous ?
 Vidosav Stevanović, Jeanne du métro, Purification ethnique, Répétition permanente, pièces traduites du serbe par Mauricette Begić et Angélique Ristić, éditions L’espace d’un instant, 2010
Vidosav Stevanović, Jeanne du métro, Purification ethnique, Répétition permanente, pièces traduites du serbe par Mauricette Begić et Angélique Ristić, éditions L’espace d’un instant, 2010
Vidosav Stevanović, né en 1942 en Serbie, s’est très tôt opposé à Milošević et à ses options nationalistes et guerrières, ce qui l’a obligé à quitter son pays au début des années 1990, puis à demander l’asile politique à la France en 1998. Beaucoup de ses œuvres ont été traduites en français, ainsi qu’en une vingtaine d’autres langues. Les trois pièces rassemblées dans ce volume tournent, chacune selon sa forme et son registre, autour de la guerre yougoslave, des conflits individuels et collectifs, de la perte des repères humains…
Jeanne du métro est un « monodrame », le long soliloque d’une jeune fille qui, réfugiée dans les souterrains du métro parisien, « cherche [sa] terre », raconte la disparition de sa famille aux origines mêlées, évoque la guerre et ce qu’elle a provoqué : non seulement les tueries et les ruines, mais une sensation de solitude absolue, la fuite, la perte de l’amour, le sentiment de l’absurdité foncière des actes humains, comme ce prétendu patriotisme guidé par l’intérêt personnel : « Quatre fois il a été serbe et quatre fois croate, chaque fois pour quelques mois seulement […]. Des deux côtés il demandait à être payé pour son patriotisme. À la fin, irrité contre les deux peuples qui payaient mal, il est devenu slovène et l’est resté plusieurs semaines ».
Dans Purification ethnique, quelques personnages – que l’auteur regroupe significativement sous l’appellation « parties en conflit » – sont enfermés dans une cave. Les courts tableaux qui se succèdent prennent la forme d’une tragédie (unités de lieu, de temps, d’action, comme dans les deux autres pièces), qui elle-même tourne à l’absurde. C’est la guerre en miniature et, dans un hors scène fantomatique, en grandeur nature, qui se joue sous nos yeux, la guerre sans issue (on ne peut pas rester là, on ne peut pas sortir), la séparation des familles, les meurtres, la perte d’identité à force d’en vouloir une, immuable et pure :
« Le père – Nous ne sommes donc pas ensemble contre les Musulmans, Croate ?
La mère – Si. Mais chacun pour soi, Serbe. »
Répétition permanente reprend le procédé baroque du théâtre dans le théâtre, les personnages étant des comédien(ne)s tentant de monter une pièce et jouant, sans en avoir conscience, les prémices de la guerre, dans une violence qui augmente à mesure que le temps passe et que les passions s’exacerbent. Là encore, le nationalisme pousse ses tentacules jusqu’à l’absurde, les relations humaines deviennent des actes purement animaux (manger / boire / violer / tuer…), le grotesque masque à peine la cruauté, et tout cela se dresse comme un cauchemar contre un idéal bien simple : « Je voulais être l’épouse de quelqu’un. Et la mère de plusieurs enfants. Et avoir une jolie petite maison à moi. Avec de l’herbe verte dans le jardin ».
Des motifs obsessionnels, on l’aura compris, sont communs à ces trois textes, et la violence aveugle de la guerre n’est pas le moindre d’entre eux. Mais ces motifs ne sont pas purement circonstanciels : au-delà du conflit yougoslave, les pièces de Vidosav Stevanović sont porteuses de la question « Qui sommes-nous ? », ainsi que des thèmes qui divisent l’humanité : les disparités sociales, les rivalités « ethniques », religieuses, sexuelles, politiques, la prétendue « identité nationale ». Et c’est bien à une dénonciation par l’excès et par l’absurde des dérives ainsi entraînées que se livre l’auteur.
Jean-Pierre Longre
08:54 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, serbie, vidosav stevanović, mauricette begić, angélique ristić, l’espace d’un instant, maison d’europe et d’orient, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/01/2011
Les mystères de la Fosse aux Lions
 Liliana Lazar
Liliana Lazar
Terre des affranchis
Gaïa, 2009
Réédition Actes Sud (Babel), février 2011
Il se passe d’étranges choses entre le village de Slobozia (dont le nom évoque la liberté, la libération) et la Fosse aux Lions (naguère « La Fosse aux Turcs », en souvenir des victoires d’Etienne le Grand contre les Ottomans) : des crimes, des disparitions mystérieuses, des apparitions de « moroï » ou morts vivants… Nous sommes à la fois dans la Roumanie ancestrale, au plus profond de la province de Moldavie où les légendes ont la vie dure, et dans la Roumanie d’aujourd’hui, celle qui a vu les méfaits de la dictature, la chute de Ceausescu et l’accession au pouvoir et aux richesses de nouveaux maîtres – pas si nouveaux que cela pourtant.
l’accession au pouvoir et aux richesses de nouveaux maîtres – pas si nouveaux que cela pourtant.
Victor Luca recèle en lui les paradoxes d’un corps robuste et d’une âme fragile – la violence irrépressible et la volonté de se racheter, la soif de liberté et l’enfermement dans la solitude – et les personnages qui l’entourent (sa mère, sa sœur, Ilie le prêtre, Ismaïl le Tsigane, Gabriel l’ermite) tenteront jusqu’au bout de le protéger des autres et surtout de le sauver de lui-même. A lui seul il synthétise les contradictions d’un pays et de ses habitants : l’indéfectible fidélité à des mythes païens mêlés de religion chrétienne et l’adaptation plus ou moins consentie aux apports de la modernité, la quête d’un bonheur illusoire et la morbide réalité des relations humaines ; plus généralement encore, dans une atmosphère qui peut faire penser à celle des romans de Virgil Gheorghiu (voir Les noirs chevaux des Carpates), Victor synthétise les paradoxes humains, le mensonge des apparences et la brutalité du réel (en matière politique et religieuse par exemple, mais pas seulement).
Liliana Lazar connaît bien la localité appelée Slobozia, sa forêt et ses collines, puisqu’elle y a vécu son enfance, nous dit-on. Après son installation en France, son premier roman (écrit en français), aux frontières du fantastique, de la poésie et du réalisme, donne la mesure d’un vrai talent littéraire appuyé sur une culture traditionnelle et populaire. A suivre…
Jean-Pierre Longre
19:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, liliana lazar, jean-pierre longre, gaia-éditions | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/01/2011
The Black Herald
 Literary magazine – Revue de littérature
Literary magazine – Revue de littérature
Issue #1 January 2011 – Janvier 2011
160×220 – 148 pages - 13.90 €
ISBN 978-2-919582-02-0
Poetry, short fiction, essays, translations.
Poésie, fiction courte, essais, traductions.
The first issue can now be ordered
Le premier numéro est désormais disponible
Texts by / Textes de : Laurence Werner David • John Taylor • Valeria Melchioretto • Tabish Khair • Émile Verhaeren • Will Stone • Philippe Rahmy • Rosemary Lloyd • Osip Mandelstam • Alistair Noon • Onno Kosters • Willem Groenewegen • Sandeep Parmar • Georges Rodenbach • Andrew O’Donnell • Khun San • Sylvie Gracia • Georg Trakl • Anne-Sylvie Salzman • James Byrne • Claro • Brian Evenson • Siddhartha Bose • Romain Verger • Yahia Lababidi • Sébastien Doubinsky • José Mena Abrantes • Cécile Lombard • Darran Anderson • Anne-Françoise Kavauvea • Emil Cioran • Nicolas Cavaillès • Mark Wilson • Zachary Bos • Paul Stubbs • Blandine Longre. Images: Emily Richardson • Romain Verger • Will Stone. Design: Sandrine Duvillier.
More about the contributors / les contributeurs
Co-edited by Blandine Longre and Paul Stubbs, the magazine’s only aim is to publish original world writers, not necessarily linked in any way by ‘theme’ or ‘style’. Writing that we deem can withstand the test of time and might resist popularization – the dangers of instant literature for instant consumption. Writing that seems capable of escaping the vacuum of the epoch. Where the rupture of alternative mindscapes and nationalities exists, so too will The Black Herald.
L’objectif premier de la revue, coéditée par Blandine Longre et Paul Stubbs, est de publier des textes originaux d’auteurs du monde entier, sans qu’un « thème » ou un « style » les unissent nécessairement. Des textes et des écritures capables, selon nous, de résister à l’épreuve du temps, à la vulgarisation et aux dangers d’une littérature écrite et lue comme un produit de consommation immédiate. Des textes et des écritures refusant de composer avec la vacuité de l’époque, quelle qu’elle soit. Éclatement des codes, des frontières nationales et textuelles, exploration de paysages mentaux en rupture avec le temps : c’est sur ces failles que l’on trouvera le Black Herald.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de Rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
15:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, poésie, essai, récit, traduction, black herald, blandine longre, paul stubbs | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

