25/06/2023
Une étrange bâtisse
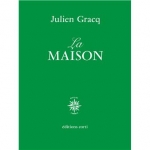 Julien Gracq, La Maison, Éditions Corti, 2023
Julien Gracq, La Maison, Éditions Corti, 2023
D’abord, la pleine réalité : pendant l’occupation, des trajets réguliers entre deux localités dans un autocar bondé traversant un paysage désolé fait de « fouillis hirsutes », avec « son sol ligneux tapissé de feuilles pourries, les branches tordues et hargneuses des chênes nains qui en barricadaient les profondeurs ». Dans cette « terre gâte », dont la description paraît prémonitoire, le regard du narrateur est attiré par une construction inattendue, délabrée mais comme encore animée, telle une « bête tapie », à la fois repoussante et attirante.
C’est alors que commence le mystère ; il décide un jour de s’approcher de la maison, bravant les obstacles naturels et l’angoisse d’aller à la rencontre d’une façade qu’il perçoit comme un visage humain. Car, singulièrement, tout semble vivant dans cette bâtisse aux allures abandonnées : une vie cachée, énigmatique, dont la vue perçoit des bribes et l’ouïe des sons, étranges et prometteurs. C’est « avec cette sensation de la gorge serrée et de la bouche sèche, et en même temps ce sentiment d’aisance jamais en défaut et de rapidité presque folle » que le narrateur pénètre dans le monde sensuel d’un rêve qui semble pourtant à sa portée.
Ce court récit que Julien Gracq ne publia jamais nous est donné comme un ultime témoignage littéraire du monde de l’écrivain, de son cheminement vers les transformations progressives du réel, de sa pénétration dans l’univers incertain des signes de la puissance de l’imagination. Les éditeurs ont eu la bonne idée de reproduire le plan et les deux états successifs du manuscrit qui montrent combien Julien Gracq travaillait ses textes : ratures, ajouts et repentirs jonchent le premier, tandis que le second ne contient que quelques corrections ponctuelles, précédant l’achèvement complet . Un travail minutieux pour un bref récit tout en tension.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, julien gracq, éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2023
Deux femmes d’aujourd’hui
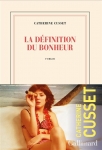 Lire, relire... Catherine Cusset, La définition du bonheur, Gallimard, 2021, Folio, 2023
Lire, relire... Catherine Cusset, La définition du bonheur, Gallimard, 2021, Folio, 2023
La définition du bonheur est un roman de notre époque. Je veux dire par là que les deux protagonistes sont confrontées à des sujets qui occupent les esprits et les corps d’aujourd’hui ou d’un hier récent : les femmes victimes d’abus sexuels et de violences physiques, la fidélité et l’infidélité dans le couple, l’éducation ou l’abandon des enfants, la dépression, le besoin de voyager, les difficultés ou l’insouciance financières, le cancer, les secrets de famille, Trump, et en dernier lieu le Covid avec ses conséquences, confinement et précautions sanitaires…
Tout y est, certes, mais ce n’est pas un document journalistique ou historique ; c’est bien un roman, dans lequel Catherine Cusset, femme d’aujourd’hui, utilise des données qu’elle connaît sans doute bien, mais qui pour une écrivaine chevronnée comme elle ne sont qu’un matériau soutenant la fiction, une fiction qui, en retour, attise la compréhension du réel. Disons donc : deux femmes, Ève et Clarisse, aux tempéraments bien différents, aux destinées sans points communs apparents, vont se trouver liées d’une manière insoupçonnée. Avant que le mystère soit levé, nous apprenons dans le prologue qu’Ève est venue en France depuis New-York, où elle réside, pour les funérailles de Clarisse. Puis une longue première partie retrace, depuis 1979, les existences des deux femmes. Existences parallèles, mais éloignées et dissemblables. Comme le montre la clé USB qu’a laissée Clarisse et qu’Ève a retrouvée, « elle entrelaçait nos vies parallèles qui se faisaient écho, si proches et si différentes dans nos expériences de l’amour, du désir, de la maternité et du vieillissement. » Les deux femmes n’ont pas les mêmes occupations et préoccupations, pas les mêmes appétits, pas les mêmes manques, pas les mêmes soucis… mais au plus profond d’elles-mêmes, les affinités qu’elles se découvrent dépassent les disharmonies.
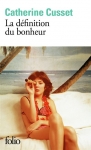 Le roman de Catherine Cusset est, au-delà de sa dimension actuelle, une belle œuvre intemporelle dont la construction est représentative de la vie des deux femmes : de longs chapitres continus pour Ève, de courtes séquences tourmentées pour Clarisse – puis le dernier récit qui opère la jonction. Une belle œuvre qui ne laisse pas de répit aux personnages, entre vie quotidienne et événements décisifs, pas de répit non plus au lecteur, qui se laisse porter par le récit, entre suspens narratif et émotion sincère.
Le roman de Catherine Cusset est, au-delà de sa dimension actuelle, une belle œuvre intemporelle dont la construction est représentative de la vie des deux femmes : de longs chapitres continus pour Ève, de courtes séquences tourmentées pour Clarisse – puis le dernier récit qui opère la jonction. Une belle œuvre qui ne laisse pas de répit aux personnages, entre vie quotidienne et événements décisifs, pas de répit non plus au lecteur, qui se laisse porter par le récit, entre suspens narratif et émotion sincère.
Jean-Pierre Longre
www.folio-lesite.fr
23:55 Publié dans Littérature, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, catherine cusset, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/06/2023
Au pays des destins croisés
 Lire, relire... Nicolas Mathieu, Connemara, Actes Sud, 2022, Babel 2023
Lire, relire... Nicolas Mathieu, Connemara, Actes Sud, 2022, Babel 2023
Ils sont nés dans la même localité, à deux pas d’Épinal, où les gens vivent tant bien que mal, végétant dans cette « petite ville peinarde » ou tentant à tout prix de s’en échapper, suivant leur tempérament ou le degré de leurs ambitions. Christophe incarne la première posture, lui qui est resté là, partageant son existence entre les copains et l’équipe de hockey sur glace dont il est l’une des vedettes, attirant irrésistiblement le regard des filles, lui qui vit maintenant, la quarantaine atteinte, avec son père et son fils, vendant de la nourriture pour animaux parce qu’il faut bien vivre. Hélène, quant à elle, a fait des études impeccables, a émigré à Nancy, s’est mariée, a eu deux filles ; une jeune femme moderne, qui apparemment a tout réussi : son couple, ses enfants, sa vie professionnelle dans un cabinet de consultants – ce qui veut tout dire et ne rien dire, vendre du vent ou de véritables conseils ?
On le voit, le destin de ces deux là est aussi éloigné que possible ; ils se sont certes connus dans l’enfance et l’adolescence, Christophe avait même séduit pour un temps la meilleure amie d’Hélène ; mais l’éloignement risquait d’être définitif. Pourtant, ils vont se recroiser. Et là… « Hélène avait voulu conquérir des distances, à coups d’écoles, de diplômes et d’habitudes relevées. Elle avait quitté cette ville pour devenir cette femme de fantasme, efficace et conséquente. Et là, comme une conne, dans un resto franchisé coincé entre un cimetière et un parking, elle venait d’avoir un coup de chaud en apercevant Christophe Marchal. Vingt années d’efforts n’avaient servi à rien. » La brillante carriériste et le sportif resté peuple vont s’apercevoir que leur vie ne leur apporte pas ce qu’ils attendaient, et une attirance mutuelle, amoureuse ou érotique (va savoir), va la rendre plus exaltante, en tout cas pour un temps.
 Nicolas Mathieu nous fait suivre deux destinées qui, partant du même point, se séparent, s’éloignent, se rapprochent, se croisent plus ou moins durablement, et à travers ces deux destinées particulières c’est la France contemporaine qu’il raconte, France d’en-haut et France d’en bas, France superficielle et France profonde. Dans des va-et-vient entre les années 1990 et l’année 2017 (année d’élections dont les enjeux n’échappent pas à la plume ironique de l’auteur), l’adolescence et ses fièvres campées avec finesse et empathie, l’âge adulte et ses illusions vus avec précision et rigueur, tout cela est étalé, disséqué. Le réalisme et la satire socio-politique se combinent dans des descriptions acérées, ce qui n’occulte pas une certaine tendresse pour le peuple. Le langage des cabinets de conseil avec son snobisme pseudo-anglophone fait, par exemple, l’objet d’un humour sans concessions, tandis que les scènes de bistrot populaire, pour burlesques qu’elles soient, attirent la sympathie ; la rengaine de Michel Sardou, qui donne son titre au roman et qui pourrait être moquée sans vergogne, apporte plutôt du liant au récit. Et la longue séquence finale de la noce campagnarde est un morceau d’anthologie naturaliste. Il y a du Zola dans ce roman d’aujourd’hui.
Nicolas Mathieu nous fait suivre deux destinées qui, partant du même point, se séparent, s’éloignent, se rapprochent, se croisent plus ou moins durablement, et à travers ces deux destinées particulières c’est la France contemporaine qu’il raconte, France d’en-haut et France d’en bas, France superficielle et France profonde. Dans des va-et-vient entre les années 1990 et l’année 2017 (année d’élections dont les enjeux n’échappent pas à la plume ironique de l’auteur), l’adolescence et ses fièvres campées avec finesse et empathie, l’âge adulte et ses illusions vus avec précision et rigueur, tout cela est étalé, disséqué. Le réalisme et la satire socio-politique se combinent dans des descriptions acérées, ce qui n’occulte pas une certaine tendresse pour le peuple. Le langage des cabinets de conseil avec son snobisme pseudo-anglophone fait, par exemple, l’objet d’un humour sans concessions, tandis que les scènes de bistrot populaire, pour burlesques qu’elles soient, attirent la sympathie ; la rengaine de Michel Sardou, qui donne son titre au roman et qui pourrait être moquée sans vergogne, apporte plutôt du liant au récit. Et la longue séquence finale de la noce campagnarde est un morceau d’anthologie naturaliste. Il y a du Zola dans ce roman d’aujourd’hui.
Jean-Pierre Longre
16:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas mathieu, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/06/2023
« Je tire mon irrévérence »
 André Stas, Je pensai donc je fus, Cactus Inébranlable éditions, 2021
André Stas, Je pensai donc je fus, Cactus Inébranlable éditions, 2021
Quel meilleur éloge funèbre que cet aphorisme d’André Stas lui-même, décédé le 26 avril dernier à l’âge de 73 ans ? Et quelle belle inspiration le Cactus Inébranlable, avec la permission de l’auteur, a-t-il eue de publier les « Aphorismes complets, 1993-2023 » de celui qui, comme je l’écrivais naguère, à la fois belge et surréaliste (c’est ô combien compatible), pataphysicien et humoriste, digne successeur de Nougé, Scutenaire, Chavée ou Blavier, est en somme un écrivain qu’on ne se lasse pas de lire !
Et là, on ne risque pas de se lasser : quasiment 380 pages dans lesquelles puiser une infinité de morceaux de littérature – proverbes et dictons détournés, sentences provocatrices, formules satiriques et malicieuses, calembours et contrepèteries… Après les « coups de chapeaux » bien ciblés de plusieurs de ses amis et un beau portrait dessiné par Roland Topor, et avant un ultime chapitre de « rab » dans lequel figurent un certain nombre de citations de congénères du passé et du présent, tels Gorges Brassens, savoureux (« Je suis anarchiste au point de toujours traverser dans les clous afin de n’avoir pas à discuter avec la maréchaussée. ») ou « l’immense Scut » (« Souvent, au lieu de penser, on se fait des idées. »), après et avant, donc, il y a l’œuvre elle-même, rassemblant les aphorismes extraits d’une bonne quantité de recueils, dont les titres sont en eux-mêmes tout un programme de jeux verbaux (voyez, par exemple, « Les Radis artificiels », « Les Bornes reculées », « Le décollement de la routine », « Le pas sage à l’acte » etc.).
Évidemment, Je pense donc je fus ne se lit pas comme un roman, tout d’un trait de la première à la dernière page. Et c’est tant mieux, car il y a de quoi picorer à satiété, dans tous les domaines. Au choix : les aveux d’un pessimiste (« Si mon humour est noir, c’est pour éviter que les idées le soient », « Écrire pour ne pas pleurer ») ou les constats presque définitifs (« D’un point à l’autre, souvent la ligne droite est le chemin le plus emmerdant »), les fausses citations (« - Existentiel mon mari ! Simone de Beauvoir ») ou les maximes larochefoucaldiennes (« Faire de l’esprit n’est pas nécessaire quand on en a », « Pour garder le moral, il faut d’abord rire de soi »), la parodie (« Un seul être vous manque et les bars vous attendent / Un seul être vous manque, mais en voici un autre |…] ») et, bien sûr, les jeux de mots (« Ineptes scies », « Qui trop embrase, mal éteint », « Mon sport : J’écris, je dessine. Je m’aère au Bic », « Et Dieu créa la flemme (le septième jour) »)… On voudrait en citer d’autres, beaucoup d’autres, quitte à céder à une subjectivité immodérée. Disons donc : il y en a pour tous les goûts, et pour tous ls prolongements possibles. L’œuvre d’André Stas est achevée, elle reste infinie.
Jean-Pierre Longre
Parmi les autres parutions récentes du Cactus Inébranlable :
 Mario Alonso, Bandes réfléchissantes
Mario Alonso, Bandes réfléchissantes
« Jouant avec les codes du genre aphoristique, Mario Alonso continue de fustiger le petit esprit en dynamitant les idées reçues à la faveur d’une poésie toujours aussi stimulante, tout comme nous avions pu le découvrir dans son premier recueil Lignes de flottaison, paru en 2021. »
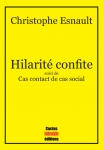 Christophe Esnault, Hilarité confite suivi de Cas contact de cas social
Christophe Esnault, Hilarité confite suivi de Cas contact de cas social
« Soucieux de santé, ça ne les dérangeait pas trop pourtant au gouvernement, les burn-out et les suicides dans l’Éducation nationale, les grèves de la faim ou les défenestrations des médecins alertant sur le manque de moyens. »
18:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aphorisme, francophone, belgique, humour, andré stas, mario alonso, christophe esnault, cactus inébranlable éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2023
Dans les archives de la mémoire
 Jean-Jacques Nuel, Images d’archives, Éditions de Petit Pavé, Le Semainier, 2023
Jean-Jacques Nuel, Images d’archives, Éditions de Petit Pavé, Le Semainier, 2023
Faire de la poésie d’autoroute ? Pour Jean-Jacques Nuel, ce n’est pas comme faire du roman de gare ! Non, rien à voir. C’est saisir dans ce qu’il y a d’on ne peut plus prosaïque le petit rien, le petit mystère, la petite anomalie qui rend, justement, la vie matérielle poétique : ce poids qui reste sur le cœur alors qu’on voit s’éloigner un poids lourd dans le rétroviseur, ce même rétroviseur qui, une fraction de seconde, laisse entrevoir une apocalypse aussitôt disparue ; ou l’ange gardien apparu dans le sillage d’un véhicule de sécurité, ou encore, sur un gobelet en carton de station-service, cette trace de rouge à lèvres qui laisse rêveur…
Le quotidien, voilà le matériau du poète. Le quotidien du présent (les bûches à rentrer, la chaudière à réviser) et celui du passé, qui induit les souvenirs – celui d’un vieux pont sur la Saône remplacé, un peu plus loin, par un ouvrage moderne (tiens donc, allusion voilée à l’ancienne activité éditoriale de l’auteur ?), celui du parking des bas ports du Rhône devenu lieu de promenade, ceux de la vie estudiantine puis professionnelle, ceux de « voyages / lointains dans l’espace / et le temps », ceux des cafés et des salles de concerts oubliés… Souvenirs le plus souvent liés à Lyon, la ville de naissance (à l’Hôtel-Dieu) et des grands ancêtres de la Renaissance, Louise Labé, Maurice Scève, Pernette du Guillet…
Tout en suggestions, sans artifices, la poésie de Jean-Jacques Nuel s’écoule goutte à goutte de la masse du réel, suscitée par « nos propres souvenirs / incessibles », par les archives individuelles et collectives de la mémoire.
Jean-Pierre Longre
 Réédition: Sous le titre Le colocataire, Jean-Jacques Nuel vient de rééditer son ouvrage Une saison avec Dieu publié au Pont du Change en 2019.
Réédition: Sous le titre Le colocataire, Jean-Jacques Nuel vient de rééditer son ouvrage Une saison avec Dieu publié au Pont du Change en 2019.
Voir ici
et là
19:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, jean-jacques nuel, éditions du petit pavé, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/05/2023
« Voir un peu de la vraie vie »
 Paul Fournel, Le Livre de Gabert, P.O.L., 2023
Paul Fournel, Le Livre de Gabert, P.O.L., 2023
C’est à Chamoison (village imaginaire mais conforme à la réalité), en Haute-Loire (département bien connu de Paul Fournel) que Gabert, écrivain ventru lassé de Paris et des prix à payer pour y survivre, s’est retiré pour « écrire à pas cher » et développer son imagination pleine de visions fantastiques et monstrueuses. Sa vie s’organise, entre l’écriture nocturne de « polars ruraux » et la fréquentation progressive des gens du village, dont il découvre bon gré mal gré les habitudes, voire les petits secrets. Il fera même un peu l’écrivain public bénévole pour des courriers administratifs ou des lettres d’amour. Lors de ses déjeuners quotidiens dans le bistrot de Tréport, il rencontre les hommes importants du village jouant à la belote, discutant foot et télé… Côté féminin il y a Lune, qui fréquente assidûment les mâles et qui aime se promener dans la campagne avec Gabert, Lola, la voisine éleveuse de brebis et sa fille Magali, une Zazie rurale, qui vient très souvent au logis de Gabert se faire raconter des histoires.
Il faut dire que l’auteur a de la suite dans les idées et le sens du pittoresque humain. On retrouve dans Le Livre de Gabert des personnages bien connus des lecteurs de Paul Fournel : la grosse Claudine et ses propos acerbes, la veuve Waserman qui habite dans son garage, les frères Bandelmas et leur manège, d’autres encore, croisés dans Les grosses rêveuses, Foraine et ailleurs. Une vraie Comédie Humaine… Et puis, très important : Gabert retrouve Jeune-Vieille (Geneviève), amie d’enfance et collègue en écriture, qui fut la protagoniste d’un roman précédent – où d’ailleurs nous croisâmes Gabert. Ils se revoient à plusieurs reprises, passent ensemble de beaux moments d’amour, et parlent livres et éditeurs.
Car le roman est pour Paul Fournel une nouvelle occasion (sinon le propos essentiel) de nous faire pénétrer dans le monde mystérieux de l’édition. Écrire des romans noirs à petit succès, cela va un moment ; mais Jeune-Vieille est persuadée que son ami peut aller plus loin. Tandis qu’elle va chercher la gloire ailleurs, elle le confie à Robert Dubois, éditeur à l’ancienne, comme on l’a su dans un roman précédent, La Liseuse : « Geneviève m’a conseillé de te lire et de te faire écrire le contraire de ce que tu écris pour te tirer hors de tes routines et t’aérer la tête. Elle est sûre que tu caches un bon livre quelque part en toi et que tu dois le faire sortir. « Un livre d’amour », m’a-t-elle dit, le livre de Gabert. » On ne le connaîtra pas, ce livre ; on saura seulement qu’il l’écrira le jour, contrairement à ses romans noirs, et qu’il s’agira de « raconter juste ce qu’il voit, repousser ce qu’il imagine. » « Voir un peu de la vraie vie. Pendant trop longtemps, il n’avait pas su débusquer le mouvement dans l’immobilité, traquer le bruit dans le silence. Et puis, peu à peu, c’est ce monde qu’il ne voyait pas qui est venu se construire et s’imposer dans son livre. » Pour peu, on dirait bien que Le Livre de Gabert est « le Livre de Fournel ».
Jean-Pierre Longre
18:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, paul fournel, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/05/2023
L’exil et l’émotion
 Victoria Yakubova, Chez moi, préface de Volker Schlöndorff, éditions L’espace d’un instant, 2023
Victoria Yakubova, Chez moi, préface de Volker Schlöndorff, éditions L’espace d’un instant, 2023
« Chez moi, ce n’est pas uniquement territorial, chez moi, c’est aussi temporel, c’est aussi il y a vingt-cinq ans.
Alors chez nous, c’est il y a vingt-cinq ans à Tachkent, en Ouzbékistan, quand le monde n’était pas encore fou. Voilà où c’est, chez moi.
Chez moi, c’est à la fois nulle part et partout ! Ni le temps ni l’espace n’existent, disent-ils ! Et ils ont raison. »
Le récit relate les trajets d’un exil à l’autre suivis par la narratrice, à partir de l’émigration familiale depuis Tachkent jusqu’en Israël : « Nous sommes les « décabristes russes ». Incroyable. Il suffisait d’arriver dans le pays des Juifs pour devenir russes et surtout pour arrêter d’être juifs. » Et c’est la découverte d’une autre vie, d’autres mœurs, d’autres lectures, d’une autre guerre, d’autres contraintes, de l’amour…
Victoria ou « Vika », la narratrice, va plus tard accomplir son rêve : étudier le cinéma à l’université de Paris. « Mais le cœur est-il heureux ? » S’il y a de belles découvertes, de belles rencontres, il y a aussi les difficultés pour trouver un travail, obtenir des papiers, il y a la bureaucratie, les soupçons, les tribulations de l’exil… Et que de tracasseries pour envoyer un colis en Israël, ou pour exhiber les documents nécessaires au mariage : « L’Ouzbékistan ? Connais pas. » Puis un jour, la famille Yakubov (les parents, la sœur de New York, Victoria de Paris) se retrouve à Tachkent, dans son quartier, vingt-cinq ans après le départ : la maison, le parc Kirov, les souvenirs, le deuil… et le retour chacun « chez soi ».
Remarquons-le, les éditions L’espace d’un instant on fait une exception : publier un texte ne relevant pas du genre théâtral. Mais remarquons-le encore : ce texte tient à la fois du récit, de la poésie, du cinéma et du théâtre. Récit : on aura compris qu’il s’agit d’une narration à caractère autobiographique ; poésie : les courts paragraphes sont comme des versets ou des strophes au lyrisme tantôt contenu, tantôt éclatant (à faire même pleurer les employés de mairie à qui Victoria a fait connaître sa vie pour débloquer le processus administratif !) ; cinéma : autant de paragraphes poétiques, autant de brèves séquences relevant du montage susceptible de faire du lecteur un véritable spectateur ; théâtre : l’écriture de l’autrice tient de la mise en scène des mots, les caractères de certains d’entre eux mettant en relief le pathétique et l’émotion, cette émotion qui émane de chaque page, de chaque scène, de chaque phrase. Un art total.
Jean-Pierre Longre
Autres parutions récentes aux éditions L’espace d’un instant :
 Dino Pešut, Les Érinyes, filles du désespoir. Traduit du croate par Nicolas Raljević. Préface de Lada Kaštelan
Dino Pešut, Les Érinyes, filles du désespoir. Traduit du croate par Nicolas Raljević. Préface de Lada Kaštelan
Présentation
Un groupe de lycéens confronté à la violence et à la haine se débat pour exister et grandir. Marija a été droguée et violée en soirée par trois garçons. Roza lutte contre ses pulsions violentes et suicidaires. Dane se drogue et se bat. Ivan est passé à tabac parce qu’il est homosexuel. Martin, qu’il aime, a du mal à assumer cette relation. Sanjin est accro à la pornographie. Le viol a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, Sanjin filmait. Les Érinyes, persécutrices représentées par trois jeunes filles du lycée, se chargent de dénoncer et de punir ce que la bonne société dénonce comme des travers condamnables selon « les lois de l’État et les lois du ciel ». Finalement, ce viol devient l’occasion d’une prise de conscience et d’une sortie de l’adolescence : l’amour l’emporte sur la bêtise.
Dino Pešut est né en 1990 à Sisak, en Croatie. Diplômé de l’Académie des arts dramatiques de Zagreb, il travaille comme dramaturge et metteur en scène dans différents pays européens. Ses textes ont notamment été présentés au Théâtre national de Split, au Theatertreffen à Berlin et à la Mousson d’été. Il a obtenu le prix Marin-Držić du meilleur texte dramatique à six reprises, ainsi que le Deutscher Jugendtheaterpreis et le prix de la fondation Heartefakt. En 2019, il est accueilli en résidence au Royal Court Theatre de Londres.
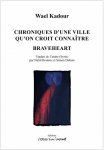 Wael Kadour, Chroniques d’une ville qu’on croit connaître. Traduit de l’arabe (Syrie) par Nabil Boutros et Simon Dubois. Préface de Monica Ruocco
Wael Kadour, Chroniques d’une ville qu’on croit connaître. Traduit de l’arabe (Syrie) par Nabil Boutros et Simon Dubois. Préface de Monica Ruocco
Présentation
Chroniques d’une ville qu’on croit connaître se déroule à Damas pendant les premières semaines de la révolution de 2011. Dans un moment de profonde transformation du pays, Rola tente de formuler sa propre interrogation sur son identité sexuelle et se retrouve dans une confrontation ouverte avec le pouvoir politique et social.
Braveheart a pour cadre une petite ville française inconnue, en 2021, et traite du problème de l’acte d’écriture depuis l’exil après l’effondrement de la question de la justice et l’impossibilité du retour à la patrie. Aline essaie d’écrire du matériel créatif et se retrouve prise entre un passé traumatisé et un futur illisible. Elle entre dans une relation amoureuse avec un jeune homme qui, selon elle, travaillait dans le renseignement et qui se déguise maintenant en une nouvelle personne.
Wael Kadour, né à Damas en 1981, est auteur, dramaturge et metteur en scène. Il a été accueilli en résidence notamment au Royal Court Theatre de Londres en 2007, ainsi qu’au Sundance Institute de New York en 2017. Il quitte la Syrie fin 2011 pour la Jordanie, avant d’arriver en France début 2016. Ses textes ont été présentés notamment à la Filature, scène nationale de Mulhouse, au Napoli Teatro Festival en Italie et au Weimar Festival en Allemagne.
 Ramzi Choukair, Y-Saidnaya / Palmyre, les bourreaux. Traduits de l’arabe (Syrie) par Ramzi Choukair, Simon Dubois et Céline Gradit. Préface de Pascal Rambert
Ramzi Choukair, Y-Saidnaya / Palmyre, les bourreaux. Traduits de l’arabe (Syrie) par Ramzi Choukair, Simon Dubois et Céline Gradit. Préface de Pascal Rambert
Présentation
Saidnaya et Palmyre, antiques villes syriennes, sont devenues sous le régime dictatorial de hauts lieux de détention. Dans une narration qui transcende le témoignage brut, les personnages, survivants de ces prisons d’effroi, dévoilent un système qui surveille et punit, instille la méfiance jusque dans les relations les plus intimes. Récits de vie autant que de détention, les histoires singulières des personnages évoquent, en creux, les rouages d’un régime de la terreur, perpétrée depuis plus de quatre décennies au moyen d’une étroite imbrication entre pouvoir politique, religion et corruption.
Ramzi Choukair est franco-syrien. Il a longtemps vécu entre la France et Damas, avant que cela ne devienne impossible. Depuis, au gré de ses rencontres, collectant des témoignages, en voyageant où il peut, il écrit. Il tente, avec les artistes-témoins qui l’accompagnent, avec humour parfois, de raconter l’enfer de la guerre et l’oppression au quotidien, l’histoire de ceux qui ont pu fuir, celle de ceux qui sont encore là-bas. Histoire parlée, dansée, chantée, de frontières qu’on passe et de pays, de clandestinité, de résistance. Pour rendre à ces villes leur héritage, ne pas laisser le régime effacer les mémoires individuelles du peuple syrien.
10:34 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, théâtre, francophone, ouzbékistan, victoria yakubova, volker schlöndorff croatie, syrie, dino pešut, nicolas raljević, lada kaštelan, wael kadour, nabil boutros, simon dubois, monica ruocco, ramzi choukair, céline gradit, pascal rambert, l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/04/2023
Un drôle de roman noir
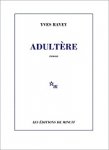 Yves Ravey, Adultère, Les éditions de minuit, 2021, Minuit Double, 2023
Yves Ravey, Adultère, Les éditions de minuit, 2021, Minuit Double, 2023
Il y a dans le roman d’Yves Ravey tous les ingrédients du roman noir. Le narrateur, Jean Seghers, tient une station-service au bord d’une route nationale. Outre le fait que le lieu soit peu réjouissant, l’entreprise est en faillite, et devrait être reprise par un certain Walden, président du tribunal de commerce, avec lequel Jean soupçonne sa femme Remedios de le tromper. En outre, il va falloir donner son congé à Ousmane, le veilleur de nuit et mécano, marié, père de famille, à qui Jean doit des indemnités qu’il n’a pas les moyens de payer… Bref, les difficultés s’accumulent sur la tête de notre (anti) héros, qui va commettre l’irréparable. « Mes pensées devenaient plus claires désormais, plus fluides, alors que s’élaboraient, en instantané, point par point, les phases successives et à venir de mon projet criminel. Celui-là, je l’exécuterais sans faillir. »
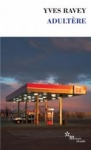 On va donc assister, dans tous ses détails, à l’exécution de ce « projet criminel » bien préparé, mais dans lequel il y a suffisamment de fissures pour attirer l’attention de Brigitte Hunter, enquêtrice de la société d’assurance de la station-service, qui va mener des investigations poussées et des interrogatoires serrés sur les circonstances et les causes de l’incendie suspect de l’atelier, et faire part de ses soupçons aux gendarmes. « Sous mes pieds, ce tas de cendres. L’enquêtrice ne me quittait pas du regard. Elle étudiait ma réaction, je le savais. Elle a repris, obsédée par ses suppositions : Hier soir, vous étiez seul dans la cuisine. Pourquoi n’êtes-vous pas parti avec votre femme en ville, j’insiste ? D’habitude, vous vous joignez à son groupe d’amies, auquel s’ajoute en principe Xavier Walden, alors, oui, je demande : Qu’est-ce qui vous a poussé à les laisser partir sans vous ? » – et maintes questions du même acabit.
On va donc assister, dans tous ses détails, à l’exécution de ce « projet criminel » bien préparé, mais dans lequel il y a suffisamment de fissures pour attirer l’attention de Brigitte Hunter, enquêtrice de la société d’assurance de la station-service, qui va mener des investigations poussées et des interrogatoires serrés sur les circonstances et les causes de l’incendie suspect de l’atelier, et faire part de ses soupçons aux gendarmes. « Sous mes pieds, ce tas de cendres. L’enquêtrice ne me quittait pas du regard. Elle étudiait ma réaction, je le savais. Elle a repris, obsédée par ses suppositions : Hier soir, vous étiez seul dans la cuisine. Pourquoi n’êtes-vous pas parti avec votre femme en ville, j’insiste ? D’habitude, vous vous joignez à son groupe d’amies, auquel s’ajoute en principe Xavier Walden, alors, oui, je demande : Qu’est-ce qui vous a poussé à les laisser partir sans vous ? » – et maintes questions du même acabit.
Cela dit, Adultère ne relève pas de la simple intrigue policière à la Columbo. L’auteur joue avec le genre et avec le lecteur, qui se pose lui-même des questions sur le ton du récit, étrangement détaché alors que le narrateur est pleinement concerné, sur la portée de l’ensemble, sur le choix des détails retenus, sur celui des noms des personnages – Seghers (comme le fameux éditeur), Remedios l’épouse, Dolorès la mère (échos exotiques), Hunter l’enquêtrice (véritable chasseur)… Et il hésite, le lecteur, entre le sourire et le malaise, entre l’angoisse due au suspense et la conscience du décalage narratif. C’est certainement ce qui fait de ce roman un beau morceau de littérature.
Jean-Pierre Longre
12:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, yves ravey, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2023
Le foisonnant persil de Suisse romande
 Le Persil Journal n° 206-207-208, février 2023
Le Persil Journal n° 206-207-208, février 2023
Près de Lausanne pousse toujours un florissant Persil, « journal inédit », c’est-à-dire composé uniquement de textes nouveaux. Le numéro de février 2023 donne « parole et silence » à des auteurs de Suisse romande, à commencer par Raluca Antonescu (comme Marius Daniel Popescu originaire de Roumanie, et autrice francophone confirmée), avec un extrait de L’aile nord, où la protagoniste, embauchée comme femme de ménage dans un hôtel, subit de drôles de relations avec les chambres qu’elle entretient, « coincée dans [une] absurdité implacable. » L’auteur « invité », Jacques Gélat, écrivain et scénariste, propose à la fin du numéro un récit au centre duquel l’abandon (maternel) et le désir de meurtre (filial), le manque d’amour, la velléité de vengeance et « le passage du temps » donnent sa puissance particulière à l’écriture.
 Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne !
Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne !
Trois numéros en un, beaucoup de belle matière, beaucoup de branches, beaucoup de feuilles – encore un Persil à dévorer.
Jean-Pierre Longre
Le Persil journal, Marius Daniel Popescu, avenue de Floréal 16, 1008 Prilly, Suisse.
Tél. +41.21.626.18.79
www.facebook.com/journallitterairelepersil
E-mail : mdpecrivain@yahoo.fr
Association des Amis du journal Le persil : lepersil@hotmail.com
11:30 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, le persil, francophone, suisse, roumanie, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/04/2023
Une enquête labyrinthique
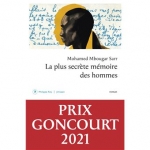 Lire, relire... Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, Philippe Rey / Jimsaan, 2021, Le Livre de Poche, 2023.
Lire, relire... Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, Philippe Rey / Jimsaan, 2021, Le Livre de Poche, 2023.
Prix Goncourt 2021
Au départ, il y a la parution, en 1938, d’un livre étonnant, foudroyant, un de ces livres « qui donnaient l’impression que plus rien n’était à ajouter », un livre dont l’auteur fut qualifié de « Rimbaud nègre » par un critique, avant d’être accusé d’imposture ou de plagiat, puisqu’on y avait décelé des reprises d’ouvrages antérieurs. Le labyrinthe de l’inhumain – tel est le titre du roman en question – est donc entouré de mystère, d’autant que l’auteur sénégalais, un certain T. C. Elimane, a disparu, et que les éditeurs du livre ont dû mettre la clé sous la porte.
Quatre-vingts ans plus tard, un jeune écrivain, Diégane Latyr Faye, sénégalais lui aussi, après avoir découvert et lu Le labyrinthe de l’inhumain et l’enquête qu’avait faite une journaliste sur cette publication, va se lancer sur les traces d’Elimane, traces littéraires, familiales, géographiques. C’est l’occasion pour lui de participer à des discussions passionnées avec de jeunes auteurs africains installés à Paris, de participer à « des joutes littéraires pieuses et saignantes » autour d’un livre qui « tenait de la cathédrale et de l’arène ». L’occasion aussi de rencontrer, directement ou indirectement, beaucoup de personnes qui ont connu T. C. Elimane, de près ou de loin, notamment la belle et expérimentée Siga, dont l’histoire familiale, entre Afrique et Europe, nous est contée en détail, ce qui permet de saisir un certain nombre d’éléments révélateurs à propos de l’énigmatique écrivain. Le récit nous emmène dans le temps à travers tout le XXème siècle et plusieurs événements qui l’ont jalonné (colonialisme et décolonisation, racisme et émigration, nazisme et Shoah…), et dans l’espace entre le Sénégal, la France et même l’Argentine – où Elimane poursuivait on ne sait quoi, on ne sait qui (les dernières pages donnent la réponse).
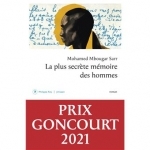 Ainsi, La plus secrète mémoire des hommes est une enquête avec tout le suspense suscité par la narration, des morts mystérieuses, des brouilles familiales, des réconciliations, des pérégrinations et des tribulations, des aventures amoureuses et des surprises – et la vie peu à peu découverte d’Elimane en cache un certain nombre. Mais les recherches labyrinthiques de Diégane laissent apparaître aussi, et surtout, le caractère indispensable de la littérature, sa puissance fascinante, aussi fascinante, sinon plus, que le sort des humains, au point que des questions se posent sur les priorités : « Que pesait la question de l’écriture devant celle de la souffrance sociale ? La quête du livre essentiel devant l’aspiration à la dignité essentielle ? La littérature devant la politique ? » On ne peut évidemment tout reprendre des hypothèses, des questions que pose ce roman au style d’une grande originalité, d’une grande densité et d’une grande vivacité (Un exemple au hasard : « Il devait être six heures. Dans la salle d’attente du jour, les premiers bruits s’impatientaient. J’ignorais si on pouvait dire que la Médina se réveillait, vu qu’elle n’avait pas dormi, ou alors d’un œil. »). Impossible de rendre la teneur d’un récit aussi foisonnant. Retenons ce que, dès les premières pages, Stanislas, traducteur de son état et apparemment disciple de Flaubert, dit à son colocataire Diégane : « Un grand livre n’a pas de sujet et ne parle de rien, il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. » Il n’y a rien à ajouter.
Ainsi, La plus secrète mémoire des hommes est une enquête avec tout le suspense suscité par la narration, des morts mystérieuses, des brouilles familiales, des réconciliations, des pérégrinations et des tribulations, des aventures amoureuses et des surprises – et la vie peu à peu découverte d’Elimane en cache un certain nombre. Mais les recherches labyrinthiques de Diégane laissent apparaître aussi, et surtout, le caractère indispensable de la littérature, sa puissance fascinante, aussi fascinante, sinon plus, que le sort des humains, au point que des questions se posent sur les priorités : « Que pesait la question de l’écriture devant celle de la souffrance sociale ? La quête du livre essentiel devant l’aspiration à la dignité essentielle ? La littérature devant la politique ? » On ne peut évidemment tout reprendre des hypothèses, des questions que pose ce roman au style d’une grande originalité, d’une grande densité et d’une grande vivacité (Un exemple au hasard : « Il devait être six heures. Dans la salle d’attente du jour, les premiers bruits s’impatientaient. J’ignorais si on pouvait dire que la Médina se réveillait, vu qu’elle n’avait pas dormi, ou alors d’un œil. »). Impossible de rendre la teneur d’un récit aussi foisonnant. Retenons ce que, dès les premières pages, Stanislas, traducteur de son état et apparemment disciple de Flaubert, dit à son colocataire Diégane : « Un grand livre n’a pas de sujet et ne parle de rien, il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. » Il n’y a rien à ajouter.
Jean-Pierre Longre
www.facebook.com/Editions-Jimsaan-257846464392099
18:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, sénégal, mohamed mbougar sarr, philippe rey, jimsaan, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/03/2023
Le réel et ses ouvertures
 Brèves n° 121, 2023
Brèves n° 121, 2023
Pour Daniel Delort (1948-2023)
« Il n’est pas facile d’écrire une bonne nouvelle. Le projet doit être parfaitement conscient quant à sa finalité, la langue doit se faire plus laconique, tendre vers une forme parfaite. Une bonne nouvelle doit offrir au lecteur des ouvertures. Elle doit lui proposer de nouvelles perspectives, l’étonner, changer sa vision du monde. » Voilà, entre autres considérations, ce que dit la fameuse écrivaine polonaise Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature 2018 (L’Obs n° 3049, février 2023, p. 70). Depuis que Brèves existe, les textes choisis par Martine et Daniel Delort, dans leur diversité, tendent vers cet idéal.
La diversité, c’est encore ce qui caractérise ce numéro 121 (121 numéros, quelle constance !). Histoires d’amours surprenantes, rêvées, trahies, mortes ou éphémères ; histoires de littérature (comment se résout une énigme littéraire) ou de musique (voir plus loin) ; les mystères d’une naissance suggérés dans une conversation entre père et fille, ou des confidences sur le tailleur porté par Jackie Kennedy lors de ‘attentat de Dallas ; une fable entre fantastique et humour, ou un cauchemar se révélant réalité et semant la révolte en Chine… Puis, avant les recensions d’usage, Éric Dussert nous présente Karen Bramson, Danoise de naissance et écrivaine française (1875-1936), avec l’une de ses nouvelles inédites, « Le petit génie », relatant la destinée exceptionnelle et tourmentée d’un petit violoniste virtuose.
Grande variété, donc, avec toutefois le point commun affirmé dans la présentation : les personnages, « anti-héros au destin improbable », un destin plus aléatoire que maîtrisé, un destin qui, tout en prenant au départ ancrage dans le réel, lui échappe subrepticement ou ouvertement, laissant entrevoir des perspectives. Ajoutons à cela cette définition de l’invention littéraire soumise par l’un des auteurs de ce recueil (Denis Soubieux) : « Personne n’invente jamais complètement les fictions, n’est-ce pas ? Elles se baladent dans l’air du temps et le premier qui s’en saisit en devient l’auteur. » Un bon complément à ce qui précède.
Jean-Pierre Longre
Les auteurs : Bertrand Runtz, Véronique Osé, Gilles-France Wanneguenn, Elisabeth Vitielli, Richard Huitorel, Caroline Charlet, Denis Soubieux, Christine Aurel, Fabien Quérault, Annie Huault et Karen Bramson.
Daniel Delort est récemment décédé. Le genre de la nouvelle lui doit une fière chandelle, à lui comme à son épouse Martine. Nous, lecteurs amateurs de textes brefs, ne pouvons plus que lui rendre hommage. Merci Daniel !
Brèves, 1, rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude
Tél. 04 68 69 50 30 ou 06 28 07 51 81
19:23 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle, francophone, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/03/2023
Des icônes trop humaines ?
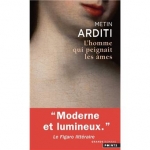 Metin Arditi, L’homme qui peignait les âmes, Grasset, 2021, Points, 2022
Metin Arditi, L’homme qui peignait les âmes, Grasset, 2021, Points, 2022
Avner, 14 ans, aurait pu poursuivre sans anicroches sa vie de jeune pêcheur juif dans la ville d’Acre, entre ses parents et sa cousine Myriam avec laquelle il découvre la sensualité amoureuse. Ce ne sera pas le cas. Au hasard de ses livraisons de poissons, il fait la connaissance d’Anastase, moine orthodoxe et peintre d’icônes, et ainsi naît la vocation d’Avner : il va devenir un « écrivain d’icônes » (puisque c’est ainsi qu’il faut dire, selon le dogme) ; pour cela, en cachette de sa famille, il va se convertir au christianisme, même s’il n’a pas la foi, tout en croyant « en la beauté, en celle des icônes, en la consolation qu’elles offraient. »
Nous sommes au XIème siècle, en un pays et à une époque où cohabitent Juifs, Chrétiens et Musulmans. Avner se situe au point de jonction des trois religions. Juif d’origine, peinte d’icônes orthodoxes, il se met à parcourir le pays avec Mansour, marchand musulman plein de sagesse, et va se rendre compte qu’au-delà des rites et des règles, c’est la foi en l’humain qui prime. Pourtant ce n’est pas ce que son maître Anastase lui a enseigné, et c’est ce qui lui est reproché : « Tu as peint des êtres humains, alors que tu aurais dû écrire la pensée du Christ. Tu es dans le blasphème. »
Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, l’exceptionnel talent d’Avner lui vaut une célébrité qui fait converger vers son atelier nombre de pèlerins dont il « écrit » le portrait en icônes dépassant, surpassant les canons religieux. Il va même jusqu’à faire le double portrait, face positive, face négative, d’un croisé venu de Bourgogne, le dissuadant ainsi de poursuivre sa conquête sanguinaire. Jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’il en soit violemment empêché, et bien que privé de moyens, il poursuit la mission qu’il s’est donnée. « D’un trait de pinceau, Avner captait une âme, et de ses icônes épurées émanait une spiritualité jamais atteinte jusque-là. » Et Metin Arditi, en menant ce conte à la fois historique, séduisant et pittoresque, décrit la manière dont le bonheur peut se révéler à travers la peinture des âmes.
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, metin arditi, grasset, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/03/2023
Le peintre et la Marguerite
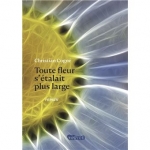 Christian Cogné, Toute fleur s’étalait plus large, Velvet, 2023
Christian Cogné, Toute fleur s’étalait plus large, Velvet, 2023
« Je ne t’aime pas du tout ! Je ne t’aime pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Je ne t’aimerai jamais ! » Ce jour-là, après l’effeuillage d’une marguerite, Petru, petit garçon issu d’un viol et à cause de cela rejeté dès sa naissance par sa mère, chuta dans un précipice en essayant de fuir cette haine. Chute réelle, chute symbolique de l’abandon dans lequel fut laissé l’enfant qui, devenu adulte, sombra dans la déchéance, l’alcoolisme et la violence, avant de rencontrer un drôle de peintre à qui il dut sa métamorphose. C’est ainsi que Petru, sous l’exigeante houlette de Sam, devint un « peintre paysagiste » prometteur.
Chez lui, la passion de la peinture va de pair avec la quête libératrice de l’amour dont sa mère l’a privé. Avant de le quitter pour d’autres contrées, Sam, son maître, lui a écrit une lettre testament où il lui prodigue ses conseils : « Remonte le temps, Petru ! Fixe ta mère dans les yeux et libère-toi. Comment ? À toi de trouver le moyen. Il te faudra des années, je le crains, pour sortir du trou. […] Je te le prédis, tu retomberas et tu te relèveras tandis que tu te croiras mort. Lorsque sur la toile peinte, tu te verras apparaître et grandir au plus loin de la ligne de fuite, tu sauras que tu as gagné ta part d’éternité. Un jour, tu seras au même niveau que Vincent Van Gogh. » Programme démesuré, que Petru suit d’aventure en aventure, de rencontre en rencontre. On le voit accoudé au comptoir d’un bistrot de banlieue, racontant par épisodes à quelques habitués ses pérégrinations en France, aux États-Unis, en Roumanie, dans la ville de Braşov, d’où vient sa mère, et où « sa propre histoire s’enracinait. » Mais « sa vraie patrie était celle des métamorphoses, des formes qui en recouvrent d’autres et des traces qui se perdent en chemin. »
Tout au long du roman, la peinture, les tableaux, les fresques même, dans une mise en abyme du récit, et nécessairement les rencontres amoureuses, tout cela figure la mise en forme artistique de la Marguerite, celle qui va se construire jusqu’à l’effeuillage victorieux, jusqu’au « Je t’aime » que sa mère a toujours refusé de lui concéder. Cette Marguerite dont il aura eu la vision au moment de son sevrage alcoolique : « La Marguerite profitait de l’obscurité pour sortir de son cadre. Elle se faisait toute petite au début. Comme une femme vulnérable qui ignore dans quel milieu elle met les pieds. Puis, dans la clarté blafarde qui émanait d’elle, sa tête s’ouvrait sur une fleur géante qui se développait, se développait… Du cœur jaune de celle-ci jaillissait une créature à tête de femme et au corps de serpent. »
Dans Toute fleur s’étalait plus large (titre emprunté à un vers de Mallarmé), les aventures romanesques et sentimentales, les voyages et les rencontres sont les manifestations extérieures de l’inlassable quête d’amour de Petru, « sur maint charme de paysage », comme l’écrivait encore Mallarmé. L’art pictural, dans les détails duquel l’auteur n’hésite pas à entrer, comme pour nous faire participer à l’apprentissage progressif de son héros jusqu’à sa parfaite maîtrise des formes et des couleurs, jusqu’à l’accomplissement de l’œuvre, l’art pictural, donc, renferme les signes et les secrets de cette quête à laquelle nous, lecteurs, participons avec une émotion intense et un attachement profond pour un personnage qui, tout en se dévoilant, garde les mystères de son paysage intérieur.
Jean-Pierre Longre
18:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, peinture, francophone, christian cogné, velvet, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/03/2023
Une enfance sous Ceauşescu
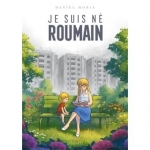 Daniel Horia, Je suis né roumain, éditions Paquet, 2023
Daniel Horia, Je suis né roumain, éditions Paquet, 2023
« L’époque d’or », prétendait le régime roumain. Une époque bien difficile en réalité : les restrictions, les rationnements, les files d’attente devant les magasins, les coupures d’électricité, la délation, la méfiance mutuelle, l’indifférence, la corruption… C’est sur ce fond plutôt sombre que le petit Daniel a commencé sa vie. Devenu adulte, il cherche ses plus lointains souvenirs, qui « affluent, s’entremêlent et se chevauchent comme une vague colorée aux mille sons et sentiments. »
Alors ils s’égrènent, les souvenirs de l’adulte, à hauteur de l’enfant qu’il était entre 1984 et 1986. Une vie de garçon de 3, 4, 5 ans, entre ses parents et ses grands-parents – une mère aimante et inquiète qui, on l’apprendra, a tenu malgré les épreuves à mettre son enfant au monde, des grands-parents paternels et maternels au passé et aux personnalités différentes mais tous attentifs à leur petit-fils, dont ils s’occupent avec affection et avec la proximité que l’on trouvait dans la tradition roumaine. C’est pour le petit garçon la découverte de la nature (la montagne, le parc Cişmigiu de Bucarest, le magnifique jardin de l’un des grands-pères), du bricolage (avec l’autre grand-père), de l’amitié, mais aussi de la cruauté au jardin d’enfants, de la maladie et de la douleur, du monde des grands qui n’est pas sans secrets, sans failles…
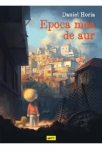 C’est d’ailleurs avec subtilité que l’auteur, qui devenu adulte a su ce qui s’est passé dans la famille et plus généralement dans la société roumaine des années 1980, laisse à l’enfant ses propres soucis d’enfant. Les souvenirs ne sont pas seulement factuels : ils sont ceux des rêves, des préoccupations, voire des soupçons d’un petit garçon. Avec le réalisme du vécu, un réalisme par moments teinté d’humour (voir par exemple la scène du restaurant où aucun des plats figurant sur la carte n’est disponible, ou l’accueil rébarbatif des employées de magasin), et avec une sensibilité teintée de discrétion, les complexités de la mémoire sont parfaitement rendues par la narration et les dialogues, ainsi que par les images colorées, lumineuses, souriantes, tendres, avec parfois de tragiques contrastes – le gris et le noir de la souffrance, les vifs éclats de la colère ou la brusquerie des catastrophes (celle de Tchernobyl, dont le nuage radioactif arrivant sur Bucarest ponctue l’album). Je suis né roumain est une belle autobiographie, qui éveillera la nostalgie ou les regrets de ceux qui ont vécu une enfance comparable, qui à d’autres apprendra un certain nombre de choses, et qui pour tous combine les plaisirs de la lecture graphique, historique, psychologique et littéraire.
C’est d’ailleurs avec subtilité que l’auteur, qui devenu adulte a su ce qui s’est passé dans la famille et plus généralement dans la société roumaine des années 1980, laisse à l’enfant ses propres soucis d’enfant. Les souvenirs ne sont pas seulement factuels : ils sont ceux des rêves, des préoccupations, voire des soupçons d’un petit garçon. Avec le réalisme du vécu, un réalisme par moments teinté d’humour (voir par exemple la scène du restaurant où aucun des plats figurant sur la carte n’est disponible, ou l’accueil rébarbatif des employées de magasin), et avec une sensibilité teintée de discrétion, les complexités de la mémoire sont parfaitement rendues par la narration et les dialogues, ainsi que par les images colorées, lumineuses, souriantes, tendres, avec parfois de tragiques contrastes – le gris et le noir de la souffrance, les vifs éclats de la colère ou la brusquerie des catastrophes (celle de Tchernobyl, dont le nuage radioactif arrivant sur Bucarest ponctue l’album). Je suis né roumain est une belle autobiographie, qui éveillera la nostalgie ou les regrets de ceux qui ont vécu une enfance comparable, qui à d’autres apprendra un certain nombre de choses, et qui pour tous combine les plaisirs de la lecture graphique, historique, psychologique et littéraire.
Jean-Pierre Longre
Daniel Horia sera présent :
À Lyon le 9 mars : Libraire Expérience de 16:00 à 19:00.
À Montbrison le 10 mars : Librairie D'une Bulle à l'Autre de 14:30 à 18:30.
À Vienne le 11 mars : Librairie Les Bulles de Vienne à partir de 10:00
15:35 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, autobiographie, francophone, roumanie, da, iel horia, éditions paquet, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/02/2023
Se venger, désespérément
 Michaël Mention, Les Gentils, Belfond, 2023
Michaël Mention, Les Gentils, Belfond, 2023
Franck, devenu disquaire après une période de tâtonnements mouvementés, a vécu quelques années de pur bonheur avec sa femme et leur fille. « Ta mère est entrée dans ma vie. L’amour. Ta mère et toi. L’émerveillement. Huit ans de bonheur. T’étais enjouée sans être chiante, et nous cool sans être laxistes. Notre harmonie était permanente, irradiant toute la famille. Avec mes parents, si on a commencé à se parler, c’est grâce à toi. Bref, chaque jour, c’était les vacances. Et la joie quotidienne de te voir grandir, de côtoyer ton intelligence, ton sourire. »
Tout à coup, l’événement le plus tragique qui puisse arriver à des parents, la mort soudaine de la fillette, tuée au cours du braquage minable d’une boulangerie. L’enquête policière n’aboutissant à rien, son couple défait par le drame, sa boutique bradée, Franck, « transpercé » par le deuil, part sur les traces du meurtrier, avec un portrait bien mince : « Homme blanc, la vingtaine, brun… et logo Anarchie tatoué sur l’épaule gauche ». Son départ à travers les bas-fonds parisiens, puis vers le sud de la France (Toulouse, Marseille) est le prélude d’une longue aventure en Guyane, dans la forêt amazonienne aux multiples dangers, un enfer qui contraste avec les quelques années paradisiaques soudainement révolues.
Avec en arrière-plan les circonstances politiques française de l’année 1978 (les discours de Giscard d’Estaing, le programme commun de la gauche) qui paraissent de plus en plus lointaines voire anachroniques, Franck, mû par une volonté obstinée de vengeance, arrive à se sortir de situations inextricables, de risques physiquement mortels et mentalement décourageants, laissant derrière lui les traces sanglantes de violences inouïes. Lorsqu’il n’est pas abandonné à lui-même dans une nature inhospitalière, confronté à des animaux peu rassurants, il croise toutes sortes de gens – indigènes pacifiques, ouvriers exploités par une multinationale, jeunes révolutionnaires utopistes – pour aboutir au milieu d’une communauté présentant toutes les apparences du bonheur, en réalité une secte qui a défrayé la chronique en novembre 1978…
Roman noir, roman d’aventures violentes, Les Gentils l’est, à coup sûr. C’est aussi le roman d’une quête pathétique de soi à travers le dialogue entre l’adulte et la fillette, à qui le récit s’adresse, comme si la mort était niée, ou en tout cas exorcisée, transcendée par l’écriture et la parole, et par un amour absolu.
Jean-Pierre Longre
www.lisez.com/belfond/collection-belfond-noir/58932
Michaël Mention sera présent au festival Quais du Polar, Lyon, du 31 mars eu 2 avril 2023. www.quaisdupolar.com
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, michaël mention, belfond, jean-pierre longre, policier | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/02/2023
Glaciales tragédies
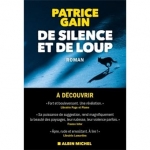 Lire, relire... Patrice Gain, De silence et de loup, Albin Michel, 2021, Le Livre de Poche, 2023
Lire, relire... Patrice Gain, De silence et de loup, Albin Michel, 2021, Le Livre de Poche, 2023
Un jour de janvier 2019, Dom Joseph, jeune novice de l’ordre des Chartreux, de son vrai nom Sacha Liakhovic, reçoit le journal de sa sœur Anna, partie à l’automne 2017 accompagner comme journaliste une expédition scientifique dans l’Arctique, au fin fond de la Sibérie, chargée d'étudier les effets du réchauffement climatique. La lecture de ce journal, entrecoupée par les pensées et occupations monastiques de son frère, nous fait découvrir à la fois le passé dramatique et la personnalité d’Anna, ainsi que les aventures non moins dramatiques des membres de l’expédition et de la jeune journaliste au tempérament bien affirmé et au courage sans faille.
 On apprend assez vite que ce qui mine Anna et a provoqué son départ, c’est la perte accidentelle de sa fille Zora et la disparition de sa compagne Romane. « Sans ma Belette accrochée à mon cou, sans Zora, qu’est-ce que je suis ? » Elle pense donc pouvoir, sinon oublier, du moins reléguer ces malheurs au fond d’elle en partant loin, sans se douter que d’autres malheurs l’attendent sur les terres et les glaces du bout du monde, sans compter avec une mémoire ravivée qui va lui faire lever le secret familial pesant sur Zora.
On apprend assez vite que ce qui mine Anna et a provoqué son départ, c’est la perte accidentelle de sa fille Zora et la disparition de sa compagne Romane. « Sans ma Belette accrochée à mon cou, sans Zora, qu’est-ce que je suis ? » Elle pense donc pouvoir, sinon oublier, du moins reléguer ces malheurs au fond d’elle en partant loin, sans se douter que d’autres malheurs l’attendent sur les terres et les glaces du bout du monde, sans compter avec une mémoire ravivée qui va lui faire lever le secret familial pesant sur Zora.
De révélations en désillusions, de longues plages de solitude en accès de violence, Anna, avec les autres membres de l’expédition, va faire des découvertes inédites, mais va aussi connaître les cruelles rigueurs de l’hiver arctique, l’implacable rigidité des autorités russes et la brutalité des hommes, résonnant avec les violences qu’elle a connues dans le passé, même si au milieu de la détresse quelques instants d’espoir éclairent la nuit (par exemple la rencontre d’un loup silencieux et apparemment fidèle et bienveillant). « Demain le soleil ne se lèvera pas. […] Est-ce que je vais pouvoir concilier les ombres qui m’habitent avec celles qui m’envelopperont ? Zora, ma Belette, je venais chercher une nouvelle voie dans le grand désert blanc, faire l’apprentissage d’une vie sans ta main dans la mienne et je vois se profiler dans l’obscurité un immense désarroi. Sacha, mon frère, prie pour moi. Du fond de ta cellule, parle-moi, encourage-moi. Chante-moi l’usage du monde et chasse les ténèbres. »
Dans un environnement évidemment glacial à tout point de vue, Patrice Gain conte des péripéties qui dévoilent l’hostilité de la nature et des hommes, une immense noirceur sur fond d’un blanc angoissant, et le lecteur n’est jamais à l’abri d’une surprise. Ce pourrait être désespérant. C’est palpitant et émouvant.
Jean-Pierre Longre
18:13 Publié dans Littérature, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrice gain, albin michel, jean-pierre longre, le livre de poche | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/01/2023
Le chauffeur, sa fille et le ministre
 Lire, relire... Tanguy Viel, La fille qu’on appelle, Les éditions de minuit, 2021, Minuit Double, 2023
Lire, relire... Tanguy Viel, La fille qu’on appelle, Les éditions de minuit, 2021, Minuit Double, 2023
On reconnaît les bons romans, en particulier, à l’adéquation repérable entre la forme et le fond, le style et l’histoire racontée, l’écriture et la parole des personnages. C’est le cas avec le dernier roman de Tanguy Viel, qui calque sa syntaxe tourmentée sur les tourments de sa protagoniste, venue se plaindre aux policiers des abus sexuels qu’elle a subis, « laissant dévider sur ses lèvres la longue pelote de récit qu’il fallait extirper d’on ne sait quelle jungle organique qui lui servait de corps – le contraire exactement de cette endurance dont elle avait fait montre toutes ces longues semaines à retenir les phrases à l’intérieur d’elle, les maintenant si longtemps à cet état larvaire et inarticulé qu’elle leur avait interdit tout accès à la lumière du langage. »
 L’histoire est dramatique, mais certainement pas unique. Laura, la fille d’un champion de boxe par ailleurs chauffeur d’un édile local en passe de devenir ministre, demande à celui-ci, sur les conseils de son père, de l’aider à trouver un logement. Promesse du maire, qui la confie à l’un de ses amis (et complice en affaires douteuses) tenancier d’un casino, et celui-ci fournit à Laura travail et logement sur place – où le maire va venir quotidiennement se faire payer, on devine comment, le service rendu. Les policiers se demandent si la plainte de la jeune femme est recevable, puisqu’il y a apparence de consentement (souvenons-nous que ce terme a fait récemment l’objet d’un livre témoignage retentissant). Consentement, vraiment ? Plutôt emprise, chantage sexuel, version moderne du droit de cuissage… Et au policier disant avec un semblant d’indulgence « Oui, bien sûr, je comprends », « Non, je ne pense pas, elle lui a dit, que vous compreniez vraiment, non, je ne le pense pas, parce que tout simplement ce n’est pas possible, pas du tout possible parce qu’alors, tout simplement, vous en sauriez plus que moi, et ça, eh bien, ça n’a aucun sens. »
L’histoire est dramatique, mais certainement pas unique. Laura, la fille d’un champion de boxe par ailleurs chauffeur d’un édile local en passe de devenir ministre, demande à celui-ci, sur les conseils de son père, de l’aider à trouver un logement. Promesse du maire, qui la confie à l’un de ses amis (et complice en affaires douteuses) tenancier d’un casino, et celui-ci fournit à Laura travail et logement sur place – où le maire va venir quotidiennement se faire payer, on devine comment, le service rendu. Les policiers se demandent si la plainte de la jeune femme est recevable, puisqu’il y a apparence de consentement (souvenons-nous que ce terme a fait récemment l’objet d’un livre témoignage retentissant). Consentement, vraiment ? Plutôt emprise, chantage sexuel, version moderne du droit de cuissage… Et au policier disant avec un semblant d’indulgence « Oui, bien sûr, je comprends », « Non, je ne pense pas, elle lui a dit, que vous compreniez vraiment, non, je ne le pense pas, parce que tout simplement ce n’est pas possible, pas du tout possible parce qu’alors, tout simplement, vous en sauriez plus que moi, et ça, eh bien, ça n’a aucun sens. »
Le maire devenu ministre, les choses vont se précipiter. Car on se doute bien que la plainte de la fille d’un chauffeur contre un ministre retors et sans scrupules, n’hésitant pas pour se défendre à salir la réputation de sa victime, se retournera contre elle et contre son père, pour qui l’affaire, quand il en prendra connaissance, deviendra insupportable. Roman dramatique, donc, dans lequel la leçon sociale ne laisse pas d’être à la fois réaliste et pathétique, vérifiant la fameuse morale de La Fontaine : « Selon que vous soyez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Cela dans un style bien différent de celui du fabuliste, suivant l’écriture fouillée de Tanguy Viel, qui explore tous les chemins possibles, même les impasses.
Jean-Pierre Longre
19:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, tanguy viel, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Une vue globale du monde »
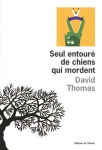 Lire, relire... David Thomas, Seul entouré de chiens qui mordent, Éditions de l’Olivier, 2021, éditions Points, 2023
Lire, relire... David Thomas, Seul entouré de chiens qui mordent, Éditions de l’Olivier, 2021, éditions Points, 2023
« Le livre que vous écrivez doit être unique » : tel est le conseil que donne un éditeur à un auteur en mal d’inspiration, qui va alors consacrer son temps à écrire « le livre le plus dégueulasse ». Ce n’est pas le cas pour celui de David Thomas, qui est pourtant unique dans son inspiration et sa composition. D’innombrables histoires courtes nous font explorer le monde, la société, les caractères, les singularités de la vie humaine : solitaire ou en couple, artistique et laborieuse, enthousiaste ou dépressive, pleine de rires et de pleurs.
Il y a cette vieille dame hospitalisée qui, tombée amoureuse de son jeune et bel infirmier, lui demande avant de mourir de se mettre nu devant elle… Il y a ce marathonien sans succès qui trouve le bonheur de courir sous les applaudissements adressés au personnel soignant pendant le confinement du printemps 2020… Il y a ce jeune garçon qui, après une mention très bien au bac, avoue à son père que sa vocation est de devenir loueur de pédalo… Il y a cet écrivain qui pratique le « no kill » avec les pages de son manuscrit (« No kill » ? Le fait de remettre un poisson à l’eau après l’avoir pêché). Il y a les réussites et les échecs, les mensonges et les vérités…
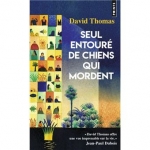 Il y a… On n’en finirait pas de glaner des anecdotes, des motifs de réflexion et de méditation dans cette mosaïque littéraire où l’humour le dispute au morbide, le paradoxal au rassurant, l’onirique au réel, le pessimisme à l’optimisme, la distance critique à l’émouvante empathie. Avec cela, un style alerte et jouissif, une prose qui se coule dans le moule de ce qu’elle évoque, à la première ou à la troisième personne, et qui nous sert périodiquement des formules d’une beauté pleine d’échos, du genre : « Ma vie de couple est dans le quotidien mais tant que ma femme sera dans le jour, le quotidien ne sera qu’un petit nain face au jour. » Ou bien : « Le bruit que font les autres sur le fil des secondes. » Ou encore : « Tu crois parler de la souffrance mais la pierre fendue par le gel en parle mieux que toi. » Tout cela pour dire que ce puzzle, pièce par pièce agencé, donne, pour reprendre le titre de l’un des textes, « une vision globale du monde ».
Il y a… On n’en finirait pas de glaner des anecdotes, des motifs de réflexion et de méditation dans cette mosaïque littéraire où l’humour le dispute au morbide, le paradoxal au rassurant, l’onirique au réel, le pessimisme à l’optimisme, la distance critique à l’émouvante empathie. Avec cela, un style alerte et jouissif, une prose qui se coule dans le moule de ce qu’elle évoque, à la première ou à la troisième personne, et qui nous sert périodiquement des formules d’une beauté pleine d’échos, du genre : « Ma vie de couple est dans le quotidien mais tant que ma femme sera dans le jour, le quotidien ne sera qu’un petit nain face au jour. » Ou bien : « Le bruit que font les autres sur le fil des secondes. » Ou encore : « Tu crois parler de la souffrance mais la pierre fendue par le gel en parle mieux que toi. » Tout cela pour dire que ce puzzle, pièce par pièce agencé, donne, pour reprendre le titre de l’un des textes, « une vision globale du monde ».
Jean-Pierre Longre
17:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, david thomas, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/01/2023
Un père et ses fils
Laurent Petitmangin, Ce qu’il faut de nuit, La Manufacture de livres, 2020, Le Livre de Poche, 2022
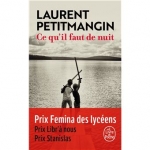 Depuis que « la moman » a succombé à la maladie qui la rongeait, ils restent tous les trois, le père avec Fus et Gillou, ses fils, tous deux de bons garçons, chacun à sa manière. Solidaires dans les difficultés, dans la douleur de l’absence, dans les tentatives faites pour retrouver le bonheur de vivre. « Il y avait déjà trois mois que la moman était partie, j’avais évacué la peur de ne pas y arriver, de ne pas faire face à tout ce qu’il y avait à organiser, à gérer. Tout ce que j’avais déjà entrevu depuis trois ans. » Il faut dire aussi que, pour aider, il y a le foot, les entraînements, les matchs de l’équipe de Metz…
Depuis que « la moman » a succombé à la maladie qui la rongeait, ils restent tous les trois, le père avec Fus et Gillou, ses fils, tous deux de bons garçons, chacun à sa manière. Solidaires dans les difficultés, dans la douleur de l’absence, dans les tentatives faites pour retrouver le bonheur de vivre. « Il y avait déjà trois mois que la moman était partie, j’avais évacué la peur de ne pas y arriver, de ne pas faire face à tout ce qu’il y avait à organiser, à gérer. Tout ce que j’avais déjà entrevu depuis trois ans. » Il faut dire aussi que, pour aider, il y a le foot, les entraînements, les matchs de l’équipe de Metz…
Les fils grandissent, leurs personnalités s’affirment. Alors que le jeune Gillou se destine à de brillantes études, encouragé par son père et par son frère, celui-ci, de son côté, se met à fréquenter de drôles de gars qui penchent nettement du côté de l’extrême-droite – à la grande honte de son père qui participait régulièrement aux réunions de sa cellule communiste. Il faut dire que dans ce coin de Lorraine, entre Nancy et le Luxembourg, sévit un chômage désespérant. Alors, Gillou parti étudier à Paris, Fus et son père cohabitent en réduisant les conversations au strict nécessaire. « Désormais, on allait devoir vivre avec ça, c’était ce qui me gênait le plus. Quoi qu’on fasse, quoi qu’on veuille, c’était fait ; mon fils avait fricoté avec des fachos. » Et un jour, survient ce qu’il aurait fallu éviter à tout prix : la violence. Le jeune homme rentre à la maison salement amoché, « le visage démonté », attaqué par des « antifas ». L’engrenage de la violence s’enclenche, avec ses conséquences dramatiques, l’impuissance, l’impression d’être dépassé par les événements – et, paradoxalement, l’amour retrouvé entre père et fils.
S’il se fonde sur des réalités sociales, Ce qu’il faut de nuit est un beau roman, littérairement et affectivement parlant. Les relations humaines, amicales, familiales sont soutenues par la langue même des personnages, la narration étant assurée avec pudeur et sincérité par le père et ses propres mots, ses propres phrases. Une vraie émotion émane du récit, qui se mue parfois en poésie apaisante : « Août, c’est le meilleur mois dans notre coin. La saison des mirabelles. La lumière vers les cinq heures de l’après-midi est la plus belle qu’on peut voir de toute l’année. Dorée, puissante, sucrée et pourtant pleine de fraîcheur. Déjà pénétrée de l’automne, traversée de zestes de vert et de bleu. Cette lumière, c’est nous. » Récit social, récit tragique, récit familial, récit poétique, tout se tient dans ce poignant roman.
Jean-Pierre Longre
22:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent petitmangin, la manufacture de livres, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/11/2022
Solitudes et longueur de temps
 Benoit Meunier, Désertiques, Ab irato, 2022
Benoit Meunier, Désertiques, Ab irato, 2022
Trois nouvelles, trois déserts, trois êtres aussi étranges que solitaires, pour lesquels le temps et l’existence ne se mesurent pas à l’aune habituelle.
Il y a d’abord celui qui vit (survit, végète ?) sur une montagne qu’il parcourt en tous sens, créant un complexe réseau de sentiers, et où les objets banals (mottes de terre, feuilles mortes, bâton…) deviennent des sortes de trésors ; une montagne dont il ne descend que pour en trouver une autre, infatigable Sisyphe randonneur, et avec laquelle il semble se confondre. Il y a ensuite le gardien d’une station-service où jamais ne s’arrête une automobile, espèce de Bagdad-Café bordé de rails vides et à l’horizon duquel ne passent que de rares individus, et dont le bâtiment, jusqu’au siège où est assis notre bonhomme, est envahi par un imbroglio de cactus qui l’empêche de bouger. Il ne vit que par son regard, son dialogue avec quelques bêtes et des souvenirs de jeux à caractère surréaliste. Et il y a celui qui, avec sa brouette, transporte inlassablement d’un tas à l’autre du minerai où se cachent des pépites d’or, dans un environnement totalement minéral, « sans oublier de faire une pause tous les trois mois pour boire un peu de l’eau qui sort du robinet de l’atelier, et respirer de temps en temps » ; lui aussi, traçant d’éternels sillons, soliloque et erre dans son monde, « citoyen de la mine » qui est sa vie, son horizon immuable.
Chaque texte a son style, qui colle au personnage décrit, à sa parole intérieure, à ses obsessions, chaque texte a son décor particulier, ses paysages, ses objets. Mais maints points communs justifient leur réunion en recueil : l’atmosphère, que l’on peut qualifier de kafkaïenne, avec çà et là des décalages surréalistes, et aussi des motifs récurrents – cactus, petits animaux du désert plus ou moins amicaux, plus ou moins repoussants, le « détachement souverain » des personnages, leurs tentatives de révolte et leur fuite vers… un autre désert ?
Ce qui hante chacun d’entre eux, notre pousseur de brouette le formule mentalement par la plume poétique de l’auteur : « Il se doute qu’il y a de l’autre côté des collines, des régions diverses et nouvelles qu’il aimerait traverser : des plaines arides, plates et nues, dont le sol blanchi n’est qu’une immense croûte de sel craquelée qui s’étend à perte de vue, barrée à l’horizon par une fine bande de terre à peine visible ; des dunes de sable au drapé soyeux, négligemment disposées au hasard des vents ; des chicots de basalte circulaires et verticaux, isolés, dressés comme des colonnes dont la base est enfouie dans un monticule de débris, assez larges au sommet pour y bâtir une ville ; des acacias noirs et tordus, fossilisés depuis des siècles ; des plateaux verdoyants ; des buissons d’épines, des dalles de granit, des lacs salés ; et plus loin des villes, des forêts, des fleuves et des rivières ; et chaque région est un nouveau désert, et chaque désert possède sa faune, sa flore et son système. » Jacques Dutronc chantait jadis : « Le monde entier est un cactus » ; Benoit Meunier, dans ce triptyque dont les composantes dépassent largement les limites de leurs cadres, nous dit : « Le monde entier est un désert ».
Jean-Pierre Longre
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, benoit meunier, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/11/2022
Un Goncourt venu de Lyon
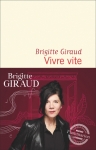 Le Prix Goncourt 2022 vient d’être attribué à Brigitte Giraud pour Vivre vite, Flammarion 2022.
Le Prix Goncourt 2022 vient d’être attribué à Brigitte Giraud pour Vivre vite, Flammarion 2022.
En attendant une chronique sur ce livre, on peut lire quelques chroniques antérieures :
http://jplongre.hautetfort.com/tag/brigitte+giraud
Et la présentation de l’éditeur :
« J’ai été aimantée par cette double mission impossible. Acheter la maison et retrouver les armes cachées. C’était inespéré et je n’ai pas flairé l’engrenage qui allait faire basculer notre existence.
Parce que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l’accident. »
En un récit tendu qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de comprendre ce qui a conduit à l’accident de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 1999. Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du propriétaire et sonde une dernière fois les questions restées sans réponse. Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur ces journées qui s’étaient emballées en une suite de dérèglements imprévisibles jusqu’à produire l’inéluctable. À ce point électrisé par la perspective du déménagement, à ce point pressé de commencer les travaux de rénovation, le couple en avait oublié que vivre était dangereux.
Brigitte Giraud mène l’enquête et met en scène la vie de Claude, et la leur, miraculeusement ranimées.
18:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, brigitte giraud, flammarion | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/10/2022
« C’est un monde »
 Lire, relire... Jean Échenoz, Vie de Gérard Fulmard, Les éditions de minuit, 2020, Minuit Double, 2022
Lire, relire... Jean Échenoz, Vie de Gérard Fulmard, Les éditions de minuit, 2020, Minuit Double, 2022
Sous quelle plume peut-on assister, dans un même roman, à la chute d’un fragment de satellite soviétique sur un hypermarché (qui entraîne la mort, entre autres, du propriétaire du narrateur, d’où suspension bienvenue du loyer), à celle, dans le même quartier, de Mike Brant depuis le sixième étage de son immeuble (manquant d’écraser la mère du même narrateur), à l’enlèvement et à la prétendue mort de la secrétaire générale d’un petit parti politique dont les responsables brillent par leur totale absence de scrupules et par leur cynisme ricanant ? Oui, sous quelle plume? Bien sûr sous celle de Jean Échenoz, qui manie dans un inimitable mélange le détachement de l'ironie, la force du burlesque, le dévoilement discret des techniques romanesques et l’empathie pour les gens ordinaires confrontés à la brutalité des arrivistes.
Les péripéties inattendues et les chutes diverses qui jalonnent ce bondissant récit sont comme une série de reflets changeants de la déchéance de Gérard Fulmard, dont la biographie relatée à la première personne est périodiquement relayée par des digressions nous faisant percevoir les effrayants abîmes de la vie politique et sociale. Gérard Fulmard, donc, stewart licencié pour faute, cherche un moyen de gagner sa vie. Pourquoi pas détective privé ? Fort de sa nouvelle raison sociale, il va se faire enrôler par les sbires de la FPI (Fédération Populaire Indépendante). Enrôler et complètement piéger, pris dans un engrenage de plus en plus serré.
Inutile de préciser qu’à aucun moment on ne risque de s’ennuyer à la lecture de Vie de Gérard Fulmard (un titre à la Stendhal, et qui se laisse comparer à ceux des grandes biographies historiques ou sacrées, sauf à y voir, par son côté assonantique, une sorte de dérision - Gérard n'est pas du genre fulminant). Non, aucun ennui. Plutôt de la jubilation, à suivre ces itinéraires citadins et narratifs dont la succession de s’épuise pas, à déceler la parodie, les allusions, la satire, à lire un vrai roman qui se pose ouvertement comme tel, puisque le romancier n’hésite pas à discrètement se manifester, un vrai roman dont chaque couche superposée (comme les pelures d’un oignon, pour reprendre la comparaison jadis faite par Queneau) laisse place à une autre couche, et ainsi de suite. « C’est un monde », comme le dit le psychiatre véreux de l’histoire.
Jean-Pierre Longre
18:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean Échenoz, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/10/2022
Anecdotes et souvenirs littéraires
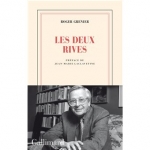 Roger Grenier, Les deux rives, préface de Jean-Marie Laclavetine, Gallimard, 2022
Roger Grenier, Les deux rives, préface de Jean-Marie Laclavetine, Gallimard, 2022
Roger Grenier (1919-2017), écrivain, journaliste, éditeur, lecteur chez Gallimard, a bien connu le monde littéraire. Dans cet ouvrage posthume, sous la forme d’anecdotes souvent souriantes, ironiques sans méchanceté, il rend compte à sa manière d’épisodes significatifs, parfois saugrenus, parfois émouvants, mettant en scène des personnalités connues ou méconnues.
Situés entre 1937 et 2005, maints événements confidentiels ou notoires sont tombés sous la plume alerte de l’auteur. C’est par exemple, en 1950, Marguerite Duras exclue du P. C. F. pour des raisons relevant de la morale la plus intransigeante ; la visite des fines fleurs de la Beat Generation (Jack Kerouac, Alan Ginsberg, Gregory Corso) dans les bistrots de Saint-Tropez ; les funérailles de Céline, en 1961, à l’occasion desquelles, dans son reportage pour France-Soir, Roger Grenier écrivit : « Il est toujours triste d’être obligé d’avoir honte d’un grand écrivain. » ; André Maurois faisant appel à des « nègres » ; des confidences de Serge Gainsbourg ; l’évocation de la mort, à Venise, de Wagner « se faisant faire une gâterie, comme on dit, par la femme de chambre »… On croise de grandes figures, amis ou connaissances de l’auteur, Camus bien sûr, Raymond Queneau, Jules Roy, Pierre Lazareff, Daniel Boulanger, et bien d’autres membres de la République des Lettres.
Ces échos des « deux rives » sont précédés de trois nouvelles, dans lesquelles Roger Grenier évoque aussi – souvenirs mêlés de fiction – des figures attachantes, discrètes voire secrètes, avec un art consommé du récit bref et du suspense narratif. Et ils sont suivis d’un texte s’attardant sur ce qui fut pour le petit Roger « un inépuisable livre d’images », deux volumes du magazine L’Illustration, aux photos « prodigieuses », atteignant « les sommets du chauvinisme ».
Comme l’écrit Jean-Marie Laclavetine dans sa préface, Roger Grenier fut « un esprit discrètement libertaire et d’un antimilitarisme foncier » (ce qui ne l’empêcha pas, entre autres engagements, de participer à la libération de Paris). Et dans cet ultime ouvrage, il use « toujours du ton d’ironie modeste et du sourire en coin de ceux qui ont perdu toute illusion quant aux capacités d’amélioration de l’espèce. » Un exemple pour finir ? En 1968 : « Mes fils, Frédéric et Nicolas, ont 15 et 13 ans. Comme je leur dis : « Il faudrait quand même que vous lisiez La Condition humaine ou Les Conquérants », l’un d’eux réplique : « Tu ne te figures pas que je vais lire les livres d’un ministre ! » Je me dis alors que Malraux vient de trouver sa punition. »
Jean-Pierre Longre
19:45 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelles, chroniques, autobiographie, récit, francophone, roger grenier, jean-marie laclavetine, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/10/2022
S’évader vers les chefs d’œuvre.
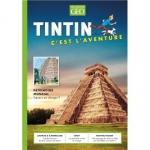 Tintin c’est l’aventure n° 12, Patrimoine mondial. Trésors en danger ? Geo, éditions Moulinsart, juin-août 2022
Tintin c’est l’aventure n° 12, Patrimoine mondial. Trésors en danger ? Geo, éditions Moulinsart, juin-août 2022
Commençons par la fin : avant une interview de François Schuiten et Benoît Peeters à propos de leur album Bruxelles, Un rêve capital, « ode au patrimoine de la capitale millénaire de l’Europe », une question récurrente parce qu’importante est posée : « Mais où est donc la Syldavie ? » La Syldavie, « pays mosaïque », celui du Sceptre d’Ottokar, où l’on passe aussi en lisant Objectif lune, On a marché sur la lune, que l’on côtoie (en Bordurie) dans L’affaire Tournesol… Tenter de répondre à cette question, c’est faire le tour de pays européens au riche patrimoine, à commencer par la Roumanie, illustrée ici par une magnifique photo de la cité médiévale de Sighişoara. Les autres hypothèses ne sont pas à rejeter, loin s’en faut : Monténégro, Albanie, Serbie, Croatire, République tchèque, Pologne, Autriche, Hongrie, et même Angleterre et Belgique – ou un mélange de toutes ces régions. Bref, on n’a pas fini d’en discuter, et le magazine Géo a dressé une carte précise du pays…
 Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey.
Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey.
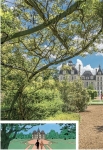 Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. »
Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. »
Jean-Pierre Longre
23:29 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : bande dessinée, francophone, hergé, tintin, éditions moulinsart, géo, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/09/2022
« Vaillante, vacillante »
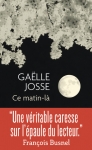 Gaëlle Josse, Ce matin-là, Les Éditions Noir sur Blanc, 2021, J’ai lu, 2022
Gaëlle Josse, Ce matin-là, Les Éditions Noir sur Blanc, 2021, J’ai lu, 2022
Il y a l’élément déclencheur – en l’occurrence, la voiture qui « ce matin-là ne veut pas démarrer. Et il y a ce qui couvait, ce que ce banal incident de la vie fait soudainement surgir. L’enfermement chez soi, en soi, le gouffre. « Clara la vaillante, vacillante. Une lettre en plus qui dit l’effondrement. […] Une lettre qui dessine une caverne, un trou où elle tombe, un creux, une lettre qui l’empêche de retrouver celle qu’elle était, entière, debout. »
Il y a Thomas, qu’elle aime et qui lui avait proposé de vivre avec lui, qui s’efforce de la maintenir à flot, mais qui peu à peu se décourage devant son absence de réaction. Il y a eu l’angoissante tension au travail, la dictature de la performance, le « maillage invisible d’ondes et de réseaux qui l’enserre chaque jour un peu plus, comme cette torture qui consiste à ligoter la victime de manière telle qu’à chaque effort pour se libérer, elle resserre un peu plus les liens, jusqu’à l’étranglement final. » Il faudra un acharnement désespéré pour sortir du puits, remonter vers le jour, répondre aux sollicitations familiales et amicales.
 Certes, dira-t-on, voilà le récit détaillé, pas à pas, d’une dépression comme on en vit ou en côtoie dans notre monde stressant. Quoi de neuf ? Eh bien, le neuf, c’est que Gaëlle Josse a su en faire un roman poétique et profond, ni larmoyant ni distant, dont le caractère empathique est plus prenant qu’une simple narration. Rythmées par les couplets d’une chanson connue (depuis « Nous n’irons plus au bois » jusqu’à « Entrez dans la danse »), les différentes étapes du récit mènent du noir désespoir à la lumière de l’espérance, « insaisissable et réelle ». C’est ainsi que le roman sait capter ce qui échappe à la raison pure.
Certes, dira-t-on, voilà le récit détaillé, pas à pas, d’une dépression comme on en vit ou en côtoie dans notre monde stressant. Quoi de neuf ? Eh bien, le neuf, c’est que Gaëlle Josse a su en faire un roman poétique et profond, ni larmoyant ni distant, dont le caractère empathique est plus prenant qu’une simple narration. Rythmées par les couplets d’une chanson connue (depuis « Nous n’irons plus au bois » jusqu’à « Entrez dans la danse »), les différentes étapes du récit mènent du noir désespoir à la lumière de l’espérance, « insaisissable et réelle ». C’est ainsi que le roman sait capter ce qui échappe à la raison pure.
Jean-Pierre Longre
19:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, les Éditions noir sur blanc, j’ai lu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2022
Histoires de lieux
 Brèves n° 120, 2022
Brèves n° 120, 2022
À la fin du volume, Éric Dussert présente Fanny Clar (1875-1944), journaliste engagée, romancière, nouvelliste, et propose à la lecture l’un de ses textes, « L’horloger qui écouta les horloges » : l’horloger en question, que personne n’a jamais vu en dehors de sa boutique, se voit harcelé par ses instruments qui lui répètent sans cesse « Le temps fuit… ». Finalement, c’est lui qui va fuir le lieu de son enfermement volontaire, quittant sa boutique pour des promenades, enfin « souriant au soleil, aux moineaux, à l’instant de joie qui passe et dont il faut jouir, vite, vite, avant qu’il soit trop tard, tard… ».
Voilà un beau prolongement des douze nouvelles qui composent le corps principal de ce numéro (dont les dernières pages sont consacrées, comme il se doit, à d’utiles recensions). De tons et de factures divers, ces douze nouvelles ont un motif commun : ce sont des histoires de lieux. Sur le mode réaliste ou fantastique, nostalgique ou humoristique, morbide ou réjouissant, dramatique ou poétique, il s’agit de lieux où l’on reste, que l’on quitte, que l’on retrouve, lieux individuels ou collectifs, intérieurs ou extérieurs – croisés par le temps, bien sûr, qui pèse de tout son poids sur les mouvements des personnages.
Les mouvements, et les destins. Il y a un jeune boucher qui, devenu veuf et séducteur malgré lui, part vers d’autres horizons ; ce voyageur infatigable découvrant un village reculé d’Afrique et la vie qu’on y mène ; ces habitants d’une banlieue réunis pour assister à la démolition de leurs logements à coups d’explosifs ; cette pauvre Liselotte qui n’a trouvé qu’un moyen pour bénéficier d’un peu de chaleur l’hiver : passer ses journées dans les bus. Il y a les souvenirs familiaux et lyonnais d’un jeune homme ; les impressions d’un commandant extra-terrestre visitant en 2096 une planète vide, la terre ; un monde où le travail est considéré comme une drogue… On en passe, laissant aux lecteurs le plaisir de suivre à leur guise le fil conducteur de ces nouvelles et les boucles parfois surprenantes qu’il offre.
Encore une fois, Martine et Daniel Delort font de Brèves bien plus qu’une simple revue, un recueil qui déploie toutes les ressources de la littérature. Profitons-en !
Jean-Pierre Longre
Les auteurs : Alain Leygonie, Dominique Lanni, Sylvie Cavillier, Marie-José Le Roy, Brice Gautier, Christophe Varlet, Jean-Yves Robichon, Rose Tacvorian, Dominique Carron, Julie Boudillon, Mireille Diaz-Florian, Marie-France Fournié, Fanny Clar
Brèves, 1, rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude
Tél. 04 68 69 50 30 ou 06 28 07 51 81
10:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, nouvelle, francophone, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/09/2022
Tragi-comédie familiale
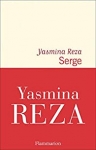 Lire, relire... Yasmina Reza, Serge, Flammarion, 2021, Folio, 2022
Lire, relire... Yasmina Reza, Serge, Flammarion, 2021, Folio, 2022
Certains écrivains sont aussi à l’aise dans l’écriture théâtrale que dans l’invention romanesque. L’art du dialogue, le mélange des registres, les mouvements de personnages bien campés, l’agencement précis de scènes en une répartition structurelle élaborée : ces caractéristiques scéniques sont aussi celles de la narration dans le dernier roman de Yasmina Reza.
« Je n’intéressais pas mon père. J’étais le bon garçon sans histoire, qui travaillait correctement, faisait tout comme son frère et n’avait aucune personnalité. Au contraire de Serge qui le rendait fou par ses opinions de blanc-bec, ses allures, sa fourberie, sa morgue et que lui en retour rendait fou à force de brutalité et raisonnements soi-disant édifiants, mais qui le surprenait, et peut-être même l’impressionnait. » On comprend ici (et ailleurs) pourquoi le livre s’intitule Serge. Celui-ci est le protagoniste, autour duquel gravitent son frère Jean (le narrateur), sa sœur Anne (Nana) et quelques autres personnages qui apparaissent au fil des scènes : Valentina, la compagne que Serge est en train de perdre, Luc, le fils de Marion, séparée de Jean, qui continue à s’en occuper comme de son propre enfant, Ramos, mari de Nana, avec laquelle il forme le seul couple stable de la fratrie, Joséphine, fille de Serge, qui va entraîner son père, son oncle et sa tante dans un voyage à Auschwitz. La visite du camp occupe une large scène centrale du roman, une scène dont la tonalité est représentative de celle de la plupart des autres. En ce lieu de toutes les cruautés, de toutes les souffrances humaines, les frères et la sœur vont se chamailler pour des peccadilles, se faire la tête, se brouiller même (Nana et Serge, qui boude de plus en plus), se moquer du beau-frère, bref se comporter comme si on était en vacances à la campagne. Et c’est aussi l’occasion, pour l’autrice à la verve acérée, de s’adonner par personnages interposés à une vive satire du tourisme de masse sur les lieux de mémoire tragique. Au milieu de cette agitation, Jean tâche de concilier les positions, mais en prend pour son grade et se fait traiter de lâche, et seule Joséphine, l’adolescente, reste fidèle à la charge de douleur que recèle le lieu.
 De fait, tout le roman est sous-tendu par la mémoire familiale et, plus généralement, humaine. La famille Popper (famille juive laïque, dont certains comportements font penser à ceux que l’on rencontre chez Albert Cohen), est travaillée par les souvenirs – ou par leur absence : « Quand je regarde Nana, je cherche à retrouver la jeune fille qu’elle était. Je cherche dans les yeux, dans les mouvements du corps, le rire, même dans les cheveux, bref dans tout l’assemblage qui fait un être, les traces d’Anne Popper, fleur magique que ses frères exposaient au compte-gouttes dans les soirées pour renforcer leur prestige. Je ne trouve rien. » La maladie et la mort habitent un récit où l’enfance et la jeunesse tentent de prendre leur place. Entre les deux (voir la tirade impayable sur le yaourt, « le dessert de l’enfant et du vieillard »), des adultes à la vie mouvementée, aux actions décalées, à l’angoisse récurrente. Serge est un roman plein e vie où la mort rôde à chaque coin de page.
De fait, tout le roman est sous-tendu par la mémoire familiale et, plus généralement, humaine. La famille Popper (famille juive laïque, dont certains comportements font penser à ceux que l’on rencontre chez Albert Cohen), est travaillée par les souvenirs – ou par leur absence : « Quand je regarde Nana, je cherche à retrouver la jeune fille qu’elle était. Je cherche dans les yeux, dans les mouvements du corps, le rire, même dans les cheveux, bref dans tout l’assemblage qui fait un être, les traces d’Anne Popper, fleur magique que ses frères exposaient au compte-gouttes dans les soirées pour renforcer leur prestige. Je ne trouve rien. » La maladie et la mort habitent un récit où l’enfance et la jeunesse tentent de prendre leur place. Entre les deux (voir la tirade impayable sur le yaourt, « le dessert de l’enfant et du vieillard »), des adultes à la vie mouvementée, aux actions décalées, à l’angoisse récurrente. Serge est un roman plein e vie où la mort rôde à chaque coin de page.
Jean-Pierre Longre
20:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, yasmina reza, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/08/2022
Maître absolu et esclave consentant
 Roland Topor, Le sacré livre de Proutto. Postface d’Alexandre Devaux, suivie de Sacré Jean-Paul par Topor, Wombat, 2022
Roland Topor, Le sacré livre de Proutto. Postface d’Alexandre Devaux, suivie de Sacré Jean-Paul par Topor, Wombat, 2022
Pour qui veut profiter d’une « robinsonnade » parodique et truculente, Le sacré livre de Proutto est une lecture jouissive. Roland Topor s’en donne à cœur joie, nous entraînant à la suite d’un certain Gisou, tyran sadique, et de son adorateur Proutto, masochiste à souhait, tous deux habitants d’une île devenue déserte après la mort collective des ses habitants les « Zoas » et sur laquelle Gisou règne en tant qu’autoproclamé dieu vivant. Le dominant et le dominé vont vivre un certain nombre d’aventures (comme le Robinson et le Vendredi de Daniel Defoe ou, plus proches, de Michel Tournier), jusqu’à l’arrivée d’une certaine Aba, dont le dieu vivant ne se privera pas d’affreusement abuser, et à la naissance d’un garçon aveugle… Bref, loufoquerie et excès, violence et jouissance, ambiguïté et hypocrisie marquent les relations entre bourreau abusif et victimes consentantes.
Parfois Gisou a des regrets : « Je regrette d’avoir échoué chez les Zoas, je maudis le jour où je t’ai connu. J’ai envie de rentrer chez moi. / - Où est-ce, Gisou ? / - Au pays des Dieux vivants. Je suis le pire d’entre eux, parce que la valeur d’un Dieu vivant se mesure à la qualité et à la quantité de ses fidèles. Je n’ai que toi, Proutto. Si les autres l’apprenaient, je mourrais de honte. » Paradoxalement, voilà qui l’humanise un peu, malgré tout ce qu’il fait subir à Proutto, cherchant toujours la pire humiliation à lui faire accepter. Dans sa postface (« Maudit Proutto ! »), Alexandre Devaux écrit à juste titre : « Plus encore qu’un « déconnage sur l’esclavage », ou une critique féroce de l’emprise de la religion sur les corps et les esprits, c’est une fable sur les rapports de domination, de soumission et de possession des êtres entre eux. Prouto est maso, Gisou est sado : « À bon sado, bon maso, ils sont tous les deux contents », dit Topor. »
Le sacré livre de Proutto est suivi d’une brève nouvelle, Sacré Jean-Paul, où Jésus (et non plus Gisou), à l’invitation du pape, participe à un concours de ramassage de billets de banque. Chez Topor, le rire est roi, un rire franc qui, disons-le, met parfois mal à l’aise, tant il est décalé, tant il est satirique, tant il se penche sur les côtés noir et ridicule des humains et des clivages sociaux. Mais ses écrits et ses œuvres d’art marquent pour toujours le patrimoine. Sacré Topor, toujours vivant !
Jean-Pierre Longre
20:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, humour, francophone, roland topor, alexandre devaux, wombat, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/07/2022
Mystérieux champion
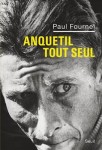 Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Le jeune Paul a eu beau, tout au long de son enfance et des routes parcourues sur deux roues, se prendre pour son champion préféré (souvenons-nous, il y avait deux clans bien marqués, celui, plus populaire, des Poulidor et celui, plus élitiste, des Anquetil), jamais il n’a réussi jusqu’à présent à percer les mystères de celui pour qui « l’essentiel se joue dans la solitude ».

« Petit cycliste, j’avais des idées claires sur ce que devait être un champion. Elles étaient si claires que je les consignais dans un cahier d’écolier parmi les photos que je découpais dans les journaux et collais dans un ordre qui n’appartenait qu’à moi. Ce cahier était à la fois mon Panthéon et mes Commandements ». Devenu grand, Paul doit pourtant se poser les questions essentielles, résumées par le titre du chapitre central, « À quoi marche Anquetil ? » : à l’exploit, à l’amour du vélo, à l’argent, à la douleur, à la drogue, à la générosité ? À tout cela sans doute, ce qui le rend d’autant plus « énervant » qu’il reste très secret.
Paul Fournel, qui s’y connaît en vélo, sportivement, pratiquement, théoriquement et littérairement (voir Besoin de vélo, Méli-vélo etc.), livre dans Anquetil tout seul des réflexions qui ne doivent rien à l’hagiographie (même si Anquetil est devenu, comme d’autres et plus que d’autres, une légende, celle-ci n’occulte en rien les défauts humains qui ne lui ont pas été épargnés), rien à la complaisance, rien au moralisme, beaucoup tout de même à l’admiration inséparable de l’autobiographie. Des réflexions, et des variations : ce livre est la partition d’une cantate qui suit les rythmes variés d’une combinaison instrumentale élégante et indicible : l’homme et la bicyclette.
Jean-Pierre Longre
23:12 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, cyclisme, francophone, paul fournel, le seuil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/07/2022
“Mépriser son être essentiel”
 Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Médecin de marine, écrivain, grand voyageur, Victor Segalen (1878-1919) a peu publié de son vivant, mais son œuvre est abondante (deux volumes dans la Pléiade). Le double Rimbaud, publié pour la première fois dans Le Mercure de France le 15 avril 1906, n’en est qu’un échantillon fort bref, mais très représentatif des préoccupations de l’auteur : peut-on être à la fois un immense poète et un négociant aventureux ? À la fois, non. Successivement, oui, apparemment, et Segalen s’interroge sur les deux Rimbaud : « Quel fut, des deux, le vrai ? Quoi de commun entre eux ? »
On le sait, Rimbaud s’arrêta brusquement d’écrire, et après avoir erré pendant au moins quatre ans, passa les dix dernières années de sa vie entre l’Abyssinie et Aden. Segalen utilise divers documents (lettres, souvenirs écrits ou oraux) pour retracer cette aventure, non sans citer et analyser auparavant un certain nombre d’extraits poétiques parvenant à « d’insoupçonnables horizons » et proclamant des désirs d’ailleurs : « Et cela fut, en vérité, prophétique des désirs constants de l’autre Rimbaud, qui même avant ses souffrances, avant ses échecs, en pleine fièvre de vie et d’action, entrevoyait, comme but seul désirable, le repos. »
Comment expliquer ce « cas singulier, d’un poète récusant son œuvre entière de poète […] par son mutisme définitif » ? Segalen avance alors « le Bovarysme », fameuse théorie conçue d’après l’héroïne de Flaubert par Jules de Gautier comme « le pouvoir départi à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est. » Et de donner les exemples d’Ingres et son violon, de Chateaubriand et ses velléités politiques, de Goethe et ses ambitions scientifiques etc. Voilà qui expliquerait aussi « les deux essors divergents » et l’étouffement de l’inspiration poétique chez Rimbaud, « persistant à mépriser son être essentiel. » Rien n’est définitivement éclairci, et Arthur Rimbaud restera toujours un cas mystérieux et fascinant dans l’histoire de la poésie. Mais Victor Segalen, dans ce petit ouvrage que les éditions Black Herald Press ont eu l’excellente idée de rééditer – en version bilingue qui plus est – fait avancer la réflexion non seulement sur le poète de Charleville, mais plus généralement sur la destinée des artistes.
22:13 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, anglophone, victor segalen, arthur rimbaud, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

