19/06/2018
Le toucher d’Échenoz
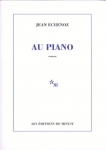 Jean Échenoz, Au piano, Les Éditions de Minuit, 2003, Poche « Double », 2018.
Jean Échenoz, Au piano, Les Éditions de Minuit, 2003, Poche « Double », 2018.
L’enfer, c’est la disparition des autres. Serait-ce une leçon possible de ce roman ? Et d’abord, y a-t-il une leçon ? Au bout du compte, non.
Commençons par le commencement. Un jour, du côté du Parc Monceau, deux silhouettes d’hommes, un grand et un petit, s’avancent en s’entretenant du chapeau que porte l’un deux (tiens, on dirait du Flaubert – Bouvard et Pécuchet – ou du Queneau, entre Le chiendent et Exercices de style)... L’un des deux hommes est le fameux Max Delmarc, dont nous, lecteurs, savons rapidement qu’il va bientôt mourir, ce dont il ne se doute pas lui-même : avantage donné au lecteur sur le personnage, et octroyé par un auteur omnipotent qui se joue des conventions romanesques et autres pactes de lecture. Ainsi pouvons-nous observer à loisir, avec un détachement qui n’exclut pas l’attachement, la vie et la mort du protagoniste.
 Car là encore les lois du roman sont mises à mal : nous n’assistons pas à une « tranche de vie », mais à une tranche de vie et de mort. Max Delmarc connaît les affres du trac (qu’il tente de noyer dans l’alcool) et les triomphes de la virtuosité. Cela ne l’empêche pas de vivre une petite vie ordinaire, entre son impresario, son garde du corps / surveillant Bernie, une sœur présente mais peu visible, et son travail quotidien d’entraînement artistique. Petite vie pianissimo, qui recèle pourtant sa chimère, sa petite fleur bleue à la Novalis – en l’occurrence une certaine Rose, ancien amour de jeunesse jamais déclaré mais toujours présent, dont il poursuit la silhouette improbable et fugitive au cours d’irraisonnables trajets en métro. Nous le savons – et lui n’en avait qu’un inconscient avant-goût, en jouant par exemple deux mouvements de Janácek, « Pressentiment » suivi de « Mort » – cette vie sans exaltation va brusquement s’interrompre, et Max va se retrouver dans un « Centre » dirigé par un certain Béliard (diable bien présentable qui a un homonyme dans Les grandes blondes, où l’on rencontrait aussi Paul Salvador, nouveau nom imposé à Max Delmarc...) ; centre-purgatoire où se côtoient Doris Day (une belle grande blonde plus accessible que Rose) et Dean Martin, et où Max séjourne une semaine avant d’être dirigé vers l’une des deux éternités possibles (« zone parc » ou « zone urbaine » – les tickets de métro ont une importance particulière dans le roman).
Car là encore les lois du roman sont mises à mal : nous n’assistons pas à une « tranche de vie », mais à une tranche de vie et de mort. Max Delmarc connaît les affres du trac (qu’il tente de noyer dans l’alcool) et les triomphes de la virtuosité. Cela ne l’empêche pas de vivre une petite vie ordinaire, entre son impresario, son garde du corps / surveillant Bernie, une sœur présente mais peu visible, et son travail quotidien d’entraînement artistique. Petite vie pianissimo, qui recèle pourtant sa chimère, sa petite fleur bleue à la Novalis – en l’occurrence une certaine Rose, ancien amour de jeunesse jamais déclaré mais toujours présent, dont il poursuit la silhouette improbable et fugitive au cours d’irraisonnables trajets en métro. Nous le savons – et lui n’en avait qu’un inconscient avant-goût, en jouant par exemple deux mouvements de Janácek, « Pressentiment » suivi de « Mort » – cette vie sans exaltation va brusquement s’interrompre, et Max va se retrouver dans un « Centre » dirigé par un certain Béliard (diable bien présentable qui a un homonyme dans Les grandes blondes, où l’on rencontrait aussi Paul Salvador, nouveau nom imposé à Max Delmarc...) ; centre-purgatoire où se côtoient Doris Day (une belle grande blonde plus accessible que Rose) et Dean Martin, et où Max séjourne une semaine avant d’être dirigé vers l’une des deux éternités possibles (« zone parc » ou « zone urbaine » – les tickets de métro ont une importance particulière dans le roman).
Une « divine comédie », avec purgatoire et descente aux Enfers ? Plutôt une « humaine comédie ». La vie avant, la vie après, finalement c’est tout comme ; la mort ne change pas grand-chose, et Max / Paul en fait l’expérience ni amère ni heureuse ; travail, amours, séparations, désillusions, les choses se répètent, sans véritable désespoir ni enthousiasme excessif.
Le relief d’Au piano se bâtit sur l’occupation principale du protagoniste, la musique, à laquelle malgré tout et sans en avoir l’air il tient par-dessus tout, et sur la manière dont est narrée sa vie quotidienne. Le toucher particulier, incisif, percutant, étonnant parfois d’Échenoz est bien là, avec le vagabondage (urbain) dans la syntaxe, les surprises de dernière minute, la distance à la fois ironique et familière, les clins d’œil au lecteur qu’il n’hésite pas à prendre à partie : « Vous, je vous connais, par contre, je vous vois d’ici ». Et nous, pouvons-nous vraiment connaître Jean Échenoz ? Je veux dire ses livres. Nous les lisons, nous les analysons, avec délectation, avec aussi la petite irritation de celui qui sent qu’il y a bien des choses là-dedans, qu’il n’arrive pas à saisir complètement et qu’il doit laisser pour la prochaine fois. C’est le propre de la littérature.
Jean-Pierre Longre
08:30 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean Échenoz, les Éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2018
Lyon contestataire
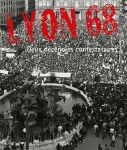 Vincent Porhel et Jean-Luc de Ochandiano (sous la direction de), Lyon 68. Deux décennies contestataires, Lieux Dits Éditions, 2017
Vincent Porhel et Jean-Luc de Ochandiano (sous la direction de), Lyon 68. Deux décennies contestataires, Lieux Dits Éditions, 2017
Lorsqu’on évoque les révoltes lyonnaises, on pense d’abord à celles des canuts qui, même si elles appartiennent à un passé relativement lointain, ont marqué durablement l’histoire de la ville. L’ouvrage dirigé par Vincent Porhel et Jean-Luc de Ochandiano remet en mémoire un passé plus proche, avec l’intention de « retisser la toile de la mobilisation sociale dans une moyenne durée (1958-1979), autour de l’explosion de mai-juin 1968 ». Ce n’est pas un simple rappel, mais une véritable reconstitution, photos et autres documents en grand nombre à l’appui, de la période indiquée. Car les « événements » de mai n’ont pas éclaté par hasard, sur terrain vierge. Dans un ordre clairement chronologique, les auteurs et leurs collaborateurs tracent les grandes étapes qui ont jalonné les deux décennies : la mise en place, le développement, le dynamisme des forces politiques et sociales dans les années 1950-1960 ; les prémices et l’éclatement des événements, jusqu’aux élections de juin ; l’atmosphère conflictuelle, la politisation, les luttes sociales, la désindustrialisation, le « maintien d’une combativité ouvrière » dans les années 1970…
 Les grandes étapes, certes, mais en entrant dans tous les détails significatifs, qui ne sont pas considérés comme des parenthèses anecdotiques, mais dans la perspective globale du récit historique. Par exemple l’immigration massive due, dans les années 1950, à la croissance industrielle et au besoin de main-d’œuvre, les effets locaux de la guerre d’Algérie, les changements successifs dans l’action syndicale, l’émergence de l’extrême-gauche (trotskistes, maoïstes, anarchistes) et du PSU, les combats sociétaux (féminisme, mouvements homosexuels, légalisation de l’avortement…), la réorganisation de l’Université etc. ; autre exemple plus ponctuel mais tout aussi significatif, la légende et la vérité concernant la mort du commissaire Lacroix, le 24 mai sur le Pont Lafayette. Et, amis lyonnais et les autres, savez-vous ce que furent « le groupe Eckart » ou « la communauté de Moulinsart » ? Ce qu’est et ce que fut « la Maison des Passages » ? Vous souvenez-vous de la grève des PTT à l’automne 1974, de l’occupation de l’église Saint-Nizier par les prostituées en 1975, des méfaits terroristes de la « branche lyonnaise » d’Action directe, du « conflit Teppaz » ?
Les grandes étapes, certes, mais en entrant dans tous les détails significatifs, qui ne sont pas considérés comme des parenthèses anecdotiques, mais dans la perspective globale du récit historique. Par exemple l’immigration massive due, dans les années 1950, à la croissance industrielle et au besoin de main-d’œuvre, les effets locaux de la guerre d’Algérie, les changements successifs dans l’action syndicale, l’émergence de l’extrême-gauche (trotskistes, maoïstes, anarchistes) et du PSU, les combats sociétaux (féminisme, mouvements homosexuels, légalisation de l’avortement…), la réorganisation de l’Université etc. ; autre exemple plus ponctuel mais tout aussi significatif, la légende et la vérité concernant la mort du commissaire Lacroix, le 24 mai sur le Pont Lafayette. Et, amis lyonnais et les autres, savez-vous ce que furent « le groupe Eckart » ou « la communauté de Moulinsart » ? Ce qu’est et ce que fut « la Maison des Passages » ? Vous souvenez-vous de la grève des PTT à l’automne 1974, de l’occupation de l’église Saint-Nizier par les prostituées en 1975, des méfaits terroristes de la « branche lyonnaise » d’Action directe, du « conflit Teppaz » ?
 Tout cela, et bien d’autres choses encore, contribue à bâtir une œuvre narrative, descriptive, historique parfaitement documentée, illustrée d’une manière abondante et vivante, une œuvre qui non seulement remet les faits en mémoire, mais les contextualise, les explore, leur donne vie, et explique clairement l’évolution de la société, avec ses répercussions sur notre époque, dans notre région et dans la ville de Lyon. « Lyon, la belle endormie, jalouse de son isolement, s’est découverte densément connectée à un contexte national et international mouvant et tourmenté, que ce soit lors des répliques de l’agitation parisienne ou par la conscience, de la part de sa jeunesse, d’un destin commun, qui, à Lyon comme ailleurs, a pris les traits de l’aspiration révolutionnaire. ». Nous avons affaire à un véritable travail de recherche historique approfondie mis à la disposition du grand public ; pas seulement de ceux qui ont participé ou assisté à ces événements, mais aussi (et surtout ?) des jeunes générations. Et, nec plus ultra, Lyon 68 est un (très) beau livre, à conserver précieusement.
Tout cela, et bien d’autres choses encore, contribue à bâtir une œuvre narrative, descriptive, historique parfaitement documentée, illustrée d’une manière abondante et vivante, une œuvre qui non seulement remet les faits en mémoire, mais les contextualise, les explore, leur donne vie, et explique clairement l’évolution de la société, avec ses répercussions sur notre époque, dans notre région et dans la ville de Lyon. « Lyon, la belle endormie, jalouse de son isolement, s’est découverte densément connectée à un contexte national et international mouvant et tourmenté, que ce soit lors des répliques de l’agitation parisienne ou par la conscience, de la part de sa jeunesse, d’un destin commun, qui, à Lyon comme ailleurs, a pris les traits de l’aspiration révolutionnaire. ». Nous avons affaire à un véritable travail de recherche historique approfondie mis à la disposition du grand public ; pas seulement de ceux qui ont participé ou assisté à ces événements, mais aussi (et surtout ?) des jeunes générations. Et, nec plus ultra, Lyon 68 est un (très) beau livre, à conserver précieusement.
Jean-Pierre Longre
Avec les contributions de Lilian Mathieu, Sophie Béroud, Jean-François Cullafroz, Gilles Boyer, Arthur Grosjean, Jacqueline Ponsot, Josiane Vincensini.
10:10 Publié dans Essai, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, images, francophone, vincent porhel, jean-luc de ochandiano, lieux dits éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/06/2018
« Quarante ans d’explorations et de débats »
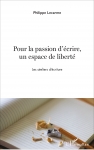 Philippe Lecarme, Pour la passion d’écrire, un espace de liberté. Les ateliers d’écriture, L’Harmattan, 2017
Philippe Lecarme, Pour la passion d’écrire, un espace de liberté. Les ateliers d’écriture, L’Harmattan, 2017
Qu’est-ce qu’un atelier ? Un lieu où l’on travaille, seul ou à plusieurs, d’une manière artisanale (l’atelier du menuisier) ou artistique (l’atelier du peintre). Le terme s’est étendu à bien des domaines, incluant au passage, outre une construction grammaticale directe (atelier pâtisserie, atelier aquarelle etc.), le volontariat et le plaisir. Effet de mode ? Si c’est le cas pour certains, l’atelier d’écriture a la vie dure, et c’est tant mieux. Philippe Lecarme en témoigne magistralement, après au moins « quarante ans d’explorations et de débats », au cours desquels il a beaucoup lu et beaucoup pratiqué, comme participant et animateur.
Son livre est fondé à la fois sur la recherche et l’expérience, et se veut « utile aux enseignants » et « aux animateurs d’ateliers », « puisque, écrit-il, je n’ai cessé de faire le va-et-vient entre ces deux domaines de pratiques ». Livre foisonnant, qui fait le tour de la question, l’analyse, la synthétise, l’illustre abondamment, le tout sur un ton qui n’exclut ni la critique ni les options personnelles (parfois « à rebrousse-poil »), ni même les petits plaisirs de l’humour légèrement corrosif. Des exemples ? « Dans bien des cercles et clubs de poètes, se rassemblent des dames sensibles quoique opulentes et des messieurs à crinières ; on y écoute poliment les ébauches d’autrui avant de confier au groupe ses propres merveilles. Qui dit poésie dit fleur bleue et petits ruisseaux, émotions tendres et délicates. Je veux bien. Mais il y a tout de même Lautréamont, Aubigné, Artaud, Michaux et quelques autres sires bien peu affables. ». Ou encore : « Rien ne semble plus facile que de “raconter sa vie”. Eh bien, essayez donc ! » ; et de bondir sur cette formule : « Écrire de soi ne va pas de soi ».
Cela dit, c’est du sérieux, du très sérieux même. L’ouvrage dépasse sans doute les autres ouvrages sur les ateliers d’écriture, parce qu’il tient compte de tous, et est le fruit d’une pratique de longue haleine. Je ne me risquerai pas à le résumer ; simplement à dire que la pratique s’appuie sur une réflexion théorique et sur des références multiples, ainsi que sur les travaux des participants (« écrivants », « scripteurs » ?), qui sont les appuis les plus sûrs et les plus divers (collégiens, lycéens, étudiants, adultes consentants et volontaires, publics spécialisés – ou spéciaux). Dans la jungle des références et des expériences, l’auteur tente de frayer, pour lui et pour nous, des chemins larges et rassurants, et il y parvient. Il questionne l’écriture à contraintes, les rapports entre écritures personnelle et collective, entre création, émotions et thérapies, et tient des propos décisifs sur les écritures autobiographiques (à lire absolument : la section intitulée « Quatre-vingt-quinze propositions, regroupées par thèmes », qui réunissent le concret, le pédagogique et le mode d’emploi, à partir de la page 296), sur la nouvelle (à lire tout aussi absolument : les « fiches » sur ce genre et les exemples donnés, à partir de la page 337), sur la poésie et les tentatives fluctuantes pour la caractériser. Bref, en parlant des ateliers, Philippe Lecarme parle de la littérature, d’une littérature pour tous, éloignée de l’élitisme des « coteries » (qu’il dénonce dans un juste aparté sur le mépris dans lequel d’aucuns tiennent le « Off » d’Avignon, ne rendant compte que du festival officiel). Pour lui, « la délimitation entre œuvres légitimes et productions mineures n’a cessé d’être instable et polémique », et les ateliers – en tout cas pour les personnes qui désirent s’y adonner et qui y prennent plaisir – permettent de ressentir, en toute simplicité, « l’infinie complexité » de l’écriture littéraire.
Jean-Pierre Longre
15:48 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, philippe lecarme, l’harmattan, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/05/2018
Une percutante symphonie
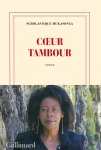 Lire, relire... Scholastique Mukasonga, Cœur tambour, Gallimard, 2016, Folio, 2018
Lire, relire... Scholastique Mukasonga, Cœur tambour, Gallimard, 2016, Folio, 2018
Prisca, jeune Rwandaise « solitaire et rêveuse » (ce qui la met en marge de ses camarades et de sa famille, pour qui la solitude songeuse n’est pas concevable), aime les livres et l’étude, et devient avec l’aide d’un prêtre de la paroisse et l’assentiment de son père une élève promise à de brillantes études. Celles-ci seront malheureusement interrompues à cause de son appartenance à l’ethnie des Tutsis, soumis à un intraitable quota universitaire.
Entre temps, la jeune fille se révèle être une chanteuse à la voix particulièrement adaptée au répertoire afro-américain (jazz, blues, gospels), et parallèlement elle fait en secret la connaissance de Muguiraneza, « La-faiseuse-de-bien », que certains appellent Nyabingui, « esprit très puissant » à la réputation sulfureuse, et qui est aussi Kitami, « la reine du royaume des femmes ». Celle-ci semble donner à Prisca le pouvoir de guérir – et c’est ce qui se passe : le père et la petite sœur de la jeune fille, qui souffraient de graves maladies, sont rétablis lorsqu’elle revient de sa mystérieuse entrevue avec Nyabingui / Kitami, dont elle lit par ailleurs la légende dans le « Carnet du frère Rogatien » datant de 1911.
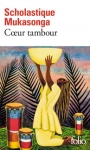 Vie mouvementée que celle de Prisca, qui n’en a pas fini avec les aventures et les métamorphoses. Des musiciens que l’on appelle « les Américains » passent dans la région ; ce sont en fait des tambourinaires venus de Jamaïque, de Guadeloupe et du Rwanda même (ou de l’Ouganda ?), qui font une tournée en Afrique en passant par l’Éthiopie, royaume du « roi des rois », terre sacrée des rastas. Ayant entendu la voix de Prisca, dont le chant devient transe, ils sont pris d’enthousiasme : « Étonnant ! Magnifique ! C’est elle ! C’est elle qu’il nous faut enfin : Prisca, tu fais déjà partie de la troupe. […] Que je sois possédée par un esprit ne semblait ni les inquiéter ni les impressionner : ils considéraient qu’ils avaient trouvé en ma personne la vivante racine de l’ordre de Nyabinghi. ». Après avoir retrouvé « Ruguina », le « Tambour avec un cœur », gigantesque instrument qui va les accompagner dans toutes leurs tournées, ils partent avec Prisca qui profite de l’aubaine pour fuir le Rwanda. Elle va devenir leur chanteuse, « la reine Kitami », dont le destin glorieux et tragique fera l’objet de nombreux reportages, de maints commentaires et de titres plus « tapageurs » les uns que les autres, du genre « Le mystère du tambour sanglant », « Crime et magie noire sous le volcan », « La vengeance du tambour »…
Vie mouvementée que celle de Prisca, qui n’en a pas fini avec les aventures et les métamorphoses. Des musiciens que l’on appelle « les Américains » passent dans la région ; ce sont en fait des tambourinaires venus de Jamaïque, de Guadeloupe et du Rwanda même (ou de l’Ouganda ?), qui font une tournée en Afrique en passant par l’Éthiopie, royaume du « roi des rois », terre sacrée des rastas. Ayant entendu la voix de Prisca, dont le chant devient transe, ils sont pris d’enthousiasme : « Étonnant ! Magnifique ! C’est elle ! C’est elle qu’il nous faut enfin : Prisca, tu fais déjà partie de la troupe. […] Que je sois possédée par un esprit ne semblait ni les inquiéter ni les impressionner : ils considéraient qu’ils avaient trouvé en ma personne la vivante racine de l’ordre de Nyabinghi. ». Après avoir retrouvé « Ruguina », le « Tambour avec un cœur », gigantesque instrument qui va les accompagner dans toutes leurs tournées, ils partent avec Prisca qui profite de l’aubaine pour fuir le Rwanda. Elle va devenir leur chanteuse, « la reine Kitami », dont le destin glorieux et tragique fera l’objet de nombreux reportages, de maints commentaires et de titres plus « tapageurs » les uns que les autres, du genre « Le mystère du tambour sanglant », « Crime et magie noire sous le volcan », « La vengeance du tambour »…
Faute de pouvoir rappeler toutes les péripéties et vanter toutes les qualités de ce roman foisonnant, on dira simplement que Cœur tambour est une percutante symphonie en trois mouvements (allegro : Kitami et ses tambourinaires ; andante : l’histoire de Prisca ; finale : le sacrifice), dont les rythmes, les mystères et les révélations risquent de hanter longtemps les songes du lecteur.
Jean-Pierre Longre
19:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, scholastique mukasonga, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/04/2018
Trois frères et leurs secrets
 Yves Wellens, Cette vieille histoire, Ker éditions, 2018
Yves Wellens, Cette vieille histoire, Ker éditions, 2018
Les trois frères Wellens (d’emblée, ce nom, qui est aussi le pseudonyme de l’auteur, pose question sur le statut même du récit que nous avons sous les yeux), les trois frères Wellens, donc, sont bien différents les uns des autres : il y a Pierre, riche promoteur immobilier, sur qui pèse la menace de révélations que pourrait faire un journaliste connu ; il y a Yves, qui en tant qu’écrivain se fait appeler Arcens (décidément, les pseudonymes se succèdent, s’emboîtent), bien éloigné du monde des affaires ; et il y a Gilles, qui n’a plus donné signe de vie depuis un certain temps, mais qui réapparaît par le truchement d’une lettre adressée à Yves.
Cette lettre est relative à la fois à l’enquête menée par le journaliste sur Pierre, à la gifle violente que celui-ci a reçue en public de la part d’une jeune femme, et à la « vieille histoire » qu’ont vécue autrefois les trois frères face à leur père alcoolique. Une « vieille histoire » qui les a à la fois réunis et séparés, car elle a mis à nu leurs personnalités respectives, notamment celle de Pierre, dont l’ « étrange sourire » ne le quittera pas. De son côté, Arcens l’écrivain mène une enquête sur ce frère au « sourire malsain », retrouve grâce à Gilles la jeune femme qui l’a giflé et saisit ses motivations, tandis que Pierre reçoit l’aide de Vinx, sorte d’espion privé et d’homme de main.
Cette vieille histoire relève du thriller parfois violent, du roman urbain (les choses se passent dans différents lieux de Bruxelles, que l’auteur connaît bien), de l’intrigue psychologique et familiale, de la satire sociale. On ne fera pas ici de révélations sur les secrets et les malaises des personnages, que l’auteur d’ailleurs ne fait que suggérer (pouvoir de suggestion que possèdent aussi les illustrations de Noam Van Cutsem). Yves Wellens a l’art de décrire et de raconter sans révéler ouvertement l’essentiel, laissé à la discrétion du lecteur. « Pour qui connaissait leurs rapports en demi-teinte, il n’était pas surprenant que les deux frères ne se voient que de loin en loin. Quelqu’un qui aurait été attablé au balcon ou dans la mezzanine d’un établissement, et se serait penché pour les apercevoir en contrebas, aurait ressenti que l’air à leur table était saturé de méfiance, et qu’un certain embarras flottait et se diffusait lentement autour d’eux. ». On pourrait le constater en citant d’autres passages, le lecteur se sent comme un observateur objectif qui ignore mais tente de deviner ce qui se cache sous les apparences. Les énigmes du roman recèlent des vérités insoupçonnées.
Jean-Pierre Longre
19:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, belgique, yves wellens, noam van cutsem, ker éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/03/2018
Sur les pas du « bourik »
 Nicolas Cavaillès, Le mort sur l’âne, Les éditions du Sonneur, 2018
Nicolas Cavaillès, Le mort sur l’âne, Les éditions du Sonneur, 2018
Image insolite : un âne chargé d’un cadavre humain si bien arrimé qu’il ne pourra pas s’en débarrasser parcourt l’île Maurice, ce « volcan surgi des eaux qui composa ses paysages par coulées de lave successives jusqu’au spectacle actuel (gangrené de béton) », une île qui, après avoir été un « désert généreux », est devenu le lieu de rassemblement d’un « peuple hétérogène – d’origine indienne, africaine, européenne et extrême-orientale – mais unanimement obsédé par sa petite géographie insulaire ».
Nous suivons donc, sur les pas de Nicolas Cavaillès, fin connaisseur des lieux, les traces de notre « bourik », qui commence par tourner en rond, puis qui se met à déambuler de coin en recoin, de ville en village. Et l’auteur profite de cette légende du « mort sur l’âne » pour plonger et nous faire plonger dans « l’obsédante géographie de l’île », et aussi dans son histoire, avec parfois une bonne digression qui a tout de même quelque chose à voir, telle celle qui rappelle la visite (forcée) du jeune Baudelaire à Port-Louis et dans les environs. Tant de villages aux noms pittoresques, parfois significatifs, parfois énigmatiques ; tant de lieux-dits, de quartiers, de figures et de groupes humains… Maurice apparaît comme un univers grouillant, dans l’espace et dans le temps, qui pose question : « Comment rendre l’île à sa nudité première, anonyme ? ». Et comment la faire sortir de la misère et de l’injustice, même après les émeutes évoquées vers la fin du récit ? « La vie reprit sa marche benoîte, à Beaux-Songes comme ailleurs – précisément comme l’âne affligé que nous avons laissé tantôt à l’entrée du village, après les vergers de Cressonville, au bord de la rivière… Pauvre bourik traînant jusqu’au bout de sa nuit son incompréhension et sa lourde fatigue, jusqu’au point du jour. ».
Dans une prose à fois impeccable, souple et poétique, dont chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre sont parfaitement pesés et rayonnent de multiples harmoniques, Nicolas Cavaillès ne se contente pas de décrire et de raconter. Il s’amuse parfois (lisez par exemple le chapitre 22 bis, où sont rapportées d’une manière impayable les dernières « aventures sensuelles » du baudet, une journée complète de débauche avec pouliches, ânesses, mules…), et souvent, prenant le lecteur à témoin, le sollicitant même, sollicitant aussi les images qui peuplent son esprit, s’adonne à la méditation et à l’interrogation : « Rien n’est à moi, nulle part le monde n’est ma maison, et tous les drapeaux que j’y plante ne flottent que dans le vent de mon égotisme, pour mieux retomber et s’enrouler autour de leur piquet lorsque mes illusions s’effritent. ». Le cadavre que notre âne trimballe au long des chemins est aussi celui de nos illusions. Reste à laisser chanter les oiseaux, en un « dialogue kreol-kreol, en plein cœur de l’île, alors qu’un ouragan s’approche. ».
Jean-Pierre Longre
10:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, île maurice, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/03/2018
« Avec le temps » ou « Itinéraire d’un enfant raté »
 Lire, relire... Catherine Cusset, L’autre qu’on adorait, Gallimard, 2016, Folio, 2018
Lire, relire... Catherine Cusset, L’autre qu’on adorait, Gallimard, 2016, Folio, 2018
Thomas Bulot est mort à 39 ans en corrigeant des copies et en buvant du champagne après avoir avalé des somnifères et, au moment ultime, enfilé un sac en plastique sur sa tête. De ce suicide, le lecteur est mis au courant au tout début du livre. Pas de suspense. Ou plutôt, un suspense contenu dans les étapes de ce récit que Catherine Cusset mène à vive allure, relatant plus de 20 ans de la vie de ce jeune homme promis à un « brillant avenir » (pour reprendre un autre titre de la romancière).
Lié à Nicolas, le frère de la narratrice, Thomas, après avoir été passagèrement l’amant de celle-ci (déjà universitaire accomplie, agrégée, normalienne, professeur aux USA), devient son ami et lui fait ses confidences. Le roman est le portrait en action de celui dont elle ne peut parler qu’à la deuxième personne. « Maintenant je ne peux dire autre chose que “tu”. “Il” est trop distant, comme si je parlais de toi à un autre. “Il” te tue encore un peu plus. ».
 Portrait d’un jeune homme qui court de promesses de réussite en constats d’échec, d’enthousiasmes en dépressions, d’amours en désolations, d’un jeune homme porté sur l’amitié, le sexe, les livres, l’alcool, et dont on apprendra que la cause de sa déchéance progressive n’est pas vraiment son tempérament, mais sa maladie : Thomas est bipolaire, comme Van Gogh, Hemingway, Virginia Woolf, Nina Simone (dont il est beaucoup question). C’est le trouble maniaco-dépressif qui l’empêche de mener à bien ses grands projets : publier un livre tiré de sa thèse sur Proust, obtenir ou conserver les postes qu’il sollicite dans les universités américaines, vivre le grand amour dont il rêvait avec l’une des quatre femmes qui ont vraiment marqué sa vie (un point commun : le « a » final de leurs prénoms, comme un constant prolongement vocal). La chanson de Léo Ferré, d’où le titre est tiré, semble se vérifier : « Avec le temps, va, tout s’en va / L’autre qu’on adorait, qu’on cherchait sous la pluie / […] Avec le temps tout s’évanouit… ». Des moments de bonheur, il y en a, oui, fugitifs ou relativement durables, par la grâce de l’amour, de l’amitié, du travail intellectuel, du regard de certains étudiants, et même dans le malheur et la solitude, il y a ceux et celles qui l’entourent : sa mère, morte trop tôt, sa sœur, qui l’aide malgré ses propres difficultés, ses amis (dont Catherine). Mais cela ne suffit pas. Tout converge vers le dénouement, tout obéit taux mots de Baudelaire : « Ô Mort ! Appareillons ! ».
Portrait d’un jeune homme qui court de promesses de réussite en constats d’échec, d’enthousiasmes en dépressions, d’amours en désolations, d’un jeune homme porté sur l’amitié, le sexe, les livres, l’alcool, et dont on apprendra que la cause de sa déchéance progressive n’est pas vraiment son tempérament, mais sa maladie : Thomas est bipolaire, comme Van Gogh, Hemingway, Virginia Woolf, Nina Simone (dont il est beaucoup question). C’est le trouble maniaco-dépressif qui l’empêche de mener à bien ses grands projets : publier un livre tiré de sa thèse sur Proust, obtenir ou conserver les postes qu’il sollicite dans les universités américaines, vivre le grand amour dont il rêvait avec l’une des quatre femmes qui ont vraiment marqué sa vie (un point commun : le « a » final de leurs prénoms, comme un constant prolongement vocal). La chanson de Léo Ferré, d’où le titre est tiré, semble se vérifier : « Avec le temps, va, tout s’en va / L’autre qu’on adorait, qu’on cherchait sous la pluie / […] Avec le temps tout s’évanouit… ». Des moments de bonheur, il y en a, oui, fugitifs ou relativement durables, par la grâce de l’amour, de l’amitié, du travail intellectuel, du regard de certains étudiants, et même dans le malheur et la solitude, il y a ceux et celles qui l’entourent : sa mère, morte trop tôt, sa sœur, qui l’aide malgré ses propres difficultés, ses amis (dont Catherine). Mais cela ne suffit pas. Tout converge vers le dénouement, tout obéit taux mots de Baudelaire : « Ô Mort ! Appareillons ! ».
Placé sous les signes de Proust, de Léo Ferré, de Baudelaire, baignant dans la musique (le jazz, Nina Simone, les Variations Goldberg), nourri de références littéraires et cinématographiques (les deux pôles de recherche de Thomas), traversant avec une certaine ironie les milieux et les mœurs universitaires des États-Unis, L’autre qu’on adorait n’est pourtant pas un roman intellectuel, mais un récit plein d’empathie et de tendresse, même s’il ne fait aucune concession à la pitié. « Je suis ton amie. Je ne suis pas méchante, tu l’as compris. Mais comme j’ignore la fragilité, comme j’ignore le mal qu’on fait à l’autre en posant le doigt sur ses zones les plus sensibles et en appuyant dessus ! ». Une vraie amitié à l’égard de celui qui pourrait passer pour un « bouffon pathétique », un perdant chronique, mais dont le destin est celui d’« une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, pour laquelle il n’existe pas de connaissance directe, au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l’aide de paroles et même d’actions, lesquelles les unes et les autres ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d’ailleurs contradictoires », comme l’a écrit Proust, cité en exergue au début du livre. Cet « itinéraire d’un enfant raté » (titre du roman que Thomas aurait voulu écrire) est celui d’un être qui garde ses mystères.
Jean-Pierre Longre
16:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, catherine cusset, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/02/2018
Confidences de femmes
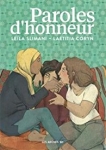 Leïla Slimani, Laetitia Coryn, Paroles d’honneur, Les Arènes BD, 2017
Leïla Slimani, Laetitia Coryn, Paroles d’honneur, Les Arènes BD, 2017
Leïla Slimani, on le sait, a obtenu le prix Goncourt pour son roman Chanson douce en 2016. Peut-être connaît-on aussi son essai intitulé Sexe et mensonges (Les Arènes). Paroles d’honneur en est l’adaptation graphique, faite avec la dessinatrice Laetitia Coryn et, pour les couleurs, Sandra Desmazières. L’occasion pour les auteures de mettre en images, en paroles, en fiction et à la portée de tout le monde le récit et les résultats, sous forme de docu-roman graphique, de conversations que Leïla Slimani a eues, au Maroc, avec Nour et d’autres jeunes femmes à propos de leur vie sexuelle.
« Cette parole vibrante et intense, ces histoires qui m’ont tant émue, qui m’ont mise en colère et parfois révoltée […], cette parole est politique, engagée, émancipatrice », écrit-elle. Il faut attentivement considérer, voir, lire cet ouvrage qui dit et montre la misère sexuelle, l’hypocrisie, l’angoisse parfois ; qui dit et montre la mise à l’écart de celles qui n’entrent pas dans la norme (virginité, mariage plus ou moins consenti, enfants) ; de celles qui, restant célibataires, courent le risque d’être assimilées aux prostituées (elles-mêmes mises au ban de la société mais fréquentées par beaucoup d’hommes) ; des homosexuels, hommes ou femmes… Certes, dans cette société régie par la loi d’une religion mal interprétée, par les tabous familiaux et « le regard de l’autre », tout n’est pas blanc ou noir. Il y a celles qui se révoltent, il y a aussi des hommes compréhensifs, voire eux-mêmes féministes.
La fraîcheur et l’expressivité des dessins, la précision des portraits et la beauté colorée des décors, le naturel et la force des dialogues mettent en scène les drames qui se jouent, souvent en secret, dans la société marocaine, mais aussi les quelques avancées, les petits progrès, et l’optimisme qui émane de la jeunesse, cet optimisme incarné par un jeune ami de Leïla : « Moi, comme beaucoup de mes copains, je ne suis pas d’accord avec cette morale rétrograde et hypocrite qui nous empêche de profiter pleinement de notre jeunesse. Et c’est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Et même si on a du mal à se faire entendre on ne baisse pas les bras. On ne nous fera pas taire. Ce pays changera ! Et j’ai vraiment espoir… ».
Jean-Pierre Longre
09:25 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, essai, francophone, leïla slimani, laetitia coryn, sandra desmazières, les arènes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/02/2018
« Laisser inventer la main »
 Eugène Ionesco, Le blanc et le noir, Gallimard, L’imaginaire, 2017
Eugène Ionesco, Le blanc et le noir, Gallimard, L’imaginaire, 2017
On connaît évidemment le théâtre de Ionesco, moins évidemment ses essais, encore moins ses écrits narratifs. Mais connaît-on son œuvre graphique ? Certes beaucoup plus restreinte que son œuvre littéraire, elle existe bel et bien, dans un esprit créatif similaire à celle-ci. Séjournant à Saint-Gall avec sa femme et sa fille, le dramaturge s’adonna, grâce à des amis, à l’art de la lithographie, et cela donna Le blanc et le noir, publié d’abord en Suisse en 1981, puis en France, chez Gallimard, en 1985. La collection « L’imaginaire », dans laquelle figure cette nouvelle édition, va comme un gant à la main inventive et quelque peu iconoclaste de l’auteur, qui écrit lui-même : « Quand je commence à faire quelque chose, c’est autre chose qui sort. Souvent, c’est mieux, c’est préférable, il faut que le rythme y soit. Le rythme est tout. C’est pour cela, dis-je de nouveau, qu’il faut laisser inventer la main. ».
Les quinze lithographies du livre (en noir et blanc, donc) sont précédées d’une longue introduction et, pour chacune d’entre elles, de commentaires parfois brefs. Pour Ionesco, le dessin semble être une découverte, ou une redécouverte : « Je recommence depuis rien. ». Et à l’imagination s’ajoute « une sincérité totale, naïve. ». À lire ses commentaires, on a l’impression qu'il découvre ses propres dessins, les décrit, les interprète comme peut le faire le lecteur, jusqu’à se questionner. Par exemple, pour le premier, à propos des figures qu’il représente : « Et voici leur chef, le maître, le dictateur, le tyran. Que sont ces quatre têtes déformées, caricaturales qui l’entourent dans les quatre coins de la feuille ? Ce sont ses adjoints, vraisemblablement. ». Ou encore : « Dans le coin de gauche, en haut, encadrée, c’est bien une croix. Une croix bien triste, esseulée. Est-ce parce qu’elle est en manque de crucifié ? Oui, si vous voulez. Mais les pendus ne sont pas de vrais pendus. ».
 Les questions que se pose l’auteur à propos de cette œuvre graphique sont celles qu’il se pose à propos de son œuvre écrite. Les commentaires qui relient les images sont parcourus de réflexions non seulement sur le dessin, mais aussi sur la vie et la mort, sur le remords, sur la foi et la religion, sur le théâtre (qui « parle trop » !), sur le silence et le besoin de sérénité. Et la sincérité toujours, qui permet à l’auteur d’insister sur ses propres contradictions – contradictions et dualité qui, en fait, nourrissent son œuvre : « Je me contredis tout le temps, j’affirme tantôt ceci, tantôt cela. » : blanc et noir, oui et non, bien et mal, tragique et comique, avec ces aveux : « Dès ma première pièce de théâtre, je me suis pris à vouloir écrire la tragédie du langage : ce fut comique. […] Tout ce que je dis est double. […] Il y a peu de choses qui séparent l’horrible du comique. ». C’est écrit à propos du théâtre, mais les lithographies qui composent ce livre en sont une illustration expressive, et un aveu de plus.
Les questions que se pose l’auteur à propos de cette œuvre graphique sont celles qu’il se pose à propos de son œuvre écrite. Les commentaires qui relient les images sont parcourus de réflexions non seulement sur le dessin, mais aussi sur la vie et la mort, sur le remords, sur la foi et la religion, sur le théâtre (qui « parle trop » !), sur le silence et le besoin de sérénité. Et la sincérité toujours, qui permet à l’auteur d’insister sur ses propres contradictions – contradictions et dualité qui, en fait, nourrissent son œuvre : « Je me contredis tout le temps, j’affirme tantôt ceci, tantôt cela. » : blanc et noir, oui et non, bien et mal, tragique et comique, avec ces aveux : « Dès ma première pièce de théâtre, je me suis pris à vouloir écrire la tragédie du langage : ce fut comique. […] Tout ce que je dis est double. […] Il y a peu de choses qui séparent l’horrible du comique. ». C’est écrit à propos du théâtre, mais les lithographies qui composent ce livre en sont une illustration expressive, et un aveu de plus.
Jean-Pierre Longre
11:40 Publié dans Essai, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, dessin, francophone, eugène ionesco, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/02/2018
Prendre conscience du langage
 Radu Bata, Survivre malgré le bonheur, Jacques André éditeur, 2018
Radu Bata, Survivre malgré le bonheur, Jacques André éditeur, 2018
Radu Bata nous a naguère fait boire « le philtre des nuages » jusqu’à l’ivresse, et il nous enjoint maintenant de « survivre malgré le bonheur ». Titre paradoxal, non ? Mais attention : si on lit bien le texte « Partie de plaisir » (page 47), on mesure la malice fortement teintée de satire, puisqu’il s’agit de « survivre malgré le bonheur / produit à la chaîne / […] malgré la menace de félicité / qui nous gouverne ». Toute une philosophie. Si le poète joue avec les mots (et il ne s’en prive pas !), avec leurs sonorités, leurs rythmes, leurs ambiguïtés, leurs affinités, leurs contradictions, leurs bizarreries, c’est pour mieux nous faire prendre conscience du langage, de son infinie portée, se son insondable profondeur, de sa beauté originelle.
Car cette conscience ne va pas de soi. Sous l’allure facile de l’écriture (les maintenant fameuses « poésettes », poésie « sans prise de tête »), se tapissent la séduction stylistique et la recherche linguistique, se mêlent le plaisir et le travail – d’une manière d’autant plus étroite que cela se conçoit sous la plume d’un écrivain qui a fait le choix personnel de la langue française, en connaissance de cause ; d’un écrivain pour qui sont compatibles les expressions les plus actuelles et les thèmes permanents de la poésie, les suites fluides de strophes et la forme compacte du haïku (entre autres).
L’œuvre de Radu Bata vise à réconcilier les générations montantes avec la poésie. La réussite de l’entreprise est certaine. Cependant il y a, aussi, large matière à étude poéticienne. On s’en gardera ici, mais les références littéraires, les motifs récurrents, tels l’amour et ses aléas, le temps qui passe et le vieillissement, l’exil (qui « n’est heureux que parmi les mots »), les origines roumaines (« je fais des allers-retours / entre les deux langues »), d’autres encore, incitent à une lecture où se combinent le plaisir immédiat et l’attention soutenue, où se révèle le double bonheur de la rêverie et de la méditation.
Et il y a les nuages, éphémères ou permanents, rêvés ou réels, blancs ou gris, capables de tout et à l’origine de tout (« nous sommes les enfants / des nuages »), les nuages qui apparaissent et disparaissent au gré des pages, les « nuages sans patrie » - ceux de l’étranger, de l’exilé, du voyageur –, les nuages joyeux, les nuages qui pleurent… Il n’y a pas qu’eux, bien sûr, mais ils peuplent si bien le recueil qu’on ne peut pas ne pas les assimiler à la poésie même de Radu Bata – comme les illustrations qui ponctuent les poèmes, ces belles images oniriques et colorées, teintées de fantastique et de surréalisme que quinze artistes offrent aux mots du poète et aux yeux du lecteur.
Que peut-il faire, ce lecteur, sinon continuer à lire, à relire, à contempler ? Et inciter ses semblables à lire, relire, contempler. Foin (et fin) des commentaires, laissons la place à l’œuvre et aux traces qu’elle laisse en nous.
l’œuvre compte moins
que l’ombre
qui s’en dégage
et finalement :
pour avoir longtemps appris
à parler avec les gens
j’enseigne
aujourd’hui
le silence
Jean-Pierre Longre
10:01 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, images, francophone, roumanie, radu bata, jacques andré éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/01/2018
Une symphonie pathétique
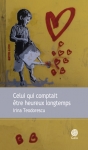 Irina Teodorescu, Celui qui comptait être heureux longtemps, Gaïa, 2018
Irina Teodorescu, Celui qui comptait être heureux longtemps, Gaïa, 2018
Avec La malédiction du bandit moustachu et Les étrangères, on avait déjà apprécié le talent et la force romanesque d’Irina Teodorescu : l’art de conter, le maniement à la fois subtil et truculent de la langue, le mélange tonique des registres, la structure rythmée des phrases, les harmonies sonnantes du style… Celui qui comptait être heureux longtemps non seulement confirme ces qualités, mais ajoute un troisième volet à une œuvre qui se fraie un chemin original et engageant dans la jungle de la littérature contemporaine de langue française, se jouant des embûches, bravant avec succès tous les dangers.
La vie de Bo commence sous les bombardements. C’est la fin (espère-t-on) de la guerre, et sa mère accouche en catastrophe de celui qu’attend un avenir prometteur. Étudiant brillant, chercheur hors pair, bricoleur et inventeur tout azimut, Bo mène une vie amicale, amoureuse et studieuse de jeune homme qui tente tant bien que mal de supporter la « Nouvelle Société » qui se « construit » sous la férule du « Haut Dignitaire », de ses sbires et de ses espions – « Nouvelle Société » dont l’appellation ironiquement transparente désigne le totalitarisme qu’a subi la Roumanie natale de l’auteure. Après une relation passionnelle et en pointillés avec la longue et brune Irenn, « Bo rencontre Di » (voilà un refrain qui sonne comme de réjouissantes petites notes musicales), et de leur union va naître un fils, joie du couple, bonheur de Bo : « Voilà que la présence de cette femme a fini par rassasier Bo et son vorace désir d’amour, voilà que le sourire de ce bébé à la pêche illumine et adoucit et chauffe et apaise. ». Mais l’enfant est malade, et pour le sauver il faudrait le faire soigner en France. Les autorités de la « Nouvelle Société » en profitent pour soumettre Bo à un odieux chantage. Dilemme cruel, choix mortel, désespoir profond. « Et les crabes continuent à se marcher dessus et les rats à sauter dans le vide les uns après les autres, ils se suivent et s’entraînent vers leur mort bête et les poulets mangent encore de la merde dans les batteries, mon fils, alors ce monde, mon fils, ce monde ne te valait pas, ne te méritait pas, dans ce monde les gens vomissent leurs maux sur les autres, sans réfléchir, sans penser ».
On le voit, on l’entend, on le sent, le style d’Irina Teodorescu est d’une vigueur qui n’a d’égale que sa sensibilité. Des pages de satire tragi-comique (par exemple sur la paperasse imposée par la bureaucratie à chaque individu qui « n’est qu’un formulaire dans ce pays ») voisinent avec des tirades d’une poésie ressassante, profonde, prenante. Lorsque l’humour affleure, c’est pour mieux contenir la douleur et la rage ; lorsque l’émotion éclate, c’est pour exprimer la tendresse et l’amour ; lorsque le rêve prend son vol, s’est pour faire oublier la mort. Et il y a la musique, celle des disques que les jeunes gens écoutent passionnément, et celle des mots et des phrases qui s’agencent et se superposent, sur des tempos et des rythmes variés, en une vaste symphonie pathétique.
Jean-Pierre Longre
14:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, irina teodorescu, gaïa-éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/12/2017
De Bucarest à MK2
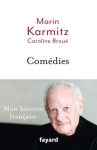 Marin Karmitz, Caroline Broué, Comédies, Fayard, 2016
Marin Karmitz, Caroline Broué, Comédies, Fayard, 2016
Né en Roumanie en 1938, Marin Karmitz est devenu, comme on le sait, l’un des hommes de cinéma les plus notoires, aussi bien en France qu’à l’étranger. Son livre Comédies (qui reprend au pluriel le titre beckettien de l’un de ses premiers courts métrages), écrit en dialogue avec Caroline Broué (qui n’hésite pas à intervenir périodiquement en son propre nom), retrace un itinéraire plein d’expériences diverses, de contradictions parfois, d’illusions, d’espoirs, de déchirements, de créations importantes, la vie d’un homme dont les « idées, en matière de cinéma, de politique, d’art, ont été élaborées en se confrontant au réel. ».
Cela commence, au début des années 1940, avec les menaces fascistes contre la famille « issue de la bourgeoisie juive roumaine », qui fuyant Bucarest se réfugie dans la station montagnarde de Sinaia (des « souvenirs extraordinaires » pour Marin), s’exile en 1947 par bateau jusqu’à Marseille et s’installe à Nice, puis à Paris.
« J’ai voulu faire du cinéma parce que j’étais incompétent ailleurs. Je dessinais mal, je ne savais pas écrire, je n’avais pas l’oreille musicale, j’étais piètre acteur. Ma mère me destinant à une carrière artistique, il ne restait que le septième art. ». Aveu bien modeste pour un homme qui a eu une telle carrière de réalisateur, de producteur, de distributeur (et aussi de photographe), pour le fondateur de MK2, pour un créateur qui a toujours voulu donner « une autre idée du cinéma », parfois « seul contre tous », un créateur qui, dit-il, « reste un passeur, un intermédiaire entre l’œuvre et le public. ». L’ouvrage retrace nombre de péripéties, évoque les rencontres et amitiés (avec Chabrol, Godard, bien d’autres encore), les inimitiés aussi, développe les idées, sans négliger le parcours politique qui le mène de la gauche prolétarienne à la présidence du « Conseil de la création artistique » voulu par Nicolas Sarkozy – ce pourquoi il a été attaqué, mais dont il se justifie en énumérant les projets, aboutis ou non, de ce Conseil, et en invoquant l’intérêt général, mais aussi ses déceptions (« J’ai compris pourquoi on ne pouvait lutter que de l’extérieur, et pourquoi vouloir infléchir les choses de l’intérieur est une illusion. »).
Homme de culture avant tout, homme de liberté, de révolte et d’indépendance, obstiné « à rester droit au milieu de l’adversité », Marin Karmitz, après le bilan de tout ce qui a fait un destin hors du commun, termine avec la « transmission » de ses réalisations à ses fils et avec un retour sur son pays d’origine, la Roumanie qu’il a redécouverte, un pays devenu « un autre monde ». L’avenir et le passé, donc, encadrant et nourrissant un récit vivant, illustré de photos et de documents évocateurs, à lire pour l’homme que l’on y découvre, pour la vie et l’histoire du cinéma et plus généralement de la culture.
Jean-Pierre Longre
18:44 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, cinéma, marin karmitz, caroline broué, fayard, jean-pierre longre, roumanie | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/11/2017
Thérapie littéraire
 Alexandre Gefen, Réparer le monde, la littérature française face au XXIème siècle, éditions Corti, « Les Essais », 2017
Alexandre Gefen, Réparer le monde, la littérature française face au XXIème siècle, éditions Corti, « Les Essais », 2017
« À quoi sert la littérature ? ». Vaste et traditionnel sujet de dissertation face auquel le lycéen se trouve souvent démuni ou, s’il a quelques connaissances, peut se référer à juste titre à Aristote (enseigner, plaire, émouvoir), et pourquoi pas évoquer la « catharsis »… Alexandre Gefen ne renie rien de cela, mais y ajoute le fruit de ses réflexions et de son érudition, qu’il applique à la littérature d’aujourd’hui éclairée par celle d’autrefois. Pas de parti pris : l’essayiste se pose en analyste, non en polémiste.
En sept parties, Alexandre Gefen étudie les récentes orientations d’une littérature qui, s’éloignant majoritairement de « l’intransitivité », d’une conception purement esthétique et/ou structuraliste (ce qu’on a vu par exemple avec le Nouveau Roman), se veut « remédiatrice » et fait face « à soi », « à la vie », « aux traumas », « à la maladie », « aux autres », « au monde » et « au temps ». On a donc affaire à une écriture du sujet (souvent à la première personne) qui reprend ou renouvelle la tradition de l’autobiographie et de la biographie, à une écriture du témoignage et de l’empathie (une « éthique du care »), de la solidarité avec les humbles, les « invisibles », les démunis, les migrants… Il y a une « resocialisation de la littérature, qui devient une activité nécessaire d’expression de soi », de même que la lecture devient une activité thérapeutique, réputée pouvoir « changer la vie », voire lutter contre la maladie et la mort (Zabor ou les psaumes, le dernier roman de Kamel Daoud, est entre autres significatif de cette tendance). En tout cas, Alexandre Gefen montre parfaitement comment la littérature actuelle, permettant de mieux connaître l’être humain dans sa complexité, revêt (dans une perspective disons camusienne) une utilité psychologique, sociale, cognitive, et n’exclut pas la réparation rétrospective (Shoah, guerre d’Algérie, génocides récents…).
Bourré de références, s’appuyant sur un corpus aussi riche que divers (avec, on ne s’en étonnera pas, de nombreuses illustrations puisées chez des écrivains comme Annie Ernaux, Philippe Forest, Emmanuel Carrère, François Bon, mais aussi Pascal Quignard, Patrick Modiano ou Georges Perec – on en passe beaucoup), Réparer le monde est un ouvrage à la fois rigoureux et ouvert : pas de conclusion hâtive, pas d’avis définitif. « L’idée d’une réparation individuelle ou sociale par l’art reste un objet de perplexité. » À chacun de se faire son opinion sur l’art littéraire et ses fonctions. « Représenter le bien » ? « Faire le bien » ? Être un pur objet esthétique qui ne trouve sa finalité qu’en soi ? Grâce au livre d’Alexandre Gefen, la réflexion avance, même si les interrogations (et les éventuelles réponses) demeurent, inséparables de leur préalable (autre sujet ardu pour les futurs bacheliers) : « Qu’est-ce que la littérature ? ».
Jean-Pierre Longre
15:00 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, alexandre gefen, éditions corti, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/11/2017
Les « chemins de traverse » de l’écriture
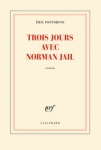 Lire, relire... Éric Fottorino, Trois jours avec Norman Jail, Gallimard, 2016, Folio, 2017
Lire, relire... Éric Fottorino, Trois jours avec Norman Jail, Gallimard, 2016, Folio, 2017
« L’écriture est un chemin aussi imprévisible que le vol d’un papillon. ». Vérité absolue ou assertion de circonstance ? C’est en tout cas ce que Norman Jail, écrivain retiré du monde, qui a publié un seul roman dans sa jeunesse, répond à l'étudiante venue s’entretenir avec lui. Il s’avère toutefois que sa bibliothèque est remplie de ses propres manuscrits signés de noms différents. « L’important est que chaque signataire est une part de moi. Nous ne sommes pas des êtres stables. Êtes-vous la même personne que ce matin ? Par moments, assez longs il est vrai, je suis Norman Jail. D’autres fois, je suis plus que jamais Alkin Shapirov, ou Omar Sen, et parfois encore, le temps d’écrire le pire en rêvant du meilleur, je suis le nom de mon état civil. ».
Écrivain mystérieux, donc, qui n’hésite pas à dévoiler à celle qui est venue l’interroger avec une certaine appréhension les arcanes de son art et l’utilisation qu’il fait des mots et de leurs résonances ludiques, poétiques et musicales. Étonnamment, lui qui a le souci de préserver ses secrets, confie à la lecture de l’étudiante son manuscrit La vie arrive deux fois – titre énigmatique qui s’éclairera peu à peu à la lecture – non sans l’avertir : « “Écrire″ contient “crier”, n’est-ce pas ? Dans “écrire″, il y a “rire”, aussi. Écrire c’est rire, lança-t-il d’un air sinistre. Et rire est une autre façon de pleurer. ».
 Alors, peu à peu, le lecteur découvre (ou tente de découvrir) avec Clara se qui se cache sous l’étrange manuscrit composé uniquement de chapitres 1… Norman Jail et Clara deviennent personnages du manuscrit comme du livre d’Éric Fottorino, observateurs, créateurs et acteurs d’une fiction qui met dramatiquement l’Histoire collective et l’histoire familiale en perspective. Récit tortueux, fait de va-et-vient, de repentirs, de reprises, Trois jours avec Norman Jail est un dialogue littéraire plein de rebondissements didactiques, un récit à tiroirs plein de pièges narratifs, un roman avec lequel on aime se perdre dans les sinuosités des « chemins de traverse » de l’écriture.
Alors, peu à peu, le lecteur découvre (ou tente de découvrir) avec Clara se qui se cache sous l’étrange manuscrit composé uniquement de chapitres 1… Norman Jail et Clara deviennent personnages du manuscrit comme du livre d’Éric Fottorino, observateurs, créateurs et acteurs d’une fiction qui met dramatiquement l’Histoire collective et l’histoire familiale en perspective. Récit tortueux, fait de va-et-vient, de repentirs, de reprises, Trois jours avec Norman Jail est un dialogue littéraire plein de rebondissements didactiques, un récit à tiroirs plein de pièges narratifs, un roman avec lequel on aime se perdre dans les sinuosités des « chemins de traverse » de l’écriture.
Jean-Pierre Longre
23:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, Éric fottorino, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/11/2017
« Marie la bien nommée »
 Lire, relire... Jean-Philippe Toussaint, Nue, Les éditions de minuit, 2013, rééd. Minuit Poche 2017
Lire, relire... Jean-Philippe Toussaint, Nue, Les éditions de minuit, 2013, rééd. Minuit Poche 2017
Cela commence avec une robe de miel bourdonnante dont on a enduit le corps entier d’un top-modèle au cours d’un défilé de mode hors du commun, et se termine (ou presque) avec une « odeur de chocolat qui semblait couler du ciel comme une résine de pin gluante et recouvrait le manteau de Marie, pour le napper, lentement, l’enrober, le saupoudrer d’une fine pellicule chocolatée. ». Entre miel et chocolat, entre douceur artificielle et écoeurement latent, entre Tokyo et l’île d’Elbe, il y a Paris et la longue attente d’un coup de téléphone, dans laquelle s’incrustent les souvenirs d’« images ensoleillées » ou de scènes saugrenues, telle celle qui montre le narrateur, caché sur le toit d’un musée japonais, en train d’espionner par un hublot le vernissage mondain d’une exposition et de tenter d’apercevoir une Marie alors inaccessible.
 Marie inaccessible et invincible, Marie redevenue si proche et si fragile dans la deuxième partie du livre. Car ce dernier volume de la tétralogie Marie Madeleine Marguerite de Montalte est, comme les trois précédents (Faire l’amour, Fuir, La vérité sur Marie), un beau roman d’amour, fait d’allers-retours passionnels entre les deux protagonistes. Un beau roman où les corps et les cœurs dansent une sorte de ballet dont la scène serait aussi vaste que les espaces traversés. Un beau roman fait de sentiments irrépressibles et de sensations profondes (les paysages noirs et nuageux, les odeurs d’incendie, les bruits d’averses, la pluie qui colle à la peau, les mains qui frottent les joues, les parfums de fleurs et de chocolat – tout y est, vue, odorat, ouïe, goût, toucher…).
Marie inaccessible et invincible, Marie redevenue si proche et si fragile dans la deuxième partie du livre. Car ce dernier volume de la tétralogie Marie Madeleine Marguerite de Montalte est, comme les trois précédents (Faire l’amour, Fuir, La vérité sur Marie), un beau roman d’amour, fait d’allers-retours passionnels entre les deux protagonistes. Un beau roman où les corps et les cœurs dansent une sorte de ballet dont la scène serait aussi vaste que les espaces traversés. Un beau roman fait de sentiments irrépressibles et de sensations profondes (les paysages noirs et nuageux, les odeurs d’incendie, les bruits d’averses, la pluie qui colle à la peau, les mains qui frottent les joues, les parfums de fleurs et de chocolat – tout y est, vue, odorat, ouïe, goût, toucher…).
Le tout dans une prose à la fois évidente et complexe, précise et fine, entre ressassante et dynamique. Une prose autant dire poétique, qui métamorphose paysages et personnages en objets esthétiques – à la manière de cette séquence où l’on voit Marie enceinte transfigurée en Annonciation italienne de la Renaissance. Et où l’on voit que la vraie littérature n’est rien d’autre que de l’art.
Jean-Pierre Longre
09:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-philippe toussaint, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
La boule du destin
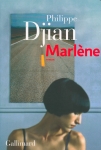 Philippe Djian, Marlène, Gallimard, 2017
Philippe Djian, Marlène, Gallimard, 2017
De retour des guerres du Moyen-Orient, Dan et Richard, amis de toujours, se retrouvent dans leur ville (américaine sans doute, mais le flou de la localisation laisse le choix au lecteur), confrontés aux difficultés de la réadaptation à la vie civile et pacifique – famille, argent, amis… Dan se force à une discipline quotidienne (travail, horaires réguliers, hygiène absolue allant jusqu’aux tocs), tandis que Richard (dont la femme Nath s’arme de patience et la fille Mona manifeste sa révolte adolescente), Richard donc, dans son « horreur de la discipline », n’arrive pas à se couler dans le moule de l’existence raisonnable. Dan, qui a pris Mona sous son aile protectrice et sauve la mise de Richard, semble être le pilier discrètement porteur de ce petit monde. « Contrairement à Richard, Dan était d’avis qu’il fallait rentrer dans le rang, faire profil bas en attendant de reprendre pied, le cours d’une vie normale, et ce n’était pas en traînant avec tous les zombies du coin, en se faisant remarquer, que l’on pourrait y parvenir. C’était déjà assez dur comme ça. ».
L’arrivée de Marlène, sœur de Nath, au milieu de l’apparente unité familiale et amicale, crée une perturbation qui va s’amplifier. Perturbation bénéfique ou maléfique ? Il y a une sorte de bonheur, semble-t-il, autour de cette jeune femme enceinte un peu maladroite, un peu mystérieuse, mais aussi des malheurs soudains et durables. Le roman, par vagues successives, tourne autour du personnage qui lui donne son titre. Même lorsqu’il ne s’agit pas directement d’elle, Marlène est là, en relief ou en filigrane, qui provoque ces vagues.
Les personnages sont ainsi ballottés, voire renversés à la manière des quilles du bowling dont s’occupe Dan. Ils apparaissent, disparaissent, comme balayés par la boule du destin, en séquences aussi rapides qu’au cinéma, d’une péripétie à l’autre sans transition. Avec sa vivacité de ton, avec ses mots percutants (chaque chapitre est d’ailleurs lancé par un substantif isolé à la figure du lecteur), Philippe Djian a l’art de se mettre, de nous mettre dans la peau de ses personnages, de les fouiller de l’intérieur, de les confronter à leurs désirs, à leurs contradictions, à leurs passions, à leurs tragédies. Le tout au rythme palpitant d’une langue et d’un style incisifs.
Jean-Pierre Longre
08:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe djian, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2017
« L’émotion ancestrale »
 Nancy Huston, Sensations fortes, Actes Sud/Leméac, 2017
Nancy Huston, Sensations fortes, Actes Sud/Leméac, 2017
Neuf nouvelles de sujets et de factures diverses écrites entre 1975 et 1997, la plupart déjà publiées en volumes collectifs ou en revues… On pourrait penser que Nancy Huston a ouvert quelques-uns de ses tiroirs pour confectionner, avec la complicité des éditions Actes Sud et Leméac, un séduisant petit ouvrage au succès pratiquement assuré.
Oui, l’ouvrage est séduisant, mais d’une séduction plutôt violente, et sa diversité n’est qu’apparente. Le titre est explicite : puisées dans la vie réelle ou dans l’imaginaire, les sensations sont effectivement fortes et bousculent le lecteur, d’une manière ou d’une autre. On assiste par exemple, dans des récits à coloration kafkaïenne, à la métamorphose d’une femme en arbre, ou à l’errance supposée d’une jeune japonaise dans le métro parisien ; dans une nouvelle datée de 1986, le mur de Berlin devient une paroi transparente, témoignage concret et artistique de la « glasnost » inaugurée à l’époque ; les souvenirs sont là aussi, avec la tentative « d’une fugue définitive » de la narratrice et de son frère. Mais « il était difficile, dans la famille Huston, de quitter Edmonton en 1960. », comme il est difficile à tout un chacun d’échapper à son destin.
La quête de ce recueil est celle de « l’émotion ancestrale » que retrouve Miki « la pleureuse » : « cette nausée et ce vertige, ce besoin de se vider, de se retourner comme un gant, d’interrompre tous les processus vitaux et de trembler jusqu’à la transparence. ». Pour surprenantes que soient les péripéties que relatent ces textes, leur force est bien là : chercher le vrai au tréfonds de l’âme individuelle et collective.
Jean-Pierre Longre
14:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, nancy huston, actes sud, leméac, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/10/2017
Une initiation au paradis
 Dany Laferrière, Le goût des jeunes filles, Zulma, 2017
Dany Laferrière, Le goût des jeunes filles, Zulma, 2017
Comme par un processus naturel dont le moteur serait l’éveil des sens, après « l’odeur du café », il y a « le goût des jeunes filles » : après l’enfance à Petit-Goâve, racontée dans le premier volume (L’odeur du café, Zulma, 2016), il y a l’adolescence et ses rites initiatiques à Port-au-Prince, ville de tous les dangers et de tous les plaisirs.
Fanfan, que l’on retrouve sous différents noms (Vieux-Os, Dany) d’un « roman » à l’autre (d’un récit autobiographique à l’autre, ce « mélange de fiction et de réalité », comme le dit le narrateur à l’une de ses tantes qui l’accuse de n’avoir rien dit de vrai dans son livre), le jeune garçon donc a la particularité de franchir le passage à l’âge d’homme en un week-end fort agité. À la suite de ce qu’il croit être un abominable et périlleux crime commis par son ami Gégé, Dany se réfugie en face de chez lui, « du côté ensoleillé de la rue », chez les « jeunes filles » dont, de sa fenêtre, il guettait la vie en constante ébullition. Jeunes filles en fleurs conscientes de leurs charmes, et qui en usent sans vergogne pour pouvoir goûter aux joies de ce monde ; jeunes filles qui, sans le savoir, vont « changer la vie » du garçon. Chez Miki et ses amies, ce « paradis » rêvé, il va non seulement observer une vie à laquelle il n’avait pas accès jusqu’ici, mais aussi assouvir des désirs latents et éclatants, plonger dans le monde méconnu du plaisir des sens, inséparable du plaisir esthétique.
Car l’initiation n’est pas seulement physique, elle est aussi poétique : Fanfan découvre avec avidité le poète Magloire Saint-Aude, dont les vers le nourrissent et rythment ses instants secrets, comme ils rythment en exergue chacune des scènes du récit rétrospectif. Nous ne sommes pas seulement dans un livre de souvenirs – souvenirs certes qui, à eux seuls, mériteraient qu’on s’y intéresse, puisqu’ils situent l’existence intime et sociale du héros à Haïti, l’île natale, entre les dictatures de « Papa » et de « Baby » Doc, cette période où les « Tontons Macoute » faisaient la loi, ne respectant que la caste des privilégiés qui jouaient leur jeu. Le goût des jeunes filles (comme les autres ouvrages de Dany Laferrière) n’est pas non plus un simple document psychologique, sociologique, historique, exotique ; son épaisseur est véritablement littéraire, et c’est sans doute pour donner plus de poids au « réel » narratif que l’auteur a combiné avec la théâtralisation du récit (39 « scènes » cinématographiques et vivantes actualisant l’intrigue) le « Journal de Marie-Michèle », jeune bourgeoise qui, en révolte contre sa mère et son milieu (le « Cercle » fermé qui monopolise argent et pouvoir), se mêle aux « jeunes filles », tout en notant ses observations sur la société haïtienne et ses propres réactions face à la vie. Il y a donc une double narration, un double regard, ceux de Fanfan et de Marie-Michèle, à la fois très différents (le garçon du petit peuple et la fille de la caste dirigeante) et très analogues (tous deux se glissent, se coulent, se fondent, se cachent pour mieux observer) ; deux récits aux tons différents (scènes vivantes et dialoguées, journal intime), encadrés et dominés par un troisième narrateur, l’auteur adulte en visite chez ses tantes à Miami et confronté à sa destinée ; trois récits donc témoignant de la même préoccupation littéraire, du même amour de la poésie et de l’écriture.
Haïtien et Québécois, membre de l’Académie Française depuis 2013, Dany Laferrière est l’un des grands écrivains de l’espace francophone international, et Le goût des jeunes filles, réédité fort à propos par les éditions Zulma après L’odeur du café, Le charme des après-midi sans fin et Le cri des oiseaux fous, confirme s’il en est besoin l’évidente validité esthétique de son œuvre.
Jean-Pierre Longre
18:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, haïti, dany laferrière, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/07/2017
Perec, la réapparition
 Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Georges Perec, Œuvres I et II, sous la direction de Christelle Reggiani, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Claude Burgelin, Album Georges Perec, Bibliothèque de la Pléiade, NRF/Gallimard, 2017.
Une parution en Pléiade, c’est à la fois un moment et un monument. À plus forte raison en ce qui concerne Georges Perec – et Christelle Reggiani commence son introduction, « Un peintre de la vie moderne », en insistant sur la combinaison entre « l’éternel et l’éphémère » qui apparaît, par exemple, dans Les Revenentes, mais aussi un peu partout. L’écrivain lui-même voyait dans son oeuvre « quatre champs différents, quatre modes d’interrogation » : les interrogations « sociologique », « autobiographique », « ludique » et « romanesque ». Ce qui réfère par exemple, pour évoquer les œuvres les plus connues, aux Choses, à W ou le souvenir d’enfance, à La disparition et à l’Oulipo, à La vie mode d’emploi. On pourrait ajouter que toute l’œuvre est traversée par le « rapport à l’histoire » et par « la mise sous contrainte de l’écriture », dont les liens sont étroits. Cela dit, Christelle Reggiani complète ces quatre « champs » par « deux pôles contraires » dans l’écriture : celui de la « blancheur » ou de la « platitude » et celui de « l’hermétisme affiché de la poésie hypercontrainte ».
 Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…
Voici qui découle de tout cela : l’œuvre de Perec est « profondément moderne », comme le furent celles de Rabelais ou Proust, et elle est devenue « classique », échappant au « flux temporel ». Justification, s’il en fallait une, des deux volumes de la Pléiade qui viennent de paraître, sous la direction, donc, de Christelle Reggiani, avec la collaboration de Dominique Bertelli, Claude Burgelin, Florence de Chalonge, Maxime Decout, Maryline Heck, Jean-Luc Joly et Yannick Séité. Depuis Les choses jusqu’à L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, le lecteur a tout loisir de tenter d’épuiser les espaces et les lieux d’une œuvre dont le mode d’emploi relève du mystère et de l’infini, de l’artisanat et du labyrinthe, du jeu d’échec et du puzzle ; tout loisir de tenter de s’en souvenir et de jouer avec les éléments de construction qui la soutiennent. Avec cela tous les ingrédients d’une telle édition sont présents : textes scrupuleusement établis, notices et notes précises pour chaque ouvrage, appendices et « marges », chronologie, bibliographies…
Et pour parfaire l’ensemble, Claude Burgelin, qui a bien connu l’écrivain, signe un très bel Album Georges Perec. Selon le modèle du genre, la biographie de l’auteur est parsemée de photos, de documents qui ne peuvent laisser indifférent, car ils mettent en avant une autre sorte de dualité de l’homme et de son œuvre, résumée dans ce paragraphe : « Perec a fait s’écrouler de rire des milliers de lecteurs ou d’auditeurs. Sa verve, sa drôlerie, sa façon de rendre sublime l’art du calembour sont étincelantes. En même temps son œuvre est issue d’une des pires barbaries de l’Histoire. Perec ne l’a jamais laissé oublier. Il n’a cessé de réfléchir à ce que fut le crime nazi et aux catastrophes qu’il a provoquées. Sa manière de faire tournoyer la force du comique, de l’ironie, et la violence de la tragédie met en place un ressort d’une rare puissance. ». C’est ainsi que l’écriture absolument maîtrisée de Perec est aussi une écriture de l’émotion absolue.
Jean-Pierre Longre
En complément, une réédition récente :
 Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017
Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud, Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du Go, Christian Bourgois éditeur, 1969, 2003, rééd. 2017
Un rival de la littérature
Né en Chine, introduit au Japon en l’an 735, le jeu de Go est à la fois « esthétique, polémique et cérébral ». Rival de l’art et de la littérature, il demande un bon entraînement et des facultés intellectuelles avérées, et a parfois remplacé, nous dit-on, la guerre elle-même. En tout cas, il paraît que l’attaque de Pearl Harbor et l’occupation du Pacifique par les Japonais relèvent de ce jeu. Duel mené à coups de pièces noires et blanches sur une sorte de damier (le Go Ban), le Go pourrait faire penser aux Dames ou aux Échecs ; non, nous disent les auteurs, c’est un jeu beaucoup plus subtil, consistant non pas à détruire les adversaires, mais à occuper le plus de terrain possible avec le minimum de pièces (ou pierres).
 Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...
Évidemment, ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans le détail des règles, du déroulement d’une partie, des tactiques possibles. Il suffit de renvoyer au livre lui-même, dont on pourrait croire à première vue que, pour un non initié, la lecture est ardue. Eh bien il n’en est rien... Ce « petit traité », réédition d’un ouvrage paru en 1969, est bien une « invitation à la découverte » : il se lit facilement, à condition qu’on se laisse entraîner peu à peu, en toute innocence, dans « l’art subtil du Go », et qu’on ne prétende pas à cette lecture seule devenir un expert ou un champion. En quatre chapitres, « Célébrations » (sorte d’historique facultatif mais plus qu’intéressant), « La règle » (où commencent les choses sérieuses), « Le jeu ; tactiques et stratégies élémentaires » (où l’élémentaire commence à être affaire de spécialistes), « Saturation » (où s’esquissent des comparaisons et considérations périphériques), Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud font pénétrer le jeu de Go dans nos esprits bornés par les échecs et dans un pays (la France) où il ne connaît pas le succès mérité. Et même si l’on n’entre pas dans tous les détails, on a l’impression de comprendre, et même, parfois, de devenir intelligent...
Évidemment encore, l’ouvrage n’est pas exempt de cet esprit oulipien qui guide les auteurs, dans leur perspective à la fois sérieuse et récréative. Aux définitions, aux éléments de tactique, au traitement des problèmes stratégiques, aux conseils décisifs se mêlent des intermèdes narratifs, des jeux verbaux, des imitations (un beau pastiche de Kipling), des allusions littéraires etc. Voilà qui contribue grandement au plaisir que nous éprouvons à lire ce livre, quel que soit notre passé, notre présent et notre avenir dans la pratique du jeu de Go. Et si celui-ci rivalise avec la littérature, n’hésitons pas à affirmer que ledit livre est autant une œuvre littéraire qu’un « petit traité ».
Jean-Pierre Longre
www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-P...
http://associationgeorgesperec.fr
10:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, poésie, autobiographie, essai, francophone, georges perec, christelle reggiani, dominique bertelli, claude burgelin, florence de chalonge, maxime decout, maryline heck, jean-luc joly, yannick séité, pierre lusson, jacques roubaud, christian bourgois, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/07/2017
L’art de l’entre-deux
 Gaëlle Josse, L’ombre de nos nuits, Les Éditions Noir sur Blanc, 2016, J’ai Lu, 2017
Gaëlle Josse, L’ombre de nos nuits, Les Éditions Noir sur Blanc, 2016, J’ai Lu, 2017
Il y a dans L’ombre de nos nuits deux récits et trois voix. À Lunéville, en 1639, dans cette Lorraine tourmentée par la guerre, le paisible atelier de Georges de La Tour va voir naître, sous les pinceaux du maître, le magnifique Saint Sébastien soigné par Irène, tableau pour lequel il emprunte des traits familiers : ceux de sa fille Claude, de la fille de sa servante, Marthe, et du fils de voisins. Le peintre rapporte lui-même les étapes de son travail, ses difficultés, ses réussites, ses ambitions (celle, notamment, de porter son œuvre au roi de France). De son côté, son apprenti Laurent, orphelin recueilli par la famille, raconte ce qu’il voit, entend, fait – et les deux voix se superposent et se complètent mutuellement, donnant deux visions de l’élaboration du chef-d’œuvre.
En alternance, nous nous retrouvons périodiquement à notre époque. À Rouen, au printemps 2014, une jeune femme, troisième narratrice, découvre entre deux trains le tableau de Georges de La Tour. La vision d’Irène penchée sur le corps blessé de Saint Sébastien lui rappelle l’amour passionné, tourmenté qu’elle a éprouvé pour B, et qu’elle croyait avoir oublié. Occasion pour elle de revivre les enthousiasmes, les attentes déçues, les souffrances de l’amour, de remonter jusqu’à certains épisodes sombres de son enfance.
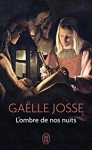 Peu de rapports, dira-t-on, entre les deux histoires. En apparence. Bien sûr, du XVIIe siècle au XXIe, le tableau établit un lien concret. Mais au travers et au-delà de l’œuvre peinte, il y a ce que contient, avec subtilité et sensibilité, l’écriture romanesque. Les parallèles s’ouvrent entre la peinture et l’amour : « Comment un peintre aborde-t-il un sujet ? Comme un nouvel amour ? Collision frontale ou lente infusion ? La claque ou la pieuvre ? Le choc ou la capillarité ? Plein soleil ou clair-obscur ? Toi, tu m’avais éblouie. Ensuite, je me suis aveuglée. ». Surtout, se dessinent le jeu des ombres et des lumières, ces entre-deux que l’art et la vie ménagent : « Nous sommes à la lisière de l’ombre et du feu, du souffle et du silence, c’est ce que je tente de montrer sur mes toiles. J’y vois le sens de notre condition humaine, sans cesse oscillant entre la joie et la peine, la bonté et la haine, la main tendue et le poing fermé, les élans les plus généreux et les pensées les plus noires. ». C’est bien de cela qu’il s’agit, comme souvent chez Gaëlle Josse : saisir par le verbe et son agencement mystérieux les sensations cachées sous les gestes de la vie et les rapports humains. Cela passe forcément par l’art. Ici, celui des couleurs et des lumières, celui des sons, celui des mots.
Peu de rapports, dira-t-on, entre les deux histoires. En apparence. Bien sûr, du XVIIe siècle au XXIe, le tableau établit un lien concret. Mais au travers et au-delà de l’œuvre peinte, il y a ce que contient, avec subtilité et sensibilité, l’écriture romanesque. Les parallèles s’ouvrent entre la peinture et l’amour : « Comment un peintre aborde-t-il un sujet ? Comme un nouvel amour ? Collision frontale ou lente infusion ? La claque ou la pieuvre ? Le choc ou la capillarité ? Plein soleil ou clair-obscur ? Toi, tu m’avais éblouie. Ensuite, je me suis aveuglée. ». Surtout, se dessinent le jeu des ombres et des lumières, ces entre-deux que l’art et la vie ménagent : « Nous sommes à la lisière de l’ombre et du feu, du souffle et du silence, c’est ce que je tente de montrer sur mes toiles. J’y vois le sens de notre condition humaine, sans cesse oscillant entre la joie et la peine, la bonté et la haine, la main tendue et le poing fermé, les élans les plus généreux et les pensées les plus noires. ». C’est bien de cela qu’il s’agit, comme souvent chez Gaëlle Josse : saisir par le verbe et son agencement mystérieux les sensations cachées sous les gestes de la vie et les rapports humains. Cela passe forcément par l’art. Ici, celui des couleurs et des lumières, celui des sons, celui des mots.
Jean-Pierre Longre
10:43 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, les Éditions noir sur blanc, j’ai lu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/06/2017
Laisser dormir le passé
 Francis Dannemark, Martha ou la plus grande joie, Le Castor Astral, 2017
Francis Dannemark, Martha ou la plus grande joie, Le Castor Astral, 2017
Le passé de Martha est douloureux : son mari radiologue « mort d’un cancer foudroyant » en 2011, puis pour elle une grave chute qui a entraîné deux ans d’hospitalisation et de soins divers, ainsi qu’une mémoire défaillante et des réactions parfois déconcertantes. Malgré cela, avec ses gestes et ses mots inattendus et au fond si appropriés, son sourire contagieux et son regard curieux de tout, c’est un vrai bonheur qui émane de toute sa personne.
Avec son frère jumeau Martin (le narrateur), elle rend visite à Jeanne, une dame âgée qui vit dans l’Yonne et a des révélations à leur faire à propos de leur père. Des révélations qui vont plus loin que ce à quoi ils s’attendaient, donnant une dimension nouvelle à la vie et à la personnalité de leur père et de ses relations avec cette vieille femme d’autant plus attachante que son récit est d’une sincérité absolue, nécessaire et vitale : « Jeanne a cessé de parler. Je l’ai vue fermer les yeux, comme s’il s’agissait de se concentrer très fort. Quelques minutes plus tôt, j’avais senti monter en moi une peur sourde, allait-elle s’effondrer, ou s’éteindre comme une bougie ? Non, elle irait jusqu’au terme de son récit. C’est de la force que je sentais en elle maintenant, et j’en étais bouleversé. ».
Autour de l’histoire centrale en tournent quelques autres, en particulier celle de John, écrivain irlandais dont Martin traduit les œuvres, qui est bizarrement accusé de plagiat et qui s’est retiré du monde pour vivre en paix dans un petit village. L’auteur en fait à l’occasion son porte-parole stylistique : « J’ai peur des trop belles phrases. L’important, c’est qu’une phrase soit si juste qu’on en oublie qu’elle est belle. » – et voilà qui se vérifie à la lecture du roman de Francis Dannemark, dont l’écriture comme naturelle ne laisse rien au hasard.
Oublions donc la beauté des phrases pour apprécier celle des personnages et de leur monde. Malgré les accidents de la vie, les incertitudes de la volonté et les caprices du destin, aucun être n’est mauvais ; tous sont profondément humains : Jeanne à coup sûr, et les hommes qu’elle a connus ; Septime le garagiste au grand cœur, qui ravive celui de Martha ; le frère, la sœur et leur famille… Et ces êtres humains, dans leurs gestes, leurs paroles, donnent à l’ensemble une atmosphère apaisante dont l’oubli des fêlures est une condition : « Le passé a bien le droit de dormir maintenant. Moi, en tout cas, je n’ai plus envie de le réveiller. », dit Martha qui préfère contempler les fleurs bleues ; la fleur bleue, cet idéal que, depuis Novalis, beaucoup se sont échinés à chercher, et qui semble ne pouvoir se réaliser que si sa recherche s’accompagne de « la plus grande joie ». Et la vie va s’écouler, paisible comme l’Yonne.
Jean-Pierre Longre
23:33 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, francis dannemark, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/06/2017
Franz, Caroline et la musique
 Gaëlle Josse, Un été à quatre mains, Ateliers Henry Dougier, 2017
Gaëlle Josse, Un été à quatre mains, Ateliers Henry Dougier, 2017
De mai à octobre 1824, quatre ans avant sa mort prématurée, Franz Schubert séjourna au château de Zseliz, résidence estivale de la famille Esterhazy, en tant que maître de musique des deux filles de la maison. Parenthèse rurale de relatif bonheur mêlé de mélancolie et de quelque regret de la vie animée de Vienne – vie de travail, de rencontres, d’espoir artistique, de misère aussi, sans compter la maladie qui l’a miné durant l’année 1823. Le jeune homme timide et peu familier des rites aristocratiques trouve dans la campagne hongroise, malgré les conventions et barrières sociales, une sorte de paix intérieure, de sérénité baignée de musique, et l’amour de la fille cadette des Esterhazy, Caroline ; amour jamais révélé, sinon par quelques coups d’œil involontaires et quelques gestes à peine esquissés.
Gaëlle Josse relate ici l’histoire romancée de cet amour, qui fait corps avec la musique : « C’est pour elle que tout lui vient, là, toute cette musique qui déferle, qui l’envahit et qu’il reçoit comme elle lui vient, une source vive, un jaillissement ininterrompu. ». Un amour dont on se doute qu’il est secrètement partagé, qui est pourtant voué à l’inaccomplissement et qui précipitera le départ de Franz. Resteront dans leur mémoire les regards échangés, une « main abandonnée » et « toute cette musique partagée ». Autour du récit principal se profilent d’autres épisodes de l’existence du compositeur, des rappels de sa vie viennoise, de ses difficultés, de ses travaux. Gaëlle Josse, dont nous apprenons dès le début du livre que la musique de Schubert l’ « accompagne depuis longtemps, depuis toujours », connaît parfaitement sa vie et son œuvre.
Surtout, ces pages, rythmées par les vers de La belle meunière, sont un hymne à l’amour et à la musique, inséparables l’un de l’autre ; la narration romanesque, l’analyse psychologique et artistique sont menées avec la délicatesse poétique que l’on trouve dans d’autres œuvres de l’auteure. « Schubert parle au cœur, en accompagnant les plus ténus, les plus impalpables de nos états émotionnels intérieurs, sa musique nous atteint avec une désarmante simplicité, comme la main d’un ami posée sur notre épaule. Si peu de choses, bien souvent, pour y parvenir. Si peu de notes, parfois, pour nous réjouir ou nous consoler. ». On pourrait en dire autant de la prose harmonieuse de ce dense et bref roman.
Jean-Pierre Longre
12:02 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, musique, franz schubert, gaëlle josse, ateliers henry dougier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/05/2017
« Le goût des mots »
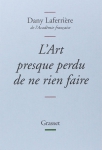
Dany Laferrière, L’art presque perdu de ne rien faire, Grasset, 2014, Le livre de poche, 2017
Ne nous y trompons pas. Même si, çà et là, y figurent des textes intitulés « L’amateur de sieste », « Éloge de la lenteur » ou « L’art de dormir dans un hamac », même si la nonchalance y est avec bonheur communicative, le livre de Dany Laferrière n’est pas un livre de vrai paresseux. C’est une somme de réflexions, de méditations, de variations, de confidences, d’analyses sur des sujets liés à l’existence humaine en général et à l’expérience de l’écrivain en particulier, et pour lesquels, certes, la tranquillité est de mise.
Vingt-trois chapitres eux-mêmes composés de plusieurs textes autonomes, que l’on peut lire comme les Essais de Montaigne, « à sauts et à gambades », avec la lenteur voulue, que l’on peut savourer, garder en bouche tout en se laissant aller aux rêveries et aux pensées qu’ils suscitent. C’est un choix infini de thèmes et de motifs qui nous est proposé : le temps, les rapports sociaux, l’amour, la mort, les voyages, la culture, le plaisir, la peur, la violence, le pouvoir, la nostalgie, l’art et, bien sûr, les livres et les écrivains préférés – le tout n’étant pas exempt de quelques épisodes autobiographiques, de quelques souvenirs intimes. Cerise sur le gâteau, chaque chapitre est ponctué par un texte en vers libres, qui donne à ce que l’on peut considérer comme une mosaïque d’essais une belle touche poétique.
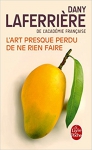 Non que la prose de l’académicien Dany Laferrière soit aride, bien au contraire. Comme toujours chez lui, elle se caractérise par son pouvoir d’évocation et d’émotion, d’empathie et d’ironie, par sa sensualité, son humour, son « goût des mots » – pour reprendre le titre d’un texte inclus dans un chapitre ô combien prometteur, « Un orgasme par les mots »…
Non que la prose de l’académicien Dany Laferrière soit aride, bien au contraire. Comme toujours chez lui, elle se caractérise par son pouvoir d’évocation et d’émotion, d’empathie et d’ironie, par sa sensualité, son humour, son « goût des mots » – pour reprendre le titre d’un texte inclus dans un chapitre ô combien prometteur, « Un orgasme par les mots »…
On voudrait tout retenir de ce traité de vie, ou mieux, de ce roman de la vie. Car il s’agit bien de cela : Dany Laferrière se et nous raconte des histoires, des histoires qui donnent à penser, qui nous rendent intelligents, pour peu qu’on puisse l’être, des histoires qui aident à vivre. « J’ai toujours vu un lien entre la librairie et le cimetière », écrit-il. L’art presque perdu de ne rien faire nous fait retrouver l’idée que les livres nous aident à attendre calmement et délicieusement la mort.
Jean-Pierre Longre
22:43 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, francophone, dany laferrière, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/05/2017
Black Herald, nouveautés 2017
Black Herald Press
Mai 2017
À paraître
Réalisme total
Totální realismus
Egon Bondy
Poème traduit du tchèque par Eurydice Antolin
Black Herald Press, mai 2017 – 58 pages – 6 €
Ouvrage bilingue (tchèque-français)

Comme je suis le plus grand poète vivant
je songeais à la poésie
Qui se mesure à l’aune seule des secondes
que je passe dans l’impuissance
Egon Bondy (1930-2007), de son vrai nom Zbyněk Fišer, fut dans un premier temps poète, influencé par Dada et le surréalisme, puis prosateur et essayiste. Réalisme total, écrit en 1950 et d’abord publié clandestinement en 1951 par la maison d’édition fondée par Bondy et son ami Ivo Vodseďálek, marque la première rupture esthétique et poétique de son œuvre. Il devient également la figure tutélaire de l’underground tchèque des années 1970, quand nombre de ses textes sont repris par le groupe de musique The Plastic People of the Universe, et jusqu’à nos jours par d’autres musiciens tchèques proches de la musique expérimentale. Il a également influencé l’écrivain Bohumil Hrabal qui, de son propre aveu, s’est inspiré de son réalisme total pour écrire la prose total-réaliste Jarmilka (1952). Marginal inclassable et provocateur, Bondy reste aujourd’hui encore un personnage emblématique de la littérature tchèque.
https://blackheraldpress.wordpress.com/books/realisme-total-totalni-realismus-egon-bondy
Pour précommander l’ouvrage / to pre-order the book:
http://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles
***
Derniers ouvrages parus
David Gascoyne et la fonction prophétique
Kathleen Raine
Traduit de l’anglais par Michèle Duclos
David Gascoyne and the Prophetic Role
Black Herald Press, mai 2017 – 118 pages – 9 €
Ouvrage bilingue – bilingual book

Après la publication de La vie de l’homme est cette viande, deuxième recueil de David Gascoyne (1916-2001), et de son poème radiophonique Pensées nocturnes, diffusé en 1955 par la BBC, Black Herald Press propose un essai consacré au poète et à son parcours si singulier. Dans ce texte paru en 1966 et jusqu’à présent inédit en français, la poète Kathleen Raine (1908-2003), par ailleurs héritière spirituelle de William Blake, rend hommage au cheminement poétique, littéraire et métaphysique de son ami David Gascoyne.
***
The Return to Silence
and other poetical essays
Paul Stubbs
(on Baruch Spinoza, Friedrich Hölderlin, Simone Weil, Arthur Rimbaud, Yves Bonnefoy, and E. M. Cioran)
Black Herald Press – 138 pages – 12 €
‘For nearly two decades (or perhaps millennia) Paul Stubbs has been engaged in the task of imagining what lies beyond the imagination…there is no guardrail to this kind of project, no literary guide or physical limit, only exploration.’—Alice Oswald (The Poetry Review)
https://blackheraldpress.wordpress.com/books/thereturntosilence
***
Pensées nocturnes / Night Thoughts
David Gascoyne
ouvrage bilingue – bilingual book
traduit de l’anglais par Michèle Duclos – Postface / Afterword by Roger Scott
Black Herald Press – 156 pages – 16 €
https://blackheraldpress.wordpress.com/books/pensees-nocturnes-night-thoughts-david-gascoyne
Pour commander les ouvrages
http://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles
***
Marché de la Poésie, Paris
Black Herald Press participera au 35e Marché de la Poésie, du 7 au 11 juin 2017, place Saint-Sulpice (Paris Ve), stand 710, en compagnie des Carnets d’Eucharis & du Visage Vert.
*
Black Herald Press
Paris • London
Black Herald Press publie une revue de littérature bilingue, des ouvrages de poésie et des essais.
Black Herald Press publishes a bilingual magazine, poetry books, and essays.
http://blackheraldpress.wordpress.com
08:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, tchèque, francophone, bilingue, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
09/05/2017
"Humour et liberté" en quatre actes
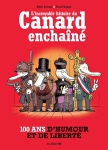 Didier Convard et Pascal Magnat, L’incroyable histoire du Canard enchaîné, Les arènes BD, 2016
Didier Convard et Pascal Magnat, L’incroyable histoire du Canard enchaîné, Les arènes BD, 2016
Il est né en 1915, en réaction à la grande boucherie qui faisait crever « dans le sang, la boue et les excréments » des millions de jeunes hommes. « Les va-t-en guerre avaient préféré dire aux Poilus qu’ils se battaient pour la France plutôt que pour leur portefeuille ! On meurt plus facilement pour une noble cause, n’est-ce pas ? ». Au printemps 1915, donc, réunion au domicile de Jeanne et Maurice Maréchal : outre les hôtes, il y a là le couple Gassier et Victor Snell – le noyau fondateur du Canard enchaîné, dès le départ « journal humoristique paraissant tous les mercredis », alors largement amputé par Anastasie (la censure).
Pendant les cent années qui ont suivi, et qui ont vu le journal s’étoffer, prendre de l’ampleur, il y a eu les hauts et les bas que toute publication régulière peut connaître, il y a eu des changements – d’équipes bien sûr, d’objectifs parfois – il y a eu les constantes majeures : faire rire à « coups de bec dans le ventre replet des industriels et des banquiers, des pousse-au-crime, des va-t-en guerre et autres ganaches de tout poil… », et rester absolument indépendant : pas d’allégeance, pas d’obligations envers quelque groupe que ce soit, pas de publicité. Et il s’en est toujours sorti, grâce à ses lecteurs de plus en plus nombreux, même si les critiques ont souvent fusé : « Si d’aventure on s’arrête pour faire un brin de causette avec l’instituteur socialiste, voilà le métallo communiste qui vient nous tirer par les basques : “Hé, camarade, attention, vous vous compromettez avec le parti américain.” Et si l’on boit un coup avec le métallo communiste, on vous crie de toutes part : “Alors, quoi, vous êtes du parti russe ?” ». Et l’humour, bien sûr : dessins, textes, jeux de mots, « noix d’honneur » etc. Tout cela pour mieux dénoncer les abus des possédants et des politiques, les violences sociales, l’autoritarisme et, surtout à partir des années 1970, les « affaires ». À la satire s’ajoute l’opposition à la hiérarchie autosatisfaite, à l’hypocrisie, à la mauvaise foi, à la langue de bois, à l’arrogance, à l’enrichissement à tout prix, à la malhonnêteté… Liste à poursuivre ad libitum…
Ce n’est pas une histoire comme les autres. « Incroyable », elle l’est par son protagoniste d’abord, ce canard grâce à qui nombre d’injustices, de coups tordus et de scandales ont pu être révélés, voire déjoués ; par la forme choisie ensuite : un vrai roman graphique, scénario parfaitement construit, texte riche et détaillé, images vivantes et variées – un roman théâtral aussi, en quatre actes assurés par la « Compagnie des Cancaniers », avec ouverture de rideau, défilés des personnages, salut final des nombreux acteurs, un rideau qui se referme sur l’image éternellement rieuse de Cabu, évoquant les pages noires des attentats. Drôles, instructives, émouvantes, ces pages de grande Histoire racontent le premier siècle d’un palmipède qui n’a pas encore fini de faire rire dans les chaumières et pester dans les palais, et auquel on souhaite évidemment longue vie. Qu’il poursuive dans la bonne humeur et le bec toujours bien acéré son œuvre de salubrité morale, politique et sociale.
Jean-Pierre Longre
10:43 Publié dans Essai, Humour, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, francophone, le canard enchaîné, didier convard, pascal magnat, Éditions des arènes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/04/2017
Les leurres et la vérité de Terezin
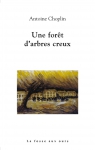 Antoine Choplin, Une forêt d’arbres creux, La fosse aux ours, 2015, Points, 2017
Antoine Choplin, Une forêt d’arbres creux, La fosse aux ours, 2015, Points, 2017
Terezin, trop fameuse localité, dont les nazis firent un ghetto, un camp de concentration, un lieu de transit vers l’extermination. Parmi beaucoup d’autres, y fut détenu Bedrich Fritta, dessinateur et caricaturiste tchèque, ainsi que sa femme et son petit garçon. Les geôliers, connaissant ses talents, le chargèrent, avec une quinzaine d’autres prisonniers, de dessiner les plans du futur crématorium et d’autres éléments de prétendue amélioration du lieu, donc de faire en quelque sorte leur métier malgré eux, ce qui leur valut « une joie presque, secrète et immobile, surplombant les parois du ghetto, réduisant à néant, le temps d’une seconde, les tragédies. ».
De ce dilemme monstrueux, de cette très relative liberté de façade, Antoine Choplin rend compte avec une fine délicatesse et une cruelle vérité. Le récit commence et finit avec des arbres (d’où le titre), des arbres à la fois bien présents et symboliques de la souffrance, des « corps décharnés », de l’enfermement (juste derrière les ormes évoqués au début passe « la clôture de fils de fer barbelés ») et de l’illusion. Car l’apparente douceur que recèlent les quelques instants fugitifs de lumière et de liberté est un leurre, comme ce qui se fabrique dans le ghetto à l’annonce d’une visite de la Croix-Rouge : façades, couleurs, décorations cachant l’angoisse et l’atrocité de la vie quotidienne, la faim, la douleur, les convois, l’épuisement, la mort.
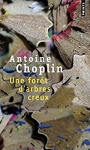 Or Bedrich et ses compagnons ne veulent pas être uniquement les instruments des bourreaux nazis. Ils comptent témoigner. C’est pourquoi la nuit ils réinvestissent l’atelier où, la journée, ils obéissent aux commandes. En cachette, ils se consacrent à « la représentation de la réalité, sensible et nue. ». Chacun à sa manière dessine « la vérité de Terezin », pour qu’à l’extérieur on sache ce qui s’y passe vraiment.
Or Bedrich et ses compagnons ne veulent pas être uniquement les instruments des bourreaux nazis. Ils comptent témoigner. C’est pourquoi la nuit ils réinvestissent l’atelier où, la journée, ils obéissent aux commandes. En cachette, ils se consacrent à « la représentation de la réalité, sensible et nue. ». Chacun à sa manière dessine « la vérité de Terezin », pour qu’à l’extérieur on sache ce qui s’y passe vraiment.
C’est sur cette vérité que s’appuie l’auteur pour construire son récit. Tout y est conforme à la réalité, dans un style qui fait de cette réalité à la fois une narration romanesque et un questionnement existentiel et artistique, conforme aux réflexions de Bedrich : « Le talent du peintre réside-t-il dans la force et la justesse de sa contribution personnelle, ou, à l’inverse, dans une capacité de retrait afin de mieux se consacrer à la vérité, ses détours, ses irisations ? ». Malgré le drame, et au-delà des mensonges et des souffrances, au-delà de la mort même, subsistent ces « irisations » de la vérité.
Jean-Pierre Longre
17:36 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, antoine choplin, bedrich fritta, la fosse aux ours, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/04/2017
Feuilles à foison
 Journal littéraire Le Persil, 2016-2017
Journal littéraire Le Persil, 2016-2017
Comment se fait-il que quelques revues littéraires – rares, il faut l’avouer – restent actives d’année en année à un rythme soutenu ? Ténacité, pluralité, diversité. Prenons exemple sur Le Persil – pas vraiment « revue », mais « journal », selon l’aveu même inscrit dans l’oreille qui jouxte la manchette (« Journal inédit, Le Persil est à la fois parole et silence ») et le format de la publication.
La ténacité, c’est celle de son initiateur et responsable, Marius Daniel Popescu, poète, romancier, personnalité du monde culturel suisse et roumain, toujours à l’offensive et sur la brèche, soutenu par les « Amis du Journal Le Persil ». La pluralité, la diversité, ce sont celles des auteurs qui emplissent les pages de leurs textes aux tonalités, aux formes, aux sujets d’une variété infinie.
 Considérons les dernières livraisons.
Considérons les dernières livraisons.
Novembre 2016, n° 127-128-129 : « Spécial polar romand », publié sous la responsabilité de Giuseppe Manone (par ailleurs président de l’Association des Amis du journal le Persil), comprenant une bibliographie du polar romand, des entretiens, des présentations d’auteurs et d’ouvrages et, bien sûr, des histoires policières. Avis aux amateurs…
Décembre 2016, n° 130-131-132 : « Atelier d’écriture avec des étudiants du Gymnase de la Cité de Lausanne. Visite de l’Institut littéraire de Bienne. Voyages ». Poèmes, proses, accompagnés d’images de Marie-José Imsand, un dossier sur Matthieu Ruf, Prix Georges-Nicole 2016… Le terme de « diversité » prend ici tout son sens.
Hiver 2016-2017, n° 133-134 : carte blanche à Germano Zuldo et Albertine, « qui ont demandé à vingt auteurs et illustrateurs de s’approprier le thème du territoire ». Textes et illustrations y rivalisent d’originalité, de personnalité – preuve s’il en est besoin qu’une contrainte thématique n’empêche pas et, au contraire, favorise la création.
Janvier 2017, n° 135-136 : « Bonnes feuilles » présentant des extraits de « livres à paraître en 2017 dans treize maisons de Suisse romande », annonçant « le joli printemps des maisons d’édition romandes ». Là encore, il y a de tout, un tout prometteur qui préfigure la qualité des publications à venir.
Cette brève présentation ne permet pas d’entrer dans le détail des feuilles foisonnant d’invention, de connaissances, de talents en germe ou en pleine maturité, d’imagination. Au lecteur de se faire explorateur de ce que Germano Zuldo et Albertine qualifient à juste titre de « formidable espace de création et de liberté ».
Jean-Pierre Longre
https://www.facebook.com/journallitterairelepersil
Le persil journal, Marius Daniel Popescu, avenue de Floréal 16, 1008 Prilly, Suisse.
E-mail : mdpecrivain@yahoo.fr
Association ses Amis du journal Le persil : lepersil@hotmail.com
10:30 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, francophone, suisse, le persil, marius daniel popescu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/04/2017
« Je viens vivre »
 Patricia Cottron-Daubigné, Ceux du lointain, L’Amourier, 2017
Patricia Cottron-Daubigné, Ceux du lointain, L’Amourier, 2017
Variation sur une question bien connue : peut-on faire de la « bonne poésie » avec de « bons sentiments » ? Oui, si ceux-ci ne sont pas une excuse, et si la poésie en question n’est pas un alibi. Et oui, les poèmes de Patricia Cottron-Daubigné chantent avec force, douleur et vérité la force, la douleur et la vérité de ceux qui cherchent refuge contre la violence, « ceux à qui nous enlevons même / la petitesse d’un pré-fixe comme un bout de terre » : « im-migrants », « é-migrants », « migrants » tout court…
Le poète d’aujourd’hui n’est pas seul à dénoncer « la cruelle désolation », « la guerre, la fuite, l’errance ». C’est sur L’Énéide de Virgile que Patricia Cottron-Daubigné fait reposer toute la première partie de son livre, « Énée de Syrie » rappelant « Énée de Troie », « exilé de tous les siècles de tous les lieux », portant son père et le poids de la guerre sur ses épaules. « C’est chez Virgile que je lis ce que je cherche dans mes mots depuis des mois. Je lis, je regarde, je cherche, je pleure, j’ai honte, j’écris. » (ce « j’écris » deviendra pluriel à la toute fin du recueil : « nous écrirons », manière d’implication collective dans le drame de ceux qui ont à franchir « tant d’écueils et tant d’eau »).
Implication dans l’histoire, implication dans l’écriture de l’actualité : ce peut être le rythme du vers mimant la marche exténuante : « je marche / je ne sais plus / le jour / j’ai compté / au début / puis la peur / a remplacé / les jours / et les nuits… » ; ce peut être un poème infini fait des noms de ceux qui sont morts « en Méditerranée et sur les routes d’Europe ». Cela n’exclut ni les évocations des « camps » délabrés où vivent ceux et celles chez qui l’on voyait « le bel imaginaire de l’enfance lointaine et des livres, des poèmes, du rire et du mouvement, du voyage libre, des jupes et des grands yeux noirs », ni celles du « ban », cette « banlieue de la banlieue » où sont relégués les « bannis », ni le chantant contraste entre la misère et le rire de Brika la Rom.
Ceux du lointain met en poésie les rivages, les naufrages, les images des hommes, des femmes, des enfants que, trop souvent, nous ne voulons pas voir malgré « le flot des mots » et « le mouvement des écrans ». Comme si l’auteure avait décidé que l’expression de notre « honte », de notre « sauvagerie » ne pouvait passer que par la poésie. Elle a raison, avec Virgile et quelques autres, de leur donner au moins le réconfort des mots, de leur donner la parole : « je ne viens rien conquérir / je viens vivre. ».
Jean-Pierre Longre
10:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, patricia cottron-daubigné, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/03/2017
L’écume du malheur
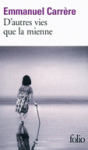 Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Lire, relire... Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009, Folio, 2010, rééd. Folio, 2017
Dans l’avant-propos de L’écume des jours, Boris Vian proclame la primauté, dans la vie comme dans son livre, de l’amour (sans oublier une certaine musique de jazz), et dévoile son principe romanesque : « Les quelques pages de démonstration qui suivent tirent toute leur force du fait que l’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ». À la fin de sa présentation de D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère écrit ceci : « Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d’extrême pauvreté, de justice et surtout d’amour. Tout y est vrai ». Faut-il arrêter ici la comparaison ? Sans doute, mais si elle m’est venue à l’esprit malgré le paradoxe, c’est parce que dans les deux cas les récits sont profondément humains et profondément « vrais », l’humanité et la vérité empruntant des chemins littéraires différents – l’imaginaire fantaisiste et l’humour (noir) dans le premier, la relation précise et sans concessions des faits réels dans le second. L’amour, la tendresse, l’amitié, la maladie, la mort, le malheur sont en tout cas, dans l’un et l’autre roman, le substrat humain qui fonde le besoin d’écriture et le désir de lecture.
 On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
On sait que les livres d’Emmanuel Carrère sont souvent le fruit d’une quête intime (Un roman russe) ou d’une enquête personnelle (L’adversaire). Cela a été suffisamment développé pour qu’on n’y revienne pas. Dans D’autres vies que la mienne, l’auteur est présent, témoin, et devient, un peu malgré lui, et en plusieurs étapes, le narrateur de deux catastrophes qui le touchent de près. C’est d’abord la mort d’une petite fille, Juliette, lors de vacances au Sri Lanka brutalement interrompues par le Tsunami, avec tout ce que cela entraîne de désespoir pour l’entourage, d’amicale sollicitude aussi autour de la détresse d’une famille atteinte au cœur de sa raison d’être. L’autre épisode relate la maladie, l’agonie, la mort d’une autre Juliette, jeune mère de famille, jeune juge au Tribunal d’instance de Vienne. Son mari, ses trois petites filles, sa sœur Hélène (compagne d’Emmanuel Carrère), son ami et collègue Étienne, chacun à sa manière l’entoure de tendresse.
Événements pathétiques s’il en est, racontés sans pathos, avec des détails que l’on sent précisément choisis, dans leur apparente objectivité et à travers quelques exemples individuels, pour montrer la confiance que l’on peut avoir dans l’amour humain (ce sont bien, d’ailleurs, les malheurs dont ils sont témoins qui renforcent les sentiments que se portent l’auteur et sa compagne, et finalement sauvent leur couple). Les personnes réelles deviennent des personnages symboliques de l’humanité, dans tous les sens du terme. Ils sont modestes (petites familles, petits juges), les morts ne sont ni héroïques ni vraiment exceptionnelles (catastrophe naturelle, cancer), mais ce qui est représenté, c’est le pouvoir qu’a chaque être humain, confronté à la fatalité, de changer la vie, de combattre la souffrance, de ressouder les liens, et aussi de peser sur les contraintes sociales, de protéger les pauvres, de braver la puissance des groupes financiers quand on est un « petit juge de province » obstinément épris de justice… Dans l’écume du malheur, il y a toujours de la place pour l’expression poignante de l’amour, et d’une œuvre de « commande », il y a toujours de quoi faire un beau roman.
Jean-Pierre Longre
16:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, emmanuel carrère, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
16/03/2017
Désespérer, fuir, rêver ?
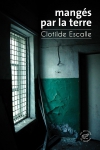 Clotilde Escalle, Mangés par la terre, Les éditions du sonneur, 2017
Clotilde Escalle, Mangés par la terre, Les éditions du sonneur, 2017
Enfermement et délabrement ; désespoir ou résignation : avant même l’ouverture du livre, un regard jeté à l’illustration de couverture annonce l’atmosphère, campe le paysage mental des personnages. « Que peut-on faire dans un patelin où la seule direction à prendre est celle de la salle polyvalente ? Panneau cloué sur un poteau, lettres fines et allongées, en italique, noires sur fond blanc, la petite flèche tout de suite après. Envie de vomir, toute la tristesse du monde – les pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi ces jambes, ces seins, etc. – toute cette tristesse prend forme, là, à la lecture de ce panneau. ». Voilà, dans la tête de Jeanne, qui résume ce paysage.
Elle rêve de partir en Amérique avec son copain Éric, qui fait dans la brocante et ne rechigne pas à la bagatelle. Et il y a les autres. Caroline, odieusement repoussée par sa mère, qui la fait passer pour folle et interner dans un asile où elle devient poupée martyre, brutalisée et aimée par deux frères débiles, Patrick et Robert ; Édouard Puiseux, le notaire engoncé dans son univers étriqué, entre les rivalités familiales qui se succèdent dans son étude, le papier peint de sa chambre et la passion jalouse et sans retour que lui voue sa servante Gabrielle. Destins divers, secrets particuliers qui se révèlent tour à tour mais qui se recoupent par leur nature même et par le croisement des chemins. Le notaire couche sans illusions et sans amour avec Agathe, la mère indigne de Caroline, laquelle partage une amitié rêveuse d’adolescente avec Jeanne. L’univers de Copiteau (le village, dont « on ne peut pas dire grand-chose ») se replie sur lui-même, se love dans l’avachissement glauque de ses habitants « mangés par la terre ».
Ce serait désespérant à mourir, s’il n’y avait les rêves de fuite, et surtout ce qui se crée, ou en tout cas ce qui se loge dans les livres et les cahiers. Le notaire Puiseux lit Chateaubriand au hasard, Paul, le frère des deux brutes de l’asile, « récite des poèmes pour se consoler », Jeanne dessine des villes imaginaires, Caroline soliloque, crie, se souvient en écrivant dans ses cahiers… Et Clotilde Escalle raconte tout cela en se coulant dans les voix de ses personnages, sans concessions, crûment parfois, en une poésie brutale et rageuse, en phrases assénées comme des coups, avec juste ce qu’il faut de recul littéraire pour faire de ce réalisme sordide un sujet de roman captivant, d’une beauté cruelle, et qui, pourquoi pas, ménage sa part de rêve par la force des mots.
Jean-Pierre Longre
http://www.marcvillemain.com/archives/2017/03/15/34813884...
10:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, clotilde escalle, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

