20/02/2025
De l’art du balayage en musique
 Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Alain Gerber, Le destin inattendu de la tapette à mouches, Frémeaux & associés, 2025
Il y a un an (janvier 2024), Alain Gerber nous gratifiait d’une belle et indispensable « autobiographie de la batterie de jazz » (voir ici) en nous racontant l’histoire de Deux petits bouts de bois, de l’art desquels il est à la fois expert et pratiquant éclairé. Maintenant, il célèbre les « balayeurs célestes du jazz avec Shelly Manne en point de comparaison », ce grand « Sheldon Manne [qui] fut un des batteurs les plus « littéraires » de l’histoire de l’instrument : un homme recherchant en permanence l’équilibre instable, mais jamais perdu, entre les différentes valeurs des éléments mis en jeu, entre les nuances dynamiques, entre les couleurs sonores, entre les couleurs du temps , entre la distension et la contraction du temps qui passe, l’instinct de vie et son contraire. »
Affirmons-le sans réserve, nul mieux qu’Alain Gerber ne sait lier l’expérience personnelle et le savoir encyclopédique. Ici comme ailleurs, il commence par évoquer un souvenir, celui de l’acquisition de sa première batterie : caisse claire, baguettes, mailloches et… balais. « Depuis cette époque, je porte un amour fou à l’art des balais, ainsi qu’à ceux qui l’ont inventé de toutes pièces et fait évoluer de manière spectaculaire depuis la fin des années vingt ; si dévorante est cette passion qu’elle s’étend aux instruments eux-mêmes. » Et depuis la même époque, il a tout appris des « brosses », de leur pratique et de leurs virtuoses, et il nous en fait tout connaître.
N'oublions pas qu’Alain Gerber est un écrivain, l’un de ceux qui, sans jamais se hausser du col, font partie de l’élite des stylistes, et son érudition musicale ne l’empêche pas de nous faire profiter de sa pratique littéraire, en nous livrant par exemple « une réflexion au passage : en littérature, j’ai toujours penché en faveur des écrivains soucieux d’entretenir une pulsation dans leurs périodes, leurs paragraphes, leurs chapitres. Et d’abord dans chacune de leurs phrases. » Pour lui « c’est affaire de métrique », de « ponctuation » et, « métaphoriquement cette fois, d’accentuation et de nuances dynamiques. » Ou encore de considérations à la fois larges et acérées : « L’un des signes très sûrs de décivilisation est le renoncement massif à l’ironie au profit de la croyance. Il s’agit ici de l’ironie à usage interne et de la croyance sans condition, telle la capitulation du même nom. Je n’ai jamais eu l’âme d’un inconditionnel, et cela ne s’est pas arrangé avec le temps. Le statut de groupie n’aura exercé sur moi qu’une timide attirance. » Un dernier extrait, en guise d’encouragements : « Quels que soient votre âge, votre sexe, votre expérience et votre culture, votre morphologie, vos capacités physiques, votre bagage technique, votre projet esthétique, soyez assuré qu’il existe, ou qu’il existera, la paire de balais la mieux adaptée à votre personnalité. Celle qui va répondre à vos besoins comme si elle avait parié sur vous pour justifier son existence. » Voilà qui donne vie à une paire d’objets apparemment bien anodins mais ô combien précieux. Martine Palmé, agent des plus grands, l’a écrit : ce livre est un « véritable trésor. »
Jean-Pierre Longre
Une autre parution récente chez Frémeaux & associés: Stéphane Carini, Les alchimies discrètes d'Henri Crolla. Accompagné de deux CD.
 Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Guitariste virtuose et figure emblématique du jazz français, Henri Crolla (1920-1960) a laissé une empreinte indélébile sur la musique de son époque. Fils d’immigrés napolitains, il s’impose comme l’un des guitaristes les plus talentueux de sa génération. Malheureusement, sa carrière fulgurante a été interrompue par sa mort prématurée en 1960. L’anthologie de Stéphane Carini rend justice à l’oeuvre d’un artiste injustement oublié et nous invite à redécouvrir la richesse inouïe et la diversité de son répertoire : du jazz à la chanson, de la poésie aux musiques de film.
Patrick FRÉMEAUX
« APRÈS LUI, IL N’Y A PLUS DE GUITARISTES »
NAGUINE REINHARDT (ÉPOUSE DE DJANGO REINHARDT)
20:15 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, musique, jazz, alain gerber, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/08/2024
Du rock et des cadavres
 Jean-Jacques Nuel, Décibels mortels, éditions Héraclite, 2024
Jean-Jacques Nuel, Décibels mortels, éditions Héraclite, 2024
Dans sa retraite bourguignonne, Brice Noval, le désormais fameux détective privé, reçoit des messages à répétition frisant le harcèlement, puis l’étrange visite d’un ami de jeunesse perdu de vue, qui est pratiquement devenu son voisin. Ancien chanteur sans talent d’un groupe de rock (bizarrement nommé Édith Ticket) tentant pâlement et sans vergogne d’imiter les Rolling Stones, pourquoi ce Gilles Nottat tient-il tant à voir son ancien condisciple de la Faculté des Lettres de Lyon ?
Nous voilà ainsi plongés, sur fond de musique des années 1980 et de paroles de chansons, dans des énigmes où se mêlent une légende médiévale, un château près de Tournus, la quête d’un trésor, la disparition d’un « bootleg » (enregistrement pirate de concert) et des meurtres à résoudre – ce dont, bien sûr, Brice Noval s’acquittera après maintes péripéties.
Comme souvent, Jean-Jacques Nuel écrit en pays connu, et utilise à bon escient les connaissances qu’il a de ses deux patries : « Les collines et les superbes vallonnements qui font du Clunisois l’un des plus beaux paysages de France », et la ville de Lyon qui recèle tant de mystères et d’histoires curieuses, telle celle du « Gros Caillou » de la Croix-Rousse. Et, outre le suspense policier, c’est ce qui fait le charme de ces fictions, qui n’excluent pas les éléments autobiographiques et les souvenirs enthousiastes qu’il entraîne dans son sillage. « Ce roman me permet aussi de rendre hommage au rock’n roll, cette musique de ma jeunesse qui a accompagné toute ma vie. » Un bel aveu !
Jean-Pierre Longre
14:31 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, musique, jean-jacques nuel, éditions héraclite, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2024
« La passion des baguettes »
 Alain Gerber, Deux petits bouts de bois, une autobiographie de la batterie de jazz, Frémeaux & Associés, 2024
Alain Gerber, Deux petits bouts de bois, une autobiographie de la batterie de jazz, Frémeaux & Associés, 2024
On connaît l’érudition jazzistique d’Alain Gerber. On savait moins, jusqu’à maintenant, qu’il pratique depuis longtemps un instrument complexe et majeur de la musique de jazz : la batterie ; en amateur, avoue-t-il modestement, mais tout de même… Une pratique à laquelle il s’adonne encore au moins une heure par jour dans un sien cabanon isolé, ce qui lui évite les récriminations du voisinage telles qu’il les a connues lorsqu’il habitait en appartement (on pouvait s'y attendre, l’humour et la malice de sont pas absents de certaines anecdotes jalonnant cette « autobiographie de la batterie de jazz ». Voir aussi, par exemple, un furtif portrait d’André Malraux, qui dans un prestigieux restaurant lui servant de cantine « semblait tenir son propre rôle », un autre d’une Catherine Deneuve « piétinant devant un mur » chaussée de « pataugas à talons » durant le tournage d’un film…).
Difficile de mesurer toutes les dimensions de ce livre foisonnant, conduit effectivement par l’histoire des paires de baguettes pour lesquelles l’auteur avoue une véritable passion, ce qui ne l’empêche pas d’utiliser sans vergogne un vocabulaire quasiment amoureux pour décrire ses relations avec les cymbales. La science exhaustive du jazz n’est pas venue toute seule, et la dimension autobiographique laisse le champ libre non seulement à l’apprentissage de la batterie, mais aussi à l’acquisition de la connaissance des jazzmen, de leurs prestations dans les caves et surtout de leurs disques, avec des références précises aux grands batteurs concédées à qui veut y prêter l’oreille ; ils sont tous là, de Kenny Clarke à Ringo Starr (oui), en passant par Jo Jones, André Ceccarelli, Max Roach, Georges Paczynski, Buddy Rich, Elvin Jones, Art Blakey, Baby Dodds, Gene Krupa, Connie Kay ou Daniel Humair.
Mais la science musicale n’occulte pas le reste, car Alain Gerber le reconnaît, il « cultive l’art (l’art ou la marotte ?) de la digression. » L’autobiographie n’est pas seulement celle de la batterie, mais aussi celle de l’auteur en personne : la rencontre décisive de l’amour, les « petits boulots » de jeunesse pour survivre, les voyages et, bien sûr, parallèlement à la musique, la littérature. Écoutons-le, dans son inimitable style nourri de paradoxes : « Quel état des lieux suis-je en mesure de dresser ce matin, si je compare mon itinéraire d’instrumentiste à celui d’homme de plume ? D’un côté, je sais de mieux en mieux ce que je devrais faire avec mes tambours et mes cymbales, mais j’en reste largement incapable ; de l’autre, je vois très bien ce qu’il ne faut pas faire et, sauf exception, ne parviens toujours pas à m’en empêcher. » Un parallèle dont il s’étonne lui-même, mais qui est d’un riche enseignement sur la puissance de ces petits instruments que sont les baguettes et le stylo, utilisés au départ sans ambition démesurée par quelqu’un qui doute de ses capacités, ne se sent pas à sa place, comme lors de ses débuts à France Culture (on le lui a fait sentir plus tard lorsqu’il en fut brusquement exclu), et qui dit avoir « fait des pieds et des mains pour entrer dans le rang. Le rang des non-alignés ».
Sans doute. Mais ce « non-aligné » nous en apprend toujours plus, sur le jazz, sur le style littéraire (cultiver la « simplicité » – pas si simple), sur la vie culturelle, sur la vie tout court. Sans parler du plaisir toujours recommencé, jamais le même, de la lecture. Et si l’auteur de ces lignes perdait un jour la mémoire, il ne se pardonnerait pas de ne pas retenir malgré tout cette formule : « C’est toute l’énigme de la musique : avec elle, ou l’on touche au sacré, ou l’on ne touche à rien du tout. »
Jean-Pierre Longre
17:44 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, autobiographie, musique, jazz, alain gerber, frémeaux & associés, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/01/2024
Rebrousser chemin ?
 Goncourt en poche... Lire, relire... Brigitte Giraud, Vivre vite, Flammarion, 2022, J'ai lu, 2024
Goncourt en poche... Lire, relire... Brigitte Giraud, Vivre vite, Flammarion, 2022, J'ai lu, 2024
Prix Goncourt 2022
Qu’attend-on de la lecture d’un roman, qui plus est d’un roman auréolé du Prix Goncourt ? Qu’il y ait une intrigue assez solide pour susciter une attention exclusive ; un protagoniste autour duquel tournent d’autres personnages intéressants pour diverses raisons ; une part d’imaginaire se combinant avec le vraisemblable, voire le réel… Et tout le reste, qui résiste à l’analyse et où réside le mystère inhérent à toute œuvre d’art.
Cette part de mystère, le commentateur ne peut la percer. Il la laisse à chaque lecteur et à son rapport avec les personnages et la narratrice. Mais il peut se livrer à quelques vérifications. Dans Vivre vite, l’intrigue fondamentale date de vingt ans, avec un héros, Claude, qui a une double passion, la musique et la moto, sans parler de l’amour partagé avec sa compagne (autrice et narratrice) et son petit garçon. Claude, donc, brusquement mort de sa passion pour la moto ; cette intrigue fondamentale en commande une deuxième, courant tout au long du roman, faite des hypothèses qui tentent de corriger le passé – et représentant la part d’imagination qui finalement se heurtera à la vérité des faits (le paradoxe étant que c’est dans cette vérité que réside le mystère, celui des véritables causes de l’accident).
 Claude, Brigitte, Théo, les acteurs directs du drame. Et il y a beaucoup d’autres personnages, famille et amis ou silhouettes simplement croisées, mais aussi, plus inattendus, la reine Astrid et l’ingénieur japonais Tadao Baba, dont la présence élargit singulièrement le champ historique et géographique. D’ailleurs le temps et l’espace se croisent sans cesse : la topographie lyonnaise, entre Croix-Rousse et rive gauche du Rhône, et le déroulement irrégulier du temps, de 1999 à nos jours, sont soumis à des va-et-vient et à des hésitations. Faut-il rebrousser chemin ou filer vers l’avenir ? C’est aussi le sujet du livre.
Claude, Brigitte, Théo, les acteurs directs du drame. Et il y a beaucoup d’autres personnages, famille et amis ou silhouettes simplement croisées, mais aussi, plus inattendus, la reine Astrid et l’ingénieur japonais Tadao Baba, dont la présence élargit singulièrement le champ historique et géographique. D’ailleurs le temps et l’espace se croisent sans cesse : la topographie lyonnaise, entre Croix-Rousse et rive gauche du Rhône, et le déroulement irrégulier du temps, de 1999 à nos jours, sont soumis à des va-et-vient et à des hésitations. Faut-il rebrousser chemin ou filer vers l’avenir ? C’est aussi le sujet du livre.
Un livre construit comme un morceau de musique – cette musique que Claude aimait au point d’en avoir fait sa profession. Prélude, seize mouvements, finale ou « éclipse ». Un livre dont l’écriture, musique du style et des mots, tout en résonances et harmoniques, trouve dans l’exploration du réel et de ses détails les sources de l’inspiration et de l’émotion.
Jean-Pierre Longre
https://editions.flammarion.com
19:43 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, brigitte giraud, jean-pierre longre, flammarion, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/09/2023
« Car la mer et l’amour ne sont point sans orage »
 Lire, relire... Pascal Quignard, L’amour la mer, Gallimard, 2022, Folio, 2023
Lire, relire... Pascal Quignard, L’amour la mer, Gallimard, 2022, Folio, 2023
On connaît le goût de Pascal Quignard pour l’écriture fragmentaire ; on sait aussi qu’il maîtrise parfaitement l’art de la narration continue ; et que la musique, particulièrement la musique baroque, est l’un de ses sujets de prédilection. Ajoutons à tout cela l’amour, la mort et bien sûr la mer (le titre l’annonce), et nous avons la forme et la matière de ce beau roman qu’est L’amour la mer.
Nous sommes au XVIIème siècle, et comme dans La comédie humaine de Balzac nous retrouvons des personnages dont nous avons fait la connaissance dans de précédents ouvrages. Par exemple Meaume le graveur, dont les tribulations étaient contées dans Terrasse à Rome ; ou Monsieur de Sainte-Colombe, fameux violiste, rendu encore plus fameux par Tous les matins du monde, et qui détruisit par le feu ses rouleaux de partitions… Bien d’autres artistes venus de différentes régions d’une Europe en effervescence peuplent les pages du livre, parmi lesquels le claveciniste allemand Jakob Froberger et son élève Hanovre, le luthiste Hatten et son amante Thullyn, violiste qui aime « le sable trempé de l’estran qui brille » et « l’eau lumineuse de la mer » ; amour de l’homme, amour de la mer… C’est d’ailleurs avec elle, grâce à elle que l’on peut accéder au cœur du propos : « Thullyn lisait les cartes, où elle était sans pareille à découvrir la chance. / Elle aimait la musique et s’abandonnait entièrement à la douleur qui naissait d’elle. / Telles étaient ses deux passions si on oublie la mer puisqu’elle venait des îles du bout du monde. / Enfin elle avait une peur absolue de la mort. Cela faisait quatre couleurs. L’amour, la mer, la musique, la mort. »

 On pourrait aussi évoquer « les épidémies, les bûchers des renégats, les émeutes des affamés, des révoltés, les barricades des parlementaires, les fumées des guerres religieuses » qui se dissipèrent « à la fin du monde baroque » avec, notamment, les « Suites de danses » de Froberger, que Bach reconnut plus tard comme son maître ; ou le château de Montbéliard où aimait se réfugier la princesse Sybille von Württenberg ; ou les sauts dans le temps qui nous font assister à la disparition des violes, à l’apparition des violons, altos, violoncelles, des piano-forte et des pianos ; ou même les confidences du narrateur sur son enfance… On entend toutes les voix, dialogues et monologues, on perçoit la multiplicité des points de vue, on se réjouit à lire la prose de Pascal Quignard, érudite sans pédanterie, musicale sans confusion. Et l’on se prend à imaginer que ce long récit aux multiples ramifications est une vaste extension du célèbre sonnet de Pierre de Marbeuf (1596-1645) qui commence ainsi :
On pourrait aussi évoquer « les épidémies, les bûchers des renégats, les émeutes des affamés, des révoltés, les barricades des parlementaires, les fumées des guerres religieuses » qui se dissipèrent « à la fin du monde baroque » avec, notamment, les « Suites de danses » de Froberger, que Bach reconnut plus tard comme son maître ; ou le château de Montbéliard où aimait se réfugier la princesse Sybille von Württenberg ; ou les sauts dans le temps qui nous font assister à la disparition des violes, à l’apparition des violons, altos, violoncelles, des piano-forte et des pianos ; ou même les confidences du narrateur sur son enfance… On entend toutes les voix, dialogues et monologues, on perçoit la multiplicité des points de vue, on se réjouit à lire la prose de Pascal Quignard, érudite sans pédanterie, musicale sans confusion. Et l’on se prend à imaginer que ce long récit aux multiples ramifications est une vaste extension du célèbre sonnet de Pierre de Marbeuf (1596-1645) qui commence ainsi :
Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage,
Et la mer est amère, et l'amour est amer,
L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer,
Car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
Jean-Pierre Longre
En lire plus sur Pascal Quignard :
http://jplongre.hautetfort.com/apps/search/?s=Quignard
Quignard et la peinture : Le regard et le silence. Terrasse à Rome de Pascal Quignard. .pdf
Quignard et la musique : Les oreilles n'ont pas de paupières... La haine de la musique de P.Q..pdf
18:51 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pascal quignard, gallimard, jean-pierre longre, folio | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/12/2021
La solitude d’une fleur bleue
 Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
« C’est l’histoire d’une fleur bleue qu’on trempe dans de l’acide. Adélaïde Berthel, c’est une femme comme une autre. Qui, à quarante-six ans, entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. » Une femme d’aujourd’hui, féministe et moderne, qui retrouve régulièrement un groupe d’amies partageant entre elles leurs problèmes sentimentaux, professionnels, existentiels – la « sororité » peut être un réconfort, mais ce n’est pas la panacée. Féministe et moderne, donc, mais, après plusieurs déboires amoureux, elle rêve de trouver enfin l’homme avec lequel elle partagera la deuxième partie de sa vie. Les tentatives sont peu concluantes. La « fleur bleue » devient « peur bleue », la « femme comme une autre » devient « faille comme une autre ».
Histoire banale d’une solitude mal assumée ? Cela se pourrait. Mais dans ce domaine, il n’y a pas de banalité. La plume de Chloé Delaume fait du destin d’Adélaïde un cas particulier, et nous suggère qu’en la matière chaque cas est bien particulier, chaque cœur aussi : « C’est le cœur d’Adélaïde, le héros de cette histoire. C’est lui qui cogne et saigne, exige et se déploie. C’est lui qui fait le deuil, englouti par le vide. » Car Adélaïde, elle, la femme de quarante-six ans, a par ailleurs d’autres vies : vie amicale, vie professionnelle : attachée de presse dans une importante maison d’édition, « passeuse », « elle doit aussi gérer les écrivains », ce qui s’accompagne de toute une série de contraintes, de déceptions, de mensonges, et ce qui donne l’occasion à l’autrice de savoureuses pages satiriques sur le monde de l’édition, rivalités et exigences commerciales, batailles d’égos et d’images…
 Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Jean-Pierre Longre
15:00 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, chloé delaume, le cœur synthétique, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/06/2021
Italo Calvino en musique
Olivier Longre, Amore Disamore, 2021
Amore Disamore, le nouvel album d’Olivier Longre, est librement inspiré du roman Les Villes Invisibles d'Italo Calvino.
Tecla, Procope, Trude, Armille, Argie, Isidora... Autant de cités imaginées par Italo Calvino et qui ne peuvent exister qu'en rêve, interrogeant nos villes modernes et nos visions de l'ailleurs. C'est à la lueur de ces villes imprévisibles et énigmatiques que ces huit titres ont été composés.
Je pense avoir écrit une sorte de dernier poème d’amour aux villes, au moment où il devient de plus en plus difficile de les vivre comme des villes. Les villes invisibles sont un rêve qui naît au cœur des villes invivables. Italo Calvino
- Du Haut des Grues
2. Round Faces
3. Amore Disamore
4. Same Old Trude
5. Les Lignes Invisibles
6. Small Flowers
7. Une Porte qui Bat
8. Song For Diomira
(Cristal publishing / Absilone)
2021
 Olivier Longre: piano, clarinette, harmonica, concertina, percussions, quadrantid swarm.
Olivier Longre: piano, clarinette, harmonica, concertina, percussions, quadrantid swarm.
Fabio Viscogliosi: voix
L'inconnu de la Rua do Duque: chant
Boris Pokora: saxophone soprano / flûte
Laurence Moletta: flûte
Lydiane Chomienne: taconeo
Thùy-Nhi Au Quang: violoncelle
Guillaume Itier: batterie
Benoit Nicolas: contrebasse
Prise de son: Nicolas Matagrin, Olivier Longre
Mixage: Olivier Longre
Mastering: Franck Choko Rivoire
Enregistré aux studios Mikrokosm, La Ruche et Ray's vintage drum stock.
Parution le 4 juin 2021
Précommander l’album : https://olivierlongre.bandcamp.com/
https://www.cristalpublishing.com/compositeurs-musiques-d...
10:13 Publié dans Littérature et musique, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, olivier longre, italo calvino, cristal publishing, absilone | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/06/2021
Paysages illimités avec pianos
 Sophy Roberts, Les pianos perdus de Sibérie, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2021
Sophy Roberts, Les pianos perdus de Sibérie, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, Calmann Lévy, 2021
« Le fait que des instruments majestueux puissent encore exister dans un endroit aussi profondément énigmatique est tout à fait remarquable, sans que je parvienne à me l’expliquer », écrit Sophy Roberts au début de son livre. Et dans toute la suite, elle plonge le lecteur dans ce mystère, non pour le percer complètement, mais pour narrer des aventures aussi diverses que lointaines, pour faire part de rencontres aussi chaleureuses qu’inattendues, pour décrire des contrées aussi froides que pittoresques. Disons-le : si l’on apprend beaucoup de choses sur les pianos (bien ou mal conservés, difficilement découverts ou trouvés en nombre surprenant, prestigieux ou modestes, ayant appartenu à des grands de Russie ou à des anonymes, joués par de grands interprètes ou par des inconnus…), l’ouvrage est à la fois relation de voyage et d’exploration, roman à caractère autobiographique truffé d’anecdotes savoureuses, somme érudite pleine de références historiques, géographiques, musicales, et semée de documents photographiques et de reproductions de gravures (on peut contempler maints portraits et paysages, faire connaissance, par exemple, avec un impayable Liszt en pop star acclamée par ses groupies, apercevoir la famille impériale prenant l’air sur le toit d’une maison à Tobolsk, ou voir un intéressant dessin musical de Kandinsky, bien d’autres illustrations encore).
Si l’on se fie à la structure d’ensemble, on suit une chronologie historique : une première partie (« Pianomanie ») qui court de 1762 à 1917, une deuxième (« Accords brisés »), de 1917 à 1991, et une troisième (« Dieu seul sait où »), de 1992 à aujourd’hui. Le motif du piano est donc décliné depuis le régime des Tsars jusqu’à la Russie d’aujourd’hui, en passant bien sûr par les grands bouleversements politiques (1917, la guerre de 1940-1945, 1991 etc.), et, cartes à l’appui, de l’Oural au Kamtchatka, en passant par le lac Baïkal, l’Altaï, la Kolyma, l’île de Sakhaline, les grandes et petites villes, les vastes étendues et les coins les plus reculés (généralement en hiver, afin d’éviter les boues et les moustiques). Et en faisant la connaissance de toutes sortes de personnes, souvent accueillantes, parfois fort originales, qui « ont ouvert non seulement leurs pianos, mais aussi leur maison et leur cœur à une inconnue. », et l’ont guidée dans sa quête inlassable d’instruments que recèlent ces contrées méconnues.
Contrées méconnues, certes, à vue de première lecture, mais contrées qui, à mesure qu’on avance dans le livre, deviennent familières, tant l’autrice nous présente avec chaleur ces régions glaciales où, comme l’écrivit Tchekhov, « les émotions et expériences sont nombreuses ». « Tandis que je passe en revue mes découvertes, j’ai conscience de toutes les choses inattendues que mes recherches ont produites, et je constate que chaque piano a réduit la taille illimitée de la Russie, qui m’apparaît désormais à échelle humaine. ». Et l’on sent bien que malgré tout ce qu’elle a vécu au cours de ses aventures sibériennes, Sophy Roberts n’en a pas fini avec les explorations, puisqu’elle avoue « savoir qu’il existe toujours un lieu plus lointain encore où se rendre. »
Jean-Pierre Longre
09:09 Publié dans Essai, Littérature et musique, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, voyages, musique, autobiographie, sophy roberts, blandine longre, calmann lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/05/2021
Les vibrations du destin
 Lire, relire... Akira Mizubayashi, Âme brisée, Gallimard, 2019, Folio, 2021
Lire, relire... Akira Mizubayashi, Âme brisée, Gallimard, 2019, Folio, 2021
Ils sont quatre musiciens amateurs jouant sous la houlette de Yu Mizusawa, unis par l’art malgré la guerre entre la Chine et le Japon. Car nous sommes en 1938 à Tokyo, Yu est japonais et les trois autres sont des étudiants chinois. Mais la brutalité guerrière de l’expansionnisme japonais va avoir le dessus : lors d’une répétition ils sont brusquement interrompus par l’arrivée de soldats qui vont emmener les quatre musiciens, non sans avoir brisé le violon de Yu, dont le fils Rei, alors petit garçon, a assisté à la scène caché dans une armoire. Par bonheur, un lieutenant nommé Kurokami, homme cultivé et délicat malgré ses fonctions, recueille le violon et le confie à l’enfant.
 Le destin de Rei se construit à partir de ce drame fondateur. Recueilli et adopté par un ami français de son père, il deviendra Jacques Maillard, choisira de faire un apprentissage de luthier à Mirecourt, haut lieu de la lutherie française, puis plus longuement à Crémone. En exerçant son métier, il passera des années à reconstruire le violon démembré de son père, qui de ce fait deviendra un nouvel instrument – qui lui aussi connaîtra un destin exceptionnel, renaissant sous les doigts virtuoses de Midori, la petite-fille du lieutenant qui jadis sauva le petit garçon et le violon. En outre, au cours de ses études, Rei / Jacques rencontre Hélène, archetière, qui deviendra sa compagne.
Le destin de Rei se construit à partir de ce drame fondateur. Recueilli et adopté par un ami français de son père, il deviendra Jacques Maillard, choisira de faire un apprentissage de luthier à Mirecourt, haut lieu de la lutherie française, puis plus longuement à Crémone. En exerçant son métier, il passera des années à reconstruire le violon démembré de son père, qui de ce fait deviendra un nouvel instrument – qui lui aussi connaîtra un destin exceptionnel, renaissant sous les doigts virtuoses de Midori, la petite-fille du lieutenant qui jadis sauva le petit garçon et le violon. En outre, au cours de ses études, Rei / Jacques rencontre Hélène, archetière, qui deviendra sa compagne.
Le récit d’Akira Mizubayashi est profondément touchant. Au-delà du jeu sur le mot « âme » (celle du violon, élément vital pour les vibrations et la sonorité, celle des humains, qui la perdent parfois dans la haine et la violence, qui la retrouvent dans l’harmonie), la littérature et la musique s’y épanouissent dans une langue à la fois fraîche et précise. L’auteur, qui ne l’oublions pas a délibérément choisi d’écrire en français, navigue comme son héros entre deux cultures : « Se sentant aimé et protégé par ses parents français, domptant vaille que vaille la peur dissimulée, inavouée, refoulée qu’il portait au fond du cœur, Jacques fit des progrès fulgurants en français à tel point qu’il figura en quelques années parmi les meilleurs élèves de la classe. Et c’est alors que lui revint petit à petit le désir de garder près de lui la langue de son père disparu. ».
Les quatre mouvements du roman (Allegro ma non troppo, Andante, Menuetto : Allegretto, Allegro moderato) sont ceux d’une sonate ou d’une symphonie, et les mots, souvent, tentent de restituer la musique en descriptions analytiques et poétiques, que cette musique soit celle, notamment, de la Gavotte en rondeau de la Troisième partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach ou du premier mouvement du quatuor de Schubert Rosamunde, que l’on entend littéralement à plusieurs reprises aux moments décisifs de la narration. « Après les deux premières mesures qui sonnaient comme d’obscurs clapotements d’eau stagnante, le violon de Midori, qui réunissait autour de son âme trois autres âmes au moins – celle de Yu Misuzawa, celle du lieutenant Kurokami et celle aussi de Rei Misuzawa –, entrait délicatement, en pianissimo, dans l’ample et profonde mélancolie schubertienne. ». Retour à l’âme polyphonique, qui par le verbe et les sons restitue les vibrations du destin et répand le souffle vital.
Jean-Pierre Longre
23:21 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, musique, francophone, japon, akira mizubayashi, gallimard, folio, an-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2020
Des airs qui pleurent, des airs qui rient
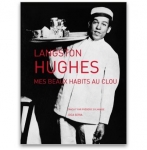 Langston Hughes, Mes beaux habits au clou, traduction de l’anglais (États-Unis) et postface de Frédéric Sylvanise, éditions Joca Seria, 2019
Langston Hughes, Mes beaux habits au clou, traduction de l’anglais (États-Unis) et postface de Frédéric Sylvanise, éditions Joca Seria, 2019
Le blues n’est pas seulement une musique. Du moins, sa musique peut être celle des mots, et Langston Hughes l’a prouvé, en suivant les règles strictes du genre : répétition des premiers vers, vers impairs avec rimes, langue populaire mais utilisée avec respect… Comme l’écrit Frédéric Sylvanise dans sa postface : « Le blues vient de la rue, mais il ne faudrait pas lui ôter toute dignité. […] Même dans le malheur, le bluesman cherche lui aussi à s’élever ».
Si le blues en tant que genre et en tant qu’état d’esprit est dominant dans ce recueil, il n’en est qu’un aspect. D’autres formes poétiques s’y épanouissent, avec des textes à la musicalité tout aussi suggestive, aux rythmes et aux sonorités tout aussi prégnants, aux thèmes tout aussi populaires. La misère sociale, le racisme et ses conséquences, le malheur et la mort, l’alcool et la méchanceté, les plaintes en forme de prières, les anecdotes domestiques, la nostalgie et les rêves inaccomplis, et bien sûr les sentiments humains – l’amitié et surtout l’amour, le plus souvent malheureux, mais donnant çà et là l’occasion d’une allusion au bonheur et à l’érotisme souriant d’une fille « trop jolie »… Chants de fidélité et de souffrance à la fois :
« Quand un type aime vraiment sa femme
I’ la quitte pas en plein hiver.
I’ m’a dit qu’i’m’aimait.
Mais il a sûrement menti.
I’ m’a dit qu’i’m’aimait.
Il a sûrement menti.
Mais c’est l’seul homme que j’aimerai
Jusqu’à la fin d’ma vie. »
Poésie du peuple, Mes beaux habits au clou (le titre annonce la dominante) est un recueil d’une grande beauté, où le désespoir et l’espoir se côtoient comme naturellement, où les pleurs et les rires se mêlent sans vergogne, où la brutalité n’empêche pas la plus grande douceur de s’exprimer, où l’idée de la mort fait partie de la vie.
« J’attends ma maman,
C’est la Mort.
Dis-le tout doux,
Dis-le tout doux si tu veux bien.
« J’attends ma maman,
La Mort. ».
Jean-Pierre Longre
16:07 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, États-unis, langston hughes, frédéric sylvanise, éditions joca seria, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/03/2019
« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »
 Pascal Quignard, Dans ce jardin qu’on aimait, Grasset, 2017, Folio, 2019
Pascal Quignard, Dans ce jardin qu’on aimait, Grasset, 2017, Folio, 2019
Non seulement le révérend Simeon Pease Cheney entendait tout, comme le recommande Dieu dans Matthieu XIII, 9, mais il notait tout : le chant des oiseaux, et aussi « le seau, où la pluie s’égoutte, qui pleure sous la gouttière de zinc, près de la marche en pierre de la cuisine… ». Cette musique est un psaume, de même que « le vent quand il s’engouffre dans le portemanteau du corridor de la cure » est un Te Deum !
L’histoire racontée par Pascal Quignard est celle, réelle, du pasteur Cheney, dont la femme morte en couches trop jeune fait de sa part l’objet d’une passion exclusive, tellement exclusive qu’il chassera de la maison sa fille Rosemund, cause involontaire du décès de sa mère, lorsqu’elle aura dépassé l’âge de celle-ci… Resté seul dans le jardin conjugal, il transcrit indéfiniment les chants d’oiseaux (bien avant Messiaen), les bruits de la vie quotidienne – et c’est ce qui le rend heureux. « C’est cette maison, mon labyrinthe. C’est ce jardin, mon labyrinthe. Ce n’est pas elle, en personne, Eva, ta mère, bien sûr, je ne suis pas fou. Mais ce jardin, c’est elle qui l’a conçu, c’est son visage. […] Dédale de plus en plus beau dans lequel je me perds. […] Dont je me suis mis à noter tous les chants qui s’ébrouent et vivent sur les branches. ».

Pourtant, sa fille apparemment ne lui en tiendra pas rigueur. Revenue chez son père vieillissant, elle l’encourage à faire publier les vastes partitions issues de ses notations ; refus successifs des éditeurs – mais après la mort de son père en 1890, elle édite à compte d’auteur ces Wood Notes Wild que Dvorak, en particulier, prit tellement au sérieux qu’il en tira son Quatuor à cordes n° 12.
 De « cette double histoire », Pascal Quignard a fait non un roman linéaire, mais un récit théâtralisé, une sorte d’oratorio à trois voix : celles du « récitant » (auteur, metteur en scène, pianiste, narrateur…), de Simeon le pasteur, de Rosemund sa fille. Trois voix auxquelles s’ajoute celle, muette et omniprésente, d’Eva la tant aimée, dont l’alliance, comme un « rayon de lumière », ira finalement au doigt de sa fille. Long poème musical et littéraire, Dans ce jardin qu’on aimait se lit, se dit, se joue et se chante en mineur et se termine dans une lumière intense, avec un arc-en-ciel au fond du jardin. On a assisté à un concert original, émouvant et beau.
De « cette double histoire », Pascal Quignard a fait non un roman linéaire, mais un récit théâtralisé, une sorte d’oratorio à trois voix : celles du « récitant » (auteur, metteur en scène, pianiste, narrateur…), de Simeon le pasteur, de Rosemund sa fille. Trois voix auxquelles s’ajoute celle, muette et omniprésente, d’Eva la tant aimée, dont l’alliance, comme un « rayon de lumière », ira finalement au doigt de sa fille. Long poème musical et littéraire, Dans ce jardin qu’on aimait se lit, se dit, se joue et se chante en mineur et se termine dans une lumière intense, avec un arc-en-ciel au fond du jardin. On a assisté à un concert original, émouvant et beau.
Jean-Pierre Longre
19:31 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, musique, pascal quignard, simeon pease cheney, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/11/2018
Une trilogie épique d’aujourd’hui (et de demain)
 Virginie Despentes, Vernon Subutex, Grasset, 2015 à 2017, Le livre de poche, 2016 à 2018
Virginie Despentes, Vernon Subutex, Grasset, 2015 à 2017, Le livre de poche, 2016 à 2018
Trois tomes, soit plus de 1200 pages, cela ne se résume pas en quelques lignes. Autant s’en tenir au titre, qui donne d’emblée le fil conducteur : Vernon Subutex (dont le prénom rappelle Boris Vian, et le nom, sans détour, un substitut de la drogue), ancien rocker, ancien disquaire, ancien ami du grand Alexandre Bleach, chanteur à succès mort d’overdose, passe par différentes phases existentielles, psychologiques, morales, sociales. Expulsé de chez lui, accueilli (avec plus ou moins d’empressement) par de « vieilles connaissances », puis clochardisé, il va faire l’objet de recherches assidues de la part de gens en quête d’enregistrements secrets d’Alex Bleach, ainsi que de la part de ses anciens amis, qui vont former autour de lui un groupe solidaire. Cela va donner lieu à l’organisation de « convergences », rassemblements dont Vernon, mixeur génial, est la cheville musicale essentielle, entraînant des danses qui n’ont pas besoin du recours à la drogue pour être sans frein.
La trame, rigoureusement construite et menée sans répit, est primordiale ; mais elle est l’axe autour duquel tourne le plus important, le plus foisonnant, le plus passionnant : une description sans concessions mais toute en finesse, aussi brutale que précise, d’une société multiple qui repousse vers les extrêmes les limites de la cohabitation, une succession de portraits en action de personnages qui ont beaucoup vécu, qui ne sont plus tout jeunes mais qui cherchent plus ou moins consciemment une forme de bonheur collectif ; aussi divers qu’attachants, obsédants parfois, ils naviguent tant bien que mal entre les tempêtes de la société actuelle – drogue, alcool, sexe, argent, violence –, mais font preuve aussi de générosité, de désintéressement, d’amour. Du trader sans scrupules au SDF sans avenir, de la mère de famille attentive au transsexuel enfin bien dans sa peau, de l’ancienne prostituée au producteur véreux, de l’alcoolique invétéré à l’universitaire engagé (on en passe beaucoup d’autres), tous sont, en quelque sorte, les protagonistes successifs du roman. Virginie Despentes maîtrise au plus haut point l’art du portrait (et les rappels succincts et clairs placés en tête des tomes 2 et 3 sont bien utiles), mais un art bien à elle. Elle entre (et fait entrer le lecteur) dans toutes les peaux, dans tous les cerveaux, dans tous les cœurs, se démultiplie en personnages de tous bords, de toutes classes, de tous tempéraments, adaptant sans fards son style, son lexique, son niveau de langue à chacun d’entre eux. Bref, elle est la reine du discours indirect libre : c’est l’auteur qui écrit, mais c’est le personnage qui pense.
C’est ainsi que Vernon Subutex semble avoir les caractéristiques du roman réaliste ; d’ailleurs l’intrigue (surtout celle du tome 3) se déroule sur fond d’actualité (attentats de 2015, Nuit Debout, luttes sociales, guerres du Moyen Orient) ; mais c’est un roman qui, à la manière des épopées, poétise le réel sans l’idéaliser, le montrant dans ce qu’il a de désespérant et de prometteur, de violent et de bienveillant, de dur et de tendre, de repoussant et d’attirant, de tragique et de comique. Toutes les dimensions du réel et de ses avatars, donc, où périodiquement l’humour affleure, éclate parfois, dans la narration objective et dans la tête des personnages ; un humour qui relève de la satire, de la dérision, de l’ironie. Tenant de toutes ces tonalités et les dépassant toutes, le dénouement apocalyptique vire à l’épopée d’anticipation, au centre de laquelle Vernon et les « convergences » sont un point d’ancrage historique. Vernon Subutex est une fresque de grande ampleur, que l’on n’est pas près d’oublier.
Jean-Pierre Longre
12:18 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, virginie despentes, grasset, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/06/2018
Le toucher d’Échenoz
 Jean Échenoz, Au piano, Les Éditions de Minuit, 2003, Poche « Double », 2018.
Jean Échenoz, Au piano, Les Éditions de Minuit, 2003, Poche « Double », 2018.
L’enfer, c’est la disparition des autres. Serait-ce une leçon possible de ce roman ? Et d’abord, y a-t-il une leçon ? Au bout du compte, non.
Commençons par le commencement. Un jour, du côté du Parc Monceau, deux silhouettes d’hommes, un grand et un petit, s’avancent en s’entretenant du chapeau que porte l’un deux (tiens, on dirait du Flaubert – Bouvard et Pécuchet – ou du Queneau, entre Le chiendent et Exercices de style)... L’un des deux hommes est le fameux Max Delmarc, dont nous, lecteurs, savons rapidement qu’il va bientôt mourir, ce dont il ne se doute pas lui-même : avantage donné au lecteur sur le personnage, et octroyé par un auteur omnipotent qui se joue des conventions romanesques et autres pactes de lecture. Ainsi pouvons-nous observer à loisir, avec un détachement qui n’exclut pas l’attachement, la vie et la mort du protagoniste.
 Car là encore les lois du roman sont mises à mal : nous n’assistons pas à une « tranche de vie », mais à une tranche de vie et de mort. Max Delmarc connaît les affres du trac (qu’il tente de noyer dans l’alcool) et les triomphes de la virtuosité. Cela ne l’empêche pas de vivre une petite vie ordinaire, entre son impresario, son garde du corps / surveillant Bernie, une sœur présente mais peu visible, et son travail quotidien d’entraînement artistique. Petite vie pianissimo, qui recèle pourtant sa chimère, sa petite fleur bleue à la Novalis – en l’occurrence une certaine Rose, ancien amour de jeunesse jamais déclaré mais toujours présent, dont il poursuit la silhouette improbable et fugitive au cours d’irraisonnables trajets en métro. Nous le savons – et lui n’en avait qu’un inconscient avant-goût, en jouant par exemple deux mouvements de Janácek, « Pressentiment » suivi de « Mort » – cette vie sans exaltation va brusquement s’interrompre, et Max va se retrouver dans un « Centre » dirigé par un certain Béliard (diable bien présentable qui a un homonyme dans Les grandes blondes, où l’on rencontrait aussi Paul Salvador, nouveau nom imposé à Max Delmarc...) ; centre-purgatoire où se côtoient Doris Day (une belle grande blonde plus accessible que Rose) et Dean Martin, et où Max séjourne une semaine avant d’être dirigé vers l’une des deux éternités possibles (« zone parc » ou « zone urbaine » – les tickets de métro ont une importance particulière dans le roman).
Car là encore les lois du roman sont mises à mal : nous n’assistons pas à une « tranche de vie », mais à une tranche de vie et de mort. Max Delmarc connaît les affres du trac (qu’il tente de noyer dans l’alcool) et les triomphes de la virtuosité. Cela ne l’empêche pas de vivre une petite vie ordinaire, entre son impresario, son garde du corps / surveillant Bernie, une sœur présente mais peu visible, et son travail quotidien d’entraînement artistique. Petite vie pianissimo, qui recèle pourtant sa chimère, sa petite fleur bleue à la Novalis – en l’occurrence une certaine Rose, ancien amour de jeunesse jamais déclaré mais toujours présent, dont il poursuit la silhouette improbable et fugitive au cours d’irraisonnables trajets en métro. Nous le savons – et lui n’en avait qu’un inconscient avant-goût, en jouant par exemple deux mouvements de Janácek, « Pressentiment » suivi de « Mort » – cette vie sans exaltation va brusquement s’interrompre, et Max va se retrouver dans un « Centre » dirigé par un certain Béliard (diable bien présentable qui a un homonyme dans Les grandes blondes, où l’on rencontrait aussi Paul Salvador, nouveau nom imposé à Max Delmarc...) ; centre-purgatoire où se côtoient Doris Day (une belle grande blonde plus accessible que Rose) et Dean Martin, et où Max séjourne une semaine avant d’être dirigé vers l’une des deux éternités possibles (« zone parc » ou « zone urbaine » – les tickets de métro ont une importance particulière dans le roman).
Une « divine comédie », avec purgatoire et descente aux Enfers ? Plutôt une « humaine comédie ». La vie avant, la vie après, finalement c’est tout comme ; la mort ne change pas grand-chose, et Max / Paul en fait l’expérience ni amère ni heureuse ; travail, amours, séparations, désillusions, les choses se répètent, sans véritable désespoir ni enthousiasme excessif.
Le relief d’Au piano se bâtit sur l’occupation principale du protagoniste, la musique, à laquelle malgré tout et sans en avoir l’air il tient par-dessus tout, et sur la manière dont est narrée sa vie quotidienne. Le toucher particulier, incisif, percutant, étonnant parfois d’Échenoz est bien là, avec le vagabondage (urbain) dans la syntaxe, les surprises de dernière minute, la distance à la fois ironique et familière, les clins d’œil au lecteur qu’il n’hésite pas à prendre à partie : « Vous, je vous connais, par contre, je vous vois d’ici ». Et nous, pouvons-nous vraiment connaître Jean Échenoz ? Je veux dire ses livres. Nous les lisons, nous les analysons, avec délectation, avec aussi la petite irritation de celui qui sent qu’il y a bien des choses là-dedans, qu’il n’arrive pas à saisir complètement et qu’il doit laisser pour la prochaine fois. C’est le propre de la littérature.
Jean-Pierre Longre
08:30 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean Échenoz, les Éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/06/2017
Franz, Caroline et la musique
 Gaëlle Josse, Un été à quatre mains, Ateliers Henry Dougier, 2017
Gaëlle Josse, Un été à quatre mains, Ateliers Henry Dougier, 2017
De mai à octobre 1824, quatre ans avant sa mort prématurée, Franz Schubert séjourna au château de Zseliz, résidence estivale de la famille Esterhazy, en tant que maître de musique des deux filles de la maison. Parenthèse rurale de relatif bonheur mêlé de mélancolie et de quelque regret de la vie animée de Vienne – vie de travail, de rencontres, d’espoir artistique, de misère aussi, sans compter la maladie qui l’a miné durant l’année 1823. Le jeune homme timide et peu familier des rites aristocratiques trouve dans la campagne hongroise, malgré les conventions et barrières sociales, une sorte de paix intérieure, de sérénité baignée de musique, et l’amour de la fille cadette des Esterhazy, Caroline ; amour jamais révélé, sinon par quelques coups d’œil involontaires et quelques gestes à peine esquissés.
Gaëlle Josse relate ici l’histoire romancée de cet amour, qui fait corps avec la musique : « C’est pour elle que tout lui vient, là, toute cette musique qui déferle, qui l’envahit et qu’il reçoit comme elle lui vient, une source vive, un jaillissement ininterrompu. ». Un amour dont on se doute qu’il est secrètement partagé, qui est pourtant voué à l’inaccomplissement et qui précipitera le départ de Franz. Resteront dans leur mémoire les regards échangés, une « main abandonnée » et « toute cette musique partagée ». Autour du récit principal se profilent d’autres épisodes de l’existence du compositeur, des rappels de sa vie viennoise, de ses difficultés, de ses travaux. Gaëlle Josse, dont nous apprenons dès le début du livre que la musique de Schubert l’ « accompagne depuis longtemps, depuis toujours », connaît parfaitement sa vie et son œuvre.
Surtout, ces pages, rythmées par les vers de La belle meunière, sont un hymne à l’amour et à la musique, inséparables l’un de l’autre ; la narration romanesque, l’analyse psychologique et artistique sont menées avec la délicatesse poétique que l’on trouve dans d’autres œuvres de l’auteure. « Schubert parle au cœur, en accompagnant les plus ténus, les plus impalpables de nos états émotionnels intérieurs, sa musique nous atteint avec une désarmante simplicité, comme la main d’un ami posée sur notre épaule. Si peu de choses, bien souvent, pour y parvenir. Si peu de notes, parfois, pour nous réjouir ou nous consoler. ». On pourrait en dire autant de la prose harmonieuse de ce dense et bref roman.
Jean-Pierre Longre
12:02 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, musique, franz schubert, gaëlle josse, ateliers henry dougier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/07/2016
Symphonie du Mal
 Jaume Cabré, Confiteor, traduit du catalan par Edmond Raillard, Actes Sud, 2014, Babel, 2016
Jaume Cabré, Confiteor, traduit du catalan par Edmond Raillard, Actes Sud, 2014, Babel, 2016
« Ce n’est qu’hier soir, alors que je marchais dans les rues trempées de Vallcarca, que j’ai compris que naître dans cette famille avait été une erreur impardonnable ». La première phrase de cet impressionnant roman est à la fois énigme liminaire et, si l’on y revient après coup, paradoxe éclairant. Le récit foisonne de personnages de toutes sortes, de tous horizons, de toutes époques, et pourtant Adrià Ardèvol, protagoniste et narrateur, prend conscience qu’il est désespérément seul, sans Dieu (auquel il ne croit pas), sans famille (ses parents, qui ne l’ont pas aimé, voulaient faire de lui un singe savant – musicien virtuose ou linguiste surdoué).
Dans la longue lettre en forme de confession adressée à Sara, son unique grand amour, par l’entremise de Bernat, son seul grand ami, Adrià explore cette si humaine solitude et les inhumaines turpitudes de ses semblables, remuant les vases nauséabondes de l’histoire individuelle et de l’Histoire collective. En effet, en suivant le double fil conducteur de sa quête personnelle et des tribulations d’un violon précieux (un « Storioni »), la narration transporte le lecteur de la Catalogne actuelle à celle de la fin du Moyen Âge, de Crémone à l’époque des grands luthiers (XVIIe-XVIIe siècles) à Rome pendant la guerre de 14-18, de la Flandre à Tübingen, de l’Europe à l’Arabie… Rien n’est dû au hasard : le questionnement central, c’est celui qui porte sur le point de convergence de toutes les hontes, l’exemple type du mal absolu : Auschwitz-Birkenau. Comment se fait-il que des hommes (Grands Inquisiteurs, bourreaux SS, médecins poursuivant jusqu’au bout des expériences sur des enfants, hommes acharnés à la lapidation…) s’adonnent au Mal sans scrupules, que d’autres le subissent sans secours – sans même celui d’une puissance et d’une commisération divines ?
Les 770 pages des Mémoires d’Adrià posent sans répit cette question, qui hante aussi les recherches de l’érudit qu’il est devenu. Pas de réponse, mais quelques découvertes. Parmi celles-ci, la malhonnêteté de son père et de quelques autres (sur fond de spoliations nazies), l’existence et les difficultés de l’amour, les joies de la connaissance et de l’art, la bonté de certaines âmes, les trahisons de quelques autres, le poids des responsabilités personnelles et familiales, jusqu’au sentiment de culpabilité… Et pour le lecteur, les mêmes découvertes, à travers une prose brillante, surprenante, vibrante, musicale, une prose qui superpose allègrement, dramatiquement, et aussi, parfois, avec humour, dans la même page, le même paragraphe, voire la même phrase, le « je » et le « il », les personnages multiples et les époques différentes. La composition, abolissant toute transition, toute limite architecturale, faisant sonner ensemble les êtres, les siècles, les lieux, transforme la narration en une symphonie dont les échos résonnent et résonneront encore longtemps, avant que s’efface le souvenir de tout, comme chez Adrià. « Après tant de jours intenses, voici venir le temps du repos ».
Jean-Pierre Longre
21:51 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, catalan, jaume cabré, edmond raillard, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/05/2016
Le poids du génie
 Nicolas Cavaillès, Les huit enfants Schumann, Les éditions du Sonneur, 2016
Nicolas Cavaillès, Les huit enfants Schumann, Les éditions du Sonneur, 2016
Tout commence avec « la mort du père », compositeur de génie et « malheureux musicien », passionné, exalté, mort fou dans un asile, écarté des siens – après avoir aimé, avoir rêvé, aussi, d’un calme bonheur familial. Puis le livre égrène les morts successives, dans un ordre rigoureusement chronologique. Celles des « huit enfants », dont certains furent vite effacés, d’autres vécurent assez longtemps pour conserver la mémoire familiale et artistique : Émile, Julie, Félix (jeune poète disparu trop tôt), Ferdinand, Ludwig, Élise (elle-même pianiste de talent), Marie (qui « se dévoua tout entière » à sa mère), Eugénie (qui contribua à la pérennité de la mémoire familiale et paternelle par les livres qu’elle écrivit).
Au centre des huit chapitres consacrés aux enfants, il y a « La mort de la mère », Clara la fameuse pianiste, elle-même compositrice, qui poursuivit sa carrière tout en enchaînant les grossesses et les accouchements et en supportant durant un certain nombre d’années le génie exalté de son mari tant aimé. « Mère exigeante et défaitiste à la fois, peu généreuse mais énergique et tenace, mettant la sourdine à la sensibilité brillante dont elle fit montre sur scène, tendancieusement autoritaire mais avant tout soucieuse d’inculquer à ses garçons comme à ses filles le devoir d’indépendance morale et matérielle, Clara sembla, consciemment ou non, classer sa progéniture en deux catégories, la forte et la faible ». Et il y a Brahms, arrivé jeune homme dans le foyer, à qui Schumann avait « symboliquement » légué « sa très haute mission artistique – et avec elle, sans le dire explicitement, son épouse et ses enfants. », et qui fut pour la famille un ami, un conseiller, un frère, un oncle, un père de substitution…
De ce récit familial, de ces « drames redondants » parmi lesquels les petits bonheurs s’insinuent malgré tout, de ces « anecdotes », de ces « visages figés » par le temps, Nicolas Cavaillès tire, avec une tranquille économie de moyens rhétoriques, avec une justesse définitive et dans une prose nourrie de poésie, des réflexions sur la mort, la « reproduction » et l’aspiration au néant, sur la filiation et l’enfance, sur la « musique spirituelle » et les « angoisses latentes » qu’elle exprimait chez Schumann (comme chez d’autres), par opposition à celle « qui beugle aujourd’hui […] ses mélodies débiles au service du système consumériste » (oh la belle page de colère !). Sous les apparences d’une composition claire et sans ambiguïtés, Les huit enfants Schumann met en relief les mystères de l’enfance, de la vie et de la mort, ainsi que les exigences et les impératifs du génie musical, qui a investi l’existence entière de la famille Schumann. Dans ce beau livre, dont le thème principal et grave est la mort, le protagoniste est la musique, qui donne (d'une manière souvent sous-jacente, en tout cas discrète) à chaque chapitre/mouvement une tonalité différente.
Jean-Pierre Longre
18:19 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, musique, nicolas cavaillès, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/10/2015
Le philosophe et « Le Chant des Muses »
 Philippe Lacoue-Labarthe, Pour n’en pas finir, écrits sur la musique, édition établie et présentée par Aristide Bianchi et Leonid Kharmalov, Christian Bourgois éditeur, 2015
Philippe Lacoue-Labarthe, Pour n’en pas finir, écrits sur la musique, édition établie et présentée par Aristide Bianchi et Leonid Kharmalov, Christian Bourgois éditeur, 2015
La notoriété de Philippe Lacoue-Labarthe ne doit rien à des éclats médiatiques, mais à un vrai travail philosophique qui se marie harmonieusement avec ses talents d’écrivain. La preuve : plusieurs années après sa mort en 2007, il y a encore de quoi publier. Ses « écrits sur la musique », rassemblés sous le titre de l’un d’entre eux, Pour n’en pas finir, donnent un bel exemple de la réflexion et de l’écriture d’un penseur qui s’est toujours interrogé sur les langages, en particulier sur celui de la musique, un art qui fut pour lui non seulement une préoccupation, mais une passion.
L’ouvrage est construit sur une chronologie inversée – des textes récents aux plus anciens –, ordre qui ne relève pas d’une gymnastique gratuite, mais qui permet de cheminer « d’un commencement à l’autre ». « Le Chant des Muses » (2005) reprend le texte d’une conférence « pour enfants », très pédagogique donc, qui définit clairement les notions de philosophie, de poésie et, bien sûr, de musique, « art de l’émotion », avec toutes ses composantes, et qui répond avec grande sincérité aux questions que tout un chacun peut se poser. Suivent des écrits de la période 1992-2002, où le motif musical permet d’aborder les concepts de « moderne » et de « progrès » dans l’art, de développer des propos sur le jazz, de transcrire un dialogue radiophonique inédit avec Pascal Dusapin, d’évoquer « l’antithèse ironique » de Nietzsche, qui disait préférer Bizet à Wagner… « L’écho du sujet » (1979) étudie longuement et précisément le rapport entre autobiographie et musique, en de belles pages qui rappellent entre autres et à juste titre « l’essence répétitive de la musique ». Les deux dernières sections sont consacrées à des inédits des années 1960, « Théâtre (ou : Opéra – ou : le simulacre – ou : le subterfuge) », projet qui met pour ainsi dire en scène « le combat de la musique contre le texte » ; enfin « L’allégorie (Première version) » laisse percevoir les talents d’écrivain et de poète du philosophe.
Un bref compte rendu ne peut analyser la teneur, la profondeur, l’unité d’un tel rassemblement de textes auquel les références à d’autres auteurs ajoutent des ramifications multiples. On laissera la conclusion à Aristide Bianchi et Leonid Kharmalov : « Au fond, c’est l’importance même du motif de la musique dans l’œuvre de Philippe Lacoue-Labarthe qui a commandé la publication de ces esquisses et requis une attention à ce à quoi elles étaient destinées : faire Œuvre, faire Livre ».
Jean-Pierre Longre
 P. S. : Les éditions Christian Bourgois ont eu l’excellente idée de publier en même temps, au format de poche, du même Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience, paru initialement en 1997, ouvrage qui, à partir de la lecture de deux poèmes de Paul Celan, s’interroge sur la « tâche » et la « destination » de la poésie contemporaine.
P. S. : Les éditions Christian Bourgois ont eu l’excellente idée de publier en même temps, au format de poche, du même Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience, paru initialement en 1997, ouvrage qui, à partir de la lecture de deux poèmes de Paul Celan, s’interroge sur la « tâche » et la « destination » de la poésie contemporaine.
23:50 Publié dans Essai, Littérature et musique, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, philosophie, musique, francophone, philippe lacoue-labarthe, christian bourgois éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/09/2014
Le puzzle des destins croisés
 Yasmina Reza, Heureux les heureux, Flammarion, 2013, Folio, 2014
Yasmina Reza, Heureux les heureux, Flammarion, 2013, Folio, 2014
Yasmina Reza, on le sait, est une femme de théâtre. Et Heureux les heureux, roman aux multiples personnages, pourrait l’attester si c’était nécessaire. Comme sur une scène aux profondeurs insondables, passent des êtres, des couples, des groupes sur lesquels, tour à tour, se fait la lumière et se focalise l’attention, tandis que les autres restent dans l’ombre, silhouettes mystérieusement concernées.
De même que vont et viennent les personnages, avec leurs aventures intimes et leurs relations sociales, se succèdent dans l’esprit du lecteur des questions qui tournent autour de l’amour, de la souffrance, de la violence, de la mort – celles que la littérature pose inlassablement. Dans La vie mode d’emploi de Perec, l’unité de l’ensemble se construit sur les multiples ouvertures de l’immeuble où se croisent les destins. Dans Heureux les heureux, elle se compose différemment, mais elle est bien là, dans la vivante convergence de tous les monologues, dans l’ironie pessimiste du ton, dans l’incessante interrogation des humains.
La réputation de Yasmina Reza n’est plus à faire, il est donc inutile d’en dire davantage. Il faut lire Heureux les heureux, texte foisonnant, aux potentialités innombrables, aux ramifications infinies.
Jean-Pierre Longre
15:45 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, yasmina reza, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/05/2013
« Comment emporter la musique avec soi ? »
 Alain Gerber, Une année sabbatique, Éditions de Fallois, 2013
Alain Gerber, Une année sabbatique, Éditions de Fallois, 2013
Sunny Matthews est l’un des meilleurs saxophonistes de sa génération, peut-être le meilleur après leur illustre prédécesseur à tous, celui qui hante les esprits, les lieux et le récit, et que l’on nomme « Le Bleu ». Sunny, donc, est l’un des meilleurs, mais sans doute celui qui s’aime le moins, qui croit le moins en lui-même et à la sincérité de sa musique, fuyant les approbations et les « compliments immérités ».
C’est pourquoi il choisit le recours radical : renoncer. Renoncer à la supercherie, à la musique et à la « dope » pour aller se désintoxiquer du côté de Lexington et s’en remettre, comme d’autres jazzmen de son acabit, aux bons soins du docteur Jim Phillips. Il ne s’en sortira pas si mal que ça, découvrant malgré lui que, par certains côtés, la vie peut valoir la peine d’être vécue, à condition d’y mettre de la vigueur. La vigueur de celui qu’une femme dévoile comme un musicien « sculpteur », la vigueur de celui qui décide de s’adonner sans réserves à la boxe, la vigueur de celui qui prend sous son aile le jeune Scott Lloyd, trompettiste dont le génie ne demande qu’à s’épanouir et qui va, dans un filial mouvement de retour, faire redécouvrir la musique à Sunny.
Bref, tout cela ne s’annonce pas mal, et cette « année sabbatique » va donner ses fruits, quand arrive le drame et ce que l’on pourrait prendre pour un écroulement. Retour à la case départ, aux mensonges, aux errances, à la musique dopée par la drogue ? Apparemment. Mais il y a la mémoire de Scotty et de ses chorus, et il y a, peut-être, ce à quoi Sunny rêvait parfois sans y croire : l’amour.
Et bien sûr il y a la prose d’Alain Gerber, qui n’a pas son pareil pour décrire et raconter la musique, cette musique qui, sans cacher les paradoxes, et même en s’appuyant sur eux, dit à chacun sa vérité, abolit les distances que, sans s’en apercevoir, on entretient avec soi-même. « Sunny pense à travers la musique. Il pense à tout, sauf à la musique qu’il est en train de jouer. La substance de cette musique est sa substance à lui. C’est une sensation qu’il n’avait jamais éprouvée auparavant. […] Ou bien le musicien ne fait qu’un avec sa musique, ou bien ils se tiennent à distance l’un de l’autre, comme deux hommes se tiennent mutuellement en respect ». À lire Une année sabbatique, il semble bien que cela vaut aussi pour l’écriture.
Jean-Pierre Longre
Éditions de Fallois
01 42 66 91 95
10:01 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, jazz, francophone, alain gerber, Éditions de fallois, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Dans l’intimité du Cantor
 Jean Miniac, Et ta main fermera mes yeux… Bach, journal intime, Fondencre, 2013
Jean Miniac, Et ta main fermera mes yeux… Bach, journal intime, Fondencre, 2013
Le rayonnement de Jean-Sébastien Bach est tel que, souvent, on voudrait percer les secrets de son génie. Vœu irréalisable, bien sûr. Nous sommes voués à écouter (ou à jouer) sa musique, à nous laisser prendre par elle, tout en ayant conscience que jamais nous ne pourrons en mesurer la profondeur.
Percer les secrets du génie, non. L’imaginer dans ses réflexions, ses méditations, ses souvenirs, oui. Pour cela, il fallait un poète qui soit aussi un musicien (ou l’inverse). Jean Miniac, organiste et auteur de plusieurs recueils poétiques, réussit à plonger le lecteur dans l’intimité du Cantor – sans prétendre ni à l’exhaustivité ni à la vérité absolue, bien heureusement.
Et ta main fermera mes yeux… est donc le « journal intime » que Bach aurait pu écrire durant les derniers mois de sa vie. Il aurait pu tenter d’expliquer, par exemple, « pourquoi [il est] devenu musicien », se rappelant un air de son enfance qui le poursuit toujours et avouant sa « manie de la résolution » qui lui fait détester l’inachèvement. Il aurait pu écrire des pages sur le jeu de l’organiste, sur le contrepoint et les voix « mises en dialogue », sur l’univers clos du choral, sur la composition de la fugue, sur les fondements sacrés de sa musique… Il aurait pu évoquer avec pudeur et émotion la mort de Maria Barbara, sa première femme, ou la rencontre de la seconde, Anna Magdalena (en n’hésitant pas, pour l’occasion, à se décrire lui-même sur le mode burlesque).
Jean Miniac tient en quelque sorte la plume du compositeur, en connaisseur et en écrivain. La poésie et la musique fondent ces pages, comme elles fondent l’existence de Jean-Sébastien Bach. Qu’on en juge tout simplement par ces quelques lignes : « J’aime l’eau lustrale qui baigne les accords épanchés du fond du cœur. J’aime leur intense vibration parcourant les cordes qui relient le cœur à la structure même du clavier – et presque nonchalamment – déjà entaché de cette même vibration (les pleurs aussi la ravivent) ; j’aime tout ce qui nous fait bruire, sentir, résonner, palpiter, ondoyer, j’aime les pleurs de l’eau (ou ses murmures), la caresse du vent (ou sa colère), la fureur de l’océan (ou son apaisement) – tous ces excellents maîtres qu’enfant déjà j’aimais appeler : « Mes instituteurs sauvages ». Je leur dois la vie, comme à Dieu même ; tout le reste n’est que broutilles et poussière, acharnement de niais, conquête du vide ».
Jean-Pierre Longre
09:59 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, journal, musique, francophone, jean-sébastien bach, jean miniac, fondencre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/02/2013
Honneur aux méconnus
 Alain Gerber, Petit Dictionnaire Incomplet des Incompris, Alter Ego Éditions, 2012
Alain Gerber, Petit Dictionnaire Incomplet des Incompris, Alter Ego Éditions, 2012
« Ils ont fait l’Histoire, mais l’Histoire ne leur a pas fait de cadeaux. Car l’Histoire est ingrate, quelquefois : des hommes l’écrivent, mais elle rechigne pourtant à inscrire leurs noms sur ses monuments. Le musicien sous-estimé n’est pas une denrée rare dans le jazz. Il est encore plus répandu que le musicien surestimé, ce qui n’est pas peu dire ». Alain Gerber y remédie à sa manière, en mettant son érudition jazzistique au service des « méconnus », des « invisibles », des « transparents », des anonymes, de ceux qui ne sont qu’une « silhouette furtive » empruntant des « chemins de traverse », de ceux qui se mettent « à contre-courant », des solitaires, des malchanceux… Bref, de Dolorez Alexandria Nelson, dite Lorez Alexandria, à Attila Zoler, l’auteur passe en revue les « incompris » ou (ce qui est encore autre chose) les « non compris ».
« Incomplet », ce dictionnaire ? Peut-être, puisqu’il le dit – impossible d’en juger. En tout cas, fort documenté : en matière d’histoire du jazz, on ne fait pas plus précis, pas plus affectueux, non plus, pour ces figures que la plupart du temps on n’aperçoit que de profil – si jamais on les aperçoit. Il y a aussi ceux dont la malédiction n’est pas celle de l’anonymat, mais celle de la réputation : « déclarés sulfureux », alcooliques, violents, la plume d’Alain Gerber les tire de l’enfer ou de l’oubli – même si, selon lui, « il n’est pas impossible qu’au bout du compte, ce déficit de notoriété ne soit pas préférable à la gloire trop brutale à laquelle d’autres furent confrontés ». Il y a ceux, aussi, qui ratent jusqu’à leur échec, comme « Jelly Roll » Morton, ou dont « l’apport inestimable reste trop largement méconnu », bien que leur prestige soit « universel », comme Martial Solal.
Un dictionnaire, certes, dans l’ordre alphabétique, avec un index des musiciens et des instruments, mais un dictionnaire qui ne se contente pas de la savante sécheresse des ouvrages spécialisés. Cette recension, pour méthodique qu’elle soit, baigne dans la prose poétique d’Alain Gerber. Qu’on lise, par exemple, les débuts de l’article sur Robert Leo « Bobby » Hackett, évoquant les « hommes du bord de mer, nés dans des villes lointaines… », ou du texte sur Eli Thompson, dit « Lucky », ne s’en laissant pas conter par « les mots errants, [qui] traînent à travers le monde, et parfois se collent à nous ». Sans oublier ce sens de la formule synthétique et de l’image savoureuse dont ou voudrait donner de multiples échantillons, du genre « Il y a des musiciens d’escabeau, des musiciens trônant sur des taupinières, mais que l’on a portés aux nues, non sans parfois de grandes contorsions » ; ou encore « Un géant peut en cacher un autre » ; ou encore… Ce « petit » dictionnaire est un grand ouvrage, qui a le mérite non seulement de réhabiliter les « incompris », mais encore de se lire comme un recueil de nouvelles que l’on peut parcourir à grandes enjambées ou déguster à petites doses, selon l’humeur.
Jean-Pierre Longre

Dans la collection « Jazz Impression » des éditions Alter Ego, n’oublions pas deux ouvrages récemment parus :
- Les Blessures du Désir, Pulsions et Puissances en Jazz, de Jean-Pierre Moussaron (tout récemment décédé, en octobre 2012), série de « portraits » et « esquisses » d’autant plus émouvants qu’ils sont très personnels.
 - John Coltrane, La musique sans raison, de Michel Arcens, « Esquisses d’une philosophie imaginaire » et « Essai pour une phénoménologie du jazz », ouvrage qui dépasse Coltrane, sans le contourner, pour construire une véritable esthétique musicale.
- John Coltrane, La musique sans raison, de Michel Arcens, « Esquisses d’une philosophie imaginaire » et « Essai pour une phénoménologie du jazz », ouvrage qui dépasse Coltrane, sans le contourner, pour construire une véritable esthétique musicale.
Alter Ego Editions
3, rue Elie Danflous
66400 Céret
http://leseditionsalterego.wordpress.com
17:15 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, jazz, francophone, alain gerber, michel arcens, jean-pierre moussaron, alter ego éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/12/2011
Comment naît la musique
 Alain Gerber
Alain Gerber
Blues, Fayard, 2009, Le livre de poche, 2011
« Une musique immense, qui n’avait en aucun musicien ni commencement ni fin. Une musique à peau sombre, née avec la peau craquelée des vieux cuirs. Par hasard, j’appris un matin, à Clarksdale (Mississippi), dans le comté de Coahoma, qu’elle portait un nom : ces morceaux que nous chantions sans nous connaître, quelqu’un les avait appelés des blues ». Pour en arriver là, que de tribulations, que de vies cassées, que de violences, que d’aspirations à ce que certains appellent la liberté ou le bonheur, dont on sait bien qu’ils n’existent pas ici bas.
Alain Gerber, avec la verve poétique et le pouvoir d’évocation qu’on lui connaît, illustre en quelques destinées le cheminement vers la naissance de cette musique vouée, « comme le silence, à étouffer les soupirs et les cris de joie de ce monde sans queue ni tête ». Nous suivons, depuis la victoire des Nordistes sur les Sudistes et l’« émancipation » des esclaves jusqu’à la mort et l’oubli – mais aussi jusqu’à l’invention de ce langage sublime qui sait exprimer l’indicible -, les vies de Nehemiah, Cassie, Silas, ces vies qui se perdent, se retrouvent, se reperdent, mais qui toutes se rejoignent dans le rêve d’autre chose.
 Musical, ce vaste roman l’est, à coup sûr, puisque, sans qu’il soit explicitement présent à chaque page, tout converge vers le blues, par la grâce progressive et miraculeuse des dons, du travail et du malheur de chaque personnage, de même que par la bonne volonté des instruments (piano, harmonica, banjo, guitare et, bien sûr, voix…) qui se plient aux rythmes, aux souffles, aux doigts de toutes sortes. Musical, le récit l’est aussi dans sa structure polyphonique, puisque chaque personnage, en se racontant, superpose sa voix à celle des autres, tout en se ménageant quelques chorus. Tous font résonner, de la Nouvelle Orléans à Chicago, du Tennessee à la Californie, des chants et des contre-chants de souffrance et de nostalgie qui passent par l’harmonie des phrases et des mots d’un vrai compositeur de romans. Comme le dit à Silas son ami le major : « Je suis convaincu qu’il existe une relation étroite entre la musique et la littérature. Malheureusement, j’ignore laquelle. L’homme qui mettra le doigt dessus méritera qu’on dresse son effigie devant le Capitole, mon cher Silas ! ». Chiche.
Musical, ce vaste roman l’est, à coup sûr, puisque, sans qu’il soit explicitement présent à chaque page, tout converge vers le blues, par la grâce progressive et miraculeuse des dons, du travail et du malheur de chaque personnage, de même que par la bonne volonté des instruments (piano, harmonica, banjo, guitare et, bien sûr, voix…) qui se plient aux rythmes, aux souffles, aux doigts de toutes sortes. Musical, le récit l’est aussi dans sa structure polyphonique, puisque chaque personnage, en se racontant, superpose sa voix à celle des autres, tout en se ménageant quelques chorus. Tous font résonner, de la Nouvelle Orléans à Chicago, du Tennessee à la Californie, des chants et des contre-chants de souffrance et de nostalgie qui passent par l’harmonie des phrases et des mots d’un vrai compositeur de romans. Comme le dit à Silas son ami le major : « Je suis convaincu qu’il existe une relation étroite entre la musique et la littérature. Malheureusement, j’ignore laquelle. L’homme qui mettra le doigt dessus méritera qu’on dresse son effigie devant le Capitole, mon cher Silas ! ». Chiche.
Jean-Pierre Longre
10:05 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, fayard, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/10/2011
Les révélations de la musique
 Kazuo Ishiguro, Nocturnes. Traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch, Éditions des 2 terres, 2010, rééd. Folio, 2011
Kazuo Ishiguro, Nocturnes. Traduit de l’anglais par Anne Rabinovitch, Éditions des 2 terres, 2010, rééd. Folio, 2011
De même que la belle interprétation d’un morceau donne envie de le réécouter, de même la lecture des « Cinq nouvelles de musique au crépuscule » de Kazuo Ishiguro (auteur, entre autres, des Vestiges du jour) invite à la relecture. Car dans chaque récit, le thème principal est soutenu par des thèmes secondaires, contrepoints et basses continues, qui lui donnent une profondeur harmonique inépuisable.
Le « crooner » vieillissant, idole d’un jeune guitariste, ne peut prouver son amour à sa femme qu’en l’amenant à Venise pour une ultime sérénade. L’ami de jeunesse, amateur de jazz, resté à près de cinquante ans une sorte d’adolescent que l’on prend en pitié, sera-t-il d’un quelconque secours pour Emily et son mari ? Que vient faire cet étrange couple de voyageurs suisses allemands dans les douces collines de Malvern, sous le regard étonné d’un jeune auteur-compositeur-interprète ? Il faut ensuite assister aux folles expéditions nocturnes, dans un hôtel de luxe, d’un jeune saxophoniste en mal de notoriété et d’une vedette de la télévision, tous deux la tête enfouie sous des bandages après une opération de chirurgie esthétique. Enfin, retour en Italie pour une série de tête à tête entre un violoncelliste plein de « potentialités » et une « virtuose » à l’attitude bizarre…
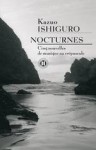 La musique est partout, susceptible de révéler les sentiments, les émotions et les secrets que tout être humain cache au fond de lui, les questions qu’il se pose, les rêves qu’il voudrait réaliser. Et l’écriture est telle, dans son apparente simplicité, dans la sobriété des moyens utilisés, dans les changements de tempo, dans les mystères qu’elle recèle, dans l’humour des situations et des gestes, que le lecteur se prend d’affection pour les personnages – témoins ou acteurs –, devinant plus ou moins spontanément que, sous des aspects très divers, chacun d’entre eux lui ressemble, en toute humanité.
La musique est partout, susceptible de révéler les sentiments, les émotions et les secrets que tout être humain cache au fond de lui, les questions qu’il se pose, les rêves qu’il voudrait réaliser. Et l’écriture est telle, dans son apparente simplicité, dans la sobriété des moyens utilisés, dans les changements de tempo, dans les mystères qu’elle recèle, dans l’humour des situations et des gestes, que le lecteur se prend d’affection pour les personnages – témoins ou acteurs –, devinant plus ou moins spontanément que, sous des aspects très divers, chacun d’entre eux lui ressemble, en toute humanité.
Jean-Pierre Longre
- 2 mars 2011 : Sortie du film Never let me go d’après le roman de Kazuo Ishiguro.
- Nocturnes fait partie de la sélection par le magazine Lire des « 20 meilleurs livres de l’année ».
18:13 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, anglophone, kasuo ishiguro, anne rabinovitch, Éditions des 2 terres, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/10/2011
Perspectives intimes
 Gaëlle Josse, Les heures silencieuses, Autrement / Littératures, 2011. J'ai lu, 2012
Gaëlle Josse, Les heures silencieuses, Autrement / Littératures, 2011. J'ai lu, 2012
La contemplation d’un tableau requiert par nature le mutisme, et si mots il y a, ils ne peuvent naître que de l’œuvre même. Dans Les heures silencieuses, Gaëlle Josse fait surgir du silence les secrets de l’image, en donnant la parole au personnage que l’on y distingue sans pouvoir en rien le reconnaître.
D’abord l’œuvre picturale, reproduite sur la couverture du livre : un tableau d’Emmanuel De Witte, tout en profondeur, où « l’ombre qui tombe à terre en dévorant les couleurs et en assourdissant les formes » est parsemée des taches de « la lumière du soleil montant ». Dans l’enfilade des pièces de cet intérieur hollandais, la première est occupée par une femme vue de dos, jouant de l’épinette. C’est elle, Magdalena, épouse de Pieter Van Beyeren, qui tient ici son journal, par le truchement de la plume subtile et retenue de Gaëlle Josse.
À Delft, au XVIIe siècle, dans le milieu des riches négociants et des navigateurs audacieux, une épouse et mère, même si elle a la fibre commerçante, doit avant tout tenir sa maison avec la discrétion et l’efficacité requises. Alors Magdalena, qui ne doit rien laisser paraître, apaise les souvenirs cuisants, les accidents de la vie, les aspirations déçues, les tristesses durables, les souffrances passagères en suivant par l’écriture les méandres de son intimité. Il y a aussi de fugitifs moments de joie, des bonheurs artistiques (on croise avec plaisir, à l’occasion, Vermeer ou Sweelinck), et l’amour porté à ses enfants, qui n’occulte pas la perte de ceux qu’elle a perdus.
 Le dévoilement esquissé des secrets de l’âme et du corps, à l’image de ce que laisse deviner le tableau de De Witte, s’accompagne de détails précis sur la vie quotidienne, les relations familiales et amicales, locales et internationales, la solidarité même : « Nos provinces offrent l’asile à ceux qui ne peuvent vivre en paix dans leur pays. Juifs, catholiques ou réformés demeurent ici en bonne intelligence, et chacun apporte sa pierre à l’édifice commun ». Avec cela, sagesse et lucidité soutiennent la réflexion : « Chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d’une vie n’est en rien semblable à celle d’un stock d’épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elles restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est d’une moindre résistance, je le crains ».
Le dévoilement esquissé des secrets de l’âme et du corps, à l’image de ce que laisse deviner le tableau de De Witte, s’accompagne de détails précis sur la vie quotidienne, les relations familiales et amicales, locales et internationales, la solidarité même : « Nos provinces offrent l’asile à ceux qui ne peuvent vivre en paix dans leur pays. Juifs, catholiques ou réformés demeurent ici en bonne intelligence, et chacun apporte sa pierre à l’édifice commun ». Avec cela, sagesse et lucidité soutiennent la réflexion : « Chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d’une vie n’est en rien semblable à celle d’un stock d’épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elles restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est d’une moindre résistance, je le crains ».
Le silence est bien la condition de la mise au jour de la vie, un silence ponctué par la musique : « C’est une grâce de se laisser toucher par elle. Je crois volontiers qu’elle adoucit nos cœurs et nos humeurs ». Ainsi ce roman, mélancolique journal intime, est-il non seulement un témoignage biographique et historique, la mise en perspective d’une quête morale et sentimentale, mais aussi une somme esthétique : la peinture, l’écriture, la musique s’unissent pour dresser, dans une atmosphère tout en nuances, le portrait d’une femme qui, au-delà de circonstances particulières, (se) pose les questions les plus humaines qui soient.
Jean-Pierre Longre
16:57 Publié dans Littérature et musique, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, musique, peinture, francophone, gaëlle josse, editions autrement, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/06/2011
Cinq musiciens et leurs secrets
 E. W. Heine, Qui a assassiné Mozart ? et autres énigmes musicales, traduit de l’allemand par Élisabeth Willenz, Les Éditions du Sonneur, 2011
E. W. Heine, Qui a assassiné Mozart ? et autres énigmes musicales, traduit de l’allemand par Élisabeth Willenz, Les Éditions du Sonneur, 2011
Voilà quelques histoires étranges qui ont au moins deux caractéristiques communes : elles s’appuient sur des faits véridiques, et elles ont trait à la musique. Cinq grands noms des siècles passés, cinq enquêtes sur des énigmes qui ont marqué la vie et/ou la mort (la mort surtout…) de personnages illustres.
On commence (à tout seigneur tout honneur, et dans le respect de la chronologie) par le « meurtre » mystérieux de Mozart, intimement lié à la composition du Requiem. N’en disons pas plus là-dessus, pour ne rien déflorer. Joseph Haydn, lui, mourut à un âge beaucoup plus avancé, sans mystère apparent ; mais ce sont les tribulations tragi-comiques de sa tête qui nous sont révélées. Quant à Paganini, « l’un des hommes les plus extraordinaires ayant jamais vécu », avait-il fait de la prison pour avoir assassiné sa maîtresse ? L’homme, sur ce point comme sur d’autres, reste obstinément silencieux. Traînant derrière lui une solide réputation d’avarice, le virtuose, un jour, fit pourtant don à Berlioz de vingt-mille francs : quelle en fut la véritable raison ? Le dernier récit relate le destin tragique de Tchaïkovski, mort d’avoir été obligé de garder en lui le secret de ses inclinations.
Certes, le côté énigmatique de ces histoires en fait la saveur ; mais aussi la manière dont elles sont menées, en vraies nouvelles policières, dans lesquelles l’enquête méthodique aboutit à des conclusions d’une logique imparable. En outre, on en apprend encore sur la biographie, les mœurs, le tempérament, l’entourage, les conditions de travail et d’existence de cinq artistes qui ont profondément marqué la vie culturelle européenne, et qui malgré leur notoriété ont conservé par devers eux les secrets les plus intimes de leur art.
Jean-Pierre Longre
16:27 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récits, musique, allemagne, e. w. heine, Élisabeth willenz, les Éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/04/2011
Sur les traces d’Emmet Ray
 Alain Gerber, Je te verrai dans mes rêves, Fayard, 2011
Alain Gerber, Je te verrai dans mes rêves, Fayard, 2011
On se souvient du film de Woody Allen Accords et désaccords, dans lequel Sean Penn incarne un jazzman hors du commun, le génial guitariste Emmet Ray, que personne ne peut se targuer d’avoir vu, entendu, rencontré, puisque la réalité ne daigne pas le faire apparaître sous ses propres traits.
Pourtant, Alain Gerber nous raconte comment il s’est acharné à le chercher jusqu’à ce qu’il en retrouve la trace. Après une entrevue vénitienne avec Woody Allen lui-même, il mène l’enquête, au risque de se fourvoyer, à partir d’une mystérieuse cassette et du témoignage d’un étrange personnage, Jean-Charles Gracieux, digne (comme le pavillon où il habite) des meilleurs contes fantastiques. C’est ainsi que l’on parvient à côtoyer cet Emmet Ray, « né Amintore Repeto », à la fois fasciné et effrayé par Django Reinhardt dont il est présenté comme le rival, bien qu’il se soit produit dans des lieux suffisamment discrets pour que le souvenir de sa virtuosité se soit effacé des mémoires les plus fiables… C’est ainsi que l’on voyage avec Alain Gerber entre la France et l’Amérique, entre le passé et le présent, jusqu’à la modeste bourgade de Bottleneck (ce nom désigne, faut-il le préciser, le tube métallique qui permet de jouer en « slide » sur les cordes de la guitare), où nous passons un long moment avec Lorette  racontant son déconcertant compagnon, ses heures flamboyantes et son entrée dans l’ombre, son glissando de fin… C’est ainsi que l’on assiste, aux côtés d’Emmet, à des scènes d’anthologie, telle cette rencontre, au comptoir d’un établissement new-yorkais, entre Marcel Cerdan, Django Reinhardt et Igor Stravinski – excusez du peu !
racontant son déconcertant compagnon, ses heures flamboyantes et son entrée dans l’ombre, son glissando de fin… C’est ainsi que l’on assiste, aux côtés d’Emmet, à des scènes d’anthologie, telle cette rencontre, au comptoir d’un établissement new-yorkais, entre Marcel Cerdan, Django Reinhardt et Igor Stravinski – excusez du peu !
« Longtemps, l’histoire du jazz s’est appuyée sur la tradition orale, ce qui n’a pas toujours permis de distinguer les événements des rumeurs, la réalité et le mythe ». Tandis que certains auteurs ne peuvent écrire qu’en vampirisant l’intimité de personnes réelles, au risque de la mort, Alain Gerber, qui a, lui, redonné l’épaisseur de l’existence à des musiciens devenus légendes (Charlie Parker, Chet Baker, Billie Holiday, Louis Armstrong, Paul Desmond, Frank Sinatra, Miles Davis, Django Reinhardt…), insuffle ici la vie à des êtres de papier ou de pellicule. Je te verrai dans mes rêves est le récit d’une rencontre pleine de vérité : celle d’un écrivain épris de jazz et d’un être essentiellement musical grâce auquel est tenue la promesse du titre.
Jean-Pierre Longre
En bonus, quelques rappels: Le jazz littéraire d'Alain Gerber.pdf
09:00 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, musique, francophone, emmet ray, alain gerber, editions fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/03/2011
Épreuves et variations
 Christian Gailly, K.622, Minuit, 1989, réédition coll. « double », 2011
Christian Gailly, K.622, Minuit, 1989, réédition coll. « double », 2011
Les phrases de Christian Gailly sont tâtonnantes, voire tatillonnantes – comme l’est la quête de son personnage, assidue, obstinée, aléatoire. Un personnage tantôt narrateur et observateur de lui-même, tantôt protagoniste et observé à la loupe, toujours à la recherche de l’émotion suscitée par l’audition radiophonique du Concerto pour clarinette en la majeur de Mozart (K.622). Mais voilà, « les conditions de l’émotion ne sont pas l’émotion, les conditions de l’émotion ne sont que le décor de l’émotion, et s’il est possible, toujours possible de reproduire le décor extérieur, le décor intérieur, lui, n’est pas reproductible, il change à vue, écrit-il ». L’achat de diverses interprétations enregistrées s’avère infructueux, même s’il procure quelques instants de quasi bonheur, jusqu’au jour de l’annonce d’un concert qui va remplir chaque instant de la vie du personnage et créer l’événement.
La lecture burlesque est possible (de ce burlesque irrésistible, agile et subtilement agaçant que peut procurer, parfois, le son de la clarinette dans les traits mozartiens). Mais K.622 est aussi une série de variations sur des thèmes liés à la quête éprouvante, inassouvie, réitérante (d’un choc musical, d’un costume parfait, de la beauté littéraire, sonore, visuelle) : « Reste l’écriture, la musique, la peinture, la beauté en un mot, la BEAUTÉ, mais que vaut-il mieux ? La chercher ? L’ignorer ? La connaître ou ne pas la connaître ? Meurt-on plus heureux auprès d’elle ? Moins désespéré ? ». Et le chapitre 3, qui tente de traduire en mots les trois mouvements du concerto de « WAM », ou en tout cas les impressions subjectives procurées par son audition, témoigne, en une sorte de condensé du roman, d’un art consommé de l’écriture musicale autant que des limites objectives de la superposition des deux esthétiques, sonore et verbale.
La parole et son commentaire, la musique et ses effets : il y a tout cela. En outre, K.622 est paradoxalement et fondamentalement un roman de l’émotion amoureuse : « Ses yeux ne me laissent pas la regarder en paix, il y a un point blanc dans chaque œil, un reflet qui m’indique qu’une source de lumière est entre nous ». C'est à quoi peut mener la musique de Mozart…
Jean-Pierre Longre
16:13 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, christian gailly, mozart, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/02/2011
Face à la laideur
 Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Jérôme Bonnetto, Le dégénéré, L’Amourier, 2010
Il y a quatre personnages : le narrateur, Luna, Victor et la jeune pianiste. Ajoutons les Niçois et la musique pour parfaire le compte. Pour raconter l’histoire, « on se parle à soi-même. C’est comme ça que ça commence. C’est comme ça qu’on dégénère ».
Et c’est « comme ça » que le lecteur est embarqué dans ce monologue intérieur, pris dans le tourbillon du soliloque, dans les lacets de la mémoire, dans la spirale de la parole intérieure, dans le piège de l’imagination, dans la folie des fantasmes. Ce qui guide le narrateur, et qui en même temps l’enferme, c’est son exigence. Exigence musicale se préservant « des méfaits de la compromission et du renoncement », face à l’ami Victor qui est devenu une « oie » ; exigence morale face à la corruption de la société, en particulier celle de la ville de Nice, qui est « devenue abjecte » ; exigence esthétique qui lui permet d’entendre les sonates inventées par Luna et de les retranscrire purement et simplement…
Tout aurait pu être beau : Nice et « le jardin d’Alsace-Lorraine », la musique enseignée au conservatoire, la visite de « la jeune pianiste », les demoiselles, les relations avec les autres, ceux qui l’appellent Le Dégénéré. Mais tout, dans la tête du narrateur en proie à lui-même et au monde, est dégénérescence. « C’est à se prendre la tête dans les mains et à ne jamais se la lâcher ». Et tout, dans ses phrases, dit qu’il faudra bien que cela finisse un jour, d’une manière ou d’une autre, comme dans les romans de Marguerite Duras ou dans les tragédies de Racine. Le dégénéré met en mots désespérants l’impuissance devant la laideur du monde et de l’âme humaine. Cela donne un roman angoissant, révolté, sombre, beau.
Jean-Pierre Longre
17:34 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jérôme bonnetto, l’amourier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/02/2011
Un genre paradoxal
 Jean Nicolas De Surmont, Vers une théorie des objets-chansons, ENS Éditions, 2010
Jean Nicolas De Surmont, Vers une théorie des objets-chansons, ENS Éditions, 2010
Jean Nicolas De Surmont, spécialiste des théories et de l’histoire de la chanson (particulièrement française et québécoise), propose dans cet essai différentes approches du « phénomène chansonnier », en le considérant du point de vue lexicographique et dans un sens extensif : « Étudier la chanson revient […] à étudier des chansons, des objets esthétiques divers dans leur style […] ainsi que des objets changeants ».
En cinq chapitres (« La poésie vocale par monts et par vaux », « Des linéarités parallèles : la poésie et la musique », « Les mutations componentielles de l’objet-chanson », « Chanson populaire et sa « populaire » épithète », « Les clivages moraux et esthétiques »), il s’adonne donc à un examen des différentes couches de signification que recouvrent le concept et les qualificatifs qui lui ont été appliqués au cours des siècles. Si toutes les chansons ont comme point commun, en général, la brièveté et la simplicité, comment expliciter des adjectifs tels que « populaire », « folklorique », « signée », « commerciale », « lettrée », « intellectuelle » ou des syntagmes tels que « chanson de tradition orale », « chanson poétique d’auteur », « poésie chantée », « chanson à texte », dont beaucoup ont sémantiquement varié au fil du temps ? Et comment résoudre la complexité engendrée par le parallélisme entre texte et musique, ainsi que par les variations de ces deux ensembles ? « C’est essentiellement la variabilité des formes et des composants des objets-chansons qui définit les métissages », et seule une observation minutieuse permet d’identifier les « types de variations ». Le chapitre consacré à la chanson populaire illustre les difficultés d’identification : l’épithète en est ambiguë depuis le romantisme, et le substantif lui-même a plusieurs fois changé de portée depuis le Moyen Âge. Même type de plurivocité lorsqu’on parle de « musique populaire », ou lorsqu’on qualifie la chanson de « bonne » ou « mauvaise », sur les plans moral ou esthétique…
La chanson est un genre paradoxal, puisqu’il s’agit à la fois d’un « genre mineur de la littérature » et d’un « genre reconnu », notamment par le peuple, du « genre le plus consommé mais aussi le moins étudié ». La confusion nécessitait une clarification par l’approfondissement des notions. Ce livre, savant et documenté, y contribue largement.
Jean-Pierre Longre
10:12 Publié dans Essai, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, chanson, jean nicolas de surmont, ens Éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2010
Les secrets de la Messe en si
 Catherine Fuchs, La beauté du geste, Bernard Campiche Éditeur, 2010
Catherine Fuchs, La beauté du geste, Bernard Campiche Éditeur, 2010
Gianni Orsini, chef d’orchestre autour duquel tourne l’intrigue principale du roman, a comme suspendu son « geste ». Sa disparition laisse perplexe son entourage, parmi lequel les cinq héroïnes, qui ont toutes quelque chose à voir avec lui (musique, amour, rencontre de hasard…) et qui ont toutes à voir les unes avec les autres. Il y a donc Gianni, il y a Marianne, Isabelle, Tatiana, Katalin, Béatrice, et il y a Jean-Sébastien Bach, dont l’œuvre est « si puissamment rassurante », et envers qui Béatrice, entre autres, « se sent transportée de reconnaissance ».
Le roman de Catherine Fuchs, elle-même musicienne, est un concert. Les mots, « miraculeux assemblages qui exaltent le banal et disposent le merveilleux à hauteur d’homme », et les notes, qui n’expliquent rien mais dont la combinaison peut éclairer bien des choses, développent le même récit, suivent la même structure : celle de la fameuse Messe en si, avec ses cinq parties auxquelles correspondent les cinq sections du livre : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Le concert donné en la cathédrale de Genève est la caisse de résonance des souvenirs, des sentiments, des questionnements des protagonistes, interprètes ou auditrices, pour lesquelles les mots, dits ou tus, forment une chaîne traçant une continuité de l’une à l’autre. Continuité complexe, faite d’anticipations et de retours en arrière, de mouvements et tonalités divers, de reprises thématiques, par lesquels le lecteur, ne maîtrisant plus rien, ne peut que se laisser guider, comme par la musique.
Celle-ci permettra-t-elle de lever les mystères, celui de la disparition de Gianni comme ceux que chaque femme recèle en elle ? Au contraire, en augmentera-t-elle la puissance ? En tout cas, elle contient tout ce qui fait la vie, et ce que Marianne, chantant son dernier solo sur « Miserere nobis », évoque en son inconscient : « Prends pitié de toutes ces ébauches, de ces réconciliations impossibles, de ces amours inavouées, de ces timides amitiés, de ces jugements si vite définitifs ; regarde ces dévouements admirables, ces haines dévastatrices, ces promesses tenues, ces reniements quotidiens ».
Jean-Pierre Longre
07:35 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, catherine fuchs, bernard campiche Éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |


