06/03/2012
Présente et absente
 Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
Patrick Lapeyre, La vie est brève et le désir sans fin, P.O.L., 2010.
PRIX FEMINA 2010
Rééd. Folio, 2012
« Il y a des circonstances où quoi qu’on fasse on va toujours nulle part ». En l’occurrence, dans le dernier roman de Patrick Lapeyre, on va et on vient entre passé et présent, entre ici et ailleurs, entre le réel quotidien et nulle part. Plus précisément, Nora Neville, jeune anglaise farouchement attachée à sa liberté, sans qu’elle éprouve le besoin de s’en justifier, va et vient entre Paris et Londres, entre Louis Blériot (qui n’est pas aviateur) et Murphy (qui est trader).
Et tout tourne autour d’elle, qu’elle soit physiquement présente ou absente, jusqu’à l’obsession, une obsession aux pouvoirs aussi absolus que mystérieux : « C’est à cette heure qu’autrefois Murphy aimait entrer en communication avec Nora. Il la retrouvait sagement assise, un livre à la main, à l’intérieur d’un café de Soho ou bien se promenant dans les allées de Green Park » ; une obsession qui peut suspendre le cours du monde, pour Blériot et pour les autres : « Le temps qu’elle pivote sur elle-même en le cherchant des yeux, il n’y a plus aucun bruit, on ne sent plus le souffle d’air, la rotation de la terre s’interrompt quelques nanosecondes ».
C ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
ertes, le personnages de Louis Blériot, « un peu poltron », anxieux, angoissé, à la fois fuyant et soumis à une épouse qui lui assure la subsistance matérielle, est celui qui occupe le plus souvent les pages du livre, mais les deux hommes se trouvent réunis par leur amour pour Nora, d’abord comme « de part et d’autre d’une paroi très fine », avant une véritable rencontre. Et c’est leur destinée, en même temps que la sienne, que la jeune femme tient inconsciemment entre ses mains.
A l’instar du titre, évocateur et harmonieux, emprunté au poète japonais Issa, le style de Patrick Lapeyre est aéré et allusif, limpide et plein d’échos ; sous un apparent dépouillement, il ne dédaigne pas l’expressivité, la tournure imagée voire surprenante – comme est surprenante l’héroïne fraîche et tragique, présente et absente, attendue et imprévisible, réelle et irréelle – un peu comme si se retrouvaient dans le monde d’aujourd’hui la Manon Lescaut de l’abbé Prévost (dont l’auteur revendique d’ailleurs la paternité), mais aussi la Nadja d’André Breton.
Jean-Pierre Longre
16:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, patrick lapeyre, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/02/2012
Match livresque
 Pierre Autin-Grenier et Christian Garcin, Quand j’étais écrivain, Finitude, 2011
Pierre Autin-Grenier et Christian Garcin, Quand j’étais écrivain, Finitude, 2011
Face à face, dos à dos, tour à tour ? En tout cas, deux écrivains, fort marris de la maigreur de leurs ventes, se retrouvent autour de bonnes bouteilles et se lancent un défi susceptible de leur remonter le moral, sait-on jamais. Pour l’un, Christian Garcin (alias Christophe Garçon), c’est « le concours de la plus maigre assistance en librairie » ; pour l’autre, Pierre Autin-Grenier (alias Paul Autant-Grognard), le gagnant serait celui « qui collectionnerait le plus d’invitations » dans les lieux culturels les plus divers.
Ce double défi donne lieu à un délicieux double petit livre, « côté pile et côté face », une double « fantaisie » pleine de rebondissements saugrenus et d’humour irrésistible, parsemée de citations et de proverbes chinois qui laissent perplexe.
À chacun ses voyages, à chacun son récit, à chacun son style, alerte et sans chichis, le style des vrais écrivains qui ne se prennent pas pour des institutions littéraires. Tout se déroule dans le fumet engageant de « casseroles frémissantes » et le bouquet enivrant de fameux bourgognes, puis se résout d’une manière un peu inattendue, mais toujours avec les livres. Les livres auxquels – auteur ou lecteur – on n’échappera pas.
Jean-Pierre Longre
Dans le même esprit, mais dans un contexte bien différent, on lira avec un plaisir non dénué d'arrière-pensées les mésaventures d'écrivains anglo-saxons racontées par eux-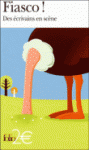 mêmes: lectures publiques sans public, signatures qui tournent court, rencontres inattendues.
mêmes: lectures publiques sans public, signatures qui tournent court, rencontres inattendues.
Ces souvenirs, extraits de Hontes, confessions impudiques mises en scène par les auteurs (éditions Joëlle Losfeld) sont d'autant plus délicieux que, tout en étant pleins d'humour et d'autodérision, ils renseignent sans faux-fuyants sur la réelle condition de l'écrivain débutant ou confirmé, méconnu ou célèbre, et sur l'ignorance, voire le mépris dans lesquels la société occidentale actuelle tient la littérature...
Fiasco! Des écrivains en scène. D'après une anthologie de Robin Robertson, traduit de l'anglais par Catherine Richard, Gallimard, Folio, 2011.
15:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, pierre autin-grenier, christian garcin, finitude, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/02/2012
« Pouvoir rire de tout, ce n’est pas rien »
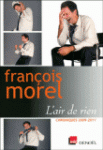 François Morel, L’air de rien, chroniques 2009-2011, France Inter/Denoël, 2011
François Morel, L’air de rien, chroniques 2009-2011, France Inter/Denoël, 2011
Le vendredi matin, un peu avant le journal de neuf heures, France Inter donne la parole à un drôle de bonhomme qui s’est fait connaître jadis avec les Deschiens (ce dont on doit lui rebattre les oreilles, d’ailleurs) et qui, depuis, a fait son chemin, notamment sur les planches théâtrales et à la radio, dans ses « billets » d’humeur et d’humour.
Chroniques de circonstance qui ont pourtant une portée plus générale que les simples (ou complexes) événements auxquels elles se réfèrent, elles donnent, sans forcer la note, matière à un livre savoureux. Elles courent sur deux saisons, du 4 septembre 2009 au 30 juin 2011, et nous replongent dans l’histoire immédiate, nous rappelant des faits petits et grands qui ont ponctué l’actualité ; le tout sur le mode délicatement railleur, finement burlesque, faussement naïf caractérisant la manière de François Morel, qui ne se prive pas, parfois, de laisser s’épancher une sensibilité sincère, voire une colère à peine contenue.
On ne rappellera pas toutes les affaires, toutes les aberrations politiques et sociales, toutes les injustices, tous les scandales auxquels s’attaque l’humoriste : un par semaine en presque deux ans, le choix est trop difficile. On dira simplement que le fait de lire ces chroniques confirme l’auditeur dans ses impressions fugitives : voilà un auteur qui manie avec une belle dextérité les mots, la syntaxe, les tonalités diverses (toute la gamme qui va du style enfantin à la fausse grandiloquence), sans se départir de sa personnalité, et sans se prendre au sérieux. « J’ai envie de parler de tout. […] C’est tout. C’est rien ». C’est salutaire.
Jean-Pierre Longre
11:34 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, francophone, françois morel, france inter, denoël, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/02/2012
« Le plus triste et le plus heureux des hommes »
É ric Durnez, Le voyage intraordinaire, Lansman, 2011
ric Durnez, Le voyage intraordinaire, Lansman, 2011
Un homme seul, dans la vie et sur la scène, raconte. Il se raconte, il raconte le voyage de sa vie, son « épreuve de force intérieure », sorte d’odyssée à la fois mentale et physique, aux étapes tour à tour vécues et rêvées.
« C’est arrivé comme ça et ça n’a plus fait l’ombre d’un pli ». Il décide d’un coup de quitter sa famille, ses camarades, et d’entamer ce qui se révélera comme un voyage initiatique. Ses souvenirs, présentés dans le désordre de la mémoire, évoquent des rencontres inopinées : « Le doyen de l’humanité, la fille la plus bête du monde, le pilote de la Grande Ourse, la jeune femme à l’orange, l’aubergiste des jours heureux, le véritable Monsieur Moyen, le manieur de paradoxes, le garçon aux trois yeux » (efficaces pour la mémoire, ces récapitulations périodiques…). Chacune de ces rencontres est une étape révélatrice, entre autres, de la relativité du temps et de la vie.
Le récit se referme sur lui-même, semble-t-il (avant de nouvelles aventures ?). Retour à la case départ, comme Ulysse à Ithaque, avec les changements inhérents au défilement du temps… Cette pièce narrative fait aussi réfléchir sur le statut même du genre théâtral : qu’est-ce que la scène, sinon une production de l’esprit, de l’imaginaire et du langage ?
Jean-Pierre Longre
16:54 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, belgique, francophone, eric durnez, lansman éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/01/2012
« La rue m’étonne toujours »
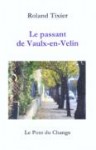 Roland Tixier, Le passant de Vaulx-en-Velin, Le Pont du Change, 2011
Roland Tixier, Le passant de Vaulx-en-Velin, Le Pont du Change, 2011
Si l’on veut sortir des clichés que les médias affichent invariablement lorsqu’ils évoquent les banlieues des grandes villes, il faut lire les textes de Roland Tixier sur Vaulx-en-Velin. Loin du misérabilisme de rigueur et des rumeurs violentes qui y sont liées, le poète chante, dans de brèves strophes en forme de haïkus, les joies simples et naturelles d’une ville qu’il connaît bien, mais dont chaque exploration est pour lui une nouvelle source de découvertes.
Lumières, poussières et promesses du printemps, oiseaux dans le vent, feuillages mobiles des arbres, la nature tient une place de choix le long des rues, des avenues et des trottoirs, d’où ne sont nullement exclus les « visages singuliers », les « acteurs extraordinaires », les « files d’attente à Casino ».
« La rue m’étonne toujours
Tant de panoplies
Tant de gens différents »
C’est bien une ville, avec ses bus et ses chantiers, ses quartiers et ses marchés, avec ses passants (parmi lesquels se glisse, tiens donc, Georges Perec), et aussi avec tout ce qui fait la vie : les souvenirs, la musique, les sensations, la légèreté ou la lourdeur de l’air, le temps qui passe, le cycle des saisons, « l’impression que tout recommence » ; bref, la discrète et immuable beauté d’un monde qu’il convient de voir d’un regard neuf, par-delà les apparences. Pour cela, rien ne vaut la poésie.
Jean-Pierre Longre
http://lepontduchange.hautetfort.com
Au Pont du Change, d'autres recueils de Roland Tixier:
- Simples choses (2009), "haïkus urbains", "regard posé sur le monde".
- Chaque fois l’éternité (2011): voir http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/09/07/des-tro...
22:57 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, roland tixier, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/01/2012
« L’arôme des mots à l’infini »
 Étienne Klein, Jacques Perry-Salkow, Anagrammes renversantes ou Le sens caché du monde, Flammarion, 2011
Étienne Klein, Jacques Perry-Salkow, Anagrammes renversantes ou Le sens caché du monde, Flammarion, 2011
Quoi de commun entre « Le massif des Écrins » et « Les défis sans merci », entre « Le triangle des Bermudes » et « Le bruit des gens de la mer », entre « La gravitation universelle » et une « Loi vitale régnant sur la vie » ? Outre des recoupements thématiques et des correspondances de sens, on l’aura compris, chaque couple d’ensembles verbaux est anagrammatique.
On pourrait citer chacun d’entre eux, chaque page : tout est en ordre, tout est réjouissant, tout est judicieux. Car les auteurs – l’un physicien, l’autre musicien – ne se contentent pas de jouer avec les lettres et les mots, ni de rappeler l’histoire sacrée, sociale, satirique, spirituelle des anagrammes. Ils se sont débrouillés pour faire de chacune d’entre elles un prétexte à développement, dans des domaines aussi divers que la littérature, la science, l’art, l’histoire, l’actualité, la vie… Chaque texte est un concentré ludique d’érudition. Un exemple limite ? « En somme, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes : le marquis de Sade démasqua le désir, l’amiral Nelson sillonna la mer, Robert Schumann reconnut Brahms et Claude Lévi-Strauss a des avis culturels. »
Souvent, on ne se contente pas d’un ou deux mots. Voici par exemple ce que devient « Jean-François Champollion, conservateur du département d’égyptologie au musée du Louvre » : « À la lueur fauve d’un gros lampion dépoli, et gouvernant mon émoi, je décrypte des cartouches ». Et « le docteur Guillotin » ? Eh bien, « il en rougit du collet ». Et « Aurore Dupin, baronne Dudevant, alias George Sand » ? Il est vraisemblable qu’elle « valsera d’abord au son du piano d’un génie étranger ». Tout le monde sera par ailleurs d’accord pour dire que l’« entreprise Monsanto » produit un « poison très rémanent », ou qu’avec « le commandant Cousteau », « tout commença dans l’eau ». Le tout à l’avenant, assorti d’explications aussi solides que plaisantes, jusqu’à l’hommage à l’éditeur, « les éditions Flammarion », qui émettent « l’arôme des mots à l’infini »… en tout cas avec ce petit livre à savourer sans retenue, et à poursuivre soi-même. Car c’est bien connu, mais il vaut mieux le rappeler à chacun : si on savoure, on suivra ; ose !
Jean-Pierre Longre
19:13 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : essai, jeu verbal, francophone, Étienne klein, jacques perry-salkow, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/01/2012
Le « vouloir-vivre » et le « bien-vivre »
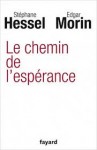 Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, Fayard, 2011
Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l’espérance, Fayard, 2011
On sait le succès planétaire qu’a connu le petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous !. Un succès non seulement livresque, mais aussi, pour ainsi dire, existentiel et social, puisque les « Indignés » se manifestent un peu partout contre les aberrations du règne de la finance. On leur reproche parfois de ne pas aller au-delà de la contestation, de ne pas proposer de solutions concrètes aux impasses du capitalisme.
Le chemin de l’espérance est, délibérément ou non, une réponse à ces reproches. En moins de 60 pages, Stéphane Hessel et Edgar Morin (dont les essais politiques antérieurs représentent en l’occurrence une solide base de réflexion) proposent une « voie politique de salut public » contre ce « qui nous conduit au désastre » en Europe, dans le monde et, surtout, en France. Les transformations suggérées reposent sur un idéalisme qui n’est pas le contraire du réalisme. La Liberté, l’Égalité, la Fraternité sont à juste titre remises à l’ordre du jour comme soutiens de la nécessaire solidarité, qu’il faut « revitaliser » dans tous les domaines de la société. Cette revitalisation concerne la jeunesse, le travail et l’emploi, l’économie et la consommation, l’éducation, la culture, le fonctionnement de l’État, la démocratie.
Lutter pour un « vouloir-vivre » et un « bien-vivre », ensemble et individuellement, ne pourra se faire « si l’on n’entreprend pas de juguler la pieuvre du capitalisme financier et la barbarie de la purification nationale », ce qui n’ira pas sans des changements radicaux dans l’organisation sociale ni sans un apaisement des tensions et des divisions.
Il ne s’agit pas pour les deux auteurs de « fonder un parti nouveau », mais de régénérer la vie collective et de renouveler la politique. Ce n’est pas une utopie.
Jean-Pierre Longre
11:51 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, stéphane hessel, edgar morin, éditions fayard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/12/2011
Les violences de l’art
 Yves Wellens, Épreuve d’artiste, Grand miroir / Renaissance du livre, 2011
Yves Wellens, Épreuve d’artiste, Grand miroir / Renaissance du livre, 2011
Stéphane Mandelbaum (1961-1986) a connu le destin tragique d’un artiste maudit ; un destin, en quelque sorte, à l’image de sa peinture violente, provocatrice, transgressive, où la mort, le sexe, le sang, la chair sont objets de fascination. Peintre insatisfait, portraitiste tourmenté, il se fit aussi voleur, et en mourut assassiné à 25 ans.
Le personnage a de quoi attirer les écrivains en quête de sujets forts. Certains pourraient en faire une biographie pleine de références ; d’autres un roman aux résonances vigoureuses. C’est le genre qu’a choisi Yves Wellens, mais à sa manière particulière, donnant des allures réalistes à l’invention et des airs romanesques à la réalité – et développant en quelque sorte ce qui se présentait sous forme abrégée ou ramassée dans certains de ses ouvrages précédents, comme Le cas de figure (Didier Devillez, 1995) ou Incisions locales (Luce Wilquin, 2002).
Selon un canevas quasiment immuable et terriblement prenant, entre prologue et épilogue, se succèdent dix chapitres d’« actualités » et sept chapitres de « portraits », qui bâtissent le processus biographique, artistique, mental du personnage devenant sous nos yeux la personne réelle de Stéphane Mandelbaum. Ce qui importe, semble-t-il, c’est moins de raconter une vie, certes hors du commun, que de tenter d’explorer les tréfonds de la création artistique avec ses tâtonnements, ses fulgurances, ses échecs, ses excès, ses risques mortels. Il y a l’enquête journalistique avec son cheminement cahoteux, et la construction esthétique avec ses errements chaotiques. Et à cette construction ne sont pas étrangers les « portraits » d’êtres tout aussi hors normes que Mandelbaum : Rimbaud, Pasolini, Bacon, Pierre Goldman, Goebbels, Himmler… On peut dire que ces portraits, de même qu’ils font partie intégrante du livre, sont au cœur même de l’œuvre du peintre.
Ainsi Wellens donne-t-il une tragédie en forme de puzzle dont chaque ensemble de scènes, chaque acte vise à percer des secrets, à approcher les rapports intimes entre un homme (sa vie, sa mort) et son œuvre. « On atteint, dans cette circonstance, un cas limite de contamination de l’œuvre par la réalité, mais aussi bien de la réalité par l’œuvre, sans qu’on sache parfaitement discerner en quel sens l’influence joue le plus ». ET Stéphane Mandelbaum lui-même de citer cette phrase : « J’ai une certaine faiblesse pour les criminels et les artistes : ni les uns ni les autres ne prennent la vie comme elle est ». Ainsi va la création.
Jean-Pierre Longre
http://www.renaissancedulivre.be/index.php/litterature/grand-miroir
16:17 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, peinture, belgique, francophone, stéphane mandelbaum, yves wellens, grand miroir, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/12/2011
De Valentin à Raymond
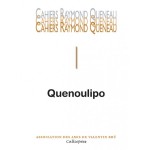 Cahiers Raymond Queneau n°1, "Quenoulipo", Éditions Calliopées, 2011
Cahiers Raymond Queneau n°1, "Quenoulipo", Éditions Calliopées, 2011
Il y a eu, jusqu’en 1986, la première série des Amis de Valentin Brû ; puis les Cahiers Raymond Queneau, et une nouvelle série des Amis de Valentin Brû ; dorénavant, l’écrivain a repris la place du personnage et la nouvelle série des Cahiers Raymond Queneau, toujours sous l’égide de l’association des Amis de Valentin Brû, est publiée par les éditions Calliopées, maison qui a l’expérience des ouvrages sur Queneau et des revues diverses (Apollinaire, Cahiers Jean Tardieu, Études greeniennes).
Tout cela, Daniel Delbreil, directeur des publications, le rappelle à bon escient dans son éditorial, avant de laisser la place à Astrid Bouygues, responsable de ce numéro 1 consacré aux rapports entre Queneau et l’Oulipo (bien normal, puisque, comme chacun le sait, l’auteur de Cent mille milliards de poèmes fur cofondateur de l’Ouvroir, qui a fêté récemment ses 50 ans). Alors on a invité du beau monde, de belles plumes qui représentent différentes générations, différentes manières, différents types de relation au père (ou grand-père)… Paul Fournel, qui affirme justement : « Il n’est pas étonnant que chaque oulipien ait « son » Queneau et en fasse le meilleur usage » ; puis Frédéric Forte, Ian Monk, Jacques Jouet, Michèle Audin, Michelle Grangaud, Harry Mathews, Daniel Levin Becker, qui se sont tous soumis aux contraintes de l’écriture oulipienne et/ou mémorielle ; sans oublier, exhumés et présentés par Bertrand Tassou, des textes inédits de Jacques Bens, oulipien historique.
La vocation première des Cahiers Raymond Queneau est, comme on s’en doute, l’étude de l’œuvre quenienne. Après la création, donc, priorité aux universitaires : Camille Bloomfield mesure et analyse avec une précision scientifique les rapports Queneau–Oulipo, Virginie Tahar examine de près les rapports intertextuels entre les mêmes, et Astrid Bouygues fait part des relations oulipiennes entre les écrits de François Caradec et Raymond Queneau. Comptes rendus et échos divers closent, comme il se doit, un volume qui ne manquera pas de ravir un public déjà conquis, mais aussi de conquérir un public potentiel.
Jean-Pierre Longre
Pour commander ou s’abonner :
15:43 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, essai, francophone, raymond queneau, oulipo, éditions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/12/2011
Dans le silence des profondeurs
 Valérie Canat de Chizy, Pieuvre, Jacques André éditeur, 2011
Valérie Canat de Chizy, Pieuvre, Jacques André éditeur, 2011
« Dans l’antre du poème, accueillir sa solitude, sa vérité. Se taire une bonne fois pour toutes, laisser couler la source claire ».
Les textes qui composent Pieuvre tiennent autant de la poésie que de la narration. C’est en tout cas poétiquement que l’auteur y déroule ses souvenirs en racontant son expérience et les épreuves de la surdité, du silence, de la solitude, de l’anormalité, des transformations physiologiques, mentales, relationnelles qu’entraîne cette sorte de mise à l’écart. Une « harmonie », une « logique » particulières marquent cet enfermement dans les profondeurs de soi.
Car ce n’est pas seulement l’ouïe qui est en jeu. L’atrophie de l’un des sens entraîne la quête d’un nouvel équilibre dans le rapport à l’environnement. Les mots sont ceux des sensations qui traversent le corps : odorat, goût, toucher, et surtout vue (scintillements légers et ombres lourdes, noirceur et clarté) sont ici sollicités, faisant résonner la présence du monde et des autres.
Pas de miracle. Singulièrement, le recours à l’écriture n’est pas considéré comme la panacée, mais comme une des composantes de la survie : « Tiraillée entre le désir de vivre et l’exigence de l’écriture, j’oscille entre ouverture et repli. Il me faut trouver l’équilibre juste entre ces deux pôles. L’extériorisation me fait perdre de la profondeur. Tandis que la solitude me rapproche de ce qui en moi est humain. Forcément douloureuse, elle me mène à creuser dans l’obscurité pour trouver la lumière ». Cette lumière, malgré tout, Valérie Canat de Chizy, qui n’en est pas à sa première expérience poétique, nous la fait entrevoir dans ce récit poétique en demi-teintes.
Jean-Pierre Longre
22:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, poésie, francophone, valérie canat de chizy, jacques andré éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/12/2011
Comment naît la musique
 Alain Gerber
Alain Gerber
Blues, Fayard, 2009, Le livre de poche, 2011
« Une musique immense, qui n’avait en aucun musicien ni commencement ni fin. Une musique à peau sombre, née avec la peau craquelée des vieux cuirs. Par hasard, j’appris un matin, à Clarksdale (Mississippi), dans le comté de Coahoma, qu’elle portait un nom : ces morceaux que nous chantions sans nous connaître, quelqu’un les avait appelés des blues ». Pour en arriver là, que de tribulations, que de vies cassées, que de violences, que d’aspirations à ce que certains appellent la liberté ou le bonheur, dont on sait bien qu’ils n’existent pas ici bas.
Alain Gerber, avec la verve poétique et le pouvoir d’évocation qu’on lui connaît, illustre en quelques destinées le cheminement vers la naissance de cette musique vouée, « comme le silence, à étouffer les soupirs et les cris de joie de ce monde sans queue ni tête ». Nous suivons, depuis la victoire des Nordistes sur les Sudistes et l’« émancipation » des esclaves jusqu’à la mort et l’oubli – mais aussi jusqu’à l’invention de ce langage sublime qui sait exprimer l’indicible -, les vies de Nehemiah, Cassie, Silas, ces vies qui se perdent, se retrouvent, se reperdent, mais qui toutes se rejoignent dans le rêve d’autre chose.
 Musical, ce vaste roman l’est, à coup sûr, puisque, sans qu’il soit explicitement présent à chaque page, tout converge vers le blues, par la grâce progressive et miraculeuse des dons, du travail et du malheur de chaque personnage, de même que par la bonne volonté des instruments (piano, harmonica, banjo, guitare et, bien sûr, voix…) qui se plient aux rythmes, aux souffles, aux doigts de toutes sortes. Musical, le récit l’est aussi dans sa structure polyphonique, puisque chaque personnage, en se racontant, superpose sa voix à celle des autres, tout en se ménageant quelques chorus. Tous font résonner, de la Nouvelle Orléans à Chicago, du Tennessee à la Californie, des chants et des contre-chants de souffrance et de nostalgie qui passent par l’harmonie des phrases et des mots d’un vrai compositeur de romans. Comme le dit à Silas son ami le major : « Je suis convaincu qu’il existe une relation étroite entre la musique et la littérature. Malheureusement, j’ignore laquelle. L’homme qui mettra le doigt dessus méritera qu’on dresse son effigie devant le Capitole, mon cher Silas ! ». Chiche.
Musical, ce vaste roman l’est, à coup sûr, puisque, sans qu’il soit explicitement présent à chaque page, tout converge vers le blues, par la grâce progressive et miraculeuse des dons, du travail et du malheur de chaque personnage, de même que par la bonne volonté des instruments (piano, harmonica, banjo, guitare et, bien sûr, voix…) qui se plient aux rythmes, aux souffles, aux doigts de toutes sortes. Musical, le récit l’est aussi dans sa structure polyphonique, puisque chaque personnage, en se racontant, superpose sa voix à celle des autres, tout en se ménageant quelques chorus. Tous font résonner, de la Nouvelle Orléans à Chicago, du Tennessee à la Californie, des chants et des contre-chants de souffrance et de nostalgie qui passent par l’harmonie des phrases et des mots d’un vrai compositeur de romans. Comme le dit à Silas son ami le major : « Je suis convaincu qu’il existe une relation étroite entre la musique et la littérature. Malheureusement, j’ignore laquelle. L’homme qui mettra le doigt dessus méritera qu’on dresse son effigie devant le Capitole, mon cher Silas ! ». Chiche.
Jean-Pierre Longre
10:05 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, alain gerber, fayard, le livre de poche, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2011
Le sacre du métèque
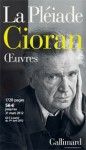 Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Cioran, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Édition établie, présentée et annotée par Nicolas Cavaillès, avec la collaboration d’Aurélien Demars, 2011
Venu des Carpates et des « cimes du désespoir », exilé à Paris, prisonnier volontaire d’une langue nouvelle et d’un pessimisme provocateur, Cioran est l’un des grands écrivains français du XXe siècle. Lui consacrer un volume de la Pléiade était justice, et la publication de ses Œuvres est un modèle du genre.
Les éditeurs ont choisi à bon escient de se limiter (si l’on peut dire) aux textes rédigés en langue française. Ce choix est dû à des raisons non seulement linguistiques et chronologiques, mais aussi philosophiques et littéraires. Les dix œuvres « françaises » publiées, présentées et annotées ici, même si elles n’échappent pas – et c’est heureux – à l’héritage roumain, forment un ensemble cohérent dans sa succession interne, tant du point de vue de la pensée que de celui du style.
On lira (ou relira) donc avec un bonheur non dénué d’une angoisse communicative Précis de décomposition, Syllogismes de l’amertume, La tentation d’exister, Histoire et utopie, La chute dans le temps, Le mauvais démiurge, De l’inconvénient d’être né, Écartèlement, Aveux et anathèmes, Exercices d’admiration, le tout complété, comme il se doit dans la Pléiade, par une préface, une biographie, une bibliographie, des notices, des notes, des appendices… Comme il se doit, et plus qu’il ne se doit : la préface, entre autres, offre, certes, une synthèse impeccable de l’œuvre de Cioran, une analyse limpide de son écriture, des ouvertures séduisantes sur les origines et les enjeux des textes, mais elle est aussi en elle-même un morceau de littérature ; à la fois enthousiaste et distanciée, construite et foisonnante, elle offre un bel exemple de « style comme aventure ».
Avec ce volume, le plaisir d’entendre une « voix [qui] accède à une pluralité de formes et de tons – de l’essai lyrique au lambeau delphique, de l’aphorisme ravageur à l’épître complice, de l’effigie destructrice à l’oraison non-violente… » est relevé par celui d’en apprendre beaucoup sur cette « voix », sur ce qui l’a construite et sapée, nourrie et affamée, encouragée et découragée, composée et décomposée. Au-delà de l’amertume ou des anathèmes, ce sont bien des « exercices d’admiration » que nous sommes amenés à pratiquer en l’écoutant, et en écoutant celles qui l’accompagnent.
Jean-Pierre Longre
19:56 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, francophone, roumanie, cioran, nicolas cavaillès, aurélien demars, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
« Pas maintenant, pas comme ça »
 Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, Les éditions de Minuit, 2011
Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, Les éditions de Minuit, 2011
En décembre 2009, des vigiles du supermarché Carrefour de Lyon La Part-Dieu, ayant surpris un jeune homme à voler une canette de bière, se défoulent sur lui jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ces quatre hommes n’en étaient sans doute pas à leurs premières brutalités, mais il n’étaient pas encore allés jusqu’à l’assassinat.
Ce dramatique fait divers a été librement adapté par Laurent Mauvignier, en soixante pages d’un seul élan – une seule phrase suspendue entre un non début et une non fin, entre inspiration et expiration, comme le dernier souffle de l’être qui ne veut pas vraiment y croire et se dit jusqu’au bout : « Pas maintenant, pas comme ça ».
La syntaxe audacieuse, tourmentée, précise, comme toujours chez Mauvignier, forge et nourrit les personnages et les événements, les sensations et la trame narrative. Adressé au frère de la victime, le récit incantatoire dévoile peu à peu ce qu’était la vie (réinventée, transposée) du jeune homme qui ne se doutait pas que, accomplissant l’acte anodin de pénétrer dans un grand magasin, il n’en ressortirait pas vivant ; sa modeste famille, ses piètres amours, ses petits boulots, tout le mène sans en avoir l’air vers la tragédie, qui est aussi celle, en quelque sorte, des quatre bourreaux dont le narrateur se demande « de quelle humiliation ils veulent se venger ».
Tragédie en un acte, en un souffle, Ce que j’appelle oubli prouve que la littérature est apte à mettre en scène la souffrance humaine, honteuse, révoltante, que l’art peut faire vivre intensément la parole toute simple d’un homme de loi : « et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière ».
Jean-Pierre Longre
09:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/12/2011
Une culture en mouvement
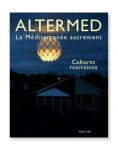 Revue Altermed n° 4, « Cultures roumaines », éditions Non Lieu, 2011
Revue Altermed n° 4, « Cultures roumaines », éditions Non Lieu, 2011
La revue Altermed a consacré trois numéros à la culture de différents pays méditerranéens, en mettant l’accent sur la création contemporaine et ce qui fait ses spécificités. La Roumanie est-elle un pays méditerranéen ? Michel Carassou, dans sa présentation, justifie le choix du numéro 4 en rappelant l’histoire et la tradition latines du pays, ainsi que l’influence ottomane à laquelle s’est heurtée « l’hégémonie slave ».
Quoi qu’il en soit, un volume consacré aux « cultures roumaines », qui ont tant de liens avec celles de divers pays d’Europe, notamment la France, autre pays méditerranéen, se justifie pleinement. Les bouleversements intervenus depuis la fin des années 1980 ne sont pas seulement politiques ou économiques. Le champ culturel a lui aussi connu des changements radicaux, ne serait-ce que par la liberté retrouvée, avec les tentatives, les tâtonnements, les expériences, les échecs et les réussites qu’elle a suscités.
La littérature occupe ici une place importante : la prose narrative, dont Andreia Roman rappelle l’histoire récente, depuis les contraintes du totalitarisme jusqu’à la « mise en question du monde » par les romanciers de la dernière génération comme Florina Ilis ; la poésie, elle aussi florissante, dont l’anthologie contenue dans ces pages complète celle qui a été publiée en 2008 dans Confluences poétiques ; le théâtre, lieu expérimental par excellence, qui oscille entre fidélité aux « racines » et « désir violent de réel ». Deux chapitres sont en outre consacrés aux arts visuels : le cinéma, dont les films d’auteurs internationalement reconnus manient à l’envi l’absurde, la satire et le « minimalisme » ; les arts plastiques – photographie, graphisme – qui tendent eux aussi vers un renouvellement complet et un engagement socio-politique marqué.
Malgré sa relative jeunesse, la Roumanie est riche d’un patrimoine culturel exceptionnel, qui a souvent nourri les avant-gardes européennes. Les artistes d’aujourd’hui ne dérogent pas à cette tradition, et on est heureux de lire ici des textes d’auteurs notoires ou encore peu connus, ainsi que des analyses précises et engageantes de certaines formes d’art contemporain.
Jean-Pierre Longre
 Les éditions Non Lieu viennent de publier une très intéressants correspondance de la poétesse et philosophe Catherine Pozzi (1882-1934) avec Raïssa et Jacques Maritain, Hélène Kiener et Audrey Deacon. Ces lettres inédites sont longuement présentées, précisément annotées par Nicolas Cavaillès, qui les a pour la plupart retrouvées à la Bibliothèque Nationale de France.
Les éditions Non Lieu viennent de publier une très intéressants correspondance de la poétesse et philosophe Catherine Pozzi (1882-1934) avec Raïssa et Jacques Maritain, Hélène Kiener et Audrey Deacon. Ces lettres inédites sont longuement présentées, précisément annotées par Nicolas Cavaillès, qui les a pour la plupart retrouvées à la Bibliothèque Nationale de France.
Nicolas Cavaillès, L’élégance et le chaos, éditions Non Lieu, 2011
17:36 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, essai, francophone, roumanie, altermed, éditions non lieu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/10/2011
Chaos bien ordonné
 Patrick Ledent, À vos caddies !, Éditions Calliopées, 2011
Patrick Ledent, À vos caddies !, Éditions Calliopées, 2011
Dans son précédent recueil (Joli coup), Patrick Ledent avait révélé un vrai talent de conteur. Voilà qui se confirme sans conteste dans À vos caddies !. Et le mot « recueil » n’est pas anodin : les vingt nouvelles, encadrées par des « Prolégomènes » et un « Envoi », bouclent un itinéraire plein de surprises, qui mène le lecteur d’une envolée satirique (le monde de la consommation) à l’autre (le monde du travail), d’un cimetière au même cimetière, à Nice où sévissent des vampires très humains. La vie, mort comprise…
Les surprises ? Elles sont multiples et variées : un drôle de restaurant où se cache une drôle de lolita, l’étrange rencontre d’une tulipe et d’un enfant, les illusions d’un tueur en série, les découragements d’un employé de bureau, les ruses d’une élégante de casino… des accidents bizarres, des hasards suspects, des rencontres inattendues…
Pour réaliste que soit le monde dans lequel évoluent les personnages et surgissent les événements, le lecteur se laisse volontiers transporter vers l’imprévu, et la verve de l’auteur y est pour beaucoup. Car le suspense s’assortit d’une écriture alerte, d’une prose séduisante où se profilent parfois quelques silhouettes familières, telle celle de Queneau qui passe comme une discrète figure tutélaire. On se laisse mener avec délices par le bout du nez pour s’évader à loisir, poussant devant soi une provision de références rassurantes et d’inventions délicieuses, dans un chaos bien ordonné. « Mais c’est dur, le chaos. Alors, pardon, je compense. Je mets de l’ordre, me réinvente, vous réinvente. Invente tout court, puisqu’on est frères. Des petites histoires. Je fais comme tout le monde, je fais comme vous : je creuse. Une évasion, ça commence par là ».
Jean-Pierre Longre
18:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, patrick ledent, éditions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/10/2011
Perspectives intimes
 Gaëlle Josse, Les heures silencieuses, Autrement / Littératures, 2011. J'ai lu, 2012
Gaëlle Josse, Les heures silencieuses, Autrement / Littératures, 2011. J'ai lu, 2012
La contemplation d’un tableau requiert par nature le mutisme, et si mots il y a, ils ne peuvent naître que de l’œuvre même. Dans Les heures silencieuses, Gaëlle Josse fait surgir du silence les secrets de l’image, en donnant la parole au personnage que l’on y distingue sans pouvoir en rien le reconnaître.
D’abord l’œuvre picturale, reproduite sur la couverture du livre : un tableau d’Emmanuel De Witte, tout en profondeur, où « l’ombre qui tombe à terre en dévorant les couleurs et en assourdissant les formes » est parsemée des taches de « la lumière du soleil montant ». Dans l’enfilade des pièces de cet intérieur hollandais, la première est occupée par une femme vue de dos, jouant de l’épinette. C’est elle, Magdalena, épouse de Pieter Van Beyeren, qui tient ici son journal, par le truchement de la plume subtile et retenue de Gaëlle Josse.
À Delft, au XVIIe siècle, dans le milieu des riches négociants et des navigateurs audacieux, une épouse et mère, même si elle a la fibre commerçante, doit avant tout tenir sa maison avec la discrétion et l’efficacité requises. Alors Magdalena, qui ne doit rien laisser paraître, apaise les souvenirs cuisants, les accidents de la vie, les aspirations déçues, les tristesses durables, les souffrances passagères en suivant par l’écriture les méandres de son intimité. Il y a aussi de fugitifs moments de joie, des bonheurs artistiques (on croise avec plaisir, à l’occasion, Vermeer ou Sweelinck), et l’amour porté à ses enfants, qui n’occulte pas la perte de ceux qu’elle a perdus.
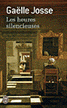 Le dévoilement esquissé des secrets de l’âme et du corps, à l’image de ce que laisse deviner le tableau de De Witte, s’accompagne de détails précis sur la vie quotidienne, les relations familiales et amicales, locales et internationales, la solidarité même : « Nos provinces offrent l’asile à ceux qui ne peuvent vivre en paix dans leur pays. Juifs, catholiques ou réformés demeurent ici en bonne intelligence, et chacun apporte sa pierre à l’édifice commun ». Avec cela, sagesse et lucidité soutiennent la réflexion : « Chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d’une vie n’est en rien semblable à celle d’un stock d’épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elles restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est d’une moindre résistance, je le crains ».
Le dévoilement esquissé des secrets de l’âme et du corps, à l’image de ce que laisse deviner le tableau de De Witte, s’accompagne de détails précis sur la vie quotidienne, les relations familiales et amicales, locales et internationales, la solidarité même : « Nos provinces offrent l’asile à ceux qui ne peuvent vivre en paix dans leur pays. Juifs, catholiques ou réformés demeurent ici en bonne intelligence, et chacun apporte sa pierre à l’édifice commun ». Avec cela, sagesse et lucidité soutiennent la réflexion : « Chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d’une vie n’est en rien semblable à celle d’un stock d’épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elles restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est d’une moindre résistance, je le crains ».
Le silence est bien la condition de la mise au jour de la vie, un silence ponctué par la musique : « C’est une grâce de se laisser toucher par elle. Je crois volontiers qu’elle adoucit nos cœurs et nos humeurs ». Ainsi ce roman, mélancolique journal intime, est-il non seulement un témoignage biographique et historique, la mise en perspective d’une quête morale et sentimentale, mais aussi une somme esthétique : la peinture, l’écriture, la musique s’unissent pour dresser, dans une atmosphère tout en nuances, le portrait d’une femme qui, au-delà de circonstances particulières, (se) pose les questions les plus humaines qui soient.
Jean-Pierre Longre
16:57 Publié dans Littérature et musique, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, musique, peinture, francophone, gaëlle josse, editions autrement, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/09/2011
« Battre le tambour »
 Jacques-Pierre Amée, Le ciel est plein de pierres, Infolio, 2011
Jacques-Pierre Amée, Le ciel est plein de pierres, Infolio, 2011
Le nouveau roman de Jacques-Pierre Amée est certes plein de pierres, mais aussi plein de rythme, et de tant d’autres choses parmi lesquelles la nature tient une place prépondérante (la forêt et les animaux, par exemple), sans compter l’amitié, l’amour, la parole, le silence, le mystère…
Le narrateur, Graham Rouge (un nom qui se détache sur la verdure, la neige, le ciel, la nuit), photographe animalier, observateur du monde lointain et proche, tente de se frayer un chemin entre souvenirs et immédiateté, entre passé et présent. Son récit, qui s’adresse à son ami Emil, hospitalisé au-delà des mers, à cette Ibi qu’il aime mais qu’il n’a pas vue depuis un certain temps, à d’autres encore, Caïm, Lucie, le lecteur, lui-même... son récit, donc, tient autant de la narration que de la poésie, du mouvement que du ressassement, de la fiction que du journal, un journal dans lequel, au fil de la lecture, on assiste à la mise en place de l’écriture.
L’auteur a l’art de (se) raconter sans en avoir l’air, par des détours, par des étapes où l’accessoire narratif parait devenir l’essentiel. « Y a rien de facile », dit périodiquement le boucher du coin : aussi difficile d’étouffer proprement un pigeon que de percer le mystère de l’énigmatique « Toubob », vagabond qui pourrait bien avoir fait disparaître avec lui la vieille dame qui l’avait recueilli, ou de reconstituer le puzzle que représente le titre du magazine NOÉ…
Voilà un livre qui « bat le tambour » (autre leitmotiv, autre rime de la prose), qui bat le rappel (des souvenirs, des amis, des contrées lointaines), qui bat la chamade (émotion à tous les tournants de pages), qui bat les cartes (pour mieux rendre compte du désordre universel). Un livre musical, où le langage des images et des mots s’impose comme une lancinante mélodie, comme une étourdissante symphonie.
Jean-Pierre Longre
15:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, suisse, jacques-pierre amée, éditions infolio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/09/2011
Se défaire du monde
 Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
Laurence Plazenet, La blessure et la soif, Gallimard, 2009, Folio, 2011
« Nous avons été deux hommes juchés face au mal. J’ai su que vous souffriez comme je souffrais. Nous adressions à des dieux différents des lamentations qui n’empruntaient pas les mêmes mots. Je ne savais pas quelle peine vous avait conduit près de moi. Je ne pensais pas qu’il fût de peine qui valût la mienne. Mais vous étiez venu du bout de la terre. Nous fûmes une seule protestation et l’amour qui ne renonce pas ».
Ces deux hommes, Monsieur de la Tour et Lu Wei, n’étaient pas faits pour se connaître : le premier, noble français plus ou moins mêlé à la Fronde, et le second, dignitaire chinois déchu par les guerres et le renversement de la dynastie des Ming, sont séparés non seulement par les océans, mais aussi par leurs origines et leurs cultures. Pourtant, leur rencontre silencieuse et leur amitié précautionneuse sont le fruit d’une convergence qui les rend inévitables : Monsieur de la Tour, brûlant d’un amour coupable et partagé pour Madame de Clermont, fuit au-delà des mers et se retrouve, au bout d’un périple aussi hasardeux que dangereux, sur un îlot où s’est retiré Lu Wei, souffrant lui-même d’un désespérant mal d’amour pour son épouse disparue. Commencent douze années de condamnation volontaire, de réclusion ascétique, au cours desquelles la soif d’absolu tente de panser la blessure, où la quête du vide le dispute à l’espoir en Dieu, ce dieu que Monsieur de la Tour cherchera encore en France, réfugié à Port-Royal, dans le plus complet dénuement, dans cet « abandonnement » qui l’accompagnera jusqu’à la fin.
Le roman de Laurence Plazenet se déroule comme une longue litanie submergeant les heurts, les atrocités, les décompositions qu’il dévoile. Psalmodiées en un récitatif qui donne autant d’importance à la musique des mots qu’à leur contenu, les phrases, dont la sobriété toute classique s’accommode parfois de circonvolutions baroques, sont prenantes. La stylisation de la forme impose l’évidence des faits et des pensées, donne à la prose une profondeur qui révèle celle des âmes.
Jean-Pierre Longre
Laurence Plazenet vient de publier Disproportion de l'homme, Gallimard, 2011. Lecture et chronique à venir…
09:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurence plazenet, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2011
Poète du mouvement
 Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral, Rafael de Surtis / Éditinter, 2011
Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral, Rafael de Surtis / Éditinter, 2011
De tous les écrivains venus de Roumanie qui, au cours du XXe siècle, ont enrichi la littérature de langue française, Ilarie Voronca est l’un des plus importants et des plus méconnus. Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Eugène Ionesco, Cioran et quelques autres font l’objet de nombreuses études ; pour les compléter, la parution de l’ouvrage de Christophe Dauphin est salutaire.
« Poète intégral », Voronca l’est à des titres divers. Théoricien de l’« intégralisme », il fut l’un des rédacteurs de la revue Integral, ainsi que d’autres revues de de cette avant-garde qui caractérisa la vie intellectuelle roumaine de l’entre-deux-guerres. En outre, toute son œuvre, en vers et en prose, relève d’une volonté d’unification « intégrale » des éléments naturels et humains. La biographie d’Eduard Marcus, alias Ilarie Voronca (1903-1946), très précisément rapportée, s’insère ici dans un environnement lui aussi parfaitement détaillé. Les années roumaines, l’installation en France, l’exil et ses difficultés, les brouilles littéraires momentanées, les amitiés, les amours, les rencontres (avec la plupart de ceux qui forment le monde artistique), les ruptures, la période de l’occupation et de la résistance, la quête désespérée du bonheur, jusqu’au suicide au domicile parisien – tout cela est solidement inscrit dans le contexte historique, social, politique, culturel, roumain, français, européen dont la destinée individuelle est indissociable.
Cette biographie est aussi un portrait moral (« Combattre les prisons, la haine, l’angoisse et l’oppression ») et surtout poétique, dans cet espace franco-roumain qu’Ilarie Voronca incarne totalement : symbolisme, avant-garde, intégralisme, lyrisme personnel… il est le poète du « mouvement », de l’« inquiétude », de l’« insatisfaction », de ces états qui ne laissent jamais en repos et d’où émane une incessante évolution.
Voilà un livre indispensable à la connaissance d’un poète majeur, qui plus est écrit par quelqu’un pour qui l’écriture est une matière vivante, puisque Christophe Dauphin, outre ses essais, a publié nombre de recueils poétiques. Son étude, qui s’appuie beaucoup sur les textes, forme un ensemble très documenté (citations, anthologie significative, riche iconographie…) : Ilarie Voronca, le poète intégral est un ouvrage nourri d’authenticité.
Jean-Pierre Longre
18:04 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, roumanie, ilarie voronca, christophe dauphin, rafael de surtis, Éditinter, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/09/2011
Des trouvailles au Pont du Change
Roland Tixier, Chaque fois l’éternité, préface de Geneviève Metge, Le Pont du Change, 2011
Alphonse Allais, L’agonie du papier et autres textes d’une parfaite actualité, introduction de Jean-Jacques Nuel, Le Pont du Change, 2011
Le Pont du Change, maison d’édition lyonnaise, enrichit sa production de deux livres à déguster lentement, avec délectation.
 L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
L’un (Chaque fois l’éternité de Roland Tixier) est un recueil de brefs poèmes qui, à la manière des haïkus, campent en quelques syllabes tel personnage, tel objet, tel paysage, telle scène, suivant les souvenirs d’un été de vacances en Limousin. Se succèdent les images que l’adulte garde de cette période enfantine, dans un univers limité à une parcelle d’espace et de temps, mais aussi élargi à tout un « monde à portée de main », où les « brosses et savons » deviennent « navires et sous-marins », où s’ouvrent de nouvelles routes – sans parler de l’évocation fugitive d’une Algérie lointaine où se déroulent des événements qui échappent à l’enfant de 10 ans… Par la « magie du verbe », choses banales deviennent « mots cueillis », « mots copeaux / qui s’entortillent », objets poétiques à peine esquissés mais harmonieusement glissés dans le silence de la page.
 L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
L’autre (L’agonie du papier) est d’une tonalité radicalement différente – variété des plaisirs, merci Monsieur l’éditeur. On savait Alphonse Allais humoriste hors pair ; on le sait, maintenant, savant et précurseur. Sous le rire et la fantaisie, sous la virtuosité parodique et la fausse grandiloquence, que d’inventions utiles, que de soins pour la survie de l’humanité ! Voilà un auteur qui, dès le tout début du XXe siècle, préconise (avant Queneau et bien avant les « textos ») une réforme profonde, phonétique de l’orthographe, et s’insurge devant la domination grammaticale du masculin sur le féminin, ou qui, devant les désastres de la déforestation et « l’agonie du papier », invente le microfilm, ancêtre de l’e-book… Dans un souci écologique et économique, il promet un bel avenir aussi bien aux énergies éolienne et marémotrice qu’aux téléconférences pour l’Assemblée Nationale, fondées sur le principe du « théâtrophone », ou qu’à un « Paris-Plage » entourant carrément la capitale pour le plus grand plaisir des vacanciers et des consommateurs de poisson. Si l’on veut plus de détails, que l’on se reporte à ce recueil de textes où l’humour, pas aussi absurde qu’on pourrait le croire, est soluble dans le progrès humain (et vice-versa).
Le Pont du Change passe par-dessus les années en deux démarches différentes. Empruntez-le sans hésiter, le trajet ne vous décevra pas.
Jean-Pierre Longre
18:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, essai, humour, francophone, roland tixier, alphonse allais, geneviève metge, jean-jacques nuel, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/09/2011
En allant chez Destouches
 Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010. J'ai lu, 2011
Mikaël Hirsch, Le réprouvé, L’Éditeur, 2010. J'ai lu, 2011
La journée du 6 décembre 1954 aura été pour quelques personnes d’une exceptionnelle densité. C’est d’abord celle où Simone de Beauvoir reçoit le prix Goncourt pour Les Mandarins, ce qui confirme le triomphe de la maison Gallimard sur ses concurrentes. Justement, dans cette maison, il y a un garçon de courses, Gérard Cohen, lui-même fils de l’un des dirigeants, et c’est sa propre journée que raconte le roman : il est chargé d’aller à Meudon, chez Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline, porter des papiers que l’écrivain déchu ne voudra même pas regarder, tant il vomit, en même temps que les Juifs et que lui-même, les « sangsues », les « maquereaux », « cette grosse baderne adipeuse de Gaston », ce « gros matou gallimardeux », et « l’univers tout entier ».
 À la fois terrorisé et fasciné par le vieil antisémite, le jeune Cohen accomplira sa mission comme d’habitude, en dépit des chiens, de la crasse et des gémissements. Mais auparavant, il profite du répit que lui donne la remise du Goncourt pour s’adonner au vagabondage, et nous suivons les zigzags spatiaux et mentaux du motocycliste. Cela donne de belles évocations contrastées du Paris des années cinquante : le Milieu (éditorial), ses habitudes et ses célébrations ; les Halles, leurs odeurs et leur grouillement ; les hôtels de passe, les œillades et les caresses professionnelles des putains ; l’île Seguin et ses usines, le village de Meudon et ses grisailles, les hauteurs de la Seine où se terre le « réprouvé »… Cet itinéraire plus ou moins aléatoire est une sorte de préparation de l’entrevue, mais surtout, peut-être, une incitation aux souvenirs. La guerre et l’occupation sont encore toutes proches, que l’enfant juif a vécues en errant « de cachette en cachette » après l’emprisonnement de sa mère et l’arrestation de la femme chez laquelle il s’était réfugié, en errant mais en parcourant la campagne, en étudiant les plantes d’Auvergne, en s’instruisant, en vivant la vie d’un garçon de son âge.
À la fois terrorisé et fasciné par le vieil antisémite, le jeune Cohen accomplira sa mission comme d’habitude, en dépit des chiens, de la crasse et des gémissements. Mais auparavant, il profite du répit que lui donne la remise du Goncourt pour s’adonner au vagabondage, et nous suivons les zigzags spatiaux et mentaux du motocycliste. Cela donne de belles évocations contrastées du Paris des années cinquante : le Milieu (éditorial), ses habitudes et ses célébrations ; les Halles, leurs odeurs et leur grouillement ; les hôtels de passe, les œillades et les caresses professionnelles des putains ; l’île Seguin et ses usines, le village de Meudon et ses grisailles, les hauteurs de la Seine où se terre le « réprouvé »… Cet itinéraire plus ou moins aléatoire est une sorte de préparation de l’entrevue, mais surtout, peut-être, une incitation aux souvenirs. La guerre et l’occupation sont encore toutes proches, que l’enfant juif a vécues en errant « de cachette en cachette » après l’emprisonnement de sa mère et l’arrestation de la femme chez laquelle il s’était réfugié, en errant mais en parcourant la campagne, en étudiant les plantes d’Auvergne, en s’instruisant, en vivant la vie d’un garçon de son âge.
Le réprouvé est un vrai livre de littérature, à tous points de vue. Celle qui s’écrit et se déroule sous nos yeux, en des phrases qui suivent avec bonheur les méandres de la mémoire et de l’autoanalyse ; celle aussi qui s’est construite dans les soubresauts politiques et sociaux (que le père de l’auteur a dû connaître dans des conditions analogues), celle qui a composé avec les abominations, les lâchetés et la mauvaise conscience, avec la souffrance, l’innocence et le courage, celle qui est inséparable de la nature humaine. Et il n’y a pas que Céline ; l’on croise, à l’occasion, Paul Léautaud, Jean Paulhan, Raymond Queneau, et cela fait toujours plaisir. Il ne faut donc pas hésiter à accompagner le jeune Gérard Cohen dans son parcours initiatique.
Jean-Pierre Longre
11:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, mikaël hirsch, l’Éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/08/2011
The Black Herald n°2 arrive
 Literary magazine –Revue de littérature
Literary magazine –Revue de littérature
The Black Herald issue #2 – September 2011 - Septembre 2011
162 pages - 13.90 € – ISBN 978-2-919582-03-7
Poetry, short fiction, prose, essays, translations.
Poésie, fiction courte, prose, essais, traductions.
With / avec W.S Graham, Danielle Winterton, Dumitru Tsepeneag, Clayton Eshleman, Pierre Cendors, Onno Kosters, Alistair Noon, Anne-Sylvie Salzman, Róbert Gál, Andrew Fentham, Hart Crane, Delphine Grass, Jacques Sicard, Iain Britton, Jos Roy, Michael Lee Rattigan, Georges Perros, Laurence Werner David, John Taylor, Sudeep Sen, César Vallejo, Cécile Lombard, Michaela Freeman, Gary J. Shipley, Lisa Thatcher, Dimíter Ánguelov, Robert McGowan, Jean-Baptiste Monat, Khun San, André Rougier, Rosemary Lloyd, Hugh Rayment-Pickard, Sherry Macdonald, Will Stone, Patrick Camiller, Paul Stubbs, Blandine Longre. and essays about / et des essais sur Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Jacques Derrida. Images : Romain Verger, Jean-François Mariotti. Design: Sandrine Duvillier.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
http://blackheraldpress.wordpress.com/magazine/the-black-herald-issue-2/
Where to find the magazine and our books / Où trouver la revue et nos publications :
http://blackheraldpressbookshop.blogspot.com/p/add-to-cart-ajouter-au-panier.html
And soon in bookshops listed here / et bientôt dans les librairies suivantes:http://blackheraldpress.wordpress.com/buy-our-titles/
Black Herald Press : http://blackheraldpress.wordpress.com/
Blog : http://blackheraldpress.tumblr.com
To follow us on Facebook / nous suivre sur Facebook : http://www.facebook.com/BlackHeraldPress
& Twitter : http://twitter.com/Blackheraldpres
Co-edited by Blandine Longre and Paul Stubbs, the magazine’s only aim is to publish original world writers, not necessarily linked in any way by ‘theme’ or ‘style’. Writing that we deem can withstand the test of time and might resist popularization – the dangers of instant literature for instant consumption. Writing that seems capable of escaping the vacuum of the epoch. Where the rupture of alternative mindscapes and nationalities exists, so too will The Black Herald.
L’objectif premier de la revue, coéditée par Blandine Longre et Paul Stubbs, est de publier des textes originaux d’auteurs du monde entier, sans qu’un « thème » ou un « style » les unissent nécessairement. Des textes et des écritures capables, selon nous, de résister à l’épreuve du temps, à la vulgarisation et aux dangers d’une littérature écrite et lue comme un produit de consommation immédiate. Des textes et des écritures refusant de composer avec la vacuité de l’époque, quelle qu’elle soit. Éclatement des codes, des frontières nationales et textuelles, exploration de paysages mentaux en rupture avec le temps : c’est sur ces failles que l’on trouvera le Black Herald.
“Black Herald Press is an outstanding new imprint – physically and stylistically their books are a delight.” — Paul Sutton, Stride magazine, 10/2010.
« La ligne éditoriale de la revue s’attache avant tout à établir un horizon élargi et diversifié de genres, de langues et de styles. Aucun thème ni mouvement commun, simplement (et c’est là que se trouve tout le sel de ces pages) l’articulation d’hémisphères, quelques terres inconnues reliées les unes aux autres pour que le style, justement, de la revue, ce soit ce point de convergence des textes entre eux. » – Guillaume Vissac, 04/2011
“Its publication feels like an event, in terms of quality and scope (it’s bi-lingual and has its sights, like Blast long before it, on the more visionary and European aspects of poetry).” – Darran Anderson, 02/2011
« Aux commandes de ce navire de pirates, Paul Stubbs et Blandine Longre, dont on avait déjà loué ici la sauvage poésie d’expression anglaise. Tous deux ont eu l’audace d’offrir à leurs contributeurs cette étrange arène où la langue, par le système d’échos qu’ils ont construit, ne peut être que remise en cause. Lecture jamais confortable, jamais contentée, donc, que celle du Black Herald, où chaque page, chaque texte, dans sa version originale et / ou dans sa traduction est source d’inquiétude. On attend avec une impatience certaine la deuxième livraison (automne 2011, nous dit-on) de ce super-héraut. » – Le Visage Vert, 01/2011
15:31 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, anglophone, francophone, poésie, nouvelle, essai, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
23/08/2011
Brisures et vérités
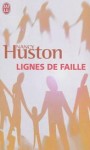 Nancy Huston, Lignes de faille, Actes Sud / Leméac, « Un endroit où aller », 2006. J'ai lu, 2011. Prix Fémina 2006.
Nancy Huston, Lignes de faille, Actes Sud / Leméac, « Un endroit où aller », 2006. J'ai lu, 2011. Prix Fémina 2006.
Quatre récits, quatre enfants de six ans différents et réunis par une ligne dont les brisures s’ouvrent peu à peu aux yeux du lecteur. Avec Sol (« Solly, Solomon »), petit garçon américain à part entière, rêvant sur Internet de puissance et d’éternité, imaginant qu’il « contrôle et possède chaque parcelle du monde », commence le parcours généalogique ascendant d’une famille reliée par quelques points d’ancrage – un grain de beauté, une poupée que se disputent violemment deux femmes âgées redevenues petites, un « vieux nounours tout râpé »…
L’exploration se poursuit avec Randall, le père de Sol, que l’on retrouve à six ans entre un père dramaturge au creux de son inspiration et une mère obsédée par ses recherches sur le Mal et les « fontaines de vie », lieux où les nazis concentraient pour les « germaniser » des enfants volés dans les pays occupés. Celle-ci, Sadie, est passée à l’âge de six ans du « parfum de tristesse » quotidien ressenti entre ses grands-parents à l’agitation réjouissante et désordonnée de la vie d’artiste menée par sa jeune mère. Finalement, c’est cette dernière, Erra (ou Kristina ou AGM), héroïne du quatrième récit, qui imprime sa marque sur tous les épisodes, en pointillés incisifs puis par la découverte de ses propres origines, donc de celles de la famille entière.
Itinéraire temporel sur plus d’un demi-siècle de bouleversements et de conflits entre 2004 et 1944, Lignes de faille est aussi un itinéraire spatial entre l’Amérique moderne et l’ancienne Europe, en passant par Israël. A travers des récits de vie individuels et familiaux, c’est la destinée du monde d’aujourd’hui qui est le véritable enjeu de la narration. C’est l’Histoire vécue de l’intérieur, dans la tension d’un mouvement chronologique inversé, à la recherche d’une authenticité dont seuls les enfants, dans leur lucide naïveté, semblent capables : « En les écoutant je repense à cette idée de théâtre et me demande si au fond le gens ne passent pas leur temps à jouer des rôles, non seulement lors des mariages mais tout au long de leur existence : peut-être qu’en conseillant ses fous grand-papa joue le rôle d’un psychiatre et en me frappant avec la règle Mlle Kelly joue le rôle d’une méchante prof de piano ; peut-être qu’au fond d’eux-mêmes ils sont tous quelqu’un d’autre mais, ayant appris leurs répliques et décroché leurs diplômes, ils traversent la vie en jouant ces rôles et il s’y habituent tellement qu’ils ne peuvent plus s’arrêter ».
Ce que se dit la petite Sadie, c’est souvent ce qu’on se dit non seulement à la lecture d’un roman, mais aussi à l’observation de la société des hommes. Lignes de faille est un roman qui, au-delà de l’habileté de la construction, de l’expressivité des soliloques enfantins, de la cruauté de certains passages, de la tendresse de certains autres, tente de mettre au jour les vérités nichées au plus profond des âmes et des corps.
Jean-Pierre Longre
16:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nancy huston, actes-sud, leméac, j'ai lu | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/07/2011
Les colères d’un modéré
 Jean Prévost, Ni peur ni haine, articles réunis et présentés par Emmanuel Bluteau, Joseph K., « métamorphoses », 2011
Jean Prévost, Ni peur ni haine, articles réunis et présentés par Emmanuel Bluteau, Joseph K., « métamorphoses », 2011
Jean Prévost n’était pas un idéologue, loin de là. Les circonstances, sa lucidité, son patriotisme, son sens politique, son humanité, son volontarisme l’ont poussé à s’engager dans la Résistance ; son assassinat par l’ennemi nazi, le 1er août 1944 dans le Vercors, a privé ses lecteurs de son œuvre à venir.
Essayiste et romancier, Jean Prévost était aussi journaliste, et en tant que tel il ne mâchait pas ses mots. En 1933, il crée avec Alfred Fabre-Luce et Pierre Dominique l’hebdomadaire Pamphlets, qui paraîtra jusqu’en mars 1934 ; des trois, il sera le seul à garder sa dignité (les deux autres deviendront pendant l’occupation des collaborateurs notoires) ; mais sept ans avant la guerre, ils unissent leurs divergences dans la rédaction de ce périodique « engagé », au sens large du terme, c’est-à-dire prenant des positions indépendantes dans les troubles de l’époque.
La publication de Ni peur ni haine est une heureuse initiative. Les articles ici réunis selon le vœu de l’auteur dévoilent son éclectisme, son intelligence et sa modernité. S’il touche à des sujets très divers, c’est en pleine connaissance de cause : politiques, économiques, sociaux, culturels, internationaux, pédagogiques, tous les problèmes sont traités en quelques pages, mais toujours à fond, sans ménagements mais sans excès, avec l’entrain d’une personnalité hors du commun, à l’écart des partis pris et des idées reçues. Qu’il défende les quarante heures ou l’enseignement de l’éducation physique, qu’il réfléchisse à la montée de l’hitlérisme ou aux événements de février 1934, qu’il enquête sur la survie matérielle des écrivains ou qu’il disserte sur les différents moyens d’information, Jean Prévost s’exprime en toute liberté, sans « peur » ni « haine », avec la logique et la clarté d’un style vigoureusement adapté au propos. Chaque texte se lit non comme un roman, non comme un simple commentaire circonstanciel, mais comme un essai dont la pérennité, la constante actualité sautent aux yeux.
À l’auteur le dernier mot, on le lui doit bien : « Dans Pamphlets, au cours d’une année particulièrement riche, j’ai tenté de mettre au point ce que je devais à mon éducation socialiste, à ma formation intellectuelle d’élève d’Alain, toutes deux modifiées par une enquête contemporaine, qui a été l’objet principal de ma vie depuis 1930. Je n’ai à dissimuler ici ni ce que je dois à ma formation, ni ce que mon expérience y a changé ; dans ces domaines où la pensée n’a jamais qu’une valeur approchée, il faut se servir hardiment de ses idées comme de ses outils ».
Jean-Pierre Longre
En savoir un peu plus sur Jean Prévost :
http://www.gallimard.fr/Folio/livre.action?codeProd=A41017
http://www.lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/jean-prevost-aux-avant-postes
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2011/05/20/aux-jeu...
http://jplongre.hautetfort.com/archive/2010/04/23/la-noblesse-des-parvenus.html
À noter que l’association « Les amis de Jean Prévost » (www.jeanprevost.org) publie la revue Aujourd’hui Jean Prévost, dont le dernier numéro propose, entre autres, un « Carnet de voyages » de l’auteur, ainsi que son texte Les sports en France. Un volume qui devrait susciter l’intérêt de tous les lecteurs de Jean Prévost, passés, présents et à venir.
Contacts : « Les amis de Jean Prévost », Maison du Patrimoine, 38250 Villard-de-Lans. Correspondance : Marie-Aline Prévost, maprevost@hfp.fr ou Emmanuel Bluteau, emmanuel.bluteau@jeanprevost.org .
16:13 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, revue, francophone, jean prévost, emmanuel bluteau, éditions joseph k., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/07/2011
Drôle ou morbide ?
 Patrick Rambaud, Comment se tuer sans en avoir l’air, La Table Ronde, 1986, rééd. Folio, 2011
Patrick Rambaud, Comment se tuer sans en avoir l’air, La Table Ronde, 1986, rééd. Folio, 2011
L’un des propres de l’homme est « le suicide individuel » : les animaux, à part quelques exceptions circonstancielles et généralement collectives, ne prennent pas ce genre d’initiative. C’est en tout cas ce qu’explique Patrick Rambaud en introduisant son « Manuel d’élégance à l’usage des mal partis avec des ruses, des méthodes et des principes expliqués par l’exemple ». Comme un autre propre de l’homme est, selon Rabelais, le rire, il semble que Rambaud ait décidé de développer l’un en s’aidant de l’autre (et inversement).
Cela nous vaut quatorze moyens d’en finir sans honte et en préservant son amour-propre. Il n’est pas question de les énumérer ici, mais on saura que les quatorze chapitres qui les abordent ne sont ni vulgairement pédagogiques ni abstraitement théoriques. Tout passe par des anecdotes aussi tragi-comiques que convaincantes. Les personnages dont l’auteur nous narre le trépas volontaire, nous les connaissons, nous les côtoyons, c’est nous, en plus malheureux, en plus désespérés, en plus obstinés. Les circonstances de la vie les ont poussés à interrompre celle-ci « sans en avoir l’air » : il leur faut trouver un moyen de maquiller leur suicide en accident, en meurtre, en geste héroïque (et « con »), en infarctus, en maladie mortelle… et ils le trouvent.
Tout cela est fort drôle, même s’il nous arrive de rire jaune, tant le genre humain dans son entier est mis à rude épreuve et tend à la morbidité. Le style allant, allusif, expéditif parfois, imagé souvent n’est pas pour rien dans le plaisir que l’on prend à lire dans les pensées des personnages, à les accompagner dans leur cheminement souvent complexe, toujours fatal. Et il faut aller jusqu’au bout : dans sa conclusion, Patrick Rambaud rappelle que le suicide ne date pas d’aujourd’hui, loin s’en faut, et termine tout de même par un bel hymne à la vie.
Jean-Pierre Longre
18:07 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : essai, récits, humour, francophone, patrick rambaud, la table ronde, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/06/2011
"Mots nomades"
 Sylvie Germain, Le monde sans vous, Albin Michel, 2011
Sylvie Germain, Le monde sans vous, Albin Michel, 2011
En juin 2010, quatorze écrivains, réunis par « Culturesfrance », ont effectué le trajet Moscou-Vladivostok à bord du Transsibérien. Beau parcours de 19 jours semé d’étapes littéraires et de rencontres diverses, belle ouverture sur le monde extérieur et intérieur.
Sylvie Germain a rapporté de ce périple le premier texte de son livre Le monde sans vous. Ni relation de voyage, ni guide touristique, ni accumulation de notes, « Variations transsibériennes » tient la promesse de son titre : le double déplacement dans l’espace et dans le temps se fait au gré de la musique des mots, du rythme des phrases : « Le train va son chemin. Il va, calme et docile, obstinément ». La musicalité, c’est aussi celle de l’alternance entre la prose narrative ou descriptive et les poèmes empruntés à Ossip Mandelstam, à la Bible, à Boris Pasternak, à Anna Akhmatova, à Arseni Tarkovski, à Paul Celan, à Jules Supervielle, à Blaise Cendrars… C’est bien sûr celle de l’évocation des paysages : la Sibérie, « Nord magnétique » ; la taïga, où « tout est échange, et tout est solitude » ; le lac Baïkal, « œil-ombilic », « visage entier », « paume large ouverte », « oreille tendue », « bouche cobalt », « vulve bleu satin » ; Vladivostok, « drapé dans les plis de son nom qui claque en saccades grises »… Surtout, c’est l’harmonie des va-et-vient entre présent et passé, soutenue par l’évocation de la mère et de sa mort, « douceur et violence intensément unies ».
On saisit alors l’unité du livre en son entier, même si les proses qui le composent datent d’époques différentes. Le Transsibérien est comme un déclencheur de poésie, de souvenirs, d’images. « Kaléidoscope ou notules en marge du père », le deuxième texte, est soutenu, après celle de la mère, par « l’une des deux images premières, fondatrices. Celle du père », ce père porteur et suscitateur de mémoire, et dont la disparition n’a pas effacé le « regard d’enfant simple et confiant ». Suite et variations : la relation entre le père et l’enfant est au cœur des deux derniers textes, « Il n’y a plus d’images » et « Cependant », où le « mystère de la mort », qui ne revendique pas le « dernier mot » (puisqu’il n’y en a pas), se laisse effleurer sans imposer la lourdeur du désespoir.
Car si les grands thèmes (mort et mémoire, entre autres) forment la trame de ce livre polyphonique, dense et profond, ils sont transfigurés par l’art – peinture, poésie, musique – et par l’écriture, « lent travail de détours », dont les « mots nomades » suivent la « marche sinueuse » du train, « point de tangence entre l’espace et le temps ».
Jean-Pierre Longre
19:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récits, poésie, francophone, sylvie germain, albin michel, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/06/2011
Des moutons et des hommes
 Blaise Hofmann, Estive, éditions Zoé, 2007, rééd. 2011
Blaise Hofmann, Estive, éditions Zoé, 2007, rééd. 2011
L’estive, une large saison d’été à garder les moutons sur les pentes des montagnes suisses, entre la vallée des hommes et les sommets des dieux, ce peut-être pour le berger l’occasion de contempler, de méditer, de réfléchir, voire d’écrire, mais c’est aussi le temps du labeur ingrat, répétitif, dur au corps et à l’esprit. En brèves et multiples notations qui combinent comme naturellement le vécu et le travail littéraire, Blaise Hofmann campe sa propre silhouette sur fond de montagne à la fois immuable et changeante, où passent avec le mouvement des saisons celui des troupeaux et des chiens.
La prose fragmentaire saisit le réel des hommes, des bêtes, de la nature dans des évocations poétiques, tantôt transparentes tantôt énigmatiques. Et les hommes, les bêtes, la nature s’en portent d’autant mieux dans les rêves du lecteur.
Jean-Pierre Longre
17:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, suisse, blaise hofmann, éditions zoé, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/06/2011
Les parenthèses de l’existence
Alain Gerber, Longueur du temps, Alter ego éditions, 2011 
Alain Gerber et la musique, c’est tout un roman ; une somme de romans. Et malgré les apparences, Longueur du temps ne déroge pas : comme dans les livres précédents, il y a la matière biographique, la narration menée sur fond d’images fortes, l’invention verbale, les thématiques musicales (avec les silhouettes de fameux jazzmen passant à l’arrière-plan, parfois même jusque sur le devant de la scène), l’évocation de pays lointains et de rues toutes proches, Bavilliers et Ouagadougou, Paris et Montréal, Belfort et Corfou, le beau pays d’« Enfrance » et le légendaire Mexique – odyssées dans l’espace et dans le temps.
À part cela, il faut bien distinguer : la matière biographique est tout ce qu’il y a de personnel, même si, mettant à contribution le couple et l’univers environnant, elle ne doit rien à l’égotisme ; et la narration est versifiée – comme Chêne et chien, « roman en vers » dans lequel Raymond Queneau se raconte sans fards. La comparaison n’est pas hasardeuse : chez l’un comme chez l’autre les vers sont la composante nécessaire de la forme romanesque ; ils lui donnent sa ponctuation, son rythme, ses mesures, ses syncopes… Syntagmes sonores, phrases coupées, listes, inventaires, mots martelés, l’écriture au plus fondamental de sa composition est musicale, à la recherche de
« la formule cinglante / le sésame /qui lève l’écrou et brise les scellés / du Temps »,
le temps, incessant leitmotiv, qui donne leur « tempo » aux souvenirs.
Si la musique est partout, n’oublions pas que tout passe par la littérature. Ce sont les mots, combinés entre eux, qui tentent de lever les voiles de la mémoire, « ce lac sourd plein de rumeurs », et de « l’imaginaire incarné ». Et, comme celles des jazzmen, on voit passer tout près les silhouettes des romans de jadis, La couleur orange, Le plaisir des sens, Le faubourg des coups-de-trique, Une sorte de bleu…
Plutôt que de gloser, le commentateur ne rêve que de céder la place au soliste, pour quelques chorus bien sentis :
« Il est faux que l’on naisse mortel / on le devient seulement après quelques années ».
« Il y aura dès lors / un temps pour écrire / un temps pour voir le monde / comme si c’était un roman / qu’on lit en se déchiffrant soi-même ».
« Sur son propre compte / l’existence nous en dit plus dans ses parenthèses / et notes anodines au bas de la page / que dans les périodes les tropes / sourates sorites et tapageurs épichérèmes /qu’elle nous jette au visage ».
« Le but ultime des voyages est / qu’en passant / la vie va vous frôler / au lieu de vous passer à travers ».
Le reste à l’avenant, au rythme des mots, de la lecture et de la vie.
Jean-Pierre Longre
13:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, poésie, musique, francophone, alain gerber, alter ego éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/05/2011
Les mystères de l’art et de la mort
 Denis Labayle, Rouge Majeur,éditions du Panama, 2008, rééd. Editions Dialogues, 2011. Prix des Lecteurs de Brive 2009
Denis Labayle, Rouge Majeur,éditions du Panama, 2008, rééd. Editions Dialogues, 2011. Prix des Lecteurs de Brive 2009
Pourquoi, en mai 1955, Nicolas de Staël, peintre de renom, riche et séduisant, se suicida-t-il en se jetant par la fenêtre de son atelier ? Cette mort prématurée est-elle due à des déboires sentimentaux, aux doutes de l’artiste, à un constat d’impuissance ? De cette énigme, Denis Labayle a fait un roman qui mêle fiction et exactitude historique.
Tout commence avec un concert en hommage à Anton Webern, dont le peintre sort enthousiasmé, quasiment envoûté, à tel point qu’il projette d’en faire une toile hors du commun : « J’ai déjà peint des instruments de musique, mais là je sens naître en moi un projet fantastique : je veux peindre une impression… Oui, c’est cela, une impression musicale. Ce sera beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus difficile ». C’est ainsi qu’il propose au narrateur, un journaliste américain venu tout simplement enquêter sur sa vie et sa relation avec les femmes, de le suivre à Antibes et d’assister à la naissance de sa nouvelle œuvre – tâche à la fois fascinante et rude pour cet ancien combattant, resté handicapé à la suite du débarquement en Normandie. C’est ainsi, encore, qu’à l’existence tourmentée de Nicolas de Staël se mêle celle de son éphémère compagnon, pris par sa propre quête et ses propres réflexions.
La narration romanesque ne cache pas l’essentiel : l’art. Elle tente même de représenter les attitudes et les gestes du peintre en plein travail. Mais comment les mots peuvent-ils traduire « l’alchimie de l’art » ? Comment peuvent-ils « entrer, par effraction, au cœur du mystère » ? Entreprise au moins aussi audacieuse, aussi utopique que celle du peintre voulant matérialiser « l’éclair créateur » produit par la musique : « Je guette sans cesse l’émotion qui m’a saisi lors du concert de Webern, et je me demande si je vais l’éprouver à nouveau. Cette attente me désespère […]. Ah ! je m’en veux de ne pas maîtriser assez mon art ». Du désespoir naît pourtant l’œuvre où domine le rouge, couleur fascinante et terrifiante, la « symphonie majeure » en « rouge immense ».
Jean-Pierre Longre
15:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas de staël, denis labayle, éditions dialogues, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/05/2011
Odyssées urbaines
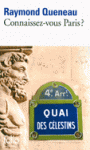 Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
Raymond Queneau, Connaissez-vous Paris ?, Gallimard / Folio, 2011. Choix des textes, notice et notes d’Odile Cortinovis. Postface d’Emmanuël Souchier.
« Ma chronique eut, je dois le dire en toute modestie, un certain succès. Elle dura plus de deux ans ; à raison de trois questions pas jour, cela en fit plus de deux mille que je posai au lecteur bénévole », écrit Queneau dans un article daté de 1955 et reproduit en tête de volume. Cette chronique, donc, parut quotidiennement dans L’Intransigeant du 23 novembre 1936 au 26 octobre 1938. Le livre publié par Odile Cortinovis et Emmanuël Souchier ne reproduit pas les 2102 questions–réponses, mais 456, selon un choix raisonné (c’est-à-dire en fonction des réponses qu’on peut leur apporter encore actuellement).
Quelques exemples ? « Qui était le Père Lachaise ? » ; « Quel est le plus ancien square de Paris ? » ; « Combien y a-t-il d’arcs de triomphe à Paris ? » ; « Quelle est la première voie parisienne qui fut pourvue de trottoirs ? » ; « Quel rapport existe-t-il entre l’église Saint-Séverin et la république d’Haïti ? » ; « Depuis quelle époque les bouquinistes sont-ils établis sur les quais ? » ; « De quand datent les premiers tramways à Paris ? » ; « Combien y avait-il d’édifices religieux à Paris en 1789 ? »… On trouvera les 448 autres questions et toutes les réponses en lisant Connaissez-vous Paris ?
Au-delà de l’encyclopédisme, il y a une vraie philosophie de la promenade urbaine (des « antiopées, ou déambulations citadines », comme le rappelle et l’explique Emmanuël Souchier) et un sens aigu de l’histoire, marques indélébiles de la vie et de la pensée de Queneau. Et, sans en avoir l’air, le goût des voyages : « Je me disais : comme c’est curieux, il me semble que j’ai fait un long… très long… voyage. J’avais visité Paris ». Nous aussi.
Jean-Pierre Longre
18:41 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, francophone, raymond queneau, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

