09/04/2013
Silence et da capo
 Gaëlle Josse, Nos vies désaccordées, Autrement / Littérature, 2012, J'ai Lu, 2013
Gaëlle Josse, Nos vies désaccordées, Autrement / Littérature, 2012, J'ai Lu, 2013
« Sophie était donc chez les dingues, dans un lieu dont j’ignorais jusqu’à l’existence, et c’était là-bas que je devais aller la chercher ». François Vallier, pianiste de renom, a connu Sophie, l’amour de sa vie, chez Zev, vieux luthier autrefois échappé du ghetto d’Odessa. Elle est peintre, belle, solitaire, fragile, passionnée; lui est embarqué un peu sans le vouloir, mais sans déplaisir, dans le tourbillon des tournées internationales et des applaudissements. Lucide sur lui-même et sur les autres, mais pas suffisamment pour se rendre compte du mal qu’il fait à Sophie en l’abandonnant à un moment tragique pour honorer un engagement au Japon. Il ne retrouvera sa trace que bien plus tard, peut-être trop tard.
Délaissant les succès clinquants et la belle Cristina et ses bijoux, au grand dam de son agent, il quitte tout pour reprendre un contact difficile et aléatoire avec Sophie, son mutisme, son enfermement obstiné, et pour découvrir qu’elle est doublement victime, de lui, François, mais aussi d’une famille sans scrupules.
 Cela, c’est l’histoire, une suite d’événements qui composent un beau roman d’amour et de peine, sensible et prenant. Seulement un de plus, s’il n’y avait l’écriture, la tonalité – ou plutôt les tonalités, épousant les contours de la narration, comme dans une symphonie. Ce peut être allègre (avec des touches de savoureuse satire sociale), mélancolique, grave, c’est toujours en harmonie avec le contexte… Et chaque chapitre se termine par un élargissement évocateur d’autres récits, mythiques ou historiques : Orphée cherchant Eurydice aux Enfers, Clara Schuman perpétuant la musique de son mari qui a perdu la raison…
Cela, c’est l’histoire, une suite d’événements qui composent un beau roman d’amour et de peine, sensible et prenant. Seulement un de plus, s’il n’y avait l’écriture, la tonalité – ou plutôt les tonalités, épousant les contours de la narration, comme dans une symphonie. Ce peut être allègre (avec des touches de savoureuse satire sociale), mélancolique, grave, c’est toujours en harmonie avec le contexte… Et chaque chapitre se termine par un élargissement évocateur d’autres récits, mythiques ou historiques : Orphée cherchant Eurydice aux Enfers, Clara Schuman perpétuant la musique de son mari qui a perdu la raison…
Les références rattachent Nos vies désaccordées aux drames qui parsèment l’histoire et la légende de l’humanité, liant intimement l’amour et la musique. Celle-ci est, bien sûr, le fil conducteur du roman, qui n’oublie pas non plus la peinture et, disons, l’art en général. Création esthétique et délicatesse des sentiments se combinent en subtiles résonances, comme dans le premier roman de Gaëlle Josse, Les heures silencieuses.
Jean-Pierre Longre
19:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, musique, francophone, gaëlle josse, autrement., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/04/2013
Mouvantes architectures
 Mario Capasso, L’immeuble. Traduit de l’espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon, La dernière goutte, 2012
Mario Capasso, L’immeuble. Traduit de l’espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon, La dernière goutte, 2012
Voilà un immeuble composé, apparemment comme les autres, d’escaliers, de couloirs, de bureaux, de toilettes, un immeuble sur lequel règnent une direction (Super), une trésorerie, où se dénouent et se dénouent à l’envi des histoires d’amitié, d’amour, voire de sexe, mais aussi d’inimitié, de rivalité, voire de meurtre.
Comme les autres ? L’auteur a vite fait de déstabiliser le lecteur en montrant d’emblée, et de plus en plus cruellement, combien l’immeuble est lui-même instable et, disons, plus meuble qu’immeuble… Tout y bouge, tout s’y bouscule, tout y devient être vivant aux réactions imprévisibles. Et si l’on s’y perd, on peut toujours faire appel au « Bureau central des informations impétueuses », ou accrocher son regard aux pancartes du type « On rase gratis, se présenter à la Trésorerie à toute heure tant qu’il n’est pas trop tard ». Cela n’empêche pas les couloirs de changer de dimensions selon les besoins, ou la « zone d’influence » du narrateur de le suivre partout où il va…
Comme les autres ? Oui, sans doute, si l’on considère que la vie menée par les occupants de ce bâtiment fantasmé est une déformation systématique, poussée à la saturation, à l’excès et à l’absurde, de celle que chacun d’entre nous mène quotidiennement. Il y a dans cet « immeuble » du Courteline, du Marcel Aymé, du Kafka, du Beckett… Ce pourrait être désespérant ; ça ne l’est pas complètement, parce que c’est aussi drôle ; et, comme les paliers des escaliers, on trouve dans le foisonnement descriptif du roman, parfois, « de vastes plages de repos ». Désespérer, rire, méditer : Mario Capasso nous donne généreusement toutes les possibilités.
Jean-Pierre Longre
18:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, espagnol, argentine, mario capasso, isabelle gugnon, la dernière goutte, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/03/2013
« Mon vieux, je t’emmène faire la révolution »
 Marc Villemain, Ils marchent le regard fier, Les éditions du Sonneur, 2013
Marc Villemain, Ils marchent le regard fier, Les éditions du Sonneur, 2013
Une manifestation qui tourne mal, on a déjà vu ça dans le passé, on le verra encore dans l’avenir. Il suffit d’une maladresse, d’un geste de trop, d’une provocation idiote, et on bascule dans la violence incontrôlée. C’est en quelque sorte ce que raconte le dernier livre de Marc Villemain.
Si ce n’était que cela, l’intérêt en serait limité. Mais justement, c’est bien plus que la relation d’un simple fait divers. D’abord, tout en débusquant quelques repères familiers, à la ville comme à la campagne, on s’immerge dans une époque incertaine, dans une sorte d’avenir brouillé mais tout compte fait prévisible, pas très lointain du nôtre, pour ainsi dire dans un monde à l’envers, où ce sont les jeunes qui sont au pouvoir, qui imposent leur loi : « À l’époque nos gouvernants avaient quoi, trente ans, quarante pour les plus aguerris. Des qui croyaient connaître la vie parce qu’ils avaient été à l’école. Des zigotos de fils à papa, teigneux et morveux du même tonneau. Mais qui ne se mouchaient pas du coude ». Alors Donatien, l’ami de toujours, celui qui a épousé la belle, fière, discrète et tendre Marie, vient trouver le narrateur et le convainc, lors d’une soirée bien arrosée de prune, de venir avec lui et quelques autres « faire la révolution », de manifester contre cette jeunesse toute puissante qui les opprime (et au nombre de laquelle on compte, soi dit en passant, le propre fils de Marie et Donatien, Julien).
À partir de là s’enchaînent les événements. On se retrouve à la capitale, on prépare soit fiévreusement soit tranquillement, dans la colère et dans la joie, la grande journée de la vieillesse en révolte. Celle-ci va tourner au face à face mal maîtrisé, et à la tragédie. On n’en dira pas plus, sinon que ce court roman nous plonge à la fois dans la tension des péripéties et dans le plaisir de savourer une prose collant à la parole rurale, goûteuse, touchante et rugueuse de personnages campés par l’auteur avec une affection contagieuse.
Jean-Pierre Longre
09:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, marc villemain, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/03/2013
Une belle voyageuse. Regard sur la littérature française d’origine roumaine
Parution
 Jean-Pierre Longre, Une belle voyageuse. Regard sur la littérature française d’origine roumaine. Éditions Calliopées, mars 2013.
Jean-Pierre Longre, Une belle voyageuse. Regard sur la littérature française d’origine roumaine. Éditions Calliopées, mars 2013.
Juillet 1990 : à l’invitation d’une amie née en Transylvanie, Jean-Pierre Longre, après avoir traversé une Europe en pleine métamorphose, arrive en Roumanie, dans ce pays qui vient de sortir d’une longue période de dictatures et de s’ouvrir à la liberté de circuler, de créer, d’accueillir. Frappé, comme d’autres visiteurs, non seulement par l’hospitalité, mais aussi par la francophilie des habitants, par leur connaissance précise de la langue, de la culture et de l’histoire de la France – les livres avaient été pour eux une échappatoire, un refuge, une ouverture vers le passé et l’avenir – il lie amitié avec plusieurs Roumains, de ceux qui le reçoivent à cette époque. Une amitié qui ne s’est pas relâchée, entretenue par de nombreuses visites de part et d’autre.
EN PLUS DE VINGT ANS, LA ROUMANIE A NOTABLEMENT CHANGÉ, SA LITTÉRATURE AUSSI, COMME LES RELATIONS ÉDITORIALES QU’ELLE ENTRETIENT AVEC LA FRANCE. CET OUVRAGE EST ISSU DE PLUSIEURS ANNÉES DE FRÉQUENTATION ASSIDUE DE LA LITTÉRATURE ROUMAINE D’EXPRESSION FRANÇAISE OU, POUR UNE MOINDRE PART, TRADUITE EN FRANÇAIS, FRÉQUENTATION DONT JEAN-PIERRE LONGRE A TENTÉ DE RENDRE COMPTE DANS DES ARTICLES DE FOND ET DANS DES NOTES DE LECTURE. AINSI EST MIS EN VALEUR LE CARACTÈRE À LA FOIS DURABLE ET DYNAMIQUE D’UNE LITTÉRATURE QUI A ENRICHI DEPUIS AU MOINS UN SIÈCLE ET DEMI LE PATRIMOINE FRANCOPHONE ET EUROPÉEN –ET QUI CONTINUE À L’ENRICHIR. TOUT EN TENANT COMPTE DE CETTE DUALITÉ, ON PEUT LIRE UNE BELLE VOYAGEUSE « À SAUTS ET GAMBADES », Y VAGABONDER À LA FAÇON DE MONTAIGNE, SELON L’INTÉRÊT DU MOMENT, D’UNE MANIÈRE CONTINUE OU DISCONTINUE. À CHACUN SON MODE DE TRANSPORT.
Voir la couverture complète ici: PRINT COUV BV.pdf
En vente ou en commande possible en librairie, ou aux éditions Calliopées
contact@calliopees.fr, tél. + 33 1 46 42 15 77
14:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roumanie, francophone, éditions calliopées, salon du livre de paris, bibliothèque georges brassens, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2013
« Un arc dans le temps »
 Matéi Visniec.
Matéi Visniec.
Le spectateur condamné à mort. Traduit du roumain par Claire Jéquier et l’auteur. Avertissement de Gilles Losseroy.
Mais, Maman, ils nous racontent au deuxième acte ce qui s’est passé au premier. Traduit du roumain par l’auteur. Préface de Jean-Claude Drouot.
Les chevaux à la fenêtre. Traduit du roumain par l’auteur. Préface de Benoît Vitse.
Mais qu’est-ce qu’on fait du violoncelle ? Traduit du roumain par l’auteur.
Théâtre décomposé ou L’homme-poubelle. Préface de Georges Banu.
Ce beau volume réunit les dernières pièces écrites par l’auteur en Roumanie et les premières écrites en France. Une anthologie bienvenue, « qui tient lieu d’arc dans le temps », et qui forme une belle synthèse de l’art et de la thématique littéraires et dramaturgiques de Matéi Visniec.
« Vous avez compris le message de la pièce ? », demande l’un des personnages. « Bien sûr, répond son interlocuteur. Mais vous voyez… Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Chaque niveau a son rythme… sa nuance… petit à petit… ». Alors ? Selon un premier niveau, avec Le spectateur condamné à mort, on a affaire à une pièce où l’absurde sert la satire : un tribunal (juge, défenseur, procureur, greffier), une brochette de neuf témoins successifs, un accusé muet qui va être condamné à mort pour on ne sait quoi : parce qu’il se tait, parce qu’il est là, parce qu’il est ce qu’il est – ou n’est pas ce qu’il n’est pas, ou est susceptible d’être ce qu’il pourrait être –, parce qu’il ne se dit pas lui-même coupable… On reconnaît là, bien sûr, la substance des procès staliniens, de tous les procès intentés par les régimes totalitaires et au cours desquels juges, greffiers, défenseurs même deviennent des pantins manipulés par l’accusation.
Si l’on pousse plus avant l’exploration, on s’aperçoit vite que la mascarade concerne tout le monde – le tribunal, les témoins, les spectateurs, la foule extérieure, le genre humain dans son ensemble – tout ce qui existe, et qui finalement se voit condamné à la négation absolue, éternelle. Seul un « clochard aveugle », personnage récurrent des pièces de Visniec, pourra faire un ultime constat : « Vraiment rien ni personne… Je suis pour de vrai seul au monde… ».
Le monde est un théâtre, c’est bien connu. Parodie de justice, Le spectateur condamné à mort est une parodie de pièce, une parodie du monde. Tout s’y confond, acteurs, auteur, metteur en scène, spectateurs, juges, accusés, accusateur, défenseur et témoins. Le monde entier est un vaste tribunal où chacun tente d’effacer la présence de l’autre, et par là même d’effacer sa propre présence ; la représentation théâtrale, opération cathartique absolue, est une gageure : représenter des êtres qui font tout pour se purger non seulement du mal contenu en eux, mais aussi de leur propre existence.
Ecrite en roumain en 1984 (période fort critique pour les écrivains du pays), créée en sa langue d’origine en 1992 à Iasi (Jassy), la pièce fut représentée pour la première fois en France en 1998 (Festival off d’Avignon). Comme les autres pièces de Matéi Visniec, elle mériterait de nombreuses autres représentations : du vrai théâtre d’aujourd’hui – et de tout temps.
Mais, Maman, ils nous racontent au deuxième acte ce qui s’est passé au premier est une « fantaisie, mascarade, bouffonnerie et expérience en deux actes » qui a été écrite en roumain en 1979, et aussitôt censurée. Matéi Visniec la livre au public français, et c’est tant mieux. Autour d’un trou, symbole d’on ne sait quoi, mais d’un « on ne sait quoi » dans lequel se tapit, on le subodore, du malheur, de l’oppression, de la séduction, de la résignation… autour de ce trou, donc, grouille, se précipite, se dispute, se perd, se retrouve, s’enfuit tout un monde d’humains anonymes ou identifiés, atemporels ou historiques, menteurs ou sincères. Et là, dans ce magma d’illusion, émergent quelques instants de vraie vie, quelques instants qui font que la folie vaut d’être exhibée, avec toute la liberté dont dispose le metteur en scène, par la grâce de l’auteur qui précise bien cependant : « Le titre de la pièce est sacré ».
Quand des chevaux fous regardent par la fenêtre, se rassemblent pour occuper les abattoirs et deviennent des bêtes féroces, faut-il s’attendre à ce que les hommes fassent preuve de sagesse ? La folie des animaux est comme un signal de celle des hommes. Ce sont alors des dialogues de sourds entre préoccupations quotidiennes et vaines illusions de l’héroïsme, l’angoisse devant le temps détraqué, le recours désespéré à la discipline militaire, le sombre constat de l’éternelle obscurité qui entoure la destinée humaine… Et, rythmant le tout, l’imperturbable litanie des guerres que se sont livrées les hommes au cours de leur histoire.
Si Les chevaux à la fenêtre met en scène les velléités du patriotisme et de la gloriole dans un espace-temps illusoire, Mais qu’est-ce qu’on fait du violoncelle ? est un huis clos tout aussi désespérant. Dans une salle d’attente, devant le jeu répétitif et obstiné d’un violoncelliste, l’attitude de personnages bien ordinaires, prêts aux concessions et aux compromis, tourne à la folie furieuse et débridée, jusqu’au rejet total. Existe-t-il des remèdes à l’enfer des autres, à la solitude et à l’absurdité ? « L’homme ? Un grain de poussière… Un rien… Mais, malgré tout, tout est possible ».
Les brèves séquences qui forment Théâtre décomposé ou L’homme-poubelle, qualifiées par Georges Banu de « monades, textes autonomes, ronds », forment des tableaux très variés dans leur forme et dans leur contenu, laissant au metteur en scène toute liberté pour « recomposer » ce théâtre à sa manière. Monologues ou dialogues, ces textes sont des « modules théâtraux », et « le jeu consiste à essayer de reconstruire l’objet initial ». Sans rompre avec les thèmes récurrents qui jalonnent son œuvre, et en les réunissant autour du motif de la « décomposition », l’auteur fait jouer là une sorte de théâtre potentiel, donnant à l’écriture des perspectives inattendues.
Avec ces pièces, Matéi Visniec confirme la portée à la fois très humaine et universelle d’une œuvre théâtrale dans laquelle le sens de l’absurde et de la révolte, la combinaison du tragique et de l’humour ne peuvent pas laisser indifférent.
Jean-Pierre Longre
Saison roumaine en Syldavie :http://www.sildav.org/component/allevents/display/section/default/11-saison-roumaine-en-syldavie
Salon du Livre de Paris 2013 : les lettres roumaines à l’honneur
Pour sa 33ème édition, le Salon du livre met à l’honneur les lettres roumaines. En 2013, les visiteurs du Salon viendront à la rencontre d’une belle sélection de 27 auteurs roumains dont une dizaine de romanciers découverts en 2012 par les éditeurs français : des essayistes d’envergure européenne ; des auteurs de roman graphique ; des dramaturges au ton percutant et rafraîchissant ; des poètes et des romanciers à la veine chatoyante et portant un regard acéré sur la société roumaine.
Voir:
http://www.salondulivreparis.com/?IdEvent=8&IdNode=4053&Lang=FR&IdNodeVersion=6673&FromBO=Y
Pour mieux connaître la littérature roumaine, voir : http://rhone.roumanie.free.fr/rhone-roumanie/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=41&Itemid=29
09:24 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, roumanie, francophone, matéi visniec, l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/03/2013
Mots, lignes, couleurs
 Madeleine Ravary, Apollinaire illustré, Éditions Calliopées, 2012
Madeleine Ravary, Apollinaire illustré, Éditions Calliopées, 2012
« Admirez le pouvoir insigne
Et la noblesse de la ligne :
Elle est la voix que la lumière fit entendre
Et dont parle Hermès Trismégiste en son Pimandre. »
Le premier poème, placé sous le signe d’Orphée, suggère la double dimension de ce double recueil : la musique des mots et des vers, la plastique des illustrations.
À chaque poème son dessin aux lignes courbes, aux couleurs abondantes ou, au contraire, en sobre noir et blanc. Le plus souvent, le figuratif se détache sur un foisonnement de volutes ou de lignes simplement suggestives, parfois frisant l’abstraction, parfois tenant du calligramme. Animaux ou êtres humains se glissent discrètement ou s’imposent carrément dans la profondeur de la page. Et comme le proclame l’enchanteur :
« Bêtes en folie… Croyez-moi je vous aime
Et sais le nom de chacune de vous. »
Claude Debon rappelle dans sa préface que Madeleine Ravary a eu de fameux ou d’obscurs prédécesseurs dans l’illustration du Bestiaire, et pratiquement aucun pour ce qui concerne L’Enchanteur pourrissant, et juge qu’« il faut du courage » pour se lancer dans ce genre de travail. C’est vrai. Le courage de se libérer des carcans tout en restant fidèle à la magie des poèmes, Madeleine Ravary l’a eu. Et l’influence chinoise, qui se manifeste ouvertement dans la traduction des titres du Bestiaire, plus secrètement dans les dessins eux-mêmes, n’est pas la moindre preuve de cette fusion entre liberté et fidélité, qui est l’un des propres de l’art.
Jean-Pierre Longre
09:12 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : illustration, poésie, madeleine ravary, apollinaire, éditions calliopées, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/03/2013
Les déambulations d’un érudit
 Pierre Brunel, Rue des Martyrs, Les éditions du littéraire, 2012
Pierre Brunel, Rue des Martyrs, Les éditions du littéraire, 2012
En adoptant le genre, le rythme et le ton du journal personnel, Pierre Brunel s’écarte apparemment de sa vocation de professeur dont les multiples publications sont des références indispensables à la recherche littéraire. Mais il ne rompt pas avec elle. Car toutes les chroniques, tous les rappels, tous les mystères dévoilés qui peuplent ces pages sont d’un grand lecteur, d’un érudit sans cesse à l’affût d’anecdotes littéraires ou historiques, d’un érudit qui se plaît parfois à laisser échapper quelque confidence.
Profitant des promenades de l’auteur dans ce quartier de Montmartre (le Mont des Martyrs) qu’il affectionne, nous croisons aussi bien Rimbaud que Napoléon, Nerval qu’Octave Mirbeau, Mérimée que Victor Hugo, Dreyfus que Zola, Baudelaire que Péguy, André Breton que Georges Duhamel, Edgar Quinet qu’Offenbach (on en passe), et aussi nous faisons la connaissance de Jean-Claude le boucher, de Léon Cladel (auteur des Martyrs ridicule) et d’autres obscurs…
Comme on passe sans raison consciente d’une rue à l’autre, comme on tourne au hasard à gauche plutôt qu’à droite et inversement, Pierre Brunel nous fait passer d’un sujet à l’autre, au gré des rapprochements d’idées et des méandres de la mémoire.
« Et sans un plan sous les yeux
on ne comprendra plus
car tout ceci n’est qu’un jeu
et l’oubli d’un temps perdu »,
a écrit Queneau, qui comme Apollinaire s’y entendait en « antiopées » et a si bien couru les rues de Paris. Ici, le hasard, certes, joue son rôle ; mais il tourne toujours autour des martyrs et de leur rue.
C’est avec les délices mesurées des promenades à pas comptés que nous suivons les itinéraires dans l’espace et dans le temps proposés par l’auteur. À le lire, on a le sentiment que cette rue des Martyrs résonne de rencontres sans lesquelles notre patrimoine ne serait pas ce qu’il est. Et, semble-t-il, elle attire toujours autant qu’aux siècles passés, celle que chantait encore récemment François Hadji-Lazaro dans une rocailleuse et truculente chanson, « Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs ».
Jean-Pierre Longre
15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal, récit, francophone, pierre brunel, les éditions du littéraire, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2013
Une odyssée roumaine
 Gabriela Adameşteanu, Une matinée perdue, traduit du roumain par Alain Paruit, Gallimard, « Du monde entier », 2005, Folio, 2013
Gabriela Adameşteanu, Une matinée perdue, traduit du roumain par Alain Paruit, Gallimard, « Du monde entier », 2005, Folio, 2013
Romancière reconnue en Roumanie depuis la publication en 1975 de Drumul egal al fiecărei zile (La monotonie de chaque jour), consacrée en 1985 par le prix de l’Union des écrivains pour Dimineaţă pierdută (Une matinée perdue), Gabriela Adameşteanu a consacré une grande partie de son temps, depuis 1991, à militer au sein du « Groupe pour le dialogue social », dont elle dirige l’hebdomadaire, 22. Activité littérairement préparée, sous et malgré la dictature, par une écriture sans concession, dans sa forme et sa signification.
 Une matinée perdue, dont on peut penser que la traduction, parce qu’elle est d’Alain Paruit, est des plus fidèles – d’autant plus que l’auteur est parfaitement francophone et francophile – , est un magnifique témoignage de cette écriture foisonnante et polyphonique qui présente, à travers des destinées individuelles, presque un siècle d’histoire collective. Quelques heures de la vie de Vica font revivre, avec ses mots de vieille femme du peuple, mais aussi avec les mots de ceux qu’elle a côtoyés, fréquentés, servis, des instants cruciaux du passé de la Roumanie, les « bouleversements qui ont secoué le pays » : les péripéties de l’entrée dans la guerre de 14-18, les disparités et les difficultés de la vie sociale et politique, l’exil à l’Ouest de ceux qui cherchent à fuir les tracasseries de l’existence quotidienne… Et il ne s’agit pas seulement de l’histoire d’un pays particulier, mais bien de l’histoire des relations humaines dans leur fonctionnement minutieusement et humoristiquement décortiqué grâce à une technique de la parole parfaitement maîtrisée ; l’alternance et la superposition du discours direct (dans la conversation) et du discours indirect libre (dans le monologue intérieur) illustrent avec saveur et justesse la dualité, la duplicité, la complexité des rapports sociaux : la longue entrevue entre Vica et son ancienne patronne Ivona en est un exemple frappant. Ainsi se dessinent les silhouettes d’êtres chez qui la tendresse et l’agacement, l’amour et la haine, le bien et le mal se combinent sans se contredire. Au-delà des cas particuliers de la fiction romanesque, un vrai tableau du genre humain.
Une matinée perdue, dont on peut penser que la traduction, parce qu’elle est d’Alain Paruit, est des plus fidèles – d’autant plus que l’auteur est parfaitement francophone et francophile – , est un magnifique témoignage de cette écriture foisonnante et polyphonique qui présente, à travers des destinées individuelles, presque un siècle d’histoire collective. Quelques heures de la vie de Vica font revivre, avec ses mots de vieille femme du peuple, mais aussi avec les mots de ceux qu’elle a côtoyés, fréquentés, servis, des instants cruciaux du passé de la Roumanie, les « bouleversements qui ont secoué le pays » : les péripéties de l’entrée dans la guerre de 14-18, les disparités et les difficultés de la vie sociale et politique, l’exil à l’Ouest de ceux qui cherchent à fuir les tracasseries de l’existence quotidienne… Et il ne s’agit pas seulement de l’histoire d’un pays particulier, mais bien de l’histoire des relations humaines dans leur fonctionnement minutieusement et humoristiquement décortiqué grâce à une technique de la parole parfaitement maîtrisée ; l’alternance et la superposition du discours direct (dans la conversation) et du discours indirect libre (dans le monologue intérieur) illustrent avec saveur et justesse la dualité, la duplicité, la complexité des rapports sociaux : la longue entrevue entre Vica et son ancienne patronne Ivona en est un exemple frappant. Ainsi se dessinent les silhouettes d’êtres chez qui la tendresse et l’agacement, l’amour et la haine, le bien et le mal se combinent sans se contredire. Au-delà des cas particuliers de la fiction romanesque, un vrai tableau du genre humain.
En surface, on pourrait croire que Vica perd effectivement son temps à errer dans Bucarest, à attendre et à discourir en vain – comme semblent discourir en vain les autres personnages, chacun dans son registre. En profondeur, la matinée n’est pas perdue pour tout le monde, en tout cas pas pour le lecteur. Selon une démarche proustienne discrètement évoquée par le titre, le temps est finalement retrouvé dans la création artistique. Comme le Leopold Blum de Joyce dans Dublin, comme l’Ulysse d’Homère sur les flots, Vica et les autres représentent l’humanité en perpétuel mouvement, en inlassable quête. L’auteur parvient à combiner la construction esthétique et le sens de l’Histoire ; en cela, sous sa plume, le roman est le digne successeur de l’épopée.
Jean-Pierre Longre
 Salon du Livre de Paris 2013 : les lettres roumaines à l’honneur
Salon du Livre de Paris 2013 : les lettres roumaines à l’honneur
Pour sa 33ème édition, le Salon du livre met à l’honneur les lettres roumaines. En 2013, les visiteurs du Salon viendront à la rencontre d’une belle sélection de 27 auteurs roumains dont une dizaine de romanciers découverts en 2012 par les éditeurs français : des essayistes d’envergure européenne ; des auteurs de roman graphique ; des dramaturges au ton percutant et rafraîchissant ; des poètes et des romanciers à la veine chatoyante et portant un regard acéré sur la société roumaine.
Voir :http://www.salondulivreparis.com/?IdEvent=8&IdNode=4053&Lang=FR&IdNodeVersion=6673&FromBO=Y
Pour mieux connaître la littérature roumaine, voir : http://rhone.roumanie.free.fr/rhone-roumanie/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=41&Itemid=29
17:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, gabriela adameşteanu, alain paruit, gallimard, folio, salon du livre de paris, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
En mémoire du fils
 Nicolas Fargues, Tu verras.Prix du livre France Culture Télérama 2011. P.O.L., 2011, Folio, 2012
Nicolas Fargues, Tu verras.Prix du livre France Culture Télérama 2011. P.O.L., 2011, Folio, 2012
Comme si le narrateur (dont on apprend très tard qu’il s’appelle Colin, un prénom qui sonne un peu comme celui de l’auteur) n’osait pas en arriver au fait, ne se résolvait pas à avouer ce qui le hante, ce n’est qu’après plusieurs longues pages d’évocations mélancoliques que l’on apprend le drame : Clément, son fils de 12 ans, est mort dans un accident de métro ; comment ? On ne le saura qu’après d’autres longues pages : en tombant sur la voie devant une rame. D’autres pages encore : est-ce vraiment un accident ? C’est en quelque sorte au détour de phrases torturées comme l’esprit de Colin que se manifestent les vérités – ou plutôt les demi-vérités, selon les perceptions des personnages.
 Nicolas Fargues ou l’art du non-dit révélateur. Colin a élevé son enfant quasiment seul, comme un père moderne, et n’a jamais rechigné à manifester une tendre complicité envers son fils ; en même temps, comme un père traditionnel, il ne reculait devant aucun reproche : la manière de s’habiller et de se comporter, les mauvaises notes, le choix des musiques etc. Maintenant que son fils est mort, cela le ronge, cela le mine, au point qu’il cherchera des dérivatifs fort inhabituels pour lui. L’Afrique, qui occupe les dernières pages, apportera peut-être la sérénité.
Nicolas Fargues ou l’art du non-dit révélateur. Colin a élevé son enfant quasiment seul, comme un père moderne, et n’a jamais rechigné à manifester une tendre complicité envers son fils ; en même temps, comme un père traditionnel, il ne reculait devant aucun reproche : la manière de s’habiller et de se comporter, les mauvaises notes, le choix des musiques etc. Maintenant que son fils est mort, cela le ronge, cela le mine, au point qu’il cherchera des dérivatifs fort inhabituels pour lui. L’Afrique, qui occupe les dernières pages, apportera peut-être la sérénité.
Tu verras – dont le titre reprend le lieu commun parental (« Tu verras plus tard, tu comprendras… ») – est le monologue éploré (mais non larmoyant) d’un homme qui tente de faire remonter par bribes ce qui restait enfoui au plus profond ; c’est la quête d’un être qui cherche à percer sa propre vérité, à s’ouvrir aux secrets de son fils, à ceux des autres et à leur amour.
Jean-Pierre Longre
17:22 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, nicolas fargues, p.o.l., folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/02/2013
Papiers millimétrés
 Jean-Jacques Nuel, Courts métrages, Le Pont du Change, 2013
Jean-Jacques Nuel, Courts métrages, Le Pont du Change, 2013
Le texte bref, malgré les apparences, n’est pas un genre facile. Il n’est pas donné à tout le monde de réussir à dire (ou, le plus souvent, à suggérer) en quelques lignes ce que d’autres développent en plusieurs centaines de pages. Il faut pour cela non seulement le sens de la concision, la maîtrise du mot et de l’expression justes, l’art de la chute, mais aussi de l’imagination, beaucoup d’esprit et beaucoup de travail.
Ces qualités, Jean-Jacques Nuel les réunit dans ses Courts métrages, qui donnent un avant-goût déjà fort savoureux de ses Contresens à venir. Ces ensembles, taillés au millimètre (de trois lignes à une page), se succèdent sur les modes humoristique, étrange, désespérant, poétique… De l’épigramme classique au conte absurde, de la leçon morale à l’anecdote terrifiante, de la fable sociale au récit d’anticipation, il y en a pour tous les goûts, et chacun peut cueillir parmi ces quatre-vingts œuvres en puissance ce qui lui convient au moment voulu, dans un contexte donné.
On aurait envie de faire profiter tout le monde de sa cueillette personnelle, et de citer ce qui tombe, même au hasard, sous le regard. On se contentera d’un exemple, « Le bureau des admissions » : « Les candidats attendaient toute la nuit dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture, pour être certains d’obtenir dès l’ouverture du bureau ce précieux ticket, délivré en nombre limité, qui leur donnait le droit d’attendre, la nuit suivante, dans la rue, sous la pluie ou dans le froid, devant les grilles de la préfecture ».
Jean-Pierre Longre
Et relire J.-J. Nuel…
 Le nom, éditions A Contrario, 2005
Le nom, éditions A Contrario, 2005
La littérature est d'abord une affaire de mots, et le tout est de pouvoir utiliser ce matériau artistiquement, le fin du fin consistant en une combinaison harmonieuse du plus petit nombre de mots possible avec la plus grande longueur de texte (voir par exemple Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau).
Jean-Jacques Nuel - ou, en tout cas - le protagoniste-narrateur (l'unique personnage) qui, dans le livre, s'appelle Jean-Jacques Nuel, a tenté de battre tous les records : bâtir une œuvre d'ampleur infinie, universellement reconnue comme telle, conférant à son auteur l'aura des idoles, en n'utilisant qu'un petit mot de quatre lettres, qui passe par le truchement de l'écriture réitérée à l'envi du statut de nom propre à celui de nom commun décliné sous toutes ses faces, dans toutes ses dimensions, selon toutes les formes esthétiques. Ce petit mot est tout bonnement le nom du narrateur (qui est aussi celui de l'auteur), lieu commun ainsi renouvelé (ce par quoi Cocteau définit la poésie), nom trop usé résonnant de son étrangeté fictionnelle, "comme si c'était appeler les choses / Justement de ce bizarre nom qui est le leur " (Aragon).
L'obsession du nom s'empare du souci de perfection définitive, et alors survient la folie des nombres, l'utopie de la machine littéraire donnant toutes facilités au scripteur, dans une tentative d'épuisement (toute perecquienne) de la vie littéraire : déambulations quotidiennes dans l'appartement, dans le quartier (une Part-Dieu lyonnaise qui n'a en soi rien pour inspirer l'artiste…), courriers aux éditeurs (réponses négatives ou inexistantes), reniement des œuvres antérieures, vains espoirs de notoriété… tout cela pour s'apercevoir au bout du compte que l'écrivain est un homme, avec des souvenirs, le sentiment de la vie et de la mort, qu'il doit faire ce qu'il a à faire, se reposer de temps en temps (disons chaque septième jour), et que la création n'est pas seulement une questions de mécanique et d'arithmétique.
Le nom est un roman de la création, et aussi - prénom oblige - une véritable confession d'écrivain.
http://lepontduchange.hautetfort.com
09:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : récit, essai, roman, jean-jacques nuel, le pont du change, a contrario, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/02/2013
Fruits défendus
 Geoffrey Lachassagne, Et je me suis caché, Aux Forges de Vulcain, 2012
Geoffrey Lachassagne, Et je me suis caché, Aux Forges de Vulcain, 2012
Il est des histoires d’enfants et d’adolescents qui ne disent pas grand-chose aux adultes, ni même aux premiers intéressés. Celle de Titi et Jérémie « parle » au sens plein du terme, et en tout cas ne peut laisser le lecteur indifférent, quel que soit son âge. Ce sont leurs voix mêmes que l’on entend, avec leurs mots, leurs phrases, leurs cris, leurs rires, leurs pleurs, leurs prières, leur lyrisme, les voix d’enfants plutôt perdus dans un monde dont, sur le mode brutal ou sur le mode affectueux, ils se sentent rejetés, et qu’ils cherchent à fuir, d’une manière ou d’une autre.
Ils vivent avec une grand-mère à la fois intraitable et possessive, adepte d’une secte dans laquelle elle les a introduits tout naturellement. Titi, 14 ans, attend le retour du grand frère Jules (qui deviendra vers la fin le troisième protagoniste, prenant à son tour la parole) ; Jérémie, 7 ans, fait cohabiter dans ses rêves les prophètes, les Indiens, les Infidèles, Yahweh… Désorientés, sevrés d’amour, ils errent, rêvent, font des projets fous et flous. « J’avais tout qui me bouillonnait dans la tête, en désordre ». Ils rencontrent d’autres êtres aussi perdus qu’eux, et vivent en leur compagnie des aventures inattendues, exaltantes et frustrantes, des aventures qui leur font toucher du doigt les vérités de la vie.
Car, sans en être conscients, c’est une quête qu’ils mènent, une quête de vérités que les adultes ne peuvent ni concevoir ni transmettre. « Et si les adultes étaient un peu moins cons, ils l’écouteraient, et alors ils comprendraient peut-être un peu de ce qu’ils répètent comme des perroquets en réunion ». Sur fond biblique, semi-rural, semi-urbain, Et je me suis caché mêle narration et poésie, veille et rêve, réalisme et imaginaire, et les héros recréent pour ainsi dire la Création, retrouvant mine de rien les origines mythiques de l’humanité – qui a osé toucher au fruit de l’arbre interdit.
Jean-Pierre Longre
17:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, geoffrey lachassagne, aux forges de vulcain, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/02/2013
Honneur aux méconnus
 Alain Gerber, Petit Dictionnaire Incomplet des Incompris, Alter Ego Éditions, 2012
Alain Gerber, Petit Dictionnaire Incomplet des Incompris, Alter Ego Éditions, 2012
« Ils ont fait l’Histoire, mais l’Histoire ne leur a pas fait de cadeaux. Car l’Histoire est ingrate, quelquefois : des hommes l’écrivent, mais elle rechigne pourtant à inscrire leurs noms sur ses monuments. Le musicien sous-estimé n’est pas une denrée rare dans le jazz. Il est encore plus répandu que le musicien surestimé, ce qui n’est pas peu dire ». Alain Gerber y remédie à sa manière, en mettant son érudition jazzistique au service des « méconnus », des « invisibles », des « transparents », des anonymes, de ceux qui ne sont qu’une « silhouette furtive » empruntant des « chemins de traverse », de ceux qui se mettent « à contre-courant », des solitaires, des malchanceux… Bref, de Dolorez Alexandria Nelson, dite Lorez Alexandria, à Attila Zoler, l’auteur passe en revue les « incompris » ou (ce qui est encore autre chose) les « non compris ».
« Incomplet », ce dictionnaire ? Peut-être, puisqu’il le dit – impossible d’en juger. En tout cas, fort documenté : en matière d’histoire du jazz, on ne fait pas plus précis, pas plus affectueux, non plus, pour ces figures que la plupart du temps on n’aperçoit que de profil – si jamais on les aperçoit. Il y a aussi ceux dont la malédiction n’est pas celle de l’anonymat, mais celle de la réputation : « déclarés sulfureux », alcooliques, violents, la plume d’Alain Gerber les tire de l’enfer ou de l’oubli – même si, selon lui, « il n’est pas impossible qu’au bout du compte, ce déficit de notoriété ne soit pas préférable à la gloire trop brutale à laquelle d’autres furent confrontés ». Il y a ceux, aussi, qui ratent jusqu’à leur échec, comme « Jelly Roll » Morton, ou dont « l’apport inestimable reste trop largement méconnu », bien que leur prestige soit « universel », comme Martial Solal.
Un dictionnaire, certes, dans l’ordre alphabétique, avec un index des musiciens et des instruments, mais un dictionnaire qui ne se contente pas de la savante sécheresse des ouvrages spécialisés. Cette recension, pour méthodique qu’elle soit, baigne dans la prose poétique d’Alain Gerber. Qu’on lise, par exemple, les débuts de l’article sur Robert Leo « Bobby » Hackett, évoquant les « hommes du bord de mer, nés dans des villes lointaines… », ou du texte sur Eli Thompson, dit « Lucky », ne s’en laissant pas conter par « les mots errants, [qui] traînent à travers le monde, et parfois se collent à nous ». Sans oublier ce sens de la formule synthétique et de l’image savoureuse dont ou voudrait donner de multiples échantillons, du genre « Il y a des musiciens d’escabeau, des musiciens trônant sur des taupinières, mais que l’on a portés aux nues, non sans parfois de grandes contorsions » ; ou encore « Un géant peut en cacher un autre » ; ou encore… Ce « petit » dictionnaire est un grand ouvrage, qui a le mérite non seulement de réhabiliter les « incompris », mais encore de se lire comme un recueil de nouvelles que l’on peut parcourir à grandes enjambées ou déguster à petites doses, selon l’humeur.
Jean-Pierre Longre

Dans la collection « Jazz Impression » des éditions Alter Ego, n’oublions pas deux ouvrages récemment parus :
- Les Blessures du Désir, Pulsions et Puissances en Jazz, de Jean-Pierre Moussaron (tout récemment décédé, en octobre 2012), série de « portraits » et « esquisses » d’autant plus émouvants qu’ils sont très personnels.
 - John Coltrane, La musique sans raison, de Michel Arcens, « Esquisses d’une philosophie imaginaire » et « Essai pour une phénoménologie du jazz », ouvrage qui dépasse Coltrane, sans le contourner, pour construire une véritable esthétique musicale.
- John Coltrane, La musique sans raison, de Michel Arcens, « Esquisses d’une philosophie imaginaire » et « Essai pour une phénoménologie du jazz », ouvrage qui dépasse Coltrane, sans le contourner, pour construire une véritable esthétique musicale.
Alter Ego Editions
3, rue Elie Danflous
66400 Céret
http://leseditionsalterego.wordpress.com
17:15 Publié dans Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, musique, jazz, francophone, alain gerber, michel arcens, jean-pierre moussaron, alter ego éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/02/2013
« Psychose mystique »
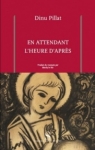 Dinu Pillat, En attendant l’heure d’après. Traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2013
Dinu Pillat, En attendant l’heure d’après. Traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2013
Peu de livres ont eu un destin aussi aventureux que ce roman – destin que relatent, dans leurs postfaces respectives, Gabriel Liiceanu et Monica Pillat. Achevé en 1948, En attendant l’heure d’après n’a pas pu être publié, et les deux exemplaires dactylographiés ont été confisqués dès l’arrestation de l’auteur, en 1959. Condamné pour apologie du mouvement légionnaire (mouvement d’extrême-droite créé en Roumanie entre les deux guerres) et pour « crime de trahison de la patrie », amnistié en 1964, Dinu Pillat (1921-1975) cherchera en vain à retrouver son texte, qui ne reverra le jour, d’une manière quasiment miraculeuse, qu’en 2010.
Sa publication en roumain et sa traduction en français sont salutaires, non seulement parce que le roman a suivi un cheminement hors du commun, mais aussi parce qu’il rend compte, sous la forme d’une fiction littéraire longuement mûrie et finement élaborée, de l’exaltation de jeunes gens qui, dans les années 1930, se laissèrent séduire par les délires apocalyptiques et parfois meurtriers d’une révolution nationale. Ainsi, sans que cela relève de l’essai, se démontent les mécanismes du fanatisme, de tous les fanatismes.
Roman à clefs, En attendant l’heure d'après n’est pas une fresque historique, mais s’attache à l’évolution psychologique et morale d’individus représentant des figures typiques du mouvement, qui devient ici celui des « Messagers ». Sans les approuver (loin s’en faut), l’auteur, adoptant différents angles d’approche, cherche à comprendre comment certains en arrivent à la violence, d’autres à la trahison, d’autres encore à la prise de conscience de l’illusion mystico-politique dans laquelle ils se fourvoient. Divers personnages gravitent autour des protagonistes – politiciens, étudiants, parents, parmi lesquels Raluca Holban, mère pitoyable et tragique voyant ses enfants lui échapper –, peuplant ce récit à la fois rigoureusement construit et foisonnant, qui vaut d’abord par la facture littéraire dans laquelle se coulent les désespérances individuelles et les errances collectives.
Jean-Pierre Longre
14:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, dinu pillat, marily le nir, éditions des syrtes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/02/2013
Amélie à Paris
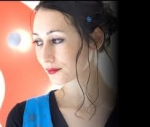 Amélie-Les-Crayons, Jusqu’à la mer, nouvel album, nouveau spectacle.
Amélie-Les-Crayons, Jusqu’à la mer, nouvel album, nouveau spectacle.
La Cigale, Paris, 7 février 2013
L’album
« 13 chansons et un nouveau grand voyage à travers l'imagination d'Amélie-les-crayons ! Comme pour "La Porte Plume", c'est Olivier Longre qui réalise les arrangements avec Amélie et l'intervention de quelques collègues dont Antoine Amigues (banjo), Bruz (basse, batterie), Yann-Gaël Poncet (violon), Loic Joucla (uileann pipes). On notera aussi la présence d'instruments non homologués tels que le cymbalum, la basse japonaise, le moineau frétillant et un choeur de femmes échevelées tout-à-fait incongru. L'ensemble est proposé dans un joyeux emballage particulièrement seyant et plein de surprises... »
 La critique de Télérama du 31/10/2012
La critique de Télérama du 31/10/2012
(http://www.telerama.fr/musiques/jusqu-a-la-mer,88773.php):
« Tellement classique qu'elle en devient osée. Classique, ou plutôt hors d'âge. Antimode, antibuzz, exquise et aiguisée. Dix ans après un premier disque, Amélie-les-Crayons est l'une des dernières à assumer une chanson à la fois simple et poétique. Quoique... L'honnêteté nous pousserait à avouer le contraire : des disques de cette famille-ci, on en reçoit quelques brassées par semaine. Sauf que la plupart nous donnent envie de pleurer, ou de rire. Ce type d'expression ne supporte pas la médiocrité ; par la place singulière qu'elles accordent aux textes et à la voix, ces chansons-là ne peuvent faire illusion, se planquer derrière une production en trompe l'oeil.
 Or les siennes, qui se donnent sans filet, sont infiniment touchantes. Dépouillées, mais pas à la manière d'un Boogaerts, chez qui le minimalisme est une esthétique sophistiquée. Elles se rapprocheraient plutôt de celles d'une Anne Sylvestre, d'une Michèle Bernard ou d'une Jeanne Cherhal (époque L'Eau). Le chant y est solaire et les mots y coulent comme un flux poétique et naturel, qui ne cherche pas à épater, mais à cerner la vérité. A l'écouter, on songe à la tradition des trouvères. Aux airs populaires d'antan, qui rythmaient la vie des gens et les travaux des champs. Aux ritournelles traditionnelles de sa Bretagne d'adoption — les paysages venteux, les côtes découpées et l'appel de la mer sont omniprésents. Chansons sur le fil, à l'équilibre gracile. Et merveilleusement gracieux. »
Or les siennes, qui se donnent sans filet, sont infiniment touchantes. Dépouillées, mais pas à la manière d'un Boogaerts, chez qui le minimalisme est une esthétique sophistiquée. Elles se rapprocheraient plutôt de celles d'une Anne Sylvestre, d'une Michèle Bernard ou d'une Jeanne Cherhal (époque L'Eau). Le chant y est solaire et les mots y coulent comme un flux poétique et naturel, qui ne cherche pas à épater, mais à cerner la vérité. A l'écouter, on songe à la tradition des trouvères. Aux airs populaires d'antan, qui rythmaient la vie des gens et les travaux des champs. Aux ritournelles traditionnelles de sa Bretagne d'adoption — les paysages venteux, les côtes découpées et l'appel de la mer sont omniprésents. Chansons sur le fil, à l'équilibre gracile. Et merveilleusement gracieux. »
 Le spectacle
Le spectacle
« Amélie-les-crayons a toujours été appréciée pour sa poésie légère, son humour irrésistible et la qualité de ses spectacles. 2 albums, 2 dvd et des centaines de concerts plus tard, la voici qui revient avec des histoires de voyage. Dans les bois, sur la mer ou à flanc de montagne, les chansons du nouveau spectacle Jusqu’à la Mer sont autant de petits galets à suivre sur cette route cousue par une artiste nomade, insaisissable, imprévisible. Avec elle sur scène, son comparse de toujours : Olivier Longre, multi-instrumentiste excentrique et attachant affublé d’objets sonores aussi étranges que variés, un binôme qui pourrait être son double : Nicolas Allemand, lui aussi multi-instrumentiste, percussionniste et danseur de claquettes, et son pianiste : Antoine Amigues. À quatre sur scène donc, rassemblés autour d’un piano dissimulant, comme à chaque spectacle d’Amélie-les-crayons, d’innombrables secrets qui apparaitront tout au long du voyage. »
La Cigale, 120, Boulevard de Rochechouart - 75018 Paris.
01 55 79 10 10
7 février 2013
Toutes les dates sur http://www.amelielescrayons.com/show.htm
15:00 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, poésie, amélie-les-crayons, olivier longre, nicolas allemand, antoine amigues, neomme, le radiant-bellevue | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
29/01/2013
Entre deux
 Willa Cather, Le pont d’Alexander, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel, Les éditions du Sonneur, 2012
Willa Cather, Le pont d’Alexander, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel, Les éditions du Sonneur, 2012
Bartley Alexander a bâti sa réputation en construisant des ponts, et il a tout pour être un homme heureux : un métier qu’il aime et qui lui permet de largement gagner sa vie, la renommée, une épouse parfaite et vigilante, des occasions de voyager entre les États-Unis, où il réside, et l’Angleterre, où il se rend fréquemment pour son travail, au prix de longues traversées en bateau (nous sommes au début du XXe siècle).
Mais parallèlement aux difficultés qu’il rencontre dans la construction du pont Moorlock, au Canada, une faille va s’ouvrir dans sa vie sentimentale. À Londres, il retrouve Hilda Burgoyne, fameuse actrice de théâtre, qu’il a autrefois connue et aimée, et qu’il redoute d’aimer de nouveau. Le roman est la relation de sa passion (au sens premier et plein du terme) qui le mine intérieurement, pris entre la fidélité à son épouse Winifred qui a « modelé sa vie » et la tentation de tout recommencer avec Hilda, qui lui donne une « force nouvelle ». Comment combler cet écart, comment échapper à « la fissure dans le mur, [à] l’écroulement, [au] nuage de poussière » ?
Le pont d’Alexander, dont le titre est à la fois reflet d’une réalité matérielle et symbole des émotions et incertitudes plus ou moins voilées du protagoniste, est un récit à la fois tout en délicatesse et tout en puissance, tout en fragilité et tout en force, comme le sont les personnages et comme l’est la destinée d’un homme qui ne peut échapper à sa dualité fondamentale. Publié en 1912, ce premier roman de Willa Cather (dont les éditions du Sonneur ont déjà publié La nièce de Flaubert) témoigne déjà d’une maîtrise parfaite de la faculté d’évocation des troubles de l’âme humaine.
Jean-Pierre Longre
15:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, états-unis, willa cather, anne-sylvie homassel, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/01/2013
Homo politicus et « collectisme »
 Fernand Bloch-Ladurie, Georges-Guy Lamotte. Le dernier des socialistes, Aux Forges de Vulcain, 2012
Fernand Bloch-Ladurie, Georges-Guy Lamotte. Le dernier des socialistes, Aux Forges de Vulcain, 2012
Homme de tous les combats, de la Résistance aux joutes électorales, et théoricien inégalé du « collectisme », Georges-Guy Lamotte (1929-2007) est l’une des grandes figures françaises de la période contemporaine. Injustement oublié aujourd’hui, il est enfin réhabilité par un chercheur hors-pair, un fin politologue et un écrivain chevronné, Fernand Bloch-Ladurie – trois personnes en une, trinité laïque qui offre au lecteur une biographie à la fois objective et pleine d’empathie, claire et labyrinthique, limpide et complexe, légère et pathétique de ce personnage qui sut avoir l’oreille de Guy Mollet et de François Mitterrand, et qui traversa toutes les tempêtes des IVème et Vème républiques sans dévier de son objectif : être Georges-Guy Lamotte, « synthèse entre Karl Marx et Margaret Thatcher »… Du moins, tout cela, c’est l’auteur qui nous le rapporte.
À une époque où nombre de « romans » ne sont que des biographies (ou autobiographies) relatant les moindres détails triviaux de vies plus ou moins sordides, plus ou moins sulfureuses, plus ou moins dramatiques, la publication d’une vraie fiction biographique, où le grotesque et la satire, l’ironie et l’autodérision voisinent avec un sens acéré de l’histoire, relève de la salubrité publique. Car il faut l’avouer : Georges-Guy Lamotte n’a jamais existé en tant que tel. Le grand burlesque repose sur ce décalage que l’on trouve entre les faits relatés et la tonalité de l’écriture, entre la boursouflure du héros et l’apparent sérieux des références, entre la caricature et la rhétorique, entre le ridicule de l’homme et la grandiloquence du discours. Ici, en outre, les allusions, les non-dits, les regards obliques, les aveux voilés sont aussi bien des sources de réflexion que des déclencheurs du rire (souvent intérieur, parfois jaune – car le lecteur quelque peu lucide sent bien que des hommes comme Georges-Guy Lamotte, il en a connu, parfois admiré, et qu’il s’est laissé prendre à leurs pièges).
Tous les hommes politiques, mais aussi tous les électeurs devraient lire Georges-Guy Lamotte. Le dernier des socialistes. Miroir déformant, vitre dépolie, lunette grossissante (on en passe), ce livre a aussi le grand mérite de dévoiler une doctrine dont chaque idéologie, chaque programme électoral passés, présents et à venir s’inspirent consciemment ou inconsciemment, puisque son Manifeste contient la réponse aux trois questions qui fondent toutes les grandes ambitions politiques :
1° Qu’est-ce que le collectisme ? Tout.
2° Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien.
3° Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose.
Jean-Pierre Longre
10:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, histoire, humour, francophone, fernand bloch-ladurie, aux forges de vulcain, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/01/2013
Relire Philippe Besson…
 Un mort et ses secrets
Un mort et ses secrets
Un garçon d’Italie, Julliard, 2003 et 2011, Pocket 2008
Le cadavre de Luca vient d’être retrouvé sur une rive de l’Arno. Accident ? Suicide ? Meurtre ? Voilà qui aurait pu fournir matière à un roman policier traditionnel, avec enquête, interrogations, confrontations… Il y a de tout cela dans le roman, mais ce n’est pas le plus important.
Ce qui compte, c’est la levée progressive des secrets plus ou moins lourds qui lestent les personnages, selon une structure apparemment simple (monologues alternés des trois protagonistes), mais qui laisse s’épanouir la prose incisive de Philippe Besson, mélange de sensibilité et de violence. Luca laisse entendre à la fois son état cadavérique, son passé mystérieux, son indépendance, les ambiguïtés de ses amours et de ses rapports aux autres ; Anna, sa compagne aimante et aimée, dévoile peu à peu son désarroi devant les découvertes que lui permettent de faire les parents de Luca et la police ; Leo, le jeune prostitué de la gare, apparaît comme un observateur secret et un amant désintéressé, lointain mais de plus en plus proche, de plus en plus impliqué…
Outre celle du roman policier, la matière aurait pu être celle du vaudeville, avec le traditionnel trio amoureux et les chassés-croisés qui s’ensuivent. Ce n’est pas non plus le propos. Il s’agit pour l’auteur – et pour le lecteur – d’affronter le tumulte des cœurs, des corps et des âmes, d’aller le plus loin possible à la rencontre de ce qu’ils cachent, de déchiffrer ce que dévoilent d’eux les actes et les pensées des personnages. Il s’agit, plus profondément encore, d’en chercher l’émotion et la beauté. Car ils sont émouvants et beaux, ces personnages, extérieurement et intérieurement, de même qu’est émouvante et belle la tragédie florentine que leur fait jouer Philippe Besson.
 Risques épistolaires
Risques épistolaires
Se résoudre aux adieux, Julliard, 2007, 10/18, 2008
Abandonnée par l’homme qu’elle aimait, Louise parcourt le monde (Cuba, New York, Venise, Paris), en quête d’on ne sait quoi : l’oubli (de soi, de l’autre) ? le renouveau ? la certitude ? Mais elle sait bien qu’aimer, « c’est prendre des risques ». Apparemment, elle tente de les reprendre, ces risques, par correspondance. Le livre entier est composé des lettres que depuis ses résidences lointaines elle adresse à Clément.
 Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.
Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.
Jean-Pierre Longre
18:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe besson, julliard, pocket, 1018, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/01/2013
Un conte modernisé
 Gilles Granouillet, Poucet, pour les grands, Lansman éditeur, 2012
Gilles Granouillet, Poucet, pour les grands, Lansman éditeur, 2012
« Tu vois, on peut tromper les histoires. Si on le veut vraiment, si on est très intelligent ! ». Visiblement, Poucet, qui s’adresse ici à une des filles de l’ogre, l’est, très intelligent, et volontaire, puisque par la magie du théâtre (et du dramaturge), le conte traditionnel va, un beau moment, changer de cap.
Grâce à deux jeunes gens qui se rencontrent au bord d’une mare, les caractères peuvent se transformer, la laideur devenir beauté, la méchanceté bonté, la cruauté douceur, la haine amour. Rien à voir, pourtant, avec un spectacle à l’eau de rose. Il ne s’agit pas d’une pièce moralisante, ni même simplement bien intentionnée. C’est du théâtre, mêlant la peur et le courage, le rire et les larmes, le poids de la tragédie et la légèreté de la comédie. Et s’il fallait en tirer une leçon, ce serait celle-ci : l’esprit de liberté a toutes les chances de l’emporter sur la résignation.
Jean-Pierre Longre
Outre Poucet, pour les grands, Lansman éditeur a récemment mis trois pièces à la disposition des lecteurs et des gens de théâtre :
Vipérine de Pascal Brullemans, « comédie fantastique sur la difficulté de traverser un deuil ».
Monstres du même Pascal Brullemans, « l’histoire d’une minute », « monologue polyphonique » d’une adolescente attendant le résultat de son test de grossesse.
Vivarium S01E02 de Thierry Simon, « polar scénique » dans lequel trois enquêteurs cherchent à « percer le mystère » d’une quadruple meurtrière.
À lire aussi, chez le même éditeur : Rêves d’air et de lumière ou comment créer le désir de théâtre, de Roger Deldime, et Humour et identité, La matière et l’esprit n° 24, novembre 2012.
18:14 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, francophone, gilles granouillet, lansman éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Un guide littéraire pour tous
 Bernard Camboulives, Sur les pas des écrivains roumains, éditions Vaillant, 2012
Bernard Camboulives, Sur les pas des écrivains roumains, éditions Vaillant, 2012
La Roumanie et la France entretiennent depuis longtemps des liens privilégiés, notamment dans le domaine culturel, et tout particulièrement littéraire. On le sait, mais il est bon que, périodiquement, quelques « passeurs » le rappellent et s’emploient à resserrer ces liens. Bernard Camboulives, fin connaisseur de la littérature roumaine, fait partie de ces « passeurs ».
Son dernier ouvrage, modestement sous-titré « Aperçu à l’usage des lecteurs francophones », dresse d’abord un tableau général de l’histoire littéraire de la Roumanie, depuis les textes médiévaux jusqu’à notre époque (en anticipant même sur les traductions à paraître d’ici au Salon du Livre de Paris, où en 2013 les écrivains roumains seront à l’honneur). La deuxième partie donne des précisions sur les œuvres en langue roumaine de certains auteurs représentant des points d’ancrage décisifs, tels que Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Eugène Ionesco, Gherasim Luca, Herta Müller, Florina Ilis (à noter qu’une liste très utile des « auteurs roumains traduits en France » figure à la fin de l’ouvrage).
Bernard Camboulives ne se contente pas de recenser et de décrire. Ses analyses sont circonstanciées et détaillées, les éclairages diversifiés (voir par exemple le chapitre sur la ballade Mioritsa et ses interprétations divergentes, ou celui qui porte sur le « cas » Eminescu). Il y a donc là matière à intéresser tous les lecteurs – ceux qui désirent s’initier à l’histoire de la littérature roumaine aussi bien que ceux qui veulent approfondir la connaissance qu’ils en ont déjà.
Jean-Pierre Longre
18:11 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, bernard camboulives, éditions vaillant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/01/2013
Les voyages d’une médaille
 Birgit Weyhe, La ronde, traduit de l’allemand par Élisabeth Willenz, Cambourakis, 2012
Birgit Weyhe, La ronde, traduit de l’allemand par Élisabeth Willenz, Cambourakis, 2012
Les dix récits qui composent ce roman graphique ont un fil conducteur unique : une petite médaille au nom de « Marie », qui passe de main en main, de pays en pays, de continent en continent au cours du XXe siècle et du début du XXIe, en une « ronde » menant de Montréal à Montréal.
L’Amérique, l’Europe, l’Afrique, les guerres mondiales et leurs horreurs, les luttes sociales, nationales et individuelles, les vicissitudes de la vie intime et collective, les petits et les grands secrets familiaux… Tout est vu, sans manichéisme ni parti pris, par le truchement de personnages attachants, qui forment eux-mêmes une chaîne aux maillons plus ou moins ténus, plus ou moins resserrés.
 Les dessins en noir et blanc, qui marient la simplicité, le symbolisme et l’expressionnisme, ne se contentent pas d’illustrer les propos, ni même de figurer la narration. Ils réussissent à diversifier les points de vue tout en donnant une idée de la vie intérieure des personnages. Voilà donc – sur un schéma antérieurement adopté par Arthur Schnitzler pour sa pièce La ronde, mais sur des sujets et dans des perspectives bien différents – une œuvre qui donne à voir, à lire, à entendre la marche du monde et les mystères des humains.
Les dessins en noir et blanc, qui marient la simplicité, le symbolisme et l’expressionnisme, ne se contentent pas d’illustrer les propos, ni même de figurer la narration. Ils réussissent à diversifier les points de vue tout en donnant une idée de la vie intérieure des personnages. Voilà donc – sur un schéma antérieurement adopté par Arthur Schnitzler pour sa pièce La ronde, mais sur des sujets et dans des perspectives bien différents – une œuvre qui donne à voir, à lire, à entendre la marche du monde et les mystères des humains.
Jean-Pierre Longre
19:20 Publié dans Mots et images | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : roman, bande dessinée, allemagne, birgit weyhe, Élisabeth willenz, cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/12/2012
La voix de la nature et le sens de la vie
 N. D. Cocea, Le vin de longue vie, traduit du roumain par Jean de Palacio, Cambourakis, 2012
N. D. Cocea, Le vin de longue vie, traduit du roumain par Jean de Palacio, Cambourakis, 2012
Dans le district de Cotnar, où la vigne produit un vin particulièrement fameux, vient d’être nommé un jeune juge auxiliaire qui observe la vie quotidienne du lieu, d’abord avec un certain recul humoristique, et entend avec intérêt les conversations des notables. Celles-ci tournent souvent autour d’un certain Maître Manole, propriétaire du « manoir » et de sa vigne, âgé d’environ quatre-vingt-dix ans, et sur lequel courent des bruits mystérieux relevant autant de la légende que de l’histoire locale.
Notre jeune magistrat, de rencontre en rencontre, va faire la connaissance du vieux boyard qui a conservé une étonnante santé pour son âge, et avec qui les promenades dans la campagne environnante prennent l’allure de déambulations philosophiques. Maître Manole dévoile peu à peu sa sagesse, sa culture, son goût pour la nature, pour les livres, pour la beauté, pour l’intelligence, pour la vie ; et finalement il révèle les secrets de sa jeunesse et l’histoire tragique de son amour passé pour une jeune Tzigane.
Le vin de longue vie, dont la première publication date de 1931, fait partie de ces romans épiques et intemporels qui mêlent le réalisme et l’étrange, l’humour et le tragique, le mystère et la vérité, la simplicité de la vie et la complexité de l’existence, la force et la fragilité des êtres, la satire et la morale, l’amour et la mort… « C’est folie et vaine ambition littéraire, que de décrire la beauté ». Et pourtant le style narratif de N. D. Cocea, à la fois alerte et poétique, recèle une inimitable beauté, celle que suggèrent la nature et la vie.
Jean-Pierre Longre
19:14 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, roumanie, n. d. cocea, jean de palacio, cambourakis, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/12/2012
Secrets de naissance
Hélène Grémillon, Le confident, Plon – JC Lattès, 2010, Folio, 2012
 Après le décès de sa mère, Camille reçoit les traditionnelles lettres de condoléances, pleines de compliments pour la défunte et de compassion pour ceux qui restent. Au milieu, une enveloppe intrigante, contenant une longue missive sans signature, qui inaugure toute une série d’envois de plus en plus étranges, dans lesquels un certain Louis évoque une certaine Annie – prénoms l’un et l’autre étrangers à Camille, qui se laisse prendre de plus en plus passionnément au suspense entretenu par cette mystérieuse correspondance.
Après le décès de sa mère, Camille reçoit les traditionnelles lettres de condoléances, pleines de compliments pour la défunte et de compassion pour ceux qui restent. Au milieu, une enveloppe intrigante, contenant une longue missive sans signature, qui inaugure toute une série d’envois de plus en plus étranges, dans lesquels un certain Louis évoque une certaine Annie – prénoms l’un et l’autre étrangers à Camille, qui se laisse prendre de plus en plus passionnément au suspense entretenu par cette mystérieuse correspondance.
Toutes sortes de soupçons lui viennent à l’esprit, y compris celui du stratagème d’un auteur cherchant à tout prix à se faire publier – puisque Camille est éditrice. Les soupçons, et aussi la peur. Camille est enceinte, et « n’importe quelle femme enceinte aurait été troublée à la lecture de ces lettres ». Au fur et à mesure, l’enfantement et la mort se mêlent étroitement dans le récit morcelé qui s’impose à la destinataire. « Une naissance appelle une mort ».
 Le lecteur, dans un mouvement parallèle, se laisse saisir par les révélations successives dont il ne doute pas, au bout d’un moment, qu’elles impliquent la naissance et l’existence mêmes de Camille, à travers les mystères de ses origines. Les récits épistolaires s’emboîtent les uns dans les autres, selon une structure narrative diversifiant les points de vue et reconstruisant habilement le passé ; un passé familial qui, s’inscrivant sur celui de la guerre de 39-45, prend une dimension à la fois personnelle et historique ; un passé d’autant plus angoissant que les sentiments et les événements intimes fondent leur drame dans le drame collectif.
Le lecteur, dans un mouvement parallèle, se laisse saisir par les révélations successives dont il ne doute pas, au bout d’un moment, qu’elles impliquent la naissance et l’existence mêmes de Camille, à travers les mystères de ses origines. Les récits épistolaires s’emboîtent les uns dans les autres, selon une structure narrative diversifiant les points de vue et reconstruisant habilement le passé ; un passé familial qui, s’inscrivant sur celui de la guerre de 39-45, prend une dimension à la fois personnelle et historique ; un passé d’autant plus angoissant que les sentiments et les événements intimes fondent leur drame dans le drame collectif.
Voilà un roman captivant, au sens premier du terme : captif de l’intrigue, le lecteur, comme l’héroïne, doit aller jusqu’au bout, jusqu’aux tout derniers mots, s’il veut s’en libérer.
Jean-Pierre Longre
18:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, hélène grémillon, plon – jc lattès, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Les masques de la vie
 Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
Tabish Khair , À propos d’un thug. Traduit de l'anglais (Inde) par Blandine Longre, Les éditions du sonneur, 2012
« M. Ali, j’ai parfois l’impression que ce que nous sommes, ce que nous paraissons être, ce que nous prétendons être et ce que nous sommes aux yeux des autres sont quatre choses bien distinctes. Telle est la nature de l’existence, l’une de ses nombreuses imperfections, pourriez-vous ajouter » : le capitaine William Meadows, revenu d’Inde en 1837 avec Amir Ali, semble avoir compris ce qui fait la diversité de l’existence et de ses énigmes, des récits que l’on en fait, aux autres et à soi ; ils sont au cœur du roman de Tabish Khair.
Le protagoniste, donc, s’est installé dans le Londres victorien, sous la protection du capitaine Meadows, qui lui demande de raconter sa vie d’adepte du « thugisme », secte réunissant jadis des musulmans et des hindous pratiquant rituellement le vol et le meurtre. En parallèle, Amir confie à Jenny, la jeune servante qu’il aime, dans des lettres dont il sait qu’elle ne pourra les lire, les vraies vicissitudes de sa vie en Inde et ses doutes actuels, dans la grisaille anglaise.
Une autre intrigue met en scène le fameux phrénologue lord Batterstone, dont la volonté est de montrer à tout prix le bien-fondé de ses théories raciales, et son employé John May qui, à force de chercher pour son patron des crânes difformes dans les tombes, sombrera dans l’acharnement du meurtre, entraînant ses complices avec lui. Le récit tourne au roman noir, avec double enquête, officielle et journalistique d’une part, nourrissant le fantasme du « cannibale décapiteur », officieuse et populaire d’autre part, assurée par quelques représentants efficaces et solidaires de la populace des bas-quartiers.
Tabish Khair, dont l’art des récits alternés se manifestait déjà dans Apaiser la poussière, sait que la vie humaine n’est pas une, et que l’existence n’est pas vouée à la certitude ; surtout, il sait l’écrire, par le truchement d’histoires qui se situent aux confins du réel, aux limites de la possibilité, aux frontières du doute. Et il sait le confier à la plume fictive de ses personnages : « Qu’il est étrange de devenir ce qu’on n’est pas. Quelques histoires, quelques mots suffisent-ils ? Notre emprise sur la réalité est-elle si faible, si précaire ? Les histoires – racontées par nous ou par d’autres – peuvent-elles nous transformer ainsi ? Et pour quelle raison avons-nous besoin de nous en revêtir – quelle que soit notre manière d’avoir prise sur la réalité, et quelle que soit cette réalité ? Est-ce donc ce à quoi nous nous résumons ? Des histoires, des mots, un souffle ? ».
Jean-Pierre Longre
http://blongre.hautetfort.com/archive/2012/04/29/a-propos-d-un-thug.html
15:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : roman, anglophone, inde, tabish khair, blandine longre, les éditions du sonneur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/11/2012
Au-delà des apparences
 Philippe Georget, L’été tous les chats sont gris, éditions Jigal, 2009, Pocket, 2012
Philippe Georget, L’été tous les chats sont gris, éditions Jigal, 2009, Pocket, 2012
Dans la région de Perpignan, cet été là, de jeunes hollandaises qui n’ont pas froid aux yeux semblent être victimes d’un tueur en série : agression, enlèvement, meurtre… Mais Gilles Sebag, policier aux allures ordinaires de père de famille soucieux et de mari aimant, et pourtant doué d’une subtilité qui ne fait pas fi des intuitions, sait aller au-delà des apparences.
Voilà un roman policier (un thriller, si l’on veut) qui, tout en répondant aux normes du  genre (intrigue à la fois localisée et complexe, suspense, rebondissements, traits psychologiques marqués, affrontements directs ou indirects, un zeste de violence et de sensualité…), émerge du lot des productions saisonnières (le Prix SNCF du polar français l'a d'ailleurs justement récompensé). Cela tient à une écriture qui marie habilement la narration implacable, les traits humoristiques et les évocations poétiques, et au caractère très humain des protagonistes. Si les chats s’ennuient, ce n’est pas le cas du lecteur.
genre (intrigue à la fois localisée et complexe, suspense, rebondissements, traits psychologiques marqués, affrontements directs ou indirects, un zeste de violence et de sensualité…), émerge du lot des productions saisonnières (le Prix SNCF du polar français l'a d'ailleurs justement récompensé). Cela tient à une écriture qui marie habilement la narration implacable, les traits humoristiques et les évocations poétiques, et au caractère très humain des protagonistes. Si les chats s’ennuient, ce n’est pas le cas du lecteur.
Jean-Pierre Longre
15:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman policier, francophone, philippe georget, éditions jigal, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/11/2012
Une nouvelle librairie à Lyon
 La librairie POINT D’ENCRAGE vient d’ouvrir dans le 9e arrondissement (Vaise). Accueil chaleureux, conseils éclairés : avis aux amateurs de bonne littérature, qui ne figure pas forcément dans les listes des best-sellers… Et un bel espace pour les enfants et la bande dessinée.
La librairie POINT D’ENCRAGE vient d’ouvrir dans le 9e arrondissement (Vaise). Accueil chaleureux, conseils éclairés : avis aux amateurs de bonne littérature, qui ne figure pas forcément dans les listes des best-sellers… Et un bel espace pour les enfants et la bande dessinée.
Une fête d'inauguration aura lieu le samedi 10 novembre à partir de 18h. A 18h30 Romain Verger lira des extraits de ses trois romans publiés. A 20 heures, Fred Griot dira sa poésie. La soirée se terminera quand tout le monde sera fatigué...
Coordonnées de la librairie :
Point d'Encrage
73, rue Marietton
69009 Lyon
04.78.47.84.16
06.61.92.76.39
En attendant la construction du site, on peut consulter :
http://www.facebook.com/PointDencrage
et le blog d’Anne-Françoise Kavauvea, l’une des deux libraires : http://annefrancoisekavauvea.blogspot.fr/
19:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : librairie, lyon, point d'encrage | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/11/2012
Le numéro trois est arrivé !
 The Black Herald – 3
The Black Herald – 3
Literary magazine – Revue de littérature
Issue #3 – September 2012 - Septembre 2012
190 pages – 15€ / £13 / $19 – ISBN 978-2-919582-04-4
Poetry, short fiction, prose, essays, translations.
Poésie, fiction courte, prose, essais, traductions.
With / avec W.S. Graham, Gregory Corso, Andrew Fentham, Louis Calaferte, Iain Britton, Jos Roy, Tristan Corbière, Michael Lee Rattigan, Clayton Eshleman, Denis Buican, John Taylor, César Vallejo, Anne-Sylvie Homassel, Cécile Lombard, Gary J. Shipley, Rosemary Lloyd, Bernard Bourrit, Mylène Catel, Nicolas Cavaillès, Ernest Delahaye, Sébastien Doubinsky, Gerburg Garmann, Michel Gerbal, Allan Graubard, Sadie Hoagland, James Joyce, João Melo, Andrew O’Donnell, Kirby Olson, Devin Horan, Dominique Quélen, Nathalie Riera, Paul B. Roth, Alexandra Sashe, Will Stone, Anthony Seidman, Ingrid Soren, August Stramm, Pierre Troullier, Romain Verger, Anthony Vivis, Elisabeth Willenz, Mark Wilson, Paul Stubbs, Blandine Longre et des essais sur / and essays about Charles Baudelaire, Francis Bacon. Images: Ágnes Cserháti, Olivier Longre, Will Stone, Devin Horan. Design: Sandrine Duvillier.
The Black Herald is edited by Paul Stubbs and Blandine Longre
Comité de Rédaction : Paul Stubbs et Blandine Longre
17:34 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, anglophone, francophone, poésie, nouvelle, essai, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/10/2012
« L’excès de l’absence »
 Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Jérôme Garcin, Olivier, Gallimard, 2011, Folio, 2012
Olivier allait avoir six ans lorsqu’il fut tué par un chauffard. Sa mort priva Jérôme, son frère jumeau, d’un autre soi-même, de son double, d’une présence nécessaire. « À chaque anniversaire, le même trouble me saisit : j’ai l’impression que je ne suis pas seul ». Et ce livre, pour la première fois, fait confidence de cet « excès de l’absence » (pour reprendre une formule de L’instant fatal de Queneau), de cette présence en creux qui a modelé ses attitudes face à la vie.
La solitude a donné à l’enfant, à l’adolescent, à l’adulte le goût de l’isolement, du grand air, des randonnées équestres dans la campagne ; les secrets enfouis de la gémellité perdue lui ont donné le goût du silence, de la pudeur muette et nouée. De là, la nécessité d’écrire : « Parmi tout ce que tu m’as appris, il y a d’abord ceci : on écrit pour exprimer ce dont on ne peut pas parler, pour libérer tout ce qui, en nous, était empêché, claquemuré, prisonnier d’une invisible geôle ». L’environnement familial et les choix délibérés aidant, la moitié vide de son existence a vite aspiré Jérôme vers les livres, toutes sortes de livres, parmi lesquels émergent ceux qui relatent l’« expérience du deuil ». Vers les livres à lire, vers les livres à commenter, vers les livres à écrire.
 Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Et ce livre-ci, Olivier, vagabondage poétique et délicat dans les souvenirs, dans les chagrins, les « sourires invisibles », les « émotions camouflées », dans les évocations familiales anciennes et toutes fraîches, tristes et joyeuses, dans les réflexions et les références d’ordre psychologique, les territoires méconnus de l’inconscient, – ce livre-ci, on comprend que l’auteur ait hésité à le publier : « Peut-être conviendrait-il de le laisser à l’état de brouillon, de vieux papier, de palimpseste, et de ne pas enfermer cette confidence volatile dans un livre définitif ». Il est pourtant, avec raison, allé jusqu’au bout ; pour lui-même sans doute ; pour son jumeau ainsi assuré de demeurer hors de l’oubli ; pour leur mère aussi – la postface d’avril 2012 en fait l’aveu : « Ce que, par une pudeur partagée, nous ne nous disions pas, mes pages l’ont libéré ». Elles libèrent de même tout lecteur, confronté à sa propre expérience du manque, si enfouie soit-elle.
Jean-Pierre Longre
22:37 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, autobiographie, francophone, jérôme garcin, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/10/2012
Distillerie littéraire au Pont du Change
Les éditions Le Pont du Change continuent à distiller des textes narratifs et poétiques. En voici deux, qu’il convient de déguster délicieusement à gorgées mesurées.
 Drôle d’animaux
Drôle d’animaux
Christian Cottet-Emard, Dragon, ange et pou, trois burlesques, Le Pont du Change, 2012
Est-il possible qu’un diacre un peu encombrant se métamorphose malgré lui en pou géant accroché à des tuyaux d’orgue ? Existe-t-il des bébés dragons cachés sous les bâches des tas de bois ? Un ange peut-il nous aider à sortir et rentrer les poubelles ?
De fait, tout cela se produit bel et bien dans les nouvelles de Christian Cottet-Emard. Pas simplement pour le plaisir de l’étrange et du fantastique. Ceux-ci, au-delà de leur charme propre, sont des chemins vers le « burlesque » et le comique de situation, mais aussi des moyens d’accès à une sorte d’observatoire. Observatoire du genre humain, de ses réactions face à l’inattendu – réactions qui n’en sont pas, puisque rien semble-t-il ne peut transformer les habitudes des hommes, incorrigibles curieux. L’auteur l’avoue poétiquement : « Les personnages principaux se contentent d’observer, comme les anges curieux de Conques qui enroulent le firmament, légèrement en retrait de ce qui s’annonce ».
Au rire déclenché par l’écriture (jeux sur les noms propres, dialogues alertes, formules répétitives, farce…) répond, plus profondément, la possibilité d’une méditation sur ces drôles d’animaux que sont les humains et sur l’évolution générale de l’espèce.
 Récit au compte-gouttes
Récit au compte-gouttes
Roland Counard, Le laitier de Noël, Le Pont du Change, 2012
De tout petits textes, à la mesure du garçonnet qui en est le héros. De tout petits textes qui, même s’ils restent aussi distincts les uns des autres que des poèmes en prose ou des saynètes comiques, forment une trame narrative aussi cohérente qu’énigmatique. De tout petits textes qui s’adressent à lui, Robin Dubuisson (deviendrait-il un jour Robin des Bois ?), tout en laissant planer sur ses faits et gestes, sur ses intentions mêmes, de lourds soupçons…
Car si la famille et le voisinage de Robin forment de prime abord un entourage rassurant, une cellule confortable, les morts violentes se succèdent – accidents ou meurtres. Celles du grand-père, de la voisine… et ce n’est certainement pas fini… Peu à peu, au compte-gouttes, les éléments s’emboîtent, sans donner de réponse claire. Vus à hauteur d’enfant, les événements se succèdent, laissant planer des hypothèses peu rassurantes sur la prétendue innocence et l’apparente naïveté des humains de cinq ans.
Jean-Pierre Longre
16:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, récit, christian cottet-emard, roland counard, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/10/2012
Tableaux de la fa(m)ille humaine
 Matéi Visniec, Lettres d’amour à une princesse chinoise, Actes Sud-Papiers, 2012
Matéi Visniec, Lettres d’amour à une princesse chinoise, Actes Sud-Papiers, 2012
Tout est possible au théâtre, et dans son œuvre entière Matéi Visniec le prouve, qui sait à merveille mettre en scène les relations sociales, sentimentales, familiales, les idées, l’érotisme, la politique, la morale, la violence, la mort… Mettre en scène, c’est-à-dire faire en sorte qu’à travers les paroles, les gestes, les silences des personnages, les questions restent posées, avec leur évidence cruciale et leur complète incertitude.
Il ne s’agit évidemment pas d’asséner des réponses. Dans les huit brèves pièces de ce nouveau volume, dont le titre poétique est emprunté à celui de la première, beaucoup de tirades, quelques monologues et dialogues, montrent à mots couverts et en d’énigmatiques paraboles la complexité du monde et des êtres. Comment deux « Maisons florales », l’une plutôt nationaliste, l’autre plutôt internationaliste (dirons-nous pour schématiser) alternent rivalités sans concessions et tentatives de concertation pour servir leur gouvernement. Comment le cœur et le corps, le sentiment et le désir, la honte et l’impudeur sont à la fois moteurs et obstacles dans la vie d’un couple. Comment révolutions, contre-révolutions et fermes résolutions se noient dans la brutalité. Comment la mort, aux yeux des enfants, n’est pas aussi tragique qu’on le croit (« Mourir, chez nous, il paraît que c’est vraiment inoubliable ») !
Pas de réponses donc, pas de démonstrations non plus. Chaque pièce est un véhicule qui nous transporte vers des espaces étranges et révélateurs. Nous voici dans un empire chinois où seules les fleurs semblent avoir de l’importance ; dans une gare perdue où ne passe aucun train ; en promenade prometteuse et lente sur un corps féminin ; dans une « baignoire révolutionnaire » ; sur un littoral aux falaises vivantes ; dans un magasin de chaussures où les femmes se laissent prendre au piège… Et, comme toujours chez Visniec, la peinture de la famille humaine et de ses failles, la poésie et la musique des mots, l’humour plus ou moins voilé, la magie narrative, le jeu de l’imaginaire.
Jean-Pierre Longre
18:14 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, francophone, roumanie, matéi visniec, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/10/2012
Après la chute
 Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Jean-Paul Dubois, Le cas Sneijder, Éditions de l’Olivier, 2011 Éditions À vue d’œil (gros caractères), 2012, Editions Points, 2012
Avec les héros de Jean-Paul Dubois, on ne risque pas de s’ennuyer – même si eux-mêmes plongent parfois dans le désespoir et la dépression. Paul Sneijder est, comme les précédents et comme l’annonce le titre, un « cas ». Mais pas tout de suite. Sa vie aurait pu rester dans des normes sociales conventionnelles : une femme du genre « executive woman », des jumeaux qui suivent les traces de leur mère, une fille d’un premier mariage, rejetée par la nouvelle famille, un exil au Québec pour la carrière de l’épouse, un intérêt particulier pour les morts collectives d’animaux (oiseaux, poissons)… Bref, une existence qui, sans être complètement ordinaire, n’est pas encore matière à roman.
 Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Et le 4 janvier 2011 à 13h12, l’accident comme il n’en arrive pratiquement jamais. Un ascenseur qui se décroche, trois morts (dont Marie, la fille chérie) et un rescapé : Paul Sneijder, pour qui tout va changer, et dont la vie peut devenir un roman, d’autant que c’est lui-même qui la raconte, à sa manière (disons : à la manière alerte, inimitable de Jean-Paul Dubois).
Paul Sneijder bascule, pour ainsi dire, vers la face cachée de l’humanité. Son obsession : étudier les divers mécanismes qui commandent les mouvements des ascenseurs, au point d’en devenir un spécialiste. Son occupation : promener les chiens des autres, au point de se prendre d’affection pour eux. Son culte : celui des cendres de Marie, dont il conserve précieusement l’urne sur son bureau. Son amusement : relever, par exemple, les nombres palindromiques trouvés par son patron. Ses souvenirs : précis, sans défauts (« Je me souviens de tout ce que j’ai fait, dit ou entendu » : telle est la première phrase du livre). Ces changements qui, aux yeux de sa femme et de ses  jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
jumeaux, tournent à la catastrophe mentale et sociale, sont pour lui salutaires, lui permettant « de considérer le mécanisme de nos vies sous un autre angle, une autre perspective ». Lorsqu’il se demande comment les chiens peuvent garder leur stabilité, ce qu’il en dit n’est évidemment pas étranger à ses préoccupations : « Je voulais croire que cela tenait à la configuration de leur mémoire qui possédait peut-être cette capacité à dissoudre l’écume des jours, à oublier ce qui n’était pas essentiel, à cultiver cette aptitude à renaître chaque jour, à repartir de zéro ».
Jean-Paul Dubois a l’art de dénicher des situations inattendues, de les cultiver, de les exploiter dans sa tonalité particulière, où tragédie et comédie se mêlent et se complètent à merveille.
Jean-Pierre Longre
13:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, jean-paul dubois, Éditions de l’olivier, éditions a vue d'oeil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

