19/03/2020
Un labyrinthe enchanté
 Le Blues roumain, « anthologie imprévue de poésies roumaines », Traduction et sélection de Radu Bata, préface de Jean-Pierre Longre, illustrations de Iulia Şchiopu et Horaţiu Weiker, Éditions Unicité, 2020
Le Blues roumain, « anthologie imprévue de poésies roumaines », Traduction et sélection de Radu Bata, préface de Jean-Pierre Longre, illustrations de Iulia Şchiopu et Horaţiu Weiker, Éditions Unicité, 2020
Cette anthologie a été « imprévue » par un poète, qui plus est, un poète bilingue, qui passe le plus aisément du monde de sa langue maternelle à sa langue d’adoption, et inversement. Nous pouvons donc aller en toute confiance sur ses traces, nous promener parmi ses traductions et « adaptations » (oui, l’artiste se permet tout) de textes qui n’ont jamais dit leur dernier mot, et qui, s’ils ne prétendent pas représenter toute la poésie roumaine, y font de larges et profondes incursions.
Qu’on ne s’attende pas à trouver ici quelque folklore, quelque exotisme que ce soit, même si le passé, la tradition, se rappellent à nous avec, par exemple, un quatrain d’Eminescu – qui n’a rien de folklorique. Et si le sous-titre, « Le blues roumain », fait allusion, en particulier, à la fameuse « blouse roumaine » immortalisée par Matisse, il peut renvoyer aussi au sentiment d’indéfinissable nostalgie que les Roumains condensent en un petit mot, le « dor », et à bien d’autres domaines poétiques et musicaux qui passent largement les frontières, voire les océans. Donc, pas de folklore, mais, véritablement, de la poésie d’aujourd’hui (et un peu d’hier), parfois complexe, plus souvent d’une simplicité toute suggestive, déclinée sur tous les tons, révélant toutes les sensibilités, s’adonnant à toutes les formes de vers et de prose, avec cependant, pour ainsi dire, un programme commun dévoilé dès le début par Nichita Stănescu : le poète « est touché par la grâce / et le souci des autres ».
Des gestes quotidiens aux visions fantastiques, de l’attente à la résignation, de la résignation au pessimisme, du silence éloquent à la parole légère, les textes choisis par Radu Bata ouvrent des passages étroits et infinis, jamais obscurs, toujours à taille humaine. Au choix, les chemins mènent, au-delà des paradoxes du désespoir et des cimes de la solitude, vers des tableaux insolites, étranges, voire surréalistes (au vrai sens du terme), parfois impressionnistes (toujours au vrai sens), d’où ne sont pas exclus les sourires de l’humour et les éclats de la vie heureuse. Et la nature est là, qui apaise et qui rassure, qui meuble les vides de l’existence humaine et humanise la violence du réel, qui « tire les rideaux rouges du froid », semant des « flocons d’espoir », de la « douceur » et de l’harmonie. Par-dessus tout, l’amour, ses couleurs, ses lumières et ses surprises, ses déceptions quand même, les battements du cœur rythmant les pensées et les phrases, les beautés de l’ici et les plaisirs du maintenant.
Jean-Pierre Longre
(extraits de la préface)
Les auteurs : Iuliana Alexa, Dan Alexe, Luminiţa Amarie, George Bacovia, Ana Barton, Ana Blandiana, Max Blecher, Dorina Brândușa Landén, Emil Brumaru, Artema Burn, Nina Cassian, Mircea Cărtărescu, Mariana Codruţ, Mihaela Colin, Traian T. Coșovei, Silviu Dancu, Carmen Dominte, Rodian Drăgoi, Adela Efrim, Mihai Eminescu, Raluca Feher, Anastasia Gavrilovici, Horia Ghibuțiu, Matei Ghigiu, Silvia Goteanschii, Mugur Grosu, Cristina Hermeziu, Nora Iuga, Vintilă Ivănceanu, Claudiu Komartin, Ion Minulescu, Ramona Müller, Ion Mureșan, Iv cel Naiv, Felix Nicolau, Florin Partene, Elis Podnar, Mircea Poeană, Ioan Es Pop, Alice Popescu, Eva Precub, Petronela Rotar, Ana Pop Sirbu, Radmila Popovici, Octavian Soviany, Nichita Stănescu, Petre Stoica, Ramona Strugariu, Robert Şerban, Mihai Şora, Iulian Tănase, Mihai Ursachi, Paul Vinicius, Gelu Vlașin, Vitalie Vovc, Anca Zaharia
10:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, roumanie, radu bata, iulia Şchiopu, horaţiu weiker, jean-pierre longre, Éditions unicité | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2020
Des airs qui pleurent, des airs qui rient
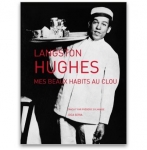 Langston Hughes, Mes beaux habits au clou, traduction de l’anglais (États-Unis) et postface de Frédéric Sylvanise, éditions Joca Seria, 2019
Langston Hughes, Mes beaux habits au clou, traduction de l’anglais (États-Unis) et postface de Frédéric Sylvanise, éditions Joca Seria, 2019
Le blues n’est pas seulement une musique. Du moins, sa musique peut être celle des mots, et Langston Hughes l’a prouvé, en suivant les règles strictes du genre : répétition des premiers vers, vers impairs avec rimes, langue populaire mais utilisée avec respect… Comme l’écrit Frédéric Sylvanise dans sa postface : « Le blues vient de la rue, mais il ne faudrait pas lui ôter toute dignité. […] Même dans le malheur, le bluesman cherche lui aussi à s’élever ».
Si le blues en tant que genre et en tant qu’état d’esprit est dominant dans ce recueil, il n’en est qu’un aspect. D’autres formes poétiques s’y épanouissent, avec des textes à la musicalité tout aussi suggestive, aux rythmes et aux sonorités tout aussi prégnants, aux thèmes tout aussi populaires. La misère sociale, le racisme et ses conséquences, le malheur et la mort, l’alcool et la méchanceté, les plaintes en forme de prières, les anecdotes domestiques, la nostalgie et les rêves inaccomplis, et bien sûr les sentiments humains – l’amitié et surtout l’amour, le plus souvent malheureux, mais donnant çà et là l’occasion d’une allusion au bonheur et à l’érotisme souriant d’une fille « trop jolie »… Chants de fidélité et de souffrance à la fois :
« Quand un type aime vraiment sa femme
I’ la quitte pas en plein hiver.
I’ m’a dit qu’i’m’aimait.
Mais il a sûrement menti.
I’ m’a dit qu’i’m’aimait.
Il a sûrement menti.
Mais c’est l’seul homme que j’aimerai
Jusqu’à la fin d’ma vie. »
Poésie du peuple, Mes beaux habits au clou (le titre annonce la dominante) est un recueil d’une grande beauté, où le désespoir et l’espoir se côtoient comme naturellement, où les pleurs et les rires se mêlent sans vergogne, où la brutalité n’empêche pas la plus grande douceur de s’exprimer, où l’idée de la mort fait partie de la vie.
« J’attends ma maman,
C’est la Mort.
Dis-le tout doux,
Dis-le tout doux si tu veux bien.
« J’attends ma maman,
La Mort. ».
Jean-Pierre Longre
16:07 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, États-unis, langston hughes, frédéric sylvanise, éditions joca seria, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/03/2020
L’amitié, la littérature, l’histoire
 Panaït Istrati – Romain Rolland, Correspondance 1919-1935, édition établie, présentée et annotée par Daniel Lérault et Jean Rière, Gallimard, 2019
Panaït Istrati – Romain Rolland, Correspondance 1919-1935, édition établie, présentée et annotée par Daniel Lérault et Jean Rière, Gallimard, 2019
Les publications de correspondances d’écrivains ont-elles un intérêt ? Non, si elles sont uniquement l’occasion de donner lieu à des anecdotes biographiques, voire à de vaines indiscrétions. Oui, si elles donnent à lire des lettres qui reflètent de fortes personnalités, qui portent témoignage de l’Histoire et qui relèvent de la vraie littérature.
Cette édition de la Correspondance 1919-1935 entre Panaït Istrati et Romain Rolland, qui « fera date », comme l’écrit Christian Delrue dans Le Haïdouc de l’été 2019, répond à tous ces critères. D’autant plus que nous avons affaire à un ouvrage très élaboré, une véritable édition scientifique, dans laquelle on peut puiser à satiété. Les notes, références, explications concernant le contexte, comme les annexes (extraits divers, lettres complémentaires, analyse graphologique etc.), renforcent l’authenticité d’un ensemble qui ne comporte « aucune suppression, aucun ajout, aucune modification », reprenant « les autographes originaux ».

Les éditeurs précisent en outre : « Vocabulaire, orthographe, syntaxe ont été conservés en gardant un souci de lisibilité et d’homogénéité. ». C’est là un aspect primordial de ce volume, pour ce qui concerne Panaït Istrati : on peut relever, de moins en moins nombreuses au fil du temps, les erreurs, les maladresses, les « fautes » d’un homme né en Roumanie, qui a beaucoup voyagé et qui a appris le français sur le tard, seul avec ses modèles ; et les conseils encourageants de Romain Rolland, qui n’hésite pas à lui envoyer de petits tableaux de fautes à éviter (« Ne pas dire… mais…), tout en s’enthousiasmant pour le « don de style », le « flot de vie » de son correspondant. Pour qui veut étudier l’évolution linguistique et littéraire d’un écrivain qui s’évertue (et qui parvient admirablement) à passer de sa langue maternelle à une langue d’adoption, c’est une mine. « On ne saura jamais combien de fois par jour je hurle de rage, et m’ensanglante la gueule et brise mes dents en mordant furieusement dans cet outil qui rebelle à ma volonté », écrit-il à son « maître » (les ratures sont d’origine, attestant la fidélité au texte initial). Mais la volonté servira la « Nécessité » d’écrire, et on mesure à la lecture combien Istrati a progressé, et combien cette progression a servi la vigueur de son expression.
Autre aspect primordial : l’Histoire, dont les troubles et les soubresauts provoquèrent une querelle politique et une brouille d’envergure entre deux personnalités de fort tempérament. Pour le rappeler d’une manière schématique, les voyages qu’Istrati fit en URSS lui révélèrent une réalité bien différente de celle qu’il imaginait, lui dont l’idéal social et politique le portait pourtant vers le communisme. Sa réaction « consterne » un Romain Rolland resté fidèle à son admiration pour le régime soviétique. « Rien de ce qui a été écrit depuis dix ans contre la Russie par ses pires ennemis ne lui a fait tant de mal que ne lui en feront vos pages. ». Le temps a montré qui avait raison… Certes, tout n’est pas aussi simple, et l’un des avantages de cette correspondance est de montrer que, sous les dehors d’un affrontement rude et apparemment irrémédiable, certaines nuances sont à prendre en compte. Il y aura d’ailleurs une réconciliation en 1933, même si chacun campe sur ses positions à propos de l’URSS (pour Romain Rolland « le seul bastion qui défend le monde contre plusieurs siècles de la plus abjecte, de la plus écrasante Réaction », pour Panaït Istrati « lieu des collectivités nulles, aveugles, égoïstes » et du « soi-disant communisme »). Malgré cela donc, le pardon et l’amitié l’emportent, peu avant la mort d’Istrati.
Évidemment, il n’y a pas que cela. Il y a les enthousiasmes et l’idéalisme du scripteur en formation devenu auteur accompli, qui contrastent souvent avec la lassitude d’une gloire des Lettres accablée par le travail, les visites, les sollicitations. Il y a, racontées avec la vivacité d’un écrivain passionné, des anecdotes semées de savoureux dialogues et de descriptions pittoresques. Il y a les échanges sur la vie quotidienne, la santé, les rencontres, les complicités, les amitiés, les amours… Et les projets littéraires, les péripéties liées à la publication des œuvres, les relations avec d’autres artistes – tout ce qui fait la vie de deux êtres qui ont en commun la passion généreuse de la littérature. Chacun peut y trouver son compte.
En 1989, parut chez Canevas éditeur une Correspondance intégrale Panaït Istrati – Romain Rolland, 1919-1935, établie et annotée par Alexandre Talex, préfacée par Roger Dadoun. Une belle entreprise, qui cependant se voulait trop « lisible », effaçant les maladresses de l’auteur débutant, les scories, repentirs, ratures… Fallait-il s’en tenir à cette version fort louable, mais partielle et édulcorée ? Non. Daniel Lérault et Jean Rière ont eu raison de s’atteler à une tâche difficile, pleine d’embûches, mais qui a donné un résultat d’une fidélité scrupuleuse et d’une grande envergure historique et littéraire.
Jean-Pierre Longre
En complément :
Le Haïdouc n° 21-22 (été 2019), « bulletin d’information et de liaison de l’Association des amis de Panaït Istrati » est consacré à cette Correspondance. Et l’un des numéros précédents (n° 14-15, automne 2017 – hiver 2018) contient un texte éclairant de Daniel Lérault et Jean Rière sur leur publication. Voir www.panait-istrati.com
17:57 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : correspondance, francophone, roumanie, panaït istrati, romain rolland, daniel lérault, jean rière, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/01/2020
Les Caractères, miroir toujours fidèle
 Jean-Michel Delacomptée, La Bruyère, portrait de nous-mêmes, Robert Laffont
Jean-Michel Delacomptée, La Bruyère, portrait de nous-mêmes, Robert Laffont
Certes, Jean de La Bruyère est un classique, et chacun se rappelle avoir lu, apprécié, étudié l’un ou l’autre des portraits dans lesquels il croque les humains de ses traits de plume ravageurs et savoureux. Mais un classique à part, dont l’œuvre est unique, dans tous les sens du terme : elle est sa seule production littéraire, et la seule dans son genre, même s’il se réclame d’abord du Grec Théophraste.
Jean-Michel Delacomptée nous rappelle cela, dévoilant par la même occasion certains aspects du personnage que faute de témoignages convergents on connaît mal : discret, « fort honnête homme », « maltraité » par la nature… Surtout, l’auteur analyse sans pédanterie, sans susciter l’ennui, bien au contraire, le contenu et la forme des Caractères, en insistant (le titre l’annonce) sur leur intemporalité. Bien sûr, La Bruyère peint toutes sortes de personnages inspirés par ceux qu’il a croisés à la ville et à la cour : le riche qui « s’étale » et le pauvre qui « ne prend aucune place », le bourgeois, le courtisan, le distrait, le glouton, l’égocentrique, l’hypocrite, l’intrigant, les femmes de toutes sortes, le misogyne… Et l’on s’aperçoit vite que, au-delà des aspects circonstanciels, c’est bien le genre humain de toute époque qui est visé, avec une impitoyable lucidité et une ferme volonté morale : « Écrire, pour lui, consistait à dénoncer les iniquités abusives afin de ramener dans la bergerie le troupeau égaré. Douteux succès, il en avait conscience. Mais il se fiait assez à la force des mots pour croire en leur capacité de convaincre les récalcitrants et même les obtus. ».
Corriger les vices, telle était la cause qu’il annonçait en mettant en forme les portraits qu’il composait. Non les vices de tel ou tel en particulier, mais ceux qui rongent la société. Moraliste sévère et conservateur, se situant du côté des Anciens dans la fameuse « Querelle des Anciens et des Modernes », La Bruyère est aussi un remarquable styliste à la plume subtile et acérée : « Les Caractères réalisent la synthèse entre la gravité de la pensée et l’excellence du style naturel, et c’est cette fusion de la forme élégante, foncièrement aristocratique, et du fond sérieux, qui, pour La Bruyère, faisait un écrivain. Et qui continue à le faire. ». Et Jean-Michel Delacomptée, avec la vivacité de son propre style, nous le présente, effectivement, comme un écrivain toujours vivant.
Jean-Pierre Longre
18:20 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, jean-michel delacomptée, la bruyère, robert laffont, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/01/2020
Journal d’une reconstruction
 Lire, relire, 5 ans après... Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, Folio 2019.
Lire, relire, 5 ans après... Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, Folio 2019.
Prix Femina 2018. Prix spécial du jury Renaudot 2018
À l’hôpital de la Salpêtrière, quelques jours après l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie-Hebdo qui lui a emporté la mâchoire, Philippe Lançon, pensant à l’infirmière de nuit qui « avait le prénom d’un personnage de Raymond Queneau », se prend à évoquer deux vers de l’écrivain : « Je crains pas ça tellment la mort de mes entrailles / et la mort de mon nez et celle de mes os ». Quelques strophes plus loin, Queneau écrit ceci, qui pourrait s’appliquer à ce que Lançon tente de dépasser : « Je crains bien le malheur le deuil et la souffrance / et l’angoisse et la guigne et l’excès de l’absence / Je crains l’abîme obèse où gît la maladie / et le temps et l’espace et les torts de l’esprit ».
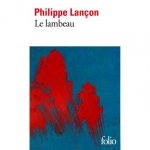 Rescapé de la tuerie dont il fait un récit à la fois terrifiant et subjectif, le récit d’une « abjection » vue du point de vue particulier d’une victime qui attend « simultanément l’invisibilité et le coup de grâce – deux formes de la disparition », l’auteur, journaliste à Charlie-Hebdo et à Libération, consacre le reste des 500 pages de son livre à la reconstruction : celle de sa mâchoire, qui va nécessiter de nombreuses opérations, et celle de sa personne tout entière, corps et esprit. Aucun détail ne nous est caché de ces mois de soins, de greffes, de suintements, de silences, d’interrogations, d’espoirs, de souffrances, d’attente au long desquels Chloé, sa chirurgienne, prend une importance médicale et humaine de plus en plus grande. L’entourage aussi tient une place prépondérante dans l’accompagnement du « patient » : son frère, ses parents, son ex-femme Marilyn, sa compagne Gabriela, ses nombreux et chaleureux amis ; et la lente progression du récit de la réparation, avec ses hauts et ses bas, est si prégnante, les précisions sanitaires et psychologiques si circonstanciées que nous, lecteurs, sommes complètement pris dans la nasse, au point de nous confondre avec l’auteur adressant ses plaintes au corps médical : « Docteur, vous m’écoutez ? La jambe et le pied droit me font mal, la cuisse droite aussi, plus encore la nuit que le jour. Le simple contact du drap m’irrite le pied entier et m’empêche de dormir. Les nerfs semblent à vif. La malléole me fait particulièrement souffrir. […] Le menton, de plus en plus envahi par les fourmis, est vivant. J’en suis venu à croire que je pense par le menton. Heureusement, je pense peu. ». Nous sommes avec lui, pleinement.
Rescapé de la tuerie dont il fait un récit à la fois terrifiant et subjectif, le récit d’une « abjection » vue du point de vue particulier d’une victime qui attend « simultanément l’invisibilité et le coup de grâce – deux formes de la disparition », l’auteur, journaliste à Charlie-Hebdo et à Libération, consacre le reste des 500 pages de son livre à la reconstruction : celle de sa mâchoire, qui va nécessiter de nombreuses opérations, et celle de sa personne tout entière, corps et esprit. Aucun détail ne nous est caché de ces mois de soins, de greffes, de suintements, de silences, d’interrogations, d’espoirs, de souffrances, d’attente au long desquels Chloé, sa chirurgienne, prend une importance médicale et humaine de plus en plus grande. L’entourage aussi tient une place prépondérante dans l’accompagnement du « patient » : son frère, ses parents, son ex-femme Marilyn, sa compagne Gabriela, ses nombreux et chaleureux amis ; et la lente progression du récit de la réparation, avec ses hauts et ses bas, est si prégnante, les précisions sanitaires et psychologiques si circonstanciées que nous, lecteurs, sommes complètement pris dans la nasse, au point de nous confondre avec l’auteur adressant ses plaintes au corps médical : « Docteur, vous m’écoutez ? La jambe et le pied droit me font mal, la cuisse droite aussi, plus encore la nuit que le jour. Le simple contact du drap m’irrite le pied entier et m’empêche de dormir. Les nerfs semblent à vif. La malléole me fait particulièrement souffrir. […] Le menton, de plus en plus envahi par les fourmis, est vivant. J’en suis venu à croire que je pense par le menton. Heureusement, je pense peu. ». Nous sommes avec lui, pleinement.
Le récit n’est pas pour autant égocentré. Outre la leçon de courage et l’éloge du personnel hospitalier, nous avons affaire à une émouvante et pittoresque galerie de portraits : ceux des familiers, mais aussi ceux de pas mal d’inconnus, soignants et soignés, hommes et femmes croisés en chemin, policiers chargés de la protection de celui qui reste une cible potentielle, policiers pour qui il se prend d’une amitié reconnaissante, quand ce n’est pas d’une complicité souriante, silhouettes entrevues, toute une humanité bien campée dans son environnement ou perdue dans l’incertain. Et l’écriture acérée, poétique, chargée de sens ou pétrie de questions de Philippe Lançon est à bonne école. On ne le trouve jamais sans son Proust, son Kafka ou son Thomas Mann, qu’il emporte jusqu’au bloc pour lire et relire ses passages favoris ; sans oublier la musique : Bach le plus souvent possible (Les Variations Goldberg, Le Clavier bien tempéré, L’Art de la Fugue), le jazz aussi… Le lambeau n’est pas une simple « hostobiographie » (pour reprendre le mot-valise d’Alphonse Boudard), mais le roman d’une tranche de vie personnelle qui vaut toutes les destinées (comme l’a écrit Sartre cité par Lançon : « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. »), toutes les destinées donc, avec leurs inévitables paradoxes : alors que l’auteur, jouissant de ses premiers instants de vraie liberté, peut enfin rejoindre sa compagne à New-York, éclate l’attentat du 13 novembre 2015 à Paris. Même de loin, c’est un nouveau « décollement de conscience ».
Jean-Pierre Longre
09:09 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, philippe lançon, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/12/2019
Tableaux poétiques
 Paul Stubbs, Visions de l’outre-monde, recueil bilingue, traduction de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, éditions hochroth Paris, 2019
Paul Stubbs, Visions de l’outre-monde, recueil bilingue, traduction de l’anglais (Grande-Bretagne) par Blandine Longre, éditions hochroth Paris, 2019
Inspirés par des tableaux de Francis Bacon, les textes ici traduits sont extraits de The End of the Trial of Man (Arc, 2015), inédit en français (Ceux de l’outre-monde).
Paul Stubbs, poète et éditeur britannique, est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes et d’essais poétiques.
Extrait :
– Aussi, quel est au juste ce lieu
où je suis détenu ? une sacristie
secrète et souterraine
du Vatican ?
une cage de paille dans un zoo ? ou simplement
quelque laboratoire ?
10:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, anglophone, paul stubbs, blandine longre, éditions hochroth paris | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/12/2019
Un polar malicieux
 Sophie Chabanel, Le Blues du chat, Le Seuil /Cadre noir, 2019
Sophie Chabanel, Le Blues du chat, Le Seuil /Cadre noir, 2019
Le chat n’est pas le héros de l’histoire, mais un comparse distrayant et problématique, dont le « blues » ira jusqu’à nécessiter la consultation d’un comportementaliste… Pour la commissaire Romano, le problème est cependant secondaire, car elle a sur les bras une enquête délicate ; elle concerne la mort d’un certain François-Xavier Tourtier, ancien banquier volage et véreux, qui paraît s’être assagi en s’intéressant à la fabrication de fours solaires. Empoisonné, semble-t-il, au jus de crevette… Sa jeune épouse Ariane, veuve rapidement consolable, un prêtre aussi séduisant que hors normes, un grand-père compréhensif, un associé idéaliste, un trader menaçant – les suspects ne manquent pas et la pression des autorités pèse de plus en plus sur les enquêteurs.
Romano, commissaire atypique, dont la vie professionnelle passe avant toutes considérations sentimentales, mais qui ne crache pas sur un aller-retour Lille-Porto pour une visite éclair à son amant du moment, Romano, donc, secondée par son adjoint Tellier, dont les opinions parfois exacerbées détonnent dans la police, et par Clément, aussi fidèle et timide que grassouillet, mène l’enquête avec une ardeur qui la fait parfois franchir les limites de la légalité, mais qui s’avère efficace. Elle s’en sort toujours, et ne se laisse pas abattre par les colères du divisionnaire Bertin.
Le suspense est habilement ménagé, le ton est plaisant, le style alerte. Un polar impeccablement écrit, malicieux, qui ne donne ni dans la violence excessive ni dans la mièvrerie, et que l’on peut trouver – qualificatif étonnant pour le genre, concédons-le – apaisant.
Jean-Pierre Longre
23:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, sophie chabanel, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
05/12/2019
« Il n’est de solution à rien »
 Cioran, Divagations, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Arcades Gallimard, 2019
Cioran, Divagations, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Arcades Gallimard, 2019
Débusqué à Paris (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet), cet ensemble d’écrits, qui « date vraisemblablement de 1945 », selon Nicolas Cavaillès, est l’une des dernières œuvres rédigées par Cioran dans sa langue maternelle, avec d’autres « Divagations », publiées en 1949, ainsi que Fenêtre sur le Rien (voir ci-dessous). Ensuite, ce sera Précis de décomposition puis les autres grands textes écrits en français et publiés dans les Œuvres (Gallimard /Pléiade).
Cioran est adepte du fragment, et ce volume resté à l’état de brouillon lui permet, en pratiquant la brièveté, de s’exprimer en toute liberté, quitte à se contredire parfois – mais le paradoxe est l’une de ses figures favorites (voir : « Entre une affirmation et une négation, il n’y a qu’une différence d’honorabilité. Sur le plan logique comme sur le plan affectif, elles sont interchangeables. »). La brièveté va de pair avec le sens aigu de la formule tendant vers la perfection : « Les pensées devraient avoir la perfection impassible des eaux mortes ou la concision fatale de la foudre. » ; et quoi qu’il en soit, « il n’est de solution à rien ». Ce qui n’empêche pas qu’on surprenne ce sceptique absolu à explorer le versant poétique (bien que sombre) du monde en prenant part « aux funérailles indéfinies de la lumière » et à « la cérémonie finale du soleil », ou en découvrant « un sonnet indéchiffrable » dans « l’harmonie de l’univers ».
Bref (c’est le cas de l’écrire), les grands thèmes de la philosophie et de la morale cioraniennes se succèdent en ordre aléatoire au fil des pages : la vie (qui n’a « aucun sens », mais « nous vivons comme si elle en avait un »), la mort, Dieu (qui reste à « réaliser »), la révolte (« vaine », mais « la rébellion est un signe de vitalité »), la douleur, la solitude, la tristesse (engendrée notamment par « la pourriture secrète des organes »), cette tristesse inséparable du « dor » roumain, langueur, nostalgie, « ennui profond » de l’inoccupation – tout cela, que l’on pourrait énumérer en maintes citations, est à peine, parfois, adouci par l’idée d’un sursis : celui, par exemple, de l’amour, « notre suprême effort pour ne pas franchir le seuil de l’inanité », ou de la musique, capable de « nous consoler d’une terre impossible et d’un ciel désert », « la musique – mensonge sublime de toutes les impossibilités de vivre ».
Gardons donc l’espoir – en particulier celui de continuer à lire Cioran : il a beau être « en proie au vieux démon philosophique », gardons-le précieusement, brouillon ou pas, inachèvement ou non, roumain ou français, comme un inimitable écrivain.
Jean-Pierre Longre
 Simultanément, paraît chez le même éditeur un autre ouvrage de Cioran :
Simultanément, paraît chez le même éditeur un autre ouvrage de Cioran :
Fenêtre sur le rien, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, Gallimard Arcades, 2019
Présentation de l’éditeur :
Avec Divagations, ce recueil exceptionnel constitue la dernière œuvre de Cioran écrite en roumain. Vaste ensemble de fragments probablement composés entre 1941 et 1945, ce recueil inachevé et inédit commence par une sentence programmatique : « L'imbécile fonde son existence seulement sur ce qui est. Il n'a pas découvert le possible, cette fenêtre sur le Rien... » Voilà sept ans que Cioran « [moisit] glorieusement dans le Quartier latin », la guerre a emporté avec elle ses opinions politiques et sa propre destinée a toutes les apparences d'un échec : le jeune intellectuel prodigieux de Bucarest a beaucoup vieilli en peu de temps, passé sa trentième année ; il erre dans l'anonymat des boulevards de Paris et noircit des centaines de pages dans de petites chambres d'hôtel éphémères. Fenêtre sur le Rien constitue un formidable foyer de textes à l'état brut, le long exutoire d'un écrivain de l'instant prodigieusement fécond. Dès les premières pages, un thème s'impose : La femme, l'amour et la sexualité - terme rare sous la plume de Cioran -, qui surprend d'autant plus qu'il est l'occasion de confessions exceptionnelles : « Je n'ai aimé avec de persistants regrets que le néant et les femmes », écrit-il. On lit aussi, tour à tour, des passages sur la solitude, la maladie, l'insomnie, la musique, le temps, la poésie, la tristesse. Chaque fragment se referme sur lui-même, et l'on note un souci croissant du bien-dire, du style. Peu de figures culturelles, réelles ou non, apparaissent ici, mais dessinent un univers contrasté et puissant : Niobé et Hécube, Adam et Ève, Bach (pour Cioran le seul être qui rende crédible l'existence de l'âme), Beethoven, Don Quichotte, Ruysbroeck, Mozart, Achille, Judas, Chopin, et les romantiques anglais. Errance métaphysique d'une âme hantée par le vide mais visitée par d'étonnantes tentations voulant la ramener du néant à l'existence, ce cheminement solitaire et amer trouve encore un compagnon de déroute en la figure du Diable, régulièrement invoqué, quand l'auteur n'adresse pas ses blasphèmes directement à Dieu...
11:23 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, roumanie, cioran, divagations, nicolas cavaillès, arcades gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/11/2019
Contes du monde comme il va
 Manuel Anceau, Lormain, Ab irato, 2019
Manuel Anceau, Lormain, Ab irato, 2019
Comme c’était le cas avec son recueil précédent, Livaine (dont Lormain, nous dit-on à juste titre, est le pendant masculin), Manuel Anceau donne à ses nouvelles des allures de contes – et pas seulement des allures. En effet, si les récits sont au départ enracinés dans le réel (un village avec ses rumeurs et ses secrets, le monde de l’entreprise et ses pratiques implacables, la famille et ses non-dits, la campagne investie par les promoteurs, la vie scolaire et ses brutalités, les transports en commun, l’angoissante disparition d’une fillette – on en passe), ce réel se transforme, par le jeu des mots et des phrases (et aussi par celui des noms propres), en imaginaire, à la limite du merveilleux ou du fantastique, sans vraiment franchir la frontière.
Il y a ici des portraits et des situations de toutes sortes, qui se succèdent et se superposent hardiment, étrangement, inexorablement. Les personnages attachants sont souvent les proies d’êtres rebutants, qui leur ressemblent pourtant un peu, ou qui les gangrènent petit à petit. Et l’inverse peut se produire. Les situations confortables ou rassurantes ne le restent pas longtemps, en général ; et ce n’est pas toujours de la faute des gens ; ce peut être à cause du monde comme il va (à la réflexion, c’est presque toujours le cas). Car la plupart des gens, même ceux qui n’inspirent pas confiance, sont des victimes : de la souffrance, du deuil, du malheur, de l’incompréhension, de la solitude, des mystères de la vie et de la mort, du destin…
Au-delà des intrigues, de leurs ombres portées et de leurs prolongements, ce qui est remarquable dans ces nouvelles (ces contes), c’est leur style. Un style qui n’a pas son pareil pour faire d’une histoire qui ailleurs revêtirait les oripeaux de la banalité quotidienne une plongée dans les profondeurs de l’âme et dans les tourbillons de la société. Les hommes ont tous leurs mystères (les animaux aussi, ainsi que les arbres et les plantes, le ciel, le jour et la nuit), et les phrases de Manuel Anceau les explorent, ces mystères, en suivant les chemins détournés et méconnus d’une syntaxe pleine de sauts, de pauses et de rebonds, de détours et de contours. Un seul exemple : « Et c’est ainsi que, ce lundi matin, marchant très tôt déjà dans les rues : je le vis venir vers moi ; vers moi, par accident pensai-je aussitôt : étant ce matin-là le seul bonhomme à marcher sur ce trottoir, il fallait bien que son impatience à dire ce qu’il avait vu, ou cru voir, trouvât un déversoir – et ce déversoir ce furent mes oreilles ; vers moi, seul à marcher sur ce trottoir ; étais-je pour autant le premier être humain à qui ce matin-là il aura parlé ? ». À nous, lecteurs, de recevoir les mots comme si nous étions les premiers à les lire.
Jean-Pierre Longre
18:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, conte, récit, francophone, manuel anceau, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
03/11/2019
Une trilogie en petits morceaux
 Lire, relire...
Lire, relire...
Pierre Autin-Grenier, Je ne suis pas un héros suivi de Toute une vie bien ratée et de L'éternité est inutile, La Table ronde, Petite vermillon, 2019
Toute une vie bien ratée, Gallimard, 1997. Folio, 1999
Pierre Autin-Grenier, né à Lyon il y a quelques dizaines d’’années, décédé en 2014, circulait entre les mots comme il circulait entre les lieux (imaginaires ou réels, Lyon ou la Provence…) et entre les années (lointaines ou immédiates), avec une délicieuse nonchalance et une émouvante incertitude.
Les textes de Toute une vie bien ratée sont écrits comme en marge, notes laissées au hasard de l’humeur, aux lisières, aux limites : limite des genres (nouvelles, journal intime, souvenirs ?), limite des registres (du réalisme au fantastique, du minimalisme au lyrisme, du comique au tragique), et certains titres à eux seuls annoncent tout un programme : « Je n’ai pas grand-chose à dire en ce moment » ; « Des nouvelles du temps » ; « Rêver à Romorantin » ; « Toute une vie bien ratée » ; « Tant de choses nous échappent ! » ; « On ne sait pas vraiment où l’on va » ; « Souvent je préfère parler tout seul » ; « Je suis bien nulle part » ; « Inutile et tranquille, définitivement »… On sent bien que la fausse désinvolture cache de vraies angoisses, des « questions de plomberie existentielle », les grands problèmes que les hommes se posent entre naissance et mort, avec la (trompeuse ?) consolation de ne pas dramatiser la situation : « Quoi de plus sain, en effet, que de regarder tranquillement le temps passer sans la moindre prétention à vouloir le rattraper ? », et de rester « inutile et tranquille, définitivement ».
 Mais il y a aussi et surtout la question de l’écriture : « Aujourd’hui me voici à l’âge des bilans ; je m’interroge, la nuit, pour savoir ce qui a bien pu m’entraîner dans cette activité de perdant : aligner des mots à la queue leu leu sur une page blanche dans l’espoir insensé d’en faire des phrases ! » À lire Autin-Grenier, on s’aperçoit pourtant vite que les mots ne sont pas alignés au petit bonheur la chance, et que l’oisiveté revendiquée est plutôt une disponibilité, celle du véritable écrivain qui travaille avec passion et acharnement à laisser venir et prendre corps le seul matériau dont il dispose : les mots. Et ces mots, agencés plutôt qu’alignés, prennent une épaisseur telle que remplissant les pages, ils réalisent l’espoir insensé non seulement de faire des phrases, mais, au-delà des incertitudes génériques, de faire chanter la poésie.
Mais il y a aussi et surtout la question de l’écriture : « Aujourd’hui me voici à l’âge des bilans ; je m’interroge, la nuit, pour savoir ce qui a bien pu m’entraîner dans cette activité de perdant : aligner des mots à la queue leu leu sur une page blanche dans l’espoir insensé d’en faire des phrases ! » À lire Autin-Grenier, on s’aperçoit pourtant vite que les mots ne sont pas alignés au petit bonheur la chance, et que l’oisiveté revendiquée est plutôt une disponibilité, celle du véritable écrivain qui travaille avec passion et acharnement à laisser venir et prendre corps le seul matériau dont il dispose : les mots. Et ces mots, agencés plutôt qu’alignés, prennent une épaisseur telle que remplissant les pages, ils réalisent l’espoir insensé non seulement de faire des phrases, mais, au-delà des incertitudes génériques, de faire chanter la poésie.
L’éternité est inutile, Gallimard, « L’arpenteur », 2002.
Un jour, Pierre Autin-Grenier, après avoir tâté de différents métiers auxquels seule une destinée mesquine semblait le vouer, et avoir finalement opté pour le métier d’auteur de « chronique douce-amère des saisons et des jours », Pierre Autin-Grenier donc (ou en tout cas celui qui, sous sa plume, parle de soi à la première personne) eut l’idée de posséder un beau bureau, instrument et emblème de sa vocation. Le Centre national du livre, sollicité, eut la « générosité » de financer l’exécution de cette « pièce unique », ce pourquoi l’auteur lui adresse en toutes lettres sa reconnaissance.
Faisons-le nous aussi. Car c’est de ce bureau, vraisemblablement, que nous sont envoyés les 17 récits de L’éternité est inutile. Des matins cafardeux inaugurant des journées qui se traînent, entre une campagne sans horizon et une société marchande sans perspective, aux vastes rêves qui chamboulent l’univers et ses habitants, qui révolutionnent le passé et l’avenir – et pourquoi pas le présent – , en passant par les petits gestes qui fendillent ne serait-ce qu’un instant le brouillard de la vie quotidienne, nous suivons les méandres d’une existence où le poids du réel s’accroche aux ailes de l’imaginaire : « Jour et nuit depuis, d’une planète l’autre, ainsi s’évade et s’invente ma vie, tantôt pour de vrai, tantôt pour de rire, comme au théâtre ».
Nous entrons dans un monde où la proclamation récurrente de l’inutilité de l’éternité, comme de la vanité de la bourse de New York ou de Tokyo, du CAC 40 et de l’indice Nikkei, ponctue des promenades à la fois grandioses et modestes entre rêves, doutes et souvenirs, entre exploits à la Blériot, moments d’amour et ambition d’insecte : « C’est comme ça que mettant un pied devant l’autre et encore bizarrement d’aplomb sur mes deux jambes, j’en viens parfois tout doucement à me demander au cours de mes rêveries par quel étrange phénomène je me suis trouvé involontairement mêlé à l’aventure humaine, ce que je suis venu faire parmi vous, si brillants d’esprit et de grâce si distinguée, sachant accorder à merveille les participes passés et cuisiner pareillement la lotte à l’américaine, moi qui n’ai même pas les yeux bleus ni même un petit je ne sais quoi du charme de la coccinelle ».
Voilà qui nous vaut des instants délectables de lecture, promis par des titres alléchants (au hasard : « Le cri inutile de la crevette », « L’intranquillité par le presse-agrumes électrique », « La campagne, les marchands de machins et les adventistes du septième jour », « Une entrecôte drôlement politisée », « Loin des cannibales »...), le tout à se mettre en bouche lentement, à savourer comme un latricières-chambertin bien décanté en pichet ou comme un ris de veau en cassolette et, tout compte fait, comme un objet artistique qui, bouleversant nos vues, peut nous faire dire à la manière de ceux qui « font la nique à l’ordre établi » : « Nous croyons en nos rêves ». Car l’écriture est là, le mot choisi et choyé, la phrase peaufinée, le paragraphe ample, l’image à la fois précise et inattendue, parlante et étincelante, qui guette le lecteur au coin des pages, le surprend et le séduit.
Après d’autres œuvres poétiques et narratives, après la trilogie – à paraître bientôt, paraît-il, en Folio – composée de Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée et L’éternité est inutile, espérons avec l’impatience des enfants d’autres histoires de cet acabit qui pourront continuer à titiller notre imagination. L’auteur nous le promet : « Je raconterai tout cela dans mon prochain livre ».
Je ne suis pas un héros, Gallimard, 1993, Folio, décembre 2002
A peine paru L’éternité est inutile, troisième volume d’une trilogie dont l’unité réside en particulier dans la tonalité mi-figue mi-raisin de textes brefs à la première personne et que d’aucuns font entrer dans le genre de « l’autofiction », à peine donc avons-nous éprouvé avec Pierre Autin-Grenier l’inutilité des illusions humaines, que nous avons la possibilité de remonter le temps. Je ne suis pas un héros, premier volume de ladite trilogie, après Toute une vie bien ratée qui pourtant n’était que le deuxième (décidément, un beau désordre qui nous fait naviguer à vue), existe en « Folio ».
Heureuse réédition, mettant à la portée du plus grand nombre les histoires généreuses et désespérées d’un écrivain qui, sans qu’on sache vraiment quand il parle de lui et quand « je » est un autre, nous parle finalement de nous, les lecteurs qui pour la plupart ne sommes pas non plus des héros.
Sous des traits humoristiques qui tentent d’occulter une vraie pudeur, sous une pseudo-tranquillité et une fausse oisiveté qui cachent et laissent entrevoir la révolte et le désespoir, on retrouve avec les délices de l’appréhension et le plaisir d’un léger masochisme les motifs révélateurs d’une écriture malicieuse et décapante. Pierre Autin-Grenier n’hésite d’ailleurs pas à avouer les affres et les rêves de l’écrivain, qui se compare volontiers et en toute autodérision à Marcel Proust et, cherchant parfois avec difficulté à « dénicher le mot qui, d’un tour de clef, [lui] eût ouvert une phrase », ne dévoile pas volontiers ses secrets, les gardant « bien au froid sous [son] cœur de pierre ». On renoue volontiers avec ce non-héros (pas vraiment un anti-héros) qui est content quand, le soir, « les monstres arrivent », qui, « après avoir rêvé à une littérature grandiose, [se] retrouve sur le coup des onze heures écossant des petits pois dans une bassine en plastique sans avoir pu tirer une seule ligne », et qui n’hésite pas à opposer à l’uniformité accablante du monde les rêves les plus débridés.
Sous l’égide du « rire panique » dessiné par Topor et illustrant la couverture de cette réédition, on découvre ce qu’on n’avait pas assez vu il y a dix ans, lors de la première parution de Je ne suis pas un héros : la prose de Pierre Autin-Grenier, la suite le confirme, c’est de la poésie.
Jean-Pierre Longre
https://www.editionslatableronde.fr/Domaine/La-Petite-Ver...
17:46 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, pierre autin-grenier, gallimard, l’arpenteur, folio, la table ronde, petite vermillon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
L’écriture contre la mort
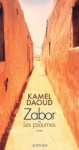 Lire, relire...
Lire, relire...
Kamel Daoud, Zabor ou Les psaumes, Actes Sud, 2017, Babel, 2019
Zabor ou Les psaumes est un livre si dense qu’une fois déverrouillée la lourde porte qui y donne accès on a du mal à en sortir, du mal aussi à en parler, a fortiori à le commenter. Il faudrait en citer des pans entiers pour rendre compte de son style, de sa teneur, de sa portée. Disons ceci : Zabor, presque trente ans, « célibataire et encore vierge » (même s’il porte un amour muet à sa voisine Djemila, répudiée par son mari donc socialement réprouvée), chassé par son père comme un bâtard et recueilli par sa tante Hadjer, compréhensive et aimante, vit en marge de la communauté de son village. Respecté parce que son père est un riche boucher, rejeté par ses demi-frères et moqué par les enfants, il est aussi une figure admirée, parce qu’il sait faire reculer la mort : lorsque quelqu’un en est proche, on fait appel à lui pour écrire au chevet du moribond, remplir un cahier de mots, de phrases, d’histoires dont lui seul a le secret. « Cela dure depuis des années, et j’ai fini par comprendre les règles du jeu, instaurer des rites et des ruses pour aboutir à cette formidable conclusion que ma maîtrise de la langue, cette langue fabriquée par mes soins, est non seulement une aventure mais surtout une obligation éthique. ».
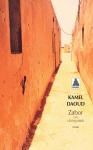 Les trois cents pages du roman tournent autour du récit de l’agonie de son père, Hadj Brahim. Malgré leur animosité, les demi-frères viennent en dernier recours chercher Zabor pour qu’il repousse sa mort. Mission quasiment sacrée : « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l’immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution. ». C’est à la fois sa puissance et son drame.
Les trois cents pages du roman tournent autour du récit de l’agonie de son père, Hadj Brahim. Malgré leur animosité, les demi-frères viennent en dernier recours chercher Zabor pour qu’il repousse sa mort. Mission quasiment sacrée : « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l’immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution. ». C’est à la fois sa puissance et son drame.
Comment ce don lui est-il venu ? Cloîtré dans sa chambre, ne sortant que la nuit, Zabor a déchiffré tous les livres qu’il trouvait dans la langue des anciens colons, le français. « Ce fut toute une aventure que d’apprendre, seul, en cachette, la troisième langue de l’ange, la pièce manquante à la loi de la Nécessité qui allait sauver tant de vies, ajouter mille et un jours à chaque rencontre, dans le secret, humblement, et dans l’art de l’écriture. ». Et plus loin : « Cette langue eut trois effets dans ma vie : elle guérit mes crises, m’initia au sexe et au dévoilement du féminin, et m’offrit le moyen de contourner le village et son étroitesse. C’étaient là les prémices de mon don, qui en fut la conséquence. ». À partir de là, ce sont des centaines de cahiers qu’il emplit de son écriture serrée, qu’il enterre la nuit dans la campagne environnante comme pour en nourrir la terre et les racines des arbres, et qui deviennent une œuvre inépuisable, flot continu faisant une sorte de suite au Coran, à la Bible, aux Mille et une Nuits, et même à Robinson Crusoë, à L'île au trésor ou à La chair de l’orchidée (pour ne citer que les titres les plus importants de son incomparable bagage).
La trame de Zabor propose des cheminements dans le dédale de l’existence, en trois étapes : « Le corps », « La langue », « L’extase ». On pourrait penser aussi : la mort, l’écriture, la vie (ou l’inverse ?). En tout cas, Kamel Daoud offre ici à chaque lecteur une nourriture inépuisable, un chant infini, des « psaumes » aux confins du profane et du sacré.
Jean-Pierre Longre
17:44 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, kamel daoud, actes sud, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
Fureur et nostalgie
 Lire, relire... Pierre Autin-Grenier, Friterie-bar Brunetti, Gallimard, L’arpenteur, 2005, La Table ronde, Petite vermillon, 2019
Lire, relire... Pierre Autin-Grenier, Friterie-bar Brunetti, Gallimard, L’arpenteur, 2005, La Table ronde, Petite vermillon, 2019
Les souvenirs conduisent Pierre Autin-Grenier dans le quartier de la Guillotière, à Lyon, où dans les années 1960 se côtoient la fine fleur du populaire et de jeunes apprentis poètes préparant la révolution. Il y a là, dans la Friterie-bar « fondée en 1906 au 9 de la rue Moncey et aujourd’hui disparue », Madame Loulou qui réchauffe les cœurs et les corps de son « marin », de son « ancien commis aux Halles » ou de son « banquier » ; le grand Raymond fort en gueule et en muscles ; Domi qui a eu bien des malheurs, dont la vocation policière de son fils n’est pas le moindre ; Ginette qui, ayant passé sa vie en mal d’amour à servir les autres, trouve maintenant refuge aux bons soins de Renée et du père Joseph ; le narrateur, grand lecteur de fond de salle, fourbissant ses armes d’écrivain…
 La Friterie Brunetti, c’est un peu le « vieux bistrot » de Brassens, les zincs de Prévert, ces lieux où l’on ne fabrique pas une convivialité aseptisée, mais où l’amitié bonhomme est naturelle, dans les vapeurs d’anarchie et de gros rouge, dans la brume des fumées de tabac fort. Atmosphère assurée, et quand on en sort on en profite pour parcourir la ville, de la « Fosse-aux-ours » (récemment devenue chantier) à Saint-Paul, en passant par la « passerelle du Palais » et le quai Romain-Rolland. C’est la nostalgie du Lyon de naguère, du temps où l’on ne se perdait pas encore entre les parkings et les tours de verre et de béton (comme celle qui fait maintenant barrière entre la place du Pont et la rue Moncey).
La Friterie Brunetti, c’est un peu le « vieux bistrot » de Brassens, les zincs de Prévert, ces lieux où l’on ne fabrique pas une convivialité aseptisée, mais où l’amitié bonhomme est naturelle, dans les vapeurs d’anarchie et de gros rouge, dans la brume des fumées de tabac fort. Atmosphère assurée, et quand on en sort on en profite pour parcourir la ville, de la « Fosse-aux-ours » (récemment devenue chantier) à Saint-Paul, en passant par la « passerelle du Palais » et le quai Romain-Rolland. C’est la nostalgie du Lyon de naguère, du temps où l’on ne se perdait pas encore entre les parkings et les tours de verre et de béton (comme celle qui fait maintenant barrière entre la place du Pont et la rue Moncey).
Nostalgie, mais aussi révolte radicale et salutaires envolées contre l’ordre établi. Celui d’alors (« On sentait bien qu’aux relents de graillon qui souvent imprégnaient jusqu’à nos chaussures venaient se mêler, à nous étourdir, de forts parfums d’insurrection »), et surtout celui d’aujourd’hui, assuré par « les bourgeois, les beaufs, les banques et les charognards de l’immobilier », celui qui a supprimé les « vrais bistrots » au profit des cafétérias et des Mac Do. L’auteur s’en donne à cœur joie, à rage ouverte, à bile déversée, dans cet adieu désespéré aux « petits Rimbaud » des « bouis-bouis de banlieue », aux « gentils pochards en perpétuel manque de piccolo », à ces « havres de grâce tombés dans les filets d’aigrefins de la finance ».
Du désespoir, vraiment ? Un peu, mâtiné de colère roborative. Il y a surtout un hymne à ces hauts lieux d’humanité que sont les cafés, les vrais, ceux qui, selon George Steiner cité en postface, « caractérisent l’Europe ». Et l’on sait bien que Lyon est une ville européenne.
Jean-Pierre Longre
https://www.editionslatableronde.fr/Catalogue/la-petite-v...
17:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, pierre autin-grenier, gallimard, l’arpenteur, la table ronde, petite vermillon, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/10/2019
Haletant
 Max Annas, Enfer blanc, traduit de l’allemand par Mathilde Sobottke, Belfond, 2019
Max Annas, Enfer blanc, traduit de l’allemand par Mathilde Sobottke, Belfond, 2019
C’est un banal incident de la vie quotidienne. Moses, jeune étudiant qui vient d’aider son professeur à trier ses livres, s’apprête à rejoindre sa petite amie quand il tombe en panne de voiture. Batterie de téléphone déchargée. Il ne lui reste plus qu’à aller chercher de l’aide derrière de hauts murs qui bordent la route. Il arrive à se faufiler par le portail d’entrée, et commence à parcourir la résidence dans laquelle il se trouve. Mais voilà… Nous sommes en Afrique du Sud, et Moses est noir. Certes, l’apartheid est officiellement aboli depuis de nombreuses années, mais le racisme est toujours présent dans l’esprit et les réactions de certains blancs plus enclins à manier la matraque qu’à utiliser les ressources de la réflexion et de l’empathie. Pour corser le tout, un couple de cambrioleurs a pénétré dans la même résidence et a commencé à visiter des maisons et à y voler des objets précieux.
Tout s’enclenche. Des espèces de miliciens locaux ont repéré Moses, des habitants ont constaté le vol de leurs bijoux – et une folle poursuite commence pour le jeune homme, qui utilise toutes ses ressources physiques et mentales pour échapper à une troupe de plus en plus nombreuse, puis à la police, tandis que les cambrioleurs, qui ont fait une découverte macabre, tentent de se cacher de dangereux malfrats et de la police… Bref, le récit, de plus en plus oppressant, met en scène victimes, bourreaux, coupables, innocents, habitants, employés de maison, dans le contexte d’un quartier réservé à une certaine classe sociale et ultrasécurisé – pas tant que cela tout compte fait, puisqu’au prix d’une grande habileté et d’efforts désespérés on peut s’y cacher… « Moses fonça à travers la haie, l’épaule la première. Son tee-shirt se déchira sur le côté. Il marcha à quatre pattes jusqu’à l’ombre de la maison suivante. Pas le temps de regarder plus attentivement. Derrière la maison, une autre rue. Maintenant, ils allaient patrouiller partout, il ne pourrait plus rester longtemps à découvert. Il se dirigea à l’arrière de la maison. Il ne comptait plus le nombre de maisons derrière lesquelles il s’était faufilé en catimini. ».
Tout cela se passe en quelques heures – unité de temps –, dans un périmètre très circonscrit – unité de lieu –, et l’action progresse vers un tragique sanglant dont on ne dévoilera pas ici le dénouement. Une progression quasiment théâtrale, ou cinématographique, qui fait alterner les focalisations (Moses, les cambrioleurs, les poursuivants…) en brefs chapitres au souffle aussi court que celui du fuyard ; et la noirceur du propos est renforcée par le contexte d’un pays que l’auteur connait bien, dans lequel les relations humaines sont loin d’être apaisées, et où la haine absurde et la violence raciste sont encore monnaie courante. Un roman haletant, à tous points de vue.
Jean-Pierre Longre
18:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, allemagne, max annas, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/10/2019
Retrouver les traces de l'essentiel
Patrick Modiano, Nos débuts dans la vie, Gallimard, 2017
Lire, relire... Souvenirs dormants, Gallimard, 2017, Folio 2019
Malgré les errances urbaines qui sillonnent ses livres, malgré la fugacité des personnages et des événements, Patrick Modiano ne laisse pas au pur hasard le soin de bâtir ses récits en forme de puzzles à trous. « Je tente de mettre de l’ordre dans mes souvenirs. Chacun d’eux est une pièce de puzzle, mais il en manque beaucoup, de sorte que la plupart restent isolées. Parfois, je parviens à en rassembler trois ou quatre, mais pas plus. Alors, je note des bribes qui me reviennent dans le désordre, listes de noms ou de phrases très brèves. Je souhaite que ces noms comme des aimants en attirent de nouveaux à la surface et que ces bouts de phrases finissent par former des paragraphes et des chapitres qui s’enchaînent », écrit-il dans Souvenirs dormants.
 Marque de cette volonté de guider la construction littéraire : la parution simultanée d’une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie, et d’un récit, Souvenirs dormants, qui se complètent mutuellement et se répondent l’un l’autre. Le même protagoniste, Jean, dont les bribes de vies relatées dans les deux ouvrages ressemblent à ce que l’on sait de l’auteur, avec ses « débuts » dans la littérature, des épisodes biographiques qui en rappellent d’autres, le réveil de « souvenirs » qui ont quelque chose à voir avec un passé plus ou moins connu.
Marque de cette volonté de guider la construction littéraire : la parution simultanée d’une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie, et d’un récit, Souvenirs dormants, qui se complètent mutuellement et se répondent l’un l’autre. Le même protagoniste, Jean, dont les bribes de vies relatées dans les deux ouvrages ressemblent à ce que l’on sait de l’auteur, avec ses « débuts » dans la littérature, des épisodes biographiques qui en rappellent d’autres, le réveil de « souvenirs » qui ont quelque chose à voir avec un passé plus ou moins connu.
Nos débuts dans la vie est un livre tout entier occupé par le théâtre : dans sa forme bien sûr, mais aussi dans l’art de mettre le genre en abyme : Jean, écrivain débutant, dialogue avec Dominique, qui joue dans La Mouette de Tchekhov (et dont la présence justifie le « nous » du titre) ; de la loge de Dominique, on peut entendre ce qui se passe sur la scène. Dans le théâtre voisin, la mère de Jean joue une pièce de boulevard. Rivalités, jalousie, surveillance et menaces de l’amant de la mère… On pourrait être en plein mélodrame à suspense. Mais il y a la mémoire, les jeux de lumière, la poésie des dialogues, et ce mélange de rêve et de réalité particulier à la prose de Modiano, et qui ici nous fait sortir du cadre du théâtre pour nous mener vers un « hors-scène » onirique : vers la pièce de Tchekhov (et aussi L’inconnue d’Arras d’Armand Salacrou), et vers des lieux parisiens : « Nous marchons tous les deux dans différents endroits de Paris… Nous ne parlons pas, mais je sais qu’elle m’a reconnu… Nous longeons les lacs du bois de Boulogne, et même nous prenons la barque jusqu’au Chalet des Îles… Nous ne disons pas un mot et, dans mon rêve, cela me semble naturel… ».

 Ces mots pourraient figurer dans Souvenirs dormants, qui relate une série de rencontres féminines que le narrateur, Jean, toujours lui, a faites dans sa jeunesse, et dont il retrouve les traces souvent fugaces dans sa mémoire et dans ses carnets. Rencontres rassurantes, presque maternelles, sur lesquelles plane l’ombre occulte du guide spirituel Gurdjieff, ou rencontres inquiétantes et mystérieuses mêlant Jean à un meurtre. Rencontres récurrentes aussi, réveillant des souvenirs qui, effectivement, dormaient. Tout cela permet quelques constats sur soi-même, frisant l’auto-analyse : « Au cours de cette période de ma vie, et depuis l’âge de onze ans, les fugues ont joué un grand rôle. Fugues des pensionnats, fuite de Paris par un train de nuit le jour où je devais me présenter à la caserne de Reuilly pour mon service militaire, rendez-vous auxquels je ne me rendais pas, ou phrases rituelles pour m’esquiver […]. Aujourd’hui, j’en éprouve du remords. Bien que je ne sois pas très doué pour l’introspection, je voudrais comprendre pourquoi la fugue était, en quelque sorte, mon mode de vie. Et cela a duré assez longtemps, je dirais jusqu’à vingt-deux ans. ». Là encore, aux souvenirs se mêlent les rêves, dont certains sont précisément rapportés.
Ces mots pourraient figurer dans Souvenirs dormants, qui relate une série de rencontres féminines que le narrateur, Jean, toujours lui, a faites dans sa jeunesse, et dont il retrouve les traces souvent fugaces dans sa mémoire et dans ses carnets. Rencontres rassurantes, presque maternelles, sur lesquelles plane l’ombre occulte du guide spirituel Gurdjieff, ou rencontres inquiétantes et mystérieuses mêlant Jean à un meurtre. Rencontres récurrentes aussi, réveillant des souvenirs qui, effectivement, dormaient. Tout cela permet quelques constats sur soi-même, frisant l’auto-analyse : « Au cours de cette période de ma vie, et depuis l’âge de onze ans, les fugues ont joué un grand rôle. Fugues des pensionnats, fuite de Paris par un train de nuit le jour où je devais me présenter à la caserne de Reuilly pour mon service militaire, rendez-vous auxquels je ne me rendais pas, ou phrases rituelles pour m’esquiver […]. Aujourd’hui, j’en éprouve du remords. Bien que je ne sois pas très doué pour l’introspection, je voudrais comprendre pourquoi la fugue était, en quelque sorte, mon mode de vie. Et cela a duré assez longtemps, je dirais jusqu’à vingt-deux ans. ». Là encore, aux souvenirs se mêlent les rêves, dont certains sont précisément rapportés.
Souvenirs réels, souvenirs rêvés… Patrick Modiano continue à fouiller méthodiquement le passé afin de retrouver les traces de l’essentiel.
Jean-Pierre Longre
17:21 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, roman, francophone, patrick modiano, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/10/2019
Une année particulière
 Irina Teodorescu, Ni poète ni animal, Flammarion, 2019
Irina Teodorescu, Ni poète ni animal, Flammarion, 2019
Carmen I., la narratrice, est née en 1979, comme Irina Teodorescu. Comme elle, elle avait dix ans lors de la fameuse « révolution » qui a chassé et liquidé le couple de tyrans qui verrouillait le pays. Maintenant avocate à Paris, Carmen apprend la mort de celui qu’elle appelait le « Grand Poète », ou « Ma Terre », qui l’appelait « Ma Fugue » et jouait un grand rôle non seulement dans sa vie à elle, mais aussi dans celle de la Roumanie, puisque, journaliste et dissident politique, il tenait une place non négligeable dans le pays nouvellement débarrassé des Ceauşescu (surtout de cette « présidente qui avait fait de son mari un homme dépendant. »).
Alors elle se souvient de l’époque où elle était la « Petite Xénoppe » de sa mère, et son récit déroule les événements qui vont de mars 1989 à février 1990, en prenant appui sur trois générations de femmes : Dani, la grand-mère, que l’on connaît par les « notes informatives » de l’hôpital psychiatrique où elle est périodiquement suivie et interrogée ; Ema, ou Em, la mère, qui se confie régulièrement à des K7 qu’elle enregistre à l’intention d’une amie exilée en Amérique ; et Carmen, donc, qui à dix ans vivait la vie d’une écolière roumaine, séjournait parfois à la montagne, et même écrivait des poèmes dans l’esprit politique du temps, dont l’un à la gloire du Parti, qui « avait remplacé Dieu et était, on nous l’avait assez martelé, notre père à tous » - poème qui lui valut les félicitations de « la camarade maîtresse ». Mais on le sait, la fin de l’année 1989 fut d’une tout autre teneur, avec les événements sanglants que connut le pays – coup d’État ou Révolution, ou moitié-moitié ? Les discussions s’animent entre Carmen et le Grand Poète. « Je lui expliquais alors que les événements de 1989 avaient été à la fois une révolution et un coup d’État, que je le savais grâce à mon point de vue distancié ; que les gens comme lui, j’entendais originaires du même pays, ne pouvaient accepter, tant d’années après, que la révolution avait été en même temps un coup d’État, que les gens comme lui – et comme ma mère, ajoutais-je pour le rassurer – se sentaient dépossédés de leur histoire dès qu’on évoquait cette hypothèse double. ».
Ni poète ni animal n’est pas un récit historique ou autobiographique. Ces deux aspects y sont certes contenus. Mais c’est avant tout un roman poétique, ou, disons, qui poétise le passé personnel et collectif, sans recourir à l’illusoire linéarité que l’on attribue aux souvenirs. Construction élaborée qui tient compte de la complexité de la mémoire, de ses allées et venues, de la distance qu’elle entretient avec les événements – distance qui n’occulte pas le tragique, mais qui n’exclut pas l’humour, même morbide. Il faut lire par exemple le récit de cette journée de Noël 1989, où le cochon familial fut tué, « nettoyé et découpé », tandis qu’étaient fusillés « la dictatrice et son mari »… D’où la résolution de la fillette : « Avant de m’endormir, je me promis de manger le plus de cochon possible. ». Les bêtes, d’ailleurs, cochon, renard, éléphant et beaucoup d’autres, tiennent une place prépondérante dans le mécanisme de la narration. Et Carmen/Irina, dans le style plein de surprises qui n’appartient qu’à elles deux, de conclure en évoquant « Ma Terre » qui l’incitait à se « repoétiser » : « Je choisis mon camp : ni poète ni animal, mais les deux réunis. ».
Jean-Pierre Longre
22:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, roumanie, irina teodorescu, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
24/09/2019
Comment garder les couleurs du temps ?
 Lionel-Édouard Martin, Tout était devenu trop blanc, le Réalgar, 2019
Lionel-Édouard Martin, Tout était devenu trop blanc, le Réalgar, 2019
Dans le village de M***, le narrateur, qui lorsqu’il était étudiant en lettres avait trouvé un petit emploi de guide au musée municipal, avait par la même occasion appris que les peintres locaux ne manquèrent pas à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et c’est à partir de l’évocation de l’un d’entre eux, Charles Desmassoures, et du récit de Marceline, vieille employée de cuisine née en 1890, que nous connaissons la vie de Charles du Puy du Pin de la Chambue, surnommé Popotame à cause de sa forte corpulence, et dont, sans qu’on le sache à M***, les toiles « s’arrachaient à Drouot, à Sotheby’s, chez Christie’s, pour des centaines de milliers de francs, de livres, de dollars ».
Fils hors normes d’une famille de hobereaux poitevins, dont les particules ne cachent pas complètement l’ascendance paysanne, Charles se révèle très jeune singulièrement doué pour la création artistique, sorte de « Mozart de la peinture ». Sur les conseils de mademoiselle Romanoz, la préceptrice familiale, Desmassoures, marchand de liqueurs et peintre du dimanche déjà cité, par ailleurs assez bien introduit dans les milieux de la bohème artistique parisienne, commence à lui enseigner les rudiments, et voilà notre Popotame parti quotidiennement dans la campagne avec son matériel. « Dès avril prenant la poudre d’escampette, traînant par les prairies tout son barda, chargé comme un baudet, tout sur le dos. La silhouette de profil, c’est la silhouette de l’écureuil debout sur ses pattes, trottinant roux, maladroit, bossu, vers la noisette ; et la noisette, c’est le bout de paysage exploré de l’œil bleu, vaguement expert, l’arbre incliné, pensif, vers le ruisseau, la mare triturée par les grenouilles, le talus gras clouté de ficaires, violettes, pervenches. Il s’arrête, ayant trouvé l’endroit. ». Avec cela, passionné par le Douanier Rousseau, dont il garde toujours avec lui, comme un « nain-nain » de bébé, la reproduction d’une gouache.
Ainsi passe le temps avec ses péripéties et ses bouleversements, le début du siècle, la guerre de 14-18, les années folles, sans que Charles quitte le domaine et son chevalet, vivant « des jours paisibles à la Chambue, sans rien qui rompît la monotonie d’une existence vouée sans partage à la peinture. » Jusqu’à ce qu’une paire de jumeaux dont Charles souffrait mal le voisinage se mettent en tête d’exploiter le sable dont regorge la campagne, dont ils couvrent ainsi les couleurs d’un blanc uniforme et poudreux… Que faire contre le blanc industriel et le noir des corbeaux (les « grolles ») qui infestent les environs et que l’on retrouvera « attablés » dans les entrailles du cadavre de Charles ?
Touchante et terrible, cette histoire de Popotame et de sa famille, que nous propose Lionel-Édouard Martin dans le style à la fois rustique et chantourné qu’il prête à la cuisinière Marceline, à qui le narrateur laisse souvent la parole. Dans un mélange d’élaboration quasiment savante et de simplicité populaire, l’auteur nous offre sa syntaxe bousculée par une poésie tour à tour rocailleuse et fleurie, verdoyante et accidentée, mettant carrément sous nos yeux les toiles de Charles du Puy du Pin de la Chambue et les fragiles couleurs de la campagne.
Jean-Pierre Longre
08:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, éditions le réalgar, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/09/2019
Le fabuleux destin de Laurent Mourguet
 Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
Paul Fournel, Faire Guignol, P.O.L., 2019
La mère de Paul Fournel, lorsqu’il était enfant, lui enjoignait d’arrêter de « faire Guignol ». Sans connaître le personnage, il se doutait qu’il « incarnait tout ce qui turbule, tout ce qui impertine, tout ce qui pique, tout ce qui ricane en souriant. ». Plus tard, intéressé entre autres par le fonctionnement des langues et du langage, il observa ce personnage de plus près, et fit des recherches poussées sur son histoire et celle de ses comparses, Gnafron, la Madelon et les autres. Il en fit même une thèse. Mais rassurez-vous, Faire Guignol (d’ailleurs qualifié de « roman ») n’est pas un pensum universitaire.
C’est au contraire le récit plein de verve, truffé de mots et d’expressions du parler lyonnais, d’une vie exceptionnelle : celle de l’inventeur de Guignol, Laurent Mourguet (1769-1844). Fils de canut, marié tout jeune à l’amoureuse, compréhensive et soucieuse Jeanne, père de famille nombreuse, il a tâté d’un peu tous les métiers pour faire bouillir la marmite. Crocheteur, marchand ambulant, arracheur de dents, il découvre finalement la manipulation des marionnettes, dont Polichinelle et Colombine sont de fameux représentants. De la manipulation à la fabrication, il n’y a qu’un pas : d’un bloc de bois naît un jour Gnafron, le cordonnier porté sur la bouteille ; puis arrive le personnage central, qui donne de l’air à son créateur, et qui vivra longtemps, très longtemps. « Chance et prix de votre patience, vous êtes les premiers à voir Guignol ! Le voici pour la première fois en son castelet, tout jeune et débutant. Mourguet l’a ganté sur sa main gauche, et de la droite il tient Gnafron. Ces deux lascars vont devenir inséparables. C’est juste un essai pour Mourguet, mais c’est un grand jour pour l’histoire du théâtre, et vous y assistez ! ».
 À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
À partir de là, « les yeux et les oreilles » de tous seront emplis des spectacles de Laurent Mourguet, des marionnettes fabriquées avec l’aide de Jeanne pour les costumes. Certes, les vicissitudes matérielles, la nécessité des déplacements, les diktats de la censure (car oui, Guignol est généreux, chaleureux, gentil, mais bien impertinent, et il sait et il dit qui sont les méchants), toutes les difficultés imaginables se mettent en travers du destin de nos marionnettes et de leurs manipulateurs. Mais le public est là, qui en redemande, et si Mourguet va étoffer sa propre troupe (famille et compagnons), les guignols (parfois de pâles et vulgaires imitations) fleurissent de tous côtés.
Oui, cela se confirme à la lecture : la vie de Laurent Mourguet est un véritable roman, et l’œuvre qu’il nous a laissée (dont les textes ont été heureusement recueillis – car leur auteur ne savait pas écrire) est trop universelle pour être oubliée, trop vivante pour mourir. Paul Fournel nous en fournit d’ailleurs, ponctués de photos quasiment parlantes, quelques échantillons colorés, engagés et pétulants, tout en rappelant le contexte historique de son élaboration, et en glissant çà et là quelques anecdotes savoureuses, quelques détails bien utiles, comme la naissances des « mères », ces grandes dames de la cuisine lyonnaise (qui ont maintenant leur « parvis » du côté de la Part-Dieu), comme les révoltes des canuts, ou comme l’ouverture en 1836 de la brasserie Georges, « le plus grand restaurant de France ». Et puis à ce propos, n’hésitons pas à accepter ce que Paul Fournel, en fin connaisseur, nous offre : « Enfin, vous allez être récompensés et réchauffés par un bon repas. Il était temps. C’est le prix de votre patience. Lyon est le moyeu d’une roue gourmande qui n’en finit pas de tourner. Au nord les vins de Bourgogne et du Beaujolais, les viandes du Charolais. Ensuite et en tournant vers la droite, les volailles de Bresse, les poissons, écrevisses et grenouilles de la Dombes, les fromages de la Savoie, les noix de Grenoble, les fruits, les légumes, les fromages et les vins de la vallée du Rhône, les châtaignes de l’Ardèche, les saucissons, les jésus, les fromages et la prune de la Haute-Loire, les céréales de la Loire et les salaisons des monts du Lyonnais. La roue tourne et tout descend vers la ville et ses marchés. ».
Bon appétit, bonne lecture, bons spectacles !
Jean-Pierre Longre
17:10 Publié dans Essai, Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, biographie, francophone, lyon, paul fournel, p.o.l., jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/09/2019
Deux cent quarante nuances de bleu
 Maggie Nelson, Bleuets, traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy, Éditions du sous-sol, 2019
Maggie Nelson, Bleuets, traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy, Éditions du sous-sol, 2019
« Pourquoi le bleu ? Les gens me posent souvent cette question. Je ne sais jamais comment y répondre. Il ne nous est pas donné de choisir qui l’on aime, ai-je envie de dire. Nous n’avons pas le choix, voilà tout. ». Car oui, Maggie Nelson l’avoue d’emblée, elle est « tombée amoureuse d’une couleur » – le bleu, donc. Et voilà que, sous sa plume, naissent des anecdotes, des citations, des adresses à un amant absent, des citations, des fragments poétiques, maintes pensées qui, à l’instar de celles de Pascal, se posent sur la page sans suite apparente, mais dont le double fil conducteur est bien composé du couple formé par le bleu et l’amour.
Certes, il n’en est pas toujours question ; les propos peuvent porter sur la maladie, la dépression, la mort, le sexe, l’absence, l’art, la peinture, la littérature, les phénomènes linguistiques, et sur le regard, celui qui perçoit le monde et en tire des impressions inattendues – comme celles de cet homme qui, ayant recouvré la vue à la suite d’une opération, ne cacha pas sa déception : « Il trouvait le monde terne, les écailles de peinture et autres imperfections le contrariaient ; il aimait les couleurs vives et les voir perdre de leur éclat le déprimait. » ; finalement, « il mourut de tristesse ». Mais immédiatement après, l’auteure écrit tout de même que « ça vaut la peine de garder les yeux ouverts. ».
Les paradoxes de ce genre sont fréquents dans l’ouvrage. Voyons entre autres l’évocation de la « petite fleur bleue » que le héros du roman de Novalis Henri d’Ofterdingen passe sa vie à chercher : c’est sa grande aventure, son grand espoir. Or les fleurs bleues, nous dit encore Maggie Nelson, sont peut-être « un bouquet de mensonges éhontés » (perspective à prendre en compte, par exemple, dans le roman de Queneau Les fleurs bleues…).
Livre scintillant de ses 240 facettes, livre en couleurs, livre d’amour (perdu ? retrouvé ?), Bleuets a toutes les caractéristiques de l’œuvre d’art, au plein sens du terme. Une œuvre d’art qui se contemple en surface et en profondeur, en long et en large, et dans laquelle le regard et l’esprit n’en finissent pas de trouver, avec méthode ou au hasard, en allers et en retours, de nouvelles lumières.
Jean-Pierre Longre
23:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, anglophone, maggie nelson, céline leroy, Éditions du sous-sol, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/08/2019
Les amours et les livres
 Graham Swift, Le dimanche des mères, traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek, Gallimard, 2017, Folio, 2019
Graham Swift, Le dimanche des mères, traduit de l’anglais par Marie-Odile Fortier-Masek, Gallimard, 2017, Folio, 2019
Jane et Paul sont amants. Amants cachés, car elle est une petite servante, et lui un jeune aristocrate destiné à épouser Emma, de même classe sociale que lui. Jane et Paul « avaient fait des tas de choses ensemble, dans des tas de lieux secrets. ». Mais ce 30 mars 1924, leurs ébats sont exceptionnels : c’est le « dimanche des mères », jour de l’année où les domestiques sont en congé pour la journée. Jane n’ayant pas de mère à voir, puisqu’elle a été abandonnée toute petite, les deux jeunes gens ont une matinée entière pour se voir, sans doute pour la dernière fois : Paul doit se marier deux semaines après. Elle le sait, et tous deux vont en profiter le plus intensément possible. Après quoi Paul va partir retrouver sa fiancée, laissant Jane seule dans la grande demeure familiale, qu’elle va explorer minutieusement dans le plus simple appareil, comme pour y laisser la trace indélébile de son corps.
 Des événements imprévus et dramatiques vont marquer ce dimanche, discrètement annoncés au détour de certaines phrases. Le destin de Jane, devenue naturellement servante après avoir été élevée à l’orphelinat, et qui a découvert les livres dans la bibliothèque de ses maîtres, va changer à partir de là. La lecture des grands auteurs (Joseph Conrad en particulier) et l’écriture littéraire vont être son avenir, jusqu’à un âge avancé. « Née en 1901 – l’année, au moins, devait être exacte –, elle grandirait pour devenir domestique, ce que le premier venu aurait pu prédire. Mais qu’elle devînt écrivain, cela, personne ne l’aurait prédit. Y compris les membres bienveillants de la direction de l’orphelinat qui l’avaient fait naître un premier mai sous le nom de Jane Fairchild. Et sa mère encore moins que quiconque. ».
Des événements imprévus et dramatiques vont marquer ce dimanche, discrètement annoncés au détour de certaines phrases. Le destin de Jane, devenue naturellement servante après avoir été élevée à l’orphelinat, et qui a découvert les livres dans la bibliothèque de ses maîtres, va changer à partir de là. La lecture des grands auteurs (Joseph Conrad en particulier) et l’écriture littéraire vont être son avenir, jusqu’à un âge avancé. « Née en 1901 – l’année, au moins, devait être exacte –, elle grandirait pour devenir domestique, ce que le premier venu aurait pu prédire. Mais qu’elle devînt écrivain, cela, personne ne l’aurait prédit. Y compris les membres bienveillants de la direction de l’orphelinat qui l’avaient fait naître un premier mai sous le nom de Jane Fairchild. Et sa mère encore moins que quiconque. ».
Graham Swift a l’art de décrire des événements apparemment simples en allant au fond des choses, en posant les questions justes et en esquissant des réponses laissées à la réflexion des lecteurs : sur l’amour, la mort, la société, la littérature, sur les rapports entre réalité et fiction… Et Le dimanche des mères est certes un roman, mais un roman qui, comme dans le théâtre classique, obéit à la règle des trois unités : unités de temps (un seul jour), de lieu (entre deux maisons de maîtres, Beechwood et Upleigh), d’action (le basculement du destin de Jane). Surtout, cette journée unique dans la vie de la petite servante lui a fait franchir des barrières et lui a ouvert un bel avenir.
Jean-Pierre Longre
23:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, graham swift, marie-odile fortier-masek, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
30/07/2019
« Tu me trouveras »
 Dario Franceschini, Ailleurs, traduit de l’italien par Chantal Moiroud, Gallimard/L’arpenteur, 2017, Folio, 2019
Dario Franceschini, Ailleurs, traduit de l’italien par Chantal Moiroud, Gallimard/L’arpenteur, 2017, Folio, 2019
Iacopo Dalla Libera, petit notaire des environs de Mantoue, en apprend de belles : son père mourant, auquel il a succédé dans sa respectable étude, lui révèle qu’il a eu cinquante-deux autres enfants de cinquante-deux femmes différentes : « Cinquante-deux putains, Iacopo. Des femmes libres et merveilleuses. Elles avaient besoin d’argent pour vivre et j’avais besoin d’elles pour donner la vie. ». Tout est dans ces deux adjectifs qui vont peu à peu révéler leur force à Iacopo : « Libres » et « merveilleuses ».
Car il décide d’obéir aux injonctions de son père en menant une enquête, au début de laquelle, à Ferrare, il rencontre Mila, « merveilleuse » jeune femme qui ne lui cache pas son métier, mais lui révèle, justement, ce que c’est que d’être « libre ». Cette enquête lui montre aussi que la vie n’est ni aussi simple ni aussi terne que ce qu’il croyait. « Il y a les histoires secrètes et vraies de quantité de pauvres gens qui ont passé leur vie à se cacher : voleurs, ratés, amants, prêtres défroqués, enfants illégitimes, putains, prisonniers. », lui dit un vieil homme qui conserve les secrets de tous ces braves gens. Et Iacopo apprendra bien d’autres choses à propos de son père (son père, vraiment ?), de sa femme (dont la rigidité quotidienne cache un tempérament de feu), de lui-même, de l’humanité ; il apprendra que la vie du peuple, malgré la pauvreté, est bien plus exaltante que l’existence compassée des petits notables…
 Roman au ton alerte et sensible, joyeux et grave, Ailleurs est aussi un roman un peu fou, dira-t-on. Oui, un peu fou sans doute, mais au propos duquel on ne peut que donner raison. Mila la jeune prostituée est bien plus « dans la vie » que Iacopo le petit notaire ne l’était jusqu’à ce qu’il la connaisse. « Mais pourquoi donc, s’était maintes fois demandé Iacopo, racontait-il tous les secrets de sa famille à une putain ? Peut-être parce qu’il faisait confiance à Mila comme à personne d’autre auparavant, avait-il songé. Elle était pure intérieurement et Iacopo savait que tout avait changé dans sa vie depuis qu’il l’avait rencontrée. ». La vie cache bien des choses. Mais une fois qu’on s’en est aperçu, au lieu de succomber à un moralisme mortifère, on peut savoir ce qu’est le véritable amour, et se laisser dire : « Si un jour tu veux me voir, tu me trouveras. ».
Roman au ton alerte et sensible, joyeux et grave, Ailleurs est aussi un roman un peu fou, dira-t-on. Oui, un peu fou sans doute, mais au propos duquel on ne peut que donner raison. Mila la jeune prostituée est bien plus « dans la vie » que Iacopo le petit notaire ne l’était jusqu’à ce qu’il la connaisse. « Mais pourquoi donc, s’était maintes fois demandé Iacopo, racontait-il tous les secrets de sa famille à une putain ? Peut-être parce qu’il faisait confiance à Mila comme à personne d’autre auparavant, avait-il songé. Elle était pure intérieurement et Iacopo savait que tout avait changé dans sa vie depuis qu’il l’avait rencontrée. ». La vie cache bien des choses. Mais une fois qu’on s’en est aperçu, au lieu de succomber à un moralisme mortifère, on peut savoir ce qu’est le véritable amour, et se laisser dire : « Si un jour tu veux me voir, tu me trouveras. ».
Jean-Pierre Longre
17:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, italie, dario franceschini, chantal moiroud, gallimardl’arpenteur, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
22/07/2019
De qui Chestov est-il le nom ?
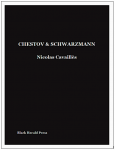 Nicolas Cavaillès, Chestov & Schwarzmann, Black Herald Press, 2019
Nicolas Cavaillès, Chestov & Schwarzmann, Black Herald Press, 2019
À la question ci-dessus, Nicolas Cavaillès, dont les livres ramassent et condensent en quelques dizaines de pages ce que d’autres développent en de gros traités ou de gras romans, répond d’une manière personnelle, originale et séduisante. D’aucuns diront que le « philosophe tragique » (selon Fondane), cet « obsédé de l’impossible » (selon Cavaillès) est vu par le petit bout de la lorgnette, ce que ne semble pas démentir l’introduction en forme de dédicace à Norman Manea, puisque l’auteur y annonce modestement des « scènes et anecdotes », des « singularités, incidents, faits divers puisés entre les lignes de sa légende » ; mais la lorgnette, tout de même, cherche à « illustrer l’incompréhensible ou l’insoluble », et y parvient parfaitement.
Il y a, oui, de petits morceaux d’existence de celui qui vécut « écartelé entre deux chutes connexes : celle d’une brique sur lui et sa propre glissade dans le néant » et avait peur, après avoir prononcé un discours, de « tomber à terre » parce qu’on lui aurait ôté sa chaise (supposition bouffonne mais angoissante), ce Chestov qui s’appelait en réalité Lev Isaakovitch Schwarzmann (et Nicolas Cavaillès ne se prive pas de décortiquer ce nom et les raisons supposées du changement), comme s’il y avait deux personnes en une, ou une personne « fissurée », divisée en deux : un Chestov « né Schwarzmann » ou un « Schwarzmann né en Chestov »… De quoi « se cogner le front contre le mur », mais surtout de quoi suivre les tribulations d’un philosophe qui aura tenté de franchir les murs qui enferment la liberté, de trouver la faille qui lui aura permis de partir « là-bas ».
Bref, à partir de là, le récit, qui adopte le tutoiement à la fois intime et respectueux, devient plus biographique. Le « là-bas » en question est la Palestine, où Chestov s’est rendu en 1936 avec « certaines attentes, informulées, inconscientes, invisibles », mais où « tu retrouves ta croix, ton épreuve intérieure, ton martyre personnel, aux yeux de tous car ils en font partie, mais surtout dans les sables mouvants de ta solitude. ». Chemin faisant, l’auteur nous gratifie de pages poétiques sur ce pays où la beauté des paysages n’occulte pas les incessants conflits dont ils sont le terrain depuis la nuit des temps, où on ne sait plus « qui est l’infidèle de qui ». C’est en tout cas une « Palestine intérieure », indescriptible, indicible, que Chestov (ou Schwarzmann ?) gardera de son périple, et nous de notre lecture.
Jean-Pierre Longre
21:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, récit, francophone, nicolas cavaillès, chestov, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/07/2019
Amour et disparition
 Philippe Vilain, Un matin d’hiver, Grasset, 2019
Philippe Vilain, Un matin d’hiver, Grasset, 2019
C’est une belle histoire d’amour qui se noue entre deux universitaires, elle (la narratrice) enseignante en littérature française, lui (Dan Peeters) sociologue américain en poste en France, bel homme, simple et bon. « Je ne trouvais pas à Dan de défauts importants, et je n’ai jamais décelé en lui de médiocrité. ». Une histoire d’amour racontée avec délicatesse, qui semble pouvoir se prolonger indéfiniment, dans une sorte de bonheur « consolidé » par le mariage et la naissance d’une petite fille, Mary. « Je songeais à la chance que j’avais d’avoir rencontré Dan et de partager sa vie, à la surprise de voir que notre couple résistait au temps. ».
Pour ses recherches sur la représentation du racisme, Dan doit périodiquement faire des voyages à Atlanta, et sa femme s’en accommode, même s’il ne lui dit rien de ce qu’il y fait. Un jour où il a accepté qu’elle l’accompagne à l’aéroport, il s’envole pour un énième voyage, et contrairement à son habitude ne donne pas de nouvelles. Il n’en donnera plus. Alors commence une longue quête angoissée qui n’aboutit à rien. Sur place, à Atlanta, elle se fait en compagnie et avec l’aide des parents de Dan ; à Paris, en épluchant ses courriers, ses mails, les études qu’il a publiées – et en égrenant toutes les hypothèses : il a pu être assassiné par un gang au cours de ses recherches ; il a peut-être décidé de changer complètement de vie ; aurait-il été un agent de la CIA infiltré dans des bandes criminelles ? Des années et des années d’attente, de suppositions, de tourments… Et comment faire admettre à la petite Mary, qui devient progressivement une adolescente, que son père ne réapparaîtra pas ? Ne pas penser que « sa disparition fût volontaire » : « C’est à cause de Mary que je n’ai pas voulu y penser, parce que je n’imagine pas qu’un père, aimant comme l’était Dan, puisse abandonner son enfant, pourtant cette probabilité existe bel et bien. ».
Ce roman, écrit avec une sobriété tendue par l’émotion, est dédié « à la confidente d’un jour », c’est-à-dire à cette femme qui a « confié son histoire » à l’auteur. Celui-ci s’est livré à un « travail de recomposition », en laissant le lecteur régler à sa manière le « suspens » des phrases, « des mots qui n’arrivent pas à se dire », mais un « suspens » que la narration aide à lever, sans résoudre l’énigme. Car, comme l’écrit Philippe Vilain, les histoires « sont simplement ce que nous faisons d’elles, je dirais même qu’elles sont belles de ce que nous faisons d’elles et de ce qu’elles font de nous : belles des surprises qu’elles nous offrent et des découvertes qu’elles nous font faire, […] belles des peurs qu’elles nous font surmonter, belles de ce qui nous arrive et de ce qu’elles nous font devenir. ».
Jean-Pierre Longre
19:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, philippe vilain, grasset, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/06/2019
« Instantanés »
 Brèves n° 114, L’atelier du Gué, 2019
Brèves n° 114, L’atelier du Gué, 2019
« C’est la vie… telle qu’elle va… cocasse et dramatique, pathétique, surprenante, drôle et belle, et pourtant si triste et quand même si riche d’amour, bref si diverse, si changeante. Insaisissable, on la vit par petits bouts, sans avoir de plan d’ensemble, tout occupé qu’on est à se laisser déborder par nos émotions, nos distractions. La nouvelle, elle, est habile à saisir ces moments de nos vies. Elle fige ceux où tout bascule et se dévoile ; comme ces photographies qui mettent en lumière le point de non-retour d’un destin, comme ces récits qui s’arrêtent à la limite d’un futur dans lequel ils se gardent bien de pénétrer. »
Nouvelles inédites :
Antoine Mocquet - Marlène Deschamps - Viviane Campomar - Bertrand Ruault - Carole Paplorey - Anna-Livia Marchionni - Suzanne Prat - Sophie Allainguillaume -valnet.c Alain Imoléon - Nicole Buresi - Laurence Chauvy - Elisabeth Pacchiano - Jean-Pierre Longre - Natalie Barsacq - Laura Schmitz - Albert Vidal - Colette Le Gallou
Vente par correspondance :
Brèves, 1, rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude (paiement par chèque - envoi franco)
Dif’Pop - http://www.pollen-difpop.com/A-86979-breves-n114-instanta...
Version numérique : http://www.scopalto.com/revue/breves
Vente en librairie: diffusion Dif’Pop / Pollen 81 Rue Romain-Rolland 93260 LES LILAS
22:32 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, brèves, atelier du gué | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
11/06/2019
La maison de l’attente
 Gaëlle Josse, Une longue impatience, Les éditions Noir sur Blanc, Notabilia, 2018, J'ai lu, 2019
Gaëlle Josse, Une longue impatience, Les éditions Noir sur Blanc, Notabilia, 2018, J'ai lu, 2019
« Ma maison à moi, c’est l’attente. C’est l’océan et le bateau de Louis. Quelque part sur une mer du monde. L’incertitude comme seul point fixe. Sous mes gestes de chaque jour, il n’y a que du vide. De la place pour les songes apportés par le vent, pour les mots racontés par les flots. ».
Pendant la guerre, le bateau d’Yvon a été bombardé par la RAF. Dommage collatéral, dirait-on aujourd’hui, qui a bouleversé la vie d’Anne, sa femme, et de Louis, son fils. Remariée après la Libération à Étienne, le pharmacien du village, mère de deux autres enfants, Anne a accepté sans enthousiasme mais avec tendresse pour sa nouvelle famille l’embourgeoisement de sa nouvelle existence. La mésentente progressive, devenant brutale, entre Étienne et Louis fait un jour fuir celui-ci ; sans avertir, il s’engage sur les bateaux de commerce parcourant les mers d’un continent à l’autre.
 Sans nouvelles de son fils, Anne entame une attente d’abord pleine d’espoir, se métamorphosant en déception et en « longue impatience ». Retournant chaque jour dans son « ancienne maison, la bicoque adossée contre le vent, avec ses volets bleus fatigués, sur la lande, à l’entrée du sentier douanier qui surplombe la mer », elle emplit cette attente des souvenirs du passé – ses deux mariages, bien différents l’un de l’autre, les années heureuses, les duretés de la guerre –, et des rêves d’avenir : surtout le banquet qu’elle préparera pour le retour de son fils, et dont elle détaille progressivement le contenu dans les lettres qu’elle lui écrit comme on lance une bouteille à la mer (« Monsieur Louis Le Floch, en mer »). Une infinie promesse, qu’elle tisse de jour en jour, de mois en mois, d’année en année, à l’insu de tous.
Sans nouvelles de son fils, Anne entame une attente d’abord pleine d’espoir, se métamorphosant en déception et en « longue impatience ». Retournant chaque jour dans son « ancienne maison, la bicoque adossée contre le vent, avec ses volets bleus fatigués, sur la lande, à l’entrée du sentier douanier qui surplombe la mer », elle emplit cette attente des souvenirs du passé – ses deux mariages, bien différents l’un de l’autre, les années heureuses, les duretés de la guerre –, et des rêves d’avenir : surtout le banquet qu’elle préparera pour le retour de son fils, et dont elle détaille progressivement le contenu dans les lettres qu’elle lui écrit comme on lance une bouteille à la mer (« Monsieur Louis Le Floch, en mer »). Une infinie promesse, qu’elle tisse de jour en jour, de mois en mois, d’année en année, à l’insu de tous.
D’une grande sensibilité, le récit de Gaëlle Josse, qui renouvelle la thématique de l’attente féminine déclinée sur différents plans depuis celle de Pénélope, nous fait pénétrer dans l’âme complexe, touchante et attachante d’une femme dont la vie est tout entière tendue vers l’amour, celui des vivants et celui des disparus, surtout celui du fils absent, enfoui au plus profond de son cœur, peu à peu débordant tout. De même, débordant le cadre du simple récit à la première personne, la poésie des paysages extérieurs et intérieurs, de l’océan, des saisons, de la mémoire, de l’« immuable cercle » du temps qui passe.
Jean-Pierre Longre
15:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, gaëlle josse, les Éditions noir sur blanc, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/06/2019
« Croire en quelque chose »
 Tomislav Zajec, Il faudrait sortir le chien, traduit du croate par Karine Samardžija, préface d’Eugène Durif, éditions L’espace d’un instant, 2018.
Tomislav Zajec, Il faudrait sortir le chien, traduit du croate par Karine Samardžija, préface d’Eugène Durif, éditions L’espace d’un instant, 2018.
Au théâtre, c’est bien simple : le spectateur voit se dérouler sous ses yeux, par le seul intermédiaire de personnes en chair et en os évoluant dans un espace à la fois symbolique et bien réel, une histoire souvent réduite à ses péripéties essentielles. Simple, vraiment ? Pas si sûr, pourrait-on rétorquer. Car c’est bien le langage des personnages (dialogues, monologues, gestes, déplacements), augmenté des éléments scéniques, qui constitue le récit que le spectateur doit construire plus ou moins consciemment dans l’instant de la représentation. Sans compter que souvent ce spectateur est un lecteur…
Et que parfois, un personnage se trouve être à la fois narrateur et acteur du récit. C’est le cas pour « l’homme », le personnage principal de la pièce de Tomislav Zajec. Lorsqu’il prend la parole, il parle de lui-même à la troisième personne, se racontant comme s’il n’était pas là, devant nous, en train d’agir (ou d’attendre), ce qui ne l’empêche pas de dialoguer avec les deux autres personnages : son ex-compagne, qu’il avait quittée brusquement et qu’il retrouve sous un abribus ; son père, ancien traducteur bougon qui doit recevoir une prestigieuse récompense et qui a pour cela besoin que son fils lui achète une cravate… Formulées ainsi, les relations entre « l’homme » et les deux autres personnages semblent anodines, ressassant des détails de la vie quotidienne. Mais justement, ces détails s’inscrivent sur le rideau qui cache et révèle le fond de la scène de théâtre. Le temps, par exemple, va et vient comme pour faire d’un seul après-midi une vie tout entière. Et l’important réside dans ce qui n’a jamais été dit, qui affleure dans les dialogues, les monologues et les questions ; « Le questionnement… Le questionnement est le propre de l’homme. Ta vie entière est un questionnement. Tu dois sans cesse t’interroger. », dit le père.
Certains aveux, certains rêves peuvent alors s’exprimer, sinon s’épanouir ; et la réalité se manifeste, cette réalité que symbolise sans doute la pluie omniprésente, ainsi que ce chien que l’on ne voit jamais, et que « l’homme » doit absolument confier à quelqu’un. Une réalité dont il faut se prémunir (la pluie) ou se débarrasser (le chien) ? Pourtant « il faut bien croire en quelque chose » ; alors, peut-être, « tout ira bien », même si, comme l’écrit Eugène Durif dans sa préface, « les personnages resteront toujours un peu de travers, un peu à côté d’eux-mêmes, dans une distance qui s’abolit un instant, trompeusement. ».
Jean-Pierre Longre
Tomislav Zajec est né en 1972 à Zagreb, en Croatie. Il a suivi un cursus de dramaturgie à la faculté des arts de la scène à Zagreb, où il a ensuite enseigné. Également poète et romancier, il est l’auteur d’une dizaine de pièces de théâtre, traduites dans autant de langues, et principalement jouées dans les Balkans, au Royaume-Uni ainsi qu’en Argentine. Il a reçu à quatre reprises le prix Marin-Držić du meilleur texte dramatique, le plus prestigieux en Croatie, et les premières traductions de ses textes ont déjà été primées par la Maison Antoine-Vitez et les Journées de Lyon des auteurs de théâtre.
11:10 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, croatie, tomislav zajec, karine samardžija, d’eugène durif, l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/06/2019
Errance et déchéance
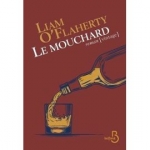 Liam O’Flaherty, Le Mouchard, traduit de l’anglais (Irlande) par Louis Postif, préface de Stève Passeur, Belfond, 2019
Liam O’Flaherty, Le Mouchard, traduit de l’anglais (Irlande) par Louis Postif, préface de Stève Passeur, Belfond, 2019
Gypo Nolan, force de la nature et esprit limité, ancien de l’Organisation révolutionnaire, dont il a été exclu, vit comme beaucoup de ses congénères au jour le jour, souvent sans savoir où il dormira le soir ni comment il pourra manger. En quête du moindre schilling, il décide de dénoncer son ami Mac Phillip, recherché par la police pour avoir tué un fermier. « Je viens réclamer la prime de vingt livres offerte par le Syndicat des fermiers pour des renseignements concernant le nommé Francis-Joseph Mac Phillip ». Ce disant, il donne l’impression de ne pas mesurer la portée de son acte.
Ni ses conséquences, qui vont faire l’objet principal du récit. Première conséquence : la mort de son ami dans l’affrontement avec la police venue l’arrêter. Deuxième conséquence : alors que les choses s’embrouillent dans la tête de Gypo, qui ne sait pas comment gérer les suites de son forfait, il se met à dépenser à tort et à travers et au vu de tous les vingt livres qui gonflent ses poches : tournées générales, visites à des prostituées, cadeaux divers – bagarres et fuites éperdues dans le labyrinthe des ruelles. Nous sommes à Dublin, dans les années 1920, peu après l’insurrection de 1916 ; dans le Dublin des ouvriers, des chômeurs, des miséreux, des parias, des révoltés, des résignés ; un Dublin que Gypo sillonne de « son corps de géant », sa lourde masse arpentant les bas-fonds d’une ville où l’alcool et le dénuement forment un mélange explosif.
L’écriture de Liam O’Flaherty, directe, sans fioritures, d’une poésie violente et brute, rend avec une particulière intensité la complexité de la situation : la condition sociale de ce peuple réduit aux expédients, la psychologie à la fois primaire et voilée de Gypo, qui tour à tour perd et prend conscience de son rôle de délateur et de la culpabilité qui le ronge, la bataille qui se livre au sein de l’Organisation révolutionnaire, guidée par le pur et froid Gallagher, sorte de Robespierre qui a tout deviné de la faute de Gypo, et qui le lui fait sentir : « Une force le poussait à affronter les regards de Gallagher, dont il ne pouvait se détacher sans ressentir une profonde brûlure dans la chair. » On se prend parfois à « souhaiter que [le] mouchard ne soit ni pris ni châtié », comme l’écrit Stève Passeur dans la préface, tant le personnage attire un mélange de dégoût et de compassion, à l’image de ses semblables voués à la déchéance, à l’image aussi de l’insecte pris au piège de son propre destin, comme de nombreux passages le laissent imaginer. « Il allait sans but, poussé vers le nord par la panique et l’impossibilité de réfléchir. Il fonçait dans tous les sens : il descendait une rue, virait à gauche, revenait en ligne parallèle, redescendait la rue qu’il venait de quitter, et contournait plusieurs fois le même coin, dans sa fuite éperdue. Il semblait aux trousses d’un lutin qui prenait un malin plaisir à revenir continuellement sur ses propres pas. Gypo pataugeait dans les mares, tombait sur les mains et les genoux dans des terrains vagues, se cognait violemment aux brèches des murs, grimpait sur des tas de briques, par-dessus des murs, sautait dans des cours et recommençait le même manège dans une autre rue. ». Voilà un exemple de condensé à la fois réaliste et symbolique du roman et de l’état d’un personnage aux abois.
Jean-Pierre Longre
 En 1935, John Ford réalisa un film (Le Mouchard) d’après le roman de Liam O’Flaherty. Outre celui-ci, les éditions Belfond viennent de publier, dans une veine et d’une autre époque, Le Messager de L. P. Hartley (traduit par Denis Morrens et Andrée Martinerie), dont Joseph Losey tira un film fameux, Palme d’Or au Festival de Cannes 1971.
En 1935, John Ford réalisa un film (Le Mouchard) d’après le roman de Liam O’Flaherty. Outre celui-ci, les éditions Belfond viennent de publier, dans une veine et d’une autre époque, Le Messager de L. P. Hartley (traduit par Denis Morrens et Andrée Martinerie), dont Joseph Losey tira un film fameux, Palme d’Or au Festival de Cannes 1971.
23:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglais (irlande), liam o’flaherty, louis postif, stève passeur, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/05/2019
Secrets, aveux et trahisons
 Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 3, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 3, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
Après son retour précipité de Dublin (voir livre 2), Alice se retrouve aux États-Unis, sous le choc de l’attentat au cours duquel Ciaran, son grand amour, a perdu la vie. Retrouvailles avec ses parents pour des relations toujours tumultueuses, poursuite des études, prise de fonctions comme enseignante à la Keene Academy… L’adaptation se fait tant bien que mal dans ce collège de Nouvelle-Angleterre où elle trouve un relatif apaisement de ses traumatismes, jusqu’au moment où elle fait la connaissance d’un père d’élève avec lequel elle noue une relation amoureuse épisodique. Après son retour à New-York, son amitié avec Duncan et Howie, les rapports en dents de scie avec ses parents, ses frères Peter et Adam, si différents l’un de l’autre, peuplent sa solitude. Un poste d’assistante d’édition va lui ouvrir les portes du monde littéraire.
 Les détails de la vie d’Alice nous sont contés sur le fond socio-politique de ces années-là : présidence prometteuse mais décevante de Jimmy Carter, élections successives de Ronald Reagan, perte des illusions, triomphe du capitalisme et des « yuppies », surgissement dramatique du sida, tout cela en résonance avec notre propre époque, jusqu’à des allusions malicieuses comme l’apparition sur la scène publique d’un jeune capitaliste à l’ambition démesurée, Donald Trump… Et nous pénétrons dans les arcanes du commerce éditorial, où Alice évolue à son aise : « Que ce soit au lycée, pendant mes études, ou quand je me terrais dans le Vermont, je ne m’étais jamais vraiment imaginée accéder à une position dirigeante. L’autorité et le management étaient des qualités que j’étais persuadée ne pas posséder, et je n’avais pas pour ambition d’encadrer une équipe, même dans un milieu littéraire. Et pourtant voilà que, à tout juste vingt-neuf ans, j’avais sous ma responsabilité une écurie d’auteurs, un budget, des subalternes – et je devais répondre de tout cela aux services commercial et comptabilité […] ». Bref, sinon le bonheur, du moins une forme de satisfaction personnelle qui, si elle ne résout pas tous les problèmes, réjouit le cœur et l’intellect.
Les détails de la vie d’Alice nous sont contés sur le fond socio-politique de ces années-là : présidence prometteuse mais décevante de Jimmy Carter, élections successives de Ronald Reagan, perte des illusions, triomphe du capitalisme et des « yuppies », surgissement dramatique du sida, tout cela en résonance avec notre propre époque, jusqu’à des allusions malicieuses comme l’apparition sur la scène publique d’un jeune capitaliste à l’ambition démesurée, Donald Trump… Et nous pénétrons dans les arcanes du commerce éditorial, où Alice évolue à son aise : « Que ce soit au lycée, pendant mes études, ou quand je me terrais dans le Vermont, je ne m’étais jamais vraiment imaginée accéder à une position dirigeante. L’autorité et le management étaient des qualités que j’étais persuadée ne pas posséder, et je n’avais pas pour ambition d’encadrer une équipe, même dans un milieu littéraire. Et pourtant voilà que, à tout juste vingt-neuf ans, j’avais sous ma responsabilité une écurie d’auteurs, un budget, des subalternes – et je devais répondre de tout cela aux services commercial et comptabilité […] ». Bref, sinon le bonheur, du moins une forme de satisfaction personnelle qui, si elle ne résout pas tous les problèmes, réjouit le cœur et l’intellect.
C’est un fait : les problèmes ne manquent pas dans l’entourage immédiat d’Alice. Son frère Adam, qui s’est enrichi à coups de manœuvres frauduleuses, va être dénoncé par Peter dans un article au retentissement accablant pour la famille, malgré les tentatives de conciliation de leur sœur, qui en prévoit les conséquences : « La honte salit tout ce qu’elle touche ». Des conséquences, il y en aura, mais aussi, pour Alice, les promesses de l’amour.
Ce troisième livre, qui suscite comme les précédents des réflexions sur l’histoire contemporaine des USA, sur l’écriture littéraire, sur les relations humaines et familiales, sur les secrets, les trahisons et les aveux, boucle en quelque sorte un cycle, puisque l’on retrouve à la fin la situation du début du premier livre : le moment où Alice a décidé de faire, en un récit rétrospectif, le roman de sa famille et de son époque. Mission accomplie pour Douglas Kennedy, qui promet une suite…
Jean-Pierre Longre
19:54 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), douglas kennedy, chloé royer, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/05/2019
Une Américaine à Dublin
 Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 2, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 2, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2018, Pocket, 2019
La suite promise de la vie d’Alice Burns (voir le livre 1) a pour cadre l’Irlande. Étudiante au Trinity College de Dublin, elle va connaître les tâtonnements, les tribulations, les émotions d’une jeune américaine transplantée dans un pays dont les mœurs religieuses, familiales, sociales sont restées plutôt traditionnelles (et où par ailleurs la Guiness coule à flot…). Recherche d’un logement, prises de contact universitaires, amicales, sentimentales, tout ce qui compose la vie d’Alice et toutes les interrogations qu’elle suscite reposent non seulement sur le présent, mais aussi sur le lourd passé familial et sur un avenir incertain. « Le désespoir que je ressentais chez mes parents m’avait poussée à me bâtir une certaine indépendance, à un âge où la plupart des gens ne cherchent qu’un moyen de s’amuser sans avoir à grandir. […] Des années plus tard, je tomberais sur un mot qui me plairait immédiatement : conjoncture. La symphonie du hasard. Tout ce qui m’arrivait était-il simplement le fruit des circonstances, ou avais-je, par le biais de mes choix et de mes actions, un certain degré d’incidence sur le cours des choses ? ».
 Au pays de Joyce, Alice trouve à qui parler de littérature, d’art, de religion, de politique… Et tout se déroule sur le fond historique tourmenté des années 1970 : le Chili sanglant de Pinochet, par lequel la famille Burns est spécialement concernée (le père, proche de la junte et de la CIA, le frère Peter, qui a lutté contre la dictature et a dû se sauver en catastrophe après avoir été témoin d’atrocités), les « Troubles » et les attentats en Irlande, UVF contre IRA… Une incursion à Paris, où Alice rend visite à Peter, lui permet de changer d’atmosphère, de découvrir une ville dont elle rêvait, mais la replonge dans des souvenirs qui avaient été aiguisés par le surgissement inattendu à son domicile de Dublin d’une ancienne camarade pétrie de révolte, de désir de vengeance et de violence. Il y a aussi la rencontre de Ciaran, qui semble être le meilleur choix amoureux, et qui lors d’un séjour à Belfast lui fait connaître ses parents, visiblement à l’opposé des parents Burns : « Voilà donc ce qu’il était possible de ressentir dans une famille aimante et équilibrée ? ».
Au pays de Joyce, Alice trouve à qui parler de littérature, d’art, de religion, de politique… Et tout se déroule sur le fond historique tourmenté des années 1970 : le Chili sanglant de Pinochet, par lequel la famille Burns est spécialement concernée (le père, proche de la junte et de la CIA, le frère Peter, qui a lutté contre la dictature et a dû se sauver en catastrophe après avoir été témoin d’atrocités), les « Troubles » et les attentats en Irlande, UVF contre IRA… Une incursion à Paris, où Alice rend visite à Peter, lui permet de changer d’atmosphère, de découvrir une ville dont elle rêvait, mais la replonge dans des souvenirs qui avaient été aiguisés par le surgissement inattendu à son domicile de Dublin d’une ancienne camarade pétrie de révolte, de désir de vengeance et de violence. Il y a aussi la rencontre de Ciaran, qui semble être le meilleur choix amoureux, et qui lors d’un séjour à Belfast lui fait connaître ses parents, visiblement à l’opposé des parents Burns : « Voilà donc ce qu’il était possible de ressentir dans une famille aimante et équilibrée ? ».
En quelques mois, Alice vit des expériences nouvelles, formatrices, émouvantes, surprenantes parfois, aussi bien pour elle que pour le lecteur. Il faut dire qu’il n’y a pas meilleur artisan que Douglas Kennedy pour faire de cette brève tranche de vie vue sous les angles psychologique, social et historique un roman palpitant.
Jean-Pierre Longre
19:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), douglas kennedy, chloé royer, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/05/2019
« Chaque famille est une société secrète »
 Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 1, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2017, Pocket, 2018
Lire, relire... Douglas Kennedy, La symphonie du hasard, livre 1, traduit de l’américain par Chloé Royer, Belfond, 2017, Pocket, 2018
Sans conteste, Douglas Kennedy sait écrire des romans, et notre soif narrative ne peut être qu’épanchée à leur lecture. La symphonie du hasard, dans sa construction musicale et sa teneur linéaire, n’a apparemment et malgré son titre rien de hasardeux, et si les péripéties qui en composent la trame laissent supposer que le destin est imprévisible, celui-ci se présente pourtant comme le résultat d’une certaine volonté humaine. En cela – outre le fait que ces péripéties, l’auteur a dû en vivre un certain nombre, ou en tout cas en avoir connaissance, puisque la narratrice Alice est vraisemblablement l’un de ses doubles –, en cela donc, nous avons affaire à un roman réaliste.
Alice Burns, éditrice, rend régulièrement visite à son frère Adam condamné à huit ans de prison. Un jour, il lui fait des révélations inattendues sur un événement de sa jeunesse : « Il fallait que tu le saches. Parce que c’est ce que je suis. Ce que nous sommes. ». Mise malgré elle dans le secret, elle décide de revenir sur le passé. « Si les deux dernières décennies m’ont appris quoi que ce soit, c’est cette vérité essentielle : le malheur est un choix. ».
 Nous voilà plongés dans l’Amérique du début des années 1970. La vie familiale avec ses conflits, ses secrets, ses non-dits, ses éclats : les parents qui ne peuvent se supporter qu’en menant l’un contre l’autre une sorte de guérilla permanente ; Alice et ses deux frères, Peter et Adam, aux tempéraments et aux visées radicalement différentes. La vie étudiante avec ses excès, ses velléités, les amitiés, les amours, l’alcool, la drogue, les regroupements par affinités, les clans, les inimitiés, les brouilles, les dépressions, les relations parfois étroites, parfois étranges, entre professeurs et élèves… Avec cela, le roman aborde de grands thèmes propres à l’époque : les préjugés racistes et homophobes persistants chez les uns, le progressisme et l’humanisme chez d’autres, les idéaux pacifistes (contre la guerre du Vietnam notamment), les manœuvres financières, les élections présidentielles, les déceptions politiques, le coup d’État de Pinochet au Chili (dont les répercussions dans la famille d’Alice ont leur importance)…
Nous voilà plongés dans l’Amérique du début des années 1970. La vie familiale avec ses conflits, ses secrets, ses non-dits, ses éclats : les parents qui ne peuvent se supporter qu’en menant l’un contre l’autre une sorte de guérilla permanente ; Alice et ses deux frères, Peter et Adam, aux tempéraments et aux visées radicalement différentes. La vie étudiante avec ses excès, ses velléités, les amitiés, les amours, l’alcool, la drogue, les regroupements par affinités, les clans, les inimitiés, les brouilles, les dépressions, les relations parfois étroites, parfois étranges, entre professeurs et élèves… Avec cela, le roman aborde de grands thèmes propres à l’époque : les préjugés racistes et homophobes persistants chez les uns, le progressisme et l’humanisme chez d’autres, les idéaux pacifistes (contre la guerre du Vietnam notamment), les manœuvres financières, les élections présidentielles, les déceptions politiques, le coup d’État de Pinochet au Chili (dont les répercussions dans la famille d’Alice ont leur importance)…
Récit rétrospectif foisonnant, dans lequel la littérature, l’écriture, l’histoire, la vie intellectuelle tiennent une place de choix, ce premier volume offre aussi de larges possibilités de réflexion sur l’existence individuelle, sociale, familiale – ce dernier volet étant inséparable de tout le reste et de cette vérité générale prononcée par l’un des personnages : « Nous avons tous une grande part de mystère ». Les volumes 2 et 3 sont annoncés pour les mois à venir. À suivre donc…
Jean-Pierre Longre
18:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone (États-unis), douglas kennedy, chloé royer, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/05/2019
« Paradis perdu »
 Jean-Jacques Nuel, Une saison avec Dieu, Le Pont du Change, 2019
Jean-Jacques Nuel, Une saison avec Dieu, Le Pont du Change, 2019
Arthur Rimbaud nous a chanté sa « Saison en Enfer ». Jean-Jacques Nuel nous livre sa « Saison avec Dieu », qui, dans un genre, un style et des perspectives différents, tient aussi de la quête mystique. Car l’auteur (disons le narrateur, qui le représente clairement et nommément) a bien connu ce Dieu, qui fut son colocataire pendant trois mois lorsqu’il était étudiant à la Faculté des Lettres d’une grande ville de province (Lyon, devine-t-on aisément). Étonnant, non ? Pourtant, cela commence de manière presque banale : « Dieu n’avait rien de remarquable. Dieu n’avait rien d’impressionnant. J’ai le souvenir d’un individu de taille moyenne, très mince, aux élégantes proportions. Physiquement, Dieu était légèrement plus grand que moi, mais il n’a jamais tiré parti de cette supériorité naturelle pour me regarder de haut. Bien au contraire, notre relation était simple, franche, cordiale, d’égal à égal, et nous partagions tout, les frais de l’appartement comme les tâches ménagères. ». Bref, un étudiant comme un autre, qui fume des Gitanes et boit des bières, sans prétention, avec sérénité.
À ceci près qu’il est la perfection même : son savoir encyclopédique n’a d’égal que son habileté pour le bricolage, et son dévouement à toute épreuve se manifeste dans la plus grande discrétion. Cela donne des formules qui hors contexte pourraient paraître de la plus grande dévotion (« Sans l’aide de Dieu je n’aurais jamais réussi aussi facilement ma licence de lettres modernes »). Et jamais un mot plus haut que l’autre, jamais de leçon de morale, jamais de reproches sur la conduite de son ami, conduite pourtant « fort éloignée des préceptes du catéchisme » (certains, qui se revendiquent représentants de Dieu sur terre, pourraient en prendre de la graine).
Alors, que dire des intentions de l’auteur lorsqu’il dévoile (sur le tard) cette rencontre ? Serait-il un nouveau Claudel derrière son pilier de Notre-Dame (en l’occurrence les cloisons vétustes d’un deux pièces insalubre) ? Un nouvel André Frossard qui affirmait « Dieu existe, je l’ai rencontré » ? Non. Jean-Jacques Nuel, d’ailleurs, anticipe les reproches de lecteurs qui n’apprécieraient pas le mélange pourtant subtil et bienvenu des tons (« la légèreté et la gravité, l’humour et le sérieux. »), et les critiques qui enfouissent leurs doutes sous une carapace de certitudes : « Les croyants de toutes confessions seront choqués par cette représentation trop familière de Dieu, fort éloignée de leur enseignement du catéchisme et de leur pratique religieuse […] – tandis que les incroyants me reprocheront au contraire de présenter Dieu sous des dehors trop favorables, ils m’accuseront de complaisance […] ». Lui, agnostique avoué, ne tire pas de leçon rationnelle de son récit ; il en garde simplement l’idée que tout ne s’explique pas, et surtout une émotion débordante au souvenir de ces « jours heureux » d’étudiant, de ce « paradis perdu » qu’il connut en compagnie de Dieu.
Jean-Pierre Longre
20:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, jean-jacques nuel, le pont du change, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

