03/09/2022
Tragi-comédie familiale
 Lire, relire... Yasmina Reza, Serge, Flammarion, 2021, Folio, 2022
Lire, relire... Yasmina Reza, Serge, Flammarion, 2021, Folio, 2022
Certains écrivains sont aussi à l’aise dans l’écriture théâtrale que dans l’invention romanesque. L’art du dialogue, le mélange des registres, les mouvements de personnages bien campés, l’agencement précis de scènes en une répartition structurelle élaborée : ces caractéristiques scéniques sont aussi celles de la narration dans le dernier roman de Yasmina Reza.
« Je n’intéressais pas mon père. J’étais le bon garçon sans histoire, qui travaillait correctement, faisait tout comme son frère et n’avait aucune personnalité. Au contraire de Serge qui le rendait fou par ses opinions de blanc-bec, ses allures, sa fourberie, sa morgue et que lui en retour rendait fou à force de brutalité et raisonnements soi-disant édifiants, mais qui le surprenait, et peut-être même l’impressionnait. » On comprend ici (et ailleurs) pourquoi le livre s’intitule Serge. Celui-ci est le protagoniste, autour duquel gravitent son frère Jean (le narrateur), sa sœur Anne (Nana) et quelques autres personnages qui apparaissent au fil des scènes : Valentina, la compagne que Serge est en train de perdre, Luc, le fils de Marion, séparée de Jean, qui continue à s’en occuper comme de son propre enfant, Ramos, mari de Nana, avec laquelle il forme le seul couple stable de la fratrie, Joséphine, fille de Serge, qui va entraîner son père, son oncle et sa tante dans un voyage à Auschwitz. La visite du camp occupe une large scène centrale du roman, une scène dont la tonalité est représentative de celle de la plupart des autres. En ce lieu de toutes les cruautés, de toutes les souffrances humaines, les frères et la sœur vont se chamailler pour des peccadilles, se faire la tête, se brouiller même (Nana et Serge, qui boude de plus en plus), se moquer du beau-frère, bref se comporter comme si on était en vacances à la campagne. Et c’est aussi l’occasion, pour l’autrice à la verve acérée, de s’adonner par personnages interposés à une vive satire du tourisme de masse sur les lieux de mémoire tragique. Au milieu de cette agitation, Jean tâche de concilier les positions, mais en prend pour son grade et se fait traiter de lâche, et seule Joséphine, l’adolescente, reste fidèle à la charge de douleur que recèle le lieu.
 De fait, tout le roman est sous-tendu par la mémoire familiale et, plus généralement, humaine. La famille Popper (famille juive laïque, dont certains comportements font penser à ceux que l’on rencontre chez Albert Cohen), est travaillée par les souvenirs – ou par leur absence : « Quand je regarde Nana, je cherche à retrouver la jeune fille qu’elle était. Je cherche dans les yeux, dans les mouvements du corps, le rire, même dans les cheveux, bref dans tout l’assemblage qui fait un être, les traces d’Anne Popper, fleur magique que ses frères exposaient au compte-gouttes dans les soirées pour renforcer leur prestige. Je ne trouve rien. » La maladie et la mort habitent un récit où l’enfance et la jeunesse tentent de prendre leur place. Entre les deux (voir la tirade impayable sur le yaourt, « le dessert de l’enfant et du vieillard »), des adultes à la vie mouvementée, aux actions décalées, à l’angoisse récurrente. Serge est un roman plein e vie où la mort rôde à chaque coin de page.
De fait, tout le roman est sous-tendu par la mémoire familiale et, plus généralement, humaine. La famille Popper (famille juive laïque, dont certains comportements font penser à ceux que l’on rencontre chez Albert Cohen), est travaillée par les souvenirs – ou par leur absence : « Quand je regarde Nana, je cherche à retrouver la jeune fille qu’elle était. Je cherche dans les yeux, dans les mouvements du corps, le rire, même dans les cheveux, bref dans tout l’assemblage qui fait un être, les traces d’Anne Popper, fleur magique que ses frères exposaient au compte-gouttes dans les soirées pour renforcer leur prestige. Je ne trouve rien. » La maladie et la mort habitent un récit où l’enfance et la jeunesse tentent de prendre leur place. Entre les deux (voir la tirade impayable sur le yaourt, « le dessert de l’enfant et du vieillard »), des adultes à la vie mouvementée, aux actions décalées, à l’angoisse récurrente. Serge est un roman plein e vie où la mort rôde à chaque coin de page.
Jean-Pierre Longre
20:40 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, yasmina reza, flammarion, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/08/2022
Maître absolu et esclave consentant
 Roland Topor, Le sacré livre de Proutto. Postface d’Alexandre Devaux, suivie de Sacré Jean-Paul par Topor, Wombat, 2022
Roland Topor, Le sacré livre de Proutto. Postface d’Alexandre Devaux, suivie de Sacré Jean-Paul par Topor, Wombat, 2022
Pour qui veut profiter d’une « robinsonnade » parodique et truculente, Le sacré livre de Proutto est une lecture jouissive. Roland Topor s’en donne à cœur joie, nous entraînant à la suite d’un certain Gisou, tyran sadique, et de son adorateur Proutto, masochiste à souhait, tous deux habitants d’une île devenue déserte après la mort collective des ses habitants les « Zoas » et sur laquelle Gisou règne en tant qu’autoproclamé dieu vivant. Le dominant et le dominé vont vivre un certain nombre d’aventures (comme le Robinson et le Vendredi de Daniel Defoe ou, plus proches, de Michel Tournier), jusqu’à l’arrivée d’une certaine Aba, dont le dieu vivant ne se privera pas d’affreusement abuser, et à la naissance d’un garçon aveugle… Bref, loufoquerie et excès, violence et jouissance, ambiguïté et hypocrisie marquent les relations entre bourreau abusif et victimes consentantes.
Parfois Gisou a des regrets : « Je regrette d’avoir échoué chez les Zoas, je maudis le jour où je t’ai connu. J’ai envie de rentrer chez moi. / - Où est-ce, Gisou ? / - Au pays des Dieux vivants. Je suis le pire d’entre eux, parce que la valeur d’un Dieu vivant se mesure à la qualité et à la quantité de ses fidèles. Je n’ai que toi, Proutto. Si les autres l’apprenaient, je mourrais de honte. » Paradoxalement, voilà qui l’humanise un peu, malgré tout ce qu’il fait subir à Proutto, cherchant toujours la pire humiliation à lui faire accepter. Dans sa postface (« Maudit Proutto ! »), Alexandre Devaux écrit à juste titre : « Plus encore qu’un « déconnage sur l’esclavage », ou une critique féroce de l’emprise de la religion sur les corps et les esprits, c’est une fable sur les rapports de domination, de soumission et de possession des êtres entre eux. Prouto est maso, Gisou est sado : « À bon sado, bon maso, ils sont tous les deux contents », dit Topor. »
Le sacré livre de Proutto est suivi d’une brève nouvelle, Sacré Jean-Paul, où Jésus (et non plus Gisou), à l’invitation du pape, participe à un concours de ramassage de billets de banque. Chez Topor, le rire est roi, un rire franc qui, disons-le, met parfois mal à l’aise, tant il est décalé, tant il est satirique, tant il se penche sur les côtés noir et ridicule des humains et des clivages sociaux. Mais ses écrits et ses œuvres d’art marquent pour toujours le patrimoine. Sacré Topor, toujours vivant !
Jean-Pierre Longre
20:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, humour, francophone, roland topor, alexandre devaux, wombat, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/07/2022
Mystérieux champion
 Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Paul Fournel, Anquetil tout seul, Le Seuil, 2012, éditions Points, 2013, rééd. Points 2021, puis 2022.
Le jeune Paul a eu beau, tout au long de son enfance et des routes parcourues sur deux roues, se prendre pour son champion préféré (souvenons-nous, il y avait deux clans bien marqués, celui, plus populaire, des Poulidor et celui, plus élitiste, des Anquetil), jamais il n’a réussi jusqu’à présent à percer les mystères de celui pour qui « l’essentiel se joue dans la solitude ».

« Petit cycliste, j’avais des idées claires sur ce que devait être un champion. Elles étaient si claires que je les consignais dans un cahier d’écolier parmi les photos que je découpais dans les journaux et collais dans un ordre qui n’appartenait qu’à moi. Ce cahier était à la fois mon Panthéon et mes Commandements ». Devenu grand, Paul doit pourtant se poser les questions essentielles, résumées par le titre du chapitre central, « À quoi marche Anquetil ? » : à l’exploit, à l’amour du vélo, à l’argent, à la douleur, à la drogue, à la générosité ? À tout cela sans doute, ce qui le rend d’autant plus « énervant » qu’il reste très secret.
Paul Fournel, qui s’y connaît en vélo, sportivement, pratiquement, théoriquement et littérairement (voir Besoin de vélo, Méli-vélo etc.), livre dans Anquetil tout seul des réflexions qui ne doivent rien à l’hagiographie (même si Anquetil est devenu, comme d’autres et plus que d’autres, une légende, celle-ci n’occulte en rien les défauts humains qui ne lui ont pas été épargnés), rien à la complaisance, rien au moralisme, beaucoup tout de même à l’admiration inséparable de l’autobiographie. Des réflexions, et des variations : ce livre est la partition d’une cantate qui suit les rythmes variés d’une combinaison instrumentale élégante et indicible : l’homme et la bicyclette.
Jean-Pierre Longre
23:12 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, cyclisme, francophone, paul fournel, le seuil, jean-pierre longre, points | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
19/07/2022
“Mépriser son être essentiel”
 Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Victor Segalen, Le Double Rimbaud / The Double Rimbaud, ouvrage bilingue - bilingual book, translated from the French by Blandine Longre and Paul Stubbs, Black Herald Press, 2022
Médecin de marine, écrivain, grand voyageur, Victor Segalen (1878-1919) a peu publié de son vivant, mais son œuvre est abondante (deux volumes dans la Pléiade). Le double Rimbaud, publié pour la première fois dans Le Mercure de France le 15 avril 1906, n’en est qu’un échantillon fort bref, mais très représentatif des préoccupations de l’auteur : peut-on être à la fois un immense poète et un négociant aventureux ? À la fois, non. Successivement, oui, apparemment, et Segalen s’interroge sur les deux Rimbaud : « Quel fut, des deux, le vrai ? Quoi de commun entre eux ? »
On le sait, Rimbaud s’arrêta brusquement d’écrire, et après avoir erré pendant au moins quatre ans, passa les dix dernières années de sa vie entre l’Abyssinie et Aden. Segalen utilise divers documents (lettres, souvenirs écrits ou oraux) pour retracer cette aventure, non sans citer et analyser auparavant un certain nombre d’extraits poétiques parvenant à « d’insoupçonnables horizons » et proclamant des désirs d’ailleurs : « Et cela fut, en vérité, prophétique des désirs constants de l’autre Rimbaud, qui même avant ses souffrances, avant ses échecs, en pleine fièvre de vie et d’action, entrevoyait, comme but seul désirable, le repos. »
Comment expliquer ce « cas singulier, d’un poète récusant son œuvre entière de poète […] par son mutisme définitif » ? Segalen avance alors « le Bovarysme », fameuse théorie conçue d’après l’héroïne de Flaubert par Jules de Gautier comme « le pouvoir départi à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est. » Et de donner les exemples d’Ingres et son violon, de Chateaubriand et ses velléités politiques, de Goethe et ses ambitions scientifiques etc. Voilà qui expliquerait aussi « les deux essors divergents » et l’étouffement de l’inspiration poétique chez Rimbaud, « persistant à mépriser son être essentiel. » Rien n’est définitivement éclairci, et Arthur Rimbaud restera toujours un cas mystérieux et fascinant dans l’histoire de la poésie. Mais Victor Segalen, dans ce petit ouvrage que les éditions Black Herald Press ont eu l’excellente idée de rééditer – en version bilingue qui plus est – fait avancer la réflexion non seulement sur le poète de Charleville, mais plus généralement sur la destinée des artistes.
22:13 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, anglophone, victor segalen, arthur rimbaud, blandine longre, paul stubbs, black herald press | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/07/2022
Une fille des livres et de l’eau
 Julia Kerninon, Liv Maria, L’iconoclaste, 2020, Folio, 2022
Julia Kerninon, Liv Maria, L’iconoclaste, 2020, Folio, 2022
Thure Christensen, jeune marin norvégien, s’arrêta un jour sur une île bretonne où il fit la connaissance de Mado, qui tenait le « café-restaurant-épicerie que possédait depuis toujours la famille Tonnerre. » Et en 1970 naquit Liv Maria, sous le signe des livres qu’aimait son père et de la vie insulaire que menait sa mère. « Son père était un lecteur, et sa mère était une héroïne. »
Une ascendance qui marquera ses goûts et son tempérament. Envoyée à 17 ans à Berlin par sa mère, elle y vivra une aventure dont le secret la suivra toute sa vie. De retour dans son île, c’est la mort de ses parents qui l’attend. Ce sera ensuite le Chili, où elle sera l’associée et la maîtresse d’un entrepreneur, puis se consacrera à l’élevage de chevaux. De retour dans son île, elle y rencontre Flynn, qui l’emmène en Irlande et devient un mari idéal, avec qui elle aura deux enfants. Elle tiendra une librairie, « le rêve qui devient réalité. » Mais ce rêve familial et livresque n’efface pas la tache indélébile, le secret inavouable qui la mine et s’est réveillé lorsqu’elle est arrivée dans le pays de Flynn. « C’était tellement inouï. Peut-être aurait-elle pu alors tout dire – pas tout, bien sûr – mais au moins une partie, et cet épisode serait devenu une romantique légende familiale. »
Liv Maria Christensen est bien plus que la protagoniste de ce qui pourrait être un roman d’aventures, de voyages, d’amours. « Fille unique du lecteur et de l’insulaire », elle est une femme d’exception, qui a vécu ce que son père disait déjà à propos de sa mère : « Les chemins difficiles qui semblent être les seuls qu’elle connaisse. » Voilà qui résume la destinée mouvementée, narrée avec vigueur et brio, de « la Norvégienne et la Bretonne. Je suis une mère, je suis une menteuse, je suis une fugitive, et je suis libre. » Elle est celle que l’on croit bien connaître, et dont même son mari n’a jamais pu sonder tous les mystères. Elle est un roman, elle est l’océan.
Jean-Pierre Longre
18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, julia kerninon, l’iconoclaste, 2020, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/06/2022
Amours, mystères et illusions
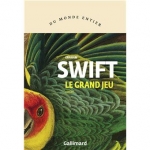 Graham Swift, Le grand jeu, traduit de l’anglais par France Camus-Pichon, Gallimard, 2021, Folio, 2022
Graham Swift, Le grand jeu, traduit de l’anglais par France Camus-Pichon, Gallimard, 2021, Folio, 2022
En 1939, beaucoup d’enfants londoniens furent évacués de Londres pour être mis en lieu sûr et ainsi échapper aux bombardements nazis. Parmi eux, Ronnie, huit ans, eut la chance d’être accueilli dans l’Oxfordshire par un couple qui s’occupa de lui comme s’il était l’enfant qu’ils n’avaient pas eu. Une belle maison, un jardin paisible, une automobile, le téléphone, de la tendresse… Même si le garçon pense à sa mère avec émotion, le voilà heureux de connaître ce confort et d’être choyé par Pénélope et Eric Lawrence – d’autant que celui-ci était « un magicien accompli », qui lui apprit les rudiments de la prestidigitation.
 Ronnie trouvera là sa vocation, en fera son métier, montant avec son « assistante » Evie White un spectacle populaire sous le patronage de son ami Jack Robins. Un fabuleux trio avec de fameux noms de scène : Jack Robinson, Pablo le Magnifique, l’étincelants Ève, et un succès grandissant auprès des estivants du bord de mer. Entre Robbie et Ève, la magie n’est pas seulement scénique, mais aussi sentimentale.
Ronnie trouvera là sa vocation, en fera son métier, montant avec son « assistante » Evie White un spectacle populaire sous le patronage de son ami Jack Robins. Un fabuleux trio avec de fameux noms de scène : Jack Robinson, Pablo le Magnifique, l’étincelants Ève, et un succès grandissant auprès des estivants du bord de mer. Entre Robbie et Ève, la magie n’est pas seulement scénique, mais aussi sentimentale.
La magie, c’est aussi celle su style de Graham Swift, qui sait à merveille opérer les va-et-vient entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire, l’amour et le désamour, le silence et la parole des regards, les apparitions et les disparitions. C’est bien de tout cela qu’il s’agit entre Jack et Ronnie, avec Evie comme point d’ancrage ou de départ. Présences et disparitions, énigmes et illusions : « Or qu’y a-t-il de plus extraordinaire : que les magiciens puissent transformer une chose en une autre, même faire disparaître et réapparaître les gens, ou que les gens puissent être présents un jour – oh, tellement présents – et plus le lendemain ? À tout jamais. » C’est l’enjeu de ce beau roman où se dessinent tout en nuances les destinées d’êtres pleins de force, de délicatesse et de mystère.
Jean-Pierre Longre
17:52 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, graham swift, france camus-pichon, jean-pierre longre, gallimard | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/06/2022
Pas à pas vers l’espérance
 Denis Clavel, Monologue du silence, éditions Esope, 2022
Denis Clavel, Monologue du silence, éditions Esope, 2022
Monologue du silence est ce qu’on peut appeler un livre précieux. Précieux par sa forme : mise en page d’une sobre perfection, mise en regard esthétique des mots et des images ; précieux par son contenu : la poésie que révèle l’épaisseur des vers dans une substantielle économie verbale, le mystère que recèlent les illustrations. Celles-ci exploitent les ressources du dessin, de la peinture, de la photographie : paysages, objets et êtres de la nature, lignes suggestives, profondeurs colorées, évocations d’un infini vertical et horizontal. Cela pour chaque page de droite.
À gauche, des textes. Poèmes brefs, lapidaires, aphoristiques. Mais une brièveté qui en dit long. Car dans l’omniprésence visuelle et auditive du silence annoncé par le titre, la polysémie du langage joue un rôle majeur : comment saisir le mot « sens » lui-même (« direction / ou / signification ») ? Sans compter une troisième acception qui parcourt le livre : les sensations mêlées, ouïe, vue, odorat, grâce auxquelles on tente de percer les énigmes de la nature, de chercher par exemple « à comprendre / ce que dit la rivière », ou à contempler « l’extase d’un oiseau » (et ne pas se contenter de « jeter [son] regard »).
On voudrait tout citer, tant la densité du recueil, qui utilise si peu de mots pour dire l’essentiel, qui fait résonner le silence d’harmoniques profondes, qui donne à entrevoir la beauté de l’existence (l’être au-delà du paraître), tant cette densité, donc, nous permet de dépasser le pessimisme de l’absence, la « misérable mort », pour parvenir vers par vers, pas à pas, à l’espérance finale. Un vaste parcours artistique et méditatif ouvert par la promesse qu’esquisse la phrase initiale : « J’écoute l’invisible ».
Jean-Pierre Longre
18:29 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, francophone, dessin, photographie, peinture, denis clavel, éditions esope, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/06/2022
« Le son des mots réconciliés »
 Nicolas Gruszkiewicz, Au matin de la Grande journée, encres de Valérie Ghévart, Éditions La Centaurée, 2022
Nicolas Gruszkiewicz, Au matin de la Grande journée, encres de Valérie Ghévart, Éditions La Centaurée, 2022
Les mots se répandent sur la page blanche comme des notes sur une partition, comme des instruments dans un orchestre, sonnent verticalement, horizontalement et en épaisseur, comme une symphonie. Ils flottent sur l’eau immobile, comme de frêles embarcations, lestés du poids de leurs harmoniques et de leurs significations, seuls ou en petits groupes obstinés forçant « le silence féroce » du vide. Çà et là, les encres tout en nuances et en forme de feuille dressent leur pointe vers des hauteurs muettes, en une verticalité qui répond à celle des poèmes, que l’on suit, bien obligé, vers le mystère de leur profondeur. Et voilà qu’on ne peut « rester immobile. »
De quoi nous parlent-ils, ces poèmes ? De la nature, du ciel, de l’eau, de la lumière, du vent, du sable, de la terre, du feu – des éléments dont la présence est immuable, mais que la mue des mots transcende, que la poésie rassemble contre la fuite du temps. Les années passent, la vieillesse gagne, mais il y a toujours un peu de lumière, et la parole respire. Contre « l’embarras du labyrinthe », se dresse « la mémoire aux lèvres d’argile », mais aussi « l’ocre sonore », les « feux mouillés », la « terre d’écume » - bref, synesthésies, oxymores et autres audaces verbales, tout ce que les mots peuvent se permettre, entre le silence et la solitude, pour préserver les « jours heureux ».
Dans ce beau recueil qui fait entendre « le son des mots réconciliés », « les questions du vent » et bien d’autres choses encore, le poète « adresse [ses] cris au ciel », et nous l’accompagnons, murmurant avec lui : « Merci pour la lumière ».
Jean-Pierre Longre
09:27 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, illustration, francophone, nicolas gruszkiewicz, valérie ghévart, éditions la centaurée, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
12/05/2022
La puissance de l’imaginaire
 Manuel Anceau, Il y a un pays, dessins d’Ève Mairot, Ab irato, 2021
Manuel Anceau, Il y a un pays, dessins d’Ève Mairot, Ab irato, 2021
« Les rêves se disent et se perpétuent, bien qu’exprimer (fût-ce entre deux bouchées de pâté à la viande) ce qui n’est pas autre chose, après tout, qu’un fort sentiment de désarroi, ce soit tout aussi bien pleurer sur son propre sort. Qu’on me comprenne : on ne peut pas passer sa vie comme Livisse à avoir le nez en l’air. » Livisse (remarquez l’art de la déclinaison chez M anuel Anceau : il y a eu Livaine, Lormain, Lieuve, Louvet, il y aura Liviane, Lise, Livia, Yvonne, Ivor, Yvan…), Livisse, donc, le protagoniste de la première des douze nouvelles (quu donne son titre au recueil), après avoir été souffre-douleur dans son enfance, est devenu un adulte dont la force est celle des simples, ce qui lui permet d’aller « lentement, mais sûrement, vers le rêve bienheureux. »
La tonalité est donnée. Les récits qui suivent disent la puissance de l’imaginaire, tout en maintenant les personnages ancrés dans le réel (celui du « pâté à la viande », de la terre et de maints éléments de la vie quotidienne). Nous avons affaire, successivement, à Nils, rejeton d’une famille de grands bourgeois, fortement intéressé par les champignons vénéneux ; à trois condamnés attendant d’être fusillés au pied de la statue du glorieux « Leunuk », héros et « grand-père débonnaire » de la nation ; à un jeune conférencier qui se sort d’un mauvais pas d’une manière inattendue et lumineuse ; à un groupe d’enfants qui, sous la conduite autoritaire d’Irène, dix ans, construit une « arche » en prévision d’un hypothétique déluge, et la catastrophe qui survient n’est pas celle que l’on attendait ; à un homme dont la mère a sacrifié sa carrière de cantatrice, et qui le regrette ; au montage d’un télescope géant dans l’Himalaya, accompagné de querelles et de visions fantastiques ; à une fillette qui dit voir apparaître des fées, ce qui perturbe la fratrie ; aux souvenirs amoureux et aux regrets d’un homme âgé ; à la présence étrange et mystérieuse d’un marginal écrivant de non moins étranges phrases sur des bouts de papier devant les habitués d’un bistrot ; aux dramatiques retrouvailles d’un homme avec sa mère, qui avait dû l’abandonner lorsqu’il était enfant pour pouvoir survivre d’une manière inavouable ; à une découverte surprenante faite par un vieux célibataire qui, voulant quitter son « pays », résout une énigme ancienne…
Il y a des motifs communs, tels que la solitude, le désarroi, les vicissitudes de la vie, mais les situations, les personnages, les décors, les intrigues, les registres se signalent par leur variété – le tout périodiquement illustré par les dessins d’Ève Mairot qui, tout en étant suggestifs, mettent l’accent sur le mystère des silhouettes, des regards, du « pays » dont il est question. Et il y a le style de Manuel Anceau, dont on a déjà relevé certains aspects à propos de précédents ouvrages : phrases tout en volutes, interruptions, parenthèses, réitérations, anticipations… Une prose poétique apte à explorer les coins et les recoins du conscient et de l’inconscient, du réel et de l’imaginaire.
Jean-Pierre Longre
https://abiratoeditions.wordpress.com
 Les éditions Ab irato viennent de publier Toyen, petits faits et gestes d’une très grande dame, par Alain Joubert.
Les éditions Ab irato viennent de publier Toyen, petits faits et gestes d’une très grande dame, par Alain Joubert.
Chronique à venir !
17:46 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, dessin, manuel anceau, Ève mairot, ab irato, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/05/2022
Cahoteuses et chaotiques
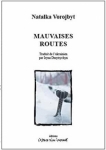 Natalka Vorojbyt, Mauvaises routes, traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn, éditions L’espace d’un instant, 2022
Natalka Vorojbyt, Mauvaises routes, traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn, éditions L’espace d’un instant, 2022
Le premier des six tableaux qui composent cette pièce est le monologue d’une journaliste venue se rendre compte de ce qu’il se passe sur le front du Donbass. « Qui ne veut pas aller au front ?! Tout le monde veut aller au front. Je l’ai décidé avant même d’y réfléchir. » C’est Serhig, combattant endurci et bel homme, qui l’y emmène en lui racontant ses propres tribulations. Témoignage vivant, brève histoire de guerre et d’amour qui se terminera, elle le sait, par « une séparation lente et terrible. »
Les fragments suivants, extensions dialoguées du premier, mettent en scène des personnages divers, dont la variété des situations n’occulte pas ce qu’ils ont en commun et qui forme à la fois l’arrière-plan constant et l’immédiateté scénique : la guerre, les dangers et les tensions qu’elle engendre. De toutes jeunes filles, assises sur un banc près d’une supérette, bavardent, se disputent, se racontent leurs amours (« Comme Roméo et Juliette : tout le monde est contre nous, et nous on est contre le monde entier. »), leurs révoltes (« Je ne veux pas regarder la télé russe. / On regardera autre chose. / Il n’y a rien d’autre. ») et expriment leurs peurs devant les explosions. Un directeur d’école tente de s’extirper d’une situation et d’une attitude qui le rendent suspect aux yeux d’un commandant de « blockpost » – ivresse, passeport égaré, détention d’une arme -, ce qui occasionne au passage une profession de foi du militaire : « Personnellement, je combats pour que ma fille ne se réveille pas un jour au milieu de la guerre, comme vos enfants. Pour qu’elle ne se cache pas dans les caves, putain [...] Et puis je suis ici pour qu’un directeur d’école ivre ne transporte pas une kalachnikov dans son coffre… Pour que ce genre de directeur ne s’approche pas des enfants. On ne sait pas ce que tu leur apprends, là-bas, quelle patrie aimer, quel drapeau arborer. » Une femme médecin et un militaire roulent sur une route accidentée, et leur conversation agitée laisse entendre que le corps du mari mort au combat se trouve dans le coffre du véhicule. Situation tragique, qui n’empêche pas l’humour (noir) : « Ton père est encore en vie ? / Non. / Alors que Poutine est en vie. / Oui, j’aurais bien fait l’échange… / Impossible. / Je sais. / Ça t’ennuie si je me soûle ? / Si tu y tiens vraiment. Mais… / Je plaisante. C’est de l’eau. » Puis c’est une scène à la limite du soutenable entre « Lui », une brute enragée, et « Elle », qui tente de l’amadouer par tous les moyens, sentiments, ruse, brutalité en retour… Image de la dictature guerrière contre les valeurs démocratiques. Le dernier tableau, dont l’action se situe « avant la guerre », met face à face les scrupules et la cupidité, la générosité et la tentation d’en profiter. Prémices de batailles plus violentes.
Tous ces personnages, dont certains, comme des fils plus ou moins ténus, réapparaissent périodiquement et tracent un cheminement entre les scènes, suivent ces « mauvaises routes » cahoteuses et chaotiques qu’ils n’ont pas forcément prévu ou envie de suivre. L’art de la dramaturge leur donne une existence immédiate, tangible, profondément humaine, et nous, lecteurs ou spectateurs, partageons de près leurs angoisses, leurs révoltes, leurs vies à la fois dramatiques et si proches de la quotidienneté de toute vie, avec ses sourires et ses peurs. D’autant plus, bien sûr, que les événements décrits ici, datant d’il y a cinq ans (2017, création de la pièce), sont d’une brûlante actualité.
Jean-Pierre Longre
Autres parutions récentes aux éditions L’espace d’un instant :
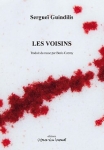 Sergueï Guindilis, Les voisins, traduit du russe par Boris Czerny, préface de Benoît Vitkine, 2022
Sergueï Guindilis, Les voisins, traduit du russe par Boris Czerny, préface de Benoît Vitkine, 2022
« La réélection frauduleuse du président sortant, Alexandre Loukachenko, en août 2020, provoque une vague de manifestations pacifiques en Biélorussie. Les opposants au régime sont violemment réprimés. La pièce Les Voisins reproduit les témoignages d’hommes et de femmes emprisonnés, violentés ou contraints à l’exil par les forces de l’ordre biélorusses. Ils racontent ce qu’ils ont vécu et qui fait qu’ils ne seront plus jamais les mêmes qu’avant. En mai 2021, la première de la pièce au Teatr.doc de Moscou a été interrompue par la police.
Ce texte est le fruit du travail collectif d’un groupe d’artistes russes et biélorusses, dirigé par Sergueï Guindilis, metteur en scène, et composé de Daria Demoura, régisseuse et documentaliste, Ekaterina Finevitch, actrice de cinéma et de théâtre, et Ksenia Terechtchenko, dramaturge. Sergueï Guindilis, né en 1994 à Moscou, a étudié la philosophie, l’art dramatique et le cinéma documentaire, et a notamment organisé différents spectacles dans le cadre du cycle « Histoire des épidémies » au Teatr.doc. »
 Kaveh Ayreek, La valise vide, traduit du dari (Afghanistan) par Guilda Chahverdi, préface de Guilda Chahverdi ,2022
Kaveh Ayreek, La valise vide, traduit du dari (Afghanistan) par Guilda Chahverdi, préface de Guilda Chahverdi ,2022
« Hamid et Maryam sont afghans, ils ont grandi en Iran. Leurs parents y avaient migré au début de la longue série des guerres afghanes dans les années 1980. Toute leur enfance, ils ont été bercés par la poésie et la description des beautés de leur terre d’origine. Dans les années 2010, une fois mariés, Hamid et Maryam décident de retourner en Afghanistan. Ce retour leur semble essentiel pour offrir à leurs enfants la
légitimité d’une terre dont eux ont été privés. Leurs familles respectives tentent de les en dissuader : les habitants de ce pays sont des loups. Mais le couple ne veut rien entendre. Il voyage par voie de terre pour voir enfin les paysages et rencontrer ses habitants. »
 Jovan Nicolić, Ruždija Russo Sejdovič, Carrousel pour les Tsiganes, traduit du rromani par Marcel Courthiades, préface de Marcel Courthiades, 2022
Jovan Nicolić, Ruždija Russo Sejdovič, Carrousel pour les Tsiganes, traduit du rromani par Marcel Courthiades, préface de Marcel Courthiades, 2022
« Dans un café tenu par Yashar, Rrom de Prizren, se déroulent des événements du quotidien en période de conflit serbo-albanais, apportant de plus en plus de violence, de corruption, de haine absurde entre ennemis jurés, hier encore amis. La pièce illustre la souffrance morale des Yougoslaves écartelés entre nostalgie, compassion, haine(s), nationalisme(s), mensonges et manipulations. Si les personnages principaux sont rroms, symbolisant le peuple simple sans orientation nationaliste, les autres protagonistes apparaissent avec toutes leurs ambiguïtés.
Mais les auteurs traitent d’une destruction intérieure, qui n’épargne personne, et ne font pas le procès de l’une ou l’autre des forces en présence. « Quand les taureaux se battent, c’est l’herbe qui souffre le plus. »
Le texte a été créé en Allemagne en 2000 par Rahim Burhan et le théâtre Phralipe, principal théâtre rrom en Europe, et édité en 2004 à l’Espace d’un instant, sous le titre Kosovo mon amour. »
 Hristo Boytchev, L’invasion, traduit du bulgare par Roumiana Stantcheva, préface de Jordan Plevneš, 2022
Hristo Boytchev, L’invasion, traduit du bulgare par Roumiana Stantcheva, préface de Jordan Plevneš, 2022
« Au fin fond de la campagne, retranchés dans leur maison transformée en bunker improbable, Luca, ses enfants Galilei le lunatique et Maria le garçon manqué, ainsi que Mattei, personnage velléitaire qu’ils hébergent, armés jusqu’aux dents, défendent leur bastion face à un ennemi invisible. Mattei courtise Maria qui le rabroue à coups de taloches, Galilei joue au somnambule, Luca règne en maître sur ce petit monde qui attend à longueur des jours, des mois, des années l’arrivée de l’envahisseur. Un jour, enfin, les collines alentour se couvrent de monde. Les envahisseurs sont là ! »
17:54 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, ukraine, russie, afghanistan, rromani, bulgarie, natalka vorojbyt, iryna dmytrychyn, sergueï guindilis, boris czerny, vitkine, kaveh ayreek, guilda chahverdi, jovan nicolić, ruždija russo sejdovič, marcel courthiades, hristo boytchev, roumiana stantcheva, jordan plevneš, éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
02/05/2022
Comment ne pas s’en sortir
 Fabrice Caro, Broadway, Sygne, Gallimard, 2020, Folio, 2022
Fabrice Caro, Broadway, Sygne, Gallimard, 2020, Folio, 2022
Le discours, Folio, 2020
Pourquoi avoir reçu « une enveloppe plastifiée bleue au bas de laquelle est inscrit : Programme national de dépistage du cancer colorectal », normalement adressée aux hommes âgés de cinquante à soixante-quatorze ans, alors que « j’ai quarante-six ans » ? C’est la question qui va tarauder le narrateur d’une manière obsessionnelle, alors qu’il tente de se dépêtrer des difficultés quotidiennes qui jalonnent la vie d’un homme d’aujourd’hui, marié, père de famille, et qui rêve de changements, de grands espaces et d’exaltations exotiques.
 Les difficultés ? C’est par exemple la convocation chez le chef d’établissement de son fils auteur d’un dessin mettant en situation compromettante deux de ses professeurs ; ou les prières que lui demande de faire sa fille abandonnée par son petit ami ; ou rendre l’invitation à l’apéritif de voisins encombrants ; ou encore envisager des vacances à Biarritz avec un couple d’amis de sa femme qui s’enthousiasment à l’idée de faire du « paddle » au bord de l’océan… Les rêves ? Séduire Mel, la professeure dessinée par son fils ; tracer sa route et parler foot en buvant l’apéritif avec des copains argentins « dans une ruelle del barrio de la Boca, attablé à la terrasse de mon café d’adoption »… et se sortir de ses fantasmes sanitaires, entre difficultés de prostate et « dépistage colorectal »…
Les difficultés ? C’est par exemple la convocation chez le chef d’établissement de son fils auteur d’un dessin mettant en situation compromettante deux de ses professeurs ; ou les prières que lui demande de faire sa fille abandonnée par son petit ami ; ou rendre l’invitation à l’apéritif de voisins encombrants ; ou encore envisager des vacances à Biarritz avec un couple d’amis de sa femme qui s’enthousiasment à l’idée de faire du « paddle » au bord de l’océan… Les rêves ? Séduire Mel, la professeure dessinée par son fils ; tracer sa route et parler foot en buvant l’apéritif avec des copains argentins « dans une ruelle del barrio de la Boca, attablé à la terrasse de mon café d’adoption »… et se sortir de ses fantasmes sanitaires, entre difficultés de prostate et « dépistage colorectal »…
On aura compris que le narrateur-protagoniste navigue entre illusions et velléités, fausses résolutions et promesses non tenues. Cela aurait pu donner un roman dramatico-psychologique. Mais le style alerte et enlevé de Fabrice Caro, son écriture ironique donnent une image à la fois humoristique et bienveillante de cet être socialement décalé, plutôt autocentré, mal à l’aise mais plein de bonne volonté, qui se dit « Il est urgent d’agir » mais n’agit pas, et qui souffre d’« un problème de communication », comme lui dit sa femme. C’est donc avec un plaisir jouissif non dénué de compassion qu’on lit les aventures d’un homme inadapté mais lucide. « Je me sens comme un de ces personnages hitchcockiens qui se retrouvent au cœur d’une intrigue d’envergure internationale alors qu’ils n’ont rien demandé, tout ça à cause d’un simple malentendu ».
Jean-Pierre Longre
 Auparavant, Fabrice Caro avait publié dans la même collection Le discours, paru depuis en Folio.
Auparavant, Fabrice Caro avait publié dans la même collection Le discours, paru depuis en Folio.
Dans une veine du même ordre, nous avons affaire à une comédie à la fois franche et grinçante. Le temps d’un repas familial (belle unité de lieu et de temps), Adrien, le protagoniste-narrateur, se dévoile comme un personnage lui aussi décalé, et se comporte un peu comme Bartleby dans la nouvelle d’Herman Melville, celui dont le mantra est « I would prefer not do », « Je préférerais ne pas… ». Amoureux qui se sent délaissé, il se désintéresse de tout ce qui ne concerne pas Sonia, l’amour de sa vie.
« Je suis en train de manger du gigot et du gratin dauphinois alors que le fruit de mon tourment est ailleurs et qu’une fourchette menace à tout moment de grincer dans l’assiette et la discussion ne porte même pas sur l’amour, ou la poésie, ou le sens de la vie, non, on parle de chauffage au sol, de vacances en Sardaigne, de Jean-François, le fils du voisin, qui a fait construire, tu entends, Adrien, il a fait CONSTRUIRE. Pour ma mère, le monde se divise en trois catégories : ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire et ceux qui n’ont pas d’actualité particulière. Entre ces deux, la construction et le cancer, pas grand-chose, une espèce de flottement, une parenthèse, un grand vise existentiel. » C’était un échantillon représentatif de ce roman délicieusement paradoxal : personnage déprimé, lecture roborative.
Jean-Pierre Longrer
www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Sygne
23:55 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, humour, fabrice caro, sygne, gallimard, jean-pierre longre, folio | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/04/2022
Le roman d’Agnès et William
 Lire, relire... Maggie O’Farrell, Hamnet, traduit de l’anglais (Irlande) par Sarah Tardy, Belfond, 2021, 10/18, 2022
Lire, relire... Maggie O’Farrell, Hamnet, traduit de l’anglais (Irlande) par Sarah Tardy, Belfond, 2021, 10/18, 2022
Nous sommes à Stratford dans les dernières années du XVIe siècle. Agnès a le don de soigner des maladies grâce aux plantes qu’elle ramasse dans les bois environnants. En butte à la mauvaise humeur de sa marâtre, elle tombe amoureuse du précepteur de ses demi-frères – sentiment qui va se révéler partagé. Elle épouse donc, malgré les obstacles, celui qui ne sera jamais nommé, mais dont on devine rapidement l’identité : William Shakespeare, fils d’un gantier connu, notable de la localité, qui règne en despote sur sa famille. Le couple va vivre dans une dépendance de la maison familiale, et trois enfants vont naître : Susanna, puis Judith et son jumeau Hamnet, que la maladie (la « pestilence ») va emporter alors qu’il est encore enfant.
 Comment se remettre de la mort d’un enfant ? Pour Agnes, le temps est au désespoir de n’avoir pas décelé la maladie de son fils, de n’avoir pu le sauver malgré ses talents de guérisseuse, d’autant que son époux va passer la majeure partie de sa vie à Londres occupé à des affaires mystérieuses. « Quelque part au fond d’elle, Agnes aimerait pouvoir remonter le temps, le reconstituer, le rembobiner comme une pelote de laine. Elle aimerait faire tourner le rouet à l’envers, défaire l’écheveau – la mort d'Hamnet, son enfance, sa petite enfance, sa naissance – pour revenir à ce moment où elle et son mari s’étaient unis dans ce lit et avaient conçu des jumeaux. » À quoi bon continuer à faire le ménage, cuisiner, soigner les gens qui viennent lui demander de l’aide ? Il y a bien sûr ses deux autres enfants, Mary sa belle-mère, Bartholomew son frère attentionné, les lettres qu’elle reçoit de Londres… Mais le souvenir du petit garçon est toujours là, plus que le souvenir même : l’image de celui qu’il serait devenu, et qu’elle tente de construire en observant Judith, sa jumelle. Elle ne se doute pas que, sous des dehors distants, son mari est lui aussi hanté par la figure de son fils, qui lui inspirera l’une de ses pièces les plus célèbres.
Comment se remettre de la mort d’un enfant ? Pour Agnes, le temps est au désespoir de n’avoir pas décelé la maladie de son fils, de n’avoir pu le sauver malgré ses talents de guérisseuse, d’autant que son époux va passer la majeure partie de sa vie à Londres occupé à des affaires mystérieuses. « Quelque part au fond d’elle, Agnes aimerait pouvoir remonter le temps, le reconstituer, le rembobiner comme une pelote de laine. Elle aimerait faire tourner le rouet à l’envers, défaire l’écheveau – la mort d'Hamnet, son enfance, sa petite enfance, sa naissance – pour revenir à ce moment où elle et son mari s’étaient unis dans ce lit et avaient conçu des jumeaux. » À quoi bon continuer à faire le ménage, cuisiner, soigner les gens qui viennent lui demander de l’aide ? Il y a bien sûr ses deux autres enfants, Mary sa belle-mère, Bartholomew son frère attentionné, les lettres qu’elle reçoit de Londres… Mais le souvenir du petit garçon est toujours là, plus que le souvenir même : l’image de celui qu’il serait devenu, et qu’elle tente de construire en observant Judith, sa jumelle. Elle ne se doute pas que, sous des dehors distants, son mari est lui aussi hanté par la figure de son fils, qui lui inspirera l’une de ses pièces les plus célèbres.
Même si son intrigue est fondée sur certains faits réels, Hamnet est un roman. Et plus encore que celui d’Hamnet, c’est le roman d’Agnes, cette jeune femme aux « étranges pouvoirs », dont l’autrice raconte le mythe, décrypte le comportement énigmatique avec une empathie profonde. Les rappels historiques servent à la fois l’imaginaire et l’analyse socio-psychologique. L’action souvent pathétique et dramatique n’occulte pas les silhouettes de personnages parfaitement campés dans leur individualité. La vie dans la nature animée, et plus tard la découverte de l’agitation urbaine par une Agnes abasourdie donnent lieu à des descriptions aussi précises que mouvementées. Dans un style qui ne laisse rien au hasard, avec un luxe de détails mêlant histoire et fiction (comme chez Shakespeare), Maggie O’Farrell crée des destinées auxquelles on ne peut que s’attacher. De ce beau roman, le théâtre n’est pas très éloigné.
Jean-Pierre Longre
19:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, maggie 0’farrell, hamnet, sarah tardy, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
18/04/2022
Rouge et noir
 François Médéline, L’ange rouge, La manufacture de livres, 2020, Points, 2022
François Médéline, L’ange rouge, La manufacture de livres, 2020, Points, 2022
Le cadavre défiguré, tailladé, émasculé, crucifié, orné d’une orchidée, descendant la Saône sur un radeau éclairé par des torches, n’est que la première manifestation d’une série de meurtres qui ont toutes les apparences d’un rituel. Vengeances ? Règlements de comptes ? Coups de folie ? Ouvrages méticuleusement préparés par un tueur en série ? Le commandant Alain Dubak, enquêteur borgne et narrateur scrupuleux, va mener avec son équipe une enquête difficile, sanglante, mouvementée, avec un souci d’efficacité dont l’urgence repousse parfois les limites de la légalité.
 Une équipe à la fois éclectique, dévouée et pittoresque, la plus originale du lot étant sans conteste celle que l’on surnomme « Mamy », amatrice boulimique de sucreries, pseudo-voyante à ses heures, dont l’apparente apathie cache une lucidité hors pair ; il y a là, aussi, Joseph, Laurent, Abdel, Thierry, Franky, Véronique la confidente de Dubak, Monique Chabert la psychologue – un attachant échantillon du genre humain. Tout ce monde se disperse sur les traces piégées du tueur et se retrouve régulièrement pour faire le point à « Fort-Apache », le siège de la PJ lyonnaise. Remontées dans le passé, arrestations erronées, arrivisme forcené du commissaire Giroux, prêt à fausser l’enquête pour satisfaire ses ambitions, incursions dans le monde de l’anarchisme radical et de l’extrême-droite fasciste, dans l’univers des artistes, sans oublier la pression médiatique… Les obstacles et fausses pistes ne manquent pas. Tout se passe à Lyon et dans les environs (mis à part quelques hors-scène du côté d’un terrible passé américain), une ville des années 1990 que l’on explore dans la diversité de ses quartiers, dans ses moindres recoins – jusque dans les traboules et même les « arêtes de poisson », réseau d’obscurs souterrains jadis creusés avec régularité par on ne sait qui dans la colline de la Croix-Rousse.
Une équipe à la fois éclectique, dévouée et pittoresque, la plus originale du lot étant sans conteste celle que l’on surnomme « Mamy », amatrice boulimique de sucreries, pseudo-voyante à ses heures, dont l’apparente apathie cache une lucidité hors pair ; il y a là, aussi, Joseph, Laurent, Abdel, Thierry, Franky, Véronique la confidente de Dubak, Monique Chabert la psychologue – un attachant échantillon du genre humain. Tout ce monde se disperse sur les traces piégées du tueur et se retrouve régulièrement pour faire le point à « Fort-Apache », le siège de la PJ lyonnaise. Remontées dans le passé, arrestations erronées, arrivisme forcené du commissaire Giroux, prêt à fausser l’enquête pour satisfaire ses ambitions, incursions dans le monde de l’anarchisme radical et de l’extrême-droite fasciste, dans l’univers des artistes, sans oublier la pression médiatique… Les obstacles et fausses pistes ne manquent pas. Tout se passe à Lyon et dans les environs (mis à part quelques hors-scène du côté d’un terrible passé américain), une ville des années 1990 que l’on explore dans la diversité de ses quartiers, dans ses moindres recoins – jusque dans les traboules et même les « arêtes de poisson », réseau d’obscurs souterrains jadis creusés avec régularité par on ne sait qui dans la colline de la Croix-Rousse.
L’ange rouge est un roman très noir, d’une noirceur sanglante soulignée par l’écriture particulière de François Médéline. Un style percutant, voire brutal, d’une violence mimant en quelque sorte celle que vivent les personnages – victimes, enquêteurs, suspects. À aucun moment on ne risque de s’ennuyer, mais il faut s’accrocher pour ne pas succomber à la frayeur, à l’horreur même. Un thriller haletant à souhait.
Jean-Pierre Longre
19:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, françois médéline, la manufacture de livres, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/04/2022
Comment l'exprimer?
 Lire, relire... Jessica Moor, Les femmes qui craignaient les hommes, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alexandre Prouvèze, Belfond, 2021, Pocket, 2022
Lire, relire... Jessica Moor, Les femmes qui craignaient les hommes, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alexandre Prouvèze, Belfond, 2021, Pocket, 2022
Une petite ville près de Manchester. Le corps de Katie Straw est retrouvé dans la rivière, en aval d’un pont d’où elle est vraisemblablement tombée. Suicide ? Accident ? Meurtre ? L’inspecteur Whitworth va mener l’enquête, en commençant par interroger les pensionnaires du « refuge », vaste demeure qui abrite des femmes fuyant la violence de leurs maris ou compagnons, et où Katie était employée. Valerie Redwood, l’intraitable directrice du lieu, met tout de suite les choses au clair : « J’ignore si vous savez quelles pensionnaires se retrouvent dans ce genre de refuge, mais soyez bien conscient que notre priorité absolue est de les protéger contre des menaces réelles de féminicides. Nous faisons attention. Katie faisait attention. […] Elles comptent sur moi pour ça, pas sur vous. Pas sur la police ou les tribunaux. Sur moi, mes compétences et la sécurité que leur apporte ce bâtiment. »
 L’intrigue policière va tenir sa place, mais parallèlement et en alternance, c’est aux diverses formes de maltraitance que la lectrice et le lecteur sont confrontés : brutalité physique ou morale, violence ouverte ou insidieuse… Compagnes, épouses, filles sont en proie à l’emprise d’hommes qui n’ont pas forcément une conscience claire de leurs méfaits, ou au contraire dont la perversité a trouvé des cibles adéquates. En tout cas, Jessica Moor, qui connaît bien la question, analyse avec finesse et clarté les caractéristiques psychologiques et sociales de cette plaie récurrente.
L’intrigue policière va tenir sa place, mais parallèlement et en alternance, c’est aux diverses formes de maltraitance que la lectrice et le lecteur sont confrontés : brutalité physique ou morale, violence ouverte ou insidieuse… Compagnes, épouses, filles sont en proie à l’emprise d’hommes qui n’ont pas forcément une conscience claire de leurs méfaits, ou au contraire dont la perversité a trouvé des cibles adéquates. En tout cas, Jessica Moor, qui connaît bien la question, analyse avec finesse et clarté les caractéristiques psychologiques et sociales de cette plaie récurrente.
Une analyse, certes, mais qui passe par le suspense narratif. Les chapitres intitulés « Avant » remontent dans le passé de Katie, dont on apprend qu’elle a dû changer d’identité, prise dans un piège masculin particulièrement retors ; et dans les chapitres intitulés « Maintenant », on suit le cheminement de l’enquête, dont la résolution nécessiterait que les pensionnaires disent tout ce qu’elles savent. Mais peuvent-elles parler, dévoiler ce qu’elles ont vécu, ce qu’elles ont vu, revenir sur des faits et méfaits qu’elles voudraient occulter et oublier ? À la fois victimes et détentrices de secrets, solidaires mais apeurées, elles restent souvent bloquées devant la parole révélatrice, comme Jenny, l’une d’entre elles, l’exprime à sa manière : « Je pourrais dire à ce flic ce qui s’est passé, le pourquoi et le comment. Il deviendrait mauvais, c’est sûr. Mais peut-être qu’il me croirait, à la fin, quand tout le reste aurait été nettoyé. Mais la mort a ses entrées partout. Je veux dire que c’est à ce moment-là que j’ai su que j’y arriverais pas. Mais peut-être que je le savais déjà. Depuis le début. Que j’allais jamais réussir à le faire, jamais réussir à venir en aide à Katie, jamais réussir à être aussi courageuse. » Les femmes qui craignaient les hommes est un roman dont la noirceur résonne au pluriel.
Jean-Pierre Longre
10:18 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, jessica moor, alexandre prouvèze, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/04/2022
Mère et fils
 Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022
Lire, relire... Édouard Louis, Combats et métamorphoses d’une femme, Éditions du Seuil, 2021, Points, 2022
Il a beau faire, beau dire, beau écrire, Édouard Louis n’en a pas tout à fait fini avec Eddy Bellegueule. Après son fameux livre de 2014, il a malgré tout pris en 2018 la défense de son père, violent mais maltraité par l’injustice sociale (Qui a tué mon père, Le Seuil), et trois ans plus tard il retrace ce qu’il appelle les « combats et métamorphoses » de sa mère.
Cette mère sur qui le malheur s’est acharné – deux maris au mieux indifférents, au pire violents, des grossesses répétées, la misère nourrie par l’alcool, la honte « de notre maison, de notre pauvreté »… Et malgré cela, la volonté de s’en sortir, la recherche d’un bonheur qui paraît illusoire, trompeur : « J’avais tellement l’habitude de la voir malheureuse à la maison, le bonheur sur son visage m’apparaissait comme un scandale, une duperie, un mensonge qu’il fallait démasquer le plus vite possible. » Pourtant elle le trouvera en rompant avec la résignation, en se rapprochant de son fils, en trouvant un emploi, en s’installant à Paris avec un nouveau compagnon, en s’adaptant à la vie citadine jusqu’à transformer son langage, en rencontrant d’autres gens (même Catherine Deneuve, le temps de fumer une cigarette avec elle !).
 Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.
Par petites touches mémorielles, en faisant alterner la troisième personne narrative et la deuxième personne empathique, avec, comme des preuves visuelles, quelques photos en noir en blanc, Édouard Louis rend un tendre hommage à une mère avec laquelle il a partagé beaucoup de malheurs, quelques joies, et finalement le bonheur. « Comment le dire sans être naïf ou sans avoir l’air d’employer une expression toute faite, idiote : j’étais ému de te voir heureuse. » Certes, il a l’air de se défendre de faire de la littérature : « On m’a dit que la littérature ne devait jamais tenter d’expliquer, seulement illustrer la réalité, et j’écris pour expliquer et comprendre la vie. » Mais il suffit de quelques traces d’émotion, de quelques pages d’une poésie intense sur l’existence passée (voyez par exemple, un peu avant la fin, ces versets qui résonnent comme une incantation) pour que le témoignage sensible, l’hommage évocateur se transforment en œuvre littéraire.
Jean-Pierre Longre
23:37 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, autobiographie, francophone, Édouard louis, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/03/2022
Le théâtre ukrainien, bien vivant. « Nous sommes tous en errance »
 Dominique Dolmieu et Neda Nejdana (sous la direction de), De Tchernobyl à la Crimée, « Panorama des écritures théâtrales contemporaines d’Ukraine », éditions L’espace d’un instant, Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre, 2019
Dominique Dolmieu et Neda Nejdana (sous la direction de), De Tchernobyl à la Crimée, « Panorama des écritures théâtrales contemporaines d’Ukraine », éditions L’espace d’un instant, Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre, 2019
Qui en France connaît le théâtre ukrainien, mis à part quelques spécialistes et traducteurs ? Nicolas Gogol et Mikhaël Boulgakov (« auteurs russophones de Kiev ») sont peut-être dans les esprits, mais en ce qui concerne les auteurs d’aujourd’hui, « terra incognita » (Dominique Dolmieu). Il était donc grand temps que le public et les lecteurs francophones découvrent l’écriture dramaturgique contemporaine de ce pays divisé « entre l’Occident et l’Orient, la liberté et le totalitarisme », de ce pays « polyethnique et polyglotte » (Neda Nejdana). Ce peut être chose faite, grâce à la Maison d’Europe et d’Orient et aux Journées de Lyon des auteurs de théâtre. Cette belle et vaste anthologie « tente tout autant de faire découvrir des auteurs européens majeurs que de parcourir les différentes tendances esthétiques qui composent son paysage dramaturgique, farce absurde, tragi-comédie populaire, lyrisme, légende poétique, farce politique télévisuelle, théâtre d’objets… ». Et elle y parvient, avec ces neuf pièces qui, effectivement, reflètent la diversité d’un théâtre décliné sur tous les tons, et qui sont réparties en quatre sections :
« La catastrophe du siècle » (celle de Tchernobyl – ou Tchornobyl dans la langue originale), un « malheur » pour les uns, une « attraction » pour les autres, comprend deux textes : Au début et à la fin des temps, de Pavlo Arie, caractérisé entre autres par un va-et-vient entre passé et présent, et Les fugitifs égarés, de Neda Nejdana, qui combine dialogues et monologues. Point commun : l’action des deux pièces se déroule dans la « zone interdite », et met en scène le désarroi de personnages qui s’y trouvent et s’y rencontrent plus ou moins volontairement ; en résumé : « Nous sommes tous en errance. ».
Sous le titre « Au temps des changements », sont présentés L’Hymne de la jeunesse démocratique de Serhiy Jadan, Miel sauvage d’Oleh Mykolaïtchouk et En direct d’Oleksandr Irvanets. En commun, là aussi, un désarroi qui saisit les personnages, d’une manière tragique ou absurde, voire humoristique, et qui a pour source les transformations de la vie économique, sociale, sociétale : comment se débrouiller avec ce passage si rapide entre dictature communiste et libéralisme sauvage, entre contrainte collective et liberté individuelle ? Tout cela peut se résumer par le côté absurde d’un néologisme : le « multiplundisme » : « Après la toxicomanie, la prostitution, l’inflation et les interférences, il s’est avéré qu’il caractérise aussi notre société. ».
« Maïdan, une révolution », avec Le labyrinthe d’Oleksandr Viter et En détail de Dmytro Ternovyi, rappelle les événements que tout le monde a en mémoire, vus par des victimes de la répression, de simples témoins plongés dans l’action, voire des objets qui s’animent, qui parlent et qui se confrontent aux tracasseries administratives. Les occupants du Maïdan sont-ils forcément des révolutionnaires ? Non. « Nous sommes des gens normaux et paisibles, qui voulons vivre une vie normale. Parce qu’il y a des droits fondamentaux : le droit à la vie et le droit à la liberté. ».
Les deux derniers textes sont regroupés dans la section « À l’intérieur et au-delà du monde » : une pièce traduite du tatar, Arzy, légende tatare de Rinat Bektashev, où dialoguent, en vers ou en prose, aussi bien des hirondelles que des personnages mythiques comme Ali Baba ; et un « Mystère psychologique en deux actes », L’Évangile selon Lucifer d’Anna Bagriana, où le passé tragique du pays est évoqué par différentes voix, dont certaines rappellent les quatre évangélistes du Nouveau Testament.
Ces 500 pages foisonnantes illustrent la vivacité du jeune théâtre ukrainien, un théâtre qui met en scène aussi bien les soubresauts de l’Ukraine moderne que les drames du passé (stalinisme, « Holodomor » ou « extermination par la famine », lutte contre le nazisme…). Un théâtre dont la variété est symptomatique de l’écriture contemporaine, et qui manie aussi bien le pathétique que la distance humoristique, l’absurde intemporel que la satire politique, une satire qui pourrait concerner plusieurs pays d’Europe orientale et d’ailleurs : « C’était il y a dix ans qu’ils étaient des bandits. Maintenant, ils sont au pouvoir ; députés, hommes d’affaires, et j’en passe. ». Voilà l’un des aspects majeurs du théâtre : un art complexe et complet susceptible de faire réagir.
Jean-Pierre Longre
Les pièces, les auteurs et les traducteurs : Au début et à la fin des temps, de Pavlo Arie; Les Fugitifs égarés, de Neda Nejdana; L’Hymne de la jeunesse démocratique, de Serhiy Jadan; Miel sauvage, d’Oleh Mykolaïtchouk; En direct, d’Oleksandr Irvanets; Le Labyrinthe, d’Oleksandr Viter; En détail, de Dmytro Ternovyi; Arzy, légende tatare, de Rinat Bektashev; L’Évangile selon Lucifer, d’Anna Bagriana. Textes traduits de l’ukrainien, du russe et du tatar de Crimée par Estelle Delavennat, Maxime Deschanet, Iryna Dmytrychyn, Bleuenn Isambard, Shirin Melikoff, Aleksi Nortyl, Iulia Nosar, Ömer Özel et Tatiana Sirotchouk.
http://www.sildav.org/editions-lespace-dun-instant/presen...
09:31 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, ukraine, dominique dolmieu, neda nejdana, pavlo arie, serhiy jadan, oleh mykolaïtchouk, oleksandr irvanets, oleksandr viter, dmytro ternovyi, rinat bektashev, anna bagriana. estelle delavennat, maxime deschanet, iryna dmytrychyn, bleuenn isambard, shirin melikoff, aleksi nortyl, iulia nosar, Ömer Özel, tatiana sirotchouk, l’espace d’un instant, les journées de lyon des auteurs de théâtre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/03/2022
Risques épistolaires
 Lire, relire… Philippe Besson, Se résoudre aux adieux, Julliard, 2007, 10/18, 2008, Pocket, 2022
Lire, relire… Philippe Besson, Se résoudre aux adieux, Julliard, 2007, 10/18, 2008, Pocket, 2022
Abandonnée par l’homme qu’elle aimait, Louise parcourt le monde (Cuba, New York, Venise, Paris), en quête d’on ne sait quoi : l’oubli (de soi, de l’autre) ? le renouveau ? la certitude ? Mais elle sait bien qu’aimer, « c’est prendre des risques ». Apparemment, elle tente de les reprendre, ces risques, par correspondance. Le livre entier est composé des lettres que depuis ses résidences lointaines elle adresse à Clément.
 Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.
Ces lettres rassemblent « les pièces dispersées d’un puzzle », celui de la vie amoureuse, des instants de bonheur et de doute, elles effectuent des retours sur un passé en dents de scie, sur la vie à deux, sur la solitude. Roman épistolaire à sens unique (aucune réponse ne parviendra, Louise en est vite persuadée), Se résoudre aux adieux tisse des variations sensibles et subtiles sur la désillusion, sans fermer la porte à l’espoir.
Jean-Pierre Longre
10:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : : roman, francophone, philippe besson, julliard, 1018, pocket, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
13/03/2022
Roman noir dans l’hiver blanc
 Ragnar Jónasson, La dernière tempête, traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Éditions de La Martinière, 2021, Points, 2022
Ragnar Jónasson, La dernière tempête, traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Éditions de La Martinière, 2021, Points, 2022
Ce roman est à la fois le dernier et le premier de la trilogie La dame de Reykjavík, puisque l’auteur avait commencé par la dernière enquête de Hulda Hermansdóttir (La dame de Reykjavík), poursuivi avec L’Île au secret, dont l’action se déroule quinze ans auparavant, c’est-à-dire en 1997 ; et nous voici encore dix ans en arrière (1987-1988) avec La dernière tempête… Nous retrouvons donc Hulda, en proie à ses problèmes familiaux et à ses scrupules de policière, et renouons avec l’art du suspense savamment entretenu par Ragnar Jónasson.
Noël 1987. Dans une ferme complètement isolée du lointain Est islandais, en pleine tempête de neige bloquant tout accès au village le plus proche, un couple reçoit la visite inopinée et inquiétante d’un homme au comportement étrange. Électricité et téléphone coupés, Erla et Einar, qui se demandent comment l’homme a pu parvenir jusque-là (il prétend s’être perdu au cours d’une partie de chasse entreprise avec des amis, ce qui leur paraît invraisemblable), vont vivre une tragédie dont les tenants et aboutissants ne seront révélés qu’à la fin de l’histoire. Sans compter qu’une autre question se pose : où est Anna, leur fille, dont ils attendaient la visite pour le réveillon ?
 Février 1988. Hulda, confrontée à un drame familial dont il a été question dans le premier volume de la trilogie, et qui a enquêté tant bien que mal et sans résultat probant sur la récente disparition d’une jeune fille, est envoyée sur les lieux de la tragédie du couple Erla-Einar. Dans la ferme, on a découvert les cadavres du mari et de la femme, visiblement assassinés il y a plusieurs semaines, au moment de Noël (puisque les préparatifs de la fête sont restés en place), et on se met à chercher, dans le gel et la neige, des traces du meurtrier. D’autres surprises macabres attendent les enquêteurs, et des rapprochements vont s’opérer.
Février 1988. Hulda, confrontée à un drame familial dont il a été question dans le premier volume de la trilogie, et qui a enquêté tant bien que mal et sans résultat probant sur la récente disparition d’une jeune fille, est envoyée sur les lieux de la tragédie du couple Erla-Einar. Dans la ferme, on a découvert les cadavres du mari et de la femme, visiblement assassinés il y a plusieurs semaines, au moment de Noël (puisque les préparatifs de la fête sont restés en place), et on se met à chercher, dans le gel et la neige, des traces du meurtrier. D’autres surprises macabres attendent les enquêteurs, et des rapprochements vont s’opérer.
La structure du roman est révélatrice de l’habileté narrative de Ragnar Jónasson. L’alternance des récits, des points de vue, des lieux, des périodes est propice à un suspense auquel le lecteur ne peut pas échapper. Il y a, certes, l’intrigue – ou plutôt les intrigues, prenantes et angoissantes à souhait –, mais il y a aussi la manière de mener ces intrigues, une manière qui relève davantage du roman noir que du roman policier classique. L’auteur a prouvé, par la diversité de ses œuvres, qu’il est un maître dans les deux domaines. Avec, ici, comme pour mettre en relief la noirceur du roman, le blanc pénétrant de l’hiver tourmenté.
Jean-Pierre Longre
22:42 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, ragnar jónasson, jean-christophe salaün, Éditions de la martinière, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
25/02/2022
Saisir l’instant
 Martine-Gabrielle Konorski, Adesso, “Une ballade italienne”, Black Herald Press, 2021
Martine-Gabrielle Konorski, Adesso, “Une ballade italienne”, Black Herald Press, 2021
Le titre l’annonce : il sera question du « maintenant » surgissant des paysages et des personnages qui rythment et peuplent les courtes proses narratives, descriptives, évocatrices, poétiques composant ce lumineux recueil. Des paysages où la silhouette de Pier Paolo Pasolini se dessine – et les citations qui ouvrent et ferment le livre le rappellent ; des personnages de toutes sortes, en nombre ou solitaires, qui baignent dans la chaleur et la lumière du littoral d’Italie du Sud.
La joie de vivre, le bonheur, la « quiétude », saisis dans l’instant dès l’ouverture, sont comme une tonalité dominante (sans oublier celle des chansons qui passent çà et là). La foule est « magnifique », « il fait bon vivre sous les figuiers et les palmiers », même si on est « à l’à-pic de la mer », et si à Ostie, « sur cette plage est mort Pier Pasolini. » Il y a maintes séquences, maintes histoires racontées ou ébauchées, imbriquées les unes dans les autres, « des histoires qui se tissent en un récit à la fois réaliste et un peu fou, telle une pièce de tissu mal cousue, un tableau authentiquement poignant. » Ce sont des vies esquissées, celles des familles, celles du peuple, celles des amis et des amoureux.
Mais il ne s’agit pas que de récits et de descriptions. Le bonheur est fait des vibrations de l’atmosphère, d’impressions fugitives, de sensations mêlées : les odeurs de la plage et de la cuisine, la chaleur de l’air et la fraîcheur de l’eau, les cris des enfants et des mouettes, la couleur de l’eau et les rayons du soleil. Et de tout cela naît une sensualité teintée de mystère, et par-dessus tout l’amour : « Elle, Lui, dressés au sommet du monde, au-dessus de l’eau. » Les détails ébauchés, les évocations suspendues, la musique des phrases et la couleur des mots – tout cela fait de cette symphonie aux apparences narratives une mosaïque poétique.
Jean-Pierre Longre
19:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : proses, poésie, francophone, italie, martine-gabrielle konorski, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/02/2022
Comment combler le vide
 Brèves n° 119, 2021
Brèves n° 119, 2021
La première nouvelle de ce numéro, signée Georges-Olivier Châteaureynaud, aurait paru carrément étrange il y a seulement trois ans. Mais après des périodes de confinement, de désertification de nos rues et de nos places, elle l’est beaucoup moins, même si elle pousse à l’extrême – et c’est là l’un de ses intérêts – la disparition de la vie humaine dans un décor urbain naguère familier, dans le métro en particulier : « Si je n’étais pas ennemi de la solitude, celle dont je pris alors conscience m’effraya. Je regrettai subitement ces milliers, ces millions d’importuns que j’avais si souvent détestés, voyageant avec eux flanc à flanc, le nez dans les pellicules de leur col, les côtes labourées par leur parapluie, les oreilles cassées par les tchikaboums de leurs smartphones mal réglés. »
La solitude, voire le désespoir seraient-ils un fil conducteur parmi les récits qui suivent ? En tout cas, à travers leur diversité, voire leur éclectisme, on peut déceler une intention : celle de combler des vides – ceux de la vie, de la vieillesse, du malheur, de la mort. Ce peut être une touchante rencontre au cimetière, un souvenir d’amour, une confrontation avec une chouette effraie, la terrible vengeance de « charmants bambins », la course d’un jeune garçon vers la construction d’une cathédrale moderne, un abandon à la lenteur musical, une bizarre invasion du monde par des extra-terrestres…
Et comme dans tout numéro de Brèves qui se respecte (en réalité, c’est le cas de tous les numéros), le lecteur peut faire la connaissance biographique et littéraire de nouvellistes confirmés. Ici, Charles Torquet (1864-1938), présenté par Éric Dussert qui a choisi la nouvelle « Les mystères de la bibliothèque » à la chute… rocambolesque, puis Felicitas Hoppe (née en 1960), s’entretenant avec Michel Ots, qui a choisi et traduit la nouvelle « Pravda ». Le tout complété par les recensions de parutions récentes.
Prenons notre temps, le temps de lire des récits brefs et denses, et la vie sera moins vide. Brèves est toujours là pour nous y aider.
Jean-Pierre Longre
Les auteurs:
Georges-Olivier Châteaureynaud, Roland Goeller, Sylvie Daffix, Ernest Fourachault, Jean-Pierre Fouilleul, Monique Romagny-Vial, Jacques Rimbert, Michèle Gerber Claret, Michel-Georges Ferrer, Dan Goetzinger, Williams Exbrayat, Xavier Lapeyroux, Charles Torquet, Felicitas Hoppe
Brèves, 1, rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude
Tél. 04 68 69 50 30 ou 06 28 07 51 81
https://www.pollen-difpop.com/article-8529-breves.aspx
19:45 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, francophone, brèves, atelier du gué, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
17/02/2022
Un passé retrouvé : des nouvelles de Marcel
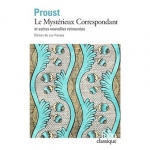 Marcel Proust, Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles retrouvées. Textes transcrits, présentés et annotés par Luc Fraisse, Gallimard, Folio classique, 2021.
Marcel Proust, Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles retrouvées. Textes transcrits, présentés et annotés par Luc Fraisse, Gallimard, Folio classique, 2021.
Il avait vingt-cinq ans, et il avait déjà écrit un certain nombre de textes. En 1896, Marcel Proust publiait son premier livre, Les Plaisirs et les Jours, recueil de textes poétiques, narratifs, descriptifs… Il n’y avait pas inclus quelques nouvelles restées à l’état de brouillon, publiées seulement en 2019 par les Éditions de Fallois, et reprises dans ce volume, accompagnées d’annotations et d’annexes substantielles minutieusement élaborées par Luc Fraisse, un connaisseur…
Si ces nouvelles, on s’en aperçoit vite, ne sont pas complètement abouties, si elles contiennent quelques maladresses et approximations formelles, elles sont le creuset de ce que deviendra l’écriture de Proust dans À la Recherche du Temps perdu. Comme l’indique Luc Fraisse dans sa préface, « Nous y apercevons l’écrivain au moment où son entreprise littéraire, qui prendra progressivement forme en continuité jusqu’à la Recherche, commence. » Sur des tons divers, ces textes esquissent des motifs que l’œuvre ultérieure développera : l’amour – plus particulièrement l’homosexualité, féminine ou masculine –, le rôle de la mémoire, l’éloge de l’affection des femmes, le génie musical (« C’est l’âme vêtue de son, ou plutôt la migration de l’âme à travers les sons, c’est la musique »), la suprême nécessité de l’art… On reconnaît par anticipation l’hypersensibilité du romancier à venir : « C’est ainsi qu’il avait aimé et souffert par toute la terre et Dieu changeait si souvent son cœur qu’il avait peine à se rappeler par qui il avait souffert et où il avait aimé. » Et le style de la Recherche est déjà là, en germe, en une syntaxe sans doute moins construite, mais déjà soucieuse de suivre les méandres de l’esprit et du cœur.
Complétant ces proses, on peut lire des textes eux aussi « restés inédits jusqu’en 2019 » et que l’on peut considérer comme les « sources de La Recherche du Temps perdu », illustrés par des fac-similés de documents tels que les pittoresques « cris de Paris » notés par le concierge à qui Proust avait demandé de les écouter et de les noter. Le dossier comprend ensuite une biographie très détaillée, une solide bibliographie et les notices, notes et variantes relatives aux nouvelles. Il y en a donc pour tout le monde, dans cette édition d’un intérêt indéniable, à la fois abordable (à tous points de vue) et savante, qui s’adresse à tous les lecteurs, fervents de Proust ou simples amateurs.
Jean-Pierre Longre
19:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle, essai, notes, marcel proust, luc fraisse, gallimard, folio, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
10/02/2022
Singularités d’un foisonnant patronyme
 Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin, Le monde des Martin, Éditions de l’Olivier, 2022
Jean-Pierre Martin n’est pas Monsieur Ducon, loin s’en faut. Rappelez-vous ce texte de Jacques Prévert, chanté par Yves Montand, les Frères Jacques et sans doute quelques autres, où est contée l’histoire d’un homme triste, si triste parce qu’il s’appelle Ducon, et qui, ayant découvert dans un vieux Bottin qu’il est « le seul Ducon », change complètement d’humeur et « poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin. » À l’opposé, il y a les Martin, qui « pullulent », « essaiment », « se multiplient ». Pour leur malheur ? En tout cas pour le bonheur du lecteur plongé dans l’ouvrage du prénommé Jean-Pierre qui, ne se contentant pas de son patronyme, l’étend à ses équivalents étrangers (Martins, Martinez, Martinson etc.). Mais rassurons-nous; sur le nombre incommensurable, et même s’il leur accorde plus de sept cents pages, il fait un choix : quarante et un chapitres consacrés à autant (disons un peu plus) de Martin, c’est déjà une épopée, un monument d’érudition, un multiple voyage dans le temps et dans l’espace.
Il avoue que « Nous, les Martin, nous formons un monde. Un monde inconnu de lui-même. » Son « Grand Récit » s’adresse donc aussi, et peut-être avant tout, à sa grande famille patronymique, où se sont illustrés voyageurs et baroudeurs, créateurs et découvreurs, mais aussi « Saints et Soldats plus souvent qu’à leur tour », à l’image du fameux Martinus (IVe siècle), celui que le geste de partager son manteau a rendu célèbre… Ce qui n’empêche pas l'hommage rendu à Sainte Martine, vierge et martyre du IIIe siècle – qui a donc précédé son pendant masculin… Si le « saint fondateur » est bien présent, il y a aussi le souci de rendre justice à des Martin méconnus et pourtant eux aussi fondateurs, en tout cas inventeurs : deux chapitres intitulés « L’invention de l’Amérique » consacrent Joseph Plumb Martin (« Martin yankee ») et Joseph Martin (« Martin cherokee »), un autre, intitulé « Naissance de l’Australie », évoque James Martin (ne pas confondre avec un autre James Martin, évadé de Botany Bay)…
C’est dire leur importance, voire leur puissance de création. Impossible évidemment (et inutile) de reprendre ici toutes les trouvailles, tous les détails historiques qui rythment ces pages. Je m’arrêterai un instant sur le chapitre consacré à Claude Martin, « dit le Major Martin », que les Lyonnais connaissent surtout comme le « fondateur de La Martinière », ces lycées dont il avait demandé la création dans son testament. On sait moins qu’il fut un grand voyageur, un aventurier, « négociant, financier et promoteur » : « Le sens des affaires, l’esprit d’entreprise qu’il se découvre doivent l’étonner lui-même. » Autre domaine : le Martin (Jean-Pierre) musicien ne pouvait faire l’impasse sur le Martinů (Bohuslav) compositeur, le « quatrième mousquetaire tchèque » (avec Dvořak, Janáček et Smetana), dont la biographie mouvementée (entre sa Bohême natale, Paris, New-York…) est à l’image de l’œuvre, abondante et multiple, en dehors des écoles et des modes – une originalité qui ne doit pas être pour déplaire à la tribu des Martin.
« Sept mille soixante-quatorze Martin, sans compter les disparus » : ils mériteraient d’être tous nommés, ces Martin morts dans les batailles et les tranchées de la guerre de 1914-1918 ; mais la liste en est si longue ! Hommage collectif, donc, et particulier pour Nelly Martin, une « diva » (pseudonyme Nelly Martyl), qui s’est engagée comme infirmière « sous la mitraille ». Et en matière d’engagement, nous avons deux Henri Martin représentant deux bords radicalement opposés, deux conceptions entre lesquelles l’auteur a manifestement choisi la deuxième (à bon escient), celle qui a produit le « saint laïc » en lutte contre le colonialisme et participant au roman national. Écoutez ce double hommage : « Dans mon lignage, tu es à la fois le contraire et le double de Thérèse Martin, dite de Lisieux : toi, Henri, le petit soldat réfractaire, et elle, Thérèse, la petite sainte de province, vous êtes deux icônes de notre tradition nationale. Vous appartenez à deux mémoires cloisonnées, vous plantez vos drapeaux dans deux régions antipodiques : les lendemains qui chantent ici-bas et le paradis du Très-Haut. » Cela dit, comme les Jean-Pierre (j’en connais plusieurs) ou les Jacques (même remarque), les Henri foisonnent ; outre les précédents, un peintre, un historien et homme politique (cher aux amateurs de Monopoly), et bien d’autres qu’il aurait été fastidieux de recenser, et qui ne le sont pas.
Jean-Pierre Martin (notre auteur) n’a vraiment pas rechigné. Son livre est le fruit, n’en doutons pas, d’un travail colossal, de recherches rigoureuses (livres, journaux, archives), de pêche en eaux profondes (martin-pêcheur… facile). Mais il ne s’agit pas que de cela. Jean-Pierre Martin est un écrivain, et même si l’on peut lire son livre « à sauts et à gambades », nous avons affaire à un roman riche en péripéties et en ramifications, ou à une série de romans qui, comme les Martin, peuvent se reproduire et se multiplier à l’infini.
Jean-Pierre Longre
19:04 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, biographie, histoire, francophone, jean-pierre martin, Éditions de l’olivier, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
07/02/2022
L’art en mouvement
 Les Carnets d’Eucharis, Sur les routes du monde #3, 2021
Les Carnets d’Eucharis, Sur les routes du monde #3, 2021
Les Carnets d’Eucharis, c’est une belle revue à lire comme voyageait Montaigne, sur des modes divers et par étapes curieuses. Montaigne dont il est question avec d’autres, (Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Flaubert…) sous la plume de Patrick Boccard, Montaigne, l’un des premiers à pratiquer l’écriture « nomadisée » qui forme le thème du premier dossier de ce numéro. « Sur les routes du monde », nous rencontrons Nicolas Bouvier (avec Jean-Marcel Morlat), Lorenzo Postelli (avec Zoé Balthus), Homère, Kerouac, Lacarrière, Tesson etc. (avec P. Boccard), et nous suivons les itinéraires poétiques, descriptifs, narratifs, souvent illustrés, de Nicolas Boldych (à « Rome-en-Médoc »), Jean-Paul Bota (à Lisbonne), Zoé Balthus (au Japon), Jean-Paul Lerouge (en Ouzbékistan) – et nous nous imprégnons des pages que l’on découvre comme les écrivains-voyageurs se sont imprégnés des lieux qu’ils ont explorés.
Un autre dossier, coordonné comme le précédent par Nathalie Riera, est consacré à des « portraits de poètes et d’artistes », après un portfolio consacré à de vivantes « figures de la danse » (instantanés numériques de Zagros Mehrkian sur des chorégraphies d’Estelle Ladoux et Nathalie Riera). Comme entraîné dans ce mouvement, le premier portrait est consacré à Pina Bausch (par N. Riera) ; puis s’avancent Pierre Reverdy (présenté par Alain Fabre-Catalan), Pippo Delbono (par Martine Konorski), Gérard Titus-Carmel (par Claude Darras), Ilse Garnier (par Marianne Simon-Oikawa) et Kathleen Raine (par Martine Konorski). C’est encore de Kathleen Raine qu’il est question dans le premier des entretiens « à claire-voix » qui suivent : Michèle Duclos, sollicitée par Martine Konorski, analyse entre autres la conception de l’art à laquelle tenait l’écrivaine britannique (« L’art est la cité de l’âme ») ; puis c’est Armelle Leclercq qui interroge Camille Loivier, dont un beau poème est reproduit. Plus loin, un autre entretien s’attarde sur « une bibliothèque en mouvement » : celle de Jean-Paul Thibeau qui, questionné par Barbara Bourchenin, s’interroge (comme jadis Georges Perec) sur son « faire-bibliothèque », un espace qui est « une invitation à différentes expériences de lectures, d’écritures », et aussi « un lieu de jubilation, d’effervescence, de jouissance et de créativité. »
 Entretemps, « Au pas du lavoir » (beau programme annonçant la pureté du mouvement) nous aura donné des poèmes de Christophe Lamiot Enos, Irina Bretenstein, Gérard Cartier, Geneviève Liautard, Jennifer Grousselas, Michèle Kupélian, et « ClairVision » des « écrits contemporains sur les arts visuels & audiovisuels » par Richard Skryzak qui s’entretient avec Dominique Pautre (de l’atelier duquel sont montrées des vues colorées), après quoi Carla Lonzi, « critique en dissidence », est présentée par Nathalie Riera. Enfin les poèmes de Naomi Shihab Nye (traduits par Geneviève Liautard) et de Parizia Valduga (traduits par Jean-Charles Vegliante) sont suivis, dans un tranquille et ultime mouvement (« Et banc de feuilles descendant la rivière ») par des notes de lecture sur des parutions récentes de Paolo Rumiz, Adrienne Rich, Paul Stubbs, Martin de la Soudière, Nietzsche et Leonardo Sciascia.
Entretemps, « Au pas du lavoir » (beau programme annonçant la pureté du mouvement) nous aura donné des poèmes de Christophe Lamiot Enos, Irina Bretenstein, Gérard Cartier, Geneviève Liautard, Jennifer Grousselas, Michèle Kupélian, et « ClairVision » des « écrits contemporains sur les arts visuels & audiovisuels » par Richard Skryzak qui s’entretient avec Dominique Pautre (de l’atelier duquel sont montrées des vues colorées), après quoi Carla Lonzi, « critique en dissidence », est présentée par Nathalie Riera. Enfin les poèmes de Naomi Shihab Nye (traduits par Geneviève Liautard) et de Parizia Valduga (traduits par Jean-Charles Vegliante) sont suivis, dans un tranquille et ultime mouvement (« Et banc de feuilles descendant la rivière ») par des notes de lecture sur des parutions récentes de Paolo Rumiz, Adrienne Rich, Paul Stubbs, Martin de la Soudière, Nietzsche et Leonardo Sciascia.
Voyages au fil du temps, des routes et de l’eau, danses des corps et des mots, portraits en action, images vives, rien de ces pages ne peut nous laisser dans l’immobilité de l’indifférence.
Jean-Pierre Longre
10:08 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, poésie, entretiens, image, voyage, francophone, traductions, les carnets d’eucharis, nathalie riera, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
04/02/2022
« La musique de l’inconnaissable »
 Jean Poncet, La vie profonde, Polaroïds de Pierre Guimet, préface de Adam Katzmann, Jacques André éditeur, 2021
Jean Poncet, La vie profonde, Polaroïds de Pierre Guimet, préface de Adam Katzmann, Jacques André éditeur, 2021
Dans sa préface, Adam Katzmann joue sur le mot « vie », rappelant que, autant que de la « vita » latine, il peut venir de « via », la voie, et a gardé cette acception dans certaines régions. Oui, la « vie profonde » est un chemin creusé entre passé et avenir, entre ténèbres et lumière, entre ignorance et connaissance, « tendue toujours vers / cette clarté lointaine / insaisissable », permettant de « mesurer l’éternité / à l’aune de la mémoire ».
Ce précieux petit recueil, ponctué par les clichés en noir et blanc de Pierre Guimet tout en suggestions, esquisses procurant quelques clés (réellement offertes à l’œil), mais laissant place aux envolées, à l’imaginaire et au rêve, ce précieux recueil, donc, « suit le cours du temps de l’âme », nous ouvre la « voie » vers « un usage médiumnique » de la poésie, sans faire abstraction des souvenirs (celui de la « mère morte », celui de « mon père », qui s’incarne dans « tous les vieillards de la ville »).
Car si « la poésie est un érémitisme », elle n’est pas en dehors du monde. Elle nous rappelle que celui-ci n'est pas forcément réjouissant, que la musique d’orgue jouée par un ancien bourreau nazi ne fera pas sécher le « Saint Sang de Dachau » ; qu’en Palestine, « la couronne a troqué ses épines / pour du fil barbelé ». Mais par-delà la souffrance et la mort, par-delà la diversité des religions, cathédrale, mosquée ou synagogue, Jean Poncet nous confie que « les mots des poètes » (qui « sont musique ») « disent la lumière de l’esprit ». La voilà, la vraie connaissance.
Jean-Pierre Longre
18:21 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, photographie, jean poncet, pierre guimet, adam katzmann, jacques andré éditeur, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
31/01/2022
Un conte enivrant et coloré
 Jim Dodge, Tom Haugomat, Fup (L’oiseau Canadèche), traduit de l’américain par Jean-Pierre Carasso, Tishina, 2021
Jim Dodge, Tom Haugomat, Fup (L’oiseau Canadèche), traduit de l’américain par Jean-Pierre Carasso, Tishina, 2021
Voilà un vrai conte, un beau conte pour adultes dans lequel les personnages sont de grands enfants. Tout commence par la chute tragique d’un avion et la mort de son pilote, suivie de la naissance de son fils, et tout finit par une naissance d’un autre ordre suivie d’un envol surprenant, et par une autre mort. Entretemps, nous suivons l’histoire merveilleuse et truculente, vive et rebondissante de quelques personnages pittoresques et originaux.
Il y a là Jackson Santee, dit Jake, ancien joueur invétéré, rétif à toute contrainte administrative, qui pense pouvoir trouver l’immortalité grâce à un whisky de sa fabrication, le « Vieux Râle d’Agonie » dont un vieil Indien lui a donné la recette et qu’il ingurgite à grandes lampées assis sur la galerie couverte de sa maison, entre deux escapades hors de son ranch ; il y a Titou, le petit-fils que Jake a recueilli quand il est devenu orphelin, au tempérament bien différent de celui de son grand-père. « Titou aimait la pureté franche et droite du jeu d’échecs. Pépé Jake penchait plutôt vers les jeux de cartes, dans lesquels on peut bluffer et garder des atouts dans sa manche » ; l’un est matinal, l’autre se réveille vers midi ; l’un « pêchait à la mouche », l’autre « avait toujours utilisé des asticots », etc. Mais ils s’entendent à merveille, grâce « à un accord de sang qui touchait le cœur de l’un comme de l’autre. »
 L’occupation principale de Titou, on ne sait pourquoi (puisqu’il n’y a pas de troupeaux à garder), est de couvrir la campagne environnante de clôtures plus belles et plus parfaites les unes que les autres – et c’est à cette occasion qu’il découvre un bébé canard qu’on va appeler Canadèche (« Cane à dèche – tu piges ? Canne à pêche : cane à dèche ! »). Outre quelques comparses, compagnons de jeu et de beuverie, rencontres occasionnelles, un quatrième personnage donne bien du fil à retordre (et des barrières à réparer) à Titou : le sanglier Cloué-Legroin, qui semble aussi solide et immortel que Jake… mais on ne racontera pas la fin.
L’occupation principale de Titou, on ne sait pourquoi (puisqu’il n’y a pas de troupeaux à garder), est de couvrir la campagne environnante de clôtures plus belles et plus parfaites les unes que les autres – et c’est à cette occasion qu’il découvre un bébé canard qu’on va appeler Canadèche (« Cane à dèche – tu piges ? Canne à pêche : cane à dèche ! »). Outre quelques comparses, compagnons de jeu et de beuverie, rencontres occasionnelles, un quatrième personnage donne bien du fil à retordre (et des barrières à réparer) à Titou : le sanglier Cloué-Legroin, qui semble aussi solide et immortel que Jake… mais on ne racontera pas la fin.
La narration brute et fraîche file son train à la fois fluide et tranquille, sans fioritures ni perte de temps. Un vrai beau conte qui enivre autant que le tord-boyaux de Jake, et un vrai beau livre tout en couleurs grâce aux nombreuses illustrations peintes de Tom Haugomat, qui apportent à l’histoire ce qu’il faut de pauses contemplatives. De grandes planches aux traits mouvementés ou paisibles, limpides ou mystérieux, alternent avec des séries de vignettes de type bande dessinée mettant l’accent sur des détails parfois insoupçonnés. Couleurs vives, formes simples et dynamiques, voilà qui, avec le récit de Jim Dodge, donne à ce livre unique une tonalité résolument artistique.
Jean-Pierre Longre
18:40 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, conte, peinture, illustrations, anglophone, jim dodge, tom haugomat, jean-pierre carasso, tishina, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
27/01/2022
Du poison et des cadavres
 Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021
Sophie Chabanel, L’emprise du chat, Le Seuil, 2020, Points, 2021
Léa Bernard, 23 ans, est découverte morte empoisonnée à son domicile. Visiblement, la jeune femme, dépressive, vivait seule et dans une absolue discrétion, consacrant scrupuleusement son temps à son travail intérimaire d’hôtesse d’accueil et à des ouvrages de broderie. Étonnant pour la commissaire Romano, son adjoint Tellier et accessoirement l’adjudant Clément, qui découvrent, renseignements pris, que Léa était « la jeune miraculée du vol AFI 587 », seule rescapée d’une catastrophe aérienne survenue au-dessus de l’Atlantique. Y aurait-il un lien entre ce crash et l’assassinat ? Les suppositions vont bon train, jusqu’au moment où l’on apprend que la victime a passé du temps à Genève comme hôtesse d’accueil d’une exposition prétendument pédagogique de cadavres plastinés.
La commissaire et son acolyte se rendent donc sur place, et découvrent peu à peu, outre les agréments de Genève et de son lac en été, un certain nombre d’éléments suspects concernant l’origine des cadavres exposés. Léa Bérard aurait-elle fait des découvertes dans le « marché du cadavre » qui se trame entre Chine, Russie, Europe (spécialement Genève et Annecy) ? L’enquête prend des dimensions insoupçonnées auparavant. « D’un côté, une demande qui explose, de l’autre, une offre qui stagne : c’est comme ça que naissent les circuits d’approvisionnement clandestins. ».
Malgré le côté macabre de l’intrigue (un autre assassinat va d’ailleurs avoir lieu), c’est avec un grand plaisir que nous retrouvons les personnages de Sophie Chabanel : Romano, qui, tout en étant harcelée par sa sœur en instance de divorce, ne vit que pour son travail mais ne dédaigne pas quelques plaisirs passagers, et qui est affublée d’un chat supplémentaire tout aussi destructeur que son comparse ; Tellier, ses scrupules, ses enfants et son moralisme rigide qui n’empêche pas son efficacité ; le divisionnaire Bertin, dont Romano moque volontiers le carriérisme forcené… L’emprise du chat est un polar au suspense prenant, à l’humour lucide, tantôt léger tantôt sans concession, aux allusions politiques claires et à l’engagement moral percutant. Une bonne lecture pour les frissons de l’âme, la détente de l’esprit et la moralisation de la conscience.
Jean-Pierre Longre
12:32 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, sophie chabanel, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
06/01/2022
Questions d’identité
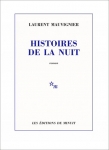 Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021
Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit, Les éditions de minuit, 2020, Minuit double, 2021
La trame de ces Histoires de la nuit a maintes fois été résumée, on ne répétera donc pas ici ce qui a déjà été écrit. Chez Laurent Mauvignier, le souffle de la syntaxe, les circonvolutions du style sont solidaires du récit, et inversement. En l’occurrence, l’intrigue aux apparences simples et aux allures de thriller est soutenue et étoffée par la voix de l’auteur qui laisse volontiers la place, en leur faisant écho, aux points de vue de ses personnages. Patrice le paysan, sa femme Marion au passé énigmatique, Ida leur fillette, Christine leur voisine artiste peintre, tous vivent dans le hameau isolé nommé « L’écart des trois filles seules » (nom mystérieux et légèrement angoissant). On suit chacun dans ses pensées et dans ses occupations d’une journée qui doit s’achever par la fête des quarante ans de Marion, jusqu’à l’irruption de l’inattendu et de l’effrayant, précédée par de mystérieuses lettres anonymes.
 Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »
Il y a la ligne principale du roman, qui tient de la tragédie classique (unités de lieu, de temps et d’action), et il y a tout ce qui converge vers cette ligne principale : les manques et les frustrations de Patrice, les agacements de Marion (sans parler de son passé que les intrus vont violemment faire ressurgir), les préoccupations artistiques et personnelles de Christine, qui revêtent dans le roman une importance symbolique et insoupçonnée : « Elle sait ça, elle cherche le moment où c’est la peinture qui la voit, ce moment où la rencontre a lieu entre elle et ce qu’elle peint, entre ce qu’elle peint et elle, et, bien sûr, c’est une chose qu’elle ne partage pas. » L’une des clés de cette histoire, c’est peut-être la petite Ida (elle-même involontairement au centre des péripéties) qui la détient inconsciemment : « Comme si, donc, tout à coup, on lui apprenait qu’elle est quelqu’un d’autre qu’Ida Bergogne, qu’on lui révélait que peut-être elle ne s’appelle pas Ida Bergogne, qu'elle n’a pas de nom, qu’elle n’est pas celle qu’on voit dans la glace tous les jours et que ses mains ne sont pas à elle, ni ses yeux, pas plus que sa bouche ou ses jambes. »
D’une manière détournée, voire insidieuse, les terribles aventures vécues par les personnages de Laurent Mauvignier, qui dans les journaux apparaitraient comme un fait divers, voilent et dévoilent l’interrogation que chacun se pose un jour ou l’autre : qui suis-je vraiment ?
Jean-Pierre Longre
09:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, laurent mauvignier, les éditions de minuit, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
28/12/2021
Pâques mortelles en pays froid
 Ragnar Jónasson, Sigló, traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Éditions de La Martinière, 2020, Points, 2021
Ragnar Jónasson, Sigló, traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Éditions de La Martinière, 2020, Points, 2021
Dans la tranquille bourgade de Siglufjördur (pour simplifier : Sigló), à l’extrême nord de l’Islande, l’inspecteur Ari Thór doit enquêter sur la mort suspecte (suicide ? accident ? meurtre ?) d’une toute jeune fille, Unnur, visiblement tombée d’un balcon. Nous sommes à la veille du week-end de Pâques, et Ari doit justement accueillir sa femme et son petit garçon venus de Suède pour ces quelques jours de congé – et voilà que les retrouvailles vont être gâchées… Les péripéties de l’enquête vont se mêler aux difficultés familiales.
L’enquête, justement : « Tout portait à croire que la jeune fille s’était jetée dans le vide. Tout portait à croire que son seul objectif avait été de quitter ce monde. Pour lui, c’était la conclusion la plus simple. Mais compte tenu des dires de la mère, une enquête approfondie s’imposait. » Ari, avec l’aide plus ou moins empressée de son second, Ögmundur, et grâce aux conseils de son ancien mentor, suit plusieurs pistes ouvertes par ses soupçons et par quelques personnages qui l’alertent : la mère de la victime, qui justement ne veut pas croire au suicide, un couple âgé et un jeune historien occupants de l’immeuble au pied duquel le corps a été retrouvé, un vieux pensionnaire de maison de retraite et les propriétaires de celle-ci, des camarades de classe de la jeune fille… Dans cette localité dont presque tous les habitants se connaissent, et où les touristes affluent pour les sports d’hiver, les investigations de l’inspecteur ne sont pas simples, les indices minimes, les hypothèses nombreuses.
Il est vrai que le lieu et l’atmosphère sont propices aux mystères : le froid, la neige, les coupures d’électricité, la tempête rebuteraient n’importe qui. Mais Ari supporte stoïquement tout cela, même si ses problèmes conjugaux viennent périodiquement le perturber. Il évolue presque à l’aise entre les écueils et mène scrupuleusement ses recherches, écoutant en particulier avec attention Salvör, la mère d’Unnur, et ne se contentant pas des apparences. « Tandis qu’il affrontait le vent saisissant du nord et les flocons qui tourbillonnaient autour de lui, Ari se demanda si l’enquête avait vraiment été résolue, comme il le croyait. Avait-il commis une erreur ? Tiré de mauvaises conclusions ? Que voulait lui dire Salvör, qu’est-ce qui pouvait bien être aussi urgent ? Tout s’était passé si rapidement. Cela ne faisait que quatre jours que le corps d’Unnur avait été retrouvé. » Ses questionnements laissent le champ libre aux surprises finales – marques d’un vrai polar à suspense.
Jean-Pierre Longre
19:06 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, ragnar jónasson, jean-christophe salaün, Éditions de la martinière, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/12/2021
La solitude d’une fleur bleue
 Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
Chloé Delaume, Le cœur synthétique, Le Seuil, 2020, Points, 2021. Prix Médicis 2020
« C’est l’histoire d’une fleur bleue qu’on trempe dans de l’acide. Adélaïde Berthel, c’est une femme comme une autre. Qui, à quarante-six ans, entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. » Une femme d’aujourd’hui, féministe et moderne, qui retrouve régulièrement un groupe d’amies partageant entre elles leurs problèmes sentimentaux, professionnels, existentiels – la « sororité » peut être un réconfort, mais ce n’est pas la panacée. Féministe et moderne, donc, mais, après plusieurs déboires amoureux, elle rêve de trouver enfin l’homme avec lequel elle partagera la deuxième partie de sa vie. Les tentatives sont peu concluantes. La « fleur bleue » devient « peur bleue », la « femme comme une autre » devient « faille comme une autre ».
Histoire banale d’une solitude mal assumée ? Cela se pourrait. Mais dans ce domaine, il n’y a pas de banalité. La plume de Chloé Delaume fait du destin d’Adélaïde un cas particulier, et nous suggère qu’en la matière chaque cas est bien particulier, chaque cœur aussi : « C’est le cœur d’Adélaïde, le héros de cette histoire. C’est lui qui cogne et saigne, exige et se déploie. C’est lui qui fait le deuil, englouti par le vide. » Car Adélaïde, elle, la femme de quarante-six ans, a par ailleurs d’autres vies : vie amicale, vie professionnelle : attachée de presse dans une importante maison d’édition, « passeuse », « elle doit aussi gérer les écrivains », ce qui s’accompagne de toute une série de contraintes, de déceptions, de mensonges, et ce qui donne l’occasion à l’autrice de savoureuses pages satiriques sur le monde de l’édition, rivalités et exigences commerciales, batailles d’égos et d’images…
 Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Le cœur synthétique n’est pas un roman sentimental. Ou s’il l’est d’une certaine manière (car oui, il y a du sentiment), il donne volontiers dans l’humour satirique (on l’a vu) et inventif (voir notamment les titres imaginaires de livres qu’Adélaïde a à défendre, comme Papa n’aime pas ses chrysanthèmes, Le Vagissement du minuteur, J’habite dans mon frigo etc.). Surtout, c’est un roman musical et poétique. Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson, et se lit comme une strophe ou un poème, avec reprises incantatoires et ce que Raymond Queneau (auteur entre autres des fameuses Fleurs bleues) appelait des « rimes de situation » (retour de personnages, d’événements ou de phrases, avec variation minimales). Sans compter que Chloé Delaume donne volontiers dans la prose rythmée, souvent en alexandrins (ou presque). Un exemple : « Elle se dira : Cet homme est hors de ma portée. Son cœur sera capable, alors, de l’oublier. C’est qu’il a tant vieilli, le cœur d’Adélaïde. Il accepte le réel, il sait se protéger. Il ne veut plus saigner, se préfère encore vide. » Humour, musique, poésie, le tout sur fond de quête amoureuse et de solitude. Voilà de quoi faire un roman original, vrai et beau. C’est réussi.
Jean-Pierre Longre
15:00 Publié dans Littérature, Littérature et musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, chloé delaume, le cœur synthétique, le seuil, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
14/12/2021
Van Gogh l’alchimiste
 Jos Roy, & dedans quantité de soleils; & inside, a great many suns, édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press, 2021
Jos Roy, & dedans quantité de soleils; & inside, a great many suns, édition bilingue, traduction anglaise de Blandine Longre et Paul Stubbs, Black Herald Press, 2021
Souvent, la mise en mots de la peinture tourne court, ou tourne mal : description purement et simplement technique des formes et des couleurs, tendance au rapport biographique, ou suite absconse de phrases indéchiffrables. Rien de tout cela avec Jos Roy. La difficulté de dire la peinture est en partie levée par la pratique d’une autre forme artistique, la poésie. Au lieu de mettre des mots sur la peinture, l’écriture se fait peinture, et en l’occurrence la vérité de Van Gogh se fait jour. Certes, « nous ne pouvons faire parler que nos tableaux », mais « la tâche / est de dire / le vrai / croquer le discours d’ocre&debleu ».
Dans ce long poème en vers plus ou moins réguliers, en strophes plus ou moins décalées, où l’esperluette, nœud musical et figuratif, se fait liant pictural et verbal, tout ce qui peut être dit de l’œuvre est révélé ou suggéré : formes, couleurs, matière, lumière, sens cachés, le chant aussi qui s’échappe de la toile, et même quelques rappels à propos du créateur : « je suis roux maigre à ma bouche il manque des dents qu’un parisien d’un autre temps rafistola ». Mouvements et sensations sont inséparables des gestes et des instruments : « dans les coulées d’ocre tendre / pas de limite entre le corps les tubes les brosses / faits de la même matière qui fait celle-ci ».
Et si les mots tentent de redire les paysages, eau, nuages, terre, village où domine « la haute note jaune », l’ocre puissant que rappelle le Chant de blé qui occupe la belle couverture du livre, c’est à la transformation du réel qu’oeuvrent de concert le matériau pictural et le matériau verbal : « toujours à galoper dans le réel pour saisir l’instant des / métamorphoses ». Transformation par « la jouissance des torsions » et par l’alchimie des couleurs : « depuis la fenêtre je suis dans le jardin de l’asile / de toutes mes chairs. je m’applique à fondre des couleurs / à la manière de l’or. ». « peinture réelle & peintre abstrait / quelle extraordinaire rencontre ! », disent les vers de Jos Roy. Cette extraordinaire rencontre, c’est aussi celle des secrets de la peinture et des mystères de la poésie.
Jean-Pierre Longre
09:45 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, peinture, francophone, jos roy, van gogh, blandine longre, paul stubbs, black herald press, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |

